|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
204, 205, 206,
207, 208, 209,
210, 211, 212,
213,
| |
|
EDITO
LES IDES DE MARS !
Les 28 petits jours du mois de février sont derrière nous et voici le mois de mars qui débute. Le mois de Mars c'est aussi le mois du changement avec le printemps comme apothéose, la nature se réveille, les parfums des fleurs embaument l'atmosphère. C'est aussi les fameuses ides, du milieu du mois de l'an moins 44 avant J.C., qui a vu la disparition de Jules César le " dictateur " qui a soumis la Gaule au régime romain.
Est-ce que le rêve est encore permis pour penser si les ides de 2021 réserveraient un sort à un autre " dictateur " afin de libérer son pays de l'asservissement auquel il l'a soumis ?
Quelle est la magie ou le prestidigitateur qui sera à la baguette pour cette chimérique pensée contre la dictature médicale, économique, policière, répressive, liberticide et décervelante par la pensée unique tout en laissant se développer une barbarie qui se banalise parce que l'excuse et la repentance sont devenues les psaumes de la " répoublique " ? Les fleurs et les marches blanches sont devenues la mode du plus jamais ça répétitif.
Sinon, ce pays connaîtra une nouvelle révolution ou une nouvelle soumission par l'invasion qui est bien en " marche ". Tous les jours, des tentatives ou meurtres sont commis sur le territoire sans que les médias en informent le public. Des territoires entiers sont occupés et soumis.
J'espère ne plus être là pour voir le désastre final après avoir déjà connu les journées mortelles des 18, 19, 23 et 26 mars 1962 qui ont scellé notre sort et l'exil inexorable.
A l'époque, nous, les jeunes sans avoir vraiment conscience du futur, étions prêts à mourir pour ce drapeau et ce pays qui nous en a bien remercié soit par un coup de pied au C.., soit par une balle dans la peau. Mais est-ce que la nouvelle jeunesse est prête à faire des sacrifices…. ?
Après ce petit " coup de gueule ", sortons les outils pour préparer ce prochain printemps et profitons encore un peu des bons moments familiaux ou entre Amis.
Amicalement et sincèrement.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
 Les ides de mars par Camuccini-
Les ides de mars par Camuccini-
|
|
C'ETAIT ENCORE L'ALGERIE FRANCAISE
Par M. Régis Guillem
|
MARS 1962 - LE MOIS DE TOUS LES MALHEURS
Le mois de Mars 1962 est le mois maudit de ces 8 années de terrorisme.
Il sonne le glas de l'Algérie Française ; que pouvions nous encore espérer après ces sinistres pseudo-accords déviants qui ouvraient de façon irrémédiable la voie à l'abandon de cette terre Française entièrement façonnée par un peuple composé de multiples nationalités venues pour en embrasser une seule : Française ; ce peuple qui face aux difficultés gigantesques, à force de persévérance, de sacrifices parvenait à sortir ce pays de l'époque moyenâgeuse pour en faire la figure de proue de l'Afrique, mais aussi le fleuron de la France.
Il débute dans l'horreur, l'ignominie et va être le reflet de ce qu'est le FLN, cette organisation terroriste à qui l'Etat Français va faire cadeau d'un pays où il ne poussait que des cailloux et à qui l'on va remettre sur un plateau un territoire digne d'un eldorado.
Mers-El-Kébir, banlieue oranaise. Le 1er mars 1962, tombait un jeudi. Il faisait le temps même de la vie, le temps qu'on imagine pour le Paradis. Un air doux et léger, un ciel aux profondeurs bleues à qui le soleil réservait sa plus fastueuse débauche de lumière, une senteur subtile de jardin laissait supposer une journée radieuse…
Il était environ 11h, un groupe de Musulmans encadré par des femmes fit irruption dans la conciergerie du stade de La Marsa, à Mers El-Kébir, tout près de la base militaire. Dans une véritable crise de folie meurtrière collective, ces hommes s'emparèrent de la gardienne, une européenne de trente ans, Mme Josette Ortéga et, sans la moindre raison, à coups de hache, la massacrèrent. Couverte de plaies affreuses, dans un ultime effort, elle tenta de s'interposer entre les bourreaux déchaînés et son petit garçon, mais en vain. Les tortionnaires déments frappèrent encore sous les yeux horrifiés du petit André, quatre ans, puis quand il ne resta plus qu'une loque sanguinolente, ils se saisirent de l'enfant et lui broyèrent le crâne contre le mur.

Leur forfait est accompli, ils s'apprêtaient à partir lorsque l'un des barbares se retourne et voit arrivé une petite fille avec des fleurs à la main. C'est Sylvette, 5 ans, qui est allée cueillir des fleurs.
Aussitôt il se rue sur elle, la roue de coups et pour l'achever, la saisissant par les pieds, la fracasse, tout comme son petit frère, contre un mur.
Quand M. Jean Ortéga, employé à la direction des constructions navales, franchit la grille du stade, le silence qui régnait le fit frissonner.
D'ordinaire, ses enfants accouraient, les bras tendus dans un geste d'amour. Une angoisse indéfinissable le submergea. Il approcha lentement, regarda autour de lui… puis, là, dans la cour, un petit corps désarticulé tenant encore dans ses mains crispées des géraniums, la tête réduite en bouillie, une large flaque de sang noirâtre tout autour.
Dès le lendemain les derniers défenseurs du drapeau tricolore entreprirent de venger cette boucherie inutile sur des innocents.
Ils furent vengés. Mais ils ne revinrent pas à la vie.
Ainsi débuta ce triste et sinistre mois de la honte de Mars 1962 qui conduisit à l'exode de tout un peuple.
La Métropole aussi connait ses drames.
Le 3 Mars 1962 : trois résistants Toulonnais trouvent la mort dans l'explosion de leur véhicule.
N'oublions donc jamais que des Métropolitains qui ne possédaient ni terre, ni réfrigérateur se sont battus pour que l'Algérie demeure Française.
Le F.L.N. poursuit inlassablement ses crimes qui atteignent le summum de l'horreur ; les enlèvements se poursuivent.
Le 4 mars 1962, Guy Lanciano et Daniel Falcone sont enlevés à Alger dans le quartier du Ruisseau. Pendant 41 jours ils subiront des tortures effroyables à la " Villa Lung ". On leur coupe le nez, les oreilles, on crève les yeux de l'un et l'on matraque l'autre qui perd l'usage de la parole.
- L'aveugle peut parler, le muet ne voit plus.
Ils seront libérés par un commando de l'OAS et remis aux services médicaux de l'armée française à l'hôpital Maillot. Leur état physique est tellement dégradé qu'on les garde longtemps... trop longtemps dans cet hôpital... jusqu'au mois d'avril 1963, période à laquelle la Croix-Rouge avise les familles de leur transfert à l'hôpital de Nancy par avion sanitaire.
JAMAIS ces familles ne les reverront ! ...
Le Sénateur Dailly interpelle de Broglie sur cette disparition. Réponse du Ministre : "L'affaire est sans doute compliquée : il subsiste quelques points obscurs. Je fais actuellement poursuivre sur le territoire national des recherches extrêmement poussées.
- Inutile de préciser que ces recherches - si elles ont vraiment eu lieu - n'ont jamais abouti...
L'OAS a conscience que son combat est celui du dernier espoir aussi elle redouble ses actions notamment en éliminant les tueurs du FLN libérés ou sur le point de l'être.
A Oran le 5 mars un Commando OAS prend d'assaut la prison et exécute 2 tueurs du FLN condamnés à mort mais graciés et en blesse 30 autres.
Le lendemain un autre Commando détruit les archives et dossiers des membres OAS inculpés en faisant sauter le troisième étage de la Préfecture d'Oran.
Entre le 6 et le 13 Mars l'ALN intensifie ses actions à la frontière tunisienne dans le seul but de faire fléchir la France.
Elle n'a pas besoin de cela car l'on sait parfaitement que de Gaulle a vendu l'Algérie.
Le 7 mars les négociations FLN-Gaullistes qui avaient été interrompues aux Rousses, reprennent à Evian.
L'OAS doit réagir avant que ne soient signés ces accords entre le Gouvernement Français et le GPRA.
A Oran le Général Jouhaud envisage une insurrection qui devra se faire autour de Tlemcen., il fixe la date du 11 mars 1962, Jouhaud dispose de l'infanterie de marine, de 3000 harkis, de tous les GMS, du cinquième étranger, d'un régiment de hussard.
Il tente de rallier le Commando Georges ; mais le Capitaine Georges GRILLOT s'y refuse et au contraire s'arrange pour une mutation en Métropole ; Jouhaud se retourne sur l'un des piliers du Commando Youcef qui se désiste également.
Il est prévu qu'un territoire soit ainsi libéré, et que l'O.A.S. demande à participer aux négociations d'Evian.
La date est fixée au 15 Mars.
Alger, informé, demande de retarder pour se coordonner avec le maquis de l'Ouarsenis, qui doit se mettre en place plus tard.
Le 13 mars 1962, Michel Debré répondant à une question du général Ailleret demandant si les musulmans perdront automatiquement la citoyenneté française déclare :
- " Oui s'ils demeurent en Algérie, mais s'ils reviennent en métropole après l'autodétermination, ils pourront reprendre la nationalité française et bénéficier des aides aux rapatriés. "
Puis se produit l'impensable en cette journée du 14 mars 1962 ; Pour la première fois, l'aviation française mitraille les terrasses d'Oran, à la demande du général Katz et sur ordre de De gaulle.
Pour réduire l'OAS maitre de la ville, Katz avait interdit toute présence sur les terrasses.
Jamais l'armée n'avait nulle part en Algérie mitraillée de telle façon une ville Européenne. Il est vrai que jusqu'en 1962, aucune d'entre elle n'était ouvertement FLN.
Et nous voici arrivés à la date de toutes les trahisons ; ce 18 mars 1962 sont signés des " accords d'Evian " par Krim Belkacem pour le GPRA et Louis Joxe, Robert Buron et Jean de Broglie pour la France.
o Un cessez-le-feu applicable le 19 mars à 12h
o Un programme commun d'intentions proposées à ratification par référendum (8 Avril en France et 1er Juillet en Algérie).
De Gaulle fait libérer Ben Bella le soir même; il prend immédiatement - avec ses collègues - l'avion pour Genève et déclare à la télé "c'est la solution du bon sens."
Les élus d'Algérie publient un communiqué "les populations d'Algérie se défendront elles-mêmes;"
Le sort des européens d'Algérie était scellé par l'article 2 du chapitre 2A qui permet aux européens de faire la demande de nationalité algérienne après les trois ans de la période temporaire.
Ils n'étaient donc pas de droit algériens, mais devaient obtenir l'accord du F.L.N., accord qui ne sera pratiquement jamais accordé. De plus cette nationalité n'est qu'une sous nationalité, celle d'un dhimmi en pays musulman.
L'armée française rentre aux casernes, l'article 5 prévoit qu'elle stationne de façon à éviter tout contact avec les forces du F.L.N. Un décret secret du gouvernement leur indique : "l'armée française ne pénétrera pas dans les zones fixées pour le stationnement des forces F.L.N. Tout contact avec les forces F.L.N. sera évité". Dans ses mémoires, le général Fourquet, successeur d'Ailleret en tire les conclusions : " … la sécurité diminue instantanément…"
La population Européenne n'étant plus protégée, l'O.A.S. décide l'implantation de maquis afin de remplacer l'Armée et assurer la protection des populations rurales.
Le Général Salan décide la création de maquis.
Le colonel GARDES implante un maquis dans le massif de l'Ouarsenis, sur un terrain favorable contrôlé par le Bachaga BOUALEM.
Le commando Albert du Sous-Lieutenant Giorgio MUZZATI, qui opérait dans le secteur, se renforce d'une centaine d'hommes venant d'ALGER.
Accroché par l'ALN, encerclé par l'armée française, mitraillé par l'aviation, l'aventure tourna court rapidement et prit fin le 10 Avril.
Un certain nombre de maquisards furent tués, principalement lors du combat contre l'ALN, d'autres plus nombreux furent fait prisonniers et le reste parvint à s'échapper.
Le Commandant Paul BAZIN - le Sergent SANDOR - AOUSTIN Pierre - BEVILAQUA Michel - ESCRIVA Roland - MARQUES Jean Claude sont tués au cours de l'accrochage.
En Oranie le Général Jouhaud donne l'ordre à Marc Peyras chef de l'Organisation de Mostaganem de créer un maquis dans les monts du Dahra.
Dès son implantation il assurera la protection de plusieurs communes et interviendra dans toutes les actions que ni l'armée, ni la gendarmerie n'assurent pour se conformer aux accords déviants.
Ses actions se montreront des plus efficaces et enrayera les attentats du FLN. Régulièrement les maquisards sont renseignés tant par les SAS, que par les chefs de 2 douars.
De Gaulle ce Général imposteur qui s'est imposé en 40 grâce et avec l'appui des Communistes, ce général adulé par les Français qui sans doute ignorent toutes ses trahisons, ce général d'opérette qui a sur les mains le sang de milliers de Français, celui qui est considéré par l'un des plus grands journalistes politologues français comme le plus grand traitre de la 5ème République.
Sur les ordres de De Gaulle Pierre Messmer donnera l'ordre à compter du 19 mars de désarmer tous les Harkis et Moghzanis les livrant ainsi à la vindicte des égorgeurs qui leur feront subir les pires atrocités indescriptibles.
Les populations musulmanes qui pour leur grande majorité étaient pro-françaises comprennent qu'elles subiront le même sort que les Harkis.
Voulant se racheter elles commettront les pires atrocités dont le summum de l'horreur fut atteint à Oran le 5 juillet 1962.
Ces assassins de dernière heure seront désignés les " marsiens " par leurs propres compatriotes.
Les premiers Harkis désarmés subiront à Saint-Denis du Sig, village Oranien, l'assaut des barbares ; les Harkis se défendront avec acharnement mais leur courage n'empêcha pas la mort d'une centaine d'entre eux.
Quelques Officiers enfreindront les consignes et au risque de leur carrière embarquent à destination de la France les familles des Moghaznis sous leurs ordres.
Malgré la précipitation des évènements et le danger qui les guette plusieurs Douars d'Oranie manifestent leur attachement à la France.
Le 21 mars à Djeniene Meskine, sur la route d'Oran à Sidi-Bel-Abbès deux délégations sont descendues respectivement de la Cité et du douar. Tous les hommes du village, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, suivaient les porteurs de drapeaux tricolores et scandaient " Algérie française " tous se dirigeant vers la mairie. En cours de route, des Européens du centre et des ouvriers, de la C.A.D.O., toute proche, se joignaient aux manifestants. Et ce fut bientôt un millier de personnes qui stationnaient devant la mairie. Puis, dans un silence impressionnant, devant toute cette foule figée au garde-à-vous, le grand drapeau tricolore était monté au haut du mât, hissé par deux employés municipaux, un Européen, et un Musulman... Puis une femme musulmane, prenant la parole, exhortait, en français et en arabe, tous ses concitoyens à la fraternisation. Pour finir, une vibrante Marseillaise réunissait, d'une même voix et d'un même cœur, les deux communautés, réunies comme autrefois.
On pouvait donc encore voir se rassembler Européens et Musulmans sous les plis de notre emblème, malgré le F .L.N. Malgré le F.L.N., car la veille, trois rebelles étaient venus commettre des actions terroristes. Surpris par un groupe de G.M.S. de Saint-Lucien, commandé par le capitaine Audon, deux rebelles étaient abattus et le lendemain la population criait sa volonté de rester française.
A Tébessa, le même jour, une manifestation analogue se déroulait.
Le 23 mars c'est le drame de Bab el Oued qui oppose l'OAS à l'armée ; Bab el Oued va subir le joug des forces gaulliennes qui n'hésiteront pas à tirer sur toute cible quelle qu'elle soit. 7500 appartements seront entièrement saccagés par les gardes mobiles pris de folie ; 15000 personnes vont être arrêtées et transférées dans des camps.
Ce blocus conduira la population algéroise à une manifestation de soutien, d'apport de vivres et de médicaments ; manifestation pacifique réprimandée par le sang.
A Oran depuis une semaine les combats de rue font rage, les gardes mobiles n'hésitent plus à utiliser les canons de 37 et mitrailleuse de 12,7 pour tirer sur les commandos OAS.
Malgré les combats un commando OAS organise un hold-up à la Banque de l'Algérie. Le butin est estimé à plus de deux milliards d'anciens francs.
Les combats entre gendarmes et Collines font 10 morts. le préfet de Police se réfugie à Mers El KEBIR.
Les combats entre Collines et gendarmes mobiles s'intensifient et font autant de victimes dans les rangs OAS, Gardes mobiles que dans la population civile.
Selon la presse, cette journée se solda par 1 tué et 15 blessés chez les gendarmes ; 3 blessés chez les soldats ; 1 tué et 21 blessés chez les civils.
Au cours de ces attaques contre les gardes mobiles, ces derniers n'hésitèrent pas à tirer sur les immeubles à l'arme lourde et tuèrent plusieurs civils.
Mesdemoiselles Lucette DOMINIGUETTI - 16 ans, Monique ECHTIRON - 14 ans, qui étendaient du linge sur leur balcon furent abattues par les gendarmes mobiles qui tiraient à la 12.7 ; madame AMOIGNAN, née DUBITON (dont le père avait été tué par le F.L.N.), sa petite fille âgée de 2 ans et demi furent fauchées, à l'intérieur de l'appartement, par des rafales de mitrailleuse 12.7 ; la sœur Sophie atteinte à la jambe dut être amputée par le docteur COUNIOT. Une mère de 7 enfants, Incarnation ESCODA, est tuée par une rafale de 12,7.
A Bab el Oued, c'est la poursuite de la répression, en particulier tous les jeunes entre 18 et 21 ans sont raflés et déportés en métropole. Cette mesure s'applique du reste dans toute l'Algérie et prendra l'appellation de " Plan Simoun ".
Dans le bled, à Bou Alam, près de Géryville le F.L.N. fait lire par le maire sa première instruction officielle : "tous ceux qui porteront encore l'uniforme colonialiste après le 1er Avril seront exécutés. Par ailleurs les harkis et anciens harkis devront quitter le village de regroupement près de la SAS et regagner leur ancien douar."
La plupart souhaitent s'engager dans l'armée française, mais l'armée ne prend que les célibataires, ils sont presque tous mariés.
Le douar regroupement de Yalou se pavoise aux couleurs française, drapeaux de fabrication locale.
Le commandant Guillaume, adjoint de Jouhaud pour le bled Oranais est arrêté "par hasard" à un barrage routier.
En fait il a très certainement été livré par l'un ou l'autre des officiers qui lui avaient promis de démarrer ce jour l'insurrection, et qui n'ont pas bougé.
Et ce 25 Mars 1962 : le choc. Les combats entre OAS et Gardes Mobiles n'ont pas cessé et s'intensifient ; tout le monde imagine que c'est la recherche du poste émetteur.
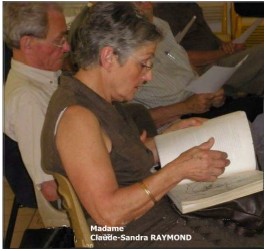 Mais en réalité c'est l'arrestation du Général Jouhaud ; à ses côtés Claude-Sandra Raymond appelée Cléopâtre dans la Résistance Oranaise. Mais en réalité c'est l'arrestation du Général Jouhaud ; à ses côtés Claude-Sandra Raymond appelée Cléopâtre dans la Résistance Oranaise.
Cette femme exceptionnelle qui dirigeait l'Echo de l'Oranie, que nombre d'entre vous connaissent qui s'est éteint le 23 mars 2013.
Elle fut une héroïne au sein des défenseurs de l'Algérie Française.
Cléopâtre fut son pseudonyme dans l'Organisation Armée Secrète.
Elle fut la secrétaire du Général Edmond Jouhaud, étant à ses côtés en permanence, et resta à ses côtés lors de son arrestation un certain 25 Mars 1962.
26 Mars 1962. Ce jour de 1962, alors que De Gaulle avait trahi et abandonné l'Algérie aux égorgeurs du FLN, des Français manifestaient pacifiquement rue d'Isly, à Alger.
Pour empêcher la population algéroise d'apporter son soutien à Bab-el-Oued, quartier assiégé par la Gendarmerie mobile, le préfet Vitalis-Cros fit appel à l'armée pour bloquer le passage de la foule. C'est le 4ème Régiment de Tirailleurs Algériens qui est désigné malgré la mise en garde de son commandement qui prévient que ces soldats ne sont pas préparés à une confrontation urbaine.
Ils étaient trois mille civils non armés à défiler vers le quartier de Bab el Oued, et se retrouvèrent donc face à un barrage militaire.
A 14h45, un lieutenant des tirailleurs vient les prévenir, ou plutôt les supplier : " dispersez-vous, nous avons ordre de tirer " (source Paris-Match n°178).
Quelques minutes après, les armes automatiques crépitent vers la foule.
Une centaine d'Algérois - hommes, femmes, enfants - furent abattus et d'autres centaines furent blessés par les balles françaises. Ils sont tombés victimes de la haine gaulliste.
Ainsi s'achève ce mois de Mars 1962 que nul ne peut oublier.
Une blessure peut, avec le temps, se refermer ; mais il y restera toujours la cicatrice.
Il en résultera un bilan de 637 attentats qui auront causé la mort de 537 innocents et 936 blessés.
Mais cette fin de mois de Mars 1962 ouvrait aussi le début des horreurs perpétrés quotidiennement : tueries, enlèvements dont le summum sera atteint ce 5 Juillet 1962 à Oran.
Condensé des principaux évènements relatés par Régis Guillem.
Le 28 Février 2021

|
|
| Le con finement
Envoyé par Eliane
| |
Autrefois, les gens qui restaient chez eux sans parler à personne étaient qualifiés de cons finis. Aujourd'hui ils sont simplement des cons finés.
Le con finement nous est parvenu par les chefs des gouvernements s'adressant à leurs cons citoyens. Tout cela est con sternant. Cela commence à nous mettre la con pression et nous entendons de nombreux potes se con plaire dans la con plainte médiatique.
Faute de mieux nous nous tournons vers l'église, ce lieu con sacré pour demander à Dieu de con jurer ce fléau. On nous dit alors que, pour ne pas être cons damnés, nous devrions pour pénitence nous con fesser.
À la maison, pas toujours facile de con tinuer à bien s'entendre avec nos cons pagnes ou nos cons joints. Il faut faire des cons promis et prendre quelques cons primés pour faire passer la pilule. Nous en sommes cons vaincus, il faut rester à la maison dans le con fort, nous limiter à manger des plats cons gelés et penser avec con passion à ceux moins bien lotis.
Bientôt tout ira mieux et le virus aura été con battu avec succès.
Mais restera la facture à payer. Et là, soyez-en sûrs, nous serons alors tous cons cernés.
Auteur inconnu
|
|
BONS BAISERS D'HONOLULU
ECHO D'ORANIE - N°295
|
En latin d'Afrique...
Une nouvelle chronique de Gilbert ESPINAL
- Là, j'ai une carte postale de Consuelo, qu'elle m'est arrivée toute fraîche de ce matin, déclara la Grand-Mère. Elle avait du la poster y a trois mois et c'est seulement aujourd'hui qu'elle arrive. J'ai du payer le timb' qu'elle avait omis de le mettre, avec une amende que, sans ça, le facteur il me la donnait pas ; et il a du monter les cinq étages à pinces que la Mère Mafigue, la concierge, elle a pas voulu lui ouvrir la censeur sous préteste qu'elle venait de se l'astiquer et que la carte postale elle allait lui mettre du sab' partout, vu la personne qui l'avait envoyée et l'endroit d'où elle venait.
- Et qu'est ce qu'elle te dit la Consuelo dans sa correspondance ?
- Pos, là sur le buffet tu l'as, à côté de la soupière ! Si t'y arrives à déchiffrer ce qu'elle a écrit, une sucette je te paye : on dirait des pattes de mouche et que ni l'endroit ni l'envers (j'ai même pensé qu'elle écrivait le français de gauche à droite, comme elle est arabe maintenant) j'ai pu comprendre une goutte de ça qu'elle a voulu me mettre.
Angustias prit le carton avec circonspection et jeta un oeil dessus :
- Pos, elle écrit : "Bons Baisers de Honolulu pour tout le monde, même à celles d'entre vous qu'elles m'arrachent la peau à longueur de journée. Je passe des vacances de rêve ici à HONOLULU accompagnée de la R'zouza (1) qu'elle me surveille comme le lait sur le feu, de la Mahbouba (2), qu'elle me colle aux fesses même quand elle me passe le rahna (3) sur les cheveux et de mon mari bien-aimé SA le Prince Ben Zine qui ne me quitte pas des z'yeux et qui se fait rapporter par les deux premières tout ce que je dis et tout ce que je fais. J'ai du même leur dire "bela fou mouk" (4) pour qu'elles me foutent la paix"...
- Anda ! coupa la Golondrina, que ça doit pas être emmerdant d'avoir deux espionnes sur le dos toute la journée, à celle qui raconte le plus de bobards !
- Cette Consuelo c'est une calentona ! déclara la Grand-Mère sur le ton du mépris ; le mari il a raison de se méfier ! C'est pas pasqu'il s'appelle Ben Zine qu'il est détaché des contingences ! La Princesse, plus elle en a plus elle en veut ! A Oran, déjà, elle avait tué son premier mari Léon, qu'il était camé au pschit' qu'on l'appelait le Camé Léon, puis son second Tragamonos qu'il a eu le temps rien que de lui laisser sa retraite avant de passer l'arme à gauche ; puis ça a été au tour du Prince El Bathroul et maintenant le richissime, dispendieux et généreux Ben Zine avec lequel elle s'est mariée rien que pour aspirer à sa pompe !
Angustias reprit :
- Elle signe "Votre Princesse Zouïna de la Babouche anciennement du Tarbouche, mon mari antérieur S.A Yennah Besef El Bathroul étant décédé cet hiver de la canicule dans le désert de Gobi où il faisait paître ses troupeaux !"
- Et qui c'est qu'y a pu lui dire qu'on lui arrachait la peau à longueur de journée ? interrogea la Golondrina. Parmi nous, y a un mouton noir qui cahùète tout ce que nous faisons et tout ce que nous exprimons ! Si ça continue, on va t-êt' obligé d'être muettes comme des tombes : "des oreilles ennemis nous écoutent", ça serait pire que pendant la guerre !
- Pos moi, sauta Amparo, depuis qu'elle nous a rendu visite l'année dernière, qu'elle est descendue chez vous, Aouela (j'espère que vous vous en souvenez) ni si quiera (5) j'ai demandé de ses nouvelles ! Elle vit dans un monde de grandeurs et moi je suis ici à trimer comme une bourrique, pour arriver à joindre les deux bouts, que mon mari y s'est fait fout' à la porte de son atelier pasqu'il réclamait la semaine de trente heures, payée quarante-cinq et sept semaines de congés, comme les Allemands, qu'eux, y z'ont perdu la guerre.
- Moi, lança Angustias, je vois qu'une seule personne qu'elle a pu lui faire le rapport à Consuelo, c'est votre petite fi' Tonina, Grand-Mère, que depuis qu'elle a rencontré la Princesse, elle s'arrête pas de parler d'elle, que la bav' elle lui coule "et que Consuelo par ci, et que Son Altesse par là..." je crois même qu'elle l'y a adressé des lettres, pasque faut' jour, j'ai entendu qu'elle demandait à votre fi' Isabelica, sa mère, à combien ça coûte de mettre un timbre pour le Moyen-Orient !
- Et qu'est-ce qu'elle a fait ma fi' ? demanda la Grand-Mère.
- Pos elle a mis la main au por' monnaie et elle l'y a sorti les sous que ça m'a paru une barbaridad' de cher ! répliqua Angustias. Je lui ai dit même à cette dernière : "Tu devrais faire entention, pasque, dans son courrier, la Princesse Consuelo, je crois qu'elle est en train de lui bourrer le mou à ta fi' en lui proposant de venir la rejoindre, non pas à HONOLULU mais dans le bled pourri où il habite Ben Zine entouré de ses chameaux et de sa famille". Votre petite-fi' Aoula, depuis qu'elle a cassé la carte avec son policier de fiancé (avec tout le jaleo que ça a fait dans le quartier) elle tourne pas rond, elle est sensible à ce que lui dit Madame Ben Zine pour lui décrasser l'âme et essayer de lui remonter le moral !
- Et qu'est-ce qu'elle lui dit Consuelo ?
- Que là où elle habite, y'a des cœurs à prendre ; et quand je lui dis des cœurs, je m'entends ! Elle lui propose même de lui présenter le plus jeune frère de son mari, le Prince Mouloud Ben Zine Ould Saraouel, qu'il est toujours pas marié. Y paraît que c'est un beau garçon, avec la chevelure crépute et des narines proéminentes, ce qui est de bon augure lui assure la Princesse en vertu de l'adage "como tiene el naz tiene el compaz" (6) ! II est un peu bovo, lui a écrit Consuelo, mais il est bon pour le service ! Tonina elle balance : tantôt elle dit qu'elle réfléchit, tantôt qu'elle se tchale (7) elle-même en se racontant des histoires d'or et de pierres précieuses et de dollars.
- Hé tu vois ma petite fi', fulmina la Grand-Mère, se marier avec un qu'il a les narines qu'elles avancent et qu'elles s'épatent ? Comment il a les lèv' ?
- Pos Consuelo elle lui a dit, exposa Angustias (pasque votre petite fi' elle a eu ses curiosités aussi !) qu'il avait pas besoin de se les faire remodeler comme on fait maintenant avec du silicone ; que de ce côté là, le Bon Dieu il l'avait bien servi et qu'elle trouverait tout son confort, en plus d'être elle-même la Princesse du Sarouel. Remarquez que s'il a un nez proéminent, ça équilibrerait avec votre petite fi' que elle, elle a pas d'appendice nasal du tout !
- Hé où tu y as vu toi, que ma petite fi' elle était tchata ?
- Aouela ! Ne me dites pas : votre petite fi' elle a deux trous au milieu du visage : on dirait une prise électrique, et pour ce qui est de sa bouche, elle est qu'on jurerait une arapède !
- Mais cette Consuelo, fulmina la Grand-Mère, c'est une mère maquerelle ! Comment elle ose proposer à ma petite fi' de se marier avec un qu'il a des lèvres en revers de pot de chambre.
- Y vous embrassera mieux grand-mère quand y viendra vous voir et ce seront des suçons princiers ! Et dans la famille, vous aurez aussi une presque Reine !
- Qué Reine ni ocho cuarto ! hurla la vieille femme. Toi, tu veux que je retourne au Moyen-Age, à l'époque de la Gabelle où si tu marchais pas droit on t'envoyait à Aubagne, à ramer sur des galères ! C'est pour ça qu'y a eu la Révolution ! Maintenant, nous avons un Président de la République ; que je sais pas si c'est mieux, avec tous ces impôts qu'il nous inflige ?
- Et vous aussi, vous payez des impôts ?
- Moi non ! clama la Grand-Mère, moi je suis économiquement faib' ! Ojala (8) que je paye des millions et des millions d'impôts, ça signifierait que je roule sur l'or. Remarque qu'avec ça qu'y font des sous que nous leur donnons aux agents du fisc ! Y boulottent tout à notre santé ! Le fruit de notre labeur et de notre sueur que, ni si quiera, je peux m'acheter, moi, un manteau pour cet hiver. Depuis l'Algérie je traîne toujours ce vieux pardessus du grand-père que j'ai fait remettre à ma taille par cette tchapoussera (9) de couturière que la Mère Mafigue elle m'avait indiquée, qu'elle prétend que c'est une élève de Galiano (çui-la qu'il a pris la suite de Dior) et que sous préteste que maintenant la mode elle est asymétrique elle m'a fait une ouverture par la manche. Ce qui fait que y faut que je passe mon cou par là, si je veux sortir la fugure et que ça me serre tant que je peux pas rouler ma pomme d'Adam. Je reste là avec le gosier coincé chaque fois que je le met. La Golondrina elle me dit qu'y faut que j'aille chez le chirurgien esthétique pour qu'y me la supprime, comme ça j'aurai le cou long et déplumé comme un coq anglais ; mais tu me vois pas à mon âge monter sur la table d'opération avec les varices que j'ai et la rotule du genou coincée !
- Aouela, essaya d'apaiser Angustias, le Président de la République il a pas la faute si votre couturière elle est maboule (10).
- Pos, lui aussi il a la responsabilité de la chose ! fulmina la Grand-Mère. T'y a pas vu le procès qu'on lui fait, ainsi qu'à sa moitié, pour les dépenses de bouche que, tout au long de leur carrière, ils ont engagées.
- Hé qu'est-ce qu'y vient faire Bush dans cette affaire ? interrompit Angustias.
- C'est pas de ce Bush que je te parle ! Je te parle du trou que tu as en dessous le nez et qui te sert à manger ! Y paraît que le matin au petit-déjeuner, ils se tapaient un sandwich au saumon fumé ou à la langouste. A midi, ils déjeunaient d'une boîte de caviar chacun, même la gamine ! Et ça, durant des années ! Il a fallu que Le Pen il mette le doigt sur la plaie pour que le scandale éclate ! De prison ils sont menacés, toute la famille, même la gamine ! C'est pour ça que la Présidente, maintenant, elle fait la quête pour rembourser le boucher, le charcutier et le poissonnier ! Tout le monde s'esbaudit pasqu'elle ramasse les pièces jaunes (encore merci qu'elle pompe pas les billets) avec cet escogriffe de David Douillet ! Comment tu crois que celui-là il est devenu aussi grand et aussi gros, qu'y paraît qu'y casse la gueule même aux japonais en leur déchirant leur kimono et en multipliant leurs shoushis ! On dit qu'il assomme même les sumos, qu'eux, quand ils le voient à la télévision, ils tournent le bouton, pasqu'y savent plus où donner de la tête.
- Ay ! Grand-mère, s'exclama Angustias pour apaiser l'indignation de la doyenne ; si votre petite fi' Tonina elle épouse le prince Mouloud vous aurez l'obligation rien que de manger du méchoui ; les hommes du désert y dégustent ni saumon, ni foie gras, ni caviar et encore moins de langouste, qu'avec la chaleur qu'y fait, elle tiendrait pas le coup. Y faut vous imaginer : vous, Patronne du harem et du gynécée, au milieu d'une tripotée de bédouins, en train de déguster un chameau rôti, votre petite fi', à proximité avec une couronne de diamants sur la tête et le prince Mouloud à ses pieds.
- J'aime pas le chameau, fit la Grand-Mère d'un air écœuré.
- Pos y vous rôtirons un mouton et même plusieurs, imaginez-les : avec une délicatesse infinie, ils écartèleront la bête et munis de trois de leurs doigts ils iront chercher dans la cavité orbitale, l'œil de l'animal (c'est le morceau de choix) et, pour vous faire honneur, ils vous l'offriront.
- Faudra que je me l'avale ! Gloup ! exhala la Grand-Mère à demi morte de dégoût. Je préfère encore la cervelle basse.
- Et là-aussi s'ils font cent-cinquante moutons pour nourrir la tribu, Aouela, vous aurez à votre disposition cent-cinquante rognons blancs, que dis-je cent cinquante ! Non ! Trois cents puisqu'il faut les multiplier par deux ! Qui plus heureuse que vous !
1 - R'zouza : la plus âgée des épouses du Prince
2 - Mahbouba : la fidèle servante noire
3 - rahna : le henné
4 - Bela fou mouk : fermez vos gueules
5 - ni si quiera : ni seulement
6 - como tiene el naz tiene el compaz : comme il a le nez il a le reste
7 - tchale : elle se ravit elle-même
8 - ojala ! : Dieu fasse que
9 - tchapoussera : cette ouvrière malhabile et maladroite
10 - maboule : folle à lier
|
|
Récit d’un prisonnier évadé d'Allemagne.
LES DISPARUS
Lassés de la nourriture infecte qui nous était servie, des traitements inhumains qui nous étaient infligés quand nous n'avions pas travaillé au gré de la brute qui nous surveillait à la mine, nous avions réussi avec des ruses de Scorix à nous enfuir de notre lieu de torture et nous errions à trois, mourant de faim et de soif dans un, chemin encaissé dont nous ne connaissions pas l'aboutissant, lorsque soudain, à quelques vingt pas, une lumière filtra dans les ténèbres.
Nous, nous arrêtâmes net, tremblant de retomber dans les mains des nouveaux bourreaux et un court conciliabule s'engagea entre nous. Mes deux camarades furent d'avis de retourner sur nos pas. Moi seul résistais : j'étais si faible et puis j'avais si faim et si soif ! O, leur dis-je», manger même du pain K K, boire à longue gorgée de l'eau fraîche pour apaiser le feu qui me brûle les entrailles et mourir après, peu m'importe, mais je veux boire. Partez, je vous en prie, car je suis décidé et préfère mourir la plutôt que de reculer d'un pas.
En présence de mon insistance farouche, mes braves camarades cédèrent, ils ne voulurent pas me quitter. Du reste, ils étaient presque aussi fatigués que moi. II fut convenu que puisque j'étais l'auteur de l'idée de demeurer sur place, je devais me dévouer et aller reconnaître les lieux.
Je m'avançais alors en rampant, retenant mon souffle, et me trouvais en présence d'une épaisse porte de bois, disjointe, par où filtrait une lumière fumeuse et cru reconnaître l'entrée d'un souterrain où nul bruit ne se faisait entendre. Intrigué, j'avançais et poussais légèrement la porte qui s'entrebâilla presque sans effort et sans bruit et j'entrais délibérément dans le couloir.
A quelques pas plus loin, presque immédiatement après, une lampe rudimentaire, une autre porte, mais fermée celle-là, car je la poussais en vain. J'en étais là de mes observations et ne savais ce que je devais faire lorsqu'un pas furtif me décela la présence d'un être humain. Vouloir fuir m'était impossible : j'attendis donc et fus tout surpris de me trouver en présence d'une sœur hospitalière, à laquelle je m'adressai, suppliant, en lui avouant qu'évadé d'un camp de prisonniers, je mourais d'inanition.
Elle m'écouta sans mol dire et après m'avoir fait signe, de l'attendre, elle disparut dans la pénombre d'un couloir humide.
J'attendis relativement longtemps, si longtemps même qu'à la fin, à la fois impatient et intrigué, je m'engageai à pas de loup dans la direction qu'avait suivi la soeur. Je n'allai pas loin cependant, car, à peine avais-je fait une cinquantaine de mètres que je me trouvais en présence d'une vaste salle, éclairée de ci, de là, par des luminaires et entourée de lits d'hôpital. Un silence lugubre y régnait et je crus à un moment donné qu'elle était inhabitée, pourtant, ayant cru entendre une plainte sourde s'échapper d'un lit voisin, je m'enhardis et m'approchant doucement, je constatai que le lit avait un occupant qui me fixait avec des yeux pleins d'épouvante. Je m'approchai encore davantage et quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître dans l'alité mon camarade X., que j'avais perdu de vue depuis le commencement de la guerre.
Je me disposais à lui donnais l'accolade quand, d'un ton plein de tristesse, il me dit textuellement : » Mon Dieu ! Pourquoi es-tu venu ? Je croyais ma retraite si bien cachée. Vas-t'en ! Fuis ! Fuis vite si tu as un peu d'estime pour moi net surtout si tu as le bonheur de retourner au pays, si lu revois mon vieux père et ma vieille mère, jure-moi de ne leur jamais dévoiler ni ma présence, ni mon état : il est préférable qu'ils continuent à me croire mort, ils souffriraient trop de me savoir ainsi. »
Et pendant qu'il prononçait ces mots, de grosses larmes sillonnaient ses joues amaigries. — « Mais sauve-toi donc, reprit-il, haletant, tu ne vois pas que tu me fais mourir ! Tiens, incrédule, soulève mes draps et regarde. » — Je soulevais les couvertures et mon horreur ne connut plus de bornes lorsque je constatai que le malheureux n'avait plus ni jambes, ni bras.
Paralysé de stupeur, je demeurais là, inerte, me demandant si je vivais un cauchemar lorsque, avec plus d'insistance il répéta sa prière. Je revins alors moi-même et après m'ètre rendu compte d'un regard circulaire que les autres, lits étaient occupés par des infirmes dans son cas, je m’enfuis, éperdu, cependant que retentissaient à mes oreilles, comme une prière ou un avertissement : « Tu as juré ! Tu as juré !»
Je courus droit devant moi, ne sentant plus ma faim ni la soif et arrivais comme un bolide sur mes camarades à qui je contais rapidement ce que j'avais vu. Notre parti fut vite pris. Nous courûmes à perdre haleine afin de mettre le plus de distance possible entre ce lieu maudit et nous.
Après des péripéties sans nombre, des dangers et des fatigues inouies, nous parvînmes à nous glisser à travers les sentinelles allemandes et à pénétrer en Hollande où l'accueil le plus empressé nous fut fait et où nous pûmes nous remettre un peu de nos terribles fatigues.
Depuis, j'ai revécu par la pensée ce terrible souvenir qui, bien souvent, hante mes nuits, et je frémis en songeant que des parents pleurent des êtres aimés qu'ils croient morts quand, en réalité, ils sont bien vivants ou enterrés comme tels.
Qu'est devenu mon pauvre ami ? Quel était cet asile souterrain où lui et ses infortunés camarades vivaient des jours et des nuits d'angoisses ? Avaient-ils été opérés à la suite d'affreuses blessures de guerre ou bien avaient-ils été sacrifiés aux majors boches pour servir à des expériences ? Toutes les suppositions sont possibles puisque je n'ai jamais plus entendu parler de mon pauvre, camarade, puisque vainqueurs, nous avons exigé la reddition de nos prisonniers. Il est vrai que nous ne sommes pas aller visiter les souterrains boches en Bavière attendu que nous n'occupons que la rive gauche du Rhin et voilà pourquoi je supposerai toujours, jusqu'à preuve du contraire que tous nos disparus à la guerre ne sont pas réellement morts, malheureusement pour eux.
René FRANCK.
|
|
PHOTOS DE BÔNE
Envoi de diverses personnes
|
BATEAUX DE PËCHE

CHARGEMENT BATEAU DE VIN

PALAIS LECOCQ

LA GARE

HÖTEL D'ORIENT

LES BENI RAMASSES
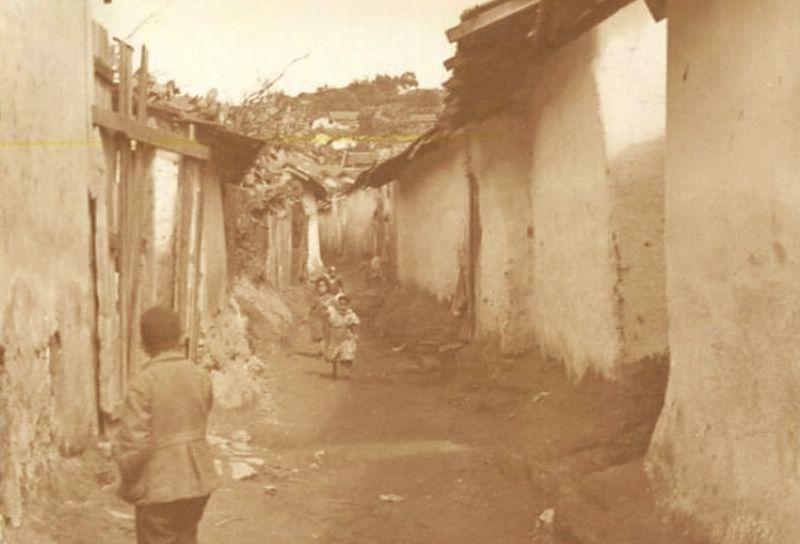
|
|
Variations en fa(mme) majeur
Par M. Marc Donato
|
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce Covid aura donné à notre linguistique un coup de seringue propre à la faire accoucher de nouveaux mots et à en dépoussiérer certains autres qui font le devant de la scène par moments. Ainsi, en cette période d'interminable pandémie, "variant" est sur toutes les lèvres de la gent médicale. Variant par-ci, variant par-là. Voilà que Covid se met à varianter en se donnant des formes légèrement différentes de sa forme initiale et qu'on appelle les variants. Certes, le mot et sa famille n'étaient pas tombés dans l'oubli : les divas de la météo vespérale ne nous annoncent-elles pas que la température pourrait varier de quelques degrés entre le chiffre du thermomètre et le fameux ressenti ? Les prix eux-mêmes varient d'un magasin à l'autre. Notre humeur varie au gré du temps... Et, parfois, l'habile variant se pare d'une coquette particularité féminine pour nous aborder, le futé, sous la forme d'une "variante", habile et rusée transformation pour un même résultat.
Beaucoup de choses varient au fil du temps, certaines même ne vont-elles pas jusqu'à s'avarier ? Mais la plus belle de ces variations a été mise en proverbe par la sagesse populaire, dont on sait que la philosophie, polie par des siècles d'expérience, mille fois replacée sur le travail par nos pères, ne souffre pas d'être remise en question. "Souvent femme varie, bien fol est qui s'y fie" en est l'illustration. "La donna è mobile", entonne le duc de Mantoue dans Rigoletto. Femme légère, plume au vent, susceptible de varier autant d'idées que de discours au premier changement d'humeur ou selon le cours des événements. Ce trait si féminin aurait-il été souligné par Victor Hugo dont le roi s'amuse en chantant ces vers au cabaret ? L'auteur des Misérables attribue la paternité du texte à François 1er qui l'aurait gravé sur une vitre du château de Chambord. On sait combien le monarque aimait les femmes, lui qui aurait contraint Honorade de Voland à se défigurer afin de détourner d'elle le fougueux jeune homme revenant d'Italie avec le mal français pour avoir fréquenté un peu trop et n'importe qui.
Quoi qu'il en soit, la populace, dans son immense sagesse, a repris à son compte cette futilité du caractère féminin. Depuis, Simone, Gisèle et Marlène sont passées par-là, défendant la cause des femmes, et on approuve totalement l'engagement qui justifie leur combat féministe. Pour autant, la Femme a-t-elle renoncé à varier ? L'éternel féminin est là, universel, intemporel, depuis maman Ève et le coup de la pomme qui nous est resté en travers de la gorge à nous, pauvres hommes. La nature est là et elle ne changera pas par la grâce d'une loi. Et puis, c'est bien ainsi qu'on vous aime, Mesdames.
Donc, le virus variante. Au diable ses airs de demoiselle ; poussé vers la porte, le voilà qui revient par la fenêtre avec ses allures de macho : sur un air de samba, c'est le variant brésilien ; sous ses sautillements zoulous, le voilà qu'il devient sud-africain ; et même british, alors que le brexit étant à peine consommé, le voilà qui se radine de ce côté-ci du Channel avec des airs de nostalgie communautaire comme s'il ne voulait pas nous lâcher. Aussi, pastichant le roi François, la tentation est grande de dire de Covid : "Souvent virus varie, bien fol est qui s'y fie". Nos savants chercheurs, notre ministre de la Santé qui n'a pas hésité à payer de sa personne en se faisant vacciner, exhibant, pudiquement, certes, une épaule juvénile à faire pâlir les plus de 75 ans et porter au rouge les réseaux sociaux qui l'implorent de découvrir un téton resté mystérieux et du coup, éminemment érotique, nos directeurs de laboratoires eux-mêmes le savent bien : Covid, dans ses variations, est bien plus dangereux qu'une pauvre femme. Je vous vois venir : femme varie, virus varie… Non, loin de moi l'idée de comparer la Femme à un virus. Je les admire trop, toutes ces dames, pour que l'idée même de cette idée effleure mon esprit.
Je plaisante, assurément, et je ne vais pas pousser l'outrecuidance jusqu'à faire franchir à mes propos le seuil de l'insulte, ce qui me vaudrait l'obligation de m'acquitter d'une amende qui, elle, ne varie que dans le sens de l'augmentation, et de devoir battre ma coulpe en place publique. Nous devrons probablement nous plier à cette caractéristique du virus ; nous nous sommes bien habitués à celle de la Femme, sans même avoir été vaccinés… Restons prudents, mes amis : souvent virus varie…
Ne variez pas d'un pouce, Mesdames.
Marc Donato - Mi-février 2021
|
|
| L'aventure d'un Alsacien-Lorrain.
Envoi de M. Christian Graille
|
Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, le Haut-Rhin, la Moselle et une partie de la Meuse passaient sous la domination prussienne.
158.000 personnes gagnaient la France et l'Algérie et l'on comptait, en 1875, 1.020 familles d'origine alsacienne ou lorraine y compris les colons des premiers jours.
Jean Ostertag, un blond Alsacien de vingt-deux ans part en 1842 effectuer ses sept ans de service militaire.
Fils d'un journalier de Drusenheim (Bas-Rhin), il n'avait certes pas les moyens de se payer un remplaçant. Il passe ses deux premières années au 3e Cuirassiers stationné à Provins. Puis en août 1844, il est muté en Algérie, au 23e Chasseurs d'Afrique qui tenait garnison à Constantine.
On ne connaît pas la raison de cette mutation si ce n'est le fait que, bien souvent, les militaires envoyés en Afrique du Nord étaient de " fortes têtes ".
En 1844 les troupes françaises luttent avec acharnement contre Abd-El-Kader.
Au 3e Chasseurs d'Afrique, le jeune Alsacien est de toutes les expéditions, dans les Aurès comme en Kabylie :
- bivouacs,
- manœuvres,
- razzias des tribus,
- harcèlement de Bou Maza,
Jean Ostertag participe à la conquête. Il manque d'avoir les pieds gelés lors de la désastreuse expédition du Bou Thaleb dans les montagnes de la Kabylie.
Il est nommé cavalier de première classe pour Noël 1847…
En 1849, démobilisé, il s'en retourne en Alsace, dans sa famille.
Mais travailler la terre ne lui plait guère. Après une expérience de deux ans de vie rurale, il reprend du service en avril 1851 au 3e Cuirassiers, son régime d'origine, stationné alors à Lyon.
Mais il y reste peu de temps : en août 1852 le général de division, inspecteur général, le mute au 4e Chasseurs d'Afrique.
Jean Ostertag se retrouve à Mostaganem. Il effectue quelques sorties vers Mascara et Orléansville car se sont produits quelques " accrochages ".
Un escadron du régiment participe à la prise de Laghouat en plein désert.
En mai 1853 une expédition du 4e Chasseurs quitte Mostaganem avec pour mission :
- de patrouiller dans la vallée du Chélif,
- rejoindre Bou-Saâda,
- puis remonter vers le Nord en direction d'Aumale,
- franchir le col de Sakamody,
- atteindre l'Arba, et
- remonter sur Mostaganem en passant par Blida et Orléansville : Quatre-vingt-dix jours d'un pénible " baroud ".
Cependant Jean Ostertag ne rentre pas à Mostaganem car en cours de route il est incorporé au 1er spahi en garnison à Médéa.
C'est dans cette ville importante, sise dans les montagnes du Titteri qu'il fait la connaissance d'une " Algérienne ", Louise Roques, fille d'un Auvergnat, vétéran de l'armée d'Afrique, née en 1835 à Mostaganem alors que son père servait dans la garnison.
Devenu brigadier en retraite, ce dernier avait installé une forge sur la route de Blida en face de l'auberge du Nador près de l'oued Athali.
Quinze ans séparent le spahi aux cheveux blonds de la jeune fille du brigadier, mais cela ne semble pas être un inconvénient majeur : Jean Ostertag obtient de son colonel l'autorisation de se marier et en juin 1856, la mairie de Médéa enregistrera le mariage civil.
Deux petites filles naissent les années suivantes.
En 1859 le spahi Ostertag est envoyé au 6e escadron à Laghouat, une oasis située à 300 kilomètres plus au Sud.
La vie y est particulièrement pénible en raison notamment des maladies qui déciment la population.
Les deux petites filles meurent en bas âge.
Puis naquit un fils, Henri, en 1861.
Un an plus tard Jean Ostertag se voit affecté au 3e escadron, à la smala de Berrouaghia ; ce pays des asphodèles (plantes vivaces) plus salubre, se situe plus au Nord, à une trentaine de kilomètres de Médéa.
Depuis longtemps maréchal en pied au 1er Spahis, il maîtrise tout à fait le travail de la forge ; il va aussi s'adonner à l'agriculture sur les terres de la smala des Spahis. Puis :
- il achète les sept hectares et le lot à bâtir d'un colon découragé,
- commence à construire une forge privée et
- plante des pommes de terre (qui lui vaudront une prime à la foire agricole d'Alger en 1864 !)
Il prend sa retraite de militaire en 1869, après vingt-cinq ans de service durant lesquels il est resté cavalier de première classe.
Il reçoit la médaille militaire et peut enfin se consacrer totalement à sa forge et à ses enfants nés à Berrouaghia.
Mais voici qu'apparaissent de nouveaux soucis : l'Alsace devenue prussienne et les nouvelles de sa famille restée à Drusenheim ne sont pas des plus réjouissantes. Jean Ostertag travaille à sa forge dès 3 heures du matin ! Toutes les ferronneries du village sortiront de son atelier…
Il devient conseiller municipal, puis adjoint au maire.
Cette position lui permet de prendre une part active au projet d'agrandissement du village lorsqu'il est question en 1876 de reprendre les terrains occupés jadis par l'ancienne smala des spahis (le régiment ayant été restructuré entre-temps), Le maire, M. Chatellard officialise sa demande ainsi que la fiche de renseignements réclamée par l'administration pour connaître la solvabilité des requérants. La loi étant la même pour tous, il doit mentionner, puisqu'il est Alsacien, et malgré sa longue carrière militaire, qu'il " a opté pour la nationalité française ! " Malheureusement en raison d'une sombre histoire de passe-droits, l'affaire traînera en longueur des années " ce qui fait quelque peu maronner les gens de l'endroit " écrit Jean Ostertag dans une lettre où il renouvelle sa demande d'attribution.
Entre temps en janvier 1877, un ingénieur topographe remet un rapport à la municipalité sur le partage des terrains en lots ; aussitôt le conseil municipal délibère, remet ses conclusions à l'Administration et procède à la mise en possession début août.
Jean obtient sept hectares supplémentaires mais il faudra de nouvelles démarches pour entériner cet état de fait.
En 1879, sa jeune nièce Marion Ostertag fuit l'Alsace prussienne pour rejoindre son oncle à Berrouaghia. Un neveu, Marc Adam agit de même.
En mai 1879, Jean Ostertag demande à l'administration un lot de terrain pour sa famille restée à Drusenheim et désireuse de gagner l'Algérie.
Malheureusement l'administration n'accordera pas de suite favorable à cette requête.
En avril 1880, Marie Ostertag, la fugitive, se marie avec son cousin, fils de spahi.
Parmi les pièces exigées lors de l'établissement du mariage civil " un certificat de publication et de non-opposition délivré par le maire de Drusenheim, lieu de naissance de Marie et visé par le consul d'Allemagne à Alger ".
Le fils succède au père à la forge.
Il y a beaucoup de travail et les " ouled Styerlag " (la famille Ostertag) comme l'appellent les Arabes, gagnent durement mais correctement leur vie.
En octobre 1881, la mise en possession des sept hectares attribués cinq ans plus tôt devient un titre définitif de propriété.
L'ancien spahi a maintenant plus de soixante ans.
Il décède en 1893, laissant sa famille à l'abri du besoin :
- ferrer les chevaux,
- réparer les instruments agricoles,
- forger les ferronneries était alors une affaire prospère.
- Même Marie Ostertag venait parfois tirer le soufflet de forge pour accélérer la cadence de travail !
Tel fut l'itinéraire de cet Alsacien venu, comme bien d'autres jeunes gens sans ressources, effectuer sept ans d'obligations militaires en Algérie et tombé amoureux de cette terre…
Jean Aucouturier.
Historia Algérie. Histoire et nostalgie. 1830-1987.
|
|
| Bône et ses environs. Les vignobles
Envoi de M. Christian Graille
|
Nous partons pour Guébar, ferme située sur la ligne de Guelma, près de Mondovi et appartenant à M. Bertagna, maire de Bône.
C'est, nous dit-on, une des plus importantes, sinon la plus importante de l'Algérie. La compagnie Bône-Guelma, toujours complaisante, a donné des ordres pour que le train s'arrête au passage à niveau qui se trouve juste en face de la ferme. Nous visitons la belle installation des chais, où se fabriquent et se conservent les vins.
Le directeur de l'exploitation explique savamment des choses scientifiques. Voici le résumé de ce qu'il m'a dit : En Algérie de hardis colons ont créé de vastes exploitations et après de nombreux tâtonnements, des expériences toujours coûteuses, parfois ruineuses même, ils ont trouvé enfin une méthode de travail qui leur donne aujourd'hui la richesse.
La plupart partagent leur domaine entre la culture des céréales et celle de la vigne, des orangers, des plantes à essence et aussi de l'élevage.
Mais la vigne tient toujours la plus large part, ayant, depuis 1870, suivi une progression croissante.
Ainsi en 1871, on comptait 9.817 hectares en 1881 il y en avait 30.200 et en 1899 155.019 donnant 4.520.418 hectolitres. C'est là, sans doute, un maximum qu'il serait peut-être imprudent de dépasser : les vignerons français se plaignant déjà de la mévente de leurs vins, la surproduction algérienne ne ferait qu'accroître le mal.
Il n'est pas téméraire de fixer à un milliard la valeur des terrains plantés en vigne. Mais ce qui est particulièrement remarquable, ce en quoi les Algériens se sont distingués et ont dépassé le plus nos viticulteurs, c'est le progrès dans la vinification. La science a été mise à contribution et, avec le soin le plus minutieux, on a créé des installations modèles pour la fermentation et la conservation des vins. Il y a trente ans le vigneron habitait un gourbi et faisait son vin comme il le pouvait, à la vieille mode.
Par une température trop élevée, la fermentation première restait incomplète mais se produisait de nouveau plus tard, au grand détriment de la qualité de la marchandise.
Maintenant plus rien n'est livré au hasard ni à la routine.
Partout la science a pénétré ; tout travail se fait par elle et avec elle. Des cuves ou basins cimentés reçoivent le raisin.
Un appareil réfrigérant, dont le modèle est très répandu, est installé tout contre, et maintient une température constante durant la fermentation du moult qui est complète du premier coup.
Le vin est alors de bon goût, de conservation sûre et de transport facile. Les caves sont-elles même des monuments.
Ce sont généralement d'immenses halls charpentés de fer, comprenant un rez-de-chaussée et un étage.
Grâce aux murs épais du rez-de-chaussée où sont les réservoirs, la chaleur pénètre difficilement ; d'autre part, le premier conserve une température de 27 à 28 degrés, mais préserve le bas qui reste avec une température moyenne à peu près constante à 20 degrés.
Dans de vastes celliers sont alignés de grands foudres renfermant de 400 à 410 hectolitres. A Guébar il y en a 40. C'est vraiment imposant.
Ces foudres de bois sont excellents pour les vins de conserve qu'ils aident à vieillir. Mais quand il s'agit de s'en servir plutôt comme réservoir en attendant un proche enlèvement, il y a toujours une évaporation inutile, d'où perte sérieuse.
D'autres parts, sous l'influence de la chaleur, ces futailles, si énormes soient-elles, se détériorent vite, et cependant elles reviennent à neuf francs l'hectolitre.
L'ingénieux viticulteur a donc cherché autre chose et a fait l'essai de cuves carrées construites avec des briques à tenons et mortaises pour offrir plus de résistance à la poussée du liquide, et enduites de ciment.
C'est excellent comme réservoir, mais d'un entretien un peu difficile comme propreté. On a trouvé encore mieux. C'est la cuve cylindrique en ciment aussi, avec revêtement de verre à l'intérieur et bouchage à tampon de caoutchouc à la partie supérieure : c'est solide, c'est frais, c'est propre.
J'ai mieux saisi sur-le-champ les explications que le directeur de la ferme nous a données sur la culture de l'oranger. Cet arbre demande un terrain fécond, suffisamment humide, et, chose essentielle, s'égouttant bien.
Les pieds sont espacés de six mètres en tous sens. On les irrigue tous les huit ou quinze jours.
Autant que possible les plantations sont faites par carré d'un hectare, entourées sur les quatre côtés d'une haie de grands cyprès. On protège ainsi les orangers contre le vent et on évite la chute du fruit qui doit être cueilli à la main, sinon il n'est plus vendable.
Comme la plupart des arbres fruitiers, les orangers donnent une bonne récolte sur deux.
Le producteur intelligent s'arrange en conséquence pour avoir, quoique par alternance, des orangeries de grand rapport et d'autres de rapport moyen.
Il y a l'oranger amer et l'oranger doux. Le fruit du premier ne vaut rien. On récolte la fleur entière pour la distillation. Ce travail dure cinq semaines et commence vers le 10 avril.
Pour l'oranger doux, dont il faut ménager le fruit, on secoue l'arbre au-dessus des toiles sur lesquelles tombent les débris des fleurs déjà fécondées.
C'est toute une administration que la direction d'une ferme de ce genre.
Celle de M. Bertagna compte en effet 3.770 hectares de vigne donnant en moyenne 65.000 quintaux de raisin.
La main d'œuvre est fournie en partie par des détenus. Nous en apercevons dans les vignes sous la surveillance d'un garde armé. Il y en a d'ordinaire 1.200 que l'on rétribue 1 franc 20 par jour.
Une visite rapide à la cavalerie de la ferme, une apparition dans les bureaux où travaillent plusieurs comptables et nous nous disposons à rejoindre la gare de Mondovi.
Mais sur les tables ont été disposés des rafraîchissements : vins blancs et rouges, vins secs et vins sucrés, tous produits par la ferme, et il faut y goûter.
Deux grandes corbeilles remplies de mandarines et d'oranges, de belles sanguines en particulier, ont été apportées à notre intention.
Ce qu'elles sont savoureuses ainsi fraîches cueillies, en pleine maturité !
Qu'elles laissent donc loin derrière elles les oranges que l'on nous vend, en France, à peine mûres, car, pour être expédiées au loin, il a fallu les cueillir sur le vert.
C'est à regret que nous quittons cette belle ferme, où nous avons reçu un si fraternel accueil, et à pied, à travers ces cultures luxuriantes, dont nous n'avions pas jusqu'ici la moindre idée, nous gagnons le train, et mêlés aux Arabes, nous rentrons à Bône.
Cette première journée était bien remplie.
Aussi je n'accompagnais pas mes grands amis à une soirée que leur avaient ménagée les instituteurs de Bône, leur inspecteur en tête, ils offraient à leurs collègues de France un punch d'honneur.
On a beaucoup causé paraît-il ; on a bien ri, et c'est fort tard que l'on s'est quitté, heureux d'avoir ainsi fraternisé.
Voyage en Algérie par M. Meunier,
Directeur d'école primaire supérieure (1909)
|
|
| Algérie : Histoire et colonisation.
La France en Algérie.
Envoi de M. Christian Graille
|
Avant la conquête.
La domination turque en Algérie qui dura trois siècles (1515-1830) n'engendra aucune mesure d'un développement du pays digne de ce nom et bien peu d'améliorations des conditions de vie des habitants.
Il y eut de forts nombreux différents qui opposèrent la France et la Turquie.
Cependant il serait inexact de réduire l'origine de la conquête à un malheureux coup d'éventail.
Sous le Directoire, une grande quantité de blé avait été achetée aux sieurs Bacri et Busnach, deux importants commerçants, qui ayant acquis le monopole du commerce en Algérie percevaient en qualité d'intermédiaires de substantiels dédommagements financiers.
Les retards de paiement de la France s'accumulant, la dette gonflait inexorablement. Un important acompte fut versé aux deux négociants qui s'empressèrent de les encaisser sans en aviser le Dey.
L'affaire traîna jusqu'à l'arrivée des Bourbons au pouvoir qui, eux, consignèrent le reliquat des sommes dues.
Blessé par l'attitude inamicale de la France le Dey lors d'un entretien pour le moins orageux avec le consul Duval, entretien qui, peut-être, se termina par une bousculade ou par un ou plusieurs coups d'éventail portés par le Turc (rien n'étant certain et confirmé officiellement).
Cet incident diplomatique ne fut, certes pas, à l'origine du débarquement des troupes françaises à Sidi-Ferruch le 14 juin 1830 puisque 3 ans s'écoulèrent entre ces deux faits.
Il nous faut, tout d'abord, expliquer les causes de l'expédition de 1830.
Ce ne fut point un fait isolé qui amena la rupture entre la France et la régence d'Alger. Les griefs du gouvernement français remontaient à l'accession au pouvoir du dernier Dey Hussein Pacha en 1818 et au fil des ans le conflit se fit plus grave :
- Le traité qui en 1817 permettait à la France la pleine jouissance de ses possessions de la Calle et du monopole de la pêche du corail stipulant une redevance de 60.000 fut arbitrairement portée trois ans plus tard à 200.000 francs.
- En 1818 un brick français fut pillé par les habitants de Bône.
- En 1823 la maison de l'agent consulaire à Bône fut violée par les autorités ottomanes sous prétexte de contrebande et malgré la fausseté de ces accusations le Dey ne donna aucune suite à cette offense.
- Des autorisations illicites de séjourner et de commercer dans cette ville et sur les côtes de la province de Constantine furent accordées à des négociants anglais et mahométans.
- En 1826 des navires appartenant à des sujets du Saint Siège mais couverts du pavillon et de la protection de la France furent injustement capturés et leur restitution refusée.
- Des visites arbitraires et des dépravations furent commises à bord des navires français.
- Enfin le 30 avril 1827 lorsque le Consul de France, que des raisons financières avaient déjà brouillé avec le Dey, le complimenta, selon l'usage, la veille des fêtes musulmanes, une grossière insulte fut la seule réponse à cet hommage officiel.
Le gouvernement intima l'ordre au consul de quitter Alger, ce qu'il fit le 15 juin. Le Dey fit aussitôt détruire les établissements français et notamment le fort de la Calle qui fut pillé complètement.
La France décida le blocus d'Alger qui ne produisit pas les effets escomptés et coûtait très cher.
Une ultime démarche de Monsieur de la Bretonnière, parlementaire, fut alors tentée mais échoua et dès la sortie du port le bateau fut la cible des batteries turques ; cette éclatante violation du droit ne pouvait rester impunie.
La guerre fut donc décidée ; une flotte et une armée se réunirent à Toulon mais la conquête s'inscrivait surtout dans une tentative de restaurer l'autorité royale remise en question.
L'Algérie sous les Turcs.
Bien que la domination turque fut terne et sans projet, mais ayant précédé la domination française, il convient d'y insister quelque peu.
L'anarchie dans laquelle était tombé l'Afrique du Nord semblait appeler la conquête étrangère. Elle se produisit sous la double forme des entreprises hispano-portugaises et de l'intervention des Turcs.
La péninsule ibérique une foi reconquise, les Portugais et les Espagnols poursuivirent au-delà du détroit de Gibraltar la croisade contre les Maures. Les Portugais dominèrent sur les côtes du Maroc, les espagnols de Mellila à Tripoli.
La première conquête des Portugais au Maroc fut la prise de Ceuta en 1416 ; quant aux entreprises espagnoles elles ne commencèrent qu'après la prise de Grenade en 1492.
Le testament d'Isabelle la Catholique prescrivait à ses successeurs de conquérir l'Afrique et d'y continuer sans jamais l'interrompre la croisade pour la foi contre les infidèles. Ils étaient d'ailleurs provoqués par les Indigènes qui, de concert avec les Morisques expulsés d'Andalousie, avaient organisé la piraterie sur toutes les côtes de la Méditerranée.
En 1505 Don Diego Hernandez de Cordoue, plus tard marquis de Comarès, prit Mers-el-Kébir.
Deux ans après, il s'avança jusqu'à Misserghin pour surprendre un douar de Gharabas mais essuya au retour un sérieux échec. Ferdinand cédant aux instances du cardinal Ximénés de Cisneros résolut de venger cette défaite.
Le cardinal réunit une armée de :
- 4.000 cavaliers,
- 12.000 piqueurs,
- 8.000 aventuriers à ses gages.
La flotte qui la portait comprenait :
- 33 vaisseaux,
- 22 caravelles,
- 6 galiotes (petites galères légères),
- 3 bateaux plats,
- une fuste (bateau à voiles et à rames) et
- 19 chaloupes.
Ximénès prit le titre de Capitaine Général et confia le commandement effectif à Pedro Navarro.
L'armada, partie de Carthagène, fit voile pour Mers-el-Kébir, d'où l'armée espagnole marcha sur Oran et enleva la place d'assaut au cri de Santiago y Cisneros.
- 4.000 Musulmans furent tués,
- 8.000 faits prisonniers
- et le cardinal fit son entrée sur une embarcation magnifique au-dessus de laquelle une banderole brodée de la croix et de la devise : In hoc signo vinces. (Par ce signe tu vaincras).
Les Espagnols s'emparèrent ensuite :
- de Bougie,
- de Tripoli,
- de Ténès.
Sur un des îlots qui ont valu son nom à Alger (El-Djezaïr : les îles).
Pedro Navarro construisit une forteresse, le Penon, dont les canons pouvaient battre la ville de la distance de 300 mètres.
Ces succès si rapides jetèrent l'effroi parmi les Indigènes ; Bon nombre de tribus s'empressèrent de faire leur soumission.
L'Espagne maîtresse d'une grande partie des côtes de l'Afrique, voyant les chefs locaux s'adresser à elle contre leurs compétiteurs, aurait pu profiter de l'anarchie du pays pour l'occuper tout entier. Mais au lieu de prendre les ports comme base de pénétration vers l'intérieur, les Espagnols se tinrent enfermés derrière de puissantes murailles.
Ce système d'occupation restreinte, dont la France devait renouveler, trois siècles plus tard, la triste expérience, eut ses résultats ordinaires.
Les Espagnols furent bientôt assiégés et comme emprisonnés dans leurs places fortes par les tribus du voisinage, réduits à tout faire venir d'Espagne , même l'eau douce.
Les difficultés de la navigation pendant l'hiver et surtout la négligence de l'intendance réduisaient parfois la garnison à l'extrême misère :
" A Bône, dit un rapport officiel, les soldats n'ont plus de quoi acheter une sardine ; A Bougie, on doit dix-huit mois de solde aux troupes et les hommes désertent pour aller aux Indes ; au Penon, on était en train de mourir de faim quand un vaisseau chargé de blé est venu s'échouer devant le fort. Tout va bien maintenant, mais il ne faudra pas continuer à tenter Dieu. "
Le Capitaine Général qui avait le commandement suprême de l'armée et des fortifications était doublé d'un corrégidor royal, sorte de gouverneur civil, qui était chargé d'assurer la solde, les approvisionnements et de rendre la justice.
Entre ces deux pouvoirs rivaux, la lutte fut incessante jusqu'au moment où le roi, en 1536, se décida à supprimer le corrégidor.
Les Espagnols se laissèrent d'ailleurs détourner de leurs entreprises africaines par les guerres d'Italie.
Le pays leur échappa économiquement et politiquement ; les Indigènes reprirent peu à peu courage ; il leur vint d'ailleurs un secours inattendu, celui des Barberousse, qui, avec quelques milliers d'hommes allaient se rendre maîtres de l'Algérie.
Les différentes phases de la domination turque.
La période turque de l'histoire de l'Algérie se divise en quatre phases :
- celle des Beylierbeys (1518-1587),
- celle des Pachas triennaux (1587-1659),
- celle des Aghas (1659-1671),
- celle des Deys (1671-1830).
Ces diverses phases correspondent à un détachement croissant vis-à-vis du sultan de Constantinople et aussi à une anarchie de plus en plus complète.
Depuis qu'Arroudj et Kheir-ed-Din avaient fondé la régence d'Alger, ou comme on le disait, l'Odjak, quatre grands personnages avaient été revêtus de la dignité de beylierbey :
- Kheir-ed-Din lui-même
- son fils Hassan,
- Salah-Raïs et
- Euldj-Ali.
Les uns et les autres avaient été des hommes remarquables par leur énergie et leur sens politique. La milice et les corsaires leur obéissaient et ils étaient eux-mêmes de fidèles serviteurs du sultan.
Mais déjà des révoltes fréquentes avaient appris aux fondateurs de la Régence que leur œuvre n'était guère solide et que la turbulence des janissaires constituait pour elle un perpétuel danger.
Dès 1556, la milice égorgeait un pacha ; en 1561, elle embarquait de force pour la Turquie Hussan-Ben-Kheir-ed-Din.
Le pacha, quand on voulait bien l'accepter, ne pouvait rien sans l'assentiment de l'agha, chef des troupes et de l'assemblée du divan (conseil du sultan ottoman) où tous les janissaires avaient accès.
Cependant jusqu'en 1587, les beylierbeys trouvèrent un solide point d'appui contre les janissaires dans la corporation des corsaires ou taïffe des reïs, qui leur était très attachée, à eux et à l'empire ottoman.
Les pachas triennaux
Les choses changèrent à la fin du XVIe siècle. Le nombre des Ioldachs (soldats) augmenta considérablement ; se voyant plus redoutables, ils devinrent :
- plus grossiers,
- plus arrogants,
- plus pillards et
- plus indisciplinés.
Leurs officiers composaient le divan, qui décidait souverainement de la paix et de la guerre, des alliances et des traités, s'inquiétant peu de savoir si la détermination prise était ou non conforme à la politique de la Porte (palais du grand vizir). Les reïs (titre donné aux capitaines des corsaires) ne se recrutaient plus comme jadis parmi les marins de l'empire turc, mais parmi les renégats qui affluaient à Alger à partir de cette époque.
Ces nouveaux corsaires furent beaucoup plus âpres au gain et plus cruels que leurs prédécesseurs. Ils n'eurent que pour les ordres du sultan que du mépris et comme seuls ils faisaient régner l'abondance dans Alger, ils en devinrent les véritables maîtres.
Après la mort d'Euldj-Ali, il n'y eut plus ni grand chef de guerre, ni grande politique dans la Régence.
L'empire turc qui avait fait à la chrétienté une guerre si redoutable, était bien affaibli et déjà commençait sa longue décadence.
La Porte renonça au grand projet qu'avaient conçu les beylierbeys : la création d'un empire en Afrique.
Elle considéra le Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli comme de simples provinces qu'il suffirait, croyait-elle, d'administrer comme celles de l'Asie Mineure et de la Turquie d'Europe. Elle envoya donc à Alger des Pachas qui ne gardaient leur gouvernement que pendant trois ans. Mais les populations de l'Afrique du Nord étaient beaucoup plus indociles et plus remuantes que celles du reste de l'empire.
Les janissaires d'Alger se sentaient assez forts pour s'ériger en maîtres et ne laissaient aux pachas que des prérogatives purement extérieures :
- une garde,
- un palais,
- des chaouchs,
- la place d'honneur dans les cérémonies publiques
En 1635, préludant à la révolution qu'elle devait accomplir vingt-six ans plus tard, l'assemblée tumultueuse du Divan soustrayait au pacha l'administration du Trésor et n'en exigeait pas moins qu'il payât les troupes.
Les pachas sans cesse ballottés entre les exigences :
- de la taïffe,
- de la milice et
- de la populace, s'efforçaient de ménager tout le monde, tremblant sans cesse pour leurs têtes et pour leurs trésors qu'ils cherchaient à accroître rapidement pour aller finir leurs jours dans une des riantes villas du Bosphore.
On cessa d'obéir aux ordres de la Porte et la Régence devint indépendante.
Les Aghas.
Dans la seconde moitié du dix-septième siècle, les Pachas furent de moins en moins respectés et obéis.
En 1659, les janissaires réunis en Divan décidèrent que le pacha envoyé de Constantinople n'aurait plus le pouvoir exécutif ; celui-ci serait exercé par les Aghas, chefs de la milice, assistés du Divan, et l'envoyé de la Porte ne conserverait plus qu'un titre honorifique.
La soldatesque devenait ainsi maîtresse du pouvoir et la séparation entre la Régence et la Porte s'accentuait.
La révolution de 1659 changeait le pachalik (division administrative) en une république militaire, dont chaque soldat devait devenir président à son tour d'ancienneté : conception bizarre et évidemment irréalisable.
L'agha ne gardait ses fonctions que deux mois, et tous les deux mois surgissait un nouveau chef du pouvoir. Le système avait pour effet de multiplier au-delà de toute mesure les désordres et les assassinats.
Tous les Aghas sans exception moururent de mort violente de 1659 à 1671.
La nouvelle constitution dura douze ans à peine. En 1671 se produisit une nouvelle révolution, qui, cette fois, fut l'œuvre des Reïs ; la souveraineté des chefs de la milice disparut devant la prééminence de la marine.
Les reïs donnèrent le pouvoir à l'un d'entre eux, qui prit le titre de Dey, c'est-à-dire, oncle, patron, appellation familière qui se transforma en un titre officiel.
Les Deys, nommés à vie, ne tardèrent pas à profiter des moyens que leur donnait la position qu'ils occupaient pour transformer leur pouvoir en une sorte de dictature. Quant aux pachas, revêts par le sultan du caftan (vêtement oriental large et long, sorte de manteau) d'honneur, ils furent complètement oubliés et sans aucune influence sur la marche des affaires.
La Porte finit d'ailleurs par se lasser d'envoyer à Alger des représentants qui étaient comptés pour rien et le dey devint en même temps pacha.
Les Deys
Les quatre premiers Deys furent des capitaines-corsaires, qui, soutenus par leur taïffe, plus puissante que la milice elle-même, abaissèrent le Divan et ne le réunirent plus que pour la forme.
Mais leur origine même les força de fermer les yeux sur les excès de la piraterie, qui exposaient Alger aux représailles des nations chrétiennes.
Après que les bombardements et les croisières eurent terrifié les habitants et ruiné la marine des reïs, les janissaires reprirent une partie de leur ancienne influence. Mais ce n'était plus l'ancien corps uni et compact qui avait dicté ses lois à la Régence pendant un demi-siècle ; l'effectif était réduit des deux tiers au moins.
Le recrutement ne se faisait guère qu'en Asie Mineure parmi les vagabonds et les mendiants.
Leur tourbe vénale s'occupa de moins et moins de conserver les privilèges qui leur étaient acquis et les échangea volontiers contre des accroissements de solde et des dons de joyeux avènement.
Cette cupidité grossière devait d'ailleurs amener des conspirations et des révoltes sanglantes, chacun de ces mercenaires ne voyant plus dans un changement de souverain que l'occasion d'une gratification nouvelle.
Le moindre retard dans le paiement de la solde, une insulte ou une injustice qu'on disait faite à l'un d'entre eux, le moindre incident était un motif de soulèvement.
Les janissaires apportaient alors leurs marmites renversées devant le palais de la Jenina (palais, siège du pouvoir) et comme ils avaient presque toujours des complices dans l'entourage du dey, celui-ci était mis à mort.
Le besoin d'argent obligea les souverains de la Régence à donner la plus grande extension à la course, qui devint une piraterie organisée par l'État et pour son compte.
Aux réclamations d'un consul, l'un d'eux répondait : " Je suis le chef d'une bande de voleurs, mon métier est de prendre et non de rendre. "
En droit, un Dey eût dû être élu par l'assemblée générale ; en fait les choses se passaient tout autrement.
Lorsque le souverain abdiquait ou mourait de mort naturelle, ce qui n'arriva que onze fois sur vingt-huit, son successeur, désigné d'avance, avait pris les précautions nécessaires et le changement s'opérait sans opposition.
Mais quand il succombait à la violence, les assassins se précipitaient à la Jenina, en occupaient les abords et proclamaient celui d'entre eux qu'ils avaient choisi ; souvent un combat s'engageait et durait jusqu'au moment où les vainqueurs pouvaient arborer la bannière verte sur le palais dans lequel ils venaient d'installer leur candidat.
En ville, des scènes de pillage accompagnaient le changement de règne.
" La milice disait un consul de France, est un animal qui ne reconnaît ni guide, ni éperon, capable de se porter aux dernières extrémités sans seulement songer au lendemain et souvent sans savoir pourquoi. "
Les janissaires faisaient parfois des choix étranges. Tel cet Hadj-Ahmed (1695), vieux soldat que les conjurés trouvèrent sur le seuil de sa porte, raccommodant ses babouches, enlevèrent sur leurs épaules et portèrent triomphalement au Divan ; inquiet et maniaque, il vécut sous l'empire d'une terreur perpétuelle et n'osait même pas sortir de la Jenina pour aller à la mosquée.
Tel encore Baba-Ali (1754) :
- ancien ânier,
- ignorant,
- brutal,
- fanatique,
- donnant des ordres au hasard et
- les révoquant au bout de quelques minutes sur l'avis d'un esclave ou d'un matelot qu'il consultait sur les affaires de l'Etat en lui disant :
" Tu as plus d'esprit que moi, décide. "
Tel Omer-Agha (1809), grand fumeur d'opium, qui restait dans une apathie voisine de l'imbécillité tant qu'il n'avait pas pris sa dose accoutumée et tombait dans des accès de démence furieuse quand il la dépassait.
Au dix-huitième siècle, l'anarchie s'aggrave encore et tout est en décadence, même la course.
Le nombre de vaisseaux diminue et l'argent manque pour en construire de nouveaux.
- Le port d'Alger qui comptait autrefois plus de 300 Reïs n'en a plus que 24 en 1725. - Les bagnes où il y avait eu 30.000 esclaves n'en ont plus que 3 ou 4.000.
- La milice qui avait eu jusqu'à 22.000 hommes est réduite de moitié ; elle perd même cette supériorité de bravoure et de discipline qu'elle avait eue jusqu'alors sur les Indigènes.
- La population est décimée par des pestes et des famines presque périodiques ;
- les révoltes d'esclaves, de Koulouglis, de Kabyles sont continuelles.
A peine un complot est-il apaisé qu'il en prenait un autre. La Porte harcelée par les réclamations des puissances européennes essayait parfois d'intervenir.
Ses envoyés étaient accueillis avec de grands honneurs, ils offraient au Dey le caftan d'investiture et le sabre encerclé de diamants en présence du Divan assemblé, la lecture du firman (décret) du Grand Seigneur était écoutée avec un silence respectueux.
Mais lorsqu'on arrivait aux réclamations, la séance devenait tumultueuse, les Algériens refusaient d'obéir aux ordres de leur suzerain : " Nous sommes ici les maîtres chez nous, disaient-ils, et nous n'avons d'ordres à recevoir de personne. "
La Régence était assaillie de temps à autre par ses voisins de l'Ouest et de l'Est, Marocains et Tunisiens, parfois unis contre elle.
Les Algériens étaient en général facilement vainqueurs ; ils entrèrent à Tunis à plusieurs reprises mais ils ne réussirent jamais à conquérir la Tunisie d'une manière définitive, ni même à la soumettre à un tribut ; aussitôt qu'ils étaient repartis, le tribut leur était de nouveau refusé.
Depuis le jour où les Espagnols avaient été vaincus devant Mostaganem, ils étaient étroitement assiégés par les Indigènes dans les quelques places fortes qu'ils avaient conservées.
En 1708, le Dey Mohammed-Bagdach, aidé par le Bey de Mascara, Bou-Chlaghem, réussit à enlever Oran et Mers-el-Kebir ; le comte de Montemar reprit ces places en 1732, en augmenta les fortifications et approvisionna par quelques razzias bien conduites.
Mais l'Espagne ne tenait guère à ces possessions qui lui coûtaient chaque année plus de quatre millions.
L'abandon d'Oran et de Mers-el-Kébir avait été convenu dans le traité conclu en 1785 entre la Régence et l'Espagne.
En 1790, un terrible tremblement de terre renversa les fortifications et les maisons d'Oran et hâta la solution décidée de part et d'autre.
L'évacuation fut terminée en mars 1792.
Mohamed-Ben-Osman (1766-1791) rendit quelque vitalité au moins apparente à la Régence.
- C'était un homme sage,
- travailleur,
- d'un esprit juste et ferme ; ce fut certainement le meilleur de tous les Deys qui se succédèrent sur le trône d'Alger, qu'il occupa pendant vingt-cinq ans en dépit de nombreuses conspirations ; il réussit à remplir les caisses de la Régence et son règne vit les derniers exploits des corsaires algériens.
La décomposition de l'Odjak s'accentuait de plus en plus. L'abolition de la piraterie en 1815 lui porta un coup de grâce.
En 18158, Ali-Khodja tenta de se soustraire au joug de la milice en quittant la Jenina pour aller habiter la Casbah, qu'il avait soigneusement armée et où il fit transporter le Trésor public.
Il essaya de s'appuyer sur les Kabyles et les Koulouglis contre les janissaires ; ceux-ci furent pour la plupart massacrés ou rapatriés à Smyrne et à Constantinople. Dernier Dey, Hussein (1818-1830), fut un des meilleurs souverains de la Régence ; il se renferma lui aussi dans la Casbah ; il eut à lutter contre diverses révoltes.
A partir de 1826, la Régence jouit d'une tranquillité relative. Mais, privée des profits indispensables de la piraterie, ne pouvant s'appuyer ni sur la milice, ni sur les Indigènes dont il n'avait jamais essayé de faire la conquête morale, le gouvernement d'Alger n'avait plus qu'une existence précaire et ses jours étaient comptés.
L'heure allait sonner où la France renverserait l'Odjak et mettrait fin à cet étrange État barbaresque qui avait réussi à vivre ou plutôt à agoniser pendant trois siècles.
Histoire des colonies françaises et de l'expansion
de la France dans le monde.
Tome II : L'Algérie par Augustin Bernard, professeur
à la faculté de lettres de Paris. 1930
|
|
| Alger
Envoi de M. Christian Graille
|
Le panorama d'Alger, vu de la mer, est des plus merveilleux spectacles que l'on puisse contempler ; en y arrivant la nuit, la ville est enveloppée d'une brune rougeâtre sur laquelle se détachent en points lumineux les longues lignes de becs de gaz qui éclairent les quais et le port.
Mais le matin, de quatre à cinq heures, au moment où le soleil se lève, l'aspect est tout différent et devient féerique. Les premiers rayons du soleil, en frappant sur la terrasse de la Kasbah, donnent à cette cité l'aspect d'une immense carrière de marbre blanc ; tous les détails disparaissent dans l'ensemble et seuls, les quais et le boulevard de la République, avec ses nombreuses arcades et ses splendides hôtels, ainsi ensoleillés, se détachent de l'arrière-plan et semble s'avancer dans la mer comme une barrière infranchissable.
Du bateau, on peut aussi admirer les environs d'Alger :
A droite, sur la hauteur, c'est Notre Dame d'Afrique, ayant à ses pieds le village de Saint-Eugène,
- puis un peu plus loin la Pointe-Pescade,
- à gauche c'est Mustapha-Supérieur, avec ses magnifiques propriétés parmi lesquelles se trouve le palais d'été du Gouverneur,
- plus loin, le grand séminaire de Kouba,
- puis en bas : l'Agha,
- Mustapha-Inférieur,
- Hussein Dey,
- la Maison Carrée,
- puis enfin, tout-là-bas, à gauche : - le Fort de l'Eau,
- la Rassauta,
- le cap Matifou.
Avec les services rapides inaugurés depuis deux ou trois ans par la Compagnie Transatlantique, on arrive généralement à Alger pendant la nuit ; aussi si l'on y gagne en vitesse, y perd-on d'un autre côté car non seulement on ne peut admirer la ville, vue d'une certaine distance mais encore on n'assiste pas au spectacle amusant d'un débarquement en plein jour.
A l'approche du paquebot qui est signalé longtemps à l'avance, les portefaix et les bateliers se préparent à l'assaut et le bateau n'est pas plutôt entré dans le port,
- qu'ils s'accrochent à ses flancs,
- escaladent le bord et
- se précipitent au-devant des passagers afin de s'emparer des bagages.
- C'est une bousculade insensée, un charivari de tous les diables ; c'est à qui aura les paquets et les valises, à qui transportera les voyageurs jusqu'aux quais et tout cela accompagné :
- de cris, de jurements, de disputes, etc., etc.
La scène recommence en arrivant à terre ; mais alors elle est exécutée par les yaouleds, ces gamins qui, simplement vêtus :
- d'un saroual (pantalon),
- d'une chemise et
- d'une chéchia (calotte rouge)
Font à Alger l'office de commissionnaires et de cireurs.
Ils ne crient pas moins forts que leurs aînés, les portefaix et il n'est pas facile non plus de se débarrasser d'eux ; ils y mettent souvent un acharnement insupportable et la personne ainsi assiégée, afin d'en finir, cède et leur confie sa valise et son plaid. Ces portefaix et ces yaouleds sont connus sous le nom de Biskri. Ils sont originaires de Biskra, capitale du M'zab, et quittent leur pays pour venir à Alger gagner quelque argent qui leur permette de retourner chez eux vivre à l'abri du besoin.
Ils occupent tout un quartier de la ville et les plus âgés ou les plus vigoureux sont employés à porter de l'eau chez les particuliers, soit à travailler sur le port.
Alger qui est la ville la plus importante de notre colonie, et qui en est aussi la capitale, compte actuellement 75.000 habitants environ, parmi lesquels :
- 24.000 Français,
- 17.000 Musulmans,
- 8.500 Israélites,
- 25.500 de nationalités diverses.
Cette ville est entourée d'une enceinte continue, flanquée de bastions et bordés d'un large fossé ; depuis longtemps déjà, des projets ont été présentés au Gouvernement afin d'obtenir l'autorisation de démolir les fortifications pour agrandir la ville ; mais aucune solution n'a encore été donnée.
Cinq portes donnent accès dans la ville :
- au Sud-Ouest la porte Azoun (Bab-Azoun),
- au-dessus, la porte d'Isly,
- puis en haut la porte du Sahel,
- au Nord-Ouest la porte Vallée, et
- en bas la porte de l'Oued (Bab-el-Oued).
Alger est divisé en deux parties bien distinctes : le quartier européen et le quartier arabe.
Dans le quartier arabe qui, du bas de la ville, c'est-à-dire des rues de Bab-el-Oued et Bab-Azoun, s'étend jusqu'à la Kasbah, les rues sont étroites et tortueuses. C'est là qu'habitent :
- les Arabes,
- les Juifs,
- les Maures et
- les Mauresques.
Dans le quartier européen qui s'agrandit chaque jour, surtout de la place Bresson et de la poste, les maisons sont magnifiques, elles ont toutes à trois étages sur la façade et un quantième sur la terrasse qui remplace le toit.
Le quartier de la Préfecture et de la Marine, c'est-à-dire le vieux quartier européen, est habité presque entièrement par :
- les Espagnols,
- les Mahonnais et
- les Maltais.
On rencontre à Alger comme endroits intéressants :
- La place du Gouvernement avec la statue du Duc d'Orléans,
- la place Malakoff où se trouve la Cathédrale, l'Archevêché et le palais du Gouverneur,
- le marché de la place de Chartres,
- la place Bresson, avec le square et le théâtre,
- la place d'Isly avec la statue du général Bugeaud et
- l'hôtel du général commandant le 19e corps,
- le marché couvert de la place de la Lyre,
- la place Randon où est la Synagogue,
- la place Bab-el-Oued où se trouve le lycée,
- les deux mosquées Maldki et Hanéfi dans la rue de la Marine,
- la zaouïa de Sidi-Abd-er-Rahman qui domine le jardin Marengo,
- la Kasbah, etc.
*
* *
La Kasbah véritable, où habitait le Dey Hussein, domine Alger du point culminant occidental au sommet du triangle de la ville.
Elle est antérieure à 1516, année où elle fut restaurée et augmentée par Selim-Ben-Teumi.
Ali Khodja, surnommé le fou, avant dernier Dey d'Alger s'étant aliéné l'esprit des troupes, fit transporter nuitamment ses trésors à la Kasbah où il s'enferma avec une garde à lui le 1er novembre 1817. Les janissaires s'étant insurgés à cette nouvelle, Ali fit décapiter un grand nombre de meneurs.
Le soufflet donné par Hussein à notre Consul M. Deval est le dernier épisode de l'histoire de la Kasbah.
Aujourd'hui c'est une immense caserne habitée par les zouaves et l'artillerie et traversée par la route d'El-Biar, route qui a fait disparaître la plus grande partie des fameux jardins du Dey.
A Alger, on appelle généralement la Kasbah cette partie de la ville située entre la Kasbah proprement dite et le quartier européen, c'est-à-dire le quartier arabe dont les maisons blanches s'élèvent en amphithéâtre sur le flanc du mamelon qui fait face à la mer.
Toute cette partie haute se compose de constructions carrées d'un ou deux étages au plus, blanchies à la chaux et sans ouverture sur les rues ; les chambres ne reçoivent de jour que par une cour intérieure ; les rues sont :
- étroites, sales, tortueuses, et l'aspect général est des plus monotone.
Toutes les maisons mauresques sont bâties sur le même modèle ; aucune n'a de façade extérieure.
La seule différence existe dans les dimensions car c'est toujours partout chez le riche comme chez le pauvre, un quadrilatère dont les étages sont surmontés d'une terrasse ou d'un toit plat.
Sauf la saillie des balcons, les murs de la rue sont unis ; quelques fois, et c'est rare, les arcatures couvrent la façade, comme à Constantine.
Les portes d'entrée, massives, garnies de clous à grosses têtes, s'enchâssent dans les jambages en marbre ou en pierre dont les rosaces forment l'ornement.
Dans les grandes maisons, la porte est précédée d'un portique garanti par un auvent supporté par des poutres carrées en bois de cèdre plus ou moins sculptées ou peintes.
Quand on a franchi la porte de la rue, on entre dans le vestibule ou skiffa, garni de bancs des deux côtés. C'est là que le maître de la maison reçoit ceux qui viennent lui parler et expédie ses affaires ; peu de personnes, pas même les proches parents ont la permission d'entrer plus avant, à moins que ce ne soit dans des occasions extraordinaires.
Ensuite on arrive dans une cour ouverte qui, suivant que le propriétaire est à son aise, est pavée de marbre ou d'autres matériaux qui sèchent facilement.
Cette cour répond assez à l'impluvium cava œdium des Romains, les unes et les autres étant ouvertes par-dessus et donnant un jour à la maison
Dans les grandes cérémonies, lorsqu'on est obligé de recevoir beaucoup de monde, comme pour un mariage, une circoncision d'un enfant ou autre occasion semblable, on se contente d'introduire la compagnie dans la cour, dont le pavé est alors couvert de nattes et de tapis pour la commodité de la conversation.
Autour de la cour il y a :
- quatre galeries, puis
- les appartements bas,
- la salle de bain,
- la cuisine et
- la citerne.
Au-dessus de ces galeries, soutenues par des colonnes en pierre ou en marbre, unies, à cannelures torses ou octogonales qui supportent les arcades en fer à cheval, il y a quatre autres galeries, soutenues également par des colonnes qui sont reliées par des balustrades à hauteur d'appui, décorées de colonnettes ou de panneaux découpés ou pleins, mais alors sculptés.
Nous avons vu, rarement il est vrai, et dans de très anciennes maisons, des balustrades en maçonnerie, déchiquetées en triangles ou en trèfles
Les portes des chambres qui sont ordinairement de la hauteur de la galerie, sont à deux battants et faites d'une infinité de petits panneaux unis ou sculptés.
Des fenêtres carrées et grillées s'ouvrent à côté.
Les galeries soutiennent une terrasse qui sert de promenade aux hommes le jour et la nuit aux femmes ; elle sert aussi pour étendre et faire sécher le linge ; sur l'un des côtés, il y a ordinairement un pavillon où l'on peut travailler à l'abri des injures de l'air et observer ce qui se passe du côté de la mer, car la plus grande attention des Algériens était d'observer si les corsaires revenaient avec des prises.
C'est l'usage en été, quand la réception doit être nombreuse, de préserver la cour des ardeurs du soleil ou des effets de la pluie à l'aide d'un rideau ou velum qui, tenant par des cordes aux crochets fixés sur les terrasses, peut-être plié et étendu suivant qu'on le juge convenable.
L'intérieur des chambres est généralement blanchi à la chaux ; le plafond est formé par des poutrelles en bois de cèdre ; mais dans les maisons riches, les murs sont ornés de faïence et les plafonds en bois sculpté offrent :
- des rosaces,
- des fleurs,
- des fruits,
- des poissons peints en couleurs voyantes et dorées.
Quant à l'ameublement rien de plus simple :
- des nattes et des tapis,
- quelques glaces, et à l'extrémité de la chambre,
- un divan servant de siège le jour, de lit la nuit,
- de grands coffres en bois peint, historiés de clous renferment les hardes et les bijoux des hommes et des femmes.
Les carreaux de faïence ornent l'intérieur des appartements ; ils concourent également à la décoration des escaliers, dont les marches sont en marbre ou en ardoise, et aussi à celle des arcades.
L'usage des cheminées est inconnu si ce n'est pour les cuisines ; on a su en tirer un parti très élégant ; des conduits placés de chaque côté de la terrasse se terminent par une série de bouches ouvertes de côté, coiffées de pyramidions faïencés et ornés de boules.
En somme, rien de mieux compris, sous un climat chaud, que la maison mauresque avec :
- ses galeries,
- ses portiques,
- ses ventilateurs finement évidés,
- ses appartements oblongs ouverts sur une cour intérieure rafraîchie par une fontaine.
Quand on a déployé le velarium antique, elle est harmonieuse, tempérée et douce au-delà de toute expression ; la chaleur y perd son énergie sauvage et la lumière son intensité et ses reflets brûlants.
Tout dans l'existence, les goûts, l'architecture des Maures s'explique donc merveilleusement par les conditions climatiques sous l'influence desquels ils sont placés.
Tout est le résultat des lois hygiéniques instinctivement pratiquées.
Dans les maisons mauresques de quelque importance, on trouve souvent une autre petite maison (douira) où l'on pénètre par un escalier donnant sur l'escalier principal ; c'est dans cette douira, appropriée au style général de la grande maison que les Maures et les Turcs se retiraient pour leurs travaux, ou plutôt leurs plaisirs.
*
* *
La fondation de la ville d'Alger date des temps les plus reculés, sous le nom d'Icosium, à l'époque chrétienne, elle posséda des évêques ; lorsque les Arabes envahirent l'Afrique, les Berbères s'y installèrent.
Ensuite, soit qu'elle ait été détruite ou incendiée d'une façon ou d'une autre, elle fut reconstruite au IVe siècle de l'Hégire (Xe de l'ère chrétienne) sous la dynastie arabe Sanhadienne par Bologguin, fils de Zïri qui lui donna le nom d'El-Djezaïr-Béni- Mer'ona, nom que les musulmans lui donnent encore aujourd'hui.
L'occupation d'Alger par les troupes françaises eut lieu le 5 juillet 1830, après vingt jours de combats et d'escarmouches.
M. Léon Galibert raconte ainsi l'entrée des troupes dans la ville :
" Le 5 juillet au matin, alors que dans le camp français tout le monde s'apprêtait à relever par une brillante tenue la solennité qui avait été annoncée, un envoyé du Dey venait encore implorer du Général en chef un nouveau délai."
Mais les ordres les plus précis avaient été donnés la veille pour que l'armée opérât sans retard sa concentration sur Alger.
C'eût été commettre une faute grave que de contremander ce mouvement.
D'ailleurs on avait fait aux vaincus toutes les concessions possibles ; il fallait donc que la capitulation s'accomplisse.
Au reste, dit le Général en chef à l'envoyé du Dey si votre maître n'est pas satisfait des avantages qui lui ont été accordés, qu'il retire sa signature. Vous le voyez, tout ici s'apprête à canonner la Kasbah.
En effet le général La Hitte, craignant une surprise, avait mis à profit la nuit du 4 au 5, pour ouvrir de nouvelles tranchées et s'approcher de la place.
Au moment où l'envoyé du Dey cherchait encore à négocier, une batterie se dressait à quatre cents mètres de la Kasbah.
La réponse du Général en chef fut considérée comme définitive, et Hussein ne songea plus qu'à exécuter la capitulation.
A onze heures les trois divisions de l'armée française se mirent en marche pour prendre possession des différents postes qui leur avaient été assignés.
La porte Neuve qui était la plus rapprochée des attaques fut choisie pour l'entrée triomphale :
- le Général Achard avec sa brigade devait occuper la porte Bab-El-Oued et les forts qui l'avoisinent,
- le Général Berthier de Savigny, le fort Bab-Azzoun et les différents postes de la marine car l'escadre depuis la canonnade du 3 était tenue au large pour des vents contraires.
Le chemin qui conduit du fort l'Empereur à la Porte-Neuve est :
- étroit, encaissé, rocailleux ; il se trouvait en outre obstrué par les boulets, les éclats de bombes et débris de toute espèce, au milieu desquels les chevaux et les roues des caissons demeuraient sans cesse engagés.
- Une batterie de campagne ouvrait la marche ; venaient ensuite les sapeurs du génie puis le 6e régiment de ligne qui, par son numéro d'ordre, formait la tête de colonne de la deuxième division. Ces troupes devaient occuper la Kasbah.
Le Général en chef, escorté d'un escadron de chasseurs s'avançait au bruit des fanfares guerrières. Officiers et soldats partageaient l'ivresse de leur Général ; tous savouraient les délices de cette journée.
Cependant lorsque l'on fut proche des remparts un profond sentiment de tristesse remplaça ces élans de bonheur ; là se trouvaient entassés pêle-mêle les cadavres horriblement mutilés des prisonniers français que les Arabes avaient fait pendant la durée du siège ; leurs membres étaient déchirés et la tête séparée du tronc.
C'était un spectacle affreux.
- Les drapeaux s'inclinèrent devant ces glorieuses dépouilles,
- les tambours roulèrent la marche funèbre et l'armée défila au port d'armes,
Enfin on franchit la Porte-Neuve.
Ici les difficultés du chemin augmentèrent ; de la Porte-Neuve à la Kasbah ce n'est plus qu'une ruelle étroite, bordée de mauvaises bicoques, bâties sans alignement et où trois hommes peuvent à peine passer de front.
Les essieux de l'artillerie renversaient à chaque instant des pans de muraille, et ces démolitions imprévues entravaient la marche de la colonne.
Pendant que l'on était occupé à déblayer la voie, le colonel Bertillat, chargé de faire le logement du quartier général, surmontant tous les obstacles, s'avança avec un faible détachement vers la Kasbah.
Aussitôt qu'on le vit approcher de l'enceinte, le Dey, qui s'y trouvait encore, en sortit précipitamment ; ses domestiques maures et les esclaves imitèrent son exemple, emportant tout ce qui leur tombait sous la main et laissant échapper, dans leur fuite, la plupart des objets qu'ils enlevaient ; si bien qu'en un clin d'œil, l'entrée de la Kasbah et ses abords semblaient avoir été livrés au pillage.
Les Juifs profitèrent seuls de cette panique ; ils recueillirent ces épaves avec une avidité extrême.
Nos soldats s'emparèrent bien de quelques objets, mais moins à cause de leur valeur intrinsèque que de leur bizarrerie.
Dans ses autres quartiers, Alger était loin de présenter l'aspect triste et désolé d'une ville où la victoire vient d'introduire l'ennemi.
Les boutiques étaient fermées mais les marchands, assis tranquillement devant leurs portes, semblaient attendre le moment de les rouvrir.
Ni l'harmonie d'une musique qu'ils n'avaient jamais entendue, ni l'éclat du triomphateur ne firent impression sur les Algériens. Assis ou couchés sur les bancs de pierre, ils ne se retournaient même pas pour voir défiler nos troupes.
Dans les faubourgs on rencontrait des Arabes montés sur leurs ânes, ou conduisant leurs chameaux qui faisaient signe aux détachements français de les laisser passer en criant de toute leur force : Balak ! Balak ! (gare ! Gare !) Cet imperturbable sang-froid s'expliquait par la confiance que notre parole leur inspirait.
En effet, tous les habitants d'Alger savaient que la capitulation garantissait à chacun :
- l'inviolabilité de ses propriétés,
- le respect des femmes,
- la sûreté individuelle.
N'ayant rien à craindre, ils n'éprouvaient que de l'indifférence pour les nouveaux venus. Seuls :
- les Maures,
- les Koulouglis,
- les Juifs surtout, accueillirent notre arrivée avec joie car ils espéraient que la longue oppression des Turcs allait faire place à un régime meilleur.
Quelques musulmanes voilées se laissaient entrevoir à travers les grillages épais de leurs balcons ; les Juives, plus hardies, garnissaient les terrasses de leurs demeures, sans paraître surprises du spectacle nouveau qui s'offrait à leurs yeux.
Nos soldats, au contraire, disait le commandant Pélissier, jetaient partout des regards avides et curieux car tout faisant naître leur étonnement dans une ville où leur présence seule semblait n'étonner personne.
Les portes de Bab-Azzoun et Bab-El-Oued, les forts qui leur correspondent et les batteries de la côte furent occupées en même temps que la Porte-Neuve et la Kasbah.
Nulle part on ne rencontra de janissaires ; sur aucun point la garnison turque n'avait laissé de postes
Les miliciens célibataires s'étaient retirés dans les casernes ; ceux qui étaient mariés avaient cherché asile dans les habitations de leurs familles.
Malgré cet abandon, jamais ville en Europe ne fut occupée avec plus d'ordre.
Le quartier général s'établit à la Kasbah ; un bataillon seulement de la division Loverdo et quelques compagnies d'artillerie en formèrent la garnison.
Deux autres bataillons de cette division s'installèrent près de la porte Bab-Azzoun ; le reste campa près de la Porte-Neuve et autour du château de l'Empereur.
- Une partie de la brigade Achard forma la garnison de Bab-El-Oued et de celui des Anglais ;
- l'autre campa dans les terrains environnants.
- Le fort Bab-Azzoun fut occupé par un bataillon de la division d'Escars,
- le deuxième régiment de marche avait pris position une demi-lieue en avant sur les bords de la mer.
- Les autres corps de cette division étaient répartis sur les hauteurs qui dominent la plage orientale.
Les sapeurs du génie et la plus grande partie des canonniers furent logés dans les bâtiments de la marine.
A peine les différentes divisions eurent-elles occupé leurs postes respectifs que tout changea de face dans Alger et les environs de la ville.
Les préjugés des musulmans s'opposaient à ce qu'on fit loger les troupes dans les maisons particulières. Aussi observa-t-on rigoureusement tout ce qui avait été prescrit à cet égard dans la capitulation.
Nos soldats ne franchirent le seuil d'aucune habitation privée ; des sentinelles ou simplement des consignes écrites suffirent pour empêcher l'accès des mosquées.
Disons-le à la gloire de l'armée française, sa modération et sa retenue prouvait qu'elle comprenait parfaitement la mission qui venait de lui être confiée.
Les brigades qui étaient entrées dans la ville établirent leurs bivouacs sur les places, sans que leur présence excitât la moindre alarme parmi les habitants.
Un grand nombre, au contraire, accouraient pour les voir de près et les noirs finirent par danser au son de la musique de nos régiments.
Il semblait que ce fût pour eux un véritable jour de fête.
La plupart venaient offrir gratuitement leurs services aux soldats et s'inclinaient devant eux en criant : " Allah ! "
Dans les bivouacs de l'extérieur la scène était plus pittoresque et plus animée. Ici les soldats avaient pour tentes des palmiers ou de larges platanes ou des haies de laurier-rose et d'aubépine.
Une fraîcheur délicieuse, entretenue par des sources d'eau vive, régnait sous tous ces ombrages tandis que la fumée grise et vaporeuse des cuisines, qui s'échappait à travers ces masses touffues, produisait avec le beau vert du feuillage et l'azur des cieux un piquant contraste.
Le bivouac était rempli d'Arabes qui venaient offrir à nos soldats :
- des légumes des œufs, des volailles.
Ils s'étonnaient qu'on leur en offrit le paiement, et, quand ils avaient reçu l'argent :
- se prosternaient,
- frappaient la terre de leur front et
- murmuraient avec une grande volubilité des phrases inintelligibles qui provoquaient de longs éclats de rire. "
Aussitôt après son entrée dans la Kasbah, le Général en chef fit chanter le Te Deum pour remercier Dieu de la victoire qu'il venait d'accorder aux armes de la France.
Le premier soin des chefs qui occupaient les ports de la Marine fut de délivrer les esclaves chrétiens enfermés dans le bagne.
On en trouva cent vingt-deux dont quatre-vingts appartenaient aux équipages du Sylène et de l'Aventure échoués sur les côtes d'Afrique quelques mois auparavant.
Parmi les esclaves français se trouvait un nommé Béraud, de Toulon, qui était là depuis… 1802.
Voyage à travers l'Algérie.
Notes et croquis par Georges Robert. Édition 1891
|
|
| Toi, petit Pied Noir
Envoyé Par J.P. Ferrer
| |
Toi, oui toi ! Le petit "Pied-Noir", qui reste accroché à ton mouchoir et qui, depuis 62, l'agite comme pour dire au revoir !
Ta terre n'est plus en vue. Depuis longtemps ! C'est foutu !
Tu ne reverras plus chez toi, ni les douars, ni Lakhdar. C'est trop tard.
Ton bateau est ancré au milieu de nulle part.
Autour de toi il n'y a qu'horizon. Va falloir te faire une raison.
Les années ont passé, va falloir accoster, et pour toujours tirer un trait.
Tu t'es trop attardé, tes yeux se sont usés sur cette ligne imaginaire qui t'a fait espérer.
Même la Vierge Noire n'a rien pu faire pour toi.
Ni pour eux. Ces "autres" qui sont partis, assommés de chagrin, pour mourir dans un coin.
Il n'en reste pas beaucoup, vous n'êtes plus très nombreux.
Je crois même que tu es un des rares survivants à être né "là-bas".
"Là-bas" c'est ce pays synonyme d'abandon, de départ et d'adieu.
Alors ne reste pas là ! Et viens nous raconter, El-Biar, les Aurès, Cap-Falcon et Oran.
On écoutera même cet Alger "fanfaron", le pont sur le Rummel, et Bône si t'as le temps
Les belles orangeraies, les fruits du Père Clément.'
Et le Mascara rouge sur la table le dimanche.
Je te préviens quand même, l'histoire de gens heureux n'intéresse pas grand monde.
Mais quand tu vas parler, on va lire ton regard, embrumé comme Tahat au sommet du Hoggar.
On va enfin comprendre ce qu'est être amoureux.
On sera d'abord deux, toi et moi si tu veux, et puis ils vont venir, les enfants, revenir, les aïeux, attirés par tes yeux brillant de mille feux.
Alors ne reste pas au milieu du néant. Ne laisse pas n'importe qui raconter n'importe quoi ! Jette-le ce mouchoir !
Pour que le monde sache ! Pour tous ceux qui sont morts... Pour ne pas qu'on oublie.
Dis-leur que "là-bas" a un nom !
Celui d'un beau pays qui s'appelle Algérie.
Orphelin d'un autre beau pays, ce foutu pays de France.
Et comme disait Camus : de l’Algérie on ne guérit jamais.
Michel Mitrant
|
|
| Les colons de 1848 en Algérie :
Envoi de M. Christian Graille
|
Mythes et réalités
Dans l'histoire de la colonisation française en Algérie et de ses débuts hésitants et chaotiques, l'entreprise de grande envergure lancée par le gouvernement provisoire de la Seconde République, reste marquée d'ambiguïté et obscurcie par les prises de position passionnée qu'elle souleva.
L'Assemblée Constituante, en effet, vota le 19 septembre un décret (Moniteur algérien du 30 septembre 1848) qui ouvrait " un crédit de 50 millions de francs au ministère de la Guerre sur les exercices 1848-1849-1850 et suivants pour être spécialement appliqué à l'établissement de colonies agricoles dans les provinces d'Algérie. "
C'était la première fois qu'une entreprise coloniale officielle, subventionnée, d'une telle ampleur était décidée. Quarante-deux " colonies agricoles " :
- devaient être créées,
- 12.000 colons transportés,
- installés aux frais de l'État,
devaient recevoir en plus d'une concession de terre de 2 à 10 hectares selon l'importance de leur famille :
- une maison,
- des instruments,
- du bétail,
- des semences et
- des rations journalières de vivres … pendant trois ans !...
Si l'on songe qu'à cette époque l'Algérie ne comptait qu'une cinquantaine de villages de colonisation peuplés d'environ vingt-mille colons ruraux, on peut se rendre compte de l'importance de l'effort envisagé !
Mettons en regard aussi le refus d'un crédit de seulement trois millions de francs qui avait été opposé au maréchal Bugeaud en 1847 pour la création de " ces camps agricoles " où il voulait installer des soldats-laboureurs.
Dès le 8 octobre 1848 (date de paiements des petits loyers) le premier convoi de colons partit du quai de Bercy à Paris avec huit cents personnes.
Cette précipitation (l'arrêté n'avait été signé que le 27 septembre) posait le problème des motivations du gouvernement.
Le décret du 18 septembre était-il simplement une mesure d'urgence en réponse au problème du moment posé par :
- la crise,
- le chômage,
- le risque de nouveaux troubles dans une population parisienne désœuvrée ?
Après la répression sanglante de juin, l'exclusion par la colonisation conçue comme une solution au problème social ?
Ou bien pouvait-on voir, au contraire, dans l'importance des crédits accordés et des moyens mis en œuvre par la Seconde République qui prétendit suivre pas à pas cette énorme entreprise, (la sous-série F 80 des Archives nationales, aujourd'hui entreposée à Aix-en-Provence contient les multiples rapports mensuels, trimestriels, annuels qui forment une masse énorme de documents non classés dans laquelle, selon l'historien L. Genet lui-même pourrait se noyer !) la manifestation d'une volonté de promouvoir une grande politique coloniale.
Politique qui voulait mettre un terme à " l'incertitude qui jusqu'ici a plané sur l'avenir de l'Algérie et la coupable incurie du Gouvernement déchu. " annonçait, dès le 2 mars 1848, le gouvernement provisoire dans une proclamation aux colons d'Algérie. La création de quarante-deux villages agricoles apparaissait dans cette optique comme une avancée du front de colonisation en territoire militaire.
Le transport de familles entières en Algérie révélait le dessein de peupler et mettre en valeur une colonie qui pouvait devenir le grenier à blé de la France comme elle l'avait été pour Rome.
Enfin, et surtout, selon les promoteurs de cette colonisation, " rendre vrai cette parole : l'Algérie est une terre française. " (F 80, 1792, rapport de la commission agricole de janvier 1849)
La signification de la politique engagée en Algérie avec les colonies agricoles est difficile à appréhender du fait de la rapide évolution de ce régime pourtant éphémère qui, devenu de plus en plus conservateur, pouvait renier le lendemain l'œuvre commencée la veille ….
Pour tenter simplement aujourd'hui d'apporter quelque lumières sur ce problème, nous essaierons seulement d'établir qui étaient les familles choisies par le gouvernement pour assurer le succès de cette entreprise.
En effet, ceux pour qui la colonisation de 1848 avait été un échec, en rejetant la responsabilité sur le choix qui avait été fait d'ouvriers parisiens pour en faire des agriculteurs.
Ce choix n'ayant à leur yeux, été déterminé que par la volonté de débarrasser la capitale de ses éléments les plus turbulents, des agitateurs tout à fait inaptes à la colonisation agricole. On voit que la personnalité des colons est au centre du débat.
S'il s'avère qu'on a envoyé en Algérie que les " excités de la capitale, insurgés, bons ouvriers en barricades et clubistes distingués " ( Dutrône Commission des colonies de l'Algérie rapport Duverger 1850), on comprendra, que n'ayant en vue que le problème de Paris qu'on voulait débarrasser " d'indésirables " et non celui de la colonie, l'échec ait été au bout de cette politique. Dans le cas contraire d'autres causes seront à rechercher pour expliquer les difficultés rencontrées en 1848.
Mais avant d'en venir à ce problème, il nous a paru utile d'en finir avec une confusion persistante entre les colons de 1848 et les déportés condamnés après l'insurrection de juin qui, de Belle-Isle, ne furent transportés en Algérie que par la loi du 24 janvier 1850.
Nos colons n'étaient-ils pas néanmoins des révolutionnaires ?
Des socialistes ayant échappés à l'arrestation de juin ?
D'autre par ces Parisiens, dont il paraissait si évident qu'ils ne pouvaient se transformer en colons ruraux, ne faisaient-ils pas partie, en fait, de cette frange de " néo-Parisiens ", arrivés récemment dans la capitale en particulier au moment de l'ouverture des ateliers nationaux, population mal intégrée dans la capitale et facilement mobilisable pour la colonisation ?
Dans ce cas ces citadins de fraîche date, n'avaient pas tout de même une expérience de la vie à la campagne.
Ceci établi, permettrait de repousser au rang de calomnies les plaisanteries suspectes qui traînaient dans les journaux et ouvrages de l'époque sur la maladresse et l'incapacité de nos Parisiens " qui avaient peur de leur bœuf " à qui ils donnaient à manger le blé qu'ils confondaient avec l'avoine…, dont les femmes allaient aux champs en bottines à talons, leur ombrelle fanée déployée sur leur tête !...
Un fond d'archives de la préfecture de la Seine, malheureusement incomplet, inexploité jusqu'ici, nous donnent pour deux arrondissements de Paris des renseignements intéressants sur les origines de candidats au départ.
Pour un des arrondissements, et d'une façon inespérée, nous avons trouvé l'indication de la date d'arrivée des candidats colons nés en province !
La liste de ces aspirants colons du IIe arrondissement ancien de Paris (aujourd'hui IXe), comprenant 854 noms, assortie des indications classiques sur :
- La date et le lieu de naissance ; la profession ; l'adresse, nous a paru fournir un échantillon suffisamment représentatif pour nous permettre, avec des renseignements tirés par ailleurs de la sous-série F 80 des Archives nationales concernant les colonies agricoles ou de témoignages contemporains, d'établir un profil du colon de 1848.
Persistance d'un mythe
Malgré les études de Lucien Genet (les colonies agricoles de 1848, in mélange d'histoire, sous la direction de Marcel Emerit, Paris 1949) et de Charles-André Julien (histoire de l'Algérie contemporaine, p.u.f) qui établissaient bien la qualité de volontaires des colons de 1848, ceux-ci sont encore présentés dans un ouvrage récent (Pierre Lafont : la France en Algérie, Plon, 1980 p. 200) comme " des déportés expulsés de Paris avec leurs familles ".
L'auteur, Pierre Lafont, ancien directeur d'un grand quotidien d'Algérie, dont beaucoup se disaient descendants de quarante-huitards " déportés " , et selon Marcel Emerit lui-même, acceptaient mal d'être trompés sur ce point.
Dans une monographie de la colonie agricole de Saint Louis, département d'Oran, (Paul Garcia, Saint Leu, village oranien 1848-1948, Oran, Heintz, 1949) Paul Garcia, instituteur français d'Algérie, présentait ainsi les colons :
" La plupart était des Parisiens, déportés, anciens ouvriers chassés des ateliers nationaux qui avaient combattu contre le gouvernement provisoire, sur les barricades du faubourg Saint Antoine. "
Ainsi, cent ans après, les accusations portées au départ par les directeurs de village, soucieux de se débarrasser de colons indociles en les taxant " d'agitateurs dangereux ", étaient admises sans autres preuves.
La résurgence récente de la confusion des " colons du décret " avec les condamnés à la déportation du fait de l'insurrection de juin 1848, justifiait que l'on ouvre à nouveau le dossier du colon de 1848.
Déportés ou volontaires ?
L'article 2 du décret du 19 septembre 1848 stipulait : " le chiffre des colons qui bénéficieront des dispositions du présent décret ne pourra excéder 12.000 âmes en 1848. " Or la commission de colonisation (MM. Michelet, Richard et Manceaux) créée pour organiser les départs des colons et recevoir les candidatures, fut assaillie d'un nombre tel de demandes qu'elle fut contrainte de dépasser le chiffre imposé car " à l'approche de l'hiver, la misère sévissant, les mairies demandaient avec insistance que le chiffre d'admissions fut plus élevé. "
Les dossiers de demandes affluèrent, tant des mairies de Paris que des communes de province dont les maires suppliaient la commission de prendre en considération l'état de misère où se trouvaient leurs administrés du fait de la crise.
Mais la commission décida de ne pas considérer que les demandes des Parisiens, arguant de leur grand nombre, mais démontrant ainsi le caractère plus que social de cette décision.
La commission d'examens comportait des représentants du peuple (Henri Didier, Dubodan, Beslay, Boissel), un ancien sous-directeur des Affaires d'Algérie au ministère de la Guerre, les maires des VIIe, VIIIe, IXe arrondissements de Paris en plus du maire du XIIe , M.Trélat qui la présidait et du secrétaire général de la préfecture de police O. Reiley….
Autant d'hommes informés des problèmes de Paris et surtout des quartiers populaires de l'Est.
Trois médecins devaient s'assurer de la bonne santé des candidats (leur vigilance fut prise en défaut, on voit même dans les convois des malades et même des aliénés).
Enfin Dutrône, conseiller à la Cour d'Amiens, secrétaire de la société pour l'abolition de l'esclavage et qui était un homme très attentif aux problèmes du peuple.
La commission, en rejetant toute candidature ne parvenant pas de Paris ou de la Seine, révélait ses préoccupations essentielles au sujet de la capitale où le chômage représentait plus qu'ailleurs un danger politique ; mais aussi elle se simplifiait la tâche car il était plus aisé d'organiser les départs à partir de Paris seulement.
Dès le vote du décret du 18 septembre, et sûrement avant l'arrêté ministériel du 27 septembre qui en fixait les modalités d'application, la commission dut se mettre au travail.
Les mairies établissaient les listes de candidats à présenter à la commission d'examen.
Le faible nombre de " refusés " (10 sur 857), indiqué sur la liste du IIe arrondissement, concerne cinq mineurs, quatre " inconnus ", un étranger et montre qu'un tri préalable existait au niveau des mairies qui devaient procéder à des enquêtes.
Par ailleurs, il nous a paru intéressant de dresser une carte des seize départements ayant envoyé le plus grand nombre de dossiers (en dehors de Paris et de le Seine) (rapport de la commission des colonies agricoles du 20 janvier 1849.)
N'esquisse-t-elle pas une géographie de la crise ou des zones les plus touchées par elle ?
Les régions les plus intéressées par le décret du 18 septembre apparaissent nettement :
- Ce sont le Nord-Ouest de la France de l'estuaire de la Seine à la frontière belge, englobant les départements où la crise agricole s'est doublée d'une crise de l'industrie textile encore en grande partie rurale.
- Une autre région se dessine vigoureusement : la région lyonnaise et sa zone d'influence où régnait la crise de l'industrie de la soie.
- L'Est avec l'Alsace et le Jura représentaient également une zone d'industries rurales très atteintes.
- Le département des Bouches-du-Rhône se détache moins en fonction de la crise, semble-t-il, que l'orientation de Marseille vers l'Algérie.
Les département ayant envoyé le plus de dossiers de demandes d'admission sont :
- le Rhône : 1.640,
- le Nord : 1.117,
- la Somme : 1.200,
- Le Pas de Calais : 428,
- la Saône : 356,
- la Seine Inférieure : 328,
- Bouches du Rhône : 245,
- Aisne : 218,
- Seine et Oise : 204,
- Seine et Marne : 160
- Rhin : 116
- Meuse : 84,
- Jura : 52,
- Isère : 52,
- Loire : 52,
- Ain : 18.
L'Assemblée dut porter par un vote nouveau (du 18 novembre 1848) le chiffre des colons de 12.000 à 13.500.
Le ministère de la Guerre organisa alors un seizième convoi pour amener " 400 ou 500 personnes déjà admises (F 80, 1329, lettre du ministère de la Guerre à M. Trelat : 2 décembre 1848).
En fait le seizième convoi comporta 840 personnes … et il ne fut que l'avant-dernier ! Il parait impossible de savoir exactement combien de personnes furent admises au départ, ni surtout combien arrivèrent en Algérie.
Les chiffres diffèrent de quelques centaines selon les documents. Dans un rapport de la commission des Tuileries (F 80, 1792 du 20 janvier 1849) on trouve ceci : " la commission ayant examiné et interrogé 16.115 personnes de tous âges et sexe en a admis 13.972. "
Ce chiffre se retrouve dans un autre document émanant du ministère de la Guerre mais ne se rapporte là qu'aux seize convois des années 1848 et 1849.
Or il y eut un dix-septième et dernier convoi pour lequel nous n'avons pas un chiffre exact.
M. Trelat, président de la commission, se plaignit en effet que celle-ci ait " admis 200 individus au-delà des 26 qui devaient partir de Paris et dont le départ avait été autorisé. " On lui répondit : " qu'il était difficile de réduire à un chiffre bien faible de partants les milliers d'aspirants colons… " et que l'on s'était " permis de ne pas compter les enfants au-dessous de cinq ans ! "
- Ajoutons qu'un certain nombre de candidats admis ne se présentèrent pas au départ…
- Des maris fugueurs disparurent pendant le voyage,
- des amoureux s'envolèrent en route,
- sans compter quelques décès d'enfants en bas-âge ou de personnes éméchées qui tombèrent à l'eau et se noyèrent tant les embarcations étaient surchargées.
Décès compensés, semble-t-il par des naissances. (P F 80, 1329. On lit : une femme vient d'accoucher à Arzew, deux enfants ont succombé dans le voyage…. Il y eu sept naissances dans le dix-septième convoi.).
Il est en tout cas avéré qu'une véritable " ruée " vers l'Algérie se produisit en 1848. Pour le départ du dix-septième convoi, la commission fut même amenée à demander " que l'autorité militaire prenne des dispositions pour que l'ordre ne soit pas troublé lors du départ, quai Saint Bernard, à 9 heures du matin. "
Car " il est possible que quelques personnes profitassent du désappointement occasionné chez beaucoup d'aspirants colons par le petit nombre de ceux qui ont été autorisé à partir pour amener des troubles. "
La commission des colonies agricoles indiquait, quelques mois plus tard à la date du 23 novembre 1849, que 80.469 candidats étaient inscrits à son secrétariat et que 58.170 d'entre eux attendaient depuis plus d'un an la reprise des convois arrêtés en mai.
Certains avaient même commis l'imprudence de vendre leurs meubles avant d'avoir une réponse.
Quelques lettres suppliant de prendre en compte une candidature nous sont parvenues.
Un candidat écrivait jusqu'à trois lettres par jour à la commission. (F 80, 1792. Rapport de la commission du 28 janvier 1849.)
Combien ont été simplement séduits par une propagande abusive qui présentait l'Algérie comme un pays de cocagne ?
Le jeune Truquin (mémoires et aventures d'un prolétaire 1833-1877 édition Tautin 1874) raconte dans ses mémoires que, passant devant la mairie du VIIIe arrondissement, il vit " un beau monsieur qui faisait un tableau enchanteur de ce pays où poussent en abondance les cocos, les dattes, les bananes… le blé surtout y donnait un rendement énorme ".
Il raconte la déception qu'il éprouva en apercevant la côte rocheuse et aride d'Arzew au lieu de la forêt tropicale qu'il imaginait… et qu'il chercha en vain pendant des jours dans les vallées intérieures.
Les arbres, la végétation luxuriante n'existaient que sur le plan de Saint Cloud que l'on fit admirer à Paris aux candidats du départ. (S. Fontanilles, colonies agricoles, Saint Cloud, Oran, 1896.)
A l'évidence les conditions géographiques du milieu méditerranéen étaient tout à fait inconnues de nos aspirants colons et la nature peu généreuse de l'Afrique du Nord devait leur réserver bien des déboires.
La qualité de volontaires ainsi bien établie pour nos colons (dont certains, preuves supplémentaires s'il en était besoin, repartirent aussitôt après avoir mis les pieds en Algérie !), peut-on exclure toute possibilité de pression faite sur quelques indésirables pour qu'ils débarrassent Paris de leur présence ?
Il ne le semble pas, d'autant que c'est ce qui serait produit pour le père d'Eugène François dont les mémoires (Rasteil, à l'aube de l'Algérie française. Le calvaire des colons de 1848, Alger 1930) ont été transcrits par le journaliste Rasteil. Il faut remarquer néanmoins qu'aucun prévenu d'insurrection de juin 1848, Rémy Gossez, qui leur consacre sa thèse, nous l'a affirmé, n'a sollicité son inscription sur les listes de candidats au départ, pour échapper à une éventuelle condamnation…
Des révolutionnaires ?
On a beaucoup dit que le gouvernement avait voulu précipiter le départ des émeutiers des barricades.
Sous la plume même de Henri Lemoine, archiviste de Seine et Oise, les colons sont qualifiés de " meneurs sans scrupules…foule d'ouvriers en chômage, de mécontents, d'intellectuels aigris… (H. Lemoine colons parisiens en Algérie, bulletin de la société d'histoire de paris, 1931) qu'il fallait éloigner à tout prix de la capitale.
Pourtant la commission des Tuileries exigeait des candidats qu'ils fournissent un certificat de bonne vie et mœurs, " ils ne devaient pas avoir combattu contre nous " disaient les instructions.
En effet vouloir débarrasser Paris de ses éléments révolutionnaires, n'était-ce pas risquer par là même de perturber le climat de cette colonisation naissante ?
D'autre part, devant l'afflux de demandes, il s'agissait de faire profiter des largesses de l'État (les colons étaient admis soit comme cultivateurs et devaient à ce titre recevoir une maison et une étendue de terre de 2 à 7 hectares, du cheptel, des semences et une allocution nourriture pendant trois ans, soit comme ouvrier d'art sans dotation de terre) uniquement des hommes " dignes de confiance ".
Les certificats étaient établis par les commissariats de police ou bien parfois par une autorité militaire comme ce lieutenant de la 6e compagnie, 4e bataillon de la première légion parisienne qui " certifie que M. Eugène Dupret s'est trouvé sous les armes dans les journées des 23, 24, 25, 26 juin et qu'il s'est conduit dans nos rangs et brave et digne citoyen. "
Une circulaire du ministère de l'Intérieur recommandait aux maires des communes par où devaient passer les convois de bien accueillir ces futurs colons " honnêtes et braves ouvriers, choisis avec un soin particulier et dignes à tous égards de la sympathie publique. "
A Paris, c'est une foule en liesse qui vient avec les délégués de toutes les mairies de la capitales assister aux départ des colons : " Les berges, les quais, les ponts étaient couverts d'une population immense qui ne s'élevait pas à moins de 40.000 âmes, la rivière était sillonnée en tous sens d'une multitude d'embarcations pavoisées… " (rapport de la commission des Tuileries F 80 1792) C'est d'ailleurs ce que nous donne à voir le journal l'illustration dans son numéro du 14 octobre 1848.
Si le premier convoi n'eut droit qu'à la bénédiction du curé de Bercy (mais au discours enflammé du général Lamoricière, lui-même) le quatrième, lui, vit bénir son drapeau (celui d'El Affroun dans la province d'Alger) par l'archevêque de Paris, accompagné du clergé de Notre Dame….
Monseigneur Sibour a adressé aux colons de pieuses paroles qui, ont profondément émus tous les assistants….
Rien à voir, on s'en rend compte avec le départ des déportés. Cependant, si ce même jour, M Trélat, représentant du peuple, président de la commission des colonies agricoles, exprima dans une chaleureuse et belle allocution toute la grandeur de la mission que ceux de nos frères qui s'éloignent vont remplir au bénéfice de la France et de la civilisation, une certaine méfiance vis-à-vis des partants n'était pas exclue.
C'est le préfet du Loiret qui informe le ministère de la Guerre qu'à la traversée de Montargis " un piquet de dragons assistait au passage du premier convoi. Des ordres sévères étaient donnés pour empêcher le débarquement des colons qui auraient voulu mettre pied à terre et défense expresse avait été faite pour leur délivrer de la poudre. " . " Trois ou quatre seulement ont été remarqués ayant des fusils de chasse " ajoutait le préfet.
On voit aussi la compagnie des chemins de fer d'Arles à Marseille pousser la prévention jusqu'à faire enlever les vitres des wagons qui devaient transporter nos " dangereux " ouvriers parisiens, de peur qu'ils ne les brisent (bien des enfants prirent mal dans les courants d'air froid).
Les rapports quotidiens expédiés à Paris par les accompagnateurs des convois, le long des canaux et des fleuves, jusqu'à Marseille et ensuite sur mer jusqu'aux ports d'arrivée en Algérie, évoquent cependant peu de manifestations " intempestives " de sentiments révolutionnaires.
L'accompagnement du septième convoi relate que le 4 novembre 1848, en passant devant Melun, " quelques bonnets rouges de notre convoi ont crié : Vive la République démocratique et sociale ! Vive Barbès et Raspail ! Nous les aurons ! ". Mais il ajoute rassurant : " J'ai remarqué que ces cris n'étaient poussés que par une bien petite minorité. "
Quelques jours plus tard, il n'y eut plus en passant devant le village de Néré, qu'un seul des colons " coiffé du bonnet rouge ", pour crier aux habitants rassemblés sur le pont : " Vive la République démocratique et sociale ! ", mais " le silence le plus glacial " a accueilli cette manifestation, rapporte note convoyeur, avec satisfaction.
Pour savoir si par ailleurs nos colons adhéraient aux principes de l'association et de l'exploitation en commun des terres, tels que les avaient exprimés les 20.000 signataires d'une pétition lancée par la Société Algérienne juste avant le vote du décret du 19 septembre 1848, on ne peut se reporter qu'à l'attitude qu'eurent les colons une fois sur place et en possession de leur lot.
De nombreux témoignages ne laissent aucun doute sur la volonté de nos colons d'exploiter individuellement leur terre et sur l'âpreté qu'ils mettaient à défendre leur nouvelle propriété.
Un accompagnateur du dernier convoi eut le loisir, arrivé en Algérie, de visiter les villages agricoles déjà installés. " On pourrait penser, dit-il, que les idées de communisme auraient pu s'infiltrer dans ces masses, que le travail en commun serait essayé ; pas du tout : même quand il aurait été utile, le travail en commun a été refusé. "
Ceci est confirmé par de nombreux rapports de directeurs de village qui, même au début, n'ont pu obtenir que les colons , installés dans des tentes ou des baraques, trouvent avantage à faire leur cuisine dans un local commun. (ibid et, en autres témoignages très nombreux F 80, 1318 : quant aux individus sans famille, ils paraissent tous ennemis de l'association et veulent une habitation isolée.)
Ne voit-on pas les colons de Marengo envoyer une pétition contre M. de Maglaive, un des rares bons directeurs de village (les directeurs de villages étaient des officiers) mais qui leur faisait faire le travail en commun.
La commission des Tuileries souligne dans son rapport de janvier 1849 :
" l'espérance de la propriété individuelle a été le véritable stimulant de la colonisation. Quelques-uns sont partis ayant l'esprit plus ou moins imbu de doctrines inapplicables. La Commission a appris par diverses lettres qu'ils se sont promptement modifiés et que ce sont ceux qui font avec le plus de zèle acte de propriété. "
A tel point, apprenons-nous par ailleurs très rapidement (le témoignage est de 1849) : " Les Arabes nomades désertent le voisinage des colons du décret, ils préféraient celui des colons civils qui sont, disent-ils, moins féroces de la propriété. Il suffit du moindre délit commis par les bestiaux arabes pour que les colons du décret en poursuivent rigoureusement la répression. "
D'autre par, le problème de la légitimité de la colonisation elle-même ne semble pas s'être posé à ces républicains qu'on pourrait croire imbus du principe du droit des peuples à disposer de leur territoire.
Y avait-il seulement un peuple dans cette Algérie que l'on devait justement peupler ? Les colons pouvaient en douter.
On leur parlait de " France africaine ", on refusait de les appeler des émigrants ; ils se rendaient dans ce qui n'était qu'un prolongement de la France, dans des villages dont certains, comme :
- Saint-Cloud, Saint-Leu, Rivoli avaient un nom bien familier !
Aller peupler l'Algérie était même présenté à nos quarante-huitards comme une œuvre exaltante au service de la patrie.
N'ont-ils pas transporté des arbres de la liberté pour les replanter dans les villages de colonisation, sans même percevoir la contradiction qui, aujourd'hui nous frappe ? Chaque convoi reçut un drapeau. " La patrie qu'il représentait semblait suivre les colons " nous dit Fantanilles dans sa monographie de Saint Cloud.
Ainsi le colon de 1848, volontaire pour l'Algérie nous apparaît comme un " homme sûr ", peu animé par des idées révolutionnaires ou socialistes malgré la présence parmi eux du frère de Pierre Leroux (F 80, 1413 . Le directeur de Montenotte dit : nous avons parmi les colons le frère de Pierre Leroux 3 mai 1848) et aussi quelques francs-maçons (F 80 1312. Dans l'inventaire d'une malle restée en dépôt sans adresse, on trouve, après le détail d'une garde-robe plutôt bourgeoise, comportant une redingote, un gilet en poils de chèvres, quinze faux-cols… un portefeuille contenant deux brevets de francs-maçons)…
C'est sûrement un républicain attaché à ses prérogatives de citoyen, et qui, à ce titre, ne comprend pas :
- qu'on conteste sa liberté d'expression,
- son droit de participer encore à la vie politique …,
- autant de prétentions qui, avec l'évolution conservatrice du régime, apparaîtront comme de dangereuses idées subversives et serviront de prétexte aux multiples évictions arbitraires dont seraient victimes les colons trop indociles aux yeux des directeurs.
Dutrone qui participait à la grande enquête lancée par l'Assemblé en juin 1849 avant de poursuivre cette colonisation et qui écrivit un rapport contre celui officiel de Reybaud nous dit : " la Commission fut impressionnée de la bonne attitude du langage digne et modéré (des colons) même chez ceux qui lui avaient été signalés comme " hommes politique dangereux ". Il ajoute que " les colons ont entendu avec étonnement.…recommander à des citoyens républicains de ne point s'occuper de politique. " Les colons se seraient écriés : " Autant voudrait dire :
- A bas la Constitution !
- A bas la politique !
- A bas la République !
- Vive le pouvoir absolu !
Ces colons entendus à huit clos par les membres de la Commission, c'est-à-dire hors de la présence des directeurs avaient été désignés par leurs camarades dans chaque village agricole ; un grand nombre fut évincé par la suite.
D'ailleurs " la moitié à peine des délégués de chaque village était digne d'être entendu ", lit-on dans un état nominatif des délégués de la division d'Oran en date du 28 décembre 1849 qui indique que sur 82 délégués : 10 évincés et 6 à évincer." (F 80 1315. L'état nominatif des délégués de la province d'Oran comportant une colonne observations où apparaît l'hostilité déclarée contre les meneurs. "
La confusion tenace entre les colons de 1848 et les déportés nous apparaît par elle-même significative : elle traduit semble- t-il l'assimilation qui se fit dans les faits entre les deux catégories de partants qualifiés, en bloc, de dangereux révolutionnaires.
En effet, bien qu'aucun des déportés de juin 1848 qui de Belle Isle furent transférés au camp disciplinaire de Lambèse ne fut admis dans les colonies de 1848, le régime militaire qui fut imposé aux colons devait induire en erreur : les villages agricoles furent totalement dépendants de l'autorité militaire qui fut :
- seule chargée de la création des colonies agricoles…
- Le service du génie exécute les travaux,
- celui de l'Intendance distribue les vivres et prestations de toute nature aux colons,
- celui des hôpitaux accueille les malades…
En outre les divers corps de troupes fournissent les officiers pour exercer les fonctions administratives et judiciaires ".
Ces officiers, les directeurs des villages furent parfois de bons administrateurs, n'abusant pas de leur pouvoir, mais il semble que ce fut l'exception ; le plus souvent, ils traitèrent les colons comme des soldats de bataillons disciplinaires ; avec les mêmes résultats. (F 80, 1414.Rapport trimestriel sur la colonie de la ferme. L'esprit de cette colonie est tranquille, lit-on dans le rapport de décembre 1850, la tendance de quelques-uns d'entre eux (les colons) à se mêler des affaires politiques a complètement disparu).
CH. A. Julien évoque celui de Pontéba qui obligeait les colons à se lever à 5 heures l'hiver, à 6 heures l'été et privait de vivres les absents.
Il n'était pas le seul : souvent les colons allaient au champ au son du tambour et les punitions du silo (cachot souterrain) étaient fréquentes.
On comprend comment le souvenir de ce colon si peu libre a pu se confondre avec celui d'un déporté.
Répartition, par arrondissement, des 3.607 familles parties de Paris
Nombre de familles Nombre de personnes
Ve 480 1.371
VIe 471 1.307
VIIIe 415 1.410
IIe 381 1.221
VIIe 335 973
IIe 268 680
1er 232 721
Xe 223 646
XIe 213 594
IIIe 213 347
IXe 185 499
IVe 191 410
Les colons de 1848 : des Parisiens mais quels Parisiens ?
Des Parisiens des quartiers populaires de l'Est de la capitale. L'émigration étant une émigration de la misère, cela n'arien d'étonnant : " Il me serait plus agréable, Monsieur le Président, écrit un candidat compagnon menuisier, au Président de la Commission d'admission, de rester en France avec mes amis et mes parents que de partir en Algérie mais le manque d'ouvrage me force à recourir à ce moyen qui, je l'espère, me fournira lieu de travailler et vivre honorablement du fruits de mes labeurs. "
On dut donner 20 francs aux plus nécessiteux pour dégager des affaires indispensable au Mont de Piété.
Dès l'arrivée dans les villages on devrait distribuer des vêtements militaires réformés aux colons " venus presque sans argent " dit le rapport de janvier 1849 sur la colonie d'El-Affroun.
Mais ces Parisiens pauvres séduits en masse par la perspective de devenir propriétaires agricoles, n'était-ils pas arrivés de la province récemment ?
On sait que Paris connut un afflux de population dans la première moitié du XIXe siècle (cf. Louis Chevalier. La formation de la population parisienne au XIXe siècle. I N E D 1950.)
Le rapport de la Commission des colonies agricoles (28 janvier 1849) fait remarquer d'autre part que parmi les 13.972 colons de Paris et de la Seine admis au départ " il n'en est peut-être que 3.000 qui soient nés dans le département de la Seine…. Les autres…. En grande partie enfants de la province trop souvent attirés à Paris par des séductions trompeuses…. Victimes de la crise industrielle ont sollicité de quitter une ville où ils ne voyaient autour d'eux que misère et désespoir. "
Il s'agissait de vérifier ces assertions un peu vagues et qui semblaient animées par un esprit anti-urbain très fréquent à l'époque.
Il fallait établir le plus exactement possible l'origine géographique des candidats parisiens au départ et leur degré d'intégration dans la population de la capitale.
L'échantillon fourni par le registre du IIe arrondissement ( V D 6 , 171. Archives de la Seine IIe arrondissement ancien, 9e actuel) indique que sur 857 candidats colons :
- 206 seulement sont nés à Paris,
- 9 à l'étranger,
- 630 en province
- (pour les 12 restants le lieu de naissance n'est pas indiqué.)
Il nous a paru intéressant de dresser la carte des départements de départ les plus représentés et de comparer ce qu'elle ce qu'elle nous révèle avec les résultats de l'enquête de P. Gaspard sur les origines de la garde mobile nationale.
Lieux de naissance par départements pour 1.000 aspirants colons nés en province.
- Pas de Calais,
- Somme,
- Aisne,
- Seine Inférieure,
- Calvados,
- Seine et Oise
- Manche,
- Oise,
- Aube,
- Marne,
- Meuse,
- Meurthe,
- Haute Marne,
- Haute Saône,
- Cote d'or,
- Jura
- Ille et Vilaine,
- Sarthe,
- Loiret,
- Yonne,
- Vosges,
- Bas-Rhin,
- Ardennes,
- Nord
- Puy de Dôme.
Les départements les plus représentatifs sont ceux du Nord et de l'Est de la France.
Cependant l'Ouest a fourni un contingent non négligeable, alors que les départements des frontières d'Alsace sont moins représentés que pour la garde mobile.
Près des trois-quarts des candidats (73,75%) sont nés hors de Paris, c'est une proportion supérieure à celle qui existait pour l'ensemble de la population parisienne (P. Gaspard : aspects de la lutte des classes en 1848. Le recrutement de la garde nationale mobile, revue historique n° 511, juillet-septembre 1974) mais semblable à celle des prévenus de juin dont P. Gaspard nous dit " qu'un quart seulement déclara une naissance parisienne. "
On pourrait penser que ce gonflement de la proportion des gens nés en province vient de l'arrivée massive des chômeurs des départements dans les six premiers mois de 1848.
En fait ce n'est pas ce qui ressort de l'analyse du registre VD 6.171 des archives de la Seine qui donnent pour les candidats du IIe arrondissement les dates d'arrivée à Paris (cette précision n'est indiquée que pour 443 aspirants colons sur les 630 nés en province.)
Près du tiers des candidats (32,71%) est arrivé entre 1830 et 1840 et particulièrement de 1836 à 1840 (19,62%).
- De 1841 à 1845 (24,57 %)
- de 1846 à 1848 (18,72 %) ont émigré à Paris.
On retrouve les phases d'expansion de la population parisienne telles qu'elles ont été déterminées par L. Chevalier.
Le faible nombre d'arrivants en 1848 infirme la thèse qui assimilait les colons aux chômeurs jetés sur le pavé après la fermeture des ateliers nationaux.
Il n'en reste pas moins que les candidats au départ en Algérie se sont recrutés surtout dans une population arrivée depuis moins de douze ans dans la capitale, ceci pour plus des deux tiers des candidats.
En Algérie même on s'effraya de voir arriver " des artistes, des artisans impropres aux travaux agricoles pour défricher un sol inculte et rebelle ; (l'écho d'Oran 25 septembre 1848). "
Nous pouvons nous reporter à la statistique des professions établie par la commission des Tuileries en janvier 1849 pour avoir une idée plus précise sur la composition socioprofessionnelle des colons.
Les archives de la Seine nous donnent également des indications précieuses pour les candidats du IVe arrondissement ancien, nous trouvons la mention " a travaillé la terre " …, quand il y a lieu.
Lieu de naissance par département pour 1.000 aspirants colons nés en province.
- Seine et Oise : 49,20 %,
- Seine et Marne : 42,86 %,
- Aisne : 36,50 %,
- Calvados : 33,33 %,
- Seine Inférieure ; 33,33 %,
- Pas-de-Calais : 31,75 %,
- Moselle : 30,15 %,
- Somme : 28,57 %,
- Eure et Loir : 23,80 %,
- Gironde : 23,80 %,
- Meurthe : 23 ,80 %,
- Nord : 23,80 %,
- Meuse : 20,63 %,
- Haute-Saône : 20,63 %,
- Côte d'Or : 22,22 %.
Le faible nombre d'arrivants en 1848 infirme la thèse qui assimilait les colons aux chômeurs jetés sur le pavé après la fermeture des Ateliers nationaux.
Il n'en reste pas moins que les candidats au départ en Algérie se sont recrutés surtout dans une population arrivée depuis moins de douze ans dans la capitale.
Ceci pour plus des deux tiers des candidats.
Le document que nous venons d'exploiter n'indique pas si dans le département d'origine, le demandeur habitait la ville ou la campagne.
En Algérie même on s'effraya de voir arriver " des artistes, des artisans impropres aux travaux agricoles pour défricher un sol inculte et rebelle. " (l'écho d'Oran 25 septembre 1848).
Nous pouvons nous reporter à la statistique des professions établie par la Commission des Tuileries en janvier 1849 pour avoir une idée plus précise sur la composition socioprofessionnelle des colons.
Les archives de la Seine nous donnent également des indications précieuses :
Pour les candidats du IVe arrondissement ancien, nous trouvons la mention " a travaillé la terre " quand il y a lieu.
Composition socioprofessionnelle.
Pour permettre une comparaison intéressante avec celle des prévenus de juin et de celle de la Garde mobile établies par P. Caspard, nous avons jugé utile, quoique assez contraignant, de couler nos renseignements dans sa classification par ordre de qualification professionnelle croissante.
Il apparaît que le groupe I, représentant les manœuvres, les domestiques, tous ceux qui, sans qualification ont pu être facilement raflés dans les quartiers populaires de Paris et sont venus grossir les effectifs des prévenus de 1848, a été relativement moins concerné par le départ en Algérie.
Cela parait étonnant et laisse supposer qu'une sélection sévère a été opérée à leur endroit par la Commission d'examen..
Par contre le groupe II des professions exigeant une qualification moyenne a fourni le contingent le plus important des colons (tout comme dans les deux autres populations, 51 % contre 49 % pour les gardes mobiles et 56,3 % pour les prévenus de juin.)
Si nous totalisons l'ensemble des ouvriers, nous voyons qu'ils représentent une forte majorité de partants (61,30 %).
Parmi eux le nombre de menuisiers-ébénistes (552) est le plus fort de toutes les professions présentes.
La crise semble avoir provoqué de forts ravages dans cette profession ainsi que dans celle du bâtiment.
Le groupe III représente les professions très spécialisées ; elles sont deux fois moins représentées chez nos colons que dans la Garde mobile (9,91 contre 18,7) mais d'une manière équivalente à celle des prévenus.
On retrouve une disproportion encore plus grande dans les professions libérales et intellectuelles dont on s'effrayait pourtant qu'elles soient tellement représentées chez nos arrivants en Algérie.
Mais la différence essentielle vient du nombre plus importants des petits commerçants et des boutiquiers tentés par la colonisation (11,21%) par rapport aux prévenus (4,1%) et Gardes mobiles (5,4%).
Les archives précisent que " 341 négociants sont partis " en plus des 91 limonadiers, 69 boulangers-pâtissiers, etc, qui ont dû fermer boutique.
On voit que la crise a atteint en même temps que les ouvriers les commerçants dont ils représentaient la clientèle principale.
La rubrique " jardiniers-laboureurs-divers ", peu représentés chez les Gardes mobiles et les prévenus prend chez nos colons une importance d'autant plus grande que nous y avons inclus aucun " divers ".
318 cultivateurs, c'est le deuxième nombre après les menuisiers-ébénistes ; près de 10% des candidats contre 1,5 à 2,1% pour les deux autres populations en y comprenant les 134 horticulteurs journaliers , au total 452 cultivateurs qui devaient vivre difficilement sur des parcelles de banlieue ont été attirés par l'appât des 10 ha de terres africaine promis par le décret de septembre.
Si on y adjoint les Parisiens nés en province qui ont eu droit à la mention " a travaillé la terre " dans le registre des Archives de la Seine, établi par la mairie du IVe arrondissement (et qui à ce titre ont été retenus en priorité par la commission de recrutement) on a une idée plus précise de la proportion des candidats aptes aux travaux agricoles.
Sur 317 inscrits 30 sont indiqués comme étant des cultivateurs et 61 " ayant travaillé la terre " jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt ans le plus souvent.
L'exemple du " bon candidat " nous est fourni par Léonardy François Joseph " ancien cultivateur ", trente-six ans, où il est connu sous d'excellents rapports.
Il est fort et robuste, sa femme âgée de trente-quatre ans est fille de propriétaire cultivateur, " elle s'est elle-même beaucoup occupée d'agriculture ".
Lorsqu'il y a un doute, on trouve la mention " ils assurent être d'anciens cultivateurs " Un document émanant de la mairie de Sos (arrondissement de Nérac dans le Lot-et-Garonne) certifiant que " le sieur Capot Joseph, natif de la commune de Sos est fils de cultivateur et que lui-même a exercé cette profession jusqu'à l'âge de vingt et un ans " permet de penser que ce certificat était exigé pour avoir droit à, la mention indiquée ci-dessus.
Au total près d'un tiers des candidats avait une expérience plus ou moins ancienne du travail de la terre en comptant les cultivateurs (9,38%).
On retrouve donc bien ce tiers de colons (ou 29,9%) dont parlait la commission des Tuileries pour qui les travaux de la campagne n'étaient pas étrangers. Cependant l'expérience acquise par ces colons l'avait été sous un climat et des conditions écologiques très différentes de celles qu'ils allaient affronter.
Tableau parmi les professions indiquées l'ordre de représentation décroissante
- Bois et ameublement 15,30
- Pierre et bâtiments 12,57
- Petit commerce et employés 11,21
- Métallurgie et mécanique 10,90
- jardiniers, laboureurs, 9,38
- Gardes Mobiles, Gardes Républicains, 6,30
- Textile et confection 5,76
- Manœuvres 5,33
- Marchands ambulants 4,91
- Fabriques de Paris 4,44
- Cuirs et chaussures 4,23
- Graveurs, dessinateurs, sculpteurs 2,97
- Imprimerie 2,90
- Petites industries diverses 2,23
- Professions libérales 1,96
Les terres qui seront offertes au défrichement étaient le plus souvent couvertes de palmiers-nains profondément enracinés dont ne pouvait avoir facilement raison le petit matériel qu'on mettra à la disposition de nos pionniers.
Lucien Genet a fait remarquer que les étendues offertes étaient nettement insuffisantes pour la culture du blé en Afrique du Nord.
Ajoutons que souvent le lotissement ne tenait aucun compte des conditions de relief ou de fertilité pouvant faire attribuer à des malchanceux un terrain en trois parcelles, représentées par des ravins ou des terrains incultivables.
On a déjà dénoncé l'impéritie de l'Administration et en particulier le refus d'accorder à ces hommes de bonne volonté des moniteurs d'agriculture pour les initier aux techniques adaptées au pays …
Ainsi, devant une nature différente, l'expérience acquise par ceux qui avaient " déjà travaillé la terre " nous parait avoir représenté un avantage très relatif…
Il n'est pas certain que ce soient nos agriculteurs du départ qui aient formé ce tiers de colons qui s'est maintenu dans les colonies :
- Un tiers périra,
- un tiers partira,
- un tiers restera, avait-on souvent prédit avec hélas beaucoup de justesse !
Un autre élément pouvait jouer en faveur de l'implantation définitive dans la colonie : C'était la composition familiale.
Age et structure familiale
Le décret du 18 septembre 1848 prévoyait que les colons titulaires devaient être majeurs (sauf autorisation des parents) et âgés de moins de 60 ans.
L'exploitation du registre de la mairie du IIe arrondissement de Paris donnant les dates de naissance des chefs de famille et la composition familiale des candidats au départ nous a permis d'établir un graphique qui fait apparaître, comme on pouvait s'y attendre que la tranche d'âge la plus représentée était celle des vingt-six à quarante-cinq ans ; mais aussi que l'importance numérique des célibataires n'avait pas été surestimée : 1.513 célibataires sur 4.568 colons titulaires et une proportion encore plus forte parmi les ouvriers d'art, 270 sur 370 .
Tels sont les chiffres globaux donnés par la Commission. Notre échantillon traduit les mêmes proportions : un tiers de célibataires parmi les colons titulaires.
Par contre, l'analyse de notre document permet de corriger l'effet subjectif produit par la lecture des différentes relations du voyage et de l'arrivée des colons qui mettent l'accent sur le nombre des enfants amenés par les colons ce qui donnait un caractère encore plus tragique à cette émigration. (P 80, 1413 dans le rapport du colonel Jolivet sur l'arrivée à Ténès le 2 décembre 1848, des colons destinés au village de Montenotte on lit : le nombre des enfants au-dessous de 2 ans est effrayant (52).
En fait d'autres convois ne comprirent que 10 à 15 enfants sur 800 personnes environ.)
En réalité plus de la moitié des colons partent sans enfants (59,57%).
Près des trois quarts des familles avec enfants en ont au maximum deux (74,12%). Voilà qui atténue sensiblement le caractère aventureux des départs.
On trouve une note indiquant que de nombreux candidats s'inscrivent comme célibataires ou, en fait, ont des enfants qu'ils laissent en France.
Cependant on peut penser que ces faux célibataires ne devaient pas être la majorité et de loin car le logement attribué à ces derniers ne devait comporter qu'une seule pièce, au lieu de deux pour les familles.
On a pu regretter la trop forte proportion de célibataires parmi les colons. On les trouvait moins motivés pour la colonisation, ils formaient une population moins facile à ancrer sur le sol algérien, plus indisciplinée, aimant fréquenter le cabaret…
Conclusion
Ainsi un profil de colon de 1848 semble pouvoir être esquissé à partir de ces données. C'est assurément un homme libre qui s'est volontairement lancé dans l'aventure coloniale.
Mais s'il n'a pas été condamné au départ par un jugement de justice, il l'a été souvent par le chômage, la misère. Tout le prouve :
- le quartier populaire où il habite à Paris
- la profession très touchée par la crise qu'il exerce le plus souvent dans l'industrie du bois, du bâtiment, du textile…
Les effets de première nécessité (vêtements, matelas) qu'on doit l'aider à dégager du Mont-de Piété.
S'il est boutiquier ou de petite bourgeoisie, c'est encore la crise de clientèle qui le pousse à partir.
Celui qui s'est laissé emporté par l'emballement de l'exotisme par le goût de l'aventure doit être l'exception.
Cependant il ne faut pas négliger l'importance d'une propagande mensongère qui a fait miroiter aux yeux de ce Parisien, qui regrette souvent sa campagne natale, l'image d'une terre fertile et généreuse.
Notre colon, ouvrier le plus souvent, a vu dans ce départ pour l'Algérie un " retour à la terre ", une occasion de retrouver une liberté et une sécurité perdues dans le système industriel et capitaliste.
" Redevenir son maître " par la possession d'une terre à cultiver et qui lui appartiendra individuellement, voilà qu'elle fut la tentation irrésistible.
Pouvait-il imaginer les épreuves que lui réservait une nature aride, affrontée dans des conditions difficiles ? On lui promettait :
- en plus d'un lot de terre, une maison, des outils, du bétail,
- des vivres pendant trois ans.
Tout lui semblait facile. En fait :
- la maison n'était pas construite,
- la terre était à défricher,
- les instruments insuffisants et souvent inadaptés,
- les vivres pas toujours de bonne qualité.…
Ce colon parti confiant avec sa femme et ses enfants (il en a peu) souvent ses parents ou beaux-parents, déchantera Comme ce parisien, habitué au franc-parler, manifestera parfois bruyamment son mécontentement, on le traitera d'agitateur, de révolutionnaire échappé des barricades.
Cette réputation usurpée le plus souvent amènera à le confondre jusqu'à nos jours avec un déporté de 1848.
En fait ce n'est qu'un républicain attaché à ses prérogatives de citoyen, à sa liberté. Il regimbera devant la discipline militaire, la vie de camp qu'on lui impose comme à une jeune recrue.
Attaché à défendre ses droits, il ne se pose pas le problèmes des Algériens.
La terre qu'on lui octroie a été enlevé aux tribus, il la défendra âprement contre tous les empiètements.
L'arbre de la liberté qu'il replante dans son village n'a de sens que pour lui.
De même que le drapeau tricolore donné à son convoi et sur lequel est inscrit d'un côté le nom de sa colonie agricole, et de l'autre, la devise républicaine " liberté, égalité, fraternité ".
Cette arbre manifeste tout simplement qu'en Algérie il est encore en France.
Colonisateur, ce quarante-huitard parisien deviendra vite colonialiste. (57.F80, 1327. Rapport du gouverneur Pélissier, inspecteur des colonies, octobre 1851 : les colons de Pontéba sont toujours acharnés contre les Arabes. Ceux-ci nourrissent des haines qui se feront jour avec éclat.)
On peut se poser à nouveau le problème de savoir si en envoyant des Parisiens seulement (seul le dix-septième convoi comprendra deux cent gardes républicains lyonnais), le gouvernement provisoire avait fait, du point de vue de la colonisation, un choix si déplorable ?
Ce colon parisien était-il le pire qui puise arriver en Algérie pour assurer le succès de ces colonies agricoles créées à grands frais par l'État ?
Assurément, a-t-on dit, car ce citadin était tout à fait inapte à son nouveau rôle.
Or nous avons vu que souvent ce colon, de par son origine provinciale avait une expérience de l'agriculture.
Expérience que la commission a cherché à détecter comme l'indiquent les mentions explicites du registre du IVe arrondissement de Paris.
Par ailleurs, l'exigence de certificats de bonnes mœurs et les professions représentées laissent apparaître que loin d'avoir encouragé le départ de gens sans métier, d'agités, ouvriers en barricades, la commission semble avoir favorisé les hommes qui avaient eu un contact avec la terre, et aussi ceux qui avaient une qualification professionnelle précise, ouvriers dans la force de l'âge qu'on pouvait supposer courageux au travail.
Or, c'est bien cette ardeur à l'ouvrage qui transparaît dans les premiers rapports des directeurs de villages, ceux-là même qui par la suite incrimineront les colons trop indépendants, trop républicains à leur goût.
D'ailleurs il nous a été donné de confronter le rapport officiel rédigé par Louis Reybaud après l'enquête de 1849 dans les colonies agricoles avec un rapport confidentiel du même auteur, évidemment plus objectif.
Celui-ci rejette la responsabilité de l'échec (à cette date) des villages agricoles non sur les colons dont " la plus grande partie des griefs exprimés ont paru fondés ", mais sur les directeurs des colonies : " partout, affirme-t-il avec force, où le directeur est bon, la colonie est bonne. Dans le cas inverse le résultat l'est aussi. "
Nous avons signalé également le rapport d'un autre membre de la commission, M. Dutrone qui s'éleva contre les accusations (officielles) portées par Reybaud à l'encontre des colons parisiens.
Cependant l'idée l'emportera qu'il ne fallait plus recruter de citadins, et pour les douze colonies nouvelles prévues par la loi du 19 mai 1849 on ne recrutera que des cultivateurs de France ou d'Algérie (non indigènes évidemment) et des soldats d'Afrique libérés (loi du 20 juillet 1850.)
Ces colons plus aptes, à priori à la colonisation agricole et pour la plupart déjà habitués aux conditions climatiques de l'Algérie, ne réussiront ni mieux ni plus mal, que nos Parisiens de 1848.
Ils apportaient ainsi la preuve que l'échec (ou semi-échec, car les colonies agricoles prospérèrent par la suite) était imputable non aux Parisiens mais aux difficultés inhérentes à toute colonisation naissante.
Revue d'histoire moderne et contemporaine.
Tome XXXI. Avril-juin 1984.
|
|
| D'un dictionnaire à l'autre.
Le Robert.
Envoi de M. Christian Graille
|
Rien dans son enfance, ni dans sa jeunesse, ne prédisposait Paul Robert à une carrière de lexicologue.
Pour faire sa thèse sur les agrumes, il était devenu un familier des dictionnaires, certes, mais aucun ne le satisfaisait entièrement.
Il en venait à penser qu'il serait utile, pour mieux rédiger, de pouvoir, en cherchant un mot, trouver des analogies et pas seulement des synonymes.
Mais ce n'est qu'en 1945 que, se mettant à l'étude de l'Anglais il est amené à constituer, pour son usage personnel, un lexique, où, dit-il " les mots s'attirent et s'articulent en eux par un jeu d'associations constantes que seules de longues et patientes lectures peuvent mettre en évidence. "
D'un lexique d'étude, il va presque à son insu, glisser vers la publication d'un dictionnaire de langue.
Si par la suite l'affaire se révéla commercialement intéressante, les débuts furent précaires.
Il dut chercher avec peine parfois des souscripteurs assez hardis pour lui faire confiance et parmi les premiers, ses amis d'Algérie.
L'Académie française, cette très vieille dame du quai Conti, crut en lui dès le début puisqu'elle couronna le premier fascicule, à sa parution.
Puis petit à petit son idée fut reconnue par :
- des universitaires,
- des écrivains,
- des journalistes qui lui apporteront leur soutien.
C'est d'Algérie que vint le premier article de presse.
|
|
| Nos pères les colons …
Envoi de M. Christian Graille
|
|
Quand ils eurent quitté le beau pays d'Alsace,
Alors qu'ils avaient fui pour demeurer français,
Nos grands-parents savaient que nul ciel ne remplace
Celui qu'on a perdu. Tristement ils pensaient :
Je sais que j'ai laissé pour toujours ma campagne,
Que je ne reverrai plus le Rhin ni ma montagne,
Les cascades de fleurs sur les murs des maisons,
Le bleu de nos forêts, la blondeur de nos gerbes,
Notre vignoble roux et ses grappes superbes,
Je sais que j'ai perdu mon rire et mes chansons…
Ils savaient ! Et pourtant dans leur foi généreuse,
Ils avaient entrepris de tout recommencer…
Ils n'imaginaient pas la route aventureuse,
Où la main du destin venait de les lancer…
Les avaient précédés de tous les coins de France,
D'Espagne ou d'Italie, un flot plein d'espérance,
Dont le seul but était de devoir réussir.
Car jamais rien n'arrête un peuple qui décide
De vaincre ou de mourir, volontaire, intrépide,
Que l'épreuve stimule et ne fait qu'endurcir !
Les beaux discours disaient : " Colon ! Vois ! Fertilise !
Ce pays sera tien, la vigne y poussera "…
Et dans la Canaan qu'on leur avait promise,
Les pauvres malheureux mouraient du choléra !
Les plaines croupissaient dans de noirs marécages,
Et la fièvre qui tue étendait ses ravages,
Tandis que vers la mer dévalaient des coteaux
Couverts de palmiers nains et de sombres lentisques,
De grands rochers pointés comme des obélisques
Où se cachaient parfois de dangereux couteaux…
Voilà ce qu'était notre Californie !
Mais nos pères étaient de la race des forts,
Ils avaient décidé que jusqu'à l'agonie
On les verrait lutter en redoublant d'efforts !
Ils s'étaient acharnés, attaqués aux broussailles,
Ensanglantant leurs mains aux tranchants des rocailles,
Et quand dans les marais qu'ils avaient asséchés
Fleurissent les vergers, grandissent les vignobles,
Leurs travaux de géants en avaient fait des Nobles !...
Ce sont ces crimes-là qu'on leur a reprochés…
Je n'ai jamais compris que la fin fût si noire…
Quand on est un rêveur on ne peut pas juger.
Rien ne peut arrêter la marche de l'histoire :
Les uns gagnent au jeu, d'autres se font gruger…
Refusant de subir le poids de tant de haine,
Il nous a bien fallu refoulant notre peine,
Choisir d'être exilés pour vivre en liberté…
Mais qu'on ne traîne pas l'œuvre de nos grands-parents
Dans la fange ou l'oubli ; Car en plus de leurs terres
Ils nous avaient légué leur part d'humanité.
Mme de Riche Muller Maryse.
|
|
| Algérie : Armée.
Envoi de M. Christian Graille
|
| Faut-il à l'Algérie une armée spéciale ?
La question de savoir si l'Algérie devait avoir son armée ou s'il ne valait pas mieux y envoyer de France, à tour de rôle, les divers régiments, a été vivement controversée. Les raisons données à l'appui de chaque opinion méritent d'être examinées avec soin.
Les partisans d'une armée spéciale font ressortir le caractère nouveau et tout particulièrement que prend la guerre en Afrique. Là, en effet, au rebours de ce qui se passe en Europe, il y a :
- peu de sièges,
- peu de batailles mais en revanche
- beaucoup de petits combats.
Un ennemi prompt à la fuite et presque insaisissable profite, pour se dérober aux poursuites, des avantages qui lui offre un terrain très difficile : Il y a donc là, pour les corps venant de France, un apprentissage à faire, et le défaut d'expérience peut entraîner, comme on en a vu plus d'un exemple, les plus funestes conséquences.
On ajoute que le climat, agissant d'une manière fâcheuse sur les régiments nouvellement débarqués, réduit considérablement l'effectif, de sorte que dans le cas possible assurément d'une guerre européenne, les communications avec la Métropole venant à être interceptées, l'armée ne pourrait réparer ses pertes.
Tous ces inconvénients disparaîtraient, dit-on, avec une armée :
- propre au pays, le connaissant bien,
- rompue au genre de guerre qui s'y fait, et parfaitement acclimatée de manière à pouvoir toujours entrer en campagne dans la plénitude de ses forces.
On répond dans le système contraire que si, en Algérie, le soldat n'apprend pas la grande guerre, il y trouve de nombreuses occasions de se former, de s'endurcir à ce mépris des fatigues et du danger qui seront toujours la véritable base de l'éducation militaire : c'est là, pour l'armée entière, un avantage inappréciable en temps de paix, avantage qu'elle ne saurait trouver dans les loisirs des garnisons de France.
Quant à ce qu'on allègue au sujet de l'inexpérience des troupes nouvelles et de la funeste influence du climat, il est facile d'y remédier en laissant pendant quelques mois les nouveaux corps dans les garnisons du littoral et en les encadrant ensuite, pour les employer à un service actif, dans des troupes déjà formées. Cette dernière opinion a toujours prévalu dans la pratique : on a seulement créé quelques corps destinés spécialement à l'Algérie et donnant aux autres troupes une coopération basée sur l'expérience.
En général ces créations ont amené les meilleurs résultats. Ajoutons ici, en faveur du système adopté de préférence, une considération importante, et qui, pour ne pas être exclusivement militaire, n'en a pas moins une grande valeur, c'est qu'un séjour de quelques années en Algérie ne peut manquer d'exercer sur l'armée toute entière, sur les chefs comme sur les soldats, une très heureuse influence.
Il est certain que le contact de cette immuable race arabe, si bien douée sur certains rapports, que le spectacle de cette forte et grande nature du midi, déjà révélée à la France lors de l'expédition d'Égypte, réagissent d'une manière salutaire sur l'esprit des troupes, et ont pour effet d'élever chez elles le niveau moral et intellectuel.
Et, à ce point de vue, ce n'est pas là le seul avantage de l'envoi successif des régiments à leur rentrée en France, rapportent avec eux la connaissance et le goût de la nouvelle colonie.
Ils les propagent sur toute la surface du pays et ils rallient de tous côtés, à l'œuvre difficile entreprise, des sympathies et d'utiles adhésions.
Augmentation de la cavalerie.
On a réclamé, à diverses reprises, l'augmentation de la cavalerie destinée à agir en Afrique, mais les diverses objections ont été faites et les hommes du métier eux-mêmes se sont trouvés partagés.
Une remarque incontestable et que tout le monde a pu faire, c'est que la cavalerie doit être particulièrement propre à poursuivre, à atteindre un ennemi dont la force principale consiste en cavalerie, et qui, plus d'une fois, n'a dû son salut qu'à l'extrême agilité de sa marche.
Il est possible toutefois que la difficulté de se procurer des fourrages, en expédition, soit un sérieux embarras ; mais cet obstacle tend à disparaître par l'établissement sur divers points, de postes-magasins suffisamment approvisionnés et par les dispositions moins hostiles d'un certain nombre de tribus qui ne demanderaient pas mieux que de céder l'excédent de leurs récoltes.
Il est d'ailleurs certain que si, malgré l'insuffisance des moyens actuels, Abd-El-Kader a été, en diverses rencontres, sur le point d'être saisi, on aurait eu de bien plus grandes chances de le prendre en lançant à sa poursuite une troupe bien montée, connaissant à fond le pays, et pouvant rivaliser de vitesse avec ses cavaliers.
Application de l'armée aux travaux publics.
L'armée a été employée en Afrique à l'exécution des travaux publics, et, dans cette nouvelle sphère d'action elle a rendu et rend tous les jours encore de signalés services.
Il s'est néanmoins produit à ce sujet quelques scrupules et on a posé la question de savoir si, au terme de la loi constitutionnelle, le soldat pouvait être astreint à donner autre chose que le service militaire.
On a soutenu que si l'armée, sous l'ancienne monarchie, n'était guère qu'une vaste réunion de mercenaires, à peu près étrangers à la nation et ne possédant aucuns droits, les choses avaient dû complètement changer du jour où l'armée, recrutée sur toute la surface du pays, était devenue une portion même de la nation, plus spécialement chargée d'assurer, au dehors comme à l'intérieur, l'action des pouvoirs publics.
Ce principe est sans doute fort juste ; il est bien évident qu'aujourd'hui, et il faut s'en féliciter, l'armée, à côté de ses devoirs a ses droits ; il est certain que, pour tout ce qui dépasse ses obligations précises, on ne peut faire appel qu'à sa bonne volonté et son dévouement.
Appliquons cette règle à l'emploi de l'armée aux travaux publics et constatons tout de suite les grands avantages de cet emploi.
Il donne les moyens d'exécuter les travaux aux meilleures conditions en raison :
- du nombre, de l'intelligence, de la forte organisation et du modique salaire des travailleurs.
Il préserve le soldat :
- de l'oisiveté, fortifie son corps et occupe utilement son esprit.
Il aide enfin puissamment à la transformation tendant à s'opérer en Europe dans le rôle des armées qui changeront de plus en plus leur action de force purement destructive contre une mission plus élevée de protection, de production même.
Maintenant et pour se borner à ce qui se passe en Algérie, il est permis d'y considérer l'exécution des travaux publics comme faisant partie intégrante du service militaire ; car ces travaux, tout en préparant la prédominance de la race européenne,
- facilitent la prompte répression des révoltes,
- tendent même à en prévenir le retour et
- profitent d'ailleurs directement à l'armée en diminuant l'insalubrité du climat.
Constatons du reste, que l'objection, due à un très louable sentiment, à la crainte de voir exploiter le soldat n'est jamais sorti du domaine de la théorie et que le plus heureux accord s'est établi, en Algérie, entre les divers membres de l'armée, accord fondé sur la justice des uns, sur la bonne volonté des autres, et grâce auquel les travaux les plus importants ont pu être entrepris et menés à bonne fin avec zèle et émulation.
Camps retranchés.
On a proposé d'installer les troupes dans de grands camps en dehors et loin des villes. Il y a utilité, sans aucun doute, à concentrer l'armée dans un certain nombre de fortes positions, d'où elle puisse rayonner au premier appel pour étendre au loin une protection efficace.
Ce système doit être préféré à celui des petits postes qui ont le défaut, comme les évènements ne l'on que trop prouvé, d'affaiblir les troupes et de les réduire même à l'impuissance par suite d'une grande dissémination.
Mais il aurait, d'autre part, plus d'un inconvénient à vouloir, d'une manière absolue, placer les corps d'occupation en dehors des villes.
Ce qu'il faut chercher avant tout, c'est la position la plus avantageuse au point de vue militaire : si cette position se trouve en dehors de toute habitation, ce n'est pas une raison pour y renoncer ; de même que si l'emplacement d'une ville paraît favorable, les troupes doivent, sans hésitation, y être installées.
A cet égard du reste, une remarque qu'on a pu vérifier plus d'une fois depuis la conquête, c'est qu'une ville ne tarde pas à se fonder sur les points où un corps de troupes un peu considérable se trouve établi en permanence.
Administration des Arabes.
- Les Indigènes doivent-ils être administrés par des chefs pris parmi eux ?
- Doivent-ils l'être directement par des officiers français ?
- Cette importante question a été, en théorie et en pratique, résolue successivement dans les deux sens.
- Écartons d'abord tout parallèle historique.
- En Algérie les circonstances au milieu desquelles on s'est trouvé ont été si neuves qu'il est pour le moins inutiles de chercher ailleurs que dans la question même les éléments de la solution. Les partisans de l'administration par des chefs indigènes soutiennent, avec raison, qu'il est très dangereux de vouloir s'immiscer dans les affaires particulières des tribus.
- En présence des différences de toutes natures, des antipathies même qui séparent les deux races mises en présence par la conquête, vouloir tout surveiller, tout réglementer chez un peuple profondément jaloux de son indépendance, c'est, disent-il, provoquer imprudemment des résistances qui se traduisent en fin de compte (et de nombreux exemples ne l'on que trop prouvé) par des assassinats et l'insurrection. L'autorité française ne doit donc intervenir que pour placer à la tête des tribus les chefs indigènes qui présentent le plus de garanties de fidélité.
- Dans un système contraire on a répondu que ces chefs ne sont le plus souvent, par la force même des choses, que des ennemis déguisés ; et si malheureusement des crimes isolés ont été commis sur la personne d'officiers français, on peut bien mettre en balance les nombreuses et funestes trahisons des chefs indigènes investis et soutenus par la France.
Il est possible d'ailleurs de respecter, dans certaines limites, l'indépendance intérieures des tribus ; mais il ne faudrait pas, sous le prétexte de ne s'immiscer en rien dans leurs affaires, renoncer à toute action sur elles ; et comme, en définitive, le contact entre les deux races existe de fait, il faut bien chercher à le rendre de moins en moins hostile, résultat que peut seul atteindre l'administration juste et habile d'officiers français. Ce sont là de bonnes raisons.
Restitution des villes.
On a proposé que les villes occupées antérieurement par les Arabes, et où ils ont été chassés depuis l'occupation, par suite des évènements de la guerre, leur fussent en partie restituées. Ce serait, a-t-on dit, une preuve :
- de force, de justice, de bienveillance qui désarmerait bien des haines.
Il est très vrai qu'un des plus puissants moyens de rapprochement entre les deux peuples, c'est une exacte justice dans les relations réciproques ; mais pour ce qui est de la mesure proposée, les Arabes pourraient fort bien ne voir qu'une marque de faiblesse dans ce qui serait présenté comme une réparation, et leur hostilité qui tient tant à de causes, ne se trouverait que très peu diminuée.
En fait, cette restitution, pratique peut-être tant qu'il ne s'est agi en Algérie que d'une simple occupation militaire, a cessé d'être possible du jour où l'on a adopté le parti, non seulement de dominer le pays mais de le coloniser.
Port d'Alger.
On sait que l'ancien port d'Alger, suffisant pour les bâtiments de commerce, était trop étroit et trop peu profond pour recevoir des navires de guerre. Le port militaire d'Alger, dont l'exécution se poursuit en ce moment, a pour but principal :
- non pas de défendre la ville contre une attaque par mer (car il aurait suffi pour cela de fortifier convenablement l'ancien port),
- non pas même de doter la France d'un grand port militaire sur la Méditerranée (qu'elle possède déjà à Toulon), mais d'assurer, pour toutes les circonstances, le transport des régiments en Algérie et en outre d'offrir à la flotte française, en cas de désastre, un refuge certain.
On se souvient des obstacles de tout genre qu'éprouva en 1830, le débarquement de l'armée française. La création du nouveau port aura pour effet de prévenir, dans toutes les prévisions, le retour de ces difficultés. D'autre part les grandes questions politiques tendent de plus en plus à se dessiner sur mer et les évènements les plus importants s'accompliraient, en cas de guerre maritime, dans le bassin de la Méditerranée.
Il y a donc tout avantage aujourd'hui que l'utilité des ports de refuge est universellement reconnue, à posséder, vis-à-vis des côtes de France, un port vaste et sûr dans lequel pourraient s'abriter des vaisseaux de guerre à la suite d'un grave désastre ou de fortes avaries.
Des divers projets mis en avant à ce sujet, deux ont particulièrement fixé l'attention :
- Le premier surnommé le grand projet, était conçu sur de très larges proportions, mais l'exécution devait être longue et dispendieuse.
- Le petit projet, beaucoup plus restreint, a été adopté avec certaines modifications, et les travaux, qui ont déjà coûté plusieurs millions, s'en poursuivent avec lenteur.
Mesures diverses. Forage de puits artésiens.
Transport des pèlerins à la Mecque.
On a récemment, et sur différents points de l'Algérie, foré avec succès des puits artésiens. C'est là une excellente mesure dans une contrée où se fait surtout sentir le manque d'eau : ce précieux élément, amené à la surface du sol, le vivifiera promptement et en renouvellera bientôt l'aspect.
Il faut se représenter l'Algérie comme offrant de grandes ressources, ou tout à fait inconnues, ou paralysées en partie par une mauvaise exploitation.
Rien de ce qui tend à révéler ces ressources et à les féconder ne doit être négligé ; et, sous ce rapport, les puits artésiens occupent le premier rang.
D'ailleurs, à un point de vue général, l'entreprise et le succès de pareils travaux ont une portée plus haute ; ils apparaissent aux indigènes comme le signe irrécusable de notre supériorité ; et il ne faut rien moins, pour convertir de rebelles intelligences, que ces heureux miracles de la civilisation.
On sait tout le prix qu'attachent les Arabes à faire le pèlerinage de la Mecque, cette capitale religieuse du mahométisme.
On sait aussi que ce pèlerinage est long, difficile et trop dispendieux pour le plus grand nombre.
Transporter aux frais de l'État les pèlerins d'Alger à Alexandrie et leur éviter ainsi la partie la plus pénible du voyage est une mesure, en voie d'exécution depuis quelques années, qui a déjà produit les meilleurs résultats.
Pratiquée sur une large échelle, elle servirait de récompense aux Indigènes qui se seraient signalés par leur fidélité et leur dévouement ; et l'une de ses conséquences les plus heureuse serait de démontrer aux Arabes, par un exemple frappant, que la France n'a jamais entendu de les opprimer dans leur foi ni dans leur culte.
Colonisation civile. Colonisation militaire.
La colonisation militaire et la colonisation civile ont eu longtemps leurs partisans exclusifs. On a cependant fini par transiger et les défenseurs les plus ardents de chacun des deux systèmes eux-mêmes admis, dans certaines limites, le concours du système opposé.
On a dû reconnaître que l'armée, admirable pour préparer la colonisation, était radicalement impuissance à l'accomplir à elle seule. Qu'on songe, en effet, au temps qu'il faudrait, en n'admettant que des colons militaires, pour peupler d'une manière un peu satisfaisante ce vaste territoire de l'Algérie.
D'un autre côté, les colons civils, abandonnés à eux-mêmes, risqueraient fort de voir leurs travaux et leurs sacrifices n'aboutir qu'à une vaste dévastation et à la ruine. Le concours de l'armée offrirait d'abord toutes facilités pour exécuter les travaux d'utilité générale, avec :
- soin, promptitude, économie.
- Puis les colons militaires, qui seraient pris dans son sein, occuperaient à l'avantage commun les avant-postes de la colonisation à laquelle ils serviraient de rempart. En arrière seraient groupés les colons civils qui, avec le temps, créeraient sur le sol une population forte et condensée.
Ces colons eux-mêmes, exposés, malgré toutes les mesures, à la possibilité d'attaques imprévues, devraient contracter, jusqu'à un certain point, l'esprit et les habitudes militaires, et pouvoir, en cas d'urgence, se protéger contre un coup de main. Cette nécessité, qui existera longtemps en Algérie, explique le système et les exagérations des partisans exclusifs de la colonisation militaire.
Colonisation civile. Systèmes divers.
Il s'est produit au sujet de la colonisation civile deux systèmes principaux et opposés : On les résume d'un mot en disant que :
- dans l'un de ces systèmes, la colonisation serait faite par de petits propriétaires, et
- qu'elle le serait dans l'autre par l'intervention de grands capitalistes.
On s'est fondé dans un sens sur la nature toute particulière de l'entreprise tentée en Algérie et sur les dangers de divers genres qui, pour longtemps encore, attendent les nouveaux colons.
Pour vaincre les obstacles toujours renaissants, il ne faudra pas moins, a-t-on dit, que le concours des stimulants les plus énergiques, et il en est peu d'aussi puissants que l'esprit de propriété, avec les heureuses conséquences qui en découlent. Ce n'est qu'à l'aide de ce principe fécond qu'on parviendra à établir sur le sol et à y implanter une population :
- agricole, laborieuse, forte,
- sérieusement attachée à une terre qu'elle aura défrichée et faite sienne, et toujours prête à tout braver pour en conserver la possession.
Cette opinion, soutenue avec opiniâtreté, a recruté surtout ses défenseurs dans les rangs de l'armée, et il n'y a rien là dont on doive être surpris.
Il est naturel que les militaires :
- désintéressés par profession,
- toujours prévenus contre ce qui peut étendre l'influence de l'aristocratie d'argent et
- sincèrement attachés d'ailleurs à une colonie dont la conquête leur est due, redoutent pour elle :
- la cupidité sans frein,
- l'exploitation sans pitié, et, par suite,
- la démoralisation des travailleurs,
- le paupérisme et
- les maux de toute nature qui signalent trop souvent les grandes entreprises industrielles .
Dans le système contraire, qui trouve surtout ses partisans dans l'ordre civil, on répond qu'il y a en réalité très peu d'inconvénients et beaucoup d'avantages à procéder par grandes concessions.
D'abord ce serait un notable soulagement pour le Trésor que de faire concourir, dans des proportions importantes, les capitaux privés à l'œuvre dispendieuse de la colonisation.
On éviterait ainsi à l'État les incessantes réclamations des petits colons, qui, au moindre revers, ne manquent pas de tendre les bras vers lui et l'accusent amèrement s'il ne satisfait pas à leurs exigences ; puis, et c'est là un grand point, la colonisation marcherait nécessairement beaucoup plus vite.
On échapperait enfin aux funestes chances du découragement, trop fréquent malheureusement, qui résulte, chez les petits cultivateurs, du sentiment de leur faiblesse et de leur impuissance individuelles.
Chaque travailleur ne pourrait plus, sans doute, se parer du vain titre de propriétaire mais tous seraient assurés d'obtenir une rétribution proportionnée à leurs efforts, et d'avoir une certaine part dans les bénéfices.
L'intérêt même du grand propriétaire les garantirait contre :
- les éventualités des maladies,
- des mauvaises récoltes,
- de tous les malheurs en un mot, qui dans le système des petites concessions, avaient pour conséquence infaillible la ruine et la misère des colons.
Quant aux inconvénients qu'on a paru craindre, il serait facile de les prévenir au moyen des conditions et charges à imposer aux grands concessionnaires et d'ailleurs la surveillance générale serait toujours réservée à l'État.
Ces deux systèmes du reste, chacun de leur côté, mis à l'épreuve en Algérie, mais dans des circonstances très défavorables, et de maintenir qu'il n'a pas été possible de se former une opinion suffisamment arrêtée sur leur valeur respective. Des expériences ont toutefois eu lieu récemment et il est permis d'en attendre, dans un temps rapproché, une solution sérieuse et complète.
Droits et obligations de l'État.
La colonisation de l'Algérie a traversé diverses phases.
Commencée au milieu de l'anarchie la plus entière, qui n'enfanta que ruines, elle subit plus tard, à la suite d'une réaction exagérée, une réglementation minutieuse, et la vie artificielle qu'on parvint à lui faire ne se soutint qu'à force de sacrifices.
On a cependant fini par comprendre qu'une part assez large devait être laissée à la liberté individuelle du colon, part sans laquelle celui-ci ne saurait jamais concevoir, pour le sol qu'il cultive, cet attachement durable et sincère qui fait surmonter bien des obstacles.
Il est juste également qu'en raison de la complication et de la difficulté des circonstances, la liberté du colon se trouve encadrée dans une organisation fortement conçues.
Le point difficile et important, c'est d'associer dans une juste mesure les deux principes de liberté et d'autorité.
L'administration supérieure, en arrivant à une bonne solution, rendra un signalé service à l'Algérie.
Si l'on adopte dans une certaine proportion, le principe de la colonisation militaire, il faut s'entendre sur la part à laisser dans les profits au soldat cultivateur.
En principe, il est de toute justice que les bénéfices se trouvent partagés entre le colon qui fait l'avance de son temps et de ses soins et l'État qui donne au travailleur :
- la terre, et de sécurité.
Dans le système de la colonisation civile, il faut distinguer, pour connaître les obligations de l'État entre la colonisation de grands capitalistes et celle par de petits propriétaires.
Dans la première hypothèse l'État n'a pas d'avances à faire ; il concède, à certaines conditions, et sous certaines charges, une étendue plus ou moins grande de terrain ; c'est ensuite l'affaire du concessionnaire :
- de trouver des colons,
- de prendre des arrangements avec eux et
- de les établir sur le sol.
Dans le système des petits propriétaires, l'État contracte d'importantes obligations. Pour que la mise en culture devienne possible, il doit :
- faire l'avance de la terre et des instruments agricoles,
- exécuter en outre certains travaux d'utilité générale
- et parfois même fournir aux colons l'habitation.
On ne peut se dissimuler que ce serait-là de lourdes charges ; si cependant on devait en être dédommagé par de larges résultats, il n'y aurait pas à reculer devant la gravité des sacrifices ; car en Algérie, plus encore que partout ailleurs, il faut savoir semer pour recueillir.
Concours des étrangers.
Il n'y a pas d'inconvénients et il y a beaucoup d'avantages à assurer à l'œuvre de colonisation algérienne, le concours de populations étrangères.
Il serait même fort utile de détourner, au profit de l'établissement nouveau, le remarquable mouvement d'émigration qui, depuis le siècle dernier, s'est manifesté en divers États européens ; on arriverait ainsi à accroître avec rapidité et dans une importante proportion la population de la colonie et ce serait là, il ne faut pas l'oublier, le point capital pendant longtemps.
D'ailleurs la France n'accomplit pas en Algérie une œuvre mystérieuse et égoïste : la conquête a eu en grande partie pour but, et aura pour résultat, d'élever à la civilisation une importante portion du Nord de l'Afrique.
Il n'y a certes là rien qu'on ne puisse avouer hautement et, par conséquent, il n'y aurait point de motif pour refuser systématiquement toute coopération étrangère.
Posons néanmoins une restriction.
La France en effet qui n'a pas besoin de se montrer exclusive, ne doit pas abdiquer non plus, et il importe que, par le chiffre de sa population civile, et par celui de son armée, elle demeure toujours, en fait comme en droit, directrice suprême de la colonie.
Algérie : questions spéciale J. Lainné,
Avocat à la cour royale de Paris. Édition 1848.
|
|
| Les tirailleurs algériens.
Envoi de M. Christian Graille
|
I - Origine des tirailleurs algériens.
Plus généralement connus sous le nom de turcos, ils ont été institués par ordonnance royale du 21 mars 1831 sous le nom de zouaves, en arabe zouaoua, nom que portent les tribus de la Grande Kabylie :
- les plus fières,
- les plus intrépides,
- les plus indépendantes de toutes les confédérations kabyles.
Leur soumission ne fut complètement achevée qu'en 1857 par son Excellence le Maréchal Randon qui bâtit le fort Napoléon au cœur même de la Grande Kabylie. Arabes de la plaine, Kabyles de la montagne furent enrôlés avec les premiers volontaires de la Chartre, que le Gouvernement dirigea sur l'Afrique pour grossir les deux bataillons de première création, dont les brillants exploits devaient bientôt les faire connaître et admirer.
- Commandés par des officiers français,
- tous volontaires, jeunes,
- plein d'énergie et de courage,
- animé du meilleur esprit militaire,
Ils débutèrent le 17 novembre 1830, par l'expédition de l'Atlas, commandée par le Général Clauzel.
Leur histoire est liée à celle des zouaves jusqu'au 7 décembre 1841 époque à laquelle les indigènes furent organisés et administrés séparément.
Il ne faut pas juger trop sévèrement les quelques fanatiques exaltés qui, dans les premières années de notre conquête, ont tourné quelquefois contre nous l'instruction militaire que nous leur avions donnée pour obéir à leurs chérifs qui, le Coran à la main, leur prêchait la guerre sainte.
Ces faits sont rares et ils ne se sont jamais produits qu'isolément.
Il est bon de citer ici le fait suivant :
La 5e compagnie du 2e bataillon du 2e régiment, commandée par le lieutenant Blanpied, forte de 65 hommes (n'ayant pour cadre français que le sergent-major Berger, un sergent et un caporal), a été surprise à quatre heures du matin le 8 avril 1864 à Aïn-Bou-Beber (province d'Oran), par des milliers de dissidents des Ouled-Sidi-Cheik et Harras.
Cette compagnie a combattu héroïquement autour de son chef et du commandant de la colonne, le colonel Beauprêtre.
Les braves turcos répondirent par des balles aux sollicitations de leurs fanatiques coreligionnaires qui leur promettaient la vie sauve s'ils consentaient à jeter leurs armes ; tous ont vendu chèrement leurs vie ; un seul homme (un clairon), criblé de blessures, a pu se traîner jusqu'à Géryville, porter la nouvelle de ce sublime désastre.
Une fois séparés des zouaves, les tirailleurs furent successivement organisés en bataillons provisoires, puis définitivement, sous la dénomination de bataillons de tirailleurs indigènes :
- d'Alger, de Tittery, d'Oran et de Constantine.
En 1855 on créa un bataillon par province.
En 1856 on les organisa par régiments à trois bataillons et ils sont aujourd'hui à quatre.
II - Organisation et composition des tirailleurs.
Actuellement Il existe aujourd'hui trois régiments de tirailleurs ; chaque régiment est composé de quatre bataillons à sept compagnies. Chaque compagnie est commandée par un officier français qui a sous ses ordres :
- un lieutenant et un sous-lieutenant français,
- un lieutenant et un sous-lieutenant indigènes
- un sergent major et un fourrier français,
- deux sergents et deux caporaux français,
- quatre sergents et huit caporaux indigènes.
- Les régiments n'ont ni musique ni compagnie hors-rang.
De la musique on peut s'en passer, mais il serait très utile, dans l'intérêt des officiers et des soldats, d'organiser une compagnie hors-rang, en prenant pour base l'effectif des régiments, dans le cas où l'on persisterait à vouloir maintenir les tirailleurs en régiments, chose contraire aux intérêts de la France.
L'organisation en bataillons d'éclaireurs fusionnés avec les zouaves rendrait de grands services à la guerre.
Les régiments n'ont pas de dépôt ; chaque compagnie a ses recrues que l'on admet au bataillon au fur et à mesure que leur instruction le permet ; dans le cas de mise en route d'un bataillon, la 7e compagnie devient dépôt et reçoit les indisponibles. Tous les tirailleurs sont engagés volontaires mais dans des conditions différentes des soldats français.
Cette organisation en régiments à quatre bataillons a de grands inconvénients, l'organisation en bataillons formant corps nous parait préférable à tous points de vue.
Il n'est guère possible au Colonel qui a son régiment dispersé, comme celui de Constantine, en quatorze détachements, du littoral au désert, de bien connaître son personnel ; l'administration est fort difficile les nombreux mouvements amènent des plus ou des moins perçu considérables :
- les envois d'effets,
- le service de la solde,
- la correspondance,
- tout se fait avec une extrême lenteur et de grands embarras.
Quand une guerre éclate, on se hâte de former des régiments ou des bataillons provisoires comme cela est arrivé pendant les guerres :
- de Crimée, d'Italie, du Sénégal, de Cochinchine, du Mexique.
Chacun des régiments a fourni tantôt un bataillon, tantôt deux compagnies et l'on est arrivé devant l'ennemi avec un esprit de corps que nous renonçons à décrire.
C'est pour des motifs :
- d'homogénéité,
- de confiance mutuelle et
- de discipline qu'il conviendrait d'organiser les tirailleurs en bataillons ayant leurs magasins sous la main, leur État-Major près d'eux, et toujours prêts à marcher tout constitués.
Mais si, pour des raisons qui nous sont inconnues, l'organisation par régiment a sa raison d'être, il conviendra de dédoubler les régiments et d'en former six à deux ou trois bataillons.
Ne pourrait-on pas former dans chaque régiment une compagnie à part, dite de vétérans, composée de tirailleurs qui, pour cause de blessures ou de vieillesse, sont incapables d'entrer en campagne ?
Purger ainsi les compagnies actives et confier à ces invalides un service de garnison compatible avec leur âge ou leurs infirmités qui n'ont pas nécessité leur admission à la retraite ?
On a reconnu l'utilité de monter les capitaines de tirailleurs, en vue, sans doute, des fonctions qu'ils remplissent ; et ce qui le démontre, c'est que le capitaine trésorier et le capitaine d'habillement ne le sont pas.
Tous les capitaines détachés dans les affaires arabes devraient donc laisser à ceux qui remplissent leur fonction au régiment le cheval de la compagnie.
N'est-il pas juste qu'un officier qui commande une compagnie ait à sa disposition les mêmes moyens d'agir qu'avaient le capitaine qu'il remplace ?
Il arrive souvent, par suite du grand nombre d'officiers français employés dans les affaires arabes, que des sous-lieutenants français soient désignés pour commander des compagnies pour l'Administration seulement.
Le lieutenant indigène, dans ce cas, prend le commandement de la compagnie pour les détails du service.
Cette mesure amène souvent de fâcheuses discussions qui n'arrivent pas à l'autorité parce qu'il répugne de réclamer ou de se plaindre, mais le service en souffre ; il ne peut y avoir sans inconvénients deux commandants de compagnie à la fois ; il est des rapports intimes entre l'Administration et la discipline.
Une punition de prison, par exemple, amène naturellement la question de la solde, de l'ordinaire et par conséquent la question d'administration que l'officier français seul peut juger et trancher.
Le sous-lieutenant français sait administrer et peut commander une compagnie ; le lieutenant indigène ne le pouvant pas, aux termes du règlement, nous pensons qu'il serait plus raisonnable que le sous-lieutenant français la commandât seul dans toutes les positions, du moins tant que les officiers indigènes seront illettrés.
III - Caractère du turco ; ses aptitudes.
Le turco est un grand enfant qui s'imagine que de Marseille à Paris il y a trois étapes parce qu'il a fait la route en trente-six heures par le chemin de fer. Il aime :
- les poupées, les joujoux, les marionnettes
- et apprécie fort peu les œuvres d'art ; c'est ce qui explique cette passivité stoïque, cette indifférence avec laquelle il traverse Paris sans rien admirer ni sans rien remarquer.
Paris plaît aux tirailleurs mais ils ne commencent à l'apprécier un peu qu'à leur rentrée en Algérie ; alors ils racontent dans les cafés maures les merveilles qu'ils ont vues, en les exagérant avec conviction, et ils finissent par regretter leur séjour dans la capitale. A l'heure qu'il est, ils demanderaient tous à aller à Paris.
Le turco est coquet, il aime à faire la fantasia au petit pied et à s'affubler de couleurs voyantes.
Naïf au début, il ne tarde pas à devenir malin au contact des anciens, des zouaves et des troupes de ligne, qu'il appelle grand-capotes et dont il cherche à copier les défauts et les qualités en commençant par les premiers et en les exagérant les uns et les autres.
(Ici nous ouvrirons une parenthèse pour dire que beaucoup d'officiers intelligents qui connaissent bien les tirailleurs sont d'un avis contraire au nôtre ; peut-être jugent-ils mieux !
Ils prétendent que l'Arabe est essentiellement malin par nature ; sa naïveté, disent-ils, n'est pas de bon aloi ; il dissimule pour mieux pénétrer nos pensées, nos intentions à son égard, afin de mieux nous tromper. Nous ne sommes pas de cet avis.)
En Italie nous avons vu des tirailleurs partager leur pain et leur tabac avec des prisonniers autrichiens.
Par contre, s'il y a lieu de châtier des ennemis cruels qui auront commis des atrocités envers les nôtres, le turco se chargera de la besogne ; il agit alors en véritable enfant du Prophète : malheur aux infidèles qu'il aurait ordre de détruire !
S'agit-il d'exterminer de ses coreligionnaires insurgés, le turco s'en chargera encore avec la même ardeur, mais, cette fois, mû par le désir de donner à ses officiers la preuve de son dévouement à la cause française (l'affaire Beauprêtre, par exemple, où malheureusement ils ont eu le dessous.)
Le turco chaparde quand il en trouve l'occasion, et fait l'aumône sans ostentation ; il est de toutes les souscriptions en faveur des malheureux ou des camarades.
Qui n'a vu les tirailleurs au départ pour une expédition, heureux de pouvoir jeter quelques pièces de monnaie à un saint homme accroupi devant une Kaaba vénérée.
Le Coran faisant du reste une obligation de l'aumône, l'Arabe la pratique dès son enfance surtout à l'égard des Zaouïa (établissement religieux et scolaire pouvant héberger des étudiants et des touristes.)
Les plus grandes qualités des tirailleurs algériens doivent être tournées vers la guerre ; nous leur prédisons un grand avenir si réellement on peut en tirer le parti que nous croyons, car :
- ils supportent tous les climats,
- ils sont braves infatigables,
- ils campent en Romains sans craindre les fièvres,
- s'ils n'ont pas de pain, ils mangeront de l'herbe ou
- feront ramadan jusqu'à nouvel ordre,
- intrépides marcheurs, si le soulier les gêne, ils le jetterons dans un fossé et feront la route pieds nus sans se blesser.
- Dans la mauvaise fortune ils ne se plaignent point,
- ils aiment leurs chefs,
- ils restent disciplinés, obéissants et dévoués ;
En un mot nos tirailleurs d'aujourd'hui sont des Numides de Jugurtha :
- braves, intrépides, de la plus grande sobriété et bons cavaliers.
Cette aptitude a été utilisée au Mexique où l'on avait formé des compagnies à cheval qui ont rendu de bons services.
A la guerre il convient de les lancer par bandes, commandées par des officiers français de la première bravoure, dans lesquels ils ont confiance ; ils se précipitent en poussant des cris épouvantables qui effraient l'ennemi quel qu'il soit. Il est difficile de résister à cette fougue avantageuses quoique désordonnée ; mais il est indispensable de faire soutenir leur attaque par des troupes françaises, coude à coude derrière lesquelles ils iraient se rallier en cas d'insuccès, car alors ils perdent la tête et ils battent en retraite, effarouchés comme des chevaux arabes qui auraient pris le mors aux dents.
Ils sont sujets à la panique et ils s'y livrent avec plus d'abandon que les soldats français ; cela tient à leur caractère plus ardent que réfléchi et à leur habitude de combattre, bien rendue dans leurs fantasias par des charges et des retraites précipitées.
En Afrique, ils ne laissent jamais entre les mains des Kabyles leurs camarades tués ou blessés ; ils considèrent avec juste raison cette faute comme très grave car elle aurait pour résultat d'affaiblir la valeur des combattants (Les Kabyles, on le sait, ne font pas de merci ; tout prisonnier est cruellement mutilé avant d'être tué. On finit généralement par lui couper la tête.)
Mais en Europe cette qualité est un grand défaut qu'il faudrait absolument corriger par des théories et des exemples de la dernière sévérité car le chiffre des combattants s'affaiblirait d'une manière sensible ; tous ceux qui sont restés blessés sur-le-champ de bataille et qui ont bien observé ce qui s'y passe doivent certainement nous comprendre.
En matière de religion le turco est indifférent à la pratiquer, sans cesser toutefois d'être fanatique.
L'Arabe fait ses prières en public ; il s'agenouille là où il se trouve, sans s'inquiéter de ceux qui l'observent. Le turco ne le fait jamais :
- il boit des liqueurs fermentées et souvent enivrantes,
- il mange l'hallouff (porc) et
- fait rarement ramadan ; cependant il ne plaisante jamais ses camarades qui, plus scrupuleux, demandent à l'observer.
Dans les régiments indigènes, jamais les tirailleurs ne se sont froissés dans leurs croyances religieuses ; aucune pression n'est exercée sur eux ; ils sont complètement libres sur ce point ; le canon français leur annonce, ainsi qu'à tous les Arabes, le lever et le coucher du soleil et leurs mosquées sont entretenues par nos soins.
IV - Cadre français.
Nous avons parlé du caractère des tirailleurs indigènes envisagé sous ses beaux côtés et principalement au point de vue militaire.
Toutefois ils n'en sont pas moins Arabes ou Kabyles aux mœurs et aux coutumes que nous connaissons. .
Nous, nous hâtons de dire que la soumission la plus parfaite à leurs chefs rend la tâche moins difficile, mais elle n'en est pas moins une rude besogne qui demande de grands soins, une extrême patience et surtout beaucoup de dévouement.
Les Français qui arrivent pour servir aux tirailleurs quel que soit leur grade, débutent en général, par s'engouer (s'enthousiasmer) de leurs hommes.
- Leur manière de se tutoyer,
- la liberté de leur jeu,
- leur langage,
- leur naïveté,
- tout chez eux porte naturellement à l'indulgence.
On trouve les tirailleurs grands enfants et presque toujours une raison pour excuser leurs fautes légères que le roumi (chrétien) ne manque pas de mettre sur le compte de leur ignorance.
Le roumi a quelquefois raison, mais souvent il se trompe, surtout s'il a affaire à un ouled plaça (soldat recruté sur les places publiques). Quelque temps après :
- quand on croit les mieux connaître,
- qu'on a reçu quelques reproches par leur faute,
- qu'on a pu remarquer que chez eux la malice dépasse parfois l'ignorance,
- on finit par tomber à leur égard dans l'extrême contraire.
On ne constate plus alors que :
- leurs travers,
- leurs maladresses,
- leur manque d'éducation,
- leurs défauts éclipsent leurs qualités,
- leurs naïvetés sont prises pour des sarcasmes,
- leur langage même devient insupportable,
- et l'on finirait, croyons-nous, par les détester, s'il était possible de détester des hommes qu'on élève pour les mener.
On reste longtemps dans cette opinion extrême, à moins que des circonstances de guerre ne viennent hâter le retour à des sentiments plus modérés et plus justes. C'est en apprenant à les connaître qu'on apprend à les aimer.
- Ceux qui les ont vu infatigables après de longues journées de marche dans les sables du Sud, souffrant la soif et toutes espèces de privations sans se plaindre,
- ceux qui les ont vu à la guerre, quand la charge sonne, s'élancer plein d'ardeur, sous une pluie de plomb, ont pu les apprécier, et quand on est sans préventions et que l'on tient compte :
- de leur race,
- de leurs mœurs et
- de leurs coutumes,
- on ne peut s'empêcher d'éprouver pour eux une certaine sympathie.
V - Cadre indigène.
Les officiers sont choisis parmi les sergents et nommés par décret du chef de l'Etat. Ils jouissent de tous les droits dévolus aux officiers français, moins les avantages qui constituent l'état de l'officier car il est révocable et dans aucun cas il ne peut commander une compagnie.
L'avancement des sous-lieutenants indigènes est exclusivement donné au choix.
Le cadre indigène est la cheville ouvrière de la compagnie.
Déjà formé aux exigences du service militaire, fait à la discipline et aux coutumes françaises, il transmet plus directement et plus sûrement aux soldats les qualités qu'il tient du cadre français.
Le capitaine habile, qui sait tirer parti de son cadre indigène, arrive en très peu de temps à former une bonne compagnie, sans avoir besoin de recourir aux punitions de prison.
Les officiers et sous-officiers indigènes, en stimulant le sentiment national, parviennent, par des remontrances et des moyens dont ils ont le secret, à corriger les mauvais soldats par les bons.
Le meilleur résultat qu'un chef puisse obtenir en campagne est certainement la discipline faite et maintenue par les hommes.
Les salles de police et de prisons ne sont pas encombrées d'hommes exempts de service, qui donnent du mal à tout le monde et jettent le désordre dans les compagnies : le désordre d'une compagnie peut se mesurer au nombre de punitions infligées.
Qui n'a pas entendu dire qu'il ne fallait pas faire d'officiers indigènes ?
Cette opinion ne nous parait ni juste, ni généreuse.
Des hommes qui versent leur sang à côté de nous et pour notre cause, des hommes de guerre dont la plupart sont couverts de blessures reçues au service de la France, ne seraient pas faits officiers indigènes parce qu'ils ne savent pas lire dans un livre ou se tenir à table à notre façon !
Peut-on s'empêcher d'admirer les lieutenants, déjà décorés, qui, sachant bien qu'ils n'avaient aucune récompense à obtenir, sont partis pour la Crimée, ont fait toute la campagne et, s'ils n'ont pas été tués, sont revenus sans récompenses, avec une ou deux blessures de plus ?
Il y en a qui sont allés dans les mêmes conditions :
- en Italie, en Cochinchine, au Mexique ou contre l'Allemagne, n'ayant aucun espoir qui stimulât leur ardeur.
De tels officiers ont droit à toutes nos sympathies et à la sollicitude du Gouvernement.
Un lieutenant indigène qui est déjà chevalier de la Légion d'honneur et qui se distingue à l'ennemi devrait être fait officier de la Légion d'honneur tout aussi bien qu'un caïd.
On pourrait également leur donner des concessions de terrain pour eux et pour leurs familles ou bien des places de caïd ou de cheiks, vrais moyens d'entretenir l'émulation dans les rangs, et, qu'on le remarque bien, leur manière de servir en garnison se ressent de cet arrêt.
On pourrait exiger de lui quelques conditions d'aptitudes de plus. Tout officier devrait savoir lire et écrire le français ; à cet effet il faudrait donner encore plus d'extension aux écoles régimentaires et surtout à l'organisation des enfants de troupe.
Une question mérite d'être étudiée en faveur de l'officier, c'est celle du mariage. Quelques-uns, maintenant que la série des retraites commence pour eux, demandent à se faire naturaliser Français au moment de quitter le service, comptant, par ce moyen, donner droit à leurs femmes, en cas de mort, à la partie de la retraite affectée aux veuves des officiers français.
Ne serait-il pas possible de leur appliquer une loi qui fût compatible avec la loi musulmane et la question de la dot, et qui permît à la veuve d'élever convenablement ses enfants ?
VI - Des rapports entre le cadre français et le cadre indigène.
Nous pensons que leurs rapports ne sont pas toujours ceux qu'ils devraient être pour des hommes qui travaillent en commun pour la même cause. La bonne harmonie, les liens moraux qui devraient unir étroitement les deux cadres, dans :
- l'intérêt du service,
- des succès au combat et
- du progrès civilisateur n'existent point.
Sans doute il n'est pas fort amusant de jouer du matin au soir le rôle de mentor auprès des indigènes et un tel dévouement n'est pas de tout le monde, mais il n'est pas moins vrai que la sympathie et le bon esprit de camaraderie ne sauraient exister sans la fusion morale des cadres.
Pour arriver à ce résultat il ne faut rien moins que de l'abnégation. Si le cadre français savait persuader au cadre indigène d'abord, et aux tirailleurs ensuite que tout ce qu'il dit et fait est dans son intérêt et qu'il leur témoignât de l'affection, on ne saurait s'imaginer jusqu'où irait alors l'esprit de dévouement et de soumission des indigènes.
Le marabout le plus influent perdrait son temps à leur prêcher la guerre sainte. L'officier français qui a su gagner la confiance des indigènes peut compter sur eux dans toutes les circonstances.
La puissance morale chez les bons officiers des bureaux arabes qui administrent le pays a plus d'influence sur leurs Caïds que nos baïonnettes.
- Mais si, se souciant fort peu des sympathies du cadre indigène et des tirailleurs,
- si indifférent à la mission qui lui incombe, le cadre français tient de mauvais propos contre la nation arabe et exagère les défauts de leur race,
- s'il néglige de prêter son concours au cadre indigène dont il a le plus grand besoin, il ne doit guère compter sur lui.
VII- Avancement.
Il y avait beaucoup à dire sur l'avancement dans les régiments de tirailleurs mais depuis que le mode d'avancement a été modifié les objections ont diminué en nombre et en importance.
En composant le cadre français d'hommes choisis sous tous les rapports ont devrait lui faire quelques avantages non seulement sous le rapport de la solde mais sous le même rapport de l'avancement en mettant, par exemple, hors cadre tous les officiers des bureaux arabes qui appartiennent à ces régiments.
Nous déplorons que des sous-officiers, après un long séjour aux tirailleurs alors qu'ils ont appris à parler la langue arabe et à connaître leurs hommes soient nommés officiers dans des régiments de ligne tandis qu'ils auraient fait d'excellents officiers de tirailleurs.
Les avantages de cette mesure (nous les connaissons parfaitement) peuvent satisfaire la théorie ; mais dans la pratique les inconvénients sont autrement graves ; nous ne saurions trop le répéter, il est indispensable que les tirailleurs connaissent leurs chefs.
VIII - Solde et masses.
Le décret organique du 7 décembre 1841 dit que les officiers des tirailleurs auront droit à la solde de l'infanterie légère en Afrique.
Evidement on a voulu dire la solde des bataillons d'Afrique c'est-à-dire la solde progressive comme la perçoive les zouaves.
La solde progressive est donnée pour l'entretien ou le renouvellement du matériel de campagne ; rien n'est plus rationnel et plus juste que cette solde progressive à laquelle tous les officiers d'Afrique devraient avoir également droit.
Ceux des tirailleurs sont probablement victimes d'une erreur typographique car si la solde progressive est légitiment due, n'est-ce pas surtout aux tirailleurs algériens qui occupent les garnisons les plus avancées vers le Sud où tout se paye fort cher ?
Les officiers indigènes, eux, n'ont pas droit à l'entrée en campagne parce qu'ils sont natifs du pays mais, comme nous, ils ont à se pourvoir du matériel de campagne.
Un sergent qui est nommé sous-lieutenant indigène et qui n'a droit qu'à une indemnité de quatre cent cinquante francs de première mise, est un homme qui s'endette au début de sa carrière et qui ne peut plus se libérer, attendu que les officiers indigènes vivent avec les officiers français et qu'ils font les même dépenses. Il n'y a plus de raison pour que ces officiers n'aient pas droit à l'entrée campagne comme les officiers français.
Dans le temps ils vivaient chez eux à la mode arabe ; ils pouvaient à la rigueur se tirer d'affaire ; mais les nouvelles prescriptions sont arrivées et c'est ce qui nous a fait dire plus haut que l'harmonie des règlements des tirailleurs est rompue.
Examinons maintenant le tarif de la solde des sous-officiers et des soldats ; en y jetant un coup d'œil, on verra qu'un caporal indigène est mieux rétribué que son sergent-major.
Nous, nous refusons à écrire les effets produits par cette mesure ; en la signalant à l'autorité nous croyons accomplir un devoir.
Il est humiliant pour un sous-officier qui se présente chez son capitaine avec sa section pour toucher sa solde, de recevoir un prêt moindre que ses caporaux.
Ces procédés font naître la jalousie et la haine dans les meilleurs cœurs.
L'adjudant avant deux ans touche huit centimes de moins que lorsqu'il était sergent-major.
- Puisque les tirailleurs sont des corps spéciaux,
- que les sous-officiers qui y sont employés doivent remplir des fonctions très difficiles qui demandent de plus grandes aptitudes que dans les régiments de ligne, il nous paraîtrait juste que leur solde fût en rapport avec celles de leurs subordonnés. Cette mesure a dû être appliquée par analogie avec la solde des régiments de zouaves ; mais dans ces régiments l'anomalie que nous signalons n'existe pas et dans aucun cas le supérieur ne touche une solde moindre que celle de ses subordonnés.
Étude sur les tirailleurs algériens par
A. Mattei, capitaine au 124e de ligne. Édition 1873
|
|
| L' EXCESSIVE COVID
De Hugues Jolivet
| |
Un cadeau de la Chine, mais un présent morbide,
Evadé d'un étal aux aliments putrides :
Extraits de chauve souris, de pangolin, fétides.
Il agresse les humains, commet un génocide.
Depuis un an déjà, le Chef qui nous préside
Lutte contre l'intruse qu'on baptise "Covid",
Prescrit masques, couvre-feu, observance rigide.
A défaut, des amendes, la punition perfide !
Toutes les mesures prises deviennent insipides
Lorsque des commerçants envisagent le suicide.
Fermés depuis des mois, les restaurants sont vides.
Dîner en clandestins, des clients sont avides !
Mais les ordres sont les ordres, la Police impavide
Force les portes secrètes des marmitons cupides,
Et dresse procès verbal, si leur chef le décide.
L'amende est indigeste, même à l'huile d'arachide !
A quand la dernière page de cet éphéméride
Célébrant la victoire contre l'excessive Covid ?
Car l'espoir des vaccins reste une lueur timide
Face aux tacles incessants des "variants" intrépides !
Hugues Jolivet
Le 9 février 2021
|
|
|
| De la colonisation en Algérie.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
I
J'avais déjà fait un premier voyage en Afrique, lorsque j'y fus envoyé en qualité d'inspecteur de colonisation.
Après un séjour de deux mois, consacrés à l'étude des ressources et des besoins commerciaux du pays, j'employais quelques jours qui me restaient, avant mon départ, à visiter les terres des environs d'Alger.
En traversant la plaine de la Mitidja, où, à côté des marais fiévreux, se déroulaient devant moi d'immenses terres arides et sans cultures.
Où, si loin que mon œil put s'étendre, je ne voyais partout qu'une végétation :
- sauvage et
- parasite,
- flétrie,
- brûlée par l'ardeur du soleil,
- je ne trouvais pas un d'arbre pour me servir d'abri, je ne pus me défendre d'un sentiment profond de tristesse et de découragement.
Je me disais que cette terre ingrate et insalubre n'indemniserait jamais la France des sacrifices qu'elle s'était imposée pour en faire la conquête.
Heureux et fier de la gloire de notre jeune armée, je me demandais :
- si sous son sang généreusement répandu,
- si ses efforts et son courage,
- son héroïsme et
- ses souffrances, ne seraient pas perdus pour nous ?
Mais lorsque pénétrant plus avant dans la plaine, j'eus enfin rencontré quelques sources d'eau vives et courante, dont l'action salutaire tempérait les ardeurs de ce soleil de feu, lorsque, sur la partie de terrain arrosé, je vis s'élever une végétation vigoureuse et puissante au-delà de toute expression, frappé par ce contraste dont je voyais à la fois la cause et les effets, j'examinai avec plus d'attention les terres que j'avais parcourues.
J'étudiais la nature et la configuration du sol ; peu à peu mes premières impressions s'effacèrent pour faire place à des pensées d'espoir et d'avenir.
Je vis alors cette plaine, qui d'abord m'avait paru aride et insalubre, partout recouverte d'une couche végétale, dont l'épaisseur et la fécondité dépassent celles de nos meilleures terres de France ; il me semble que les eaux qui se perdent par les infiltrations souterraines ou dans des marais fiévreux, pouvaient être facilement recueillies et utilisée.
Poussant plus loin mes désirs d'amélioration et de progrès, j'en vins à me demander ce qu'il en coûterait à la France pour :
- dessécher ces marais et
- creuser des canaux d'irrigation alimentés par les cours d'eau qui traversent la plaine, au moyen de barrages ou de digues, dont les Romains, nos devanciers en Afrique, nous ont laissé tant et de si beaux restes.
J'ai hâte de le dire, ces travaux ne sont pas impossibles et la dépense nécessaire, pour les exécuter, ne devrait pas arrêter un gouvernement qui comprendrait : les avantages qu'il pourrait en obtenir.
- Avec un plan bien étudié,
- de sages économies,
- un emploi intelligents de l'armée et des colons,
- l'exécution de ces travaux serait facile et peu dispendieuse ; on obtiendrait pour résultat d'assainir la plaine, de donner abondamment du travail et du pain à ceux qui n'en ont pas dans la métropole.
Le cœur plein de ces idées j'acceptai avec empressement le poste qui m'était offert ; et sans trop rechercher si mes nouvelles fonctions étaient un exil ou une disgrâce, je partis pour l'Afrique, heureux de contribuer activement à la colonisation de ce beau pays.
Il ne m'a pas été donné de m'associer longtemps à cette œuvre, que je persiste à regarder comme une des plus importantes et des plus utiles entreprises de la France. Je suis resté peu de jours en Afrique, mais je les ai consacrés à l'étude du progrès et des besoins de la colonisation.
Ce nouvel examen a confirmé toutes mes impressions premières ; aussi, malgré les essais malheureux qui ont été faits, je n'ai pas cessé d'espérer et de dire, avec M. Fortin d'Yvry : " J'ai foi dans l'Algérie comme en une nouvelle France, dont la conquête est assurée et dont les ressources sont aussi vastes que le territoire est étendu et varié. "
Première partie.
Premiers obstacles à la colonisation.
La guerre et les fièvres ont été les grands obstacles qu'a rencontrée d'abord la colonisation :
- Quand nos hôpitaux recevaient tous les jours de nouveaux malades,
- quand les Arabes, conduits par un chef habile et infatigable, se montraient partout hardis et menaçants,
- la confiance ne pouvait s'établir ; les travailleurs et surtout les capitaux ne vont que là où il y a pleine et entière sécurité ; et pour coloniser, il faut de l'argent et des bras.
L'insuccès des premiers colons est venu aggraver les difficultés. Les travailleurs, et plus encore les capitalistes, qui déjà s'aventuraient difficilement en Afrique, ont été effrayés de ces résultats.
- Leurs craintes,
- leurs répugnances,
Se sont accrus à tel point, que la colonisation par l'industrie privée ne sera désormais possible que lorsque le gouvernement, prenant l'initiative, aura prouvé par le succès que le succès est possible, certain.
Ceux qui ont échoué ne veulent pas avoir tort ; ils attribuent leurs malheurs :
- au sol, au climat, au gouvernement, à l'usure, à tout enfin,
Excepté :
- à leur imprudence,
- à leur ignorance,
- au leur manque d'argent et de direction,
Et pourtant ce sont là les causes principales de leurs misères :
Comme leurs malheurs sont, les plaintes incessantes et unanimes, on a ajouté foi en leur parole, on les a crus sans examen, et peu à peu s'est accréditée cette opinion,
- qu'en Afrique la santé de l'homme dépérit et se perd vite,
- que la terre, dure au travail, ne donne que peu ou point de produit,
- que le gouvernement ne veut rien faire pour encourager et protéger les colons
Opinion funeste qui a eu pour effet :
- de décourager ceux qui avaient le plus d'ardeur,
- de rendre indifférents ceux qui espéraient encore et voulaient entreprendre,
- et de généraliser cette pensée mensongère
Qu'il n'y a rien à faire en Afrique !
Un examen approfondi des essais de culture faits en Algérie, nous fera connaître les véritables causes de la ruine des premiers colons ; il nous montrera tout ce qu'il à d'exagéré et de faux dans l'opinion qui s'est accréditée.
Quant à moi, je n'hésite pas à affirmer, dès à présent :
- que l'Algérie peut et doit être colonisée,
- que le climat, le sol et l'État peuvent assurer aux colons, santé bien-être et protection,
- que la colonisation n'est pas seulement possible, mais que, dès qu'on le voudra, elle deviendra facile,
- enfin, qu'elle doit être immédiate ; car c'est seulement par elle que la France conservera sa conquête.
La prise d'Abd-El-Kader a mis fin à la guerre ; l'Algérie est désormais à l'abri de ces attaques meurtrières et inattendues qui ont mis tant de fois à l'épreuve les forces et le courage de notre brave armé.
Mais il ne faut pas conclure de là que l'Arabe soit partout soumis ou résigné.
Pendant longtemps encore ce peuple :
- altier et
- fanatique,
Supportera difficilement le joug de ceux qu'il regarde comme des usurpateurs de ses biens, les ennemis de sa foi.
Pour le contenir et le réprimer au besoin, une force imposante sera indispensable. Sans entrer dans l'examen des grandes questions, qui aujourd'hui occupent tous les esprits, on peut se demander si pour telle éventualité qu'il est sage de prévoir, nous ne serons pas forcés de réduire considérablement l'effectif de l'armée d'Afrique et si l'état de nos finances nous permettra de maintenir le budget de l'Algérie au chiffre élevé, mais nécessaire, auquel il a été porté.
Dans ce cas :
- où trouver une force suffisante pour remplacer les soldats ?
- Comment alléger la France du sacrifice énorme qu'elle s'impose ?
- Telle est la première question à résoudre, car il faut assurer la conquête avant de rien entreprendre.
Or, ce que nous indiquons comme une éventualité hypothétique, peut devenir bientôt une nécessité absolue.
Cette question n'a qu'une solution possible : La colonisation.
C'est évidemment par elle et par elle seulement qu'on obtiendra les hommes et l'argent nécessaires, indispensables.
Hâtons-nous donc de coloniser l'Afrique, car déjà la question de l'Algérie pourrait être ainsi posée : Ou la colonisation ou l'abandon.
Hâtons-nous ! Car la colonisation n'aura pas seulement pour effet de rendre plus facile et moins dispendieuse la défense du sol que nous avons conquis.
Elle sera en outre pour :
- les négociants,
- les industriels,
- les ouvriers de la métropole
Une source certaine de bien, être et de richesse.
- Si malgré les victoires de notre armée, il faut encore soixante ou quatre-vingt mille hommes pour garder l'Algérie,
- si un budget de quatre-vingt à cent millions est aussi indispensable,
- si la France ne peut, à l'avenir, s'imposer de si grands sacrifices en hommes et en argent, enfin
- si la colonisation peut seule suffire à ces exigences, on peut dire que nous touchons au moment suprême qui doit décider du sort de notre colonie.
En effet au moyen du crédit de cinquante millions votés par l'assemblée constituante, l'État a commencé un grand essai de colonisation ; si cet essai ne réussit pas, la colonisation n'est plus possible et l'Afrique est perdue pour la France !
Quel est le capitaliste qui voudrait exposer sa fortune et le cultivateur sa famille dans une entreprise où le gouvernement aurait échoué avec ses immenses ressources ? Evidemment, il ne se trouverait plus en France, ni un homme, ni un écu pour coloniser l'Algérie.
Au moment où j'écris ces lignes, les résultats de cet essai sont connus ; on sait que les colons envoyés en Afrique en 1848 sont, malgré d'énormes sacrifices, aussi malheureux que leurs devanciers ; mais on sait aussi que cet essai n'était pas sérieux, que ce n'était pas la colonisation qu'on avait pour but lorsqu'on a envoyé en Algérie les ouvriers sans travail de Paris et de Lyon.
On sait, enfin, que les causes qui ont empêché ces colons improvisés de réussir, sont indépendantes du sol et du climat de l'Afrique.
La commission envoyée en Algérie par le ministre de la guerre a fait connaître quelques-unes de ces causes.
Je me borne à dire, quant à présent, que cet essai, stérile et très coûteux, ne préjuge rien et que la question de la colonisation reste entière.
- La dignité,
- l'honneur,
- l'intérêt de la France sont engagés en Afrique.
Nous avons eu la gloire de détruire ce repaire de la piraterie qui, de Malte à Gibraltar, désolait la Méditerranée et rendait la navigation dans ces parages si dangereuse aux navires de commerce.
Les nécessités de la guerre, une politique sage et prévoyante ont agrandi le but de la première expédition ; la conquête a été résolue.
Cette œuvre grande et difficile, l'armée française l'a accomplie avec constance et courage.
Aujourd'hui nous sommes maîtres de cette belle et riche contrée qui donne :
- à notre marine plus de deux cents lieues de côtes,
- à notre industrie un débouché et d'immenses ressources,
- à nos ouvriers sept mille lieues carrées de terrains à cultiver.
- Notre marine,
- notre commerces,
- nos fabriques ont déjà gagné à l'occupation de l'Algérie.
Ces premiers avantages seront décuplés, lorsque les richesses de ce beau pays seront connues et convenablement exploitées.
Dans nos campagnes et plus encore dans nos villes une population nombreuse manque souvent de travail et souffre même dans les temps de calme.
Dans les jours de stagnation et de crise, elle endure toutes les horreurs de la misère et de la faim. Cette population, d'abord :
- pleine de sève et de vie, laborieuse, intelligente,
Les souffrances et les privations de toute sorte :
- l'affaiblissent, l'énervent, la démoralisent et la corrompent.
Elle trouvera en Afrique le travail et le bien-être ; et la France s'épargnera ainsi de poignantes douleurs et de grandes convulsions.
- Ces avantages immenses,
- Ces ressources certaines,
- cette gloire,
- ces richesses,
La colonisation seule peut nous les donner.
A l'œuvre donc ! Faisons vite et bien !
Mais en agriculture pour réussir, il faut procéder avec lenteur et maturité ; là surtout on doit accorder très peu au hasard, si l'on veut éviter de cruelles déceptions.
Une faute a pour première conséquence une considérable perte de temps, et d'un temps précieux.
Comment concilier la prudence, la lenteur qu'exige une bonne culture, avec les nécessités de la France et de l'Algérie qui aspirent à une prompte colonisation ?
En étudiant les essais des premiers colons, nous échapperons aux fautes qu'ils ont commises ; cette expérience ne doit pas être perdue pour nous.
Nous devons en outre nous inspirer des travaux des hommes intelligents et dévoués qui, ont longtemps habité l'Afrique et qui ont publié sur la colonisation des livres malheureusement trop vite oubliés.
Nous préserver de ces fautes et profiter de ces leçons, telle doit être notre règle de conduite.
Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de chercher un nouveau mode de colonisation, ni d'aller vers l'inconnu mais d'appliquer un système qui, grâce à une expérience si chèrement acquise n'ait plus à redouter de déceptions ni de catastrophes.
Pour indiquer cette marche à suivre il n'est donc pas besoin de formuler une théorie nouvelle.
Il suffira d'examiner les causes qui ont entrainé la ruine des premiers colons et de nous en préserver ; nous devons en outre chercher dans les livres les moyens déjà consacrés par l'expérience et les meilleurs pour arriver sûrement et vite à une bonne colonisation.
Mais pour attirer en Afrique des bras et des capitaux ce n'est point assez de dire que le succès de la colonisation est facile, assuré ; il faut d'abord prouver que la santé et la fortune y sont garanties, protégées contre les influences du climat et les attaques des Arabes : à cette triple condition, la confiance renaîtra !
III
Les grandes pertes que nous avons éprouvés en Afrique pendant les premières années de l'occupation avaient fait craindre les effets du climat ne rendissent à peu près impossible la colonisation par les Européens.
On est à peu près revenu aujourd'hui de cette appréhension ; mais comme elle n'est pas complètement dissipée, je crois devoir entrer dans quelques détails pour démontrer que, en Algérie comme en France, le colon européen peut vivre et travailler sans avoir à redouter les effets du climat, et qu'il n'a besoin pour cela que de s'astreindre à quelques précautions d'hygiène faciles et peu dispendieuses.
Le climat de l'Algérie est généralement sain, mais il est chaud et dans les régions élevées, sujet à grandes variations de température.
Dans la région du littoral la chaleur est tempérée par des brises de mer presque continuelles.
Si on excepte quelques parties basses et sans écoulement, telles que la Macta où le soleil et l'eau décomposent les plantes et développent des germes putrides, l'Européen vit partout en santé et supporte le travail qui n'est interrompu qu'au moment des fortes chaleurs.
Dans la région plus élevée des plateaux, le climat est plus sain que dans celle du littoral. Le travail n'y est jamais interrompu.
Au reste, l'opinion qui s'était d'abord accréditée de l'insalubrité du climat disparaît et s'efface tous les jours pour faire place à l'opinion contraire.
Voici à ce sujet comment s'exprime M. Fortin d'Ivry : " Les ressources de l'Algérie sont immenses et d'abord le climat y est excellent, il offre à différentes hauteurs des plaines, des plateaux et des montagnes qui permettent toutes les conditions de culture et d'habitation pour l'Européen. "
Pourtant l'acclimatation sera toujours pénible et la prudence exige qu'on se mette en mesure d'en prévenir et d'en combattre les effets.
D'un autre côté les terres d'Afrique n'ont pas été remuées depuis plusieurs siècles et les premiers travaux de culture auront pour résultat l'émanation de miasmes nuisibles à la santé du colon.
Il y a là encore un danger contre lequel on doit se prémunir.
Le choix des lieux est le moyen le plus sûr et le plus important.
Les colons ne doivent être placés que sur des terrains où les eaux sont abondantes, de bonne qualité et d'un écoulement prompt et facile.
Il est de plus indispensable d'exercer une surveillance active et de ne pas permettre que le colon se loge dans des maisons qui manqueraient aux premières conditions de l'hygiène.
Mieux vaut avoir d'abord quelques travailleurs de moins en Algérie, que de s'exposer, presque à coup sûr, à les voir entrer dans les hôpitaux peu de jours après leur installation.
Et c'est ce qui arrive quand le colon est mal logé et, plus sûrement encore, lorsqu'il est placé dans le voisinage d'eaux stagnantes. Les défrichements sont pénibles, dangereux à cause des émanations.
Il convient donc surtout dans les premiers temps, que le colon puisse varier ses travaux et ne soit pas constamment employé à remuer des terres presque vierges. Les herbes ramassées avec soin et brûlées tous les jours sur les champs défrichés, contribueront à purifier l'air ; enfin le colon doit avoir une nourriture saine et suffisante et se garantir de tout excès.
Avec ces précautions sa santé est aussi assurée qu'elle pourrait l'être en France. Les moyens que j'indique sont faciles et peu dispendieux ; ils seront suffisants pour maintenir le colon en santé.
Je dois maintenant essayer de dissiper les craintes qu'inspirent encore les Arabes et que de fréquentes révoltes semblent justifier ; ces craintes ne sont pas mieux fondées que celles qu'avait fait naître d'abord la prétendue insalubrité du climat, mais elles sont plus généralement répandues, et pour les détruire, j'ai besoin d'entrer dans de plus grands développements.
IV
Il est un grand nombre de personnes qui pensent que l'Arabe, tant de fois vaincu mais toujours révolté, ne nous laissera jamais jouir paisiblement du sol que nous avons conquis. Ceux-là se trompent ; ils ne connaissent :
- ni l'Afrique, ni le caractère, ni les mœurs,
- ni les ressources du peuple qui l'habite.
D'autres, moins effrayés, conviennent que la prise d'Abd-el-Kader a mis fin à la guerre, que l'Arabe est soumis ou tout au moins découragé ; mais ils ajoutent que, pour assurer la tranquillité et contenir les populations indigènes, il faut absolument que l'effectif de l'armée d'Afrique soit maintenu sur le pied actuel.
Ils pensent que le rappel d'une partie des troupes serait le signal d'une grande insurrection.
Et comme l'état présent des affaires de l'Europe et notre situation financière font craindre, avec quelques raisons, que la France ne soit forcée bientôt forcée de rappeler une partie de son armée :
- les craintes restent,
- la confiance ne renaît pas et
- la colonisation est toujours stérile !
Il importe de détruire ces frayeurs exagérées ; il faut que la vérité soit connue et qu'on sache bien que, si les besoins de la France, l'exigent, l'armée d'occupation pourra être réduite sans qu'on ait à redouter ni insurrection, ni soulèvement de la part des Arabes.
Ce n'est pas sans hésitation, j'allais presque dire sans répugnance, que j'aborde cette question ; mais la défense de nos possessions d'Afrique se lie d'une manière si intime au sujet que je traite, que je n'ai pu me dispenser d'en parler.
La colonisation n'est possible qu'avec une sécurité entière.
Mais quels que soient l'importance et l'intérêt qui se rattachent à cette question, quoique je sois profondément convaincu que la colonisation ne deviendra possible que lorsque les craintes, l'Arabe inspire, seront entièrement effacées, j'aurais été obligé de laisser, sans la traiter, cette question importante, si déjà un général habile et expérimenté, qui a longtemps commandé en Afrique ne l'avait parfaitement élucidée.
En 1846 et 1847, M. Le Pays de Bourjolly a publié successivement deux brochures où il traite de la défense de nos positions avec autant de clarté que de talent.
C'est du projet de ce général que je me suis inspiré.
Dans la première partie de son travail il s'occupe de la qualité des troupes qui doivent composer l'armée d'Afrique. Cette partie a vivement été controversée par les hommes de guerre ; le maréchal Bugeaud, entre autres, en a fait une longue critique.
Il n'en a pas été de même pour la seconde la seule dont nous ayons à nous occuper ici :
- celle-là fut généralement approuvée,
- le gouvernement lui-même adopta un moment le projet du général de Bourjolly, des travaux furent entrepris à cette occasion.
Avant d'exposer ce système de défense et pour qu'on en ait la parfaite intelligence, je dois faire connaître l'état de l'Algérie avant et depuis la conquête, les travaux que nous y avons fait,
- les mœurs,
- le caractère,
- les besoins des Arabes.
L'Afrique française s'étend, de l'Est à l'Ouest, depuis la Régence de Tunis jusqu'à l'empire du Maroc ; elle est bordé au Nord par la Méditerranée au Sud par le Sahara, à l'exception de la grande Kabylie.
Cette immense étendue de terrain qui, d'après M. Carette, a plus de vingt mille lieues carrées de superficie, est aujourd'hui la propriété de la France, le prix des victoires de son armée et des sacrifices qu'elle s'est imposés.
La population indigène répandue sur cette vaste contrée est évaluée à deux millions d'habitants.
Indocile, dur et farouche l'Arabe est nomade ; il serait difficile de le maintenir dans la soumission et peut-être impossible de lui faire adopter nos mœurs et nos usages. Dans l'Est ses mœurs sont plus douces, son caractère moins turbulent ; cultivateur, laborieux et diligent, il s'est attaché aux plaines riches et fertiles de la province de Constantine et s'y est établi à demeure fixe.
Il a compris les bienfaits de l'administration française et apprécie les effets de sa puissante protection.
Il a su s'approprier avec discernement ce qui a été fait de bon et d'utile dans les essais de culture que nous avons tentés.
Peu d'efforts restent à faire pour l'attacher entièrement à la France à laquelle il est soumis et contre laquelle il ne se révoltera jamais, si on évite avec soin de le froisser dans ses intérêts et dans sa foi.
Dans la province d'Alger, la population indigène tient par :
- l'esprit,
- les mœurs et
- les usages des populations de l'Est et de l'Ouest.
En la protégeant dans sa personne et ses propriétés, en augmentant son bien-être, ce qui est facile, la France aura beaucoup fait pour la pacification du pays.
Voici comment s'exprime, à ce sujet, le général Bedeau : " Je ne crois pas à l'imperméabilité du peuple arabe, à sa haine pour les arts et notre bien-être social, parce que je trouve dans son histoire même, dans les traces si nombreuses de ses arts importés et appliqués en Europe, la cause de ma conviction…. Je ne crois pas qu'il soit insensible aux influences qui partout et toujours ont pénétré les hommes …
Et, plus loin, il ajoute : La paix nous a permis de donner à ces populations un bien-être matériel progressif ; ce bien-être a diminué de jour en jour les instincts guerriers que le désordre entretient et excite ; cette population est préparée à nous être un utile auxiliaire de la puissance que nous voulons fonder dans le pays… "
La population indigène de l'Algérie peut être classée en quatre grandes races, elle se fractionne à l'infini par la division en tribu :
- Deux de ces races sont d'origine kabyle,
- une d'origine arabe,
- la quatrième connue sous le nom de Chaouya, descend de l'ancienne population numide et s'est conservée à peu près pure de tout mélange avec l'Arabe qui l'a vaincue et soumise.
Les Chaouyas sont doux et laborieux ; l'Arabe les méprise comme un peuple vaincu et soumis.
En les protégeant efficacement il nous sera aisé d'en faire des auxiliaires actifs et dévoués.
La haine que se portent ces races est loin d'être éteinte ; elle est plus forte et plus terrible que celle que chacune de ces races éprouve contre nous.
Sans les exciter, ce qui serait immoral, il sera d'une sage politique de profiter de ces haines qui entretiennent des divisions, pour nous établir les arbitres et les médiateurs des querelles des tribus et des races entre elles ; nous acquerrons ainsi une influence qui rendra plus facile la pacification de l'Algérie.
Le Tell est la région la plus fertile de l'Afrique ; c'est là que doivent être établis nos colons. Il s'étend de l'Est à l'Ouest, mais il varie beaucoup dans sa largeur qui est de plus de cent lieues dans la province de Constantine et se réduit à moins de trente dans celle d'Oran.
Puis vient la région du Sahara où la colonisation n'arrivera pas de longtemps, quoique cette partie d'Algérie donne de bons pâturages pendant l'hiver et le printemps et que dans certaines contrées la culture des céréales puisse y être faite avec succès et avantage.
Ce pays immense, riche et fertile au-delà de toute expression, défendu par une population de deux millions d'habitants a été conquis par notre armée en dix-sept ans.
Les Romains, ces grands dompteurs de nations avaient employé plus d'un siècle à faire cette conquête.
Mais au milieu des luttes politiques qui absorbaient tous les esprits, la France a été peu attentive à la gloire de son armée.
A part quelques faits d'armes éclatants, quelques désastres inévitables dans une guerre d'invasion et qui seuls ont pu exciter la curiosité publique, cette conquête, à la fois riche et glorieuse, s'est accomplie sans qu'on s'en soit ému !
- Et pourtant que d'efforts,
- que de constance nos soldats n'ont-ils pas dû dépenser avant de dompter et de soumettre un peuple armé pour la défense du sol et de la religion, avec un chef habile, actif et courageux !
Depuis la prise d'Alger jusqu'à la soumission d'Abd-el-Kader :
- que de marches, de privations et de fatigues
Pour :
- joindre, attaquer, et vaincre un ennemi qui toujours fuit et échappe dans un pays presque inconnu, sous un soleil brûlant !
Quand nos soldats ne trouvaient :
- ni routes tracées,
- ni villes,
- ni villages, ils étaient quelquefois obligés d'établir leurs bivouacs auprès de marais insalubres et les germes putride qui se développent avec force et rapidité.
Je le dis avec bonheur, la France peut et doit être fière de son armée :
- elle a fait en Algérie des prodiges d'énergie et de bravoure,
- elle a supporté avec une constance admirable les privations et les fatigues de toute sorte,
- les fièvres qui l'ont quelquefois décimée n'ont jamais pu abattre son courage ;
- pendant dix-sept ans elle a poursuivi sans relâche un ennemi puissant et dangereux ; elle l'a Vaincu !
Grâces en soient rendues à elle et aux chefs habiles qui l'ont dirigée dans cette rude et pénible entreprise ! Leur mission était :
- belle,
- grande,
- difficile.
Ils l'ont remplie ! Ils ont bien mérité de la France.
Mais l'armée n'a pas seulement conquis l'Afrique, elle a encore porté à ce pays, les arts et l'industrie, bienfaits de la civilisation ; en cela elle a été puissamment secondée par les colons venus de France pour s'associer à son œuvre.
Dans ce pays où naguère encore on ne trouvait que :
- deux villes de quelque importance,
- des bourgs rares et mal bâtis, et
- des gourbis infects,
On voit aujourd'hui plusieurs grandes et belles villes, autour desquelles viennent se grouper :
- de délicieux villages,
- de magnifiques casernes,
- de vastes hôpitaux,
- de grands travaux de fortification et de défense ont été exécutés ou sont en d'exécution,
- le port d'Alger a été agrandi et rendu plus sûr,
- Arzeu,
- Mers el Kébir,
- Nemours,
- Philippeville,
- Bône ont eu leurs rades et leurs ports réparés et défendus.
Au lieu de sentiers difficiles, ardus, accessibles seulement aux piétons et aux mulets, on a tracé :
- de magnifiques routes, dont quelques-unes sont déjà carrossables et très bien entretenues,
- des ponts ont été établis,
- les anciennes villes restaurées et agrandies,
- on a bâti des églises,
- des palais,
- des théâtres.
Partout enfin on reconnaît aujourd'hui en Afrique la main de la France et son génie !
- Et quand on pense que ces travaux ont été faits pendant une guerre de dix-sept ans toujours pénible et souvent meurtrière !
- Quand on se dit que nos soldats et leurs chefs, tenus constamment en haleine par un ennemi actif et courageux y ont puissamment contribué
- que des colons intelligents et hardis n'ont milieu des dangers de la guerre et des privations de toutes nature, d'engager leur fortune et leur vie dans cette œuvre de civilisation, on ne peut se lasser d'admirer :
- le courage et l'énergie des soldats,
- le génie,
- l'activité des chefs,
- la constance,
- le dévouement des colons.
Est-ce à dire pour cela qu'en Afrique tout ait été bien fait et que nous n'ayons que des louanges à donner ? Non, certes, car bien des fautes ont été commises, bien des abus ou ignorés ou tolérés sont restés impunis :
Plus d'une fois, dans le cours de ce travail, nous aurons à signaler ces abus et ces fautes ; mais à côté du juste blâme doit se trouver l'éloge mérité.
Je suis heureux de pouvoir rendre cette justice à des hommes sur les fautes desquels je ne m'aveugle pas mais dont je reconnais aussi la valeur.
Et puis, quelques-unes de ces fautes s'expliquent tout au moins, si elles ne se justifient par les soins incessants qu'exigeait une guerre de tous les jours.
Et quand, à côté des erreurs et des abus que le temps efface, on trouve :
- des routes, des ponts, des villes, des villages, des hôpitaux, des casernes, des ports, des arsenaux
Qui restent et témoignent des efforts d'un grand peuple on peut oublier un moment d'erreurs et d'abus pour admirer sans réserve veux qui ont fait ces grandes choses, qu'ils soient :
- colons, généraux ou soldats !
Outre les avantages qu'ils procureront ou ont déjà donnés :
- au commerce, à l'industrie, à la colonisation,
Les travaux dont nous venons de parler auront surtout pour effet de rendre plus facile et plus sûre la pacification de l'Algérie.
La guerre est finie, la mission de l'armée n'est plus d'attaquer et de vaincre, elle doit maintenir et conserver.
Cette différence dans le but doit nécessairement apporter une modification dans les moyens.
Le nouveau système de défense doit s'appuyer sur les travaux dont nous venons de parler, et cette défense sera d'autant plus facile qu'on tiendra plus compte des mœurs et du caractère des Arabes bien connus aujourd'hui.
Enfin on devra s'efforcer de suppléer au nombre des troupes par une bonne disposition.
On se rappelle que la conquête que nous avons à conserver et à défendre est un immense plateau longitudinal serré entre la mer et le désert.
Si on n'a pas oublié ce que nous avons dit du caractère et des mœurs des Arabes, on comprendra que les forces consacrées à cette défense doivent être placées de manière à pouvoir se porter rapidement sur les points menacés.
Il est toujours plus facile contenir que de réprimer.
C'est dire que la principale ligne de nos forces a sa place indiquée au centre même des plateaux.
Cette ligne qui s'étendrait de l'Est à l'Ouest, de Constantine à Tlemcen, serait appuyée sur les villes de :
- Mascara,
- Orléansville
- Miliana,
- Médéa,
- Aumale.
C'est là que doit être concentrée la grande masse de nos forces. On comprend en effet que lorsque notre armée sera à portée des points qui pourraient être menacés, les soulèvements seront toujours et facilement prévenus, et que si, par impossible, les Arabes se portaient à une tentative hostile, la promptitude de la répression nous préserverait pour longtemps de leurs attaques. Aujourd'hui nos troupes sont cantonnées dans les villes du littoral.
L'Arabe ne voit pas assez souvent nos soldats et cesse de les craindre :
A ce premier inconvénient s'en joint un autre.
Les longues marches sont toujours pénibles en Afrique, les transports difficiles et dispendieux ; quand une ou plusieurs tribus se soulèvent, il faut pour les joindre, aller les chercher loin et préparer de longs convois, ce qui fait perdre un temps précieux.
Souvent, ce temps perdu change en révolte ouverte ce qui n'était d'abord qu'une simple démonstration, et nos soldats fatigués, harassés par une longue marche sont obligés de se battre quand ils n'auraient eu qu'à se montrer pour faire rentrer l'Arabe dans l'ordre, s'ils étaient arrivés quelques jours plus tôt sur les points menacés. Les travaux déjà terminés ou en voie d'exécution, contribueront puissamment à la défense du littoral et de la partie de non possessions comprises entre la mer et la ligne de défense.
La côte d'Afrique est difficile et dangereuse ; elle n'est abordable que sur quelques points.
- Les brisants,
- les roches sous-marines,
- le manque de fond et
- d'abris la protègent contre les attaques du dehors ; les points accessibles seront bientôt suffisamment défendus.
Il y a donc peu de crainte à avoir de ce côté, et à tout évènement les secours venus de France et de l'intérieur seraient promptement rendus sur les lieux.
Une attaque de la part des Arabes n'est pas à craindre sur ces points.
Nos villes et le pays qui les avoisinent seront toujours suffisamment préservés par la seule présence des Français ; il suffira donc d'une faible garnison.
Une ligne de postes avancés par :
- Sebdoue, Daya, Saïda, Tiaret, Beaugar, Batna et Biskara
Maintiendrait la soumission jusqu'au désert, et quelques détachements de troupes répartis dans les autres villes ou villages de l'intérieur complèteraient ce système de défense.
Les colons placés entre la grande ligne du centre et la côte seraient préservés de toute attaque, d'un côté par les travaux et les garnisons de la côte, de l'autre par la masse de nos forces qui sera toujours un épouvantail pour ces Arabes.
De plus les centres de colonisation efficacement protégés trouveraient toujours un écoulement facile à leurs produits, soit dans les villes du littoral, soit dans les camps et l'armée, rapprochée des lieux de production et de culture serait constamment approvisionné et garantie par ce voisinage, de la nostalgie qui a déjà cruellement sévi en Afrique.
- Vingt mille hommes suffiraient pour garder la ligne du centre,
- six mille fourniraient les garnisons de la côte et
- six mille les postes avancés.
- Cinq mille hommes répartis par petits détachements et cantonnés dans les villes et les villages de l'intérieur, complèteraient l'effectif de l'armée d'Afrique, qui serait de trente-sept mille hommes.
Ce système de défense, proposé par le général de Bourjolly et approuvé par des hommes de guerre habiles et expérimentés n'a pas besoin d'être expliqué.
Pour ceux qui connaissent l'Afrique, il se justifie de lui-même, car il prévoit tout et assure la libre et tranquille possession de nos conquêtes.
Pourtant il serait peut-être désirable de la compléter par l'organisation d'une garde nationale.
Les colons qui auront à défendre leurs familles et leurs propriétés seront d'utiles auxiliaires à notre armée.
Mais pour être utile, la garde nationale de l'Algérie doit être fortement constituée et organisée ; la loi de 1832 serait insuffisante.
Dans ce pays à peine sorti d'une longue guerre où une population nouvelle composée d'éléments hétérogènes est venue s'établir, il faut plus de force et de vigueur dans le commandement et un lien de discipline plus sévère que ne le comporte cette loi.
Aussi nous proposerions comme base de cette organisation :
1° Que le service fût obligatoire pour tous les colons sans exceptions ni privilèges. Si un citoyen, pour un motif quelconque, est dispensé du service, il naît des jalousies dont le moindre inconvénient est de produire le découragement dans l'esprit de ses camarades.
2 ° Les gardes nationaux de l'Algérie ne devraient jamais être astreints au service des places. Outre que ce service est toujours mal fait par la garde nationale, il n'est d'aucune utilité pour elle et fait perdre un temps précieux au négociant et à l'ouvrier.
3° la garde nationale devrait être fréquemment réunis en corps et exercée aux manœuvres d'ensemble. On le sait l'Arabe est surtout frappé par les objets extérieurs ; tant qu'il verra des citoyens isolés, se rendre sans ordres dans un corps de garde, il ne croira pas qu'ils puissent être dangereux pour lui. Si au contraire, il les voit réunis en corps, sortir des villes ou des villages, s'exercer aux marches et aux manœuvres, il comprendra que là aussi il y a une force avec laquelle il faudrait compter au besoin et cela le rendra plus sage et plus prudent.
4° Enfin, dans chaque localité, suivant l'importance de la population, la garde nationale devrait avoir à sa tête :
- un officier de l'armée, ferme et éclairé,
- capitaine,
- chef de bataillon ou
- colonel.
On éviterait ainsi les jalousies et les rivalités que la camaraderie introduit dans le service et qui désorganisent les gardes nationales, surtout dans les petites villes.
Ces corps ainsi constitués ne grouperaient au besoin autour des détachements de l'armée, cantonnés dans les villes ou les villages, et présenteraient une force imposante ; Ces forces réunies assureraient la paix et la tranquillité en Afrique.
|
|
| Un collaborateur inconnu de Molière.
Envoi de M. Christian Graille
|
Les personnes qui se sont occupées de l'histoire de l'Algérie sous la domination turque (1512-1830) savent combien il est difficile de se procurer les anciens ouvrages les plus essentiels sur la matière.
Dans cette catégorie de raretés bibliographiques, les mémoires du chevalier d'Arvieux occupent un rang assez honorable, car leur auteur, outre diverses missions importantes en Syrie et à Constantinople, eut celle d'aller porter à Tunis, en 1665, la ratification du traité conclu par le duc de Beaufort avec le chef de la régence.
Et, en 1674, il exerça à Alger les fonctions de consuls de France, avec le titre d'agent du roi en Afrique qui lui constituait une position supérieure.
Mais d'Arvieux n'a pas été seulement un diplomate distingué, il fut aussi un orientaliste remarquable qui parlait et écrivait avec facilité :
- l'arabe, le turc, le persan, l'hébreux,
- le syriaque (langue sémitique du proche orient) etc.
On conçoit que les œuvres d'un pareil personnage aient été particulièrement recherchées par l'auteur de cet article, qui a pour devoir officiel de former à Alger une bibliothèque africaine.
Cependant il les avait demandées vainement à la librairie métropolitaine ; et il y renonçait presque, lorsqu'un jour ces précieux mémoires se rencontrèrent par hasard sous sa main chez un bouquiniste… d'Alger !
En parcourant les six volumes qui le composent, je fus surpris, je l'avoue, d'y trouver le passage suivant à la page 251 du quatrième volume : M. de la Gibertie revint en cour (août 1670) et ne manqua de faire l'histoire de ce qui est arrivé à Soliman l'ambassadeur turc pendant le voyage de Paris à Toulon et les peines qu'il avait eu d'arrêter les saillies et les extravagances de cet employé, qui ne pouvait étouffer le chagrin qu'il avait de ne pas s'en retourner en son pays aussi riche qu'il s'imaginait le devoir être, et bien d'autres choses qui ne sont pas dignes de l'attention des lecteurs.
1) Un article sur le chevalier d'Arvieux, orientaliste, diplomate dont le nom se rattache à l'histoire des États barbaresques avait été publié jadis par nous dans l'Akhbar. Ce travail remanié et augmenté de beaucoup de renseignements empruntés aux mémoires même du héros a paru tout récemment dans le feuilleton du journal parisien l'Étendard (9 août 1868).
2) C'est ce dernier article que nous reproduisons ici. Plus tard nous donnerons l'historique des négociations de Arvieux à Tunis en 1665 et de sa mission à Alger en 1674, relations des plus curieuses au point de vue de l'histoire de ces contrées sous la domination turque.
Le roi ayant voulu faire un voyage à Chambord pour y prendre le divertissement de la chasse, voulut donner à sa cour celui d'un ballet ; Et comme l'idée des Turcs que l'on venait de voir à Paris était encore toute récente, il crut qu'il serait bon de les faire paraître sur la scène.
Sa Majesté m'ordonna de me joindre à MM. Molière et de Lulli pour composer une pièce de théâtre où l'on pût faire entrer quelque chose des habillements et des manières des Turcs.
Je me rendis pour cet effet au village d'Auteuil où M. de Molière avait une maison fort jolie.
Ce fut là que nous travaillâmes à cette pièce de théâtre que l'on voit dans les œuvres de Molière sous le titre de Bourgeois gentilhomme qui se fait turc pour épouser la fille du Grand Seigneur.
Je fus chargé de tout ce qui regardait les habillements et les manières des Turcs.
La pièce achevée, on la présenta au roi qui l'agréa et je demeurai trente jours chez Baraillon, maître tailleur, pour faire les habits et les turbans à la turque.
Tout fut transporté à Chambord et la pièce fut représentée dans le mois de septembre (1670) avec un succès qui satisfit le roi et toute la cour.
Sa Majesté eut la bonté de me dire qu'elle voyait bien que le chevalier d'Arvieux s'en était mêlé.
Le ballet et la comédie furent représentés avec un si grand succès que, quoiqu'on les répétât plusieurs fois de suite, tout le monde les redemandait encore ; aussi, ne pouvait-on rien ajouter à l'habileté des acteurs.
On voulut même faire entrer les scènes turques dans le ballet de Psyché qu'on préparait pour le carnaval suivant. Mais après y avoir bien pensé, on jugea que les deux sujets ne pouvaient pas s'allier ensemble… "
Si mes souvenirs ne sont pas en défaut, les éditeurs de Molière n'ont pas eu conscience de ce curieux passage des Mémoires du chevalier d'Arvieux.
Il me semble même qu'un des plus récent loue Molière de sa parfaite connaissance des mœurs turques ; tandis qu'il fallait dire, sur ce point, avec le grand roi : " On voit bien que le chevalier d'Arvieux s'en est mêlé ! "
Je suppose que le lecteur ne sera point fâché de connaître un peu plus intimement ce collaborateur inconnu de Molière qui vient de se révéler à lui : Je ne le reverrai pour cela ni à la Biographie universelle ni à l'Histoire de l'empire ottoman, par Hammer, ouvrages qui se sont occupés de lui mais où les inexactitudes sont mêlées de lacunes importantes.
La lecture de ses mémoires est ce qui conviendrait le mieux et je la conseillerais s'il n'était pas si difficile de se les procurer.
Reste à leur emprunter, par voie d'analyse, les renseignements les plus essentiels sur notre héros, et c'est ce que je vais faire.
La famille du chevalier d'Arvieux était originaire d'Alexandrie-la-Paille, en Lombardie, où ses membres tenaient un rang très distingué parmi les plus considérables.
Leur nom était Arveo au pluriel Arvei ; ils portaient d'azur au griffon d'or armé, langué et vilainé de gueules.
La branche à laquelle appartenait l'auteur des Mémoires s'était établi en Provence ; d'autres branches se rencontraient en divers pays et jusqu'en Angleterre où elles furent appelées Harvey.
Le chevalier dont nous nous occupons ici vint au monde dans le territoire de Marseille, le 21 juin 1635.
En 1653, il fit son premier voyage dans le Levant, à Smyrne, sous les hospices de MM. Bertandié, ses parents.
Pour ce premier voyage, comme pour les missions diplomatiques qu'il accomplit pendant les trente ans qui suivirent, il a laissé dans ses mémoires d'amples relations qui se lisent avec un intérêt où les charmes du style n'entrent pour rien ; et c'est là qu'il faut chercher les éléments authentiques de sa biographie.
Il en est un cependant qui y manque tout à fait , mais que Bussy-Rabutin, avec son indiscrétion ordinaire, a pleinement dévoilé dans son histoire amoureuse des Gaules (tome II, page 303) ; nous allons l'exposer succinctement.
D'après le très médisant cousin de Mme de Sévigné, la maréchale de la Mothe procura, vers 1675, au chevalier d'Arvieux, le consulat de Tunis avec une pension de 1.000 livres sur un évêché, et elle fit recevoir sa sœur femme de chambre d'une des filles de France.
Après avoir fait remarquer qu'il faut lire ici à Alger au lieu de Tunis, recherchons, qu'elle était, selon le même auteur, l'origine de l'intérêt tout particulier qu'une si grande dame portait à notre héros, et pourquoi elle désirait tant lui voir faire son chemin … hors de France.
Si l'on en croit Bussy, le chevalier, qui était écuyer de la maréchale et à qui ses fonctions permettaient de voir librement Mlle de Toussy, la fille de sa protectrice, avait inspiré un tendre sentiment à celle-ci, quoiqu'il fut laid et qu'il frisât la quarantaine.
Mais elle l'avait aimé peut-être par les mêmes motifs qui firent naître la passion de Desdemona pour le More de Venise, c'est-à-dire pour ses étranges aventures, pour les dangers exceptionnels qu'il avait courus ; en un mot, pour la teinte fortement dramatique de son existence passée.
Quoiqu'il en soit, elle lui témoigna son affection avec tant de vivacité que le pieux chevalier, car d'Arvieux l'était beaucoup, finit par se trouver dans une situation analogue à celle du patriarche Joseph avec la femme de Putiphar (officier du pharaon.)
Ainsi, un certain jour, sous prétexte de lui donner la commission d'acheter des jarretières, elle lui montra les siennes, en place, comme échantillon, et cela avec si peu de ménagement que les tentations de Saint Antoine sont à peine comparables à celle du pauvre chevalier dans cette conjoncture délicate.
Bussy-Rabutin affirme que Arvieux sortit vainqueur de cette rude épreuve ; et il faut que cela soit quatre fois vrai pour qu'un mauvais sujet comme lui se décide à en convenir.
Dans les six volumes consacrés aux Mémoires d'Arvieux, on ne rencontre pas la plus légère allusion à une galanterie quelconque.
Et cependant leur auteur ne se maria que le 12 mai 1690 c'est-à-dire à l'âge de cinquante-cinq ans !
Il mourut le 30 octobre 1702 dans sa soixante-huitième année et fut enterré dans l'église du Cannet, au territoire de Marseille où est la sépulture de ses ancêtres.
Sans doute, quelques érudits, adonnés à l'étude des annales turques et barbaresques, auraient toujours connu son nom ; mais ce nom fût demeuré ignoré à tout jamais de la masse du public si celui qui le porte n'avait collaboré au Bourgeois gentilhomme.
Car il est permis d'espérer que les éditeurs tiendront compte de cette collaboration pour " les habits et les manières des Turcs " si mince qu'elle puisse être et que la mémoire de d'Arvieux ne périra pas tant que la grande figure de Molière sera en honneur ; c'est-à-dire tant qu'il y aura au monde un homme capable de comprendre la langue française.
Adrien Berbrugger. Archéologue.
Revue africaine
|
|
| La polygamie musulmane.
Envoi de M. Christian Graille
|
| Ses causes fatales et le moyen de la détruire.
C'est ici qu'il faut bien se garder d'englober toute la population algérienne, car il y a sur ce chapitre capital des différences bien marquées.
Au point de vue de la loi, tout musulman peut, il est vrai, prendre simultanément quatre femmes légitimes mais la pratique et la théorie marchent-elles en rapport parfait ?
On va voir qu'il s'en faut de beaucoup
En effet il y a des portions très considérables de la population indigène qui sont monogames de fait et même beaucoup de gens qui se réfugie dans le célibat systématique.
Donc il faut encore distinguer et ne pas faire une règle générale sans exception, quand il se trouve, au contraire, des exceptions très importantes par le nombre.
A cet égard on peut diviser les Musulmans en deux camps :
- Dans l'un seront les habitants fixes des villes,
- dans l'autre, les hordes plus ou moins nomades du pays de la tente
- ce qui est dans une demeure inamovible incline à la monogamie, par des motifs très puissants qui seront exposés plus loin.
Tout ce qui s'abrite sous la toile mobile est poussé à la polygamie par des raisons opposées mais non moins impérieuses.
Ce sont d'un côté les citadins et les Kabyles, de l'autre les Arabes errants.
Pour éviter la sécheresse et l'ennui d'une dissertation en règle, nous rapporterons ici une conversation qui eut lieu l'an dernier (1854) dans la région du haut Chélif, entre une dame française de beaucoup d'esprit et de sens et un grand chef indigène qui avait visité deux fois l'Europe.
Nous remplissions alors les fonctions toutes passives d'interprète, comme aujourd'hui nous nous acquittons de celle de simple rapporteur.
On voudra donc bien ne pas faire remonter jusqu'à nous, la responsabilité d'opinions qui appartiennent à d'autres.
Ceci entendu, faisons parler le procès-verbal.
La dame dont il s'agit nous avait chargé de protester auprès dudit chef, au nom du beau sexe européen, contre ce qu'elle appelait la coutume avilissante de la polygamie. Le chef pris ainsi à partie lui répondit en ces termes :
" Madame, je pourrais me procurer le plaisir de vous prouver qu'au fond vos compatriotes et coreligionnaires sont aussi polygames que nous, sinon plus ; mais je laisse cette facile récrimination de côté, et j'arrive droit au but.
Pour rendre une explication plus compréhensible je me permettrais de vous mettre en scène, en supposant un instant que vous avez épousé un musulman de ceux qui vivent de la vie nomade.
Je dis qu'alors, bien loin de blâmer la pluralité des femmes, vous seriez la première à y exciter votre époux, si par hasard il était tenté de ne point vous donner de rivale.
Cela semble fort, et cependant je crois que vous en conviendrez quand vous connaîtrez un ensemble de faits qui vous sont aujourd'hui inconnus.
Car vous n'avez certainement pas la moindre idée de ce qu'est un ménage nomade et de la multitude des travaux intérieurs qu'il comporte.
D'abord nous habitons des maisons en poils où rien ne ferme où tout ce que nous avons de plus précieux et notre existence même ne sont pas à l'abri aux attaques des voleurs et de l'ennemi qu'à la condition d'avoir autour de nous un personnel nombreux et surtout de confiance.
Or, après les membres de la famille, des épouses seules satisfont à la condition impérieuse. Il n'y a et ne peut y avoir, dans notre existence nomade :
- ni meunier, ni boulanger, ni drapier, ni couturière, ni tailleur, ni porteur d'eau, ni marchand de bois etc.
Vous seriez donc obligée :
- de nettoyer le blé,
- de le moudre,
- de faire la pâte,
- de la cuire,
Sans préjudice des travaux de cuisine.
- Vous auriez à traire les vaches ou les brebis pour faire avec leur lait des fromages et du beurre,
- vous devriez préparer la laine de vos troupeaux pour en tisser des vêtements.
Quand le douar déménagerait, ce qui arrive dans le Sud une soixantaine de fois par an, sinon plus,
- à vous le soin de faire les paquets,
- d'abattre la tente et
- de charger le tout.
De peur de détournement en route, vous suivriez le convoi, mais le plus souvent à pied car les bêtes auraient assez de mobilier à porter.
Vous avez vu le tableau attrayant qu'un habile peintre a su faire avec le sujet de Rébecca à la fontaine.
Vous irez aussi chaque jour à la fontaine et elle sera bien loin quelquefois. Mais quand vous en reviendrez, ne vous laisser pas peindre, car :
- votre pauvre corps tout courbé,
- votre figure inondée de sueur, de poussières,
- vos jambes boueuses,
- vos habits ruisselants de l'eau qui s'enfuie de l'outre ne vous feraient point paraître à votre avantage, si le pinceau de l'artiste était fidèle.
Vous aurez encore à aller au bois chaque jour, et, souvent à d'assez grandes distances. pliant sous le faix et le sang coulera plus d'une fois de vos bras et de vos jambes et même de votre délicate figure, que :
- les branches sèches,
- le bois brûlé ou
- les arbustes épineux auront trop rudement touchée.
Eussiez-vous la force de Samson et l'agilité du coureur Chanfara, les vingt- quatre seules et uniques heures qu'il y ait dans une journée ne vous suffiraient pas pour accomplir une faible partie de cette besogne.
Vous seriez alors la première à supplier votre mari de vous donner des compagnes pour partager le lourd fardeau que la nécessité impose à tout ménage nomade.
D'ailleurs vivant parmi nous et promptement initiée à notre existence semée de périls toujours imminents, vous comprendriez que le chef de famille ne pourrait, sans se déconsidérer, et sans faillir à sa mission, prendre sa part des travaux domestiques.
Il a sa tâche à lui, tâche assez rude ainsi que vous allez le voir :
- son pied doit toujours être près de l'étrier,
- sa main à la portée du fusil,
- sa langue au conseil,
- son œil et son oreille partout :
- ici pour découvrir les pâturages destinés à remplacer ceux qui s'épuisent,
- là il faut prévenir les desseins de l'ennemi ou pour lui dresser quelque embûche.
Comme toute puissance belligérante, il a besoin d'avoir des alliés sûrs ; et ces alliés il les trouve au moyen des femmes qu'il prend dans les familles influentes.
Je conclus, Madame, en vous affirmant de nouveau qu'une fois entrée jusqu'au cœur de notre société nomade, vous n'auriez aucune répugnance, au fond, à vous voir adjoindre les trois compagnes légales, et que vous regretteriez peut-être que la loi ne permit pas à votre mari d'en prendre davantage. "
Après avoir quitté cet étrange polygame, notre spirituelle compatriote disait :
" Je ne suis jamais doutée jusqu'ici du rôle que jouent dans le développement de l'humanité :
- cet amas de moellons et de plâtre qu'on appelle une maison,
- ce morceau de pierre qu'on nomme une meule et
- ces modestes industriels que tant de gens traitent du haut de leur grandeur.
Je ne pourrai plus voir désormais :
- un maçon, un meunier, un boulanger,
sans avoir la sensation de le remercier cordialement, car :
- avec la truelle,
- la meule et
- le pétrin,
ils ont permis à la femme d'atteindre dans la civilisation la hauteur morale et intellectuelle qu'elle occupe aujourd'hui. "
On doit comprendre maintenant pourquoi les Maures des villes et les paysans Kabyles se contentent généralement d'une femme, surtout les premiers. Leur intérieur qui diffère moins du nôtre, n'exige qu'une ménagère. User du bénéfice de la loi pour s'en donner plusieurs serait un luxe fort coûteux auquel très peu de bourse peuvent atteindre.
Ce serait d'ailleurs la source de nombreux et graves ennuis.
Car les querelles féminines qui s'évaporent si promptement au grand air de la tente, devant l'intervention d'un mari guerrier, souverain absolu dans son domaine de famille, acquièrent une grande puissance de concentration entre les murailles d'une maison où elles couvent sourdement et arrivent à une maturité funeste.
Cela ressemble aux haines qui s'engendrent entre marins pendant une traversée où l'on est resté constamment renfermé dans les flancs du navire.
L'antipathie devient aversion dans ces sortes de serres-chaudes et la crise tourne à la monomanie féroce.
En résumé malgré les facilités légales et le goût inné que les hommes ont en général de la polygamie et qui est sans doute un effet du péché originel, les Musulmans n'usent du bénéfice de la pluralité des femmes que lorsqu'ils peuvent le faire sans grande dépense ni inconvénient, c'est-à-dire dans la vie arabe proprement dite.
Le nomade même s'il vient se fixer dans une ville tourne au monogame, souvent même en célibataire, parce qu'étant bon calculateur, il entrevoit dans le bilan de quatre ménages simultanés, un excédent de frais et de désagréments qui l'épouvantent.
Donc nous avons eu raison de dire au commencement de cet article qu'il faut établir une distinction parmi les Indigènes au point de vue du mariage, et ne pas les ranger tous pêle-mêle sous la bannière de la polygamie.
Il reste à discuter un autre préjugé celui du fait des musulmans de l'Algérie autant de Maures de Venise toujours prête à étouffer sous le matelas conjugal leurs trop légères épouses.
Ici encore il y a d'assez importantes distinctions à établir. Nous ne nous appuierons pas sur ce qui se passe sous nos yeux dans les villes où chacun peut constater d'éclatants démentis à cette jalousie féroce attribuée aux maris algériens.
L'invasion de la misère, nous le savons, a produit souvent des modifications déplorables à la susceptibilité qui doit toujours veiller sur le foyer domestique.
Il serait donc injuste et peu raisonnable de baser des conclusions sur un état évidemment anormal, et qui d'ailleurs n'est que transitoire, il faut l'espérer.
Mais toutes ces populations du Sud, qui n'ont pas le droit de réclamer, comme les musulmans citadins, le bénéfice de certaines circonstances atténuantes, leur conduite envers leurs femmes n'est-elle pas, dans des occasions fréquentes et généralement connues, l'antipode de la jalousie ?
Sans sortir du Tell ne trouverait-on pas des exemples remarquables de bénévolence maritale ?
Dès les temps les plus anciens, on voit les Ketama, grande tribu berbère qui est le fond de la population autochtone de l'Est, pratiquer l'hospitalité avec une largeur qui exclut tout sentiment jaloux à l'endroit de leurs femmes.
Les mœurs plus que faciles ont laissé des traces évidentes chez les Amer, auprès de Sétif et chez plusieurs peuplades de la Kabylie.
Nous demandons à ceux qui ont visité le Sahara, non pas à tire d'aile, mais avec la lenteur patiente de l'homme qui veut bien observer, ce qu'ils pensent de la jalousie des nomades, de ces philosophiques populations où la longanimité conjugale, l'aveuglement volontaire en fait d'incartades féminines et d'odieuses spéculations sur la femme pour le compte des maris ou des parents, atteignent un degré d'immoralité qu'il faut voir de ses yeux pour le croire et le comprendre.
Mais c'est un sujet délicat et qui, pour cause, ne comporte pas de plus amples développements.
Comme il ne faut ni scandaliser ni lasser le lecteur, nous terminerons, en même temps que la question particulière des mœurs des nomades, la série de nos articles sur les erreurs populaires à propos de l'Algérie.
A. Berbrugger
La revue africaine volume 3. 1858
|
|
PHOTOS DE BÔNE
Envois par divers lecteurs
|
PLAGE GASSIOT

LE PONT D'HIPPONE
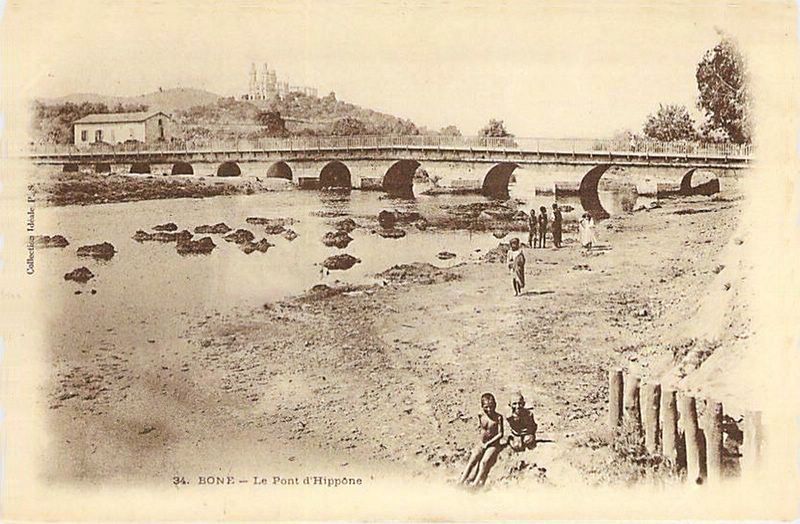
MAISON A LA CASBAH

CONCOURS DE MUSIQUE

DEMENAGEMENTS LESAVRE ET JAN

NAVIGATION MIXTE

|
|
| La visite à la Zaouïa d'El-Hamel.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
Nous venions de quitter la route de Djelfa, l'auto roulait maintenant sur l'étroite piste qui de là conduit à la Zaouïa. (édifice religieux et scolaire )
Dans leur nudité affreuse d'argile et de pierre, les montagnes éblouissaient au soleil pourtant voilé...
Puis ce fut :
- la vallée desséchée de l'oued,
- les touffes de lauriers roses non encore fleuris,
- enfin l'étonnement des étroits vergers perdus dans ce prélude du désert,
- neiges des amandiers et
- touffes rosées des pêchers en fleurs.
Alors au pied de la montagne violette, érodée par le vent, la Zaouïa parut, toute blanche, couronnant le village couleur terre…
Nous descendîmes de l'autobus. La pente devenait par trop déclive.
Après avoir traversé le lit presque sans eau de l'oued nous commençâmes notre ascension.
Une autre voiture, plus légère, nous précédait. Nous distinguions maintenant plus nettement la foule massée sur l'étroite terrasse précédant le bordj du cheikh….
Inattendus, des cavaliers entourèrent l'auto, pétaradant autour d'elle de leurs fusils, tandis que les femmes hululèrent en signe de joie, alors ce fut pour nous la course pour gravir la colline glaiseuse afin de ne rien perdre de cette réception impromptue dans la très célèbre, très vénérés zaouïa d'El-Hamel, de la très sainte confrérie des Rah-anta.
Comme il est étrange ce sanctuaire, couvent et séminaire, centre de pèlerinage, perdu dans une vallée aux limites du désert, dans les lieux où déjà la vie ne vient plus.
Quel enchaînement de circonstances l'ont fait établir ici ?
Tout ce qui touche à la vie y semble factice et peut-être que dans ces lieux appauvris, la prière vers un Dieu est-elle plus élevée et plus touchante…
Sur l'étroite petite place entre le Marabout éblouissant sous sa parure de chaux et le bordj du cheikh rougeoyant de ses murs d'argile, toute la population s'est massée ; manteau rouge du caïd, burnous blanc du saint, c'est le même contraste entre les hommes qu'entre les pierres, entre la vie séculaire et la vie méditative… Une vieille aveugle, les yeux morts pourtant rehaussés de khôl, trépigne une danse ahurissante au son nasillard des raïtas (instrument de la famille des hauts-bois) et des tambourins.
Les étendards sacrés flottent au vent qui emporte les cris des femmes au loin dans la vallée….
Ils seraient amusants les petits croquis d'album que l'on pourrait tracer ici. D'abord tous les oripeaux bariolés de cette foule de mendiants qui sont venus chercher la paix contemplative et presque la sécurité matérielle, à l'ombre du Marabout.
L'une des étroites salles basses, où juché sur son estrade, un taleb enseigne, la feuille à la main les sept prononciations sacrées du Coran et le Dzikr (1) aux novices.
Il a une étrange figure énigmatique ; avec des yeux lointains ses lèvres murmurent une insaisissable prière.
La cuisine, antre à peine éclairée par une cheminée étroite, et sur des pierres, grises des cendres d'un foyer où s'endorment les braises, les immenses jarres de cuivre, décor de quelque conte inédit, de la mille et deuxième nuit où Ali Baba revenu, aurait rassemblé ses jarres dans l'officine secrète de ce couvent…
Et pour terminer, un café servi par l'actuel Marabout Sid Belkacem dans la grande salle de son bordj.
Oh ! Ce n'est sans doute pas la plus pittoresque des visions que nous a réservée cette après-midi étouffante… Mais l'accueil de cet homme saint est si affable, si bienveillant et inattendu dans le lieu qu'on ne put s'empêcher d'en être ému….
Il a fait pour répondre aux paroles de remerciements prononcés, un discours très rapidement débité avec des balancements de tête.
L'interprète le traduit.
Il y a des paroles qu'on est surpris d'entendre. " Le lumineux flambeau de la civilisation française " n'est pas un vain mot pour les lèvres de celui dont l'aïeul refusa, en 1871, lors de la levée des boucliers des Rah' maniyya de se joindre aux insurgés.
Et quand il invoque, sur la tête de ses visiteurs, la baraka qu'il détient de Lella Zineb, qui fut avant lui celle qui assuma la direction spirituelle de la zaouïa, on ne peut s'empêcher de croire qu'un rayon de la bonté céleste est resté dans ses mains dispensatrices que la terre de tant de bontés !…
Les derniers cahots de la piste et nous revoilà sur la route de Djelfa, vers le Nord, tandis qu'au loin, la très Sainte, très vénérée zaouïa d'El-Hamel, disparaît dans la poussière blonde de ce coin d'islam.
El Hamel, 17 mars 1924
Jean Mazard.
Alger Étudiants (29-03-1924)
|
|
| Ville et rade de Bougie.
Envoi de M. Christian Graille
|
|
L'emplacement de Bougie (Bugia, Boudjeïa) dut autrefois être occupé par les Carthaginois, puisque suivant le géographe grec Seylax toute la côte septentrionale d'Afrique depuis la grande Syrte ( ville libyenne) jusqu'aux colonnes d'Hercule était jalonnée de comptoirs ou occupée par des villes puniques.
Au temps de Procope (500-565 - avocat et historien byzantin) la langue carthaginoise se retrouvait encore chez quelques habitants, débris dispersés du peuple détruit par les Romains.
Saldae, colonie romaine succéda à la colonie punique dans la concentration des intérêts commerciaux et politiques.
Il n'existe plus aujourd'hui aucun doute sur les emplacements de Choba et de Saldae ; Choba occupait l'emplacement de Mansouriah à l'Est de Saldae et Saldae celui qu'occupe Bougie.
Genséric (389-477 - roi des Vandales), successeur des Romains, quittant l'Espagne en mai 429, couvrit de ses Vandales tout le littoral à une certaine profondeur.
C'est par la route de Sitilis (Sétif) à Hypo-Regius (Bône) qu'il arriva de victoires en victoires dans l'été de 430 à cette dernière et s'en empara en août 431.
Rien dans les auteurs anciens ne prouve qu'il ait occupé Saldae au titre de capitale ; elle dut naturellement servir à sa marine mais il n'y eut que Bône qui fut quelque temps occupée par lui avant son arrivée à Carthage, seule capitale du royaume vandale.
Aux Vandales, chassés par Bélisaire succédèrent les Byzantins, aux Byzantins, les Arabes dans la possession de Bougie.
Il faut constater que ce fut vers le milieu du 12e siècle seulement, sous les Émirs berbères Hammadites, branche cadettes des Zirittes, que Bougie atteignit le rang de capitale et commandait à :
- Bône, Constantine et Alger.
Ce fut l'époque de sa plus grande splendeur.
Vers 708 elle acheva d'être convertie à l'Islamisme ; jusque-là elle avait conservé les traces de la religion chrétienne ; mais de tous les évêques, l'histoire n'a conservé que le nom d'un seul Paschasius qui figure au Concile de 484, assemblé par Hunéric, roi des Vandales.
Entre le 7e et le 15e siècle les historiens arabes et principalement Ebn-El-Khaldoun ont transmis une foule de documents peu coordonnés, souvent contradictoires sur les princes ou rois de Bougie.
Il en ressort cependant que Bougie a été, entre ces limites une imposante cité berbère :
- riche,
- commerçante,
- décorée de monuments dont on ne peut que soupçonner l'importance par la grande quantité de débris.
Les Arts et les Lettres y étaient cultivés ; la population de guerrière qu'elle était à l'origine devint abonnée aux fêtes et aux plaisirs ; aussi Bougie fut prise en 1509, sans coup férir, par Pierre Navarre, envoyé par Ferdinand-le-Catholique.
Trois ans après, Baba-Aroudj qui devint plus tard fondateur d'Alger, voulant en faire sa capitale, vint en faire le siège en 1512.
Il y perdit un bras, revint une autre fois sans plus de succès et finalement s'établit à Alger.
Ce ne fut qu'en 1555 que Sala-Raïs, le cinquième pacha d'Alger, s'empara de Bougie mais le génie d'Aroudj était éteint, la cité resta ville de province sous la domination nominale des Turcs jusqu'en 1833 époque où la France y planta le drapeau de sa future régénération.
Importance politique et militaire.
Bougie fut de tout temps le point objectif de quiconque a voulu dominer le bassin latin de la Méditerranée.
Inutile sous ce point de vue aux Romains qui en étaient les maîtres absolus, elle resta avec eux une simple colonie du nom de Saldae.
Elle devint nécessaire à l'Espagne après l'expulsion des Maures de l'Andalousie, c'est pourquoi Ferdinand-le-Catholique envoya en 1509 Pierre Navarre s'en emparer.
En 1541 Charles-Quint eut l'occasion d'en juger les ressources et de suite il y fit construire des fortifications considérables qui existent encore toutes entières.
Baba-Aroudj en comprit également l'importance et quittant son premier établissement de Djidjelli, il voulut faire de Bougie le centre de ses audacieux projets.
La blessure qu'il y reçut en 1512 en voulant s'en emparer lui fit renoncer ; c'est à cela qu'Alger qui l'appela dans ses murs au moment d'une lutte intestine dût, d'être définitivement la capitale des États barbaresques.
Louis XIV mieux renseigné après l'expédition avortée du Duc de Beaufort sur Djidjelli regretta beaucoup de ne l'avoir pas portée sur Bougie qu'il eut trouvée à cette époque presque sans défenseurs.
Enfin il parait que nos intelligents voisins ont mis la position de Bougie au rang des plus importantes et surtout des plus fortes et que si après l'insulte faite au brick anglais le Procris, la France ne s'était pas empressée de la venger, ils s'en seraient donné la peine et le profit.
La ville, convenablement fortifiée, serait une place imprenable et comme elle est la porte de la Kabylie, du seul peuple que nous puissions avoir la prétention légitime de convertir, sinon à nos usages, du moins à nos intérêts, par la réciprocité des bénéfices, elle doit, malgré l'oubli dont elle semble frappée depuis l'occupation française, attirer définitivement la haute attention de l'État.
Que deviendra Bougie ?
Sera-t-elle le second bastion de la courtine qui commence à Toulon qui avec Tunis formerait un triangle stratégique ? L'avenir décidera ; mais il faut espérer que la France poursuivra à travers les siècles ses traditions de progrès et de gloire dont la devise : " Gesta Dei per Francos ", est inscrite au frontispice de son histoire.
- Qu'après avoir défendu le génie de la Grèce, de Rome et le Christianisme,
- après avoir sauvé l'Europe de l'Islamisme au 8e siècle, elle combattra par la morale chrétienne le principe de l'Islam en Afrique.
C'est par Bougie que la France doit entrer dans la Kabylie ; c'est quand le Kabyle qui par :
- ses qualités,
- ses défauts et même
- ses mœurs,
A tant d'analogie avec les Gaulois, qui comme eux s'est inspiré de Rome pour sa djemâa (commune) aura pris confiance, que la France pourra dire en regardant l'Algérie : " Voilà l'autre rive du lac français. "
Chaque génération ne remplit que sa tâche et on ne crée rien de durable sans la sanction du temps.
232 ans ont été nécessaires aux Romains pour opérer la fusion des deux peuples, bâtir leur domination de telle sorte qu'à la fin du 1er siècle de l'ère chrétienne était devenue si romaine qu'on n'y exilait plus.
On y aurait retrouvé le langage de Rome toutes les jouissances du luxe et tous les agréments de la patrie.
Donc, sans impatiences, sans luttes matérielles qui perpétuent les mots de " vainqueurs " et " vaincus " et avec eux les haines de races rappelons au Berbère ses origines glorieuses.
Rappelons-lui que ses héros légendaires ont vaincu et refoulé l'Islamisme, qu'ils ont eu comme nous leur Jeanne d'Arc chrétienne Damia-Ben-Nifack, insultée comme la nôtre du nom de Kahina (sorcière) qui mourut comme elle, trahie en combattant pour son pays.
Alors il est possible qu'un jour cet homme des traditions, retrouvant sur son front le signe du Rédempteur retourne vers ceux qui ont conservé la foi que ses pères avaient embrassés par conviction.
Rappelons-nous que c'est la lutte de l'ascétisme chrétien :
- contre les sens et la vérité,
- la folie religieuse des anachorètes ( religieux contemplatifs solitaires),
- de la Théhaïde ( lieu isolé et sauvage où l'on menait une vie austère, calme et solitaire) qui donnèrent à Mahomet l'idée d'une religion nouvelle, d'un code social et religieux donnant toutes les satisfactions matérielles à des peuples ardents de sang, enthousiastes d'esprit.
L'erreur spiritualiste enfanta par réaction l'erreur matérialiste et c'est entre elles qu'est la vérité à laquelle il faut revenir.
C'est donc par la science économique que cette terre sera régénérée ; elle a produit les :
- Tertullien, Cyprien, Augustin,
Apôtres d'un passé qui fut nécessaire et glorieux ; ils présagent de sa fécondité pour ceux de l'avenir.
Il appartient à notre siècle profondément remué par la science de restreindre les oscillations de l'esprit religieux, toujours outre passant le but, d'entrer franchement dans la vie réelle et pratique.
Avec les principes éternels communs à tous les cultes, avec des institutions morales :
- honorant le travail et
- garantissant la récompense,
- dispensant l'instruction,
- effaçant les marques serviles,
On doit arriver à déraciner les habitudes et détruire les préjugés qui nous séparent du peuple berbère. C'est une œuvre de patience et de temps ; c'est une conquête bien autrement glorieuse que celle d'un territoire !
M. Amédée Thierry, dans son histoire des Gaulois, semble du reste vouloir prouver que la race berbère est une fraction de la grandes invasion des Gaëls (populations irlandaises et écossaises) et Kimris (populations du Nord de la Gaule) qui, après avoir couver le territoire occupé par la France actuelle, déborda sur l'Afrique ; en fait, de grandes analogies :
- dans leurs mœurs,
- dans leurs superstitions,
- dans leurs cérémonies,
- dans leur manière de combattre,
Se retrouvent chez les Kabyles actuels descendants des Berbères et en vertu de l'affinité des races le rapprochement paradoxal de l'extrême civilisation et de la barbarie n'est plus impossible.
La civilisation romaine que la Gaule a acceptée et que le christianisme y a fait atteindre des régions supérieures est descendue dans la Berbérie ; elle s'y est perdue dans le matérialisme musulman.
Il est incontestable qu'au 3e siècle nos pères et les leurs vivaient sous les mêmes lois, il est sage et prévoyant de penser qu'une même loi peut les réunir encore et de préparer leur avenir en conséquence.
Les Velleda ( prophétesses) ont disparu de chez les Berbères par le régime musulman ; qu'elles y reviennent ou, en d'autres termes, que la femme y reprenne son rang et sa dignité, et l'œuvre de la fusion sera facilitée.
La régénération de la femme kabyle est donc un des points à poursuivre pour l'œuvre de la civilisation déjà fort au-dessus de la femme arabe ; ayant comme mère une autorité morale incontestée sur ses enfants, il faudrait qu'elle eût comme épouse des garanties contre le mari. Qu'elle ne pût être :
- chassée de son foyer,
- achetée comme un meuble ou un animal qu'on peut mettre au rebut.
Il est vrai que ces conditions entameraient le Code musulman qui fait de la femme, sinon une esclave, au moins une très humble servante de l'homme au lieu d'une compagne ; mais la civilisation française est à ce prix et nous devons la faire accepter.
Baie de Bougie.
Si la ville de Bougie en elle-même est une citadelle ébauchée, sa rade est par la nature dotée de tout ce qui peut la convertir en un vaste port militaire et commercial. Le golfe de Bougie ancien Sinus Numidicus commence au cap Cavallo et finit au cap Carbon ; mais cet enfoncement n'offre d'abri véritable que dans la partie occidentale, épanouissement des contreforts de la montagne du Gouraya, laquelle par des ressauts (saillies, petites avancées) successifs arrive à la mer et s'y termine brusquement par des falaises de 150 à 200 mètres, constituant les caps Bouac et Carbon, peu distants l'un de l'autre.
A partir du cap Bouac la côte revient vers l'Ouest sensiblement jusqu'au-delà de la ville où était l'ancien port romain ; de telle sorte que la rade qui en résulte n'est ouverte qu'au Nord-Est.
La tenue est excellente ; la partie abritée est de 6 à 700 hectares, par des fonds de 7 à 16 mètres.
Le cap Carbon porte un phare de 1er ordre dont les éclipses, de minute en minute, se voient quelquefois à 12 milles.
Les attérages (lieux où les navires peuvent aborder) sont sans écueils, sauf l'îlot Pizan, situé à 6 milles à l'Ouest du cap Carbon et qui par sa hauteur est vu d'assez loin.
La baie de Bougie est sans contredit le meilleur mouillage l'Algérie ;
Mers-el-Kébir, seul pourrait supporter la comparaison, mais les rafales violentes qui viennent de la plaine des Andalous chassent les navires vers des fonds de plus en plus considérables. C'est à un degré moindre le défaut du port ; les rafales descendant du Gouraya y sont puissantes, mais le fond est moins incliné, la tenue y est plus solide.
Bougie peut, par une jetée de 1.500 à 2.000 mètres établie au cap Bouac, sur un fond moyen de 20 mètres, acquérir 800 hectares d'eaux tranquilles par tous les temps et aptes à recevoir les plus forts bâtiments.
On va bientôt commencer une jetée à la pointe du fort Abd-el-Kader.
Elle dotera la ville d'un excellent port commercial suffisant pour longtemps aux besoins, et ne sera elle-même qu'une avance pour l'avenir car elle sera la ligne séparative nécessaire du port de guerre et celui du commerce, un quai commun aux deux services.
La ville de Bougie invisible du large, cachée par des montagnes inaccessibles et élevées ne redouterait aucun feu de l'ennemi, soit direct, soit courbe car une jetée au cap Bouac et la batterie de mortiers qu'on veut placer au petit phare de ce nom, le tiendraient en mer à 6 kilomètres.
Enfin, ses défenses d'entrée ne pourraient appeler sur la ville les feux de l'attaque.
Le blocus de l'Algérie est un fait impossible : les vents du Nord l'on dit, car si les tempêtes qu'ils jettent sur son littoral annulent les blocus, elles peuvent favoriser l'arrivée des secours de la France ; mais il faudrait avoir des ports sûrs et faciles d'accès pour recevoir ces secours et les abriter.
Quand les conditions normales de liberté et de facilités intérieures auront rendu à chaque port sa valeur intrinsèque, on regrettera d'avoir si peu fait pour Bougie. Sans contredit l'ouvrage qu'il conviendrait de faire pour rendre la rade de Bougie sûre et tranquille serait la jetée du cap Bouac ; mais c'est une question de millions qui ne pourra se discuter qu'avec la nécessité où se trouverait l'État de se créer un port militaire en Algérie.
Un ingénieur hydrographe de la marine, M. Lieussou, trop tôt enlevé à son pays et à ses amis a publié dans son excellent ouvrage intitulé " étude sur les ports de l'Algérie (2me édition) ", une esquisse complète et vraie sur le port de Bougie.
Il a saisi, dans cet ouvrage, l'occasion de dire la vérité sur la prétention d'Alger à devenir port militaire.
Mais à défaut de M. Lieussou, la jetée dira, tant qu'elle vivra, quelles incertitudes ont plané sur la valeur de ce port sans caractère bien marqué. Pour être commercial, il faudrait qu'il fût l'exutoire d'un riche pays, et la Mitidja ne motiverait pas à elle seule la création d'un grand port.
Pour être militaire il faudrait qu'il fût sans crainte pour ses arsenaux, et précisément il est à la merci du premier navire blindé qui par surprise pourra s'en approcher. Que de millions cependant ont été dépensé là, qui pour la sécurité de la colonie eussent été mieux placés ailleurs !
Alger est :
- admirablement située,
- pittoresque,
- hospitalière,
- jouissant d'une grande salubrité ;
Elle est même une cité commerciale parce que l'État en a fait un centre vers lequel convergent beaucoup de routes, un chemin de fer : mais tout cela ne prouve point qu'il faille encore en faire un port de guerre ni même une capitale.
Les Anglais trouvent que Londres est trop près de la mer, qu'on pourrait arriver au cœur de leur pays et le blesser à mort ; que dirons-nous d'Alger ?
On devrait donc éviter d'appeler sur une ville commerciale, une cité :
- de luxe, d'agréments, de plaisirs,
- une maison de santé à l'usage de l'Europe, les rigueurs forcées de l'ennemi, encore moins sur la capitale de notre colonie, mise à la merci de quelques bombes.
Supposons Alger attaquée ; d'où lui viendrait une diversion favorable ?
De la France qui est à 48 heures ? C'est trop loin ; mais supposons que Bougie soit port de guerre : la diversion n'est plus qu'à 9 heures de distance et c'en est assez pour intimider ou neutraliser l'attaque, car une flotte ennemie ne serait pas à l'aise entre Toulon et Bougie, ces deux points avertis par Mers-el-Kébir, sentinelle avancée, et par le télégraphe sous-marin, entièrement Français.
Toulon et Bougie à 24 heures de distance pour les vaisseaux à grande vitesse, à 12 heures pour la jonction des deux flottes françaises en travers du fameux lac, ce serait la création de la courtine (murs de fortification rectilignes compris entre deux bastions) et de ses deux bastions.
Nous sommes dans une époque où l'on fait de grandes choses et la création d'un port de guerre à Bougie serait le corollaire de l'occupation de l'île de Périm dans la mer Rouge.
Importance commerciale.
Sans remonter plus haut qu'au 12e siècle, nous trouvons Bougie, ville considérable, siège d'un grand commerce, poussant au loin vers le désert ses rameaux florissants.
Si la race berbère a été abrutie par trois siècles de régime turc, elle a prouvé sous ses Émirs puissants et tolérants qu'elle était l'égale de tous quand ses allures étaient libres.
Une lettre du 18 mai 1182, adressée par la République de Pise à l'Émir de Bougie, prouvent des relations bonnes et bien établies ; des habitudes de loyauté garantissaient seules cependant les transactions commerciales et en effet l'histoire n'a reproché à aucun Émir berbère ce qui était le fait habituel des pachas turcs.
Telle était même la liberté des transactions que, moyennant un droit de 10% les Émirs laissaient vendre à leurs ennemis les objets importés par les navires chrétiens.
En 1230, un premier traité de commerce conclu entre Pise et le royaume de Tunis dont celui de Bougie était l'enclave (quasi-indépendante et la plus florissante) devint la base du droit public avec les États maritimes de l'Italie :
- Gênes réclama ensuite les mêmes privilèges que les Pisans et obtint son traité en 1236,
- Venise en 1251,
- Florence en 1252.
La guerre de Saint Louis, loin de nuire au commerce en resserra les liens.
Le traité de 1270 consacra le respect des naufragés et de leurs biens alors que le droit d'épave existant encore en France.
Les Émirs de Bougie pratiquaient donc et largement les principes de la liberté religieuse.
Une lettre conservée dans les archives de Marseille constate en juin 1293 les bons offices du chef de la marine de Bougie rendus aux négociants.
Les articles d'importation à Bougie consistaient :
- en vins pour les Chrétiens nombreux qui vivaient sous la protection des Émirs,
- en toiles de Reims,
- futaines (étoffe croisée dont la chaîne et la trame sont en coton,)
- draps,
- quincaillerie.
Bougie placée au milieu des côtes de l'Algérie et à l'entrée du massif berbère principal, demeura longtemps l'une des cités les plus commerçantes de l'Afrique, étendant ses relations à tous les ports de la Méditerranée avec :
- l'Italie,
- la France,
- l'Espagne,
- l'Asie Mineure,
- la Morée (région du Péloponnèse,)
- la Turquie,
- l'île de Chypre,
- la Syrie,
- l'Égypte.
Elle exportait :
- des cotons bruts, du lin, de la soie, des laines,
- des cuirs, de la cire, des métaux, des écorces à tan.
- du miel, des caroubes, des noix, des céréales, de l'huile, des épices,
Enfin un produit dont le nom désigne l'origine, la bougie, et un autre, le corail, s'ajoutaient aux éléments de richesse que possédait la ville.
Les métaux précieux y étaient admis en franchise car Bougie possédait un hôtel de monnaie.
La ville déchut au 15e siècle, comme toutes les grandes villes de la Méditerranée :
- Colomb avait découvert l'Amérique,
- Vasco de Gama doublait le cap des tempêtes,
- les flottes demandaient désormais aux pays nouvellement découverts ce que les caravanes apportaient à la Méditerranée.
Puis vint l'expulsion des Maures d'Espagne ; la réaction chrétienne ouvrit la porte à la violence Baba-Aroudj en prit le prétexte et installa la domination des Turcs.
Le commerce alors fut anéanti ; Bougie qui ne pût être la capitale des États barbaresques, resta petite ville, et sa rade fut celle d'hivernage des frégates corsaires de l'hodjak (milice des janissaires) d'Alger.
A l'heure actuelle la cité expédie encore :
- huiles, caroubes, figues sèches,
- liège, bois, métaux
Pour une valeur variable entre deux à cinq millions suivant la bonté des récoltes.
Les huiles que les versants des montagnes kabyles livrent à la consommation, partant du même pressoir, vont à la fois à Tombouctou et à Paris, aux rives du Niger et à celles de la Seine, réunissant ainsi le connu et l'inconnu.
Cette situation n'est-elle pas la clé de l'avenir ?
Situation de la Ville de Bougie.
État présent. Description et ressources.
Bougie est située sur la côte Nord-Ouest du golfe de ce nom, ancien golfe de Numidie, à 28 lieues de Sétif à laquelle elle est reliée par une route qui va être prochainement terminée et qui sera sans contredit une route des plus remarquables par l'aspect du pays qu'elle traverse.
Au pied de la ville est une rade immense ; derrière elle s'élève rapidement la montagne du Gouraya, dont le pic, de 704 mètres au-dessus du niveau de la mer était naguère le but d'un pèlerinage pieux : le tombeau de la sainte femme nommée Lella-Gourayah, compris maintenant dans l'enceinte du fort du même nom.
Sur ses flancs Est et Ouest existent deux ravins.
La ville européenne seule est en vue de la rade ; la partie indigène est sur le revers du mamelon entre le ravin de Sidi-Touati à l'Est et celui du Djebel-Khalifa à l'Ouest.
Des maisons entremêlées de quelques arbres sont coquettement assises et quand le projet des fortifications sera définitivement arrêté nul doute que de grands espaces réservés jusqu'à présent par le Génie militaire ne soient remis à la colonisation et utilisés en constructions et jardins ; alors l'antique capitale des Émirs berbères pourrait redevenir :
- ville de luxe,
- ville commerçante,
- ville forte.
On voit encore :
- les murailles gigantesques, débris imposants de la ville sarrasine,
- les citernes dites romaines et les murs de Saldae,
Enfin, au bord de la mer, à côté d'un débarcadère mesquin construit depuis l'occupation française,
- les fiers et robustes débris de l'enceinte fortifiée semblent évoquer les souvenirs du passé et reprocher au présent ses défaillances et ses hésitations.
La ville est administrée par un maire et un conseil municipal depuis le 14 juin 1854 ; elle relève de la préfecture de Constantine depuis le 10 mars 1850 ; mais par l'absence de chemins convenables, elle n'a pris, depuis l'occupation française aucun développement.
On compte beaucoup sur le prochain achèvement des routes qui la relieront à Sétif et à la grande route d'Alger à Constantine par les Beni-Mançour.
Ces routes permettront en effet aux produits des riches plaines de Sétif de venir s'embarquer à Bougie en diminuant de moitié leur parcours actuel et à la route des Beni-Mançour, dirigée sur Aumale, recevra tous les produits des versants kabyles dans toute la vallée de l'Oued-Sahel, depuis Bougie jusqu'à Aumale.
On travaille activement à ces routes.
La population de la ville en 1866 était de 2.916 âmes dont :
- 1.550 Européens et
- 1.566 indigènes.
La population européenne se répartissait ainsi :
- 809 Français,
- 145 Anglo-Maltais,
- 157 Italiens,
- 226 Espagnols et
- 15 divers,
Ce qui, avec la garnison qui doit être réglementairement de 1.000 hommes, fait une population de 4.000 âmes environ.
La ville a pour enceinte une muraille qui relie entre eux les forts :
- Abd el Kader,
- de Moussa ou Barral en s'appuyant sur la caserne Bridja, puis de Moussa retourne vers la mer et finit à la Casbah.
Elle a sept portes :
- Celle d'Abd-el-Kader,
- de la Caserne,
- du vieillard,
- de Moussa ou Barral,
- des Disciplinaires,
- du Grand Ravin,
- de Fouka et de la Casbah.
Elle en aura une nouvelle sur la route qui joindra le port à la plaine.
Sa forme est celle d'un triangle dont le fort Moussa est le sommet, Abd-el-Kader et la Casbah les extrémités de la base assise sur la mer.
La circulation n'y est pas facile, vu la raideur des rues principales :
- la rue Trézel,
- du Cadi,
- du Vieillard,
- de la Marine qui, avec celle de la Casbah mènent à la porte de Fouka, composant la ville européenne.
Quant aux autres qui desservent les quartiers indigènes, une seule est accessible aux voitures : C'est la rue Kléber où se trouve la prison civile.
Dans la partie Nord-Ouest se trouve :
- un grand quartier indigène,
- la place du marché ou place Louis Philippe qui possède un petit fondouk et
- le Camp Supérieur où se trouvent les citernes romaines.
L'eau est rare et c'est d'autant plus regrettable qu'autrefois elle en était amplement pourvue ; elle recevait de sept lieues, par un aqueduc dont on voit encore les restes, la rivière de Toudja, l'Oued-Ghir.
Elle s'alimente maintenant par les sources :
- de Roumane,
- de la fontaine romaine,
- des quatre bassins du four à chaux,
- de Sidi-Touati,
- des cinq fontaines.
Celle du fort Clauzel fournit exclusivement à l'abreuvoir et au lavoir, près du parc à fourrage.
On s'est emparé de toutes les sources qui appartenaient à des propriétés particulières dominant la ville et ainsi on est arrivé, après avoir frappé de stérilité tous ces terrains, à donner aux habitants le strict nécessaire.
L'eau ne manque cependant pas, ni les moyens de la conserver.
On pense que bientôt l'édilité donnera satisfaction à ce besoin de premier ordre.
La ville possède maintenant une église mais n'a point de mosquée !
Elle qui fut une ville sainte ! Un lieu de pèlerinage qu'on appelait la petite Mecque ! Elle qui avait son puits de Zem-Zem visité par tant de pèlerins !
Il est maintenant à côté d'une vacherie et abandonné aux bestiaux.
Elle possède trois marabouts insignifiants et mal entretenus :
- Sidi-Yaya,
- Sidi-Soufi,
- Sidi-Abd-er-Rahman.
- Il y a une caserne d'infanterie à Bridja-Supérieur pouvant accueillir un bataillon et sous laquelle existe une citerne de 5.000 mètres cubes,
- une autre caserne à Sidi-Touati pour 50 hommes,
- celle du fort de Moussa (Barral) pour 150 hommes, habitée par les pionniers de Discipline et
- celles de Sidi-Ahmed et de Bridja-Inférieur pour les Fusiliers de Discipline,
- enfin de petits logements pour les troupes d'artillerie et du génie.
- L'artillerie a ses magasins place de l'Arsenal et à Mangin,
- le génie et les subsistances militaires à la Casbah,
- le Campement près de la porte sarrazine ;
- l'Atelier N° 4 des travaux publics est campé au Plateau des Ruines, au sommet du Gouraya.
L'hôpital militaire est le seul bâtiment hospitalier ; il est sur le plateau de Bridja près de la caserne et peut contenir 177 lits.
Le parc aux fourrages est en dehors et au bas de la ville.
Une chétive et ancienne maison mauresque est affectée au Cercle militaire.
Il y a :
- un cercle civil,
- un phare de 1er ordre au cap Carbon,
- un de 4e ordre au cap Bouac,
- une école de garçons,
- une pour les filles,
- un lavoir,
- un abreuvoir au dehors de la ville, c'est tout et c'est peu pour une ville qui jouit annuellement de plus de 1.000 francs de revenus de ses marchés.
On trouve deux hôtels à Bougie : l'hôtel de la Marine et l'hôtel des Quatre Nations.
Comme dans toutes les villes de l'Algérie le nombre de cafés et de débits de boissons semble supérieur aux besoins ; ils font vivre pauvrement ceux qui les tiennent.
Il existe une imprimerie typographique.
Les moulins à farine de MM. Moncada et Guillaumi, situés à 6 kilomètres de la ville ne pouvant suffire à la consommation faute de la réglementation des eaux de l'oued-Akdou, on y a introduit la vapeur.
Mais leur industrie ne pourra se développer que par l'arrivée des grains de Sétif quand la route sera ouverte. Les moulins à huile de MM. :
- Lambert,
- Ahjmed Khatri,
- Dufour,
- Honorat,
- Et Emery sont en bonne voie de fortune et livrent au commerce de grandes quantités d'huiles comestibles rivalisant avec les meilleures huiles de Provence.
L'exploitation des lièges de M. Chabannes du Peux, en plein rapport, va donner lieu à des fabriques de bouchons et verse déjà aux Indigènes employés aux divers travaux 60.000 francs de salaires.
- Les figues sèches,
- les caroubes,
- les huiles à savon
Sont en ce moment la base du commerce d'exportation bougiote.
La France y envoie :
- des cotonnades,
- du fer,
- des épices,
- de l'argent.
Les Indigènes :
- greffent les oliviers et les caroubiers sauvages,
- plantent des figuiers.
De sorte que les produits d'exportations augmenteront considérablement en peu de temps, sans compensation proportionnelle des produits français, à moins que la colonisation, étouffée dans l'étroit espace que lui a mesuré la Circulaire de mai 1866, ne s'étende dans des limites convenables.
Les articles d'exportation que les routes ouvertes vont créer sont : les blés et les orges des plaines de Sétif et d'Aumale. Très probablement :
- les laines de Bou-Saâda,
- les cuirs,
- le miel,
- la cire de toute la Kabylie,
- les minerais riches et variés que des recherches concédées ont mis à découvert dans l'Oued- Agrioum et ailleurs.
Les vignes commencent à fournir une partie de la consommation, mais jusqu'à présent les propriétaires ont cherché à faire des vins trop fins et c'est probablement une mauvaise spéculation.
On cite MM. Blanc et Dufour comme ayant les vignobles les plus étendus et les mieux entretenus.
La culture du lin et du coton a donné des produits d'une qualité remarquable ; mais ces industries ont subi à leur début des mécomptes, de sorte que ces cultures sont à peu près abandonnées.
Les environs sont accidentés et d'un aspect agréable ; les pentes Sud du Gourayah sont en roches calcaires, reliées par des argiles rouges.
Du temps de Léon l'Africain on y voyait, dit-il, des maisons de plaisance richement ornées dont il donne la description.
Le temps n'a laissé que des débris méconnaissables ; mais Peyssonnel (médecin et naturaliste) qui, en 1722, en a vu les restes, affirme que ce pays a réuni des hommes qui savaient jouir de la vie, aimant la danse, la musique et les doux plaisirs.
Il ajoute qu'on voit aux alentours plusieurs montagnes toutes couvertes de bois dans lesquelles se nourrissent une infinité de singes et quelques panthères.
Ces animaux, en effet, fréquentent encore les environs de la ville.
- Les sangliers,
- hyènes,
- chacals,
- lynx et
- tous les gibiers, garnissent les ravins environnants.
Les villages kabyles semblables à nos hameaux de France, et quelques-uns des gros bourgs, tranchent par leurs maisons blanchies à la chaux.
C'est un progrès accompli !
Depuis notre occupation le bien-être commence à pénétrer et se traduit par un peu plus de propreté.
Le terrain occupé par la colonie bougiote, dit territoire civil, est évalué à 400 hectares desquels la moitié est domaine public ou domaine militaire.
Les seuls moyens de transport à Bougie, pour les excursions que l'on voudrait faire dans les environs, sont les chevaux et les mulets.
Une route a été faite dans la direction de Sétif mais elle n'est pas encore achevée pour le service des voitures.
La route de Sétif sera finie en 1870, dit-on, et sera l'une des plus belles et des plus curieuses comme tracé, surtout dans la partie des montagnes nommée Châbet-El-Akhra ; elle est en corniche à une grande hauteur au-dessus du ravin où coule l'Oued-Agrioum, et elle est elle-même surplombée par des hauteurs verticales de 1.000 mètres.
Les constitutions nerveuses en sont fortement impressionnées, dit-on ; le surplomb inspire la crainte et le vide donne le vertige.
Sans doute ces effets n'auront plus autant d'intensité quand la route aura sa largeur réglementaire et son parapet, mais il y aura toujours des émotions vivement recherchées par les touristes.
La route des Béni-Mançour, à laquelle on travaille activement va servir de canal aux produits de la vallée de l'Oued-Sahel ou Soummam jusqu'à Aumale et rejoindra aux Beni-Mançour la grande route impériale d'Alger à Constantine.
Cette route sera probablement aussi profitable aux intérêts de Bougie que celle sur Sétif.
Ce sont deux canaux convergents qui desserviront des pays riches et de produits extrêmement variés et naturellement la ville placée au point de convergence et jouissant d'un bon port, devra reprendre, sous l'influence des deux courants, l'importance commerciale qu'elle a eu autrefois et qu'elle eût repris en partie depuis l'occupation française, si les intérêts particuliers des villes voisines n'avaient constamment pesés sur son développement.
Marine locale.
Le port de commerce compte une quarantaine de bateaux pêcheurs ou allégés occupant une population maritime de 80 marins, représentant 150 individus femmes et enfants compris.
Cette industrie presque abandonnée par les Indigènes est exploitée par les :
- Italiens,
- Maltais et
- Espagnols
En grande partie naturalisés Français.
La marine indigène a disparu :
- devant l'activité des nouveaux marins plus habiles et presque aussi sobres qu'eux,
- devant les formalités de douane et les restrictions de l'inscription maritime dont ils ne comprennent pas encore le but et la portée.
Mais la cause matérielle de la disparition des bateaux indigènes a été surtout le manque de terrains pour les hâler et les réparer ; le mauvais temps est venu les briser les uns après les autres en les prenant en rade sur de mauvaises amarres.
C'est une erreur assez accréditée de penser que les Indigènes avaient une population maritime digne de ce nom.
La vérité est que la marine barbaresque était composée en partie de renégats de toutes nationalités et qu'au moment des sorties de ces corsaires on complétait les armements en ramassant à terre tous les gens sans aveu.
Longtemps déjà avant la prise d'Alger, en dehors de quelques felouques faisant l'été un petit cabotage, la marine locale indigène n'existait plus : les marins de l'été étaient tisserands l'hiver.
La rade de Bougie possède actuellement un service régulier : le service hebdomadaire des Messageries arrivant d'Alger le dimanche, et partant pour les escales de l'Est et revenant le jeudi partant pour Dellys et Alger.
La Compagnie générale y avait créé aussi un service par quinzaine : un de ses bâtiments partait de Marseille pour Alger et Bougie et retournait à Marseille.
Si les courriers de France arrivaient directement à Bougie, ils gagneraient trois ou quatre heures sur ceux d'Alger par la raison que la ligne la plus courte entre Marseille et l'Algérie aboutit sur Bougie faisant gagner une différence de 55 kilomètres.
La route passerait alors à l'Est des îles Baléares ce qui assurerait un abri plus prolongé contre le mistral.
Bientôt la ville jouira d'un port de commerce sûr et tranquille par tous les temps ; la jetée sera une utilité et un ornement ; mais il est regrettable que le fort Abd-El-Kader, qui tombe en ruines, ne soit pas rasé pour la construction de cette jetée : la cité aurait gagné là une promenade magnifique qui lui fait défaut.
Considérations générales.
Pendant toute la période de pacification, aucune question ne méritait plus d'intérêt que les routes stratégiques ; elles ont été faites par le génie militaire et là où la guerre en a nécessité la construction.
La colonisation venue à la suite des camps les a utilisées, de telle sorte que l'on a pu remarquer que les provinces sont peuplées de colons en raison de la résistance indigène.
Après la période de pacification doit venir celle de la colonisation, non plus seulement les colons fournisseurs de l'armée et vivant par elle seule, mais le peuple industriel venant la faire vivre et fécondant la terre si chèrement achetée par nos soldats et par les sacrifices de la France entière.
Ce peuple industriel, c'est :
- l'agriculteur,
- c'est le commerçant et
- les intermédiaires qui vont de l'un à l'autre.
Cette classe de peuple ne peut prospérer que par une grande indépendance ; elle fuit le militarisme qui tue l'initiative personnelle ; ses voies de communications sont rarement des voies stratégiques, aussi entend-on répéter partout en ce moment : routes et ports ! C'est l'aspiration générale ; c'est la question unique sur laquelle on doit s'entendre au plus tôt.
Route et port ne sont qu'une seule chose :
- La route est le canal où la contrée verse ses produits,
- le port en est l'extrémité, le dock d'où ils reçoivent toutes les destinations.
- Créer des routes sans les ports c'est créer l'engorgement du canal,
- créer des ports sans les routes c'est l'engorgement du port, et en résumé, c'est créer la souffrance et la ruine.
Avant de créer une route il faudrait connaître son extrémité qui est le port. Qui doit l'indiquer ? La nature, car en général elle crée les ports et le commerce s'y établit de telle sorte que l'extrémité d'une route est déterminée à priori.
Rarement l'homme crée le port de toutes pièces, si ce n'est pour une défense nationale.
Il résulte de là que la question de port prime la route qui en est le corollaire et que toute la prudence de l'État doit être employée dans le choix.
Là, malheureusement, il faut l'avouer, il y a quelques modifications à introduire dans les études de projets parce que les hommes spéciaux n'y ont pas la part de légitime influence qui leur est due.
- Ce serait aux marins et aux armateurs à désigner les ports de commerce.
- Ce serait aux agriculteurs, aux industriels et aux négociants à désigner les routes commerciales.
- Il resterait aux ingénieurs et aux administrateurs à les construire et à les réglementer.
J'entends :
- par agriculteur les propriétaires fonciers gérant leurs terres et y habitant une grande partie de l'année,
- par industriels, les chefs de grandes usines ou exploitations,
- par négociants, les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs.
Avec ces hommes spéciaux il serait impossible d'être hors de la vérité ; la besogne des ingénieurs et des administrateurs deviendrait :
- facile, économique, glorieuse,
Car elle serait basée sur des idées pratiques.
Ville et rade de Bougie par J. Masselot,
lieutenant de vaisseau, Directeur du port de Bougie,
ancien élève de l'École Polytechnique. Édition 1869.
|
|
| Suivons le guide !
Envoi de M. Christian Graille
|
Ceux qui parcouraient l'Algérie moins de trente ans après la prise d'Alger étaient en droit d'éprouver un étonnement émerveillé devant les transformations de ce pays sortant à peine d'une longue guerre.
Accomplissons un retour dans ce passé à la lumière de nombreux témoignages, parmi lesquels l'ouvrage exhaustif et précis du géographe Mac Carthy édité en 1858, étrangement méconnu par les historiens considérés colle les mieux informés, omis dans leur bibliographie.
C'est lui que nous suivrons le plus souvent, regrettant de devoir le résumer et recommandant particulièrement de concourir à l'original.
Alger.
Nous n'avons mis que cinquante heures pour arriver de Marseille, notre steamer, le Du Tremblay glisse maintenant vers la vaste nappe d'eau du port où s'entrecroisent des embarcations de toutes sortes.
La tour octogonale construite par les Turcs sur l'emplacement du Penon espagnol est devenue un phare aux feux tournants visibles de vingt kilomètres.
Dans l'ancienne darse des pirates est rangée une flottille de pêche, (beaucoup des 1.700 embarcations de pêcheurs d'Algérie sont basées à Alger) devant le pavillon de la santé maritime curieusement inspiré des temples grecs.
Franchie la porte de France, longeant la grande mosquée et celle de la pêcherie (Djama Djedid) nous accédons à la place du gouvernement, l'ancienne place royale que les Indigènes appellent place du cheval à cause de la statue équestre du Duc d'Orléans, fondue dans le bronze des canons turcs (érigée en 1845).
Aussi belle que la ville fut de la mer est la mer vue de la ville, l'incessante et bruyante activité du port que le regard embrasse tout entier :
- la large baie semi-circulaire jusqu'à la petite éminence du Cap Matifou,
- les contre forts de l'Atlas rehaussés par la silhouette du Bou Zegza au-delà desquels apparaissent les cimes neigeuses du Djurdjura.
Les couleurs changeantes, la magie de la lumière transfigurent cette place que bien des peintres s'évertueront à reproduire.
Dans la foule bigarrée, que de militaires ! Un passant sur deux est en uniforme.
Autour sur les chaussées bordées de platanes, récemment plantés, des spahis et des chasseurs d'Afrique caracolent entre des calèches et de petits omnibus colorés " les carricolos " baptisés de noms pittoresques :
- Lézard,
- lion du désert,
- frégate à vapeur,
- berceau d'amour.
Quelques groupes en costumes maures ou en burnous se meuvent avec lenteur parmi les Européens en tenue de ville ou en costumes méditerranéens hétéroclites et originaux, tandis que traversent furtivement la place des femmes dissimulées dans de blancs Haïks et que passent quelques élégantes française en robe à crinoline.
Côté Nord, un peu en retrait l'hôtel de la Régence, ancienne résidence du marquis de la Tour du Pin devant lequel on projette de transplanter de grands palmiers,
- la librairie Bastide et Jourdan,
- le café d'Apollon,
- la placette Mahon sur l'emplacement du Batistan,
- l'ancien marché d'esclaves.
Côté mer, la blanche façade crénelée, la coupole et le haut minaret carré de Djama Djedid, une vaste échappée sur le port et le large conférant à cet ensemble un caractère unique.
Côté Sud l'immeuble Duchassaing, traversé par une galerie, abrite le café-concert de la Perle.
D'un côté de la haute ville, plus de Djénina ; très endommagée par un incendie elle a été démolie malgré les protestations de l'historien Berbrugger : sa valeur d'art, à vrai dire, était médiocre.
Derrière son emplacement, la mosquée Ketchaoua transformée de fond en comble, devenue cathédrale en un style de prétentions orientales.
D'anciens palais logent l'évêché, le gouverneur.
Vers la rue d'Isly.
De la place du gouvernement, la rue Bab-Azzoun :
- parallèle à la mer,
- étroite,
- bordée d'arcades, et
- bien achalandée,
- conduit à l'élégant théâtre conçu par Chassériau.
A côté le cercle militaire aménagé dans deux anciennes casernes de janissaires.
Au-delà on monte vers la rue d'Isly rectiligne aboutissant à la porte du même nom par où l'on traverse la nouvelle enceinte.
Elle longe un long caravansérail et s'élargit à mi-longueur en une placette sur laquelle se dresse une statue du maréchal Bugeaud et où s'achève la construction du collège franco-arabe.
De l'autre côté de la place, la rue Bab-el-Oued, elle aussi bordée d'arcades débouche sur une esplanade ; là va bientôt être construit le grand lycée, près du jardin en pente dû à l'initiative de Marengo.
Plus loin commence le faubourg de Bab-el-Oued très espagnol ; dans le haut au bassin de la Bassetta viennent s'abreuver les chevaux des carriers de Valence et les chèvres des Maltais.
Le long de la plage, les messageries remisent leurs diligences.
Un peu plus loin l'hôpital militaire est installé dans les anciens jardins du Dey.
De part et d'autre de la haute ville qui recèle dans ses ruelles du Nord de nombreuses maisons closes, deux voies montantes sinueuses, les " tournants de Rovigo " et la rampe Valée se réunissent au-delà de la Kasbah et des casernes des zouaves, avant la porte du Sahel où un pont-levis franchit le fossé des remparts. Autour de la ville quelques beaux villages en sont comme la banlieue au Nord, Saint Eugène, le long de la côte rocheuse, dominé par une pente abrupte sur le ressaut de laquelle vient d'être posée la première pierre de la future basilique dédiée à Notre Dame d'Afrique.
A l'Ouest le plateau d'El-Biar, à plus de 200 mètres d'altitude.
Vers le Sud où des ravins se succèdent le village d'Isly, Mustapha inférieur et Mustapha supérieur aux blanches demeures dans de vastes jardins, dont le petit palais, résidence d'été du gouverneur.
Le long de la baie, après l'ancien domaine de l'Agha des spahis :
- l'hôpital civil de Mustapha,
- le quartier des chasseurs d'Afrique et
- le parc à fourrages,
- les 28 hectares poussiéreux du champ de manœuvres,
- le Jardin d'Essai.
Après le village d'Hussein-Dey dominé par celui de Kouba et le grand séminaire en construction, nous arrivons à la Maison-Carrée où l'ancien fort turc (bordj el Harrach) a été transformé en pénitencier et une papeterie installé en 1853.
Par-delà ce sont les jardins maraîchers aux alentours du Fort de l'Eau.
Une capitale charmante.
Rien ne manque à cette capitale en miniature de 44.500 habitants (56.000 avec les faubourgs).
Depuis 1857 elle est dotée :
- d'une école de médecine,
- des sociétés savantes publient des revues de qualité,
- une bourse y fonctionne.
La vie mondaine aux dires de Louis Veuillot n'y sent nullement sa province.
Dans ce doux climat l'on vit beaucoup dans la rue.
Une étroite promiscuité atténue les préjugés de classes et de races.
- Ville charmante aux dimensions humaines et à la mesure du pas,
- propice aux flâneries,
- aux rencontres,
- aux discussions parfois tapageuses, vite apaisées.
L'été il y fait bon vivre à l'ombre des arcades et des jeunes arbres, un éventail à la main, en sparterie (fabrication d'objets en fibre végétal : jonc, alfa,) locale à manche de bois pour les hommes ou éventés par l'humide brise d'une mer omniprésente, dont le bleu apparaît à chaque croisement de rues.
- Les plages,
- les chemins et
- les sentiers des collines ombreuses sont tout proches.
La province d'Alger a été transformée la première.
Dans le Sahel, défriché, couvert de céréales et de quelques vignobles sont éparpillés plus de vingt villages, parmi lesquels :
- Birmandreis,
- Birkadem,
- Dély-Ibrahim,
- Douéra, (plus de 1.000 habitants), doté d'un moulin à vapeur,
- Chéragas qui cultive des plantes à parfum et produit des fromages de Brie,
- Staouéli à côté du domaine des Trappistes et un peu plus loin
- Zéralda,
- Koléa avec ses 2.700 âmes est presque une ville entourée de :
- Douaouda,
- Fouka,
- Castiglione (qui comprend Bou-Ismaïl et Téfeschoun), les hameaux suisses.
Le grand marché de Boufarik.
En Mitidja où prospèrent :
- fourrages, orges, blés, tabac, mûriers pour l'élevage des vers à soie,
15 villages dans l'Est dont :
- Maison-Blanche,
- Rouïba,
- Réghaïa,
- l'Alma,
- le Fondouk,
- Rivet,
- les récentes orangeries de Sidi Moussa,
- l'Arba,
- Rovigo
Et presque autant dans l'Ouest :
- Marengo, non loin du vaste lac Halloula près du récent barrage de l'oued Meurad,
- Ameur el Aïn,
- El Affroun,
- Mouzaïaville dont l'église vient d'être construite,
- la Chiffa.
A Boufarik, vraie petite ville de bientôt 4.000 habitants dans sa forêt d'arbres plantés se tient tous les lundis le grand marché de la plaine ; alentours plusieurs villages :
- Chebli,
- Bouïnan,
- Béni-Méred,
- Oued el Alleug,
- Souma.
Nous voici à Blida (9.000 habitants) sur la place d'armes bordée de platanes, encadrée d'immeubles à arcades.
L'église est une ancienne mosquée ; aux casernes et à l'hôpital militaire, comme dans toute ville algérienne, s'ajoutent :
- un théâtre,
- un marché européen,
- un beau jardin public hors les murs.
Dans la vallée avoisinante de l'oued el Kébir fonctionnent des minoteries ; des orangers du temps des Turcs entourent la ville ainsi que :
- Joinville,
- Montpensier,
- Dalmatie, coquets villages satellites.
- De part et d'autre de Blida la " route de l'Atlas " relie village à village.
Sur le littoral Est, Dellys est un enviable séjour pour les 2.000 personnes qui y résident, précédée de jardins, dominant des eaux très poissonneuses.
A l'Ouest les quelques maisons de Tipaza sont groupées sur le rivage, en contre-bas d'un plateau jonché de ruines romaines dorées, face à l'imposant promontoire du Chenoua.
Cherchell reste au large dans le dixième des 369 hectares de l'antique cité Césarée ; le port de cette époque, utilisé par les barbaresques, a été remis en état, des statues des mosaïques réunies dans un modeste musée.
A côté du vieux Ténès, une bourgade française surplombe de quarante mètres sa marine.
La route qui la relie à Orléansville est jalonnée de groupes d'habitations européennes, dont Montenotte.
Dans les gorges de la Chiffa.
En Kabylie, vient d'être installé Dra-el-Mizan et à 25 kilomètres au-dessus du fort de Tizi-Ouzou, dans l'enceinte de fort Napoléon, 67 maisons sont déjà construites.
De l'autre côté, dans l'intérieur du pays, sur le versant Sud du Zaccar, Miliana est nichée dans un fouillis de végétation, des eaux courantes s'éculant le long de sa grand' rue ombragée.
Non loin le récent village de Vesoul-Bénian avoisine les sources d'Hammam-Rirha jaillissant à 45° auprès desquelles l'armée a installé un hôpital de convalescents.
En suivant la vallée du Chélif, passant par Affreville plantée de peupliers d'Italie :
- Duperré, Lavarande, Pontéba et sa pépinière,
Nous franchirons l'oued sur un pont de bois et parviendrons à Orléansville, dont les jeunes verdures sont rafraîchissantes sous un soleil presque aussi torride qu'au Sahara.
Revenu à Blida, en route pour le Sud, nous traversons d'abord un large oued presque à sec sur le long pont de bois puis nous nous engageons dans les gorges de la Chiffa.
Après un arrêt au ruisseau où les singes descendent nombreux de la montagne nous montons à Médéa : émergeant des ruines de la guerre, devenue européenne, elle a gardé trois minarets dont l'un domine une mosquée changée en église.
A sa Casbah ont été substitués des casernes et un hôpital. Bien qu'à 944 mètres d'altitude, elle s'environne de vignobles et autres cultures ; deux villages en sont proches, Damiette et Lodi.
Puis c'est la redoute de Boghar et son beau jardin pépinière face au ksar (village fortifié) de Boghari, en contre bas sur l'autre rive du Chélif ; au-delà cinq caravansérails ont été construits récemment :
- Boughzoul,
- Aïn Oussera,
- Gelt-es-Tel ou rocher de sel,
- Aïn el Ibel,
- Sidi Maklouf
S'échelonnant jusqu'à Djelfa et c'est enfin Laghouat, " fleur du désert " protégée par le fort Bouscaren et la tour Morand, bien reconstruite autour de la vaste place Randon, une rue à arcades ouvrant sur des jardins de palmiers que jouxtent de vraies prairies, irriguées par le barrage récemment construit sur l'oued Mzi.
Il est moins loin d'atteindre Oran par la mer : le trajet en diligence (un jour sur deux) dure 65 heures !
La ville (22.000 âmes) garde bien des vestiges de sa longue période espagnole.
Sur le versant du Mourdjadjo a été inaugurée en 1850 la chapelle votive de Notre Dame du Salut.
Les Français ont respecté la mosquée du pacha au beau minaret octogonal, construite avec la rançon des esclaves, celle de Sidi el Haouri.
La promenade du général Létang autour du Château Neuf est due, comme en face le jeune boisement des Planteurs.
D'aspect tout européen, la capitale de l'Ouest est très commerçante, avec plusieurs usines et de nombreux entrepôts.
On a commencé à aménager le port mais il reste trop petit et insuffisamment profond pour les gros navires qui doivent encore mouiller à Mer-el-Kébir.
Dans les environs, à la Sénia, à Valmy se développent des cultures maraîchères. A Misserghin, autour de l'orphelinat fondé en 1842, une belle pépinière, créée par les militaires a été cédé aux religieux..
Au-delà de Mer-el-Kébir, après les plages d'Aïn-el-Turk et des Andalouses, la route ne va pas plus avant.
Le clocher et l'église de Mostaganem.
Mais vers l'Est, Mostaganem (6.500 citadins), bien que ne disposant pas encore d'un port aménagé, est :
- active, animée,
- sa place ,ici encore encadrée de maisons à arcades, dominée par le clocher de son église.
Le ravin d'une petite rivière pérenne, qui peut s'enfler dangereusement, la coupe en deux, avant de la séparer de l'agglomération indigène de Tidjit.
Dépassant un important quartier de cavalerie et plus loin, un haras, en moins d'une heure de marche, nous atteignons Mazagran, entouré de quelques cultures maraîchères et de vergers.
Une constellation de 14 villages agricoles gravite alentour dont :
- Aïn Tédélès, Pelissier, La Stidia, Rivoli….
L'aspect de la région n'est plus " désert et abandonné " : les palmiers nains font de plus en plus place aux cultures, de même autour d'Arzeu, bien que celle-ci demeure bien léthargique, les 18 colonies de 1848 sont maintenant bien implantées, Saint-Cloud étant la plus vivante grâce aux Parisiens qui y ont importé leurs guinguettes et leurs bals de faubourg, organisé en petite salle de spectacles.
200 colons à Saïda.
Sur la route d'Alger, Relizane vient de naître ; vers Mascara, Saint Denis du Sig bénéficie d'un barrage irriguant 800 hectares et des olivettes y font leur apparition.
L'ancienne capitale d'Abd El Kader, en partie détruite par la guerres, reprend son activité artisanale, fabrique des burnous noirs et des haïks.
Auprès d'elle poussent deux petits villages, Saint Hippolyte et Saint André, dans les céréales et les vignobles de la plaine d'Eghris et des coteaux avoisinants.
Plus au Sud, autour de la redoute de Tiaret, se sont fixés 700 colons et 200 à Saïda. A Géryville et Aïn Sefra dans le Sahara il n'y a guère de civils auprès des postes militaires.
Par contre dans la vallée fertile de la Mékerra, Sidi-Bel-Abbès, mi-légionnaire, mi-civile, est " une jolie ville toute neuve. "
Au Sud-Ouest d'Oran, par les riches terres noires de Rio Salado et d'Aïn-Témouchent, nous accédons à Tlemcen, restée très musulmane.
Dans le méchouar l'hôpital et des casernes.
Plusieurs villages satellites se développent, plus bas que la ville et ses jardins :
- Hennaya,
- Bréa,
- Négrier,
- Safsaf…
Vers le Maroc, les 500 à 600 personnes qui habitent Lalla-Marnia sont en partie des ouvriers de la mine voisine.
La route aboutit sur la mer à Nemours, encore une " plancheville " plus qu'un ensemble de maisons.
Des trois provinces d'Algérie celle d'Oran apparaît au voyageur comme la plus prometteuse pour un peuplement européen rural et multi-urbain.
Moins frappantes sont les transformations dans la province de Constantine, à part les plaines littorales et quelques villes, dont plusieurs sont toutes nouvelles.
Treize mosquées à Constantine.
A Constantine deuxième cité d'Algérie par ses 34.000 habitants, le vieux pont d'El Kantara qui vient de s'écrouler, va être remplacé par un autre en amont.
Le palais du Bey est devenu la résidence du gouverneur commandant la division et la ville ne manque pas d'avoir son théâtre.
Parmi les treize principales mosquées, Djama-Kebir a été conservée ainsi que Sidi-Lakhdar, surmontée d'un minaret octogonal, Sidi el Kettani.
Hors la porte Valée une vaste esplanade surplombe les anciennes écuries turques du Bardo, affectées à un quartier de cavalerie.
La ville reste un centre artisanal et commercial important laissant peu de place aux Européens.
A sept kilomètres vers le Nord-Ouest, au Hamma, de plantureux jardins sont abreuvés par une source thermale et des eaux abondantes ; une distillerie vient d'y être installée.
Non loin de là dans la vallée de l'oued Bou Meurzoug, commencent à se peupler le Kroubs et les Ouled-Rahmoun.
Cinq routes divergent en étoile de Constantine, la reliant :
- à Philippeville et Bône,
- à Djidjelli par Mila,
- Bougie par Sétif,
- Biskra par Batna
- et à Tébessa.
Philippeville sous la protection du fort établi par Randon et de la batterie de Skidda, (Philippeville) a été construite de toutes pièces, typique des cités d'Algérie réalisées par des militaires : Grand' rue bordée d'arcades entre la mer et la porte principale de l'enceint, place d'Armes, auxquelles s'ajoute même un petit théâtre.
Les citernes romaines de Rusicade (nom de Philippeville à l'époque phénicienne et romaine) lui assurent l'eau ; son port est à quatre kilomètres, à Stora.
Dans la plaine voisine de l'oued Safsaf ont surgi les villages de :
- Saint-Antoine,
- Valée,
- Damrémont.
Sur les ruines d'Hippone.
A l'Ouest, par-delà les forêts, Collo est à l'entrée d'un bassin très sûr. 500 habitants s'y adonnent principalement à la pêche.
A l'Est dans le massif de Filfila, a été ouverte uns carrière de marbre blanc.
Par la route qu'infléchit le massif de l'Edough, on parvient à Bône en traversant Jemmapes, dans une région de collines agricoles et minières.
Bône, centre actif et prometteur à côté des ruines d'Hippone, dominée par une kasbah, a fait éclater une enceinte turque.
Une large avenue promenade, le long de laquelle ont été édifiés une belle église et un théâtre, aboutit majestueusement au port en construction…
Sur les 12.000 Bônois, 6.000 sont Européens.
Plusieurs usines y fonctionnent dont une filature de soie, et à l'Alélik, non loin du haras, des hauts fourneaux traitent les minerais de l'Edough, au sommet duquel a été créée la station forestière de Bugeaud.
Liège, plomb et corail.
La vaste plaine bônoise, naguère aussi redoutable que la Mitidja, est de plus en plus assainie et cultivée, ainsi qu'autour de :
- Duzerville,
- Dréan,
- Mondovi,
- Barral en remontant la Seybouse.
Proche de la frontière tunisienne, la Calle, au milieu de trois grands lacs, a repris l'exploitation du liège et du plomb argentifère.
La pêche du corail de Bône à la Calle occupe 160 à 180 bateaux, surtout napolitains.
Les bestiaux de Guelma.
Par Duvivier on parvient à Guelma, fondé en 1845 qui s'est développée deux ans plus tard grâce au renfort d'ouvriers d'art reconvertis dans l'agriculture : joli centre de 1.500 Européens et 800 Indigènes, où les établissements militaires ont été construits à l'intérieur d'une enceinte romano-byzantine, flanquée de tours carrées.
Son marché aux bestiaux est devenu le plus important de toute l'Algérie : il y passe chaque année 40.000 à 50.000 bovins.
Guelma est entouré de plusieurs villages agricoles :
- Héliopolis,
- Petit,
- Millesimo.
Dans les environs un orphelinat a été aménagé à Medjez-Ahmar, tout près des extraordinaires sources hyper thermales d'Hammam-Meskoutine ; un petit établissement y reçoit des blessés et malades militaires depuis 1845.
A Souk-Ahras, autour d'un fondouk datant de 1852, une agglomération nouvelle est née spontanément. A partir de 1856 :
- quelques colons, ainsi que
- des Juifs,
- des Tunisiens,
- des Mzabites vont s'y établir, bientôt au nombre de 1.200.
Riveraine de la Medjerda, sur la route de Tunis, la Tagaste de Saint Augustin revit avec la présence française.
De Constantine on parvient à Tébessa où une centaine d'Européens se serrent à côté de 1.100 Indigènes à l'intérieur de l'enceinte byzantine, auprès des vastes ruines de l'antique Théveste, en passant par Aïn Béida : là, 200 Européens voisinent avec une smala de spahis.
Édifiée sur la Sifitis romaine dans une région de riches céréales et pourvue de moulins, Sétif est proche du territoire concédé à la Compagnie genevoise où cinq villages ont été terminés dont Aïn-Arnat et Bouhira.
A travers la montagne récemment pacifiée par une route réellement praticable depuis 1853 seulement, on parvient de Sétif à Bougie, restée bloquée pendant six ans : cette ancienne capitale ne garde que quelques ruines de sa splendeur passée, dans une belle végétation.
Parmi 200 anciennes maisons à demi ruinées, une petite ville française s'est construite, protégée par le fort de Gouraya auquel monte un chemin en lacets.
Point de port aménagé ; l'anse de Sidi Yahia, en allant vers l'admirable cap Bon est un abri assez sûr dans une verdure luxuriante.
Djidjelli, qui était isolée sur sa presqu'île, a été reliée à Sétif et à Constantine par Mila encore tout indigène mais où cependant des colons ont établi un moulin. Bougie vient d'être aussi désenclavée en direction d'Aumale par la riche vallée de la Soummam.
Vers le Sud, Batna, ville toute neuve gardienne de l'Aurès, précède le défilé d'El Kantara par lequel on débouche sur les oasis du désert.
A Biskra le vieux fort turc est devenu fort Germain et la pépinière est pleine de promesses car les oasis de l'oued Rirh sont ranimés par des puits artésiens tout récemment forés.
La foire annuelle d'Alger se tient en septembre.
Avant de quitter Alger, nous ne manquerons pas de visiter sa foire annuelle qui se tient en septembre.
Il en est d'autres :
- à Mostaganem,
- à Blida, même
- à Douéra.
Nous irons aussi admirer l'exposition permanente qu'a institué à Alger le maréchal Randon, après le succès de l'Algérie lors de l'Exposition de Paris en 1849 et l'exposition universelle de Londres en 1851.
Et de retour à Paris, nous irons confronter les souvenirs de ce beau voyage avec l'expédition permanente, rue de Grenelle-Saint Germain, " tableau brillant du présent et éclatant appel à l'avenir. ", selon les termes de Mac Carthy notre guide.
Pierre Coinard (Algérie, l'œuvre française.)
Historia : Algérie. Histoire et nostalgie. 1830-1987.
|
|
Salut et santé
Par M. Marc Donato
|
Ah, cette eau bénite ! Voilà qu'elle fait le buzz cette semaine sur la toile ! Et oui, j'avais déjà abordé le sujet autour d'un bénitier, mobilier important s'il en est dans une église. Plus que jamais, en cette période pandémique persistante, le bénitier est soupçonné de tous les maux, lui qui, véhicule terrestre du salut, véhiculerait aussi le virus du covid. Songeons-y, mes frères, chaque main qui plonge ses doigts dans le saint liquide se frotte aux parois de la cuvette, déposant du même coup d'invisibles particules de ce virus mortel. Le démon se cache là où on l'attend pas et Covid, lui aussi, se pare de bonnes intentions pour paver son chemin. Des milliers de bénitiers sont ainsi mis hors jeu, asséchés pour ne pas être accusés de répandre le mal.
Monseigneur était tourmenté par le problème ; il en passait des nuits blanches à se tirlipoter les méninges pour trouver une solution à cette vacance des bénitiers. Or, voilà qu'un jour où il faisait ses courses au drugstore du coin avec sa bonne, s'approchant du distributeur de gel hydro alcoolique, il s'écria : '' Euréka ! Voilà ce qu'il faut '' . Tu remplaces le gel par l'eau bénite et hop, salut et santé seront réunis. Un coup de pédale, une giclée d'eau bénite.
- Mais bon sang, c'était bien sûr, se dit monseigneur Bourrel.
L'idée, depuis a fait florès. Un juteux, si je puis dire, commerce a trouvé là une niche où des créateurs astucieux autant qu'intéressés proposent le distributeur ad hoc aux autorités ecclésiales. Silencieux, discret, s'adaptant à tous les styles, en métal argenté, en inox, sur pied, accrochable… le marketing s'est emparé de la chose. Et ça a marché. Distributeurs comme ci, distributeurs comme ça, un vrai concours Lépine des distributeurs d'eau bénite.
L'eau a fait tache d'huile et c'est à qui aura son appareil assurant l'immunité salutaire et la salvation spirituelle. Paintein en Bavière, Ecosse, Bruxelles, Florence, Bologne, Vannes, en France ont connu les paroisses initiatrices suivies aujourd'hui de centaines d'autres. Au ran-cart, goupillon, pulvérisateur, pistolet à eau, procédés ringards s'il en est. Les fidèles sont accueillis désormais par un mobilier d'un nouveau genre. Le traditionnel bénitier en pierre a été remplacé par un distributeur automatique d'eau bénite, gage de purification sans trans-mission.
Salut et santé sont désormais les deux mamelles de l'Eglise. Pourquoi pas, si l'efficacité du procédé est attestée dans les deux cas ? Attention quand même : certains visiteurs trop ha-bitués à utiliser les distributeurs de gel hydro alcoolique ne font parfois pas la distinc-tion. Faut-il être stupide : se laver les mains à l'eau bénite et se signer au gel hydro alcooli-que…
Mais cette idée, originale, disons-le, ne peut qu'évoluer. On pourrait bien voir un jour des distributeurs automatiques de sandwichs transformés pour s'adapter aux besoins cultuels : hostie dans les églises, pain azyme dans les synagogues, eau miraculeuse de Zamzam (La Mecque) dans les mosquées. Il y a là certainement une idée à creuser.
Et je vais même plus loin, le bonhomme Michelin pourrait bien faire entrer les églises dans son fameux guide rouge et décerner des distinctions : une étoile à l'église de Trifouillis-les-Oies pour la pureté de son eau bénite, deux étoiles à celle de Jouy-sous-les Côtes pour son eau bénite sans calcaire. On risquerait alors des retraits d'étoile : à Cirque-sous-l'étang pour son eau croupie, à Sel-sur-Mer pour son eau saumâtre... Mais alors, attention aux suicides des prêtres ! On a connu des précédents dans la restauration.
Allez, encore un peu de gamberge : le Petit Rusé pourrait proposer des itinéraires ''eau bé-nite''. Si vous passez dans l'Yonne, ne ratez pas l'église de Anus, un trou, perdu dans la cam-pagne, mais avec un distributeur dernier cri. Sallespisse, dans les Pyrénées-Atlantiques, vaut le détour pour son distributeur en inox avec image pieuse…
Ce Covid, quand même… Il n'aura pas eu que de mauvais côtés. Combien d'industriels se sont réinventés, combien de créateurs se sont révélés… L'imagination au pouvoir, même pour l'eau bénite.
Au plaisir, mes frères.
Marc Donato - 5 février 2021
|
|
À LA MEMOIRE DE TOUS CEUX À QUI NOUS DEVONS TIMGAD
RESSUSCITEE ET PARTICULIEREMENT Â CELLE DE
CHARLES GODET QUI LUI CONSACRA SA VIE
TIMGAD
Antique THAMUGADI
Christian COURTOIS
Chargé d'enseignement
â la Faculté des Lettres d'Alger
CETTE PLAOUETTE EDITEE SUR L'ORDRE
DE M. ROGER LEONARD
GOUVERNEUR GENERAL DE L'ALGERIE
PAR LA DIRECTION DE L'INTERIEUR ET DES
BEAUX-ARTS (SERVICE DES ANTIQUITES)
A ETE TIREE EN NOVEMBRE 1951 SUR LES
PRESSES DE L'IMPRIMERIE OFFICIELLE
A ALGER
TIMGAD
II

LE CARDO MAXIMUS NORD, LE FORUM ET LE THEATRE
C'est au Nord de la ville de Trajan que s'est établie la petite agglomération qui constitue l'actuelle Timgad et c'est de ce côté qu'on aborde le champ de fouilles. La route, dans la traversée du village, suit le même tracé que la voie romaine qui conduisait à Cirta (Constantine), la capitale de la province de Numidie. L'entrée de la ville était marquée par une PORTE MONUMENTALE. Il n'en subsiste plus que les soubassements. Cet édifice fut sans doute commencé dès la fondation de la colonie, c'est-à-dire en l'année 100, mais ne paraît avoir été achevé qu'en 149, sous le règne d'Antonin le Pieux (137-161). L'originalité du monument, dont la décoration devait être assez médiocre, réside dans les deux petites chambres ménagées dans les piles. Ouvertes sur l'extérieur, elles abritaient probablement un corps de garde.
Entrée du Forum - Cardo maximus Nord
Une fois franchie la porte de Cirta, on s'engage dans le cardo maximus. C'est une voie large de 5 mètres environ, et longue de 180 mètres qui conduit au Forum. Les dalles de calcaire bleuâtre, disposées en biais, gardent encore çà et là l'empreinte profonde qu'y ont laissée les roues de charrettes. Entre leurs interstices, on aperçoit l'égout collecteur sous-jacent que révèle aussi de loin en loin la présence de regards. Cinq rues aboutissaient de part et d'autre à ce cardo, non compris le boulevard qui longeait extérieurement la ville (sauf à l'Ouest), ni le decumanus maximus auquel il conduit. De chaque côté s'élevaient des portiques à colonnes. Les douze insulae qui le bordaient étaient occupées soit par des édifices publics, soit par des maisons d'habitation.
 La porte du Nord ou de Cirta
La porte du Nord ou de Cirta
Le nombre des maisons découvertes à Timgad dépasse de beaucoup la centaine, et il ne saurait être question de les décrire toutes. Il suffira d'en présenter quelques-unes unes et de conseiller au visiteur de pénétrer dans les autres au gré de sa fantaisie. Celles qu'il trouvera le long du Cardo lui fourniront quelques types courants, la plus intéressante sinon la plus caractéristique étant celle qui occupe la deuxième insulae à gauche, à cause des bains privés qu'on y voit et aussi parce qu'elle fut utilisée, semble-t-il, comme CHAPELLE CHRETIENNE. Les maisons de Timgad sont assez diverses et certaines, comme la maison de Sertius, couvrent d'assez vastes espaces. Mais au centre de la ville il est exceptionnel qu'une seule maison s'étende sur deux insulae. Il est au contraire fréquent que l'insulae ne soit pas occupée par une seule maison, mais que deux ou trois y coexistent. D'une manière générale, la maison romaine n'était point comme les nôtres largement ouverte sur l'extérieur. C'était, si on la ramène à sa structure élémentaire, une maison à atrium, c'est-à-dire que la partie essentielle en était une cour centrale bordée de portiques, sur lesquels donnaient les différentes pièces. La principale de ces pièces,' souvent située en face de l'entrée (vestibulum), portait le nom de tablinum et servait de salle de réception. De l'extérieur, les maisons, avec leurs ouvertures rares et étroites, offraient l'aspect rude des maisons arabes, dans lesquelles la vie s'organise aussi autour du patio. Quelques maisons pourraient avoir eu un étage.
Il ne faut naturellement pas s'attendre à voir ce schéma reproduit partout avec une régularité stricte. Les conditions de fortune, le terrain dont on disposait, les contingences de toutes sortes ont amené les propriétaires et peurs architectes à en bousculer constamment l'ordonnance ; et ce n'est pas le moindre intérêt des maisons de Timgad que de montrer à la fois la fidélité à un type de maison et l'ingéniosité avec laquelle chacun l'adaptait à ses propres besoins.
Quant aux édifices publics qui bordaient cette partie du cardo, c'étaient les petits thermes du Nord et la Bibliothèque.
Les PETITS THERMES DU NORD qui occupent la première insula à gauche ne présentent pas un intérêt exceptionnel. On a jusqu'ici découvert quatorze établissements de bains à Timgad et il est à peine besoin de dire qu'il serait fastidieux de les étudier tous dans le détail d'autant que l'organisation en est plus ou moins similaire. On exposera cette organisation à propos des Grands Thermes du Sud sur lesquels il est préférable de concentrer son attention.
 La Bibliothèque
La Bibliothèque
La BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE qui occupe la cinquième insula à gauche est par contre l'un des édifices les plus curieux et les plus charmants de Timgad. Il présentait du côté de la rue une cour rectangulaire bordée de portiques. Sur chacun des portiques latéraux s'ouvraient deux petites chambres et sur le portique du fond une salle dallée plus vaste, de forme semi-circulaire, dont le diamètre était de 12 mètres. La paroi de cet hémicycle était constituée par des pilastres de briques flanquées de colonnes avec lesquelles alternaient des niches rectangulaires qui constituaient les rayons. La niche centrale, plus importante et encadrée de colonnes de marbre, était sans doute occupée par une statue (Minerve ?). Les lecteurs s'asseyaient probablement sur les marches qu'on voit en avant des niches.
 La Bibliothèque
La Bibliothèque
Au temps où il fut construit et qu'on ignore le monument, dont les plaques de marbre blanc et vert dissimulaient le corps de briques, ne devait pas manquer d'une certaine splendeur qui ajoutait à sa grâce. On comprend que M. Julius Quintianus Flavius Rogatianus, qui l'offrit à sa ville, ait été quelque peu fier de sa générosité et qu'il ait cédé à la tentation de rappeler qu'il lui en avait coûté 400.000 sesterces, soit une centaine de mille francs or. Les lecteurs ne lui en furent pourtant pas tous reconnaissants. Mécontents sans doute des heures d'ouverture, certains ne se firent point scrupule de graver une marelle sur les dalles du portique, ni d'orner les colonnes d'inscriptions généralement obscènes.
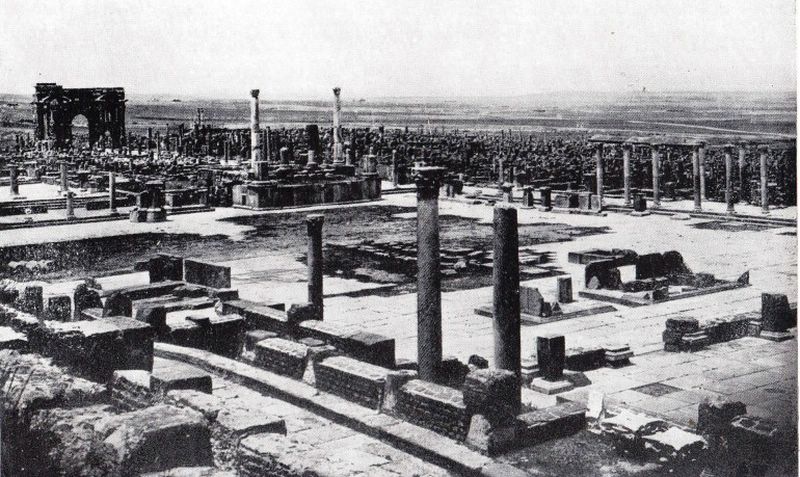 Le forum (partie nord)
Le forum (partie nord)
Le cardo maximus Nord aboutit au decumanus maximus en face de l'escalier qui conduit au forum. Cet escalier était précédé par une porte monumentale dont il ne subsiste que les bases et qui, dans sa décoration sinon dans son plan même, était à peu près identique à la porte de Cirta à laquelle elle faisait pendant. D'autres accès permettaient d'atteindre le forum et particulièrement un autre escalier situé légèrement plus à l'Est et dépourvu de caractère ornemental.
Ce forum n'occupait pas tout à fait le centre géométrique de la ville. Il s'allongeait au Sud du decumanus maximus et était déporté sur le quart Sud-Ouest. Le long du decumanus, il était bordé par un portique sur lequel s'ouvrait une rangée de BOUTIQUES. Celles-ci étaient au nombre de dix à l'Ouest de la porte monumentale (quatre grandes et six petites, dont une double) et de deux à l'Est, entre les deux escaliers.
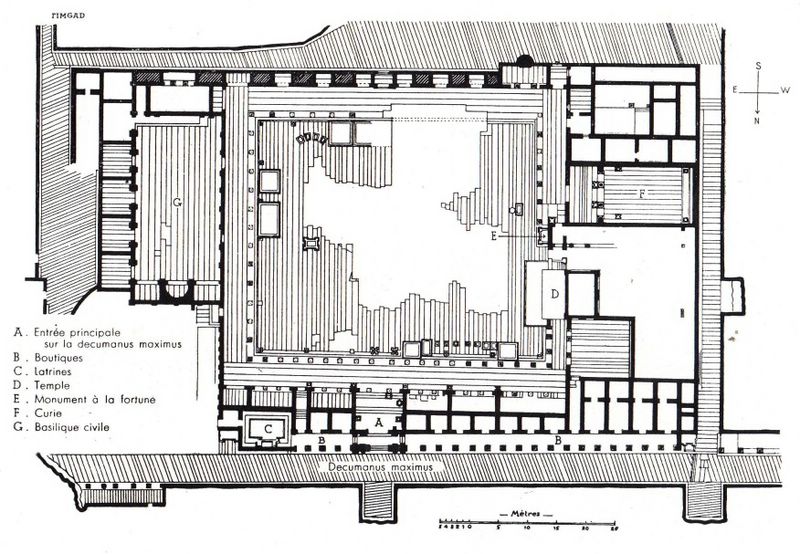 Plan du Forum
Plan du Forum
Au-delà du petit escalier se trouvaient des LATRINES PUBLIQUES formées de deux pièces de dimensions inégales, la plus grande mesurant 8 mètres sur 5 mètres 50. A la paroi Nord de cette dernière s'accotait un bassin. Les stalles - simples ou doubles au nombre de 25 probablement, étaient placées au-dessus d'un égout périphérique (trois d'entre elles ont été restaurées). A l'angle Nord-Est du forum se trouve une fontaine presque semblable à celle qui occupe symétriquement l'angle Nord-Ouest.
Du côté du decumanus maximus, le forum était donc invisible. La porte monumentale mise à part, rien ne le signalait à l'attention. L'aspect de cette partie de la ville était celui d'une voie commerçante dont la vie se retirait le soir venu, les marchands demeurant dans un autre quartier comme aujourd'hui ceux de Tunis ou de Fès.
 Le Forum (porte nord)
Le Forum (porte nord)
Il fallait donc franchir la porte monumentale pour découvrir le FORUM. Une fois monté un large escalier de douze marches, coupé de paliers et qu'ornaient des statues, on se trouvait sur une vaste esplanade de 50 m. sur 43 environ, dallée de calcaire bleue et qui, sauf à l'Ouest dans la partie où s'élevait la tribune, était entièrement entouré par un portique corinthien plus élevé de deux marches. Ce forum, l'un des plus vastes de l'Afrique du Nord, conserve, en dépit de ses dalles en partie arrachées et du petit nombre de colonnes qu'on a pu rétablir sur leur base, une singulière grandeur, mais l'aspect qu'on en voit est bien différent de celui de jadis. Il faut imaginer une trentaine de statues dont certaines équestres dispersées à travers la place : dieux, empereurs, ou même simples particuliers à qui allait la reconnaissance publique et dont les bases épigraphes - celles du moins qu'on n'a pas réutilisées dans les murs de basse époque - attestent seules aujourd'hui la pieuse intention. Mais peut-être est-il prudent de ne pas trop pousser cette imagination si l'on est plus attaché à l'esthétique qu'à la morale.
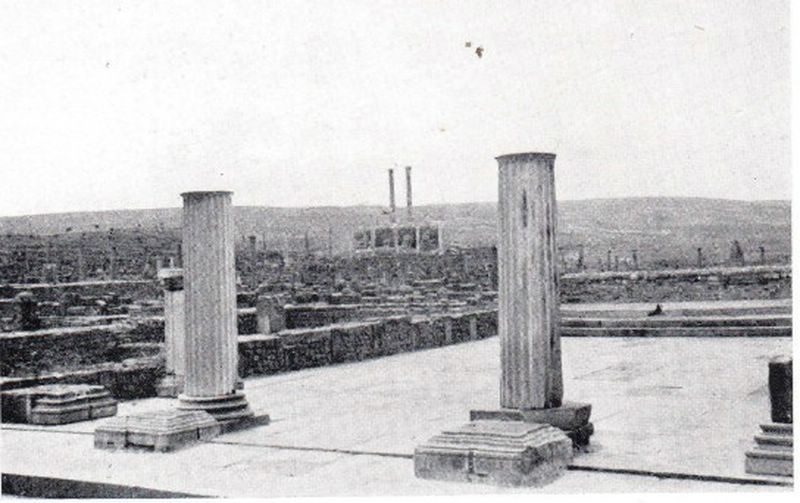 La curie
La curie
Tracé lors de la fondation de la colonie et achevé dès la première moitié du second siècle, le forum était à Timgad comme dans les autres villes romaines le centre de la vie municipale. C'est autour de lui que s'élevaient les principaux bâtiments officiels. Mais ce n'était pas pour autant une sorte d'oasis administrative. C'était le rendez-vous des gens d'affaires Celui aussi des flâneurs et des joueurs, comme le prouvent les dessins et les trous pour les billes qu'on voit encore sur ses dalles comme sur celles de la basilique. Sur une marche de la face Nord, la pierre a gardé la gravure d'un jeu dont la règle nous demeure mystérieuse. L'inscription qui en constitue l'élément principal : Venari, lavari, ludere, ridere, occ est vivere (chasser, prendre des bains, jouer, rire, çà c'est vivre) nous apporte l'écho d'une philosophie sans doute peu ambitieuse, mais que certains ne manqueront pas de tenir pour le secret de la sagesse.
Si l'on fait maintenant, - de la droite vers la gauche - le tour du forum, on le verra bordé de bâtiments sur toutes ses faces. Mais la destination d'un certain nombre d'entre eux - principalement sur les faces Sud et Nord - n'a pu être établie, quelque imagination qu'on ait déployée. Il est préférable de ne s'arrêter qu'à ceux qu'on a pu identifier avec certitude ou presque.
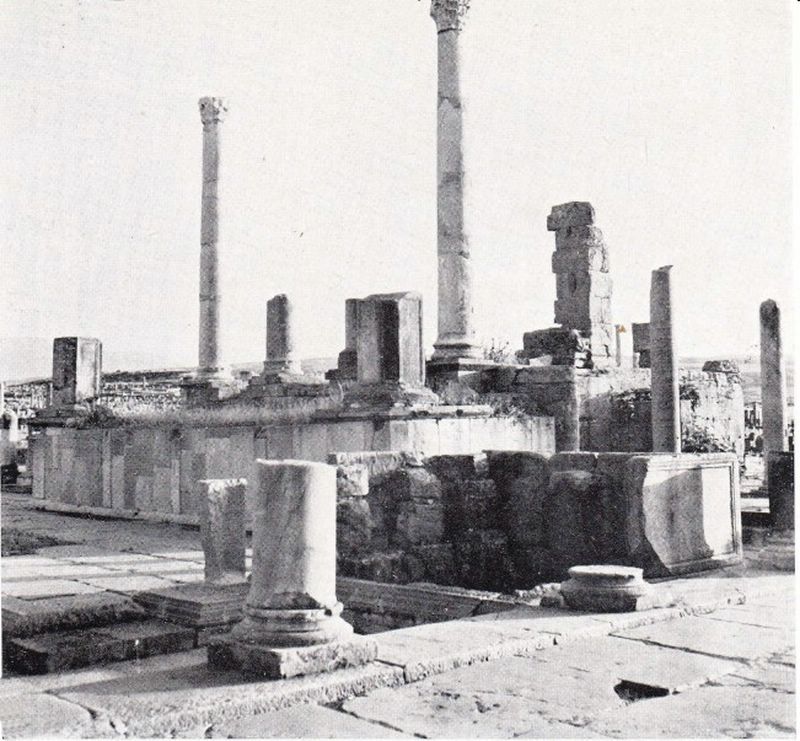 Le temple et la tribune du forum
Le temple et la tribune du forum
C'est d'abord, sur la face Ouest, un temple et la curie entre lesquels s'élevait un petit édifice consacré à la Fortune. Le TEMPLE était composé d'une chambre ou cella de 7 mètres sur 4 mètres 50, construite au-dessus d'une salle voûtée et en avant de laquelle se trouvait un portique tétrastyle, à colonnes lisses et à chapiteaux corinthiens. On a voulu y voir sans raison valable un temple de la Victoire. En fait, on ignore à quelle divinité il était consacré. Chose remarquable, ce temple n'était point précédé par un escalier monumental, comme il est presque de règle, mais par une tribune qu'ornaient des piédestaux hexagonaux surmontés de statues de la Victoire. C'était là que, comme au forum romain, les professionnels et les amateurs de la politique haranguaient leurs concitoyens. On est tenté d'évoquer aussi le coin d'Hyde Park.
Si le temple était flanqué au Nord d'un édifice non identifié, constitué par une salle à peu près carrée qui s'ouvrait sur le portique et qu'un escalier reliait peut-être (?) au decumanus maximus, la destination de l'édifice qui le borde au Sud n'est pas douteuse : c'est la CURIE, c'est-à-dire la salle ou se réunissait le conseil municipal de la colonie. Ce monument se compose de deux parties ; un vestibule étroit, avec un escalier de quatre marches et une salle rectangulaire de 15 mètres sur 8. La communication entré ces deux éléments s'établissait par trois baies. La baie centrale, ouverte, était séparée des baies latérales par des colonnes cannelées en avant desquelles se trouvaient deux statues. Les baies latérales étaient closes par des balustrades qui joignaient les colonnes à des pilastres engagés. La salle principale, soigneusement dallée, était surélevée de deux marches vers le fond. Les parois semblent avoir été revêtues de plaques d'un marbre gris veiné dont on a retrouvé quantité de fragments au cours des fouilles. Quatre statues dont les bases sont encore en place contribuaient à l'ornementation de l'édifice. L'une d'elle (à droite) représentait l'empereur Trajan fondateur de la colonie et l'inscription de sa base permet de penser que l'édifice a été dédié à la fin de 116 ou au début de 117. En pendant se trouvait une autre statue, celle de la Concorde de l'ordre des décurions, ce qui écarte toute hésitation sur la nature du monument, dont la présence est d'ailleurs nécessaire dans toute colonie, l'organisation municipale n'en étant qu'un décalque de celle de Rome.
Le côté Sud du forum, d'où deux étroits escaliers permettaient de gagner le théâtre est bordé par des logettes dont on ignore la destination. L'une d'elles, au Sud-Ouest, plus vaste que les autres, paraît avoir été destinée à recevoir une statue. Mais la pierre qui devait porter l'inscription est demeurée vierge.
 Le Théâtre
Le Théâtre
Quant à la façade orientale du forum, elle est longée dans la majeure partie par un vaste édifice oblong qui est la BASILIQUE CIVILE. Deux portes, ouvertes sur le portique, donnaient directement sur une nef de 38 mètres sur 20, entièrement dallée et ornée de statues. Le côté Sud du monument était occupé par une tribune, tandis que, au Nord, se trouvaient trois petites pièces, celle du milieu de forme semi-circulaire, les deux autres de forme rectangulaire. Six chambres s'ouvraient à l'Est. Cet édifice semble dater, d'après les inscriptions qu'on y a retrouvées, du règne d'Hadrien (117-138) sinon de celui de Trajan (97-118) et sa destination n'est pas douteuse bien qu'aucun texte épigraphique ne l'atteste. Il offre, en effet, le plan classique des basiliques civiles, tel qu'on le voit réalisé à Djemila ou à Tipasa par exemple ; le magistrat siégeait sur la tribune tandis que les plaideurs devisaient dans la nef et que, naturellement, les désœuvrés venaient leur y tenir compagnie. Salle des pas, ou si l'on veut des paroles, perdus, la basilique servait aussi aux réunions électorales.
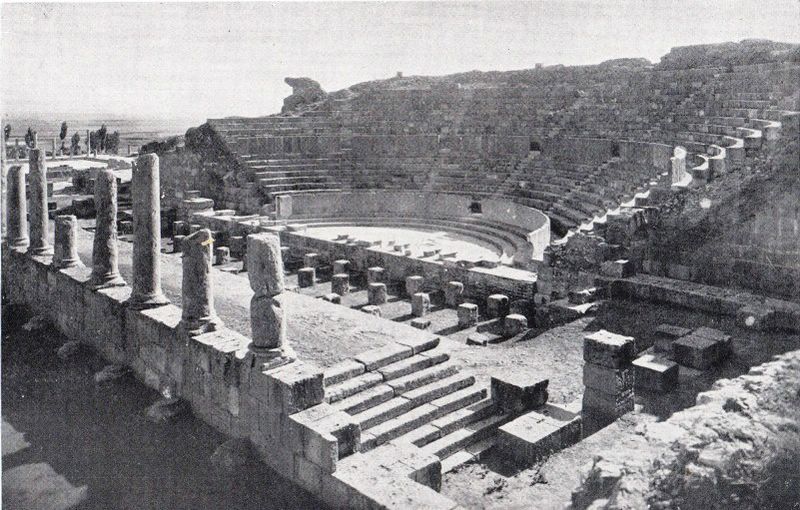 Le Théâtre
Le Théâtre
Deux escaliers ménagés sur la face Sud du forum menaient à une large rue en pente de l'autre côté de laquelle se trouve le THEATRE. Cette rue large de dix mètres vers l'Ouest se rétrécit dans sa partie orientale à partir d'un massif de maçonnerie élevé pour soutenir la butte naturelle dans laquelle est creusée la caves, butte dont une partie avait du être arasée pour permettre la construction du forum.
La partie réservée aux spectateurs, la cavea, la salle, comme nous dirions, est constituée comme dans tous les théâtres antiques par des gradins disposés en hémicycle autour d'une place dallée, ou orchestra, à laquelle on parvenait par des couloirs voûtés situés de part et d'autre. Seul le couloir Nord communiquait avec la rue. Le couloir Sud était fermé par un mur, mais une porte permettait de gagner les dépendances dont on parlera plus loin. Quant aux gradins, ils étaient répartis en deux séries concentriques au moins que séparaient entre elles des dalles encastrées de champ. Chaque gradin est d'une largeur moyenne de 0 m. 60. Pour les notabilités, on avait prévu une installation plus confortable. Sur trois larges marches situées en avant du premier gradin, on plaçait les sièges portatifs qui leur étaient destinés.
Cinq escaliers conduisaient de l'orchestre aux gradins supérieurs que couronnait sans doute, comme dans d'autres théâtres, une sorte de promenoir, peut-être constitué par une colonnade à laquelle on pouvait accéder directement du sommet de la colline par une entrée dont il ne subsiste que l'infrastructure. Tous ces gradins supérieurs ont d'ailleurs été reconstruits et seuls les cinq ou six premiers rangs sont authentiques.
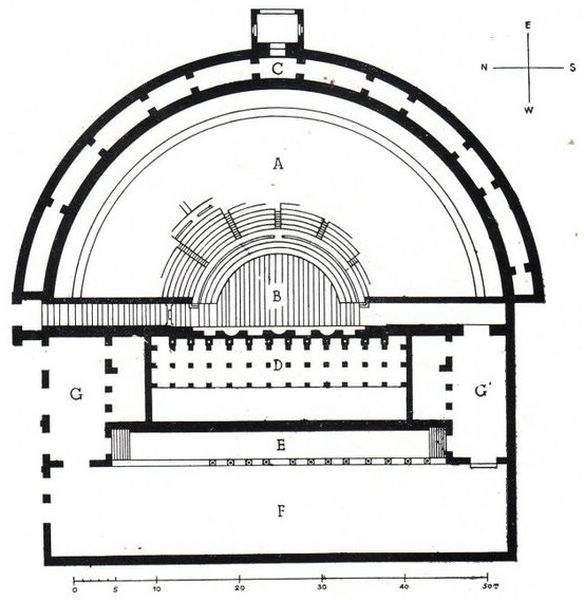
Avant la restauration des gradin
D'après A. Ballu
A : Cavea
B : Orchestra
C : Promenoir
D : Proscenium
E : Portique
F : Cour
G G : Vestibules
Plan du Théâtre
Dans son ensemble, le théâtre atteignait un diamètre de 63 mètres, dimension qui le classe dans la bonne moyenne des théâtres africains, mais très inférieure à celle du théâtre de Marcellus à Rome qui était de 102 mètres. Approximativement, cela représente 3.500 à 4.000 places ; chiffre énorme si on le rapproche du nombre présumé des habitants de Timgad, mais qui ne semble pas excessif si l'on considère que les représentations attiraient en même temps qu'eux les populations des villes voisines auxquelles un théâtre faisait défaut.
De l'autre côté des couloirs dont on a parlé se trouvaient la scène et ses dépendances. La scène, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire le proscenium, était constituée par une plate-forme de 30 mètres sur 5, située à un mètre environ au-dessus du niveau de l'orchestra. Le plancher lui-même a naturellement disparu, mais il reste les rangées de piliers sur lesquels il reposait, ainsi que certains éléments, semble-t-il, du dispositif servant à manœuvrer le rideau. En avant de la scène, on voit encore le petit mur de briques qui la séparait de l'orchestra. Il est coupé de cinq niches alternativement semi-circulaires et rectangulaires, jadis garnies de placages et de colonnettes corinthiennes dont on n'a retrouvé que des fragments. Aux deux extrémités, un escalier de sept marches mettait en relation proscenium et orchestra. Le fond de la scène était formé par un mur aujourd'hui disparu, mais qu'on peut imaginer, avec ses alvéoles et ses colonnes, d'après le théâtre de Djemila ou celui de Khamissa où il a été conservé.
En arrière de la scène se trouvait une vaste cour rectangulaire que bordait à l'Est, c'est-à-dire du côté du mur de scène, un portique de seize colonnes, dont quelques-unes unes sont encore debout, et dont l'entablement portait une dédicace aux empereurs Marc Aurèle (161-180) et Lucius Verus (161-169), ce qui permet de penser que c'est entre 161 et 169 que le théâtre fut, sinon construit, du moins achevé. Cette cour, fermée des côtés Ouest et Sud, communiquait au Nord directement avec la rue, tandis qu'aux deux extrémités de sa façade orientale, de part et d'autre du portique, on trouvait deux vestibules symétriques par lesquels on gagnait les coulisses. L'un d'eux, celui du Sud, s'ouvrait sur le couloir voûté qui menait à l'orchestra. L'autre, fermé du côté de ce couloir, s'ouvrait sur la rue par trois portes.
Cet édifice, l'un des plus considérables de la cité, n'était pas, si l'on en juge par les fragments décoratifs qu'on y a recueillis, d'une qualité particulièrement remarquable. Il n'en est pas moins déplorable que les soldats de Justinien en aient emprunté les pierres pour construire la forteresse -- ce qui ne veut pas dire qu'il ait été heureux de les lui restituer sous forme de gradins.
Sur la colline, en arrière de l'hémicycle d'où l'on domine l'immense champ de ruines, on a découvert un ensemble de constructions assez informes, accolées au théâtre du côté de l'Ouest. Il semble qu'elles se répartissent autour d'une cour rectangulaire au milieu de laquelle se trouvait sans doute un autel. Du côté Sud de la cour, s'élevait vraisemblablement un petit TEMPLE, peut-être dédié à Cérès. Au Sud du théâtre, subsiste un édifice qui pourrait avoir été un TEMPLE de Mercure.
 Le théâtre en 1850 - Aquarelle de Delaware
Le théâtre en 1850 - Aquarelle de DelawareA SUIVRE
|
|
| COTES
Par M. Bernard Donville
|
Bonjour à tous
Le troisième chapitre : Quelques visions de nos côtes. Nous arrivons à Bône qui pour ceux qui ne le savent pas n'est pas qu'un cimetière où on ne parle qu'en fables...
Le quatrième chapitre : Nous poursuivons notre voyage côtier par une ville qu'on ne peut nous accuser d'avoir envahi puisque c'est nous qui l'avons créé : Philippeville. Et notez la curiosité des circonstances c'est le nom du détracteur principal de notre histoire que l'on va retrouver à proximité : Stora !!!
J'espère que votre route est toujours favorable et que la santé reste Bône... (on fatigue avec le confinement!)
Bonnes lectures à tous
Amitiés, Bernard
Cliquer CI-DESSOUS pour voir les fichiers
cotes3-Bône
cotes4-Philippeville
A SUIVRE
|
|
|
VOYAGE DE ROBERT HOUDIN
EN ALGÉRIE (1)
Je glisserai rapidement sur le récit de mon voyage à travers la France et la Méditerranée ; je dirai seulement qu'à peine en mer, je désirais déjà être arrivé. Aussi ce fut avec une joie indicible que, après trente-six heures de navigation, j'aperçus la capitale de notre colonie.
J'étais attendu. Une ordonnance vint au-devant moi et me conduisit à l'hôtel d'Orient, où l'on m'avait retenu un appartement des plus confortables.
De la fenêtre de mon salon je voyais la rade d'Alger, et ma vue n'avait d'autre limite que l'horizon. La mer est toujours belle lorsqu'on la voit de sa fenêtre ; aussi, chaque matin, je l'admirais volontiers de cet endroit, et lui pardonnais ses petites taquineries passées.
Ma vue s'étendait également sur cette magnifique place du Gouvernement plantée d'orangers comme on n'en voit pas en France. Ils étaient à cette époque chargés de fleurs épanouies et de fruits en pleine maturité.
Par la suite, nous nous plaisions, Mme Robert Houdin et moi, à aller le soir, sous leur ombrage, prendre une glace à la porte d'un Tortoni algérien, tout en respirant la brise parfumée que nous apportait la mer.
Après ce plaisir, rien ne nous intéressait autant que l'observation de cette immense variété d'hommes qui circulaient devant nous.
On eut dit que les cinq parties du monde avaient envoyé leurs représentants en Algérie; c'était des Français, des Espagnols, des Maltais, des Italiens, des Allemands, des Suisses, des Prussiens, des Belges, des Portugais, des Polonais, des Russes, des Américains, tous faisant partie de la population algérienne.
Joignons à cela les différents types arabes, tels que les Maures, les Kabyles, les Koulougly, les Biskri, les Mozabites, les Nègres, les Juifs, et l'on aura une idée du spectacle qui se déroulait à nos yeux.
Lorsque j'arrivai à Alger, M. de Neveu m'apprit qu'une partie de la Kabylie s'étant révoltée, le maréchal-gouverneur venait de partir avec un corps expéditionnaire pour la soumettre. En conséquence de ce fait, les fêtes pour lesquelles on devait convoquer les chefs arabes ne pouvaient avoir lieu avant un mois, et mes représentations étaient remises à cette époque.
J'ai à vous demander maintenant, ajouta le colonel, si vous voulez souscrire à ce nouvel engagement ?
Mon colonel, dis-je sur le ton de la plaisanterie, je me regarde comme engagé militairement, puisque je relève de M. le Gouverneur. Fidèle à mon poste et à ma mission, je resterai quoi qu'il arrive.
Très bien ! M.Houdin, fit en riant le colonel, vous agissez là en véritable soldat français, et la colonie vous en saura gré. Du reste, nous tâcherons que votre service en Algérie vous soit le plus doux possible. Nous avons donné des ordres à votre hôtel, pour que vous et Mme Robert Houdin n'ayez point à regretter le bien être que vous avez quitté pour venir ici.
(J'ai oublié de dire que dans mes conditions d'engagement, j'avais stipulé que ma femme m'accompagnerait.) Si en attendant vos représentations officielles, il vous était agréable, pour occuper vos loisirs, de donner des séances au théâtre de la ville, le gouverneur le met à votre disposition trois jours par semaine, les autres jours appartenant à la troupe d'opéra.
Cette proposition me convenait à merveille ; j'y voyais trois avantages : le premier, de me refaire la main, car il y avait deux ans que j'avais quitté la scène ; le second d'essayer les effets de mes expériences sur les Arabes de la ville : le troisième, de faire de fructueuses recettes. J'acceptai, et comme j'adressais mes remerciements à M. de Neveu :
C'est à nous de vous remercier, me dit-il. En donnant des représentations à Alger, pendant l'expédition de Kabylie, vous nous rendrez un grand service.
Lequel, colonel ?
En occupant l'imagination des Algériens, nous les empêchons de se livrer sur les éventualités de la campagne à d'absurdes suppositions, qui pourraient être très préjudiciables au gouvernement.
S'il en est ainsi, je vais me mettre immédiatement à l'œuvre.
Le colonel partit le lendemain pour rejoindre le maréchal. Auparavant, il m'avait remis entre les mains de l'autorité civile, c'est-à-dire qu'il m'avait présenté au maire de la ville, M. de Guiroye, qui déploya envers moi une extrême obligeance pour me faciliter l'organisation de mes séances.
On pourrait croire qu'en raison du haut patronage sur lequel j'étais appuyé, je n'eus qu'à suivre un sentier semé de fleurs, comme dirait un poète, pour arriver à mes représentations. Il n'en fut rien : j'eus à subir une foule de tracasseries, qui auraient pu m'ennuyer beaucoup, si je n'avais été muni d'un fond de philosophie à toute épreuve.
M. D., directeur privilégié de la salle Bab-Azoum, venait de commencer sa saison théâtrale avec une troupe d'opéra. Craignant que les succès d'un étranger sur sa propre scène ne détournassent l'attention publique de ses représentations, il se hâta de faire des réclamations auprès de l'autorité.
Le maire, pour toute consolation, lui répondit que le gouvernement voulait qu'il en fût ainsi. M. D. protesta et alla même jusqu'à menacer de quitter sa direction. Le maire se renferma dans son inflexible décision.
Le temps tournait au noir, et la ville d'Alger se trouvait sous le coup d'une éclipse totale de directeur, lorsque par esprit de conciliation, je consentis à ne jouer que deux fois par semaine, et à attendre pour commencer mes séances que les débuts de la troupe d'opéra fussent terminés.
Cette concession calma un peu l'imprésario, sans toutefois me gagner ses bonnes grâces. M. D. se tint toujours à mon égard, dans une froideur qui témoignait de son mécontentement. Mais j'étais dans les dispositions qu'a presque toujours un homme complétement indépendant : cette froideur ne me rendit point malheureux.
Je sus également me mettre au-dessus des taquineries que me suscitèrent certains employés subalternes de la direction, et, fort de cette pensée que mon voyage d'Algérie devait être un voyage d'agrément, je pris le parti de rire de ces attaques mesquines. D'ailleurs mon attention était tout entière à une chose bien plus intéressante pour moi.
Les journaux avaient annoncé mes représentations. Cette nouvelle souleva aussitôt dans la presse algérienne une polémique, dont l'étrangeté ne contribua pas peu à donner une grande publicité à mes débuts.
"Robert Houdin, dit un journal, ne peut pas être à Alger, puisque tous les jours on voit annoncer dans les journaux de Paris: " Robert Houdin, tous les soirs, à 8 heures."
Pourquoi, répondit plaisamment un autre journal, Robert Houdin ne donnerait-il pas des représentations d'Alger, tout en restant à Paris ? Ne sait-on pas que ce sorcier a le don de l'ubiquité, et qu'il lui arrive souvent de donner le même jour et en personne, des séances à Paris, à Rome et à Moscou ?
La discussion continua ainsi pendant plusieurs jours, les uns niant ma présence, les autres l'affirmant.
Le public d'Alger voulait bien accepter ce fait comme une de ces plaisanteries qu'on qualifie généralement du nom de canard, mais il voulait aussi qu'on l'assurât qu'il ne serait pas victime d'une mystification, en venant au théâtre.
Enfin, on parla sérieusement, et les journalistes expliquèrent alors que M. Hamilton, en succédant à son beau-frère, avait conservé pour titre de son théâtre le nom de ce dernier, de sorte que Rober Houdin pouvait aussi bien s'appliquer à l'artiste qui portait ce nom qu'à son genre de spectacle.
Cette curieuse polémique, les tracasseries suscitées par M. D , et, j'aime à le croire, l'attrait de mes séances, attirèrent un concours prodigieux de spectateurs. Tous les billets avaient été pris à l'avance, et la salle fut remplie à s'y étouffer ; c'est le mot. Nous étions à la mi-septembre, et le thermomètre marquait encore 35 degrés centigrades.
Pauvres spectateurs, comme je les plaignais ! A en juger par ce que j'éprouvais moi-même, c'était à sécher sur place, à être momifié. Je craignais bien que l'enthousiasme, ainsi que cela arrive toujours en pareil cas, ne fut en raison inverse de la température. Je n'eus au contraire qu'à me louer de l'accueil qui me fut fait, et je tirai de ce succès un heureux présage pour l'avenir.
Afin de ne point enlever au récit de mes représentations officielles, comme les nommait M. Neveu, l'intérêt que le lecteur doit y trouver, je ne donnerai aucun détails sur celles qui les précédèrent et qui furent toutes comme autant de ballons d'essai. Du reste, les Arabes y vinrent en petit nombre. Ces hommes de nature indolente et sensuelle mettent bien au-dessus du plaisir d'un spectacle le bonheur de s'étendre sur une natte et d'y fumer en paix.
Aussi, le gouverneur, guidé par la connaissance approfondie qu'il avait de leur caractère, ne les invitait-il jamais à une fête ; il les y convoquait militairement. C'est ce qui eut lieu pour mes représentations.
Ainsi que M. de Neveu me l'avait annoncé, le corps expéditionnaire rentra à Alger le 20 octobre, et les fêtes qui avaient été suspendues par la guerre, furent annoncées pour le 27. On envoya des émissaires sur les différents points de la colonie, et au jour fixé, les chefs de tribus, accompagnés d'une suite nombreuse, se trouvèrent en présence du maréchal-gouverneur.
Ces fêtes d'automne, les plus brillantes de l'Algérie, et qui sont sans rivales peut-être dans aucune autre contrée du monde, présentent un aspect pittoresque et véritablement remarquable.
J'aimerais à pouvoir peindre ici la physionomie étrange que prit la capitale de l'Algérie à l'arrivée des goums du Tell et du Sud ; et ce camp des indigènes, inextricable pêle-mêle de tentes d'hommes et de chevaux, qui offrait mille contrastes aussi séduisants que bizarres ; et le brillant cortège du gouverneur général au milieu duquel les chefs arabes, à l'air sévère, attiraient les regards par le luxe des costumes, la beauté des chevaux et l'éclat des harnachements tout brodés d'or ; et ce merveilleux hippodrome, placé entre la mer, le riant coteau de Mustapha, la blanche ville d'Alger et la plaine d'Hussein-Dey, que dominent au loin de sombres montagnes. Mais ce sujet dépassant de beaucoup le cadre de mon récit, je n'en dirai rien encore.
Je ne décrirai pas non plus ces exercices militaires, image d'une guerre sans règle et sans frein qu'on appelle la Fantasia, où 1200 Arabes, montés sur de superbes coursiers, s'animant et poussant des cris sauvages comme en un jour de bataille, déployèrent tout ce qu'un homme peut posséder de vigueur, d'adresse et d'intelligence.
Je ne parlerai même pas de cette admirable exhibition d'étalons arabes dont chaque sujet excitait au passage la plus vive admiration ; car tout cela a été dit, et j'ai hâte d'arriver à mes représentations, dont les différents épisodes ne furent pas, j'ose le dire, les moins intéressants de cette immense fête. Toutefois je veux citer un fait, parce que j'en ai été vivement frappé.
J'ai vu dans ces luttes hippiques, où hommes et chevaux l'œil en l'eu, la bouche écumante, semblent dépasser en vitesse nos plus puissantes locomotives ; j'ai vu dis-je, un cavalier montant un magnifique cheval arabe, vaincre à la course, non-seulement tous les chevaux de son cercle, mais distancer encore dans une course suprême tous les chevaux vainqueurs.
Cet invincible cavalier avait douze ans et pouvait passer sous son cheval sans se baisser. J'avais cru jusque-là que le type du cheval arabe était d'être petit et délicat. On trouve en Algérie d'excellents chevaux de toute grandeur et de toute force.
Les courses durèrent trois jours. Je devais donner mes représentations à la fin du second et du troisième. Avant d'en parler, je dirai un mot du théâtre d'Alger.
Le théâtre impérial est, sans contredit, le monument le plus remarquable de la ville. Il présente une façade de trente mètres de largeur. Sept portiques donnent entrée dans un vestibule grandiose d'où partent des escaliers de marbre d'une grande beauté. Un magnifique foyer qui occupe toute la largeur du bâtiment est éclairé par d'immenses fenêtres en vue de la mer. Au-dessus s'élève encore un autre foyer, dit des fumeurs. Le frontispice est orné de sculptures, de statues emblématiques, de mascarons, de corniches festonnées que surmonte un aigle gigantesque planant sur tout le monument.
En voyant cet immense édifice, on pourrait croire qu'il renferme une vaste salle. Il n'en est rien. L'architecte a tout sacrifié aux exigences de l'ordre public et de la circulation. Les escaliers, les couloirs et le foyer occupent un aussi grand espace que la salle entière.
Peut-être cet artiste a-t-il pris en considération le nombre des amateurs de spectacle qui est assez restreint à Alger, et a-t-il pensé qu'une petite salle offrirait aux artistes une plus grande chance de succès.
Le 28 octobre, jour convenu pour la première de mes représentations devant les Arabes, j'étais de bonne heure à mon poste, et je pus jouir du spectacle de leur entrée dans le théâtre.
Chaque goum, rangé par compagnie, fut introduit séparément et conduit dans un ordre parfait aux places qui lui étaient assignées d'avance. Ensuite vint le tour des chefs, qui se placèrent avec tout le calme que comportait leur caractère.
Leur installation fut assez longue à opérer, car ces hommes de la nature ne pouvaient pas comprendre qu'on s'emboîtât ainsi, côte à côte, pour assister à un spectacle, et nos sièges si confortables, loin de leur sembler tels, les gênaient singulièrement. Je les vis se remuer pendant longtemps et chercher à replier sous eux leurs jambes, à la façon des tailleurs européens.
Le maréchal Randon, sa famille et son état-major occupaient deux loges d'avant-scène, à droite du théâtre. Le préfet et quelques-unes des autorités civiles étaient vis-à-vis dans deux autres loges.
Le maire s'était placé près des stalles de balcon. M. le colonel de Neveu était partout ; c'était l'organisateur de la fête.
Les caïds, les aghas, les bachagas, et autres Arabes titrés eurent les honneurs de la salle ; ils occupèrent les stalles d'orchestre et de balcon.
Au milieu d'eux étaient quelques officiers privilégiés, et enfin des interprètes se mêlèrent de tous côtés aux spectateurs pour leur traduire mes paroles.
On m'a rapporté aussi que des curieux de la ville qui n'avaient pu obtenir des billets d'entrée, avaient pris le burnous arabe et, la tête ceinte de la corde en poil de chameau, s'étaient faufilés parmi leurs nouveaux coreligionnaires.
C'était vraiment un coup d'œil non moins intéressant qu'admirable, que cette étrange composition de spectateurs.
Le balcon, surtout, présentait un aspect aussi beau qu'imposant. Une soixantaine de chefs arabes, revêtus de leurs manteaux rouges (indice de leur soumission à la France,) sur lesquels brillaient une ou plusieurs décorations, se tenaient avec une majestueuse dignité attendant gravement ma représentation.
J'ai joué devant de brillantes assemblées, mais jamais devant aucune qui m'ait aussi vivement impressionné. Toutefois cette impression que je ressentis au lever du rideau, loin de me paralyser, m'inspira au contraire une vive sympathie pour des spectateurs, dont les physionomies semblaient si bien préparées à accepter les prestiges qui leur avaient été annoncés.
Dès mon entrée en scène, je me sentis tout à l'aise et comme joyeux du spectacle que j'allais me donner. J'avais bien un peu, je l'avoue, l'envie de rire de moi et de mon assistance, car je me présentais la baguette à la main avec toute la gravité d'un véritable sorcier. Je n'y cédai pas.
Il ne s'agissait plus ici de distraire et de récréer un public éclairé et bienveillant ; il fallait frapper juste et fort sur des imaginations grossières et sur des esprits prévenus, car je jouais le rôle de marabout français. Comparées aux simples tours de leurs prétendus sorciers, mes expériences devaient être pour les Arabes de véritables miracles.
Je commençai ma séance au milieu du silence le plus profond, je dirais presque le plus religieux, et l'attention, des spectateurs était telle, qu'ils paraissaient comme pétrifiés sur place. Leurs doigts seuls, agités d'un mouvement nerveux, faisaient glisser rapidement les grains de leurs chapelets, pendant qu'ils invoquaient sans doute la protection du Très-Haut.
Cet état apathique de mes spectateurs ne me satisfaisait pas ; je n'étais pas venu en Algérie pour visiter un salon de figures de cire ; je voulais autour de moi du mouvement, de l'animation, de l'existence enfin. Je changeai de batterie.
Au lieu de généraliser mes interpellations, je m'adressai plus particulièrement à quelques-uns d'entre les Arabes, je les stimulais par mes paroles et surtout par mes actions. L'étonnement fit place alors à un sentiment plus expressif, qui se traduisit bientôt par de bruyants éclats.
Ce fut surtout lorsque je fis sortir des boulets de canon d'un chapeau, que mes spectateurs, quittant leur gravité, exprimèrent leur joyeuse admiration par les gestes les plus bizarres et les plus énergiques.
Vinrent ensuite, accueillis par le même succès, la Corbeille de fleurs paraissant instantanément au milieu d'un foulard ; la Corne d'abondance, fournissant une multitude d'objets que je distribuai, sans pouvoir cependant satisfaire aux nombreuses demandes faites de toutes parts, et plus encore par ceux mêmes qui avaient les mains pleines ; les pièces de cinq francs, envoyées à travers la salle dans un coffre de cristal suspendu au milieu des spectateurs.
Il est un tour que j'eusse bien désiré faire, c'était celui de ma bouteille inépuisable, si appréciée des Parisiens et des ouvriers de Manchester. Je ne pouvais le faire figurer dans cette séance, car, on le sait, les sectateurs de Mohamed ne boivent aucune liqueur fermentée, du moins en public. Je le remplaçai avec assez d'avantage par le suivant.
Je pris une coupe en argent, de celles qu'on appelle bols de punch dans les cafés de Paris. J'en dévissai le pied, et passant ma baguette au travers, je montrai que ce vase ne contenait rien ; puis, ayant rajusté les deux parties, j'allais au milieu du parterre ; là, à mon commandement, le bol fut magnifiquement rempli de dragées qui lurent trouvées excellentes.
Les bonbons épuisés, je renversai le vase et j'annonçai qu'à l'aide d'une simple conjuration il se trouverait rempli de café. Et passant gravement par trois fois ma main sur le vase, une vapeur épaisse en sortit à l'instant et annonça la présence du précieux liquide. Le bol était plein de café bouillant, je le versai aussitôt dans des tasses el je l'offris à mes spectateurs ébahis.
Les premières tasses ne furent acceptées, pour ainsi dire, qu'à corps défendant. Aucun arabe ne voulut d'abord tremper ses lèvres dans un breuvage qu'il croyait sorti de l'officine du diable ; mais, séduits insensiblement par le parfum de leur liqueur favorite, autant que poussés par les sollicitations des interprètes, quelques-uns des plus hardis se décidèrent à goûter le liquide magique, et bientôt tous suivirent leur exemple.
Le vase rapidement vidé, fut non moins rapidement rempli à différentes reprises ; et comme l'aurait fait ma bouteille inépuisable, il satisfit à toutes les demandes; on le remporta même encore plein.
Cependant il ne me suffisait pas d'amuser mes spectateurs, il fallait aussi, pour atteindre le but de ma mission, les impressionner, les effrayer même par l'apparence d'un pouvoir surnaturel.
Mes batteries étaient dressées en conséquence : j'avais gardé pour la fin de la séance trois trucs qui devaient achever d'établir ma réputation de sorcier.
Beaucoup de lecteurs se rappelleront avoir vu dans mes représentations un coffre petit, mais de solide construction, qui, remis entre les mains des spectateurs, devenait lourd ou léger à mon commandement. Un enfant pouvait le soulever sans peine, ou bien l'homme le plus robuste ne pouvait le changer de place.
Revêtu de cette fable, ce tour faisait déjà beaucoup d'effet. J'en augmentai considérablement l'action en lui donnant une autre mise en scène.
Je m'avançai, mon coffre à la main, jusqu'au milieu d'un praticable qui communiquait de la scène au parterre, Là, m'adressant aux Arabes : D'après ce que vous venez de voir, leur dis-je, vous devez m'attribuer un pouvoir surnaturel ; vous avez raison. Je vais vous donner une nouvelle preuve de ma puissance merveilleuse en vous prouvant que je puis enlever toute sa force à l'homme le plus robuste, et la lui rendre à ma volonté. Que celui qui se croit assez fort pour subir cette épreuve s'approche de moi. (Je parlais doucement, afin de donner le temps aux interprètes de traduire mes paroles.)
Un arabe d'une taille moyenne, mais bien pris de corps, sec et nerveux comme le sont les hercules arabes, monta avec assez de confiance près de moi.
Es-tu bien fort, lui dis-je, en le toisant des pieds à la tête ?
Oui, fit-il d'un air d'insouciance.
Es-tu sûr de rester toujours ainsi ?
Toujours.
Tu te trompes, car en un instant, je vais l'enlever tes forces et te rendre aussi faible qu'un enfant.. L'Arabe sourit dédaigneusement en signe d'incrédulité,
Tiens, continuai-je, enlève ce coffre.
L'arabe se baissa, souleva la boite et me dit froidement :
N'est-ce que cela ?
Attends. répondis-je.
Alors avec toute la gravité que m'imposait mon rôle, je fis du bras un geste, et prononçai solennellement ces paroles :
Te voilà plus faible qu'une femme ( Aux yeux des Arabes c'est le dernier degré de faiblesse.) ; essaye maintenant de lever cette boite.
L'hercule, sans s'inquiéter de ma conjuration, saisit une seconde fois le coffret par la poignée, et donne une vigoureuse secousse pour l'enlever. Mais cette fois le coffre résiste, et, en dépit des plus vigoureuses attaques, reste dans la plus complète immobilité.
L'Arabe s'épuise en vain sur le malheureux coffret une force qui eût pu soulever un poids énorme, jusqu'à ce qu'étant épuisé, haletant, rouge de dépit, il s'arrête, devient pensif, et semble commencer à comprendre l'influence de la magie.
Il est près de se retirer; mais se retirer, c'est s'avouer vaincu, c'est reconnaître sa faiblesse, c'est être moins qu'un enfant, lui dont on respecte la vigueur musculaire. Cette pensée le rend presque furieux.
Puisant de nouvelles forces dans les encouragements que ses amis lui adressent du geste et de la voix, il promène sur eux un regard qui semble leur dire : Vous allez voir ce que peut un enfant du désert.
Il se baisse de nouveau vers le coffre ; ses mains nerveuses s'enlacent dans la poignée, et ses jambes placées de chaque côté comme deux colonnes de bronze, serviront d'appui à l'effort suprême qu'il va tenter. Nul doute que sous cette puissante action la boite ne vole en éclats.
0 prodige ! Cet hercule tout à l'heure si puissant et si fier, courbe la tête; ses bras rivés au coffre cherchent dans une violente contraction musculaire à se rapprocher de sa poitrine ; ses jambes fléchissent, il tombe à genoux en poussant un cri de douleur.
Une secousse électrique produite par un appareil d'induction, venait à un signal donné par moi, d'être envoyée du fond de la scène à la poignée du coffre, De là les contorsions du pauvre Arabe. Faire prolonger cette commotion eut été de la barbarie.
Je fis un second signal et le courant électrique fut aussitôt interrompu. Mon athlète dégagé de ce lien terrible, lève les mains au-dessus de sa tète : - Allah ! Allah s'écrie-t-il plein d'effroi.
Puis s'enveloppant vivement dans les plis de son burnous, comme pour cacher sa honte, il se précipite à travers les rangs des spectateurs et gagne la porte de la salle.
A l'exception des loges d'avant-scène (En terme de théâtre, on désigne les spectateurs par le nom de la place qu'ils occupent. Ainsi une ouvreuse dira : mon avant-scène vient de sortir avec sa dame sous le bras ; ma stalle n" 20 s'est trouvée malade, etc.) et des spectateurs privilégiés, qui paraissaient prendre un grand plaisir à cette expérience, mon auditoire était devenu grave et sérieux, et j'entendais les mots Chitan, Djenoun (Satan, Génie) circuler sourdement parmi ces hommes crédules qui, tout en me regardant, semblaient s'étonner de ce que je ne possédais aucun des caractères physiques que l'on prête à l'ange des ténèbres.
Je laissai quelques instants le public se remettre de l'émotion produite par mon expérience et par la fuite de l'hercule Arabe. Après quoi je passai au tour suivant.
Un des moyens employés par les marabouts pour s'agrandir aux yeux des Arabes et établir leur domination, c'était de faire croire à leur invulnérabilité.
L'un d'eux entre autres faisait charger un fusil qu'on devait tirer sur lui à une courte distance. Mais en vain la pierre lançait-elle des étincelles ; le marabout prononçait quelques paroles cabalistiques, et le coup ne partait pas.
Le mystère était simple : l'arme ne faisait pas explosion, parce que le marabout en avait habilement bouché la lumière.
Le colonel de Neveu m'avait fait comprendre l'importance de discréditer un tel miracle en lui opposant un tour de prestidigitation qui lui fut supérieur.
J'avais mon affaire pour cela. J'annonçai aux Arabes que je possédais un talisman pour me rendre invulnérable, et que je défiais le meilleur tireur de l'Algérie de m'atteindre.
J'avais à peine terminé ces mots, qu'un Arabe qui s'était fait remarquer depuis le commencement de la séance par l'attention qu'il prêtait à mes expériences, enjamba quatre rangées de stalles, et dédaignant de passer par le praticable, traversa l'orchestre en bousculant flûtes, clarinettes et violons, escalada la scène, non sans se brûler à la rampe, et une fois arrivé me dit en français :
- Moi, je veux te tuer.
Un immense éclat de rire accueillit et la pittoresque ascension de l'Arabe et ses intentions meurtrières, en même temps qu'un interprète qui se trouvait peu éloigné de moi, me faisait connaître que j'avais affaire à un marabout.
Toi, lu veux me tuer, lui dis-je en imitant le son de sa voix et de son accent, eh bien ! moi, je te réponds que, si sorcier que tu sois, je le serai encore plus que toi, et que tu ne me tueras pas.
Je tenais en ce moment un pistolet d'arçon à la main ; je le lui présentai.
Tiens, prends cette arme, assure-toi, qu'elle n'a subi aucune préparation.
L'Arabe souffla plusieurs fois par le canon, puis par la cheminée, en recevant l'air sur sa main, pour s'assurer qu'il y avait bien communication de l'une à l'autre, et après avoir examiné l'arme dans tous ses détails :
Le pistolet est bon, dit-il, et je te tuerai.
Puisque tu y tiens et pour plus de sûreté, mets double charge de poudre et une bourre par-dessus.
C'est fait.
Voici maintenant une balle de plomb ; marque-la avec un couteau, afin de pouvoir la reconnaître, et mets-la dans le pistolet en le recouvrant d'une seconde bourre.
- C'est fait.
Tu es bien sur maintenant que ton arme est chargée, et que le coup partira. Dis-moi, n'éprouves-tu aucune peine, aucun scrupule à me tuer ainsi, quoique je t'y autorise ?
Non, puisque je veux te tuer, répéta froidement l'Arabe.
Sans répliquer, je piquai une pomme sur la pointe d'un couteau, et me plaçant à quelques pas du marabout, je lui commandai de faire feu.
Vise droit au cœur, lui criai-je.
Mon adversaire ajusta aussitôt sans marquer la moindre hésitation.
Le coup partit, et le projectile vint se planter au milieu de la pomme.
J'apportai le talisman à l'Arabe qui reconnut la balle marquée par lui.
Je ne saurais dire si cette fois la stupéfaction fut plus grande que dans le tour précédent.
Ce que je pus constater, c'est que les spectateurs ahuris, en quelque sorte, par la surprise et l'effroi, se regardaient en silence et semblaient se dire dans un muet langage : où diable nous sommes-nous fourrés ?
Bientôt une scène plaisante vint dérider grand nombre de physionomies. Le marabout, quelque stupéfait qu'il fût de sa défaite, n'avait point perdu la tête ; profitant du moment où il me rendait le pistolet, il s'empara de la pomme, la mit immédiatement dans sa ceinture, et ne voulut à aucun prix me la rendre, persuadé qu'il était sans doute d'avoir là un incomparable talisman. Dieu veuille pour lui que depuis il ne l'ait pas mis à l'épreuve !
Pour le dernier tour de ma séance, j'avais besoin du concours d'un Arabe. A la sollicitation de quelques interprètes, un jeune Maure d'une vingtaine d'années, grand, bien fait et revêtu d'un riche costume, consentit à monter sur le théâtre. Plus hardi ou plus civilisé sans doute que ses camarades de la plaine, il s'avança résolument près de moi.
Je le fis approcher de la table qui était au milieu de la scène, et lui montrai ainsi qu'aux autres spectateurs qu'elle était mince et parfaitement isolée. Après quoi, et sans autre préambule, je lui dis de monter dessus, et je le couvris d'un énorme gobelet d'étoffe ouvert par le haut.
Attirant alors ce gobelet et son contenu sur une planche, dont mon domestique et moi nous tenions les deux extrémités, nous nous avançons jusqu'à la rampe avec notre lourd fardeau, et là, par un brusque mouvement, nous renversons le tout. L'Arabe avait disparu ; le gobelet était entièrement vide !
Alors commença un spectacle que je n'oublierai jamais.
Les Arabes avaient été tellement impressionnés par ce dernier tour, que, poussés par une terreur indicible, ils se lèvent dans toute les parties de la salle, et se livrent instantanément aux évolutions d'un sauve-qui-peut général.
La foule est surtout compacte et animée aux portes du balcon, et l'on peut juger à la vivacité des mouvements et au trouble des grands dignitaires qu'ils sont les premiers à vouloir quitter la salle.
Vainement l'un d'eux, le caïd des Beni-Salah, plus courageux que ses collègues, cherche à les retenir par ces paroles.
- Arrêtez ! arrêtez ! nous ne pouvons laisser perdre ainsi l'un de nos coreligionnaires ; il faut absolument savoir ce qu'il est devenu et ce qu'on en a fait. Arrêtez !. arrêtez !
Bast ! les coreligionnaires n'en fuient que de plus belle, et bientôt le courageux caïd, entraîné lui-même par l'exemple, suit le torrent des fuyards.
Ils ignoraient ce qui les attendait à la porte du théâtre.
A peine avaient-ils descendu les degrés du péristyle qu'ils se trouvèrent face à face avec le Maure ressuscité.
Le premier mouvement d'effroi passé, on entoure notre homme, on le tâte, on l'interroge ; mais, ennuyé de ces questions multipliées, il ne trouve rien de mieux à faire que de se sauver à toutes jambes.
Le lendemain, la deuxième représentation eut lieu devant une autre assemblée d'Arabes et produisit à peu de chose près les mêmes effets que la première.
Le coup était porté : dès lors les interprètes et tous ceux qui approchèrent les Arabes reçurent l'ordre de travailler à leur faire comprendre que mes prétendus miracles n'étaient que le résultat d'une adresse inspirée et guidée par un art qu'on nomme prestidigitation, et auquel la sorcellerie est tout à fait étrangère.
Les Arabes se rendirent sans doute à ce raisonnement, car je n'eus par la suite qu'à me louer des relations amicales qui s'établirent entre eux et moi. Chaque fois qu'un chef me rencontrait, il ne manquait pas de venir au devant de moi et de me serrer la main. Bien mieux, ainsi qu'on va le voir, ces hommes que j'avais tant effrayés, devenus mes amis, me donnèrent un précieux témoignage de leur estime, et je puis le dire aussi, de leur admiration, car c'est leur propre expression.
Trois jours s'étaient écoulés depuis ma dernière représentation, lorsque je reçus dans la matinée une missive du gouverneur, qui me recommandait de me rendre au palais, à midi précis, heure militaire.
Je n'eus garde de manquer à ce rendez-vous formel, et le dernier coup de midi sonnait encore à l'horloge de la mosquée voisine, que je me faisais annoncer au palais. Un officier d'état-major se présenta aussitôt.
Venez avec moi, monsieur, me dit-il d'un air quasi mystérieux, je suis chargé de vous conduire.
Je suivis mon conducteur, et au bout d'une galerie que nous venions de traverser, la porte d'un magnifique salon s'étant ouverte, un étrange tableau s'offrit à mes regards. Une trentaine des plus importants chefs arabes étaient debout et symétriquement rangés en cercle dans l'appartement, de sorte qu'en entrant je me trouvai naturellement au milieu d'eux.
Salam alikoum (que le salut soi sur toi) ! firent-ils d'une voix grave et presque solennelle, en portant la main sur leur cœur selon l'usage arabe.
Je répondis d'abord à ce salut par une légère inclination de tête et de corps, ainsi que nous la pratiquons, nous autres Français, et ensuite par quelques poignées de main, en commençant par ceux des chefs avec lesquels j'avais eu l'occasion de faire connaissance.
En tête se trouvait le bachaga Bou-Allem, le Rothschild africain, dans la tente duquel j'étais allé prendre le café, dans le camp que les Arabes avaient formé près de l'hippodrome pour le temps des courses.
Venait ensuite le caïd Assa, à la jambe de bois, qui m'avait également offert le chibouk et le café, au même campement. Ce chef n'entend pas un mot de français, si bien que lors de la visite que je lui fis avec mon ami Bou-kandoura, autre Arabe de distinction avec lequel j'avais lié connaissance, ce dernier put me raconter en sa présence, sans qu'il se doutât qu'on parlait de lui, l'histoire de sa jambe de bois.
Assa, me dit mon ami, ayant eu la jambe fracassée dans une affaire contre les Français, dut à l'agilité de son cheval d'échapper à l'ennemi vainqueur. Une fois en lieu de sûreté, il s'était lui-même coupé la jambe au-dessous du genou et dans sa sauvage énergie, il avait ensuite plongé dans un vase remplit de poix bouillante l'extrémité de ce membre ainsi mutile, afin d'en arrêter l'hémorragie.
Voulant rendre les salutations que j'avais reçues, je fis le tour du groupe, adressant à chacun un bonjour de forme variée. Mais ma besogne, car c'en était une de serrer toutes ces mains rudes et nerveuses, fut considérablement abrégée ; les rangs s'étaient éclaircis à mon approche. Bon nombre des assistants ne s'étaient pas senti le courage de toucher la main de celui qu'ils avaient pris sérieusement pour un sorcier ou pour le diable en personne.
Quoi qu'il en fût, cet incident ne troubla en aucune façon la cérémonie ; on rit un peu de la pusillanimité des fuyards, puis chacun reprit cette gravité, qui est l'état normal de la physionomie arabe.
Alors, le plus âgé de l'assemblée s'avança vers moi et déroula une énorme pancarte. C'était une adresse écrite en vers, vrai chef-d'œuvre de calligraphie indigène, qui était enrichie de gracieuses arabesques exécutées à la main.
Le digne Arabe qui avait bien au moins soixante-dix ans, lut sans lunettes, à haute, mais inintelligible voix, pour moi du moins qui ne connaissais que trois mots de la langue, arabe, le morceau de poésie musulmane.
Sa lecture terminée, l'orateur tira de sa ceinture le cachet de sa tribu et l'apposa solennellement au bas de la page.
Les principaux chefs ou dignitaires arabes suivirent-son exemple.
Quand tous les sceaux eurent été apposés, mon vieil interlocuteur prit le papier, s'assura si les empreintes étaient parfaitement séchées, fit un rouleau, et, me le présentant, me dit en français d'un ton profondément pénétré :
A un marchand on donne de l'or ; à un guerrier on offre des armes ; à toi, Robert Houdin, nous te présentons un témoignage de notre admiration que tu pourras léguer à tes enfants.
Et traduisant un vers qu'il venait de me lire en langue arabe, il ajouta : - Pardonne-nous de te présenter si peu, mais convient-il d'offrir la nacre à celui qui possède la perle ?
J'avoue bien franchement que de ma vie je n'éprouvai une aussi douce émotion ; jamais aucun bravo, aucune marque d'approbation ne me porta si vivement au cœur. Emu plus que je ne puis le dire, je me retournai pour essuyer furtivement une larme d'attendrissement.
Ces détails et ceux qui vont suivre blessent bien un peu ma modestie, mais je n'ai pu me résigner a les passer sous silence; que le lecteur veuille bien ne les accepter que comme un simple tableau de mœurs.
Je déclare, du reste, qu'il ne m'est jamais entré dans l'esprit de me trouver digne d'éloges aussi vivement poétisés. Et pourtant je ne puis m'empêcher d'être aussi flatté que reconnaissant de cet hommage, et de le regarder comme le plus précieux souvenir de ma vie d'artiste,
Cette déclaration terminée, je vais donner la traduction de l'adresse, telle qu'elle a été faite par le calligraphe arabe lui-même.
"Hommage offert à Robert Houdin par les chefs de tribus arabes, à la suite de ses séances donnée à Alger, le 28 et 29 octobre 1856.
Gloire à Dieu qui enseigne ce que l'on ignore, qui rend sensibles les trésors de la pensée par les fleurs de l'éloquence et les signes de l'écriture.
" Le destin aux généreuses mains, du milieu des éclairs et du tonnerre, a fait tomber d'en haut, comme une pluie bienfaisante, la merveille du monde et du siècle, celui qui cultive des arts surprenants et des sciences merveilleuses, le sid Robert-Houdin.
"Notre temps n'a pas vu personne qui lui soit comparable. L'éclat de son talent surpasse ce que les âges passés ont produit de plus brillant. Parce qu'il l'a possédé, son siècle est le plus illustre.
Il a su remuer nos cœurs, étonner nos esprits, en nous montrant les faits surprenants de sa science merveilleuse. Nos yeux n'avaient jamais été fascinés par de tels prodiges. Ce qu'il accomplit ne saurait se décrire, nous lui devons notre reconnaissance pour tout ce dont il a délecté nos regards et nos esprits ; aussi notre amitié pour lui s'est-elle enracinée dans notre cœur comme une pluie parfumée, et nos poitrines l'enveloppent-elles précieusement.
Nous essaierons vainement d'élever nos louanges à la hauteur de son mérite ; nous devons abaisser nos fronts devant lui et lui rendre hommage, tant que la pluie bienfaisante fécondera la terre, tant que la lune éclairera les nuits, tant que les nuages viendront tempérer l'ardeur du soleil.
Ecrit par l'esclave de Dieu.
ALI-BEN-EI-HADJI-MOUÇA "
Pardonne-nous de te présenter si peu, etc.
Suivent les signatures et les cachets des chefs de tribus.
Au sortir de cette cérémonie et après que les Arabes nous eurent quittés, le maréchal-gouverneur, que je n'avais pas vu depuis mes représentations, voulant me donner une idée de l'effet qu'elles avaient produit sur l'esprit des indigènes, me cita le trait suivant : Un chef kabyle, venu à Alger pour faire sa soumission, avait été conduit à ma première représentation.
Le lendemain, de très bonne heure, il se rend au palais et demande à parler au gouverneur.
Je viens, dit-il au maréchal, te demander l'autorisation de retourner tout de suite dans ma tribu.
Tu dois savoir, répond le gouverneur, que les formalités ne sont pas encore remplies, et que tes papiers ne seront en règle que dans trois jours; tu resteras donc jusqu'à cette époque.
Allah est grand, dit l'Arabe, et s'il lui plaît, je partirai avant ; tu ne me retiendras pas.
Tu ne partiras pas, si je le défends, j'en suis certain ; mais, dis-moi, pourquoi es-tu si pressé de t'en aller ?
- Après ce que j'ai vu hier, je ne veux pas rester en Alger ; il m'arriverait malheur.
Est-ce que tu as pris ces miracles au sérieux ?
Le Kabyle regarda le maréchal d'un air d'étonnement, et sans répondre directement à la question qui lui était faite :
Au lieu de faire tuer tes soldats pour soumettre les Kabyles, dit-il, envoie ton marabout français chez les plus rebelles, et avant quinze jours, il te les amènera tous ici.
Le Kabyle ne partit pas, on parvint à calmer ses craintes ; toutefois il fut un de ceux qui, dans la cérémonie qui venait d'avoir lieu, s'étaient éloignés le plus à mon approche.
Un autre Arabe disait encore en sortant d'une de mes séances : Il faudra maintenant que nos marabouts fassent les miracles bien forts pour nous étonner.
Ces renseignements, dans la bouche du gouverneur, me furent très agréables. Jusqu'alors je n'avais pas été sans inquiétude, et, bien que je fusse certain d'avoir produit une vive impression dans mes séances, j'étais enchanté de savoir que le but de ma mission avait été rempli selon les vues du gouvernement. Du reste, avant de partir pour la France, le maréchal voulut bien m'assurer encore que mes représentations en Algérie avaient produit les plus heureux résultats sur l'esprit des indigènes.
Quoique mes représentations fussent terminées, je ne me pressai pas cependant de rentrer en France. J'étais curieux d'assister, à mon tour, à quelques scènes d'escamotage exécutées par des marabouts ou par d'autres jongleurs indigènes. j'avais promis en outre à plusieurs chefs arabes d'aller les visiter dans leurs douars. Je voulais me procurer ce double plaisir.
Il est peu de Français qui, après un court séjour en Algérie, ont entendu parler des Aïssaoua et de leur merveilles. Les récits qui m'avaient été faits des exercices des sectaires de Sidi-Aïssa m'avaient, inspiré le plus vif désir de les voir exécuter, et j'étais persuadé que tous leurs miracles ne devaient être que des trucs plus ou moins ingénieux, dont il me serait sans doute possible de donner le mot.
Or, M. le colonel de Neveu m'avait promis de me faire assister à ce spectacle ; il me tint parole.
A un jour indiqué par le mokaddem, président habituel de ces sortes de réunions, nous nous rendîmes, en compagnies, de quelques officiers d'état-major et de leurs femmes, dans une maison arabe, et nous pénétrâmes par une porte basse dans la cour intérieure du bâtiment, où devait avoir lieu la cérémonie. Des lumières artistement collées sur les parois des murs et des tapis étendus sur les dalles attendaient l'arrivée des frères. Un coussin était destiné au mokaddem.
Chacun de nous se plaça de manière à ne pas gêner les exécutants. Nos dames montèrent aux galeries du premier étage, de sorte qu'elles se trouvaient par ce fait, comme nous disons en France, aux premières loges.
Mais je vais laisser le colonel de Neveu raconter lui-même cette séance, en la copiant textuellement dans son intéressant ouvrage sur les Ordres religieux chez les musulmans de l'Algérie :
" Les Aïssaoua entrent, se placent en cercle dans la cour et bientôt commencent leurs chants. Ce sont d'abord des prières lentes et graves qui durent assez longtemps; viennent ensuite les louanges en l'honneur de Sidi-Mohammet-Ben-Aïssa, le fondateur de l'ordre : puis les frères et le mokaddem, prenant des timbales et des tambours de basque, animent successivement la cadence, en s'exaltant mutuellement d'une manière toujours croissante.
" Après deux heures environ, les chants étaient devenus des cris sauvages et les gestes des frères avaient suivi la même progression.
Tout à coup, quelques-uns se lèvent et se placent sur une même ligne en dansant et prononçant aussi gutturalement que possible, avec toute la vigueur de leurs énergiques poumons, le nom sacré d'Allah. Ce mot qui désigne la divinité sortant de la bouche d'Aïssaoua, semblait être plutôt un rugissement féroce qu'une invocation adressée à l'Être suprême.
Bientôt le bruit augmente, les gestes les plus extravagants commencent, les turbans tombent, laissent paraître à nu ces tètes rasées qui ressemblent à celles de vautours ; les longs plis des ceintures rouges se déroulent, embarrassent les gestes et augmentent le désordre.
"Alors les Aïssaoua marchent sur les mains et les genoux, imitent les mouvements de la bête. On dirait qu'ils n'agissent uniquement que par l'effet d'une force musculaire qui ne dirige plus la raison, et qu'ils oublient qu'ils sont hommes.
Lorsque l'exaltation est à son comble, que la sueur ruisselle de tous leurs corps, les Aïssaoua commencent leurs jongleries. Ils appellent le mokaddem leur père, et lui demandent à manger ; celui-ci distribue aux uns des morceaux de verre qu'ils broient entre leurs dents ; à d'autres, il met des clous dans la bouche ; mais au lieu de les avaler, ils ont soin de se cacher la tête sous les plis du burnous du mokaddem, afin de ne pas laisser voir aux assistants qu'ils les rejettent. Ceux-ci mangent des épines et des chardons ; ceux-là passent leur langue sur un fer rouge ou le prennent entre leurs mains sans se brûler. L'un se frappe le bras gauche avec la main droite ; les chairs paraissent s'ouvrir, le sang coule en abondance : il repasse la main sur son bras, la blessure se ferme, le sang a disparu. L'autre saute sur le tranchant d'un sabre que deux hommes tiennent par les extrémités et ne se coupe pas les pieds. Quelques-uns tirent de petits sacs en peau, des scorpions, des serpents qu'ils mettent intrépidement dans leur bouche."
Je m'étais blotti derrière une colonne d'où je pouvais tout voir sans être aperçu. J'avais à cœur de n'être pas la dupe de ces tours mystérieux ; j'y prêtai donc une attention très soutenue.
Autant par les remarques que je fis sur le lieu même de la scène que par les recherches ultérieures auxquelles je me suis livré, je suis maintenant en mesure de donner une explication satisfaisante des miracles des Aïssaoua.
Seulement pour ne pas interrompre trop longuement mon récit, je renverrai le lecteur curieux de ces détails, à la fin de cet ouvrage, au chapitre spécial que j'ai intitulé : UN COURS DE MIRACLES.
Je crois être d'autant plus compétent pour donner ces explications, que quelques-uns de ces tours rentrent dans le domaine de l'escamotage, et que les autres ont pour base des phénomènes tirés des sciences physiques.
Une fois instruit du secret des jongleries exécutées par les Aïssaoua, je pouvais me mettre en route pour l'intérieur de l'Afrique.
Je partis donc, muni de lettres du colonel de Neveu pour plusieurs chefs de bureaux arabes, ses subordonnés, et j'emmenai avec moi Mme Robert-Houdin, qui se montrait tout heureuse de faire cette excursion.
Nous allions voir l'Arabe sous sa tente ou dans sa maison ; goûter à son couscoussou, que nous ne connaissions que de nom ; étudier par nous-mêmes les mœurs, les habitudes domestiques de l'Afrique ; il y avait là certes de quoi enflammer notre imagination. Et c'est à peine si je songeais par moments, moi qui redoutais tant le mauvais temps sur mer, que le mois où nous nous rembarquerions pour la France, serait précisément un de ceux où la Méditerranéenne est le plus agitée !
Parmi les Arabes qui m'avaient engagé à les visiter, Bou-Allem-Ben-Cherifa bachaga, du D'jendel, m'avait fait des instances si vives que je me décidai à commencer mes visites par lui.
Notre voyage d'Alger à Médéah fut tout prosaïque; une diligence nous y conduisit en deux jours.
A cela près de l'intérêt que nous inspira la végétation toute particulière du sol de l'Algérie, ainsi que le fameux col de la Mouzaïa que nous traversâmes au galop, les incidents du voyage furent les mêmes que sur les grandes routes de France. Les hôtels étaient tenus par des Français ; on y dînait à table d'hôte avec le même menu, le même prix, le même service. Cette existence de commis voyageurs n'était pas ce que nous rêvions en quittant Alger.
Aussi fûmes-nous enchantés de mettre pied à terre à Médéah ; au-delà, la diligence ne suivait plus la même direction que nous.
De Médéa à la tribu de Mohammed, nous avions suivi une route assez praticable ; en sortant de chez lui, nous entrâmes dans un pays inculte et désert, où l'on ne voyait d'autres traces de passage que celles que nous laissions nous-mêmes. Le soleil dardait ses plus brûlants rayons sur nos têtes, et nous ne trouvions sur notre chemin aucun ombrage pour nous en garantir. Souvent aussi notre marche devenait très pénible; nous rencontrions des ravins dans lesquels il nous fallait descendre au risque de briser les jambes de nos chevaux et de nous rompre le cou. Pour nous faire prendre patience, notre guide nous annonçait que nous ne tarderions pas à gagner un terrain moins accidenté, si nous continuions notre route.
Il y avait environ deux heures que nous avions quitté notre première halte, lorsque Mohammed qui avait lancé son cheval au galop, nous quitta en nous criant qu'il allait revenir, et disparut derrière une colline.
Nous ne le revîmes plus
J'ai su depuis que jaloux de la richesse de Bou-Allem, il avait préféré encourir une punition que de rendre visite à son rival.
Cette fuite nous mit, Mme Robert Houdin et moi dans une grande inquiétude, que nous nous communiquâmes, sans crainte d'être compris par nos guides. Nous avions à redouter le mauvais exemple donné par Mohammed ; les quatre arabes ne pouvait-ils pas imiter leur chef et nous abandonner à leur tour ? Que deviendrions-nous dans un pays, où, lors même que nous rencontrerions quelqu'un, nous ne pourrions pas nous comprendre ?
Mais nous en fûmes quittes pour la peur ; nos braves conducteurs nous restèrent fidèles, et furent même très polis et très complaisants pendant toute la route. Du reste, ainsi que nous l'avait annoncé Mohammed, nous gagnâmes bientôt un chemin qui nous conduisit directement à la demeure de Bou-Allem.
Comparativement à la maison du caïd, celle du bachaga pouvait passer par une habitation princière, moins pourtant pour l'aspect architectural des bâtiments que par leur étendue. Comme dans toutes les maisons arabes, on n'y voyait extérieurement que des murs ; toutes les fenêtres donnaient sur les cours ou sur les jardins.
Bou-Allem et son fils, agha lui-même, avertis de notre arrivée, vinrent à notre rencontre et nous adressèrent en arabe des compliments que je ne compris pas, mais que je supposai être dans la formule de salamalecs usités chez eux en pareil cas, c'est-à-dire : Soyez les bienvenus, ô les invités de Dieu !
Telle était du reste ma confiance, que quelques choses qu'ils nous eussent dites, je les aurais accueillies comme des politesses.
Nous descendîmes de cheval, et, sur l'invitation qui nous en fut faite, nous nous assîmes sur un banc de pierre où l'on ne tarda pas à nous servir le café. En Algérie, on fume et l'on prend du café toute la journée. Il est vrai que cette liqueur ne se fait pas aussi forte qu'en France, et que les tasses sont très petites.
Bou-Allem qui avait allumé une pipe me l'offrit. C'était un honneur qu'il me faisait de fumer après lui ; je n'eus garde de refuser, bien que j'eusse autant aimé qu'il en fut autrement.
Comme je l'ai dit, je ne savais de la langue arabe que trois ou quatre mots. Avec un aussi pauvre vocabulaire, il m'était difficile de causer avec mes hôtes. Néanmoins, il se montrèrent extrêmement joyeux de ma visite ; car, à chaque instant, ils me faisaient grand nombre de protestations, en mettant chaque fois la main sur leur cœur. Je répondais par les mêmes signes, et je n'avais ainsi aucuns frais d'imagination à faire pour soutenir la conversation.
Plus tard, cependant, poussé par un appétit dont je ne prévoyais pas la prompte satisfaction. je risquai une nouvelle pantomime. Mettant la main sur le creux de mon estomac et prenant un air de souffrance, je cherchai à faire comprendre à Bou-Allem que nous avions besoin d'une nourriture plus substantielle que ses compliments de civilité. L'intelligent Arabe le comprit et donna des ordres pour qu'on hâtât le repas.
En attendant, et pour nous faire patienter, il nous offrit par gestes de visiter ses appartements. Nous montâmes un petit escalier en pierre.
Arrivés au premier étage, notre conducteur ouvrit une porte dont l'entrée offrait cette particularité, que, pour y passer, il fallait à la fois baisser la tête et lever le pied. En d'autres termes, cette porte était si basse, qu'un homme d'une taille ordinaire ne pouvait la franchir sans se courber, et, comme le seuil en était élevé, il fallait enjamber par-dessus.
Cette chambre devait être le salon de réception du bachaga Les murailles en étaient couvertes d'arabesques rouges rehaussées d'or, et le plancher couvert de magnifiques tapis de Turquie. Quatre divans, revêtus de riches étoffes de soie, en formaient l'ameublement avec une petite table en acajou, sur laquelle étaient étalés des pipes, des tasses à café en porcelaine, et quelques autres objets à l'usage particulier des musulmans.
Bou-Allem y prit un flacon remplit d'eau de rose, et nous en versa dans les mains. Le parfum était délicat. Malheureusement notre hôte tenait à faire grandement les choses, et pour nous montrer le cas qu'il faisait de nous, il usa le reste du flacon à nous asperger littéralement de la tête jusqu'aux pieds.
Me tournant vers Mme Robert Houdin, je lui dis, en faisant une imperceptible grimace : J'aime le parfum, mais pas trop n'en faut. L'excès dans tout est un défaut. Nous empestions à force de sentir bon.
Nous visitâmes encore deux autres grandes chambres plus simplement décorées que la première, et dans l'une desquelles se trouvait un énorme divan. Bou-Allem nous fit comprendre que c'était là qu'il couchait.
Ces détails eussent été très intéressants dans tout autre moment, mais nous mourrions de faim, et, comme dit le proverbe : Ventre affamé n'a ni yeux ni oreilles. J'étais tout prêt à recommencer ma fameuse phrase, mimée, lorsqu'on passant dans une petite pièce qui n'avait pour tout ameublement qu'un tapis de pied, notre cicérone ouvrit la bouche, indiqua avec le doigt qu'on allait y mettre quelque chose, et nous fit ainsi comprendre que nous étions dans la salle à manger. Je mis la main sur mon cœur pour exprimer le désir que j'en ressentais.
Sur l'invitation de Bou-Allem, nous nous assîmes sur le tapis, autour d'un large plateau qu'on y avait déposé en guise de table.
Une fois installés, deux Arabes se présentèrent pour nous servir.
En France, les domestiques servent la tête découverte, en Algérie, ils gardent leur coiffure, mais en revanche, comme marque de respect, ils laissent leurs chaussures à la porte de l'appartement et servent nu-tête ; entre nos serviteurs, et ceux des Arabes, il n'y a de différence que des pieds à la tête.
Nous étions seuls attablés avec Bou-Allem.
Le fils n'avait pas l'honneur de diner avec son père, qui mangeait toujours seul.
On apporta sur le plateau une sorte de saladier rempli de quelque chose qui ressemblait à du potage de la citrouille. J'aime assez ce mets.
Quelle heureuse idée, dis-je à ma femme !
Bou-Allem a deviné mes goûts ; comme je vais faire honneur à son cuisinier ! Notre hôte comprit sans doute le sens de mon exclamation, car nous présentant à chacun une rustique cuillère de bois, il nous engagea à suivre son exemple, et plongea son arme jusqu'au manche dans la gamelle.
Nous l'imitâmes.
Pour mon compte, je sortis bientôt une énorme cuillerée, que je portai avec empressement à ma bouche ; mais à peine l'eusses-je goûtée :
Pouah ! m'écriai-je en faisant une horrible grimace, qu'est-ce que cela ? J'ai la bouche en feu ?
Mme Robert Houdin arrêta une cuillerée qu'elle tenait de ses lèvres, puis, soit appétit, soit curiosité, elle voulut s'assurer par elle-même du goût de notre potage : elle en essaya, mais elle ne tarda pas à joindre son concert au mien en toussant à perdre haleine. C'était une soupe au piment.
Tout en paraissant contrarié par ce contre-temps, notre hôte avalait sans sourciller d'énormes cuillerées de potage, et chaque fois il étendait les bras d'un air de béatitude qui semblait nous dire : C'est pourtant bien bon !
On desservi. la soupière presque vide.
Bueno ! bueno ! exclama Bou-Allem, et nous montrant un plat qu'on venait de mettre devant nous.
Bueno est espagnol. Le brave bachaga, qui savait deux ou trois mots de cette langue, n'était pas fâché de nous montrer son érudition.
Ce fameux plat était une sorte de ragoût qui semblait avoir quelque analogie avec un haricot de mouton. Quand j'étais à Belleville, c'était le plat chef-d'œuvre de Mme Auguste, et je lui faisais toujours un bon accueil. Aussi en souvenir de ma bonne cuisinière, je me préparai à fondre sur le ragoût ; mais je cherchai vainement autour de moi une fourchette, un couteau, ou même la cuillère de bois qu'on nous avait donnée pour le potage.
Bou-Allem me sortit d'embarras. Il me montra, en puisant lui-même dans le plat avec ses doigts, que la fourchette était un instrument tout à fait inutile.
Comme la faim nous pressait, nous passâmes par-dessus certaines répugnance, et ma femme, à mon exemple, pêcha délicatement un petit morceau de mouton. La sauce en était encore fortement épicée. Toutefois, en mangeant très peu de viande et beaucoup d'un mauvais petit pain sans levain qu'on nous avait servi, nous pûmes adoucir la force du poison.
Pour être agréable à notre hôte, j'eus le malheur de lui répéter le mot espagnol qu'il m'avait appris. Ce compliment, qu'il croyait sincère, lui fit un grand plaisir. Il voulut le justifier.
Plongeant alors sa main dans le plat il en retira bientôt un os garni de viande, en arracha quelques morceaux avec ses ongles et les offrit galamment à Mme Robert Houdin.
Je prévins une seconde édition de cette politesse en puisant moi-même dans le ragoût.
Je me demandais comment ma femme arriverait à se débarrasser de ce singulier cadeau : elle le fit beaucoup plus adroitement que je ne l'eusse pensé. Bou-Allem ayant tourné la tête pour donner des ordres, le morceau de viande fut remis dans le plat avec une étonnante subtilité, et nous eûmes bien envie de rire, lorsque notre hôte, qui ne se doutait de rien, reprit ce fragment de mouton pour son propre compte.
(1) Extrait de l'ouvrage de Robert Houdin
intitulée : Confidences d'un Prestidigitateur.
Publié dans les N° 23 , 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38,
du PROGRES, journal d'Oranie, 1881.
Source Gallica
|
|
| TAUX OU TARE
De Jacques Grieu
| |
La pandémie sévit et met à la torture
Les gens, les politiques et tous ceux qui l'endurent.
Faut-il un couvre-feu ? Un peu tôt ? Pas trop tard ?
Pire, un confinement… arrivant en retard ?
Le peuple es abattu ; c'est la mort de fêtard,
Des restos, des cafés qu'on a mis au rancard.
Les taux des infectés, des morts, des contagieux
Egrènent un bilan que l'on sent désastreux.
Je me lève trop tard : les censeurs ont raison ;
Mais c'est l'étau des tares ! C'est l'effet polochon !
Tôt de cholestérol ? Tare de l'édredon ?
Mais pourtant je n'ai rien du lent colimaçon !
Si je prends du retard, c'est que c'est ma façon,
De peser tard et tôt pour mûres réflexions.
Mes idées, en balance, on les pèse sans tare ;
Leur taux d'erreurs est bas, sans être trop… vantard.
En retard ? Ah, mais non ! C'est un peu court, pendards :
On pourrait dire aussi, bien des tares, sans fard ;
Par exemple, tenez : il est minuit, Schweitzer !
C'est trop tard ou trop tôt, c'est l'heure mensongère …
S'il n'est jamais plus tard que ce fameux minuit,
C'est trop tôt pour demain, trop tard pour aujourd'hui…
C'est toujours l'impatient qui arrive en retard,
Dont le taux d'accidents en fait un faux fêtard.
Si se coucher tard nuit, méfions nous des nuits brèves,
C'est que les levers tard, sont très bons pour les rêves.
" Mourir jeune et sans tare " ? Mais le plus tard possible :
" Mieux vaut jamais que tard " est alors notre cible.
C'est toujours bien trop tôt qu'apparaît le " plus tard ".
Le poids de mes propos tient compte de ces tares.
Les grasses matinées font des soirées tardives.
Par les voies du " plus tard ", à " jamais " on arrive !
" Je suis venu trop tard dans un siècle trop vieux "
A dit un grand génie au caractère anxieux.
Dans ce siècle trop jeune, est-ce moi le gâteux ?
Pouvoir être en retard est un plaisir des dieux !
L'avenir est trop tard et le présent trop tôt.
Trop tard est le salaire et trop taux est l'impôt.
Covid ou pas covid, écoutons nos guitares ;
Et le doux lever tard est le meilleur nectar.
Jacques Grieu
|
|
|
Algérie : Mémoire et imposture
Envoyé par Mme Annie Bouhier
|
| On va bien finir par s'apercevoir que ce rapport est très incomplet et très orienté,
Heureusement qu’il existe encore des grands maitres comme c’est le cas ici...merci Professeur Jean-Pierre Pister.
C’est à un gauchiste notoire que le président de la République - qui a déclaré, à Alger, que le colonialisme avait été « un crime contre l’humanité » - a confié la charge de négocier, avec des « historiens » algériens, les modalités d’une « réconciliation des mémoires » entre les deux parties. Les algériens jubilent !
Ce personnage a remis son rapport, qui contient des préconisations délirantes, dont celle de transférer au Panthéon les restes de la dame Halimi, ancienne avocate des tueurs du FLN. Nous ne sommes pas loin des « excuses » officielles que réclament les Algériens, pour justifier la demande à venir de « dédommagements » sonnants et trébuchants. Quand on se reconnaît « coupable » d’un crime, comment refuser d’en payer le prix ? On ne peut rien construire sur cette contradiction.
Les réactions sont diverses. Voici celle du Professeur PISTER, historien, qui traduit au mieux la position et les craintes des défenseurs de l’œuvre et de la mémoire françaises en Algérie. Je le cite :
J'ai eu connaissance du rapport Stora dès le milieu de la semaine dernière par mon ancien étudiant, désormais professeur d’histoire du Maghreb à la Sorbonne, Pierre Vermeren, dont on connait la riche bibliographie.
Voici une partie de mon commentaire adressé à quelques correspondants dont je respecte l'anonymat par souci de discrétion.
"Benjamin Stora s’est autoproclamé scandaleusement le meilleur spécialiste de l’Algérie. Né en 1950 à Constantine, il a milité dans la mouvance trotskyste lambertiste dès son arrivée en France. Il a rejoint ensuite le PS et est devenu le favori de François Hollande.
J’ai eu l’occasion de le rencontrer à Nancy et de déjeuner avec lui par obligation professionnelle en 2007. Il a alors promis à mon épouse, née à Oran, de mentionner les massacres du 5 juillet 1962 dans ses futures publications ....nous attendons toujours !
Dans le document transmis à Macron, il recommande la commémoration de la répression anti-FLN du 17 octobre 1961 à Paris qui aurait fait 3 à 400 morts. Il s’agit là d’une "fake news" éhontée banalisée dans les années 90 par le journaliste gauchiste Daniel Mermet et le pseudo historien Einaudi sur France-Inter. Des travaux scientifiques récents, ceux de Brunet, en particulier, démontrent qu’il faudrait diviser le nombre de victime par dix. Voir à ce sujet l’article de Wikipédia. Nous sommes dans une totale affabulation historique. Le silence sur le 5 juillet n’en est que plus scandaleux. Maître Goldnadel, avocat du Cercle algerianiste, en a fait état sur C News, il y a quelques jours.
Parmi les autres propositions scandaleuses figurant dans ce rapport, le projet de transfert au Panthéon des restes de la dame Halimi, ancienne avocate des tueurs du FLN.
Ne nous laissons pas décourager et continuons de résister, c’est là un impératif absolu. Au cours de ma carrière, j’ai toujours dit la stricte vérité à mes étudiants, candidats à Normale Sup, à Sciences Pô et même à de futurs officiers quand j’ai accompli une suppléance en Prépa St-Cyr. Cela ne m’a jamais valu le moindre problème avec ma hiérarchie puisque j’ai terminé ma carrière avec une note globale particulièrement élevée et une remise de décoration.
La vérité historique est un impératif absolu qui finit toujours par triompher. Pensons aux massacres vendéens de 1793-1794 si mal traités par l’historiographie républicaine, aujourd’hui pleinement reconnus. Le grand Soljenitsyne est venu lui-même sur place, en célébrer le 200e anniversaire.
L'exacte vérité sur ce que fut l’Algérie française finira par triompher, j’en suis convaincu."
|
|
| LA VIE LUXURIANTE
Envoyé par Eliane
| |
Nous croyions que le luxe était ce qui est rare. cher et exclusif, bref tout ce qui nous semblait inaccessible.
Aujourd'hui, nous nous rendons compte enfin que le luxe. c'était ces petites choses que nous ne valorisions pas.
- le luxe, c'est d'être en bonne saute, loin des hôpitaux
- le luxe c'est de pouvoir se promener dans la rue et de respirer sans masque - le luxe, c'est de se réunir avec la famille et les amis
- le luxe, ce sont ces regards et ces sourires
- le luxe, ce sont les câlins et les bisous
- le luxe, c'est regarder le coucher de soleil a la terrasse d'un café - le luxe c'est de partager un bon repas entre amis
Tout cela était le luxe et nous ne le savions pas..
|
|
|
Un an après son irruption en Occident, la Covid-19 continue d’occuper le devant de la scène politique et médiatique, au point que nous courons le risque d’en oublier que la marche du monde ne se réduit pas à la question sanitaire, fût-elle jugée essentielle dans nos sociétés vieillissantes et fuyant la mort à mesure que la longévité humaine augmente
Aussi, pour éviter une lecture étroite, réductrice et, in fine, dangereuse de l’actualité, il n’est pas inutile de se remémorer le conseil que donnait Charles Péguy, en 1910, dans Notre jeunesse : « Il faut toujours dire ce que l’on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit ».
C’est muni de cette recommandation qu’il y a lieu de lire attentivement le document d’actualisation de l’analyse stratégique présenté le 21 janvier dernier par la ministre des Armées. Cet exercice met en lumière les profondes évolutions apparues depuis 2017 et qui, conjuguées, aboutissent à un dangereux délitement de l’ordre international en lieu et place des espoirs placés dans un univers coopératif et solidaire ou dans les vertus pacifiantes du marché.
Aussi la réalité qu’il importe de voir et de méditer est celle-ci :
- accroissement de la compétition entre grandes puissances (en huit ans la Chine a doublé son budget de Défense tandis que celui des États-Unis atteint aujourd’hui 720 milliards de dollars, celui de la France étant de 39,2 milliards d’euros - soit 47,3 milliards de dollars - en 2021) ;
- existence de stratégies hybrides combinant actions militaires et non militaires tout en demeurant à distance du conflit ouvert ;
- affirmation de puissances régionales comme la Turquie ou l’Iran ;
- aggravation des risques de prolifération nucléaire au Moyen-Orient et en Asie ;
- ruptures technologiques dans le domaine du numérique et du spatial.
Partant de ce constat le ministère des Armées n’hésite pas à évoquer le risque de déclassement stratégique de l’Europe et de la France ; en contrepoint, il souligne l’effort de notre pays pour, via la Loi de programmation militaire 2019-2025, remonter en puissance nos forces. Celles-ci, grâce à la régénération nécessitée par des décennies de vaches maigres budgétaires et à l’adaptation aux nouveaux enjeux technologiques, devraient satisfaire à l’Ambition 2030, étape à franchir pour être efficaces à cet horizon sur l’ensemble du spectre des conflits possibles.
Quoique la période en soit achevée, formulons des vœux pour que ces ambitions, dont la réalisation conditionne non seulement le rang mais peut-être la survie de la France, soient traduites dans la durée, ce qui supposerait une véritable rupture avec des pratiques très anciennes résultant, qui sait, d’une vision insuffisamment tragique de l’Histoire…
On peut d’ailleurs se demander si cela n’est pas ce type de regard trop superficiel sur la nature de l’Histoire qui anime la Cour de Justice de la Communauté européenne. En effet, le 28 janvier dernier, à l’issue d’une affaire concernant l’armée slovène, elle a considéré, en écartant les arguments de spécificité absolue des militaires, que ceux-ci relevaient en principe, comme tous les travailleurs, du champ d’application de deux directives européennes (2003/88/CE et 89/391/CEE) relatives au temps de travail et à son aménagement et à la sécurité et à la santé des travailleurs, et qu’ils n’en étaient exclus que pour certaines activités spécifiques liées directement aux opérations et à l’entraînement.
Ce raisonnement, que d’aucuns apprécieront comme traduisant la recherche d’une voie moyenne entre les impératifs de sécurité et les droits individuels, nous apparaît irrecevable pour plusieurs raisons : d’une part il y va de la sécurité nationale qui est de la seule responsabilité des États membres, d’autre part, l’application de ces directives affaiblirait le principe même de disponibilité, élément central du statut militaire et à ce titre emportant de nombreuses conséquences directes et indirectes favorables du point de vue de la condition du personnel et enfin il introduirait des complications de gestion et des surcoûts ( besoins en effectifs) dont une armée tournée vers les opérations et contrainte financièrement - comme l’est l’armée française - n’a nul besoin.
Souhaitons vivement que la France reste ferme sur la position qu’elle tient sur ce sujet depuis 2014 ; si tel n’était pas le cas il y aurait quelque contradiction gravement fautive entre les principales conclusions de l’actualisation stratégique et la banalisation du métier militaire…
L’implantation conséquente de l’islam en Europe pose des problèmes d’organisation de la société face auxquels nos dirigeants apparaissent désemparés. Ne voyant pas – ou refusant de voir – ce qu’est l’islam dans sa nature même, ils raisonnent par analogie aux autres religions, et notamment au christianisme. Ce comportement vicié d’emblée est cause de solutions bancales.
Car l’islam est à la fois une religion (dîn), un système politique (dawla) et un mode de société (dunya), ces trois domaines étant intégralement fusionnés. On est face à une réalité de nature fondamentalement différente de celle des autres religions.
Si la grande majorité des musulmans pratique pacifiquement sa religion, l’islam est un projet politique consistant en l’obligation prescrite par le Coran de soumettre tout individu à l’unique loi islamique (charia) dont Dieu seul est l’auteur. Cette loi prime sur la loi civile qu’elle récuse et abolit. Elle vise à se substituer aux valeurs et modes de vie de notre civilisation. Une loi de séparation religion/État n’a aucun sens, en islam ; elle lui est, par nature, contraire ; les concepts de laïcité et de démocratie tels que compris en Occident lui sont incompatibles.
En principe, aucun musulman ne peut quitter l’islam sous peine de prison ou de mort, la musulmane n’a le droit de n’épouser qu’un musulman et les non-musulmans sont soumis, dans les pays où l’islam est au pouvoir, à un statut juridique spécifique restrictif, la dhimmitude, qui entrave leur place dans la société civile. Les musulmans ont le pas dans la vie publique sur les autres, la femme est inférieure à l’homme (Coran 4,34 ; 2,228), la communauté musulmane est la meilleure (3,110) puisque l’islam prévaut sur les autres religions (9,33).
Il convient donc de sortir au plus vite des raisonnements par analogie
Le voile de la religieuse est purement religieux et son port doit être libre partout. Celui de la musulmane a un sens politique qui est le rejet de notre civilisation et doit être proscrit dans l’espace public.
Une église, un temple, une synagogue ne sont que des édifices religieux. Une mosquée est, en outre, le lieu de la puissance publique, la mairie de l’État musulman où des décisions législatives et juridiques sont prises (successions, conflits interpersonnels…) selon des règles souvent à l’encontre des nôtres – ainsi de l’héritage double pour les fils que pour les filles (Coran 4,11) – et où, via son école (médersa) attenante, est enseigné le Coran avec certains principes contraires à nos lois. De plus, la communauté musulmane considère que le terrain sur lequel elle est bâtie devient sacré et, de facto, sa propriété. Et non plus territoire français. Le financement de l’investissement et du fonctionnement des mosquées doit être strictement contrôlé, toute dérive devant entraîner l’arrêt des travaux ou la fermeture du lieu.
Un prêtre, un pasteur ou un rabbin sont des ministres de leur culte, un imam jouit d’une autorité tant temporelle que religieuse. Il est un fonctionnaire de l’État musulman. Le prêtre est un religieux, l’imam est un homme de religion qui a pour rôle d’enseigner le Coran. Ils ne peuvent être considérés de la même façon. La nomination des imams et leurs dires, écrits et agissements doivent être encadrés par l’État.
Une école chrétienne ou juive transmet des savoirs dans le cadre de nos valeurs, une école musulmane instruit ses élèves dans l’assurance de la supériorité de l’homme sur la femme ou du musulman sur les autres, dans l’obligation du prosélytisme coranique, dans l’idée que la laïcité est contraire à la loi de Dieu.
L’islamisme est la manifestation extrême, souvent violente, de l’exercice de l’islam et doit être combattu avec la sévérité la plus totale. Mais, en amont, c’est bien l’islam en tant que tel qui pose problème car il est intrinsèquement porteur – qu’on le veuille ou non – d’un projet politique s’opposant sur bien des points à nos valeurs et modes de vie.
Henri de SAINT-BON
Colonel (er)
Spécialiste de l’Islam
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
Covid-19 à Annaba
Envoyé par Casimir
https://www.elwatan.com/regions/est/annaba/covid-19-a-annaba-la-decrue-en-attendant-la-campagne-de-vaccination-24-01-2021
Par El Watan - l Par Mme Leïla Azzouz 24 janvier 2021
La décrue en attendant la campagne de vaccination
La situation des contaminations de Covid-19 dans la wilaya de Annaba a entamé sa décrue. Elle est, depuis plusieurs semaines, en courbe décroissante.
C’est ce qu’a assuré le Dr Damèche, le directeur de la santé de la wilaya d’Annaba lors de la session d’APW, tenue dernièrement au siège de la wilaya. Pour étayer ses affirmations, devant un parterre d’élus et de journalistes, Dr Damèche a abondé : «Aucun cas suspect n’a été déclaré à l’université Badji Mokhtar.
Même dans les mosquées, la situation est satisfaisante. Situation similaire dans les structures sanitaires d’accueil qui ne connaissent plus la pression constatée au début de la pandémie.» Cette stabilité est constatée à quelques jours de l’arrivée de 500 000 doses du vaccin russe Spoutnik V, acquises par l’Algérie, tel que confirmé, mercredi dernier, par le Pr Ryadh Mahyaoui, membre du Comité scientifique en charge du suivi de la pandémie.
En attendant, les préparatifs de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sont achevés dans la wilaya où le même responsable a veillé personnellement sur cette opération, baptisée «Plan opérationnel de la campagne de vaccination contre la Covid-19».
Toujours selon le Dr Damèche, «après l’arrivée des premiers lots de vaccin, l’opération s’effectuera en trois phases. La première concernera les professionnels de la santé et les corps constitués.
La deuxième est destinée aux personnes âgées de plus que 65 ans, dont le nombre dans la wilaya est de 24 000 individus, suivront les malades chroniques estimés à 84 413 personnes. Quant à la dernière phase, elle est destinée aux étudiants et le reste de la population».
Sur le plan des lieux destinés à abriter cette campagne, la wilaya a affecté, selon toujours le DSP, 22 infrastructures du secteur de la jeunesse et des sports qui vont être transformées en salles de vaccination. Même les équipements destinés à la conservation et le transport des doses du vaccin sont au programme. «Nous avons 64 chaînes de froid avec une capacité de 322 litres.
Cependant, les moyens de transport du vaccin demeurent insuffisants», regrette le même responsable. Le DSP a annoncé le lancement prochain du centre CMCC, prévu pour le début du mois de mars 2021. Pour lui, «il sera le premier centre en Algérie où les services hématologie et anatomopathologie y seront installés».
24 janvier 2021
Annaba
Envoyé par Vivien
https://www.liberte-algerie.com/est/lentreprise-portuaire-mise-sur-lexportation-du-clinker-en-2021-354330
Par Liberté Algérie - par A. Allia le 20-02-2021
L’entreprise portuaire mise sur l’exportation du clinker en 2021
Au nombre des engagements commerciaux contractés par l’entreprise portuaire d’Annaba pour l’année 2021, le clinker de ciment, dont la première exportation remonte à l’année 2017, a pris de plus en plus d’importance, jusqu’à devenir l’une des activités principales de cette infrastructure.
Ainsi, des conventions de partenariat dans la commercialisation du clinker à l’international ont été signées, la semaine dernière, entre l’entreprise portuaire d’Annaba et les groupe Lafarge Algérie et Cilas et la société par actions Biskria Ciment, pour l’exportation, durant l’exercice en cours, de 1 million de tonnes de clinker gris vers différents pays d’Afrique de l’Ouest, entre autres et les USA.
S’exprimant en marge de la cérémonie de signature, Achour Djelloul, le P-DG du Groupe services portuaires (Serport), a rappelé que ces accords de partenariat s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures et qu’au vu des résultats enregistrés, durant ces dernières années, l’activité d’exportation du clinker a permis au pays de passer du statut d’importateur à celui d’exportateur de ciment.
Lors de son allocution d’ouverture, Achour Djelloul a indiqué que les ports dédiés à l’exportation de ciment sont ceux d’Oran, de Djen Djen, de Skikda et d’Annaba, pour lesquels un programme de mise à niveau logistique et organisationnel a été également engagé pour les mettre en capacité de faire face à ce challenge économique de grande importance pour le pays, dans le cadre de la politique de diversification des exportations hors hydrocarbures pour les années à venir.
Ce responsable révèle que les dix infrastructures portuaires s’attellent à moderniser leurs équipements de manutention et leurs espaces de stockage afin de répondre à la demande des opérateurs économiques engagés dans le vaste programme d’exportation du clinker, entre autres.
Cela, en faisant noter que l’exportation du clinker à partir du port d’Annaba a atteint 2,8 millions tonnes, pour une valeur de 80 millions dollars, en 2020, alors que 200 000 tonnes de ce produit ont déjà été expédiées à partir de ce même port, depuis le début de l’année en cours.
Dans cette perspective, les quatre ports commerciaux de Jijel, d’Oran, d’Annaba et de Skikda sont en train de renforcer leurs capacités de transbordement par l’installation, avant la fin de l’année en cours, de cinq Shiploaders d’une capacité de 18 000 tonnes par heure, devait ajouter le P-DG du Groupe Serport.
A. Allia
…SOUFFLES…SOUFFLES…SOUFFLES…
Envoyé par Louise
https://www.liberte-algerie.com/culture/les-villes-sans-coeur-lalgerien-vit-comme-dans-un-hotel-toujours-pret-a-retourner-dans-son-village-352770
Liberté-Algérie - Par Amin ZAOUI le 21-01-2021
Les villes sans cœur : l’Algérien vit comme dans un hôtel, toujours prêt à retourner dans son village !
Qu’importe le nom de la ville : Alger, Oran, Constantine, Saïda, Tizi Ouzou, Annaba, Tlemcen, Béjaïa, Biskra, Tiaret… métropole soit-elle, moyenne ou marginale, l’ombre de la ville s’est éclipsée de la ville. Effacement. La ville algérienne a perdu les valeurs de la citadinité ! A perdu sa mémoire, ses trottoirs, ses balcons, sa langue, ses odeurs et ses habitants. Les villes algériennes sont devenues folles. Dans le chaos, l’indifférence et le bricolage.
Le village a perdu son identité. Il ressemble à un bourg surpeuplé. Avec tout le respect au bourg, le vrai bourg, et aux braves gens de la dechra, la vraie dechra.
La topographie citadine est outragée.
Aucun pays du tiers-monde, les pays du monde arabe et ceux d’Afrique du Nord, ne possède un patrimoine aussi riche en villes, à l’instar de l’Algérie. Nous avions hérité de la colonisation, le jour de notre indépendance en 1962, plus de quarante superbes grandes villes et une dizaine de centaines de beaux villages, sur la côte, dans les Hauts-Plateaux et au Sahara. Un capital urbain inestimable d’une architecture remarquable. Des perles. Pour l’Algérien, tout était prêt pour faire de l’Algérie indépendante un pays moderne et concurrentiel. L’infrastructure est là.
Toutes ces superbes villes et ces beaux villages sont notre butin de guerre, certes ! Notre fierté nationale libérée, certes.
Mais, avec une mentalité moyenâgeuse, nous avons partagé ce butin de guerre comme cela se faisait au temps des foutouhat islamiques ! Nous avons occupé ces villes et ces beaux villages après 132 ans de colonisation de peuplement, qui sont notre patrimoine, certes, mais avec une autre culture. La gestion de la ville a besoin d’une philosophie urbaine, d’un État moderne. Mais dès l’indépendance nous sommes passés d’un système colonial raciste à un pouvoir politique rural. Depuis l’indépendance et jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous avons un pouvoir et non pas un État. L’État n’est pas le pouvoir. Dès l’indépendance, portés par le populisme, les Algériens se sont comportés, d’une façon ou d’une autre, en situation de vengeance psychique contre tout ce qui a été hérité de la colonisation. Tout ce qui symbolise le colonisateur est à détruire : les villes, l’administration et la langue.
Par cet état psychique vengeur contre la colonisation, et inconsciemment, nous nous sommes trouvés dans une situation de déconstruction de nos richesses arrachées par le sang et dans le sang.
Jusqu’au début des années soixante-dix, la ville algérienne était encore un modèle pour tous les pays arabes et maghrébins, sans exception aucune. Des villes propres. Organisées. Une bonne gestion. Enfant encore, on prenait le car de Tlemcen vers Oran, on passait par des villages comme des bijoux : Henaya, Remchi, Témouchent, Hassi Ghalla, Rio Salado (El-Maleh), Boutlellis, El-Amria, Messereguine… Ces villages par leur beauté ressemblaient à des images en couleurs dans un livre scolaire ! Dix ans après, les arbres étaient arrachés, les trottoirs creusés ! Les balcons aveuglés. Les caves désertées. Les beaux marchés couverts dévastés. Les beaux cafés délaissés ! Une autre tradition s’est installée dans l’espace villageois. Comme dans les villages, une autre mentalité a pris position dans l’espace urbain des grandes villes. Un choc urbain s’est procréé. Le nouveau pouvoir politique à la tête de l’Algérie nouvellement indépendante, qui puisait dans le populisme socialiste et le nationaliste grippé pour endoctriner la population, ne s’intéressait nullement à préserver le grand patrimoine urbain. Plutôt, il était occupé par le règlement des comptes avec les frères d’hier. Afin de régner, le pouvoir était prêt à tout casser pour y demeurer. Régner même sur les ruines et sur les discours phraséologiques !
Le pouvoir politique de l’Algérie indépendante, par sa mentalité rurale et son idéologie populiste, a encouragé inconsciemment le démantèlement des villes considérées comme butin de guerre à la manière des ères des foutouhat islamiques. Le pouvoir algérien, et depuis l’indépendance, a fait savoir, d’une façon indirecte aux Algériens, que ce qu’ils ont réalisé, après une guerre de sept ans et demi, n’est pas une simple indépendance d’un pays colonisé, mais une foutouhate (une conquête). Que les Algériens n’ont pas libéré leur pays l’Algérie, mais fatahouha, ils l’ont conquis. Donc, il faut se partager tout ce qui a été récupéré : les villas, les magasins, les bâtiments, les trottoirs, les fermes, les terres, la mer, les plages et les jardins publics.
Certes, il existait une Algérie citadine autochtone, qui a pu conserver sa culture ancestrale pendant la colonisation en essayant de la conjuguer avec la culture européenne humaine. Mais avec l’indépendance tout a été chamboulé. La ville européenne a été vidée. La ville autochtone a été noyée. L’espace a été envahi. L’Algérien s’envahit !
Le sens de la ville a perdu son sens. Une désurbanisation. Une anti-urbanisation. La dechra s’est installée au cœur de la ville, culture, mentalité et comportement. Un double bouleversement urbain et culturel, pour la ville comme pour la dechra.
En ville, les citadins qui occupent cet espace ne sont plus citadins. La citadinité n’est pas une plus-value, un privilège. N’est pas un classement social notable, mais une identification civilisationnelle bien précise. La culture de la campagne, du village, de la dechra n’est pas non plus une dévalorisation ou une sous-évaluation. Tout s’est métamorphosé. On a ruralisé la cité et on a manqué d’améliorer la vie rurale tout en respectant la ruralité. Le populisme politique, la psychologie du groupe social, la pauvreté généralisée et le rêve de la richesse ont bouleversé la vie dans la ville et chamboulé les valeurs de la vie à la campagne. Le paysan n’est pas un mot péjoratif. Le fonctionnaire n’est pas une distinction. Petit à petit, la ville s’est vidée de son sens citadin. Les occupants de la ville ne sont ni citadins ni villageois. Mi-figue, mi-raisin. Une autre catégorie socioculturelle est née dans le chaos stérile. Et la décennie noire ou rouge (1990-2000), avec plus de deux cent mille morts, a aggravé la situation dans l’espace urbain. Je ne sais pas pourquoi, j’imagine l’Algérien citadin comme quelqu’un qui occupe une chambre d’hôtel ! Il est toujours prêt à rentrer chez lui, dans son village natal, le lendemain matin ! Et ce lendemain est reporté à chaque fois à un autre matin, et sa ville se dégrade de plus en plus sous ses yeux, dans l’indifférence totale !
A. Z.
aminzaoui@yahoo.fr
La pêche au corail rouge rouverte courant de 2021
Envoyé par Victorien
https://www.liberte-algerie.com/est/la-peche-au-corail-rouge-rouverte-courant-de-2021-353528
Liberté-Algérie - Par APS le 04-02-2021
ANNONCÉE PAR LE MINISTRE DE TUTELLE LORS DE SA VISITE À EL-TARF
Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a annoncé, mardi 2 février, à El-Tarf, que “la pêche au corail rouge sera rouverte durant l'année en cours, dès que toutes les conditions seront réunies”. S'exprimant lors d'un atelier national sur l’exploitation du corail, organisé par l’ANDPA (Agence nationale de développement durable de la pêche et de l’aquaculture), le ministre a indiqué que l’activité sera rouverte au cours de cette année “sur des bases bien fondées” après finalisation des textes et des mécanismes réglementaires en concertation avec les professionnels et autres acteurs et intervenants dans le domaine de la production et de l’exploitation du corail.
L’objectif de cet atelier, retransmis en visioconférence pour les professionnels des wilayas de Jijel et Skikda, vise, a-t-il ajouté, à ouvrir “un débat fructueux sur la situation de cette filière et de mobiliser l’ensemble des acteurs autour de l’enjeu d’aplanir toutes les entraves existantes, la finalité étant de revenir à l’activité de pêche au corail dans des conditions organisationnelles irréprochables dans les wilayas concernées”.
Soulignant que le “compte à rebours”, s’agissant de la pêche du corail rouge, a été enclenché “dès aujourd'hui”, M. Ferroukhi a aussi précisé que les textes et loi régissant cette activité ont été élaborés pour permettre une exploitation “rationnelle et durable” de cette richesse. Le ministre, relevant que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant à redynamiser le secteur, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a, en outre, assuré que d'autres ateliers d'évaluation sont prévus pour “les deux prochains mois”.
Il a également souligné que la réouverture de cette activité permettra de mettre fin au “braconnage de cette richesse, assurera, outre un essor économique certain avec emplois et plus-value, une renaissance des métiers de transformation et des coopérations avec les différents partenaires dont l'université”. Selon la directrice du développement de la pêche au ministère de tutelle, Mme Sara Cheniti, la pêche au corail, activité suspendue en 2001, sera pratiquée, une fois relancée, dans deux zones (est et ouest du pays) englobant 10 périmètres dont 3 à El-Tarf. Chaque périmètre sera attribué à 30 concessionnaires avec un délai d'exploitation de 5 ans et une quantité de pêche “autorisée minimale” de 100 kg/an, a ajouté la même source.
APS
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci-dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la Seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
|
M.
Mon adresse est, (cliquez sur) :
|
|
| Un pharmacien plein d'humour
Envoyé par Annie
| |
|
Voici ce que ce pharmacien plein d'humour a affiché sur sa vitrine !!!
INFORMATION COVID
- L'âge moyen des décès par COVID est de 84 ans.
Le virus s'attaque plutôt aux personnes très âgées ou ayant des maladies graves (cancers, pathologies multiples...)
- 35 000 décès pour 67 millions d'habitants en France,
Cela représente 0,05 % de mortalité ; le taux de survie au COVID est donc actuellement de 99,95 % !!
- La "seconde vague" correspond à une augmentation des personnes testées positives dont la très grande majorité n'a pas de symptômes ou va guérir spontanément.
Elle ne correspond pas au nombre de décès !!!
NOTRE CONSEIL :
SI VOUS ÊTES À RISQUES ET QUE VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES, ALLEZ VOIR VOTRE MÉDECIN,
MAIS DANS TOUS LES CAS, N'OUBLIEZ PAS QUE LE CORPS HUMAIN EST EXTRÊMEMENT BIEN FAIT !
PENSEZ À RENFORCER VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE,
ETEIGNEZ LA TÉLÉ ET ARRÊTEZ D'AVOIR PEUR !
(c'est très mauvais pour la santé !)
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
|
|