|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les dix derniers Numéros :
91, 92,
93, 94,
95, 96,
97, 98,
99, ,
| |
|
|
|
EDITO
LA CENTIEME !
Chères Amies, chers Amis,
Vous comprendrez l'émotion particulière de cet éditorial, qui est celui du 100ème Numéro de " La Seybouse " dont le numéro 1 date de novembre 2001 ! A cette époque reculée, la forme de notre support était spartiate : texte simple et liens vers des pages du site.
Le nom même de " La Seybouse " a été imaginé sur l'idée de reprendre son modèle original créé en 1843 à Bône.
100 mois après sa création, la revue s'est développée sur son idée initiale, la mémoire des pionniers de l'Algérie.
La première " Feuille " a 9 ans et a eu 99 petites soeurs. Exhumé des archives, le premier numéro, au teint jauni, avec ses lignes pâlottes tapées sur un vieil ordinateur, présente un contenu encore bien modeste! Mais cela fait tout drôle d'en parcourir les lignes, un peu comme à l'ouverture d'un vieil album photos.
C'est qu'en 9 ans, il en a coulé de l'eau sous les ponts de " La Seybouse "! Une immersion affective dans le passé qui ne laisse pas insensible.
En ces neuf années, la " Feuille " a quelque peu évoluée, bien qu'elle ait toujours eu comme objectif premier de relater la mémoire des Pieds-Noirs. Un seul regret en 9 ans : ne pas être parvenu à faire écrire toute la mémoire vivante des membres de nos communautés, si ce n'est que très ponctuellement.
Mais il n'est jamais trop tard. Vous pouvez donc prendre la plume pour le 101ème numéro, suggérer à la rédaction des sujets d'articles, ou encore fournir des informations sur notre " vie là-bas " ou des petits reportages, même sur des sujets vous concernant (sur votre métier, sur un voyage, un souvenir...) sans pour autant tomber dans l'inconvenance du " trou de serrure. "
A une époque où l'on passe son temps à courir de droite et de gauche, écartelés entre le travail, la famille et les loisirs plus nombreux, une petite Gazette de mémoire collective permet de se recentrer sur son ex-lieu de vie par la lecture des événements qui s'y sont déroulés. Il est un peu fédérateur pour nos communautés ici et là-bas.
L'éditorial de la Seybouse ! Tous les mois, parvenir à trouver un sujet qui nous (et vous) fait réagir, et lui consacrer quelques lignes avant de vous abandonner à la lecture du numéro en cours.
Quelquefois, l'éditorial est écrit avant la Gazette elle-même. C'est le cas lorsqu'un sujet s'impose à l'auteur de ces lignes avant même qu'il ne choisisse les éléments du sommaire. C'est le cas le plus rare, fréquemment guidé par l'actualité. D'autres fois, l'éditorial est écrit quelques minutes avant l'envoi de la Gazette : dans ce cas, je me contente souvent de relever les points les plus significatifs du sommaire.
Mais quel que soit le cas de figure retenu, l'éditorial est l'occasion pour moi de m'adresser directement à vous : lecteurs et lectrices, étudiants, chercheurs, politiques ou encore simples curieux.
A la façon d'un yaouled qui naît, cherche et qui grandit pour atteindre l'âge de la maturité, votre mensuel préféré, " La Seybouse " que la plupart d'entre-vous a vu naître il y a 9 ans, fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, lundi 1er novembre 2010, cette Gazette que nombre de Pieds-Noirs, de Français, d'Algériens, etc.., ont déjà adopté vient d'atteindre tranquillement son 100ème numéro. Le parcours n'a pas été facile, encore que du chemin reste à faire, surtout qu'une partie vieillissante de l'équipe de cette " revue " qui tenait à gagner le défi qu'elle s'était lancé, a du s'arrêter pour des raisons de santé ou plus personnelles.
Partir pour mourir quelques mois après, selon les hommes de mauvaise foi, ce mensuel tient bon la barre. Ceci du fait que, aimables Amis et lecteurs, tant que vous serez satisfaits, je me battrai pour continuer dans le chemin que j'avais tracé. A cet effet, pour mieux vous servir et s'ouvrir sur le monde entier, j'accueillerez toujours vos desiderata, doléances, textes, documents et photos afin d'alimenter toutes les rubriques de " La Seybouse ". Et à ce sujet, je tiens à remercier tous ceux qui visitent le site tous les jours et me laissent par messages leurs suggestions sur les différents articles. Ma mission faut-il encore vous le rappeler : c'est de servir des informations vraies, justes et mémorielles. Numéro 100, c'est peu, diront les mauvaises langues, j'en suis conscient et c'est ce qui fait ma motivation aujourd'hui à aller de l'avant, car à l'époque, personne ne croyait qu'on parviendrait à en faire une vraie revue, et surtout qu'elle tiendrait aussi longtemps.
Nous vivons dans un monde où c'est la loi de la régularité qui prime. Malgré la multitude de journaux P.N. existant sur papier au sein d'associations, très peu se sont risqués gratuitement sur Internet et arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme " La Seybouse " et ceci grâce à votre sollicitude et votre soutien permanent. Je tiens à vous rassurer que, tant que je me sentirai soutenu par vous-mêmes, Chers Amis et aimables Lecteurs, et que la santé soit au rendez-vous, je serai présent pour continuer le combat de la mémoire Pieds-Noirs.
Pour ce 100ème numéro de "la Seybouse", j'ai décidé de vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître... En fouillant dans les vieux numéros de notre Gazette préférée, j'ai été très souvent surpris : on s'imagine que les choses changent, qu'aujourd'hui c'est très différent d'hier et dans un sens oui, heureusement les choses changent, et en même temps elles ne changent pas tant que ça et aussi vite que l'on voudrait.
Mon idée de départ était de créer un lien entre les P.N. et le site de " Bône la coquette ". En effet, bien que situés sur un même territoire, les habitants de l'Algérie étaient auparavant séparés les uns des autres par les découpages départementaux, par l'immensité du territoire Algérien, par l'éloignement des villes, par le manque de moyens personnels de transport et Internet n'existait pas.
L'utilisation courante du Web dans de nombreux foyers Pieds-Noirs à provoqué l'émergence d'une nouvelle attente : dorénavant la communauté veut, sur Internet, des contenus plus riches et plus interactifs que ceux trouvés sur les revues papier des Associations dont ils ne sont pas très majoritairement adhérents et donc par la force des choses n'en peuvent avoir accès. Il faut dire qu'en ce temps là, la quasi-totalité des associations en étaient réfractaires ou férocement anti-Internet. Depuis Internet a mûri et peut enfin faire preuve de créativité avec les nouvelles technicités. Il est en train de fixer les bases d'une nouvelle communication dynamique sur la Toile, certes parfois trop intrusive, mais dont la redoutable efficacité convaincra sans doute très rapidement les plus réticentes d'entre-elles afin qu'elles diffusent gratuitement les trésors de mémoire en leur possession.
J'avais participé avec d'autres amis au vrai premier forum P.N. et j'ai pu me faire une idée des problèmes que rencontrait la communauté P.N., et notamment celui de la mémoire. J'ai donc décidé de créer le site de " Bône la Coquette ", puis presque un an après, est sortie la Gazette " La Seybouse " qui ne contenait que des liens vers le site de Bône. Très rapidement, " La Seybouse " est devenue le trait d'union entre les habitants de Bône et sa région avant de le devenir pour toute l'Algérie. Couplé dès le départ au site Internet de Bône, ils se sont fait le relais de l'information bien au-delà du territoire national, en direction de tous ceux qui s'intéressent à notre belle Algérie.
A quoi, ou à qui, est dû le succès de " la Seybouse " ?
En premier lieu à ces femmes et ces hommes passionnés par l'Histoire de notre Algérie à qui j'ai offert chaque mois les colonnes pour qu'ils puissent vous communiquer leur passion du territoire. Natifs d'Algérie, d'adoption, tous partagent la même passion du pays. Beaucoup sont à la retraite, d'autres encore en activité. Certains écrivent ou envoient des documents épisodiquement, à leur rythme, mais tous sont largement impliqués dans le patrimoine mémoriel de notre pays de naissance. A l'occasion de ce centième numéro, j'aurai voulu les mettre à l'honneur en vous faisant découvrir leur parcours et vous permettre ainsi de mieux les connaître et mieux comprendre la philosophie de la Gazette, mais le temps m'a encore une fois fait défaut. Donc pour n'en vexer aucun, je ne citerai personne, mais ils savent la reconnaissance que j'ai envers eux. Je les remercie vivement pour leur concours au fil des années et leur extrême gentillesse.
" La Seybouse " propose, chaque mois, un véritable contenu. En effet, les sujets sont traités de manière à intéresser tout le monde. La distribution de la revue se fait uniquement sur Internet et gratuitement.
Cependant, l'âme de " La Seybouse " provient certainement de la passion avec laquelle elle est réalisée chaque mois.
Son esprit d'indépendance est peut-être aussi le résultat de l'énergie insufflé par les collaborateurs.
100 numéros envoyés à plus de 5 000 adresses Email et chaque mois des centaines de milliers de lecteurs anonymes directement sur le net. Cela ne s'est pas fait tout seul.
Le temps passe et ces anniversaires sont l'occasion de faire une pause, se retourner, regarder le chemin parcouru, s'interroger sur les valeurs que j'ai affiché. Liberté, Egalité, Fraternité, Liberté d'Expression ont toujours été au coeur de mes projets et de mes actions.
Je crois pouvoir dire oui ; oui j'ai toujours tenté de respecter la liberté de chacun même lorsque au nom de la liberté d'expression j'ai été attaqué, menacé ou diffamé. Il m'en a fallu de la patience et du courage pour surmonter tout cela, même si les traces ne s'effaceront jamais.
Oui j'ai voulu aussi faire vivre la Vérité. L'Egalité dans la place accordée à chacun, quelle que soit son origine sociale, religieuse ou sa couleur de peau du moment qu'il y avait le même respect. Oui j'ai voulu montrer une mémoire fraternelle, aimante où le partage et la tolérance guident les pas de chacun. Tout ceci je l'ai fait avec vous, grâce à vous et aussi grâce à ma famille qui m'a supporté et soutenu dans les combats de tous les jours.
Ce numéro 100, qui j'en suis persuadé, fera honneur aux 99 précédents, et qui remercie la communauté d'être aussi active et fidèle...
A demain, Après demain ! et A+ ……
Merci pour toute l'aide et le soutien que vous m'avez apporté au fil des années.
Bonne lecture en couleurs de ce 100ème numéro.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
N.B : Tous les numéros de " La Seybouse " sont en ligne en version intégrale et en couleur sur le site de Bône : ils peuvent être lus à l'écran ou tirés en couleur sur papier.
Ce 100ème NUMERO, une Edition Spéciale, de 100 pages est aussi sous format PDF, que vous pourrez enregistrer et éditer comme un livre.
Ce 100ème Numéro ne doit pas faire oublier que nous sommes à la veille de la commémoration de tous nos morts et surtout de ceux resté au bled. Ayons une pensée très forte pour eux.
Ce bouquet de roses de Guelma est offert par M. Yves Jan.

Cueillies il y a plus de
70 ans, dans le jardin de mes parents à Guelma et immortalisé dans ce tableau,
peint par une amie bônoise Madame Yvonne Grob née Palomba .
Pour moi il représente entres autres le souvenir de ceux qui nous ont quittés " tous saints " ( c'est à dire croyants, appelés comme tels dans la Bible, Nouveau Testament ) ; mais aussi en ce jour du souvenir, les amis et l'amitié que nous avons eu le bonheur de trouver ou de retrouver lors de nos voyages en Terre Natale ; MERCI JEAN PIERRE .
Je pense aussi à tous les autres et que les hommes renoncent à leur haine, pour retrouver la fraternité et l'amour .
" Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous méprisez pas, ne vous haïssez pas et soyez des frères " ( Hadith 35 - Imam An-Nawawi )
Comme quoi quelque soit notre croyance ou notre philosophie nous sommes fait pour nous entendre.
Alors à tous bien fraternellement je vous embrasse.
Yves Jan
OPERATION : " TOUSSAINT - TADDO 2010 "
Nettoyage, Entretien et Fleurissement de nos Tombes
Effectués par M. Mounir Haneche







 MERCI MOUNIR
MERCI MOUNIR
|
|
| IAMBES
De M. André Chenier
Envoyé Par José
| |
C'est un poème très pathétique composé par le poète André Chénier avant l'exécution de la sentence. Condamné à mort par les tenants de la "terreur " de la Révolution française, il sera guillotiné le 25 /07/1794. C'est l'état d'esprit d'un condamné en sursis qui apparaît à travers ces vers.
IAMBES
Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr
Animent la fin d'un beau jour
Au pied de l'échafaud j'essaye encor ma lyre.
Peut-être est-ce bientôt mon tour.
Peut-être avant que l'heure en cercle promenée
Ait posé sur l'émail brillant,
Dans les soixante pas où sa route est bornée,
Son pied sonore et vigilant;
Le sommeil du tombeau pressera ma paupière.
Avant que de ses deux moitiés
Ces vers que je commence ait atteint la dernière.
Peut-être en ces murs effrayés
Le messager de mort, noir recruteur des ombres,
Escorté d'infâmes soldats,
Ébranlant de mon nom ces longs corridors sombres,
Où seul dans la foule à grands pas
J'erre, aiguisant ces dards persécuteurs du crime,
Du juste trop faibles soutiens,
Sur mes lèvres soudain va suspendre la rime;
Et chargeant mes bras de liens,
Me traîner, amassant en foule à mon passage
Mes tristes compagnons reclus,
Qui connaissaient avant tous l'affreux message,
Mais qui ne me connaissent plus.
Eh bien! J'ai trop vécu. Quelle franchise auguste.
De mâle constance et d'honneur.
Quels exemples sacrés, doux à l'âme du juste,
Pour lui quelle ombre de bonheur,
Quelle Thémis terrible aux têtes criminelles,
Quels pleurs d'une noble pitié,
Des antiques bienfaits quels souvenirs fidèles,
Quels beaux échanges d'amitié,
Font digne de regrets l'habitacle des hommes?
La peur fugitive est leur Dieu,
La bassesse, la feinte. Ah! Lâches que nous sommes
Tous, oui, tous. Adieu, terre, adieu.
Vienne, vienne la mort! Que la mort me délivre!
Ainsi donc à mon coeur abattu
Cède aux poids de ses maux? Non, non. Puisse-je vivre!
Ma vie importe à la vertu.
Car l'honnête homme enfin, victime de l'outrage,
Dans les cachots, près du cercueil,
Relève plus altier son front et son langage,
Brillants d'un généreux orgueil.
S'il est écrit aux cieux que jamais une épée
N'étincellera dans mes mains;
Dans l'encre et l'amertume une autre arme trempée
Peut encor servir les humains.
Justice. Vérité, si ma main, si ma bouche,
Si mes pensées les plus secrets
Ne froncèrent jamais votre sourcil farouche,
Et si les infâmes progrès,
Si la risée atroce, ou, plus atroce injure,
L'encens de hideux scélérats
Ont pénétré vos coeurs d'une longue blessure;
Sauvez-moi. Conservez un bras
Qui lance votre foudre, un amant qui vous venge.
Mourir sans vider mon carquois
Sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leur fange
Ces bourreaux barbouilleurs de lois!
Ces vers cadavéreux de la France asservie,
Égorgée! O mon cher trésor,
O ma plume! Fiel, bile, horreur. Dieux de ma vie!
Par vous seul je respire encor :
Comme la poix brûlante, agitée en ses veines
Ressuscite un flambeau mourant,
Je souffre; mais je vis. Par vous, loin de mes peines,
D'espérance un vaste torrent
Me transporte. sans vous, comme un poison livide,
L'invisible dent du chagrin,
Mes amis opprimés, du menteur homicide
Les succès, le sceptre d'airain;
Des bons proscrits par lui la mort ou la ruine,
L'opprobre de subir sa loi,
Tout eut tari ma vie; ou, contre ma poitrine
Dirigé mon poignard. Mais quoi!
Nul ne resterait donc pour attendrir l'histoire
Sur tant de justes massacres.
Pour consoler leurs fils, leurs veuves, leur mémoire,
Pour que des brigands abhorrés
Frémissent aux portraits noirs de leur ressemblance?
Pour descendre jusqu'aux enfers
Nouer le triple fouet, le fouet de la vengeance,
Déjà levé sur ces pervers?
Pour cracher leurs noms, pour chanter leur supplice?
Allons, étouffe tes clameurs;
Souffre, o coeur gros de haine, affamé de justice;
Toi, Vertu, pleure, si je meurs.
André Chenier
|
|
|
AVENIR DE L'EST
Extraits des chroniques
du Journal de Bône, Constantine, Guelma
Source BNF
|
|
Bône, du 2 au 14 Janvier 1891
LES IDÉES DE M. PAULIAT
Le rapport de M. Pauliat sur l'Algérie a fait beaucoup de bruit. Ce bruit n'est par près d'être calmé, car à M. Pauliat, l'honorable sénateur, doit succéder le non moins honorable député, M. Dugué de la Fauconnerie, ce membre de là droite assez sauvage dans son parti pour faire risette aux Républicains, en désespoir
Tout rempli de sentiments hostiles à l'égard des colons français que soit le rapport de M. Pauliat sous la vague apparence de s'intéresser à leur sort qu'il voudrait améliorer, ce document, par les clameurs qu'il soulève, pourra peut-être apporter quelque profit à l'Algérie.
D'abord il constate avec un regret peu dissimulé ce que la Presse algérienne s'évertue, depuis des années et des années, à prouver à la Métropole le peu de densité de la population française en Algérie et l'écart considérable entre celle-ci, d'une part, et la population indigène ; d'autre part, entre la même et la population étrangère.
Nous voulons être juste en plaçant sous les yeux de nos lecteurs les lignes pleines de bon sens que M. Pauliat consacre à la constatation de ce fait et aux conséquences qu'il pourrait avoir pour l'avenir de l'Algérie.
" Placée à deux pas de la France, dit-il alors que les possessions africaines des autres nations sont à des semaines de navigation de leur Métropole, appelée à être la tète de ligne d'un transsaharien dont la construction peut avoir dans l'Afrique centrale d'incalculables conséquences politiques, il saute aux yeux, dans l'hypothèse de conflits en Europe, que l'Algérie deviendra le point de mire d'attaques qu'il ne serait jamais venu précédemment à l'idée d'aucun gouvernement étranger de diriger contre elle.
" Dans ces circonstances nouvelles, il est de la dernière évidence que l'intérêt primordial de la France est lié comme il ne l'a encore jamais été au développement de la colonisation algérienne, et au développement de cette colonisation par l'intermédiaire de Français venant de la Métropole.
" Le plus simple bon sens, en effet, nous conseille d'avoir au plus tôt, dans nos départements de l'Afrique du Nord, une population en majorité française, et dont la masse compacte et le nombre puissent nous être d'un solide appui dans certaines conjonctures futures que notre pays commettrait la plus grave imprudence de ne pas prévoir. "
Mais, à côté de cette appréciation si sensée, on ne lira pas sans étonnement la suivante concernant les compatriotes de M. Pauliat établis en Algérie et n'ayant, probablement à ses yeux qu'un tort: celui de ne pas taire partie du corps électoral qui l'a élu :
Afin de bien apprécier les conséquences morales du système, il n'y a du reste qu'à observer les différences d'allure existant en Algérie entre les colons d'origine française et ceux d'origine étrangère. Tandis que ces derniers se montrent actifs, tenaces, appliqués et qu'ils réussissent fort vite, les autres, accessibles, en beaucoup trop grand nombre, au découragement, passent tout leur, temps à se répandre en récriminations et en plaintes, et à trouver que la Métropole ne fait jamais assez pour eux. A quelque heure de la journée qu'on les prenne, on les voit toujours préoccupés de quelque secours, de quelque faveur, ou de quelque allocation que leurs représentants devraient solliciter à leur profit, et qu'à moins d'injustice on devra leur accorder.
Où M. Pauliat a-t-il donc été prendre le portrait des colons qu'il nous dépeint ? Est-ce au cours de la caravane parlementaire dont il faisait partie? Les colons français n'ont, sans doute, pas été assez enthousiastes pour un sénateur que colons étrangers et indigènes, afin de se taire bien venir de lui, traitaient en grand seigneur. Il devrait pourtant ne pas ignorer, en consciencieux rapporteur, que la plupart des grands vignobles algériens et tunisiens, sortis comme par enchantement de terre dans une période de moins de dix ans, appartiennent à des colons français. Il devrait aussi savoir que ce sont ces colons français qui, les premiers, ont fait de la plaine de la Mitidja un véritable petit paradis algérien.
Le brave sénateur doit, à coup sûr, faire partie de la Société protectrice des indigènes, ces agneaux sans tâche dont le moindre défaut est d'abhorrer le roumi et de le suriner gentiment sur les grandes routes - il est vrai qu'ils ne surinent point sur les boulevards, à Paris, et cela suffit au philanthrope sénateur - ou, sinon, il est bien digne d'entrer dans ce sacré corps.
Plus on avance dans la lecture du compendieux rapport de l'honorable sénateur, plus on découvre l'ignorance profonde où il se trouve des choses d'Algérie, dont il parle comme un aveugle né des couleurs.
Assurément, c'est chiffres en mains qu'il veut convaincre et ces chiffres, dit-il, c'est aux documents officiels du Gouvernement général qu'il les emprunte. Mais il leur fait dire ce qu'il veut et ne tient nul compte des circonstances de temps, de lieu, de climat, de population différant complètement avec celles de France.
Le grand tort de M. Pauliat et de ceux qui raisonnent comme lui c'est d'être des assimilateurs à outrance. Ce sénateur est d'autant plus blâmable en cela, qu'il se rend parfaitement compte, comme on a pu le voir déjà par un extrait de son rapport, de l'infériorité numérique où nous nous trouvons en présence de la marée montante des populations indigènes et étrangères.
Ainsi, pour ne citer qu'un exemple: au sujet de l'instruction des indigènes, M. Pauliat trouve à déblatérer contre nous à cause du peu d'extension de la langue française parmi les indigènes. Et, à ce propos, il cite des chiffres extraits d'un rapport de M. Labussière, en vertu desquels il résulterait que, sur une population enfantine de 535.389 sujets, 10.415 seulement fréquenteraient nos écoles. Il en conclut :
" Ainsi, malgré vingt années de ce Gouvernement civil qu'on réclamait depuis 1848 comme le seul dont on peut espérer à bref délai la colonisation de l'Algérie et l'assimilation des indigènes, l'administration algérienne n'a encore su organiser l'enseignement primaire des indigènes algériens que de manière à donner l'instruction à 10.415 de leurs enfants, quand ils en ont. A 535.389 qui pourraient et qui, dans l'intérêt de la domination française et de notre politique générale, devraient la recevoir. "
Il n'ajoute point que les familles indigènes sont entièrement réfractaires à l'instruction donnée par les écoles françaises et qu'elles s'empressent, quand elles le peuvent, de se soustraire à l'obligation scolaire qu'on ne peut, en Algérie, mettre à exécution, comme en France, à cause de l'insuffisance des locaux à ce destinés.
Ah ! Si M. Pauliat s'était élevé contre la manie stupide qui nous fait, entretenir de nos deniers des medersas et des écoles primaires indigènes, où l'on enseigne aux jeunes intelligences arabes les versets du Coran et la haine du roumi, alors nous eussions approuvé ses critiques sur un gaspillage de finances destinées à fomenter contre nous l'esprit d'insurrection.
M. Pauliat revient à une saine appréciation des faits lorsqu'il dit :
" Il est, d'autre part, certain, toujours dans le même ordre d'idées, que tout nous ordonne aujourd'hui de faire nos efforts pour gagner à tout prix l'affection et l'estime des indigènes, de façon que, dans la supposition où ils viendraient à s'imaginer un jour que le choix peut leur en être laissé, ils préfèrent de beaucoup la domination de la France à celle de n'importe quel autre peuple, et qu'ils n'hésitent pas, dés lors, une seule minute à rester dans notre parti. "
Quand il ajoute :
" Il y a beaucoup d'idées du même genre et aussi simples qu'on pourrait appliquer avec le plus grand profit en Algérie ; mais elles sont systématiquement dédaignées, comme s'il y avait un parti pris et une sorte de politique consistant à maintenir les indigènes à l'écart de la population française, et à leur rendre impossible tout rapprochement avec elle. "
Là, il s'égare de nouveau, car, si les indigènes se tiennent à l'écart de notre civilisation, ce fait ne peut-être imputé à grief à la population européenne de l'Algérie, mais bien à l'indigène lui-même, dont l'esprit fataliste, routinier et ennemi de tout progrès s'oppose, par la force même des choses et surtout par l'esprit intolérant de sa religion, à toute communion d'idées avec des vainqueurs, d'une religion différente.
On ne tient pas à l'écart les indigènes des bourses nombreuses qui leur sont accordées dans nos établissements d'instruction publique et jusque dans nos écoles du gouvernement en sont la preuve, ce sont eux qui se tiennent volontairement à l'écart.
Une autre preuve. On recrute beaucoup d'indigènes, par l'appât du gain, pour servir dans les rangs de l'armée française. Croit-on qu'au sortir du régiment, après avoir été pendant longtemps mis en contact avec nos us et coutumes, ils abandonnent leur ancienne vie nomade et sauvage ? Non. Ils n'ont qu'un vernis de civilisation, que trois ans de séjour dans leur tribu ou leur douar sera tombé aussitôt. Certes, la vie de garnison en Algérie, où ils sont constamment en contact avec leurs coreligionnaires, n'est pas faite pour les dégrossir. Il n'en est pas moins vrai que l'influence du régiment français, si petite qu'elle soit, ne laisse aucune trace dans la suite sur leur manière de vivre.
Ils prennent nos vices, voilà tout, et perdent un peu de leur sobriété légendaire. Remplacer une vertu par un vice, n'est pas, croyons-nous, le but à atteindre pour la civilisation.
Si M. Pauliat ne prend pas ouvertement la défense des indigènes comme M. Mermeix, ses conclusions sont pourtant à peu près les mêmes.
Il semble faire un crime à la France, de puiser des ressources ; dans la poche de ceux auxquels, en fin de compte, bénéficie surtout la mise en valeur d'un pays où nulle route, nul chemin de fer, nul commerce enfin n'existaient avant l'occupation française.
Le parallèle le plus instructif et le plus propre à rétorquer la plupart des arguments mis en avant par M. Pauliat consisterait à comparer les résultats de la domination française : pendant soixante ans avec ceux de la domination turque.
Jamais l'Arabe ne fut plus malheureux que sous le sabre de ses coreligionnaires. C'est alors surtout que les impôts étaient vraiment arbitraires et vexatoires, car ils entraient tout entiers dans la masse du trésor turc pas une parcelle n'en était distraite pour améliorer la situation matérielle ou morale des sujets.
Il reste un vestige de cette tyrannie en Tunisie, où il y a encore des biens habous. Or, ces habous furent institués sous la domination turque, pour ôter au vainqueur, en les remettant aux mains des confréries religieuses comme, nos biens de mainmorte à l'époque du moyen âge, la possession d'une certaine partie du sol dont le propriétaire pouvait ainsi seulement se réserver la jouissance. Par cet unique moyen le vaincu d'alors se soustrayait à la rapacité du vainqueur.
Aujourd'hui l'indigène n'est pas trop dépossédé de vive force, comme cherche à l'insinuer M. Pauliat. Au commencement de la conquête on a pu lui faire payer les frais de la foi guerre. C'était le droit du vainqueur, les Prussiens, que nous sachions, n'ont pas agi autrement à notre égard en 1870.
Maintenant les contributions de guerre, sauf les séquestres nécessaires pour réprimer les insurrections, n'ont plus aucune raison d'être.
L'état indivis de la propriété indigène, comme nous l'avons trouvée à notre arrivée, a fait surgir de nombreuses difficultés dont quelques-uns ont peut-être profité. Mais la France a porté un remède à cette situation en constituant l'état-civil des indigènes qui a permis d'établir sur des bases plus solides la constitution de leur propriété.
On ne pouvait pas agir plus généreusement à l'égard d'une race vaincue.
Et il n'est peut-être pas, dans toute l'histoire, un pareil exemple de bon traitement employé par le vainqueur au profit exclusif du vaincu.
L'honorable M. Pauliat est donc mal venu de dire à ce sujet :
" On est conduit à constater tout de suite que, comme pour les centimes additionnels des départements algériens, la plus grosse partie des recettes communales ne vient pas des Algériens eux-mêmes : elle est encore faite par les indigènes.
Et ces recettes sont considérablement augmentées, en outre, sous le nom d'octroi de mer, d'une subvention métropolitaine supérieure à 6 millions, laquelle consiste dans une sorte d'aliénation au profit de ces communes d'un certain nombre de taxes et de droits de douanes dont le produit, rationnellement, devrait entrer dans les caisses du Trésor.
II ne sait pas que, précisément, l'octroi de mer pèse sur la population européenne qui consomme la presque totalité des objets soumis à cet impôt.
Aussi la répartition de ce produit, fourni par les colons eux-mêmes, est-elle basée sur des quotités proportionnelles au degré de consommation des populations en présence.
Ainsi l'Arabe et le Kabyle ne consomment pas d'alcool ; la religion le leur défend. Ils participent pourtant, à un certain prorata, à la répartition des ressources procurées par cette liqueur exclusivement consommée par des Européens. De même pour bien d'autres produits, dans le détail desquels nous ne voulons pas entrer pour allonger inutilement la discussion.
Il est curieux, après la constatation faite par M. Pauliat, que ce sont surtout les indigènes qui payent tous les impôts en Algérie et que les populations étrangère et indigène dominent d'une manière tout à fait inégale la population française de l'Algérie, il est curieux, disons-nous, de lui entendre avancer le fait suivant:
" Il y a un fait contre lequel les arguments les plus spécieux et les raisonnements les mieux déduits ne sauraient à aucun degré prévaloir; et ce fait c'est que tous les ans, dans la supposition où il n'y a pas d'insurrection à réprimer, et toutes recettes déduites, l'Algérie coûte à la France de 83 à 84 millions. "
Mais à qui profitent-ils ces 83 à 84 millions - M. Pauliat, dans son habileté à faire parler les chiffres, n'en est pas à un million de plus ou de moins - à qui ?
Mais à ces braves indigènes, dont M. Pauliat déplore le sort, qu'il dit pressurés, tondus jusqu'à la peau ; mais aux étrangers, auxquels les Français, après avoir versé leur sang pour la conquête, versé leurs millions pour la mise en valeur du pays, s'empressent de faire place, dans un fol accès de générosité mal placée.
Et M. Pauliat s'étonne que l'Algérie coûte cher à la France !
A. BLANC
?o?-?o?-?o?-?o?
|
|
|
LE MUTILE N° 191, 1er mai 1921
|
Pour aider la France
Sous ce titre, dans notre N° 118, du dimanche 10 avril, nous avons inséré une lettre de notre abonné et propriétaire M. Michel Malleval, de Damiette.
Nous recevons de M. Mégias, conseiller général d'Oran, la réponse suivante, approbative et sincère, les mêmes sentiments se manifestent d'ailleurs en tout bon Français, - nous reproduisons intégralement et avec plaisir sa lettre.
Nous souhaitons que ces sentiments trouvent un écho chez les nombreux riches.
Oran, le 16 avril 1921.
Monsieur Malleval,
Propriétaire viticulteur à Damiette
Monsieur,
Je viens de lire avec le plus vif intérêt et le plus grand plaisir, l'appel que vous avez adressé sur Le Mutilé de l'Algérie, aux privilégiés de la fortune, en faveur de la Patrie en danger.
Vous estimez, avec un désintéressement qui vous honore, qu'en raison de l'heure angoissante que nous vivons, l'impôt qui vous est demandé est insuffisant pour aider à relever le Pays, et vous préconisez une imposition supérieure, à établir au prorata du superflu des fortunes. Je doute, hélas ! Que vos sentiments élevés puissent faire de nombreux adeptes, l'égoïsme régnant encore ici-bas. Je souhaite, cependant de me tromper dans mes prévisions, le cas échéant, vous aurez droit à la gratitude nationale, car vous aurez, trouvé l'un des remèdes aux maux actuels de la France mutilée
Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous exprimer ici mon admiration la plus sincère pour votre élan patriotique. Il est à souhaiter que les capitalistes qui, actuellement, tiennent dans leurs coffres-forts les destinées de la France, comprennent enfin leur devoir, comme l'ont compris leurs devanciers de 1793; Votre appel est opportun: c'est le cri d'alarme d'un parfait altruiste, doublé d'un bon citoyen digne du beau nom de Français.
Après cet ardent appel, le Parlement devrait comprendre que, seuls, les sacrifices matériels des heureux du sort pourront épargner à notre malheureuse Patrie la honte de la banqueroute et les horreurs de la Révolution.
Que les riches jettent un regard compatissant sur les victimes de la guerre : leurs sacrifices ont été bien plus grands, nul ne le contestera !
Je tiens à vous féliciter bien vivement pour votre généreuse pensée, et je prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.
J. MEGIAS.
Conseiller Général
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
 Envoi de M. Michel Zammit Envoi de M. Michel Zammit
CYCLISME
ANDRE LANGELLA
Vainqueur de la course
BÔNE – MONDOVI et retour
Dimanche dernier s’est déroulé la première épreuve cycliste du Grand Prix des Habitants des Cités Auzas et Chancel, organisé par la JBAC.
Le parcours à effectuer était Bône -Mondovi et retour. Dans le trajet du retour, les coureurs eurent à subir le vent contraire.
André Langella s'est vu attribué la prime au premier coureur arrivant à Mondovi.
Voici d'ailleurs les résultats techniques de cette course qui a été suivi avec un grand intérêt par les nombreux amateurs de cyclisme.
1. André Langella (JBAC-
2. Pace (JBAC) -
3. Géramita (JBAC) -
4. Zammit et Bolari (ASB) -
6. Sant (ASB) -
7. Gardoui (Jemmapes) -
8. Pimila (ASB) -
9. Caristo -
10. Molence -
11. Mélio -
12 Florio
| |
LES ANNALES ALGERIENNES
De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)
Envoyé par Robert
|
|
Evénements à Bône en 1833
Tout avait été tranquille dans les environs de Bône depuis l'expédition des Ouled-Attia. Les Arabes venaient de tous côtés au marché de cette ville, et toutes les impressions qu'ils y recevaient étaient favorables au général d'Uzer et à l'autorité française. Ce général était tout à la fois craint et aimé des indigènes, qui savaient que, quoiqu'il les traitât avec une paternelle douceur, il ne laisserait jamais une injure ou une injustice impunie.
Au mois de septembre 1833, il eut occasion de faire une nouvelle et frappante application de son système : les Merdès, tribu très nombreuse, qui habite sur la rive droite de la Mafrag, à l'est de Bône, se permirent de piller quelques marchands qui se rendaient dans cette ville. Le général les somma de lui faire réparation de cette offense. Il leur envoya même, pour les engager à ne pas le forcer à recourir aux armes, dix de leurs compatriotes qui servaient à Bône dans ce qu'on appelait les Stages. Les Merdes furent sourds à ses remontrances; mais il fut si évident qu'ils mettaient le bon droit contre eux, que les dix envoyés du général, quoique de leur tribu, revinrent à Bône, ne voulant pas s'associer à leur injustice.
Obligé d'employer la force, le général d'Uzer marcha contre les Merdès. Arrivé sur la rive gauche de la Mafrag, au marabout de Sidi-Abdel-Aziz, il fit de nouvelles sommations, qui ne furent pas plus efficaces que les premières. Ayant ainsi épuisé tout moyen de conciliation, il lança sur l'autre rive de la Mafrag toute sa cavalerie, qui en un clin d'oeil enfonça les rebelles, et leur enleva leurs troupeaux. Ils vinrent alors demander leur grâce à genoux. Le général d'Uzer la leur accorda, après une sévère réprimande. Il eut la générosité, peut-être excessive, de ne retenir, du butin qu'il avait fait sur eus, que ce qui était nécessaire pour indemniser les marchands qui avaient été pillés. Depuis cette époque, les Merdès, dont une faible partie était déjà sous notre domination, ne donnèrent plus de sujets de mécontentement.
Dans cette expédition, le capitaine Morris, du 5ème régiment de chasseurs d'Afrique, eut un combat singulier avec un Arabe d'une taille gigantesque. Les deux adversaires ayant été démontés dans le choc, se prirent corps à corps : le Français sortit vainqueur de cette lutte acharnée, où l'Arabe laissa la vie.
|
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LI COCHON, LA CHIVRE Y LI MOTON
[FABLE IMITÉE DE LA FONTAINE]
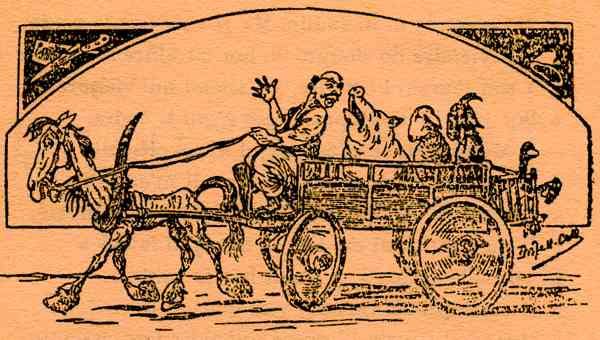
On chivre, one p'tit moton, aie on cochon smin
Monti sor one charite, son barti bor l'marchi,
Cit pas por rigoli, qui son fir cit chemin
Ma barc' qui son patron, y s'en alli sarchi
Quarqu'on qui vo achetir la chivre y son cochon
Ou bian on zarbicot, qui chiera son moton.
Li cochon qu'il a por, y son beaucoup crier
Y blorait mon zami, comme si ji souis frapper.
La chivre y li moton y son risti tranquille
Y pense qui bor bromner, y marcher bor la ville,
Y ni pu pas comprendre, bourquoi fir tot cit bruit
Quand barsonne y son fir, jami di mal bor loui.
Li Kabyle qui conduit al marchi la charrite
Y loui dit : - " Quis qui ci, borquoi ti casse la Lite ?
Barqua inal babac, y fot moi la paix,
Ou bian ji trape li fouet, bor j'ti fot bon raclée.
Rigarde cit moton, y n'fir pas di scandale
Ji fir qui,squi ji vo, y si fot pas mal.
Y di rian, son contan ! - Il y blous qui coillon,
Blous qui bite ma barole, qui répond li cochon ;
Barc' qui ni couni pas, quisqui va fir bor loui ?
Ma si voir li coteau, qui cope la tite di loui,
Y criera blous qui moi. Ji crois qui cit chivre
Y son kif kif to l'monde, tos bisoan bian vivre.
Li moton son pensi, sa laine ji va copi
La chèvre qu'one pitit, son li y va buvi ?
Pit-itre y son rison. Ma moi ji couni bian,
Ji soui bon por mangi, por fir bon boudan
Soucisse y soubressade, quisqui mange li Franci.
Fini ma mison ! ! Son fini bian bouffi !
Douman ji soui moru, voilà bourquoi ji plore.
Cit cochon son rison ; il an a bon tite.
Barc' qui voit. qui sa grisse, a li zôtre y brofite.
MORALE
Borquoi bisoan crier lorsqui ti va crivi :
Si ti plor, ti a por, jami ti po sangé ;
Pas bisoan .di pensi li mal qui va rivé ;
Millor qui ti t'amouse, avant qu'ti soui mangi.
|
|
La Parodie du Cid
Envoyé par M. Michel Parent
|
|
| La présentation du Drapeau
Envoyé par M. Raoul Pioli
|
Ayant reçu un beau texte concernant la présentation du drapeau, je viens de l'illustrer avec des symboles que nous connaissons bien et qui nous sont chers.
Je n'ai pas réussi à trouver l'auteur du texte d'origine qui reste inconnu pour l'instant.
M. Raoul PIOLI
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
|
|
PHOTOS DE VIE BÔNOISE
Envoyé par M. divers donateurs
|
Envois de M. Daniel Bonocori
 La reddition d'Abd El Kader
La reddition d'Abd El Kader
 Une rue de Bône à Antony
Une rue de Bône à Antony
Envois de M. Charles Ciantar
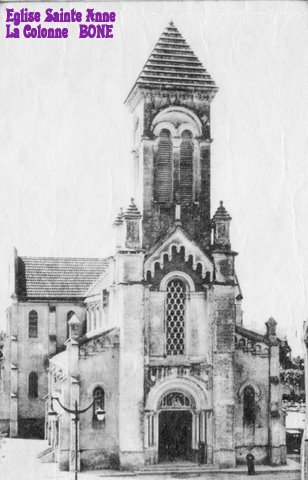
 L'Eglise Sainte-Anne de Bône
L'Eglise Sainte-Anne de Bône
 La Procession de Sainte-Anne
La Procession de Sainte-Anne
|
|
|
CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS
DE BARBARIE (1857)
PAR M. L'ABBE LÉON GODARD
ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE
AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES
Dominare in medio inimicorum tuorum.
Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.
A M. L'ABBÉ SUCHET
VICAIRE-GÉNÉRAL D'ALGER,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, ETC.
VÉNÉRABLE AMI,
Permettez-moi de vous dédier ces pages. Vous y retrouverez quelques-unes des pensées que nous échangions, durant les douces soirées d'Alger, au palais épiscopal, et encore au feu du bivouac, durant les nuits étoilées, dans les plaines sans bornes du Sahara,
Daignez agréer, vénérable ami, ce témoignage de mes sentiments profonds d'attachement et de respect,
LÉON GODARD, PRÊTRE.
PRÉFACE
Tous les faits recueillis dans ce livre et qui ont rapport aux corsaires, aux esclaves et aux martyrs, sont parfaitement authentiques. Outre un certain nombre de relations ou procès-verbaux officiels de rédemption publiés par les ordres religieux voués au rachat des captifs, j'ai consulté les archives des révérends pères capucins de Tunis, l'Histoire de Barbarie et de ses corsaires par le père Dan, Topografia de Argel par D. Haedo, Alcune memorie d'Italia par Mgr Luquet, évêque d'Hésébon, etc.
Comme je destine ces récits particulièrement aux jeunes gens, j'ai cru devoir leur en faciliter la lecture en présentant la narration sous forme de dialogue. Ce dialogue cache une action peu sensible et très secondaire, qu'il est impossible de confondre avec la partie purement historique, dont elle est, pour ainsi dire, l'encadrement. Dom Gervasio Magnoso, que je fais parler dans cet ouvrage, est un vénérable religieux mort en 1851, après avoir vécu environ un demi-siècle en Algérie. J'espère que les paroles que je lui prête ne feront pas injure à sa mémoire.
Il est sans doute inutile d'ajouter que je n'ai point voulu écrire ici l'histoire complète de l'esclavage des chrétiens en Barbarie. Ce volume en est une page détachée, mais trop peu connue, si je ne me trompe, et dont la plus grande partie n'existait pas encore en français.
INTRODUCTION
C'était au mois de mai 1850. Le soleil disparaissait au couchant, et enflammait doses derniers rayons la mer qui baigne le pied d'Alger. Les ombres des hautes collines de la Bouzaréa commençaient à envahir la blanche ville des corsaires. La brise et les flots se taisaient. Dans le calme du soir, les cloches et les muezzins invitaient à la prière, chrétiens et musulmans.
Non loin de la porte Bab-el-Oued, sur la terrasse d'une maison mauresque, plusieurs personnes, qui venaient respirer la fraîcheur de la nuit, s'agenouillèrent en ce moment et récitèrent pieusement l'Angélus. On distinguait d'abord parmi elles un moine vénérable, trinitaire, d'origine espagnole. Il habitait Alger depuis cinquante ans, et il en avait passé une partie su service des esclaves chrétiens dans les bagnes. Il était l'hôte et l'ami de cette maison.
Le propriétaire, M. Morelli, négociant français, avait acquis une jolie fortune sans ternir l'éclat d'une probité héréditaire ; il consacrait maintenant ses loisirs à l'étude de l'histoire et aux œuvres de piété. Mme Morelli était une Italienne distinguée par l'élévation de son esprit et la noblesse de ses sentiments religieux.
Vous voyez auprès d'eux les trois enfants qui composent leur famille : Alfred, engagé dans la marine ; Carlotta, jeune fille qui présente le fidèle reflet des vertus de sa mère; et Marie, cette petite enfant qui joue à l'angle de la terrasse avec Fatma la négresse.
Chaque soir les mêmes personnes se trouvaient ainsi réunies. Alfred passait à cette époque un congé de trois mois au sein de sa famille, et il n'était pas le moins attentif aux récits du vieux moine. Une blanche barbe couvrait la poitrine du père Gervais, ou dom Gervasio. Dans cette poitrine battait un cœur de feu; sous ce front chauve virait une imagination que l'âge et les fatigues avaient calmée sans doute, mais qui éclatait encore au réveil des souvenirs. Fatma n'était pas une esclave; et si elle remplissait ordinairement la charge de servante, on la traitait pourtant avec une bonté, unie familiarité qui la plaçaient au-dessus de cette condition. C'est qu'elle avait un jour sauvé d'un péril imminent la vie de Carlotta.
" Quelle splendide soirée! dit M. Morelli. Comme l'air est frais et pur ! Le bleu du ciel va s'étoiler : je me croirais à Naples.
Je ne contemple jamais le magnifique panorama d'Alger, cette rade dont la courbe est si belle, ces riches coteaux où les villas brillent au milieu des bocages, cette mer sillonnée de navires, enfin ce vaste horizon des montagnes kabyles, sans ressentir une intime joie de ce que la Providence nous donne un tel pays.
Tu es jeune, Alfred, reprit M. Morelli; tu verras se développer ici un avenir fécond en grandes choses pour la France et l'Algérie. Dieu a ses desseins quand il livre à une nation comme la nôtre l'entrée d'un continent immense, une terre des plus fertiles, la lisière importante d'une mer où se joueront encore les destinées du monde. Ce n'est pas sans but qu'il installe les fils des croisés au milieu des empires musulmans.
Vous tressaillez de bonheur aux perspectives de l'avenir, et je partage vos espérances, ô mes amis, dit le vieux moine. Mais n'oubliez pas le passé, lorsque vous mesurez l'immense bienfait de la conquête d'Afrique pour la France et pour la civilisation. Ah ! Quand on a vu comme moi les souffrances horribles des chrétiens sur ces plages, les humiliations de l'Europe inclinée sous le cimeterre, les triomphes sauvages des sectaires musulmans, l'impiété, la dépravation des renégats, le sang des martyrs, les larmes et l'agonie des esclaves, on ne sait pas, mes amis, s'il faut bénir le Ciel pour les promesses de l'avenir autant que pour la délivrance du passé.
Mon révérend père, répondit Carlotta, depuis que j'ai entendu vos premiers récits des douleurs des pauvres captifs, j'y pense bien souvent sans pouvoir retenir mes larmes.
Et moi, ma soeur, je sens la colère me monter au front, le sang bouillonner dans nies veines, lorsque je pense en rencontrant ces vieux Maures, dont le regard fourbe n'ose s'arrêter sur le mien. Voilà, me dis-je, un ancien bourreau de mes frères ! Mes mains se crispent, je voudrais me venger. Tenez, ou m'a fait connaître un homme qui s'est longtemps livré à la course : Mohammed-Ben-Abd-Allah, ce mendiant borgne et en guenilles dont la flûte criarde nous déchire le tympan à Bab-el-Oued ; sa vue me fait mal, je le hais...
Alfred, dit alors sa mère, je conçois ce premier mouvement de la nature; mais il n'est pas chrétien : laisse à Dieu le soin de la vengeance ; tu vois qu'elle s'accomplit. Une guerre légitime a mis fi n à cette odieuse piraterie. Chacun de nous doit pardonner, et rendre le bien pour le mal. Je te conseille de faire une aumône à ce malheureux, lorsque tu passeras devant lui avec la tentation de le haïr.
Alfred eut besoin d'un instant pour se pénétrer des paroles de sa mère. La conversation continua sur la question des corsaires, et l'on pria le père Gervais de raconter comment l'ordre de la Trinité pour la rédemption des captifs avait été fondé.
La conversation s'étendit ensuite sur les pères de la Merci et sur le zèle que l'Église catholique a déployé de tout temps pour le rachat des esclaves. On rappela les grands travaux des franciscains à la côte d'Afrique, le martyre de Bérard de Corbie et de ses compagnons, et celui des autres moines du même ordre envoyés au Maroc sous la conduite de Daniel de Belvederio. Le père Gervais rendit hommage au bienheureux Raymond Lulle, du tiers ordre de Saint-François, et confesseur héroïque de la foi à Tunis, à Bône, à Bougie ; il exalta le dévouement des martyrs Antoine Neyrotti, de l'ordre de Saint-Dominique, Hermengaud et Sérapion, des pères de la Merci. C'était faire une rapide esquisse de l'histoire du christianisme sur les côtes de Barbarie avant les conquêtes des Turcs, au XVI° siècle. Mais comme la plupart de ces faits sont connus ou du moins faciles à trouver dans les auteurs ecclésiastiques, je ne juge pas à propos de les rapporter en détail. Dom Gervasio promit à ses hôtes de poursuivre le lendemain son sujet.
Nous recueillerons attentivement ses paroles.
SOIREES ALGERIENNES
PREMIÈRE SOIRÉE
Période turque. - Les Maures expulsés d'Espagne.
Les Turcs. - Les corsaires.
A la chute du jour, on était, selon la coutume, réuni sur la terrasse, et, tout en savourant le thé que Fatma venait de servir, on admirait le spectacle toujours nouveau de la mer et du panorama d'Alger. Un gros navire était en vue, toutes voiles dehors, et il ressemblait de loin à une cathédrale du moyen âge balancée sur les flots. Des barques légères se hâtaient vers le port, et glissaient comme des goélands aux longues ailes sur la mer endormie.
" Révérend père, dit M. Morelli, comment donc les Turcs ont-ils fait d'Alger une puissance maritime redoutée de l'Europe ?
Madame, répondit le trinitaire, pour comprendre la fondation des régences turques à la côte d'Afrique et l'accroissement prodigieux de la piraterie qui en résulta dans la Méditerranée, il faut se rendre compte de la situation de la Barbarie à l'aurore du XVI° siècle.
Le royaume de Grenade était, depuis la fi n du XIIIe siècle, le seul État musulman qui subsistât encore en Espagne, lorsque Ferdinand le Catholique et Isabelle unirent par leur mariage, en 1479, les couronnes de Castille et d'Aragon. Ferdinand résolut d'anéantir définitivement la puissance du Croissant dans la Péninsule. Profitant des luttes intestines qui avaient réduit AbdAllah, roi de Grenade, à une extrême faiblesse, il l'assiégea dans cette capitale; elle se rendit le 4 janvier 1492, et Abd-Allah se retira à Fez, tandis que des princes de sa famille restaient en Espagne, après avoir reçu le baptême.
Un grand nombre de Maures émigrèrent dès lors en Afrique. Cependant beaucoup d'entre eux seraient restés en Espagne, où les intérêts matériels les fixaient, si on leur eût accordé la liberté. Mais Ferdinand s'aperçut bientôt que leur présence était un danger pour l'État, du moins tant qu'ils n'abjureraient pas le mahométisme. Ils formaient une partie considérable de la population, dissimulaient mal des haines qui se transformaient en sourds complots, et qui eussent pu recevoir d'Afrique une assistance fort à craindre pour une conquête récente et mal affermie. Il n'y avait que deux moyens de conjurer le péril : convertir les Maures ou les expulser. La religion, l'humanité, la politique voulaient qu'on eût d'abord recours au premier. Le fameux Ximenès de Cisneros, archevêque de Tolède, et Fernando de Talavera, métropolitain de Grenade, amenèrent une foule de ces musulmans au christianisme. Leurs succès mêmes irritèrent les plus fanatiques, et des séditions éclatèrent. De faux convertis ne se servaient du crédit qu'ils obtenaient auprès des chrétiens que pour les trahir. Bref, la puissance et la nationalité de l'Espagne étaient en danger. Ferdinand dut se résigner à prononcer l'expulsion des Maures qui refuseraient d'embrasser l'Évangile, et les exilés cherchèrent un refuge en Afrique. L'Espagne sacrifiait des avantages temporels à d'autres d'un ordre plus élevé. L'installation des Maures andalous en Afrique était un bienfait pour les Arabes et les Kabyles. L'agriculture et l'industrie en profitèrent.
On assure, interrompit M. Morelli, qu'on doit à ces Maures la culture soignée des oliviers et des mûriers. Ils ont planté les délicieux jardins qui entourent plusieurs villes de la côte. Les Grenadins établis à Cherchell s'y livraient avec succès à l'éducation des vers à soie. Ils réparèrent un peu les plaies faites au pays par le règne des Arabes. Partout où l'Arabe a gouverné, du Maroc au golfe Persique, la terre a été déboisée et s'est changée en désert.
Et pourtant, reprit dom Gervasio, les Arabes se montrèrent jaloux, défiants, tyranniques envers ces coreligionnaires étrangers. Ils ne leur ouvrirent qu'un certain nombre de villes, et leur fermèrent l'intérieur du pays. Cette circonstance, ajoutée à la haine qui animait les exilés contre l'Espagne, jeta naturellement ceux-ci dans la piraterie. Ils assaillirent sans relâche le territoire espagnol, et enlevèrent aux navires chrétiens toute sécurité dans ces parages.
L'Espagne se voyait donc forcée de poursuivre les Maures au delà même du détroit et jusque dans leur exil. Ce fut pour aider à la répression de leurs courses, que le duc de Médina Sidonia s'empara de Mélilla, sur la côte du Maroc, en 1497, et don Diégo de Cordoue de Mers-el-Kébir, en 1505. Ces mesures étaient insuffisantes, et le coup d'œil d'aigle du cardinal Ximenès embrassa de plus vastes projets.
Le célèbre moine, entré dans les conseils de la couronne, travaille à la réforme de son ordre, voyage en mendiant, et lorsqu'il découvre des rives de l'Espagne les côtes de l'Afrique, son zèle s'enflamme, et il a comme un pressentiment de la mission qu'il doit y remplir.
Pardonnez à un Espagnol de vous parler de Ximenès avec orgueil. Je passe sous silence, pour arriver à ce qui regarde l'Afrique, les immenses travaux du cordelier archevêque de Tolède, comme savant, comme ministre, comme diplomate et arbitre entre les rois, comme réformateur dans l'Église et dans l'État. Septuagénaire, il se fait général d'armée: il est à la tête d'une croisade qu'il arme à ses frais pour la conquête d'Oran. Ses vues élevées n'ont pas même été comprises de Ferdinand. Il veut, lui, ce que la France a voulu depuis pour elle-même et pour la civilisation, asseoir la puissance chrétienne en Afrique, et faire de la Méditerranée un lac espagnol. Il brise toutes les volontés qui s'opposent à la sienne ; il méprise les sarcasmes lancés au religieux qui passe des revues à cheval, et il fait voile de Carthagène le 16 mai 1509. Il préside la nuit au débarquement, et son armée se montre en bon ordre, dès le point du jour, aux Maures étonnés. La croix archiépiscopale de Ximenès marche en avant ; elle porte sur une banderole flottante les paroles qui annoncèrent autrefois à Constantin l'empire du monde : IN HOC SIGNO VINCES, Tu vaincras par ce signe. Cette devise se répète sur tous les drapeaux, et la croit brille dans tous les rangs. La bataille s'engage. Ximenès, comme un autre Moïse, se prosterne en prière, et on lui apporte bientôt la nouvelle de la victoire. Les Maures sont battus, la ville est prise; le moine y entre en répétant les paroles du prophète : Non nobis Domine, non nobis.. Ce n'est point à nous, Seigneur, non ce n'est point à nous, c'est à votre nom qu'en appartient la gloire. Mais il verse des larmes à la vue des cadavres ennemis, et quand Pierre de Navarre, son lieutenant, lui répond qu'après tout ce sont des infidèles :
" Oui, dit le vieillard; mais on m'enlève moitié de la victoire; car je voulais les conquérir à Jésus-christ. " L'Espagne suivit quelque temps la politique de Ximenès. Elle s'empara immédiatement de Bougie et de Tripoli. Tunis, Alger, Mostaganem, Arzew, se reconnurent vassales, et promirent de renoncer à la piraterie. Mais, la première terreur passée, les courses recommencèrent, et Pierre de Navarre parut avec une escadre devant Alger, que Ferdinand voulait punir. Les Algériens s'humilièrent, rendirent au roi, comme gage de soumission, cinquante, esclaves chrétiens, et s'engagèrent à payer un tribut pendant dix années. Mais, pour plus de garantie, les Espagnols bâtirent une forteresse sur le rocher où s'élève le phare d'Alger, qu'ils nommèrent El Pegnon de Argel. Il est maintenant compris dans le môle. La ville était ainsi tenue en respect, car l'artillerie espagnole pouvait battre ses remparts.
Eh bien ! Madame, tout ce préliminaire vous explique dans quelles circonstances les Arabes appelèrent les Turcs à leur secours. Les points de l'occupation espagnole se multipliaient. Ils étaient parfaitement choisis en vue d'une grande conquête, les officiers français le reconnaissent, et les dynasties musulmanes qui régnaient alors des Syrtes au détroit de Gibraltar, épuisées par les discordes intérieures, se sentaient menacées dans leur existence. C'est à ce moment que les fameux corsaires Baba-Aroudj et Kheïr-ed Din, nommés en France les frères Barberousse, viennent lutter contre les Espagnols en se rendant aux vœux des Arabes. Ils se présentent comme auxiliaires, et ne tardent pas à s'imposer comme souverains. Tous les marins savent leur étonnante histoire. "
Alfred, cédant à cette invitation, n'hésita point à dire les aventures qui avaient tant de fois échauffé sa jeune imagination.
" Les frères Barberousse sont nés d'un renégat sicilien établi à Mitylène, l'ancienne Lesbos, et d'une Espagnole andalouse. Leur père, nommé Yacoub, quitta la profession de potier pour le métier de corsaire, et il éleva pour la mer ses quatre fils, Élias, Isaac, Aroudj et Kheïr-ed-Din. On dit que du nom d'Aroudj ou Baba-Aroudj, les Européens ont fait Barberousse; d'autres veulent que l'on ait surnommé Barba-Rossa les deux derniers frères, à cause de la couleur de leur barbe.
Quant au nom de Kheïr-ed-Din, interrompit le père Gervais, il signifie en arabe le bien de la religion. Les Européens prononcent Cheredin ou Hariadan.
Dans mon enfance, le nom de Barberousse me faisait peur, dit Carlotta, et aujourd'hui encore il me fait frissonner.
Quoi qu'il en soit, reprit Alfred, dans une rencontre avec les chevaliers de Rhodes, Élias fut tué et Aroudj fait prisonnier. Kheïr-ed-Din offrit en vain mille drachmes pour sa rançon. Alors le jeune captif s'attira la confiance de ses maîtres par son caractère et ses talents; puis, un jour, il s'échappa et réussit à rejoindre Kheïr-ed-Din. Les deux frères, avec un seul brigantin, se rendirent bientôt redoutables, et, en 1504, le bey de Tunis s'estima heureux de leur ouvrir le port de la Goulette, à la condition qu'il prélèverait la dîme sur les captures. Ils s'emparèrent les années suivantes d'un très grand nombre de navires espagnols et italiens. Leur flottille se composait de douze navires, dont huit leur appartenaient. Kheïr-ed-Din commandait en l'absence d'Aroudj.
Bougie, tombée aux mains de l'Espagne, invoqua leur assistance. Deux fois ils furent repoussés ; Aroudj perdit même un bras à la première attaque. Ils cherchèrent un point d'appui au voisinage de cette ville, et furent accueillis avec joie par les habitants de Djidjelli, qu'ils enrichirent promptement, et qui par reconnaissance les proclamèrent souverains de la ville et du territoire.
La mort de Ferdinand le Catholique, en 1516, vint exciter encore l'ambition des deux frères, et elle détermina les Barbaresques à de nouveaux efforts contre les Espagnols. Alger s'était placée sous le commandement de Sélim-Eutemi, cheik d'une famille puissante de la Mitidja. Il n'osait pas attaquer la forteresse espagnole des îlots Beni-Mezegren, en face de la ville, et il sollicita le secours d'Aroudj. Celui-ci comprend aussitôt qu'un nouvel horizon se déploiera devant lui s'il se rend maître d'Alger. Il accorde son concours, et se débarrasse d'abord d'un puissant rival, le corsaire Car-Hassan, qui s'est installé à Cherchell. Il entre ensuite dans Alger, où la troupe de ses Turcs et de ses renégats force les habitants à subir leurs caprices. Aroudj fait étrangler le faible Eutemi, se déclare souverain, décapite ceux des Algériens qui désapprouvent son usurpation, et gouverne par la terreur. En septembre l516, il bat une armée espagnole envoyée contre Alger sous la conduite de Francisco de Vera, et dont les débris furent presque anéantis par une horrible tempête ; il défait et chasse les Arabes partisans du fils d'Eutemi. Son règne s'étend rapidement sur Blida, Médée, Miliana, Ténès et Tlemcen. Mais il indisposa les habitants de cette dernière ville par sa cruauté : il fit pendre par la corde de leurs turbans, aux piliers du Méchouar ou de la citadelle, le roi et ses sept fils, et il fit noyer les autres membres de la famille dans un étang, prenant plaisir lui-même, comme le dit Marmol, à leurs postures et à leurs grimaces. Les Arabes s'unissent aux Espagnols d'Oran pour délivrer Tlemcen. Aroudj, pressé dans le Méchouar, traverse les lignes ennemies et fuit vers Alger. Mais on le poursuit, malgré les trésors qu'il sème sur la route pour ralentir ses adversaires ; il est atteint sur les bords du Rio-Salado ou l'Oued-el-Meleh (la rivière de sel) et frappé au cœur d'un coup de pique ; on envoie sa tête à Oran, et son caftan sert à confectionner une chape d'église.
Son frère Kheïr-ed-Din s'empressa de consolider son pouvoir en gagnant les marabouts les plus renommés, et en s'abritant sous la suzeraineté de Constantinople, qui lui reconnut le titre de bey. Il fortifia le gouvernement ou l'odjack organisé par son frère, comprima les Arabes, fut délivré par une tempête d'une expédition envoyée contre lui par Charles-Quint, rasa le pegnon d'Alger, et fonda définitivement la puissance maritime de la régence.
Trente mille esclaves chrétiens travaillèrent au port et aux fortifications de la ville. De nouvelles captures arrivaient, pour ainsi dire, sans interruption; c'étaient quelquefois des populations entières qui se trouvaient jetées en esclavage. Ainsi les habitants de Mahon laissent un soir la flotte de Kheïr-ed-Din, qu'ils ont prise pour celle de Charles-Quint, entrer dans leur port. Le lendemain, huit cents Mahonnais montaient à bord des galères algériennes, et venaient grossir la multitude des captifs qui gémissaient dans les fers ou s'épuisaient de fatigues sous le bâton.
Kheïr-ed-Din, appelé par Soliman, sultan de Constantinople, à commander en chef la marine turque, éprouvée par de grands échecs dans ses rencontres avec les forces de Charles-Quint et du fameux amiral vénitien André Doria, laissa le gouvernement d'Alger au renégat sarde Hassan Agha, et partit à la tête de quarante galères. Après divers exploits sur les côtes d'Italie et dans l'archipel grec, il ravit Bizerte, la Goulette, Tunis, aux princes hafsides, qui avaient essayé de nuire à ses projets ambitieux.
Mais Moulê-Hassan, dépossédé, appelle Charles-Quint. L'empereur dirige en personne une flotte de quatre cents navires, et débarque, comme autrefois Louis, sur les rives de Carthage. Les Turcs évacuent la Goulette. Kheïr-ed-Din veut mettre à mort vingt-deux mille esclaves chrétiens qui sont renfermés dans Tunis. Ses conseillers le détournèrent d'une si monstrueuse atrocité. Le lendemain, il était vaincu et s'enfuyait du côté de Bône, tandis que les esclaves récoltés dans la citadelle facilitaient aux Espagnols la prise de la ville. Charles-Quint livra Tunis au pillage. Il délivra les captifs, embrassa les plus vieux, leur fi t donner à tous des vêtements et les moyens de regagner leur pays. On célébra solennellement dans le camp la fête de saint Jacques, patron de l'Espagne, et l'empereur se rembarqua sur le vaisseau amiral avec le nonce du pape et l'évêque de Grenade. C'était en 1535.
Par un traité les Espagnols gardaient la Goulette, et le prince Hafside Moulê-Hassan rentrait dans Tunis, à la condition de délivrer sans rançon tous les esclaves chrétiens du royaume, de laisser libres le commerce et l'établissement des Européens à la côte, avec leurs églises et leurs monastères; enfin Tunis ne s'allierait point aux corsaires, et paierait une redevance annuelle à la couronne d'Espagne. Barberousse parvint à Alger par terre : il y fut rejoint par sa flotte, se ravitailla, et fi t encore du mal aux chrétiens avant d'aller mourir à Constantinople, en 1547, au milieu de honteuses débauches.
La puissance turque était complètement fondée à Alger; et nul ne pensa plus à l'ébranler depuis une dernière et malheureuse tentative faite par Charles-Quint, en 1541. Une flotte de plus de cinq cents navires, montée par douze mille matelots et vingt-deux mille hommes de troupes, vint alors attaquer Hassan-Pacha, successeur de Kheïr-ed-Din. Il avait convenablement fortifié la ville et se tenait prêt à une défense vigoureuse.
Le débarquement des Espagnols s'opéra sur la plage à gauche de l'Harrach. L'armée investit la ville du côté de l'est, en gravissant les coteaux de manière à tourner la Casbah pour redescendre sur Bab-el-Oued. Ce mouvement avait lieu le 25 octobre. Dans la nuit une furieuse tempête se déchaîne, les vaisseaux chassent sur leurs ancres, ils s'entrechoquent, les câbles se rompent, la mer se couvre des débris d'un immense naufrage. L'armée de terre lutte avec peine dans les ténèbres contre la violence de l'ouragan. Au lever du jour les Algériens l'attaquent dans ses lignes; la défense est héroïque; elle refoule les assaillants dans la ville, de telle sorte que le chevalier français Ponce de Balagner, qui tenait déployé l'étendard de Malte, vint planter son poignard dans la porte Bâb-Azoun. La brume qui touerait la mer se dissipe; Charles-Quint et l'armée reconnaissent tout le désastre de la flotte, et sont forcés de rejoindre au cap Matifou les vaisseaux échappés à l'orage. L'Europe était vaincue dans Charles-Quint, non par les Turcs, mais par les éléments de la nature, ou plutôt par les mystérieux décrets de la Providence. La chrétienté perdait l'espoir de réussir où le géant venait d'échouer : elle se résignait en quelque sorte à s'humilier devant un repaire de brigands, et à leur acheter le droit de navigation et de commerce.
L'Espagne lutte encore quelque temps pour garder les points qu'elle occupait sur le littoral, pour soutenir ses alliés musulmans et même étendre ses conquêtes. En 1551, son allié Hassan perdit Tlemcen, que le pacha Salah-Raïs réunit à la régence d'Alger. La même année, cependant, le vice-roi espagnol de Sicile et André Doria enlevaient la ville tunisienne d'Africa au corsaire Dragut, qui avait hérité de la renommée des Barberousse. Dragut prétendit que, l'Espagne violait la trêve signée entre elle et la Porte. Le sultan prit parti pour le pirate, en s'emparant de Tripoli sur l'ordre de Malte. Dragut faillit être anéanti, peu auparavant, au détroit qui sépare du continent l'île de Djerba; mais il réussit à s'enfuir eu faisant élargir en dix jours, par deux mille esclaves chrétiens, le canal trop étroit pour ses galères.
En 1553, les Espagnols abandonnent Africa, on la garnison ne peut vivre ; Salah-Raïs leur prend Bougie deux ans plus tard, et Djerba retombe au pouvoir des Turcs en 1560. En 1570, Aluch-Ali, ou Ochali, pacha d'Alger, chasse de Tunis le roi Hamida, et les Espagnols ne reprennent cette capitale que pour y succomber, en 1574, sous les efforts du capitaine turc Sinan-Pacha. Ce renégat leur enlève en même temps la Goulette et Bizerte. Outre la ville d'Oran, qu'ils gardèrent jusqu'en 1792, ils ne possèdent plus en Afrique, depuis Philippe II, que des présides ou petites places isolées, telles que Ceuta et Mélilla, sentinelles avancées qui veillent dans l'intérêt de l'Espagne, mais sans menacer le Maroc. La garnison y est emprisonnée, comme les Français le furent assez longtemps eux-mêmes en plusieurs places de la côte, au début de la conquête. Elle fait encore chaque jour le coup de feu contre les Kabyles, qui viennent l'inquiéter derrière ses remparts.
L'Espagne donc répudie, sous Philippe II, la politique de Ximenès ; soit défaut d'intelligence, soit découragement, elle renonce à l'occupation, à la colonisation de l'Afrique, et se borne à protéger son littoral contre les corsaires. Tout au plus va-t-elle les surprendre quelquefois dans leurs ports. Mais les échecs partiels qu'ils éprouvent les laissent vraiment maîtres de la Méditerranée.
La bataille de Lépante, gagnée le 7 octobre 1571, par don Juan d'Autriche, et qui peut-être sauva l'Europe, servit la cause des corsaires africains en leur permettant de s'ériger en souverains et d'agir avec indépendance sans craindre la Porte, dont la suzeraineté n'était plus que nominale. Leurs succès en mer, les troubles religieux de l'Europe, attirent à eux une foule de renégats de toute nation. L'appât du gain, l'attrait d'une vie de hasards, portaient des aventuriers à faire la course avec les raïs sans même embrasser le Coran.
Je suis surprise, dit Mme Morelli, qu'un tel état de choses ait pu se constituer. Que faisait donc la France alors ? N'avait-elle donc pas un roi chrétien, un roi chevalier ? François 1er, Henri IV, ont toléré ce brigandage ?
Madame, répondit le père Gervais, la France, ordinairement si grande et si généreuse, la France parut oublier alors ses nobles traditions. François 1er, foulant aux pieds les intérêts de la civilisation et du christianisme, se préoccupe uniquement d'abaisser l'Espagne et de satisfaire ses rancunes contre Charles-Quint, auquel les électeurs allemands ont donné de préférence la couronne impériale. Il met l'Europe, on peut le dire, à deux doigts de sa perte, en faisant alliance contre la maison d'Autriche avec le sultan de Constantinople et avec Barberousse, le roi d'Alger. Je le sais, la France a lavé cette infamie ; c'est une raison de plus pour ne pas la dissimuler : oui, on a vu Kheïr-ed-Din reçu à Marseille comme un roi, en 1543; le pavillon de France s'est abaissé devant celui d'un chef de brigands; ce pirate a eu sous ses ordres une flotte française, commandée par un Enghien, et François 1er paya huit cent mille écus la coopération de ce scélérat. Gorgé de l'or de la France, Kheïr-ed-Din ne se trouvait pas suffisamment repu. Il ramenait sur sa flotte, à Constantinople, plus de sept mille esclaves italiens. Mais la faim, la soif, le manque d'air les tuaient au fond des cales, ou on les entassait dans les immondices, et à toute heure il fallait jeter des cadavres à la mer.
Le jugement, que vous portez sur la politique de François 1er, me paraît sévère, dit M. Morelli ; mais pour tout autre qu'un Français, il n'est que juste. Je crois cependant que Henri IV mérite plus d'indulgence. Déjà Catherine de Médicis avait eu l'idée de fonder un royaume français qui eût embrassé l'Algérie et la Sardaigne. Elle fi t'adresser des propositions dans ce but au sultan. Mais on ne pouvait pas raisonnablement espérer que le mahométisme travaillerait de lui-même et sciemment à sa ruine. Henri IV, inspiré sans doute par Sully, avait des vues plus hautes et plus justes, quand il songeait à équilibrer les intérêts politiques de l'Europe, pour en tourner toutes les forces contre les royaumes musulmans. Il reprenait sous une autre forme, et en se plaçant à un point de vue plutôt politique que religieux, la grande pensée des papes dans les croisades et à Lépante. Aurait-il réussi à former un faisceau des membres de la famille chrétienne, divisée par le protestantisme ? C'est douteux. Mais il faut lui tenir compte de l'intention. Si la mort l'empêcha de poursuivre la réalisation de ce rêve, il pût conclure du moins avec la Turquie, en 1604, un traité qui, en sauvegardant les intérêts de la France, obligeait les Barbaresques à rendre les esclaves français et à respecter son pavillon.
J'en conviens, répliqua le trinitaire, la politique de la France protégea ses intérêts particuliers ; mais ce fut d'une manière très imparfaite, et au prix de quelles humiliations !
D'abord la France renouvelle des traités avec les Barbaresques, et traite d'égal à égal avec de vils renégats, sans foi ni loi. Elle reconnaît officiellement les droits et la souveraineté d'écumeurs de mer campés en face d'elle.
Le traité signé aujourd'hui est violé demain. Les corsaires se jouent des serments et des signatures; la France voit ses vaisseaux capturés contre le droit des gens, et souvent sans obtenir satisfaction.
Et savez-vous quels usages régnaient en mer, malgré tous les traités ? Eh bien ! Les corsaires visitaient vos navires marchands, et s'adjugeaient une partie de leurs approvisionnements de vivres. Si le capitaine laissait paraître son mécontentement, on déclarait le bâtiment de bonne prise. L'ambassade de Henri IV, représenté par M. de Brèves, fut une des plus honorables. Et voyez, néanmoins, à quoi cela se réduisit. Je cite un contemporain :
" Le lendemain de son arrivée à la Goulette, le pacha de Tunis le fi t régaler d'un présent de quatre bœufs, d'autant de moutons, et de deux douzaines de poules. Il lui envoya un chaouch avec trois beaux barbes, dont le principal, que l'ambassadeur devait monter, était richement caparaçonné, ayant un harnais garni de lames d'argent doré, avec une housse de velours cramoisi rouge, et à l'arçon de la selle une masse d'armes d'argent, qui est une marque d'honneur dont se signalent les grands de l'empire. En cet équipage, le sieur de Brèves entra dans Tunis, où à moitié de chemin furent au-devant de lui, en fort bon ordre, tous les chefs de la milice et du divan, bouloubaschis et autres, qui le saluèrent, criant par trois fois : Hou ! hou ! hou ! et l'accompagnèrent jusqu'au logis qui lui avait été préparé à la ville. Il fut question de rendre les navires, les marchandises et les captifs français. Ce fut alors que les compliments se refroidirent. Le pacha eût cédé; mais les janissaires s'y opposèrent, et, pour ne pas tout perdre, le sieur de Brèves se contenta des captifs et de ceux qui n'étaient renégats que par force, ou qui voulaient se déclarer chrétiens. Les Turcs dirent à ceux-ci que c'était pour les éprouver, et qu'on les brûlerait vifs s'ils abjuraient le Coran. Cependant beaucoup le firent, et devinrent libres...
" De Brèves alla ensuite à Alger ; mais il ne pût obtenir aucun traité avec les corsaires, et rentra en France de crainte de quelque mauvais tour. "
Aussi voyons-nous à peu près constamment des Français dans les bagnes, bien qu'ils y soient en moindre nombre que les esclaves des autres nations.
En supposant qu'une nation chrétienne ait réussi à se faire respecter des corsaires, faudrait-il s'en glorifier ? Celle-là n'aurait-elle point à rougir de n'avoir consulté que son propre avantage, et d'avoir laissé par égoïsme et par jalousie, à la merci des forbans, une autre nation chrétienne et rivale ?
Je le dis hautement, la main sur la conscience, le sentiment de l'honneur a été bien affaibli dans l'âge moderne, et celui de l'intérêt l'étouffa quelquefois. Le moyen âge n'a jamais connu cette dégradation morale. Jamais il ne s'est courbé devant Mahomet ; jamais il n'a exploité contre des frères l'insatiable rapacité des musulmans.
Je le répète, le sentiment de la peur a saisi les nations modernes. Elles ont eu peur des Turcs ; elles se sont rachetées par des tributs. La peur est une faiblesse que les siècles des croisades n'ont pas connue; elle ne se trahit pas plus dans les actes diplomatiques que sur les champs de bataille. Ceux qui insultent les âges de foi devraient un peu mieux s'en souvenir.
Tant que la papauté gouverna dans les plus hautes questions politiques la grande famille catholique et latine, tant que l'hérésie en ravageant l'Europe ne détruisit pas l'unité de l'Occident, l'organisation de la piraterie, sa prépondérance sur mer n'étaient pas possibles ; car à la voix des papes toutes les forces maritimes se seraient unies pour briser celles des musulmans. Pie V, à la bataille de Lépante, sauva la civilisation; mais s'il n'anéantit pas les corsaires qui la menacèrent encore et entravèrent sa marche, c'est que son appel ne fut entendu ni des peuples protestants, ni de leurs alliés. L'Espagne, les républiques italiennes et les chevaliers de Malte y répondirent. Heureusement ce suprême effort fut une victoire. Que serait-il avenu, grand Dieu ! si le Turc l'eut emporté à Lépante !
Alfred, continua le père, vous êtes indigné du mépris dont les musulmans nous accablent là où ils sont les maîtres : croyez vous que nous ne l'ayons pas mérité ? Chiens, fils de chiens, nous disent-ils. Eh ! ne sommes-nous pas les fils de ceux qu'ils ont tenus à la chaîne et bâtonnés durant trois siècles ? Ne sont-ils pas en droit de s'enorgueillir de notre infériorité ? Nous leur avons tout laissé croire sur notre compte ; et nous commençons à peine à réformer leurs préjugés. Vous voulez qu'ils nous estiment au-dessus d'eux ! Alors expliquez-leur pourquoi, jusqu'au XIXe siècle, et d'après les traités avec les puissances chrétiennes, en cas d'échange des prisonniers, ils rendaient deux chrétiens pour cinq musulmans ; expliquez-leur pourquoi la compagnie française d'Afrique avait stipulé que si, hors du cas de guerre, un Maure tuait un chrétien, il paierait cinq cents piastres, et que si un chrétien tuait un Maure, ce chrétien en paierait huit Cents ; l'Europe n'estimait-elle pas ainsi le sang maure plus que le sang chrétien ? Du moins les musulmans le pouvaient-ils comprendre autrement ?
C'est une réflexion que je n'avais pas encore faite, repartit Alfred. Du reste, toutes celles que vous nous présentez en ce moment m'étonnent, et j'en reste confus.
Mon cher ami, durant le demi-siècle que j'ai passé dans les bagnes, j'ai eu le temps et l'occasion de méditer sur cette plaie de la piraterie turque. Combien de fois, de notre terrasse, où pourtant je n'eusse pas oser monter à cette heure-ci, car les Maures prenaient alors le frais sur celles de leurs maisons, combien de fois n'ai-je pas contemplé avec douleur cette belle mer qui va baigner les plus beaux rivages du globe ! Ah ! me disais-je, on assure qu'un grand homme veut faire de la Méditerranée un lac français, et ce n'est pas même un lac chrétien ! O peuples d'Europe, ne le comprenez-vous pas ? ce lac doit être à vous. Progrès, commerce, liberté, civilisation, tout est suspendu jusqu'à l'heure oui vous mettrez en lambeaux ce pavillon sinistre au pâle croissant, symbole de la nuit. Après les pertes de l'honneur, je calculais les autres : un million d'esclaves, d'innombrables navires, les riches cargaisons du Levant, de l'Inde et de l'Amérique; et je ne concevais pas que la politique moderne, basée sur l'intérêt, restât sourde à sa voix comme à celle de l'honneur et de la foi. On se contentait de prendre en mer les pirates, quand on le pouvait ; mais leurs navires ne portaient rien. J'entre dans votre manière de voir, dit M. Morelli.
Toutefois, la question des corsaires et des esclaves a encore à mes yeux quelque chose de louche. Les peuples chrétiens, de leur côté, ne faisaient-ils pas la même chose que les Turcs ? En usant des mêmes moyens, en capturant des navires, en réduisant aussi à la servitude ceux qui les montaient, n'autorisaient-ils pas la conduite des corsaires ? En un mot, n'a-t-on pas de part et d'autre, les mêmes reproches à se faire ?
Sous prétexte de modération et de justice, certains écrivains prétendent qu'il en est ainsi. Mais approfondissez l'histoire, et vous verrez que c'est une grave erreur.
Le musulman croit, comme article de foi, qu'il est de son devoir de combattre les peuples chrétiens, de les convertir par la force ou de les soumettre à l'impôt, tant qu'il est assez puissant pour y réussir. En droit, la guerre est permanente entre lui et nous ; la paix n'est qu'une trêve. Il se fait donc agresseur quand il peut, et ne connaît pas notre droit à l'indépendance. Jamais homme d'État ni théologien catholique n'est parti de là pour autoriser la guerre contre les infidèles. Il faut qu'il y ait des droits lésés à revendiquer. Aussi l'agression, l'initiative est venue des musulmans, et non des chrétiens.
Le musulman croit, comme article de foi, que le serment ne l'oblige pas envers les chrétiens, du moment qu'il est contraire aux intérêts de l'islamisme. Le chrétien se regarde obligé par le serment envers le musulman comme envers tout autre. Aussi, c'est par exception que les navires chrétiens violent le droit des gens ; et il est sans cesse outragé par les corsaires qui ne s'y soumettent pas en principe.
Si telle est la conduite d'un musulman imbu d'une croyance religieuse quelconque, je le demande, quelle sera celle des renégats, des écumeurs de mer, qui ne sont pas même musulmans ? Il n'y a donc sous ce rapport, ni en droit ni en fait, aucune comparaison à établir entre les deux partis.
Nous avons eu des corsaires et non des pirates dans la marine de l'État; mais les raïs ou capitaines barbaresques sont de vrais pirates : le corsaire attaque régulièrement, selon les lois de la guerre, une nation ennemie ; le pirate court les mers pour piller, et jette indifféremment le harpon sur tous les navires qu'il rencontre.
Ce n'est pas là toute la différence entre les corsaires musulmans et les nôtres. Pour nous, les captifs sont de simples prisonniers de guerre ; en Espagne même, on ne leur infligeait de châtiment particulier que s'ils étaient convaincus de crimes prévus par les lois et en dehors de faits de course ; nulle part on ne les vendait comme esclaves ; nul n'en abusait comme d'une propriété; nos codes et notre religion sauvaient l'honneur des femmes, et la vie à tous.
Mais il n'en était pas ainsi des chrétiens prisonniers des musulmans. Ils tombaient, par le fait, dans l'esclavage, et devenaient une chose qui se vend et s'achète, dont on use et dont on abuse; à peine un reste d'humanité que le Coran n'avait pas éteint, avait-il fait passer en coutumes quelques formalités judiciaires pour le meurtre public et solennel de l'esclave chrétien.
Pauvres esclaves ! dit Carlotta.
Oui, ce Coran que tant de libres penseurs ont l'outrecuidance de vouloir aujourd'hui réhabiliter, consacre de nouveau l'esclavage pour tout prisonnier de guerre, six siècles après que le Christ a affranchi l'humanité ; et alors même que le prisonnier se fait musulman, il est encore esclave. Avant Jésus-Christ, je comprendrais peut-être l'esclavage adouci d'une race inférieure sous une race civilisée; mais ici l'ordre est interverti contre le bon sens et contre toute justice. Nos chrétiens étaient traités comme les nègres.
Oh ! révérend père, dit Carlotta, je ne conçois même pas que les musulmans aient réduit les nègres à un tel esclavage. Fatma me raconte quelquefois ce qu'elle a souffert, et j'en ai grand pitié.
Carlotta, en disant ces mots, regardait la négresse d'un air de compassion.
" Aïa, aïa, Lella, dit le moine à Fatma, qui se tenait assise, portant la petite Marie dans ses bras. Venez, venez, Mademoiselle. "
La négresse se leva.
" Entsa bent' El-Djezaïr : Vous êtes née à Alger ? demanda le père.
Lala, sidi, ana oulad es soudân : Non, non, Seigneur, je suis fille du Soudan. "
Et le moine lui fit raconter son histoire. Fatma parlait cette langue franque, ce sabir demi arabe, demi européen, pauvre de mots; car il essaie de rapprocher des idiomes d'un génie trop différent ; expressif cependant, et riche de figures, parce qu'il supprime les détails qui ne sont pas essentiels, et qu'il emprunte beaucoup à l'imagination : C'est une langue dans l'enfance ; mais il faut traduire au lecteur. " Je suis fille du soudan, dit la négresse, Enfant, je fus enlevée par les Touaregs-Agbaïl, tandis qu'on célébrait les noces de ma sœur sous les palmiers de l'oasis. La lance de fer perce mon père à la poitrine, il est mort. Le combat s'engage. On nous jette, ma sœur et moi, sur le méhari à la course rapide. Je n'ai point connu le sort des miens et des combattants. Le chagrin a tué ma sœur. Moi, plus petite, j'ai souffert et oublié. Sid Messaoud-ben-Kouider m'a achetée vingt douros. Il me répétait souvent : " O Fatma, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mahomet est le prophète de Dieu. "
Jour et nuit je tournais la meule du moulin sous la tente. Sa tente est au pied du Djebel-Azereg. Mon dos s'est courbé sous la peau de bouc gonflée d'eau. Les lanières en cuir d'antilope ont creusé des sillons dans ma chair. O Mabrouka, que la malédiction soit sur ta tête ! Elle me haïssait, la méchante femme, l'épouse de mon maître. Elle me refusait le sommeil et ma part de rouina, même au jour des copieux festins. J'ai senti les dents de l'hyène au pied du Djebel-Azereg, la montagne bleue.
Sidi-Messaoud a voulu la paix. Mabrouka ne me bat plus. On m'engraisse de kouskoussou pour le marché de Tétouan. Sidi-Requiq, le Maure de Bâb-Azoun, m'a payée quarante douros c'est que j'étais belle avec mon collier de talisman et le henné jaune qui teignait mes ongles. Mais, à Alger, ô Mabrouka ! tu étais la douce gazelle, et voici Hadjira la lionne furieuse. O Sidi-Messaoud, que la bénédiction de Dieu se repose sur toi ! tu étais mon père, et Sidi-Requiq est le vautour.
Alors je me suis rappelée mon oasis du soudan. J'allais mourir. Azraïl, l'ange de l'agonie, étendait sur mes yeux l'ombre noire. La fièvre était dans mes veines comme le poison de la lefa. La maraboute au voile blanc, l'amie de Lella Carlotta, m'a emportée à l'hôpital de la Karatine. J'ai retrouvé mon âme, et lella Carlotta la sainte, l'amie du pauvre, la chérie de Dieu, m'a préservée d'Hadjira la maudite, et de Sidi-Requiq le fils du diable. "
Fatima se tue. Elle attachait sur Carlotta un regard aimant et respectueux.
" Si une négresse ressentait à ce point les souffrances de l'esclavage, dit Mme Morelli, quelles ne furent pas les douleurs des captifs arrachés à la civilisation chrétienne ! L'intelligence de leurs maux était bien plus grande ; le sentiment, la sensation même sont beaucoup plus vifs dans le civilisé que dans le barbare ou le sauvage. "
A SUIVRE
|
PHOTOS D'ECOLE
Envoyé par Mme Michèle Rochas née Dilettato
|
|
ECOLE SAINT-CLOUD
CE1 1956/1957

___________________
CE2 1957/1958

___________________
CM1 1958/1959

Est-ce que d'autres amies se reconnaîtront-elles ?
Merci Michèle
___________________
ECOLE ???
 Envoi de Marc Spina qui l'a reçu d'autres contacts.
Qui pourrait nous dire qu'elle est l'école, la classe, l'année
ainsi que des identifications éventuelles d'élèves
Envoi de Marc Spina qui l'a reçu d'autres contacts.
Qui pourrait nous dire qu'elle est l'école, la classe, l'année
ainsi que des identifications éventuelles d'élèves
|
|
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
AVANT-PROPOS.
Pendant tout le Moyen-Âge, les Provençaux, malgré la piraterie sarrazine, eurent des relations avec le nord de l'Afrique, comme avec le Levant. Mais, de même que le commerce du Levant prit un caractère tout nouveau à la suite des Capitulations, de nième une ère nouvelle commença au XVI° siècle pour celui de la Barbarie. Les Turcs, établis dans les pays barbaresques, remplacèrent à Alger, à Tunis, à Tripoli, les dynasties locales et donnèrent à la piraterie une extension qu'elle n'avait jamais eue. Cependant les Français, à la suite des Capitulations, créèrent des consulats et organisèrent des échelles sur le modèle de celles du Levant Bien plus, grâce à l'alliance algérienne, ils obtinrent le privilège exclusif du commerce sur une partie des côtes de la Régence et y fondèrent des établissements connus sous le nom de Concessions d'Afrique, exploités jusqu'à la Révolution par une série de compagnies exclusives. Enfin, la ruine de Narbonne et de Montpellier, le privilège de la franchise de son port, donnèrent à Marseille, dans la Méditerranée, un monopole qu'elle n'avait pas au moyen âge.
Au XVe siècle encore, les ports du Languedoc, même ceux du Roussillon, comme Collioure et Port-Vendres, peut-être ceux de l'Océan, comme Bayonne et les ports bretons, si l'on en croit de Mas Latrie, envoyaient des navires sur la côte nord d'Afrique.
Mais, d'un autre côté, les Marseillais, à partir de la fin du XVI° siècle, eurent à se défendre contre des concurrents étrangers de plus en plus nombreux, qui vinrent disputer le trafic méditerranéen aux vieilles cités du moyen âge. Les Anglais, les Hollandais, les Danois, les Suédois, furent des rivaux dangereux et envahissants, en face desquels les Italiens, Vénitiens, Génois, Florentins, ne surent pas garder leurs anciennes positions. Seule, Marseille, en butte aux attaques et souvent aux coalitions de tous ces adversaires, pût maintenir, pendant près de trois siècles; la prépondérance du commerce et du nom français dans toute l'étendue de la Barbarie.
On trouve souvent répétée, dans les documents du XVII° siècle, celte assertion que nos relations avec les Turcs n'avaient d'autre objet que de sauvegarder les intérêts de notre commerce. Il y avait là plus qu'une exagération, car l'alliance turque joua souvent un rôle important dans les combinaisons de la politique française. Mais, ce qui n'était pas vrai pour les Turcs l'était à la lettre pour les Barbaresques .
Ce fut uniquement en vue du commerce que la France et les autres puissances chrétiennes - eurent des correspondances suivies avec les régences de Tripoli, de Tunis, d'Alger, et avec les chérifs du Maroc. Ce fut pour défendre des intérêts commerciaux qu'elles nouèrent ces relations, aussi humiliantes pour elles que fructueuses pour ces ennemis jurés des chrétiens. Mais il s agissait plus de protéger contre eux le commerce méditerranéen et particulièrement le commerce du Levant, que de développer un trafic dans leurs États misérables. Aussi, faire l'histoire des établissements et du commerce français en Barbarie n'est pas exactement faire l'histoire des Relations de la France avec les Barbaresques, parce que beaucoup de négociations avec eux eurent pour objet la répression de la piraterie, la sécurité de la navigation on en trouvera l'exposé dans mon Histoire du commerce français dans le Levant.
Cependant, en dépit des conditions les plus défavorables, des Français s'étaient établis en Barbarie, dans les échelles fondées au XVI° siècle ; des compagnies exploitaient les Concessions d'Afrique. La politique française en Barbarie eut aussi pour but constant de protéger et de développer ces intérêts. On ne trouvera pas ici l'histoire détaillée de nos relations avec les Barbaresques, même à ce point de vue. Je me suis plus attaché à montrer les résultats qu'à exposer les négociations, compliquées et sans cesse renouvelées, qui les amenèrent ou en assurèrent le maintien.
Ces résultats pourront paraître minces et peu dignes de remplir un gros livre. Les ministres de nos rois, au XVII° ou au XVIII° siècle, n'auraient pas pensé ainsi. jamais le commerce des Français ne fut réellement important en Barbarie ; jamais leurs établissements ne prirent un grand développement, mais ils ont tenu dans notre histoire une place bien plus grande qu'il ne semble au premier abord ; ils n'ont cessé d'occuper notre diplomatie et de préoccuper nos ministres.
En effet, les Concessions d'Afrique donnaient aux Français un grand prestige auprès des Barbaresques ; elles étaient le symbole et le meilleur garant d'une amitié et d'une paix, dont le maintien était d'une importance vitale pour notre commerce méditerranéen. Les opérations commerciales y donnaient parfois des bénéfices énormes ; on espérait toujours les renouveler et donner à ce trafic un grand développement.
Aussi, les Concessions et le commerce français furent-ils toujours l'objet des vives jalousies des autres puissances, particulièrement de l'Angleterre. Pendant deux siècles, la diplomatie anglaise fut occupée à nous supplanter, tandis que celle de Versailles ne mettait pas moins d'activité et de vigilance à maintenir la situation acquise.
Les diplomates anglais et français auraient montré bien plus d'audace encore à se disputer la place, s'ils avaient pu prévoir la conséquence finale de la longue prépondérance de l'influence française sur la cote nord de l'Afrique. Bien des gens avisés pensaient, sous Louis XVI, que cette influence finirait par nous donner la possession de l'Egypte : ils ne soupçonnaient pas que l'occupation de l'Algérie et de la Tunisie serait le fruit de trois siècles d'efforts et de la remarquable continuité de notre politique. C'est à cause de ce résultat, imprévu pour eux, que l'histoire de nos anciens établissements et de notre commerce en Barbarie doit nous intéresser plus encore que les gens du XVII° ou XVIII° siècle.
Aucun exemple ne montre mieux comment l'expansion d'an pays au dehors peut être préparée par de lointaines et obscures entreprises. Celles de nos ancêtres n'ont peut-être pas donné encore tous leurs fruits dans le nord de l'Afrique et la perte de l'Egypte, due en partie, à l'ignorance du passé et des droits acquis, est une preuve malheureusement trop saisissante de la nécessité qu'il v a de faire connaître et revivre toutes les vieilles traditions de notre politique. D'un autre côté, cette histoire nous attachera davantage à nos possessions d'Afrique, en nous faisant voir qu'elles nous coûtent bien plus qu'on ne le dit communément. Aux trois milliards auxquels on évalue les dépenses de la conquête de l'Algérie, depuis 1830, il faudrait ajouter tout ce qu'il nous en a coûté, en argent et en hommes, depuis le XVI° siècle, pour établir notre influence, la maintenir et préparer la conquête.
L'histoire des anciennes Concessions d'Afrique est intéressante à un autre point de vue, qui intéresse les économistes. Elle est l'un des chapitres les plus curieux de l'histoire des compagnies commerciales de l'ancien régime.
Les compagnies nombreuses qui se succédèrent jusqu'à la Révolution, pour exploiter les Concessions, furent, en effet, dans une situation spéciale, unique même, dans les annales des anciennes compagnies. Elles avaient un monopole, et cependant elles eurent toujours à lutter contre la concurrence des négociants particuliers, parce que leur monopole n'existait que pour les Concessions, dont le territoire était peu étendu ; les capitales barbaresques, Alger et Tunis, restèrent toujours en dehors. Il y eut donc, pendant plus de deux siècles, sur cette côte d'Afrique, une rivalité acharnée et intéressante entre les compagnies et le commerce privé. Aussi est-ce bien à tort que, dans les études faites jusqu'ici, on a eu une tendance à confondre l'histoire des compagnies d'Afrique avec celle des échelles de Barbarie; loin de se confondre avec celle des compagnies, l'activité des négociants français, établis à Tunis ou à Alger, la contraria continuellement.
Plus encore que pour le commerce du Levant, les Marseillais furent à peu près les seuls, pendant plus de deux siècles, à représenter les Français en Afrique, sauf au Maroc où les Ponantais jouaient un certain rôle. Sans doute, des capitaux souvent importants furent fournis aux diverses compagnies d'Afrique par des habitants de Paris ou d'autres villes, mais la direction de ces compagnies fut toujours à Marseille : leurs agents et les directeurs des comptoirs furent toujours Marseillais ; Marseille fut toujours le point de départ et de retour de leurs navires.
Les Marseillais ne sont pas, en général, considérés comme des gens patients, capables d'efforts persévérants.
Aucune histoire ne pourrait mieux montrer la fausseté d'un pareil préjugé. On verra la singulière activité, l'initiative déployée par les négociants marseillais du XVII° et du XVIII° siècle. On verra la merveilleuse opiniâtreté, l'admirable persévérance qu'il fallut pour reconstituer sans cesse de nouvelles compagnies, à la suite de la ruine de celles qui les avaient précédées, et pour continuer sans découragement jusqu'à la Révolution l'exploitation des Concessions d'Afrique. Cette histoire sera une précieuse leçon pour les négociants d'aujourd'hui. Ils verront quelle énergie il fallut à leurs ancêtres pour établir et maintenir leur commerce dans des conditions particulièrement difficiles.
Tandis que M. de Mas Latrie a fait connaître le commerce de l'Afrique du nord au moyen de, on peut dire qu'à partir du XVI° siècle cette histoire est restée à peu prés inédite. Des travaux importants, il est vrai, ont été publiés sur l'histoire des pays barbaresques. A côté des Histoires d'Alger de Laugier de Tassy, de Rotalier, de De Grammont, il faut citer les Annales Tunisiennes, de Rousseau, et M. Mercier, dans son Histoire de l'Afrique septentrionale, a réuni les annales de tous les pays barbaresques depuis la plus haute antiquité jusqu'en 1830.
On s'est occupé aussi beaucoup des relations politiques de la France avec les Barbaresques. M. P. Heinrich a écrit un livre intéressant sur l'alliance franco-algérienne au XVI° siècle. De Grammont, en dehors de son Histoire d'Alger, a étudié une série de points de détail. L'importante thèse de doctorat en droit de M. Boutin (les traités de paix et de commerce de la France avec la Barbarie.) est intéressante surtout par l'analyse et l'étude juridique des traités conclus depuis le XVI° siècle avec les Barbaresques. M. Plantet a publié une masse considérable de documents dans ses deux recueils Correspondance des deys d'Alger et Correspondance des beys de Tunis avec la cour de France : il a éclairci nombre de points obscurs dans les notes copieuses de ces deux ouvrages. Il avait annoncé une Histoire de nos relations avec les Barbaresques ; il était tout préparé par ses longues recherches de l'écrire et il avait tracé d'intéressantes esquisses dans ses Introductions. Les deux recueils de M. Plantet ont été pour moi d'une utilité inappréciable : ils me dispenseront d'entrer dans de longs détails au sujet de nos négociations avec Alger et avec Tunis.
Il n'en sera pas de même pour nos relations avec le Maroc qui restent fort mal connues. Aucun ouvrage d'ensemble n'a été écrit depuis le travail estimable mais très incomplet de Thomassy. M. Rouard de Card, dans son livre récent sur Les traités entre la France et le Maroc n'a consacré qu'un chapitre aux relations diplomatiques antérieures à la Révolution (on peut s'étonner qu'il n'ait même pas cité l'ouvrage de Thomassy). M. Boutin a donné un certain nombre de détails inédits, d'après des recherches faites aux archives des affaires étrangères, mais le plan de son ouvrage ne lui a pas permis d'être complet. Il a donc été nécessaire de s'appesantir davantage sur une série de négociations encore ignorées.
Outre les travaux d'ensemble, de nombreuses études de détails sont éparses dans l'inestimable recueil de la Revue africaine, où tout une pléiade de chercheurs travaille depuis près d'un demi-siècle à élucider l'histoire du nord de l'Afrique. M. Fagnan, professeur à l'Ecole de droit d'Alger et arabisant distingué, qui la dirige avec tant de compétence, a bien voulu me donner des indications dont je suis heureux de le remercier. La " Revue tunisienne ", beaucoup plus jeune, marche sur les traces de son aînée et a publié déjà des documents très importants.
Mais les études relatives au commerce des Français et à leurs établissements sont moins nombreuses et surtout très insuffisantes, malgré quelques bons travaux de détail.
Comme ouvrage d'ensemble sur les Concessions d'Afrique, il n'y a que le livre de Féraud sur la Calle, précieux surtout par les nombreux documents des Archives d'Alger qu'il renferme. M. Boutin a donné un résumé étendu de l'histoire des Concessions, en se servant surtout des travaux antérieurs, dont il a reproduit un certain nombre d'erreurs ; il a cependant utilisé les Correspondances publiées par M. Plantet et quelques documents des Affaires étrangères. M. Albert Maire, bibliothécaire à la Sorbonne, a découvert et publié une correspondance très intéressante relative au comptoir du cap Nègre, mais elle est restreinte à quelques années. Il est juste de signaler aussi le très intéressant article publié par M. Alfred Sport dans la " Revue des Questions Historiques " (janvier 1900) sur le rôle des Français à Tunis, d'après les documents publiés par M. Plantet. Quant au Maroc, l'ouvrage de Thomassy est le plus important, à la fois pour l'histoire de nos relations et pour celle de notre commerce, mais le sujet est également à renouveler aux deux points de vue.
L'abbé Raguet, directeur de la Compagnie des Indes à Paris, avait l'intention, vers 1725, de faire une histoire des anciennes compagnies d'Afrique, et le dessein lui paraissait déjà difficile : il écrivait à Taxil, agent de la Compagnie à Marseille, le 20 mai 1726, de faire des recherches dans les archives des compagnies : " Cet arrangement, disait-il, doit me donner la matière d'une histoire complète... Je vous supplie d'entrer dans les vues du gouvernement et de la Compagnie et de ramasser le plus que vous pourrez de Mémoires pour nous les envoyer au plus tôt. Combien les particuliers, depuis les premiers qui allèrent en Barbarie, seront bien aises de n'être pas oubliés dans la postérité. "
Mais Taxil lui répondait, le 19 août : Je me suis donné tous les soins possibles pour retrouver les actes et conventions qui furent passés avec les Puissances du pays, mais ç'a été fort inutilement. Ces pièces se sont égarées en passant successivement d'une compagnie à l'autre.
On ne s'étonnera donc pas si, même après des recherches consciencieuses de plusieurs années, certains points de cette histoire restent obscurs. Cependant, la masse considérable des documents, renfermés dans nos différents fonds d'archives, permet de jeter une lueur suffisante sur ce passé ignoré.
Comme l'étendue de cet ouvrage, qui embrasse une période de deux siècles et demi et l'ensemble des pays barbaresques, n'a pas permis des développements et des détails qui eussent rendu sa lecture plus intéressante, peut-être, il a été nécessaire d'accumuler des notes au bas des pages, pour signaler des documents dont l'utilisation plus complète pourrait fournir la matière de nombreux et intéressants travaux de détail, autant que pour fournir des références.
Les riches archives de la Chambre de Commerce de Marseille sont moins complètes pour la Barbarie que pour le Levant. Aussi les différents fonds d'archives de Paris, archives des Affaires étrangères, archives nationales, archives du ministère des colonies, manuscrits de la Bibliothèque nationale, m'ont fourni beaucoup plus de matériaux que pour mon Histoire du Commerce du Levant. Je regrette de ne pouvoir remercier nominalement Messieurs les archivistes de leur obligeance, mais je dois des remerciements tout particuliers à M. Tausserat Radel, sous-chef du bureau historique à la division des archives du ministère des Affaires étrangères et à M. Rigaud, attaché au même bureau, qui se sont montrés pour moi d'une amabilité et d'une complaisance inépuisables. Ils ont bien voulu me faciliter le dépouillement des importants dossiers de la Correspondance consulaire, non communiqués encore au public, en me donnant accès dans leur propre cabinet. Je tiens à leur en exprimer ici ma profonde reconnaissance.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
| L'ŒUVRE DE F.-C. MAILLOT
N° 8
|
|
ANCIEN PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SANTÉ DES ARMÉES
Deuxième Edition
PARIS 1894
OCTAVE DOIN, ÉDITEUR
8, PLACE DE L'ODEON |
MAILLOT François-Clément, né à BRIEY (Moselle) le 13 Février1804. Ancien Président du Conseil de Santé des Armées, Commandeur de la Légion d’Honneur, récompense nationale attribuée par la loi du 25 juillet 1888. Ancien médecin en chef de l’hôpital militaire de Bône 1834-1836. |
TRIBUT DE RECONNAISSANCE DU COMITÉ
D'ÉTUDES MÉDICALES DE L'ALGERIE
MON DERNIER MOT
SUR LES FIÈVRES DE L'ALGÉRIE
Avant de me confiner dans le repos absolu, auquel me convint mon grand âge et la stupéfiante perturbation des sciences médicales, j'éprouve, une fois encore, le désir de fixer sur le papier quelques souvenirs bien lointains déjà, il est vrai, mais qui cependant se rattachent directement à la question, toujours ouverte, des fièvres de l'Algérie, à cet objet constant de mes études et de mes préoccupations pour d'armée. Je regarde aussi comme un devoir, ante mortem, de faire ressortir que c'est presque exclusivement aux médecins modernes des armées de terre et de mer, ces chevaliers errants de la science et de l'humanité, que reviennent le mérite et l'honneur d'avoir éclairé d'un jour si vif un sujet de premier ordre, qui jusqu'à eux était resté tout à fait incompris. Mon assertion est incontestable ; rien de plus facile à prouver qu'on lise, en effet, les classiques qui faisaient foi, dans le premier tiers de ce siècle : les Fièvres de Charnel, de 1821, les diverses édifiions de la Nosographie de Pinel, le Traité des fièvres pernicieuses d'Alibert, et l'on aura ainsi, comme je crois l'avoir déjà exprimé, la quintessence de l'enseignement officiel â cette époque. Puis, que l'on mette en regard les recherches de Boudin, d'Haspel, de Dutroulau, de Colin, de Bérenger-Féraud, de Mahé, de Laveran, l'esprit restera confondu en constatant l'incompétence négative des premiers, d'une part, et la profonde investigation, l'heureuse fécondité des seconds, d'autre part. On comprendra très bien le sentiment de réserve qui m'a engagé à ne pas inscrire son nom parmi ceux qui je viens de citer ; mais, comme il est infiniment probable que c'est pour la dernière fois que je laisserai ma plume octogénaire écrire quelques lignes destinées à la publicité, je demande la permission de dire combien je me trouve honoré de constater qu'après bien des controverses mes savants successeurs ont fait entrer dans le domaine scientifique les principales des propositions que, de 1834 à 1836, j'avais posées et développées sur le traitement des fièvres dans les pays chauds et marécageux.
On sait, par de nombreux ouvrages de médecine, toutes les calamités qui ont assailli nos troupes, à leur arrivée en Afrique ; je n'ai donc pas à m'en occuper. Mais, poux bien faire comprendre la situation, il n'est pas sans intérêt de constater combien, en dehors des données purement scientifiques, la population s'était émue devant une mortalité que l'histoire, de son coté, s'est chargée de nous transmettre, et dont je trouve un exemple saisissant dans un ouvrage qui vient de paraître sous le titre de : " Trente-deux ans à travers l'Islam " et que l'on doit M. le consul général Roches, ancien interprète de l'armée d'Afrique et qui, en cette qualité, faisait partie de la colonne chargée, en 1841, de ravitailler la garnison de Milianah. " Onze cents hommes valides, dit-il, furent laissés le 10 juin 1840 à Milianah... Au 15 octobre, il n'y en avait plus que 300, qui portaient la mort dans leur sein. Au "1er janvier 1841, il n'en restait que 80 : ainsi, plus de 1000 hommes sur 1100 périrent en moins de six mois. "
On ne peut se soustraire au désir qui, en pareille occurrence, devient une obligation professionnelle, de s'expliquer ce lugubre drame ; et l'on arrive vite à .reconnaître que ce ne sont ni des maladies obsidionales, ni des maladies de misère, ni les fatigues, ni les privations qui ont pu, en 113 jours, et dès le début du blocus, faire mourir 800 hommes sur 1100. Bien certainement, étant donnée la nature du pays dans lequel ces troupes expéditionnaient depuis plusieurs mois, il faut y voir l'influence de l'élément palustre, ce facteur, toujours le même, des terribles affections qui nous ont enlevé tant de monde en Morée et en Algérie; on pourrait même ajouter: dans nos colonies lointaines.
J'ai essayé de me procurer des renseignements médicaux, pour éclaircir ce lamentable épisode de Milianah ; mais je n'ai pas été assez heureux pour en rencontrer, malgré les sources officielles où il m'a été donne de puiser; ce qui m'autorise à penser qu'il n'en existe nulle part. Il faut donc s'en rapporter au raisonnement et analyser des faits analogues, pour en déduire des conséquences pratiques et applicables au fait actuel. Je ne mets en doute ni le savoir ni l'expérience des médecins attachés à cette expédition; mais je crois que le plus grand nombre de malades atteints si subitement aura immédiatement épuisé la provision réglementaire de sulfate de quinine ; et la clinique aura été ainsi complètement désarmée. Nous avons connu cette triste situation à Alger même, en 1832 et en 1838, à une époque où les relations avec la France, se faisant encore presque exclusivement par des bâtiments à voiles, étaient assez rares et irrégulières. Nous n'avions même pas l'outillage nécessaire pour pulvériser les écorces de quinquina ; on était réduit à les concasser, pour en faire une décoction que l'on administrait aux malades dans de petites fioles portant l'étiquette fallacieuse de potion fébrifuge. Cette même cause, la pénurie du sulfate de quinine, parait avoir eu aussi une large part dans la catastrophe de l'île Maurice, dont j'ai parlé dans la Gazette des Hôpitaux du 29 mai 1883 : 40.000 morts, en 1867, sur une population de 364.000 âmes. L'un des médecins les plus distingués du pays, M. Pellereau, à qui nous devons le meilleur travail sur la nature paludéenne de ces fièvres, dont l'origine et le caractère avaient d1abord été méconnus, a eu l'obligeance de me remettre une note que je m'empresse de faire connaître comme un document précieux, en faveur de mon opinion sur les maladies de Milianah. " La mortalité fut occasionnée non seulement par le développement de miasmes abondants, et d'une excessive intensité, mais encore et surtout par un manque déplorable de sulfate de quinine. Cet alcaloïde fit défaut au moment même où l'épidémie était à son apogée, et où une malheureuse population se débattait sous sa fatale étreinte. La petite quantité qui se trouvait dans les pharmacies de l'île fut vendue à un prix exorbitant, jusqu'à 1.540 francs le flacon de 30 grammes. Lorsqu'il n'en resta plus, il fallut s'adresser aux pays environnants. Puis, cette dernière ressource épuisée, nous trouvant sans armes et sans défense contre la plus meurtrière des épidémies, on dut recourir à des médicaments reconnus, aujourd'hui, tout à fait inutiles, tels que : arsenic, goudron, acide phénique, etc., et, de plus, à des plantes indigènes dont les résultats furent également nuls. "
Je n'ai pas besoin de dire combien, en face d'un ennemi si redoutable dont nos maîtres, dans leurs leçons et dans leurs livres, ne nous avaient à peu près rien appris, nous avons tous dû faire d'efforts et de tentatives pour paralyser ses coups. Ces efforts et ces tentatives ont porté, principalement, sur les fièvres paIudèennes à type continu, sur les accidents consécutifs du paludisme, sur l'emploi du sulfate de quinine à hautes doses. Des circonstances particulières m'avaient préparé à aborder avec résolution le premier point de cette étude ; je venais d'assister à des épidémies de fièvres intermittentes endémiques à Ajaccio et à Alger, lorsque je fus envoyé à Bône, en pleine station marécageuse, sous un ciel brûlant; c'était me conduire tout droit à la connaissance des fièvres auxquelles, pour bien mettre en garde les praticiens contre leur marche insidieuse, j'ai cru devoir donner le nom de pseudo-continues
Je n'ai ni le désir, ni la volonté, ni le besoin de revenir sur les attaques bien regrettables, au point de vue de la conservation des hommes dont mes recherches ont été le point de mire. Je remets à l'argumentation que Littré a inscrite en tête des Epidémies d "Hippocrate le soin de faire priser à sa valeur le rôle qui me revient dans la détermination des fièvres continues des pays chauds et marécageux. J'ajoute que je regarde aussi comme une grande force et comme un insigne honneur pour moi de pouvoir joindre à cet important témoignage celui non moins imposant de l'éminent professeur Verneuil qui, 40 ans après Littré, date pour date, fit ressortir au Congrès scientifique d'Alger en 1881 la portée de ces mêmes travaux, et leur donna un retentissement auquel je n'avais jamais eu l'ambition d'aspirer. Il y a loin de la haute sanction de ces grands esprits à la résistance opiniâtre qu'a rencontrée sur son chemin une méthode universellement adoptée maintenant. Dés le début, elle s'était cependant affirmée par des succès faciles à contrôler, à vérifier par I'expérimentation, qu'elle appelait et provoquait avec confiance parce qu'elle savait qu'elle reposait sur un grand nombre de faits, concordant tous entre eux pour attester sa puissance.
La symptomatologie des accidents consécutifs était trop bien connue, trop minutieusement décrite, pour que nous ayons eu à la modifier en rien. Mais, il n'en a pas été de même pour la théorie de leur genèse. Au début de notre séjour en Afrique, on était généralement encore dans la croyance qu'ils étaient dus à l'action des préparations de quinquina et à leur emploi prématuré ; d'où le double précepte de prescrire le sulfate de quinine en petite quantité (20 à 40 centigrammes dans la journée), et de n'y recourir que vers le septième ou huitième accès de fièvre. Le Recueil des mémoires de médecine militaire reproduit, en 1833, ces mêmes conseils, en publiant des travaux dus à des médecins de l'Algérie, qu'il donne comme devant servir de guides aux praticiens. Entraîné par la marche des maladies de Bône, ce foyer pestilentiel, je dus bien vite m'éloigner de la voie qui nous était tracée, et prescrire avec succès le sulfate de quinine à des prises très élevées, ce qui me permit d'écrire, dans un Mémoire sur !es fièvres intermittentes du Nord de l'Afrique lu le 30 mai 1835 à l'Académie de médecine, ce qui suit : " Par l'emploi de cette médication, nous avons aussi décidé, je crois, un grand fait ; c'est que, loin de déterminer des engorgements des viscères abdominaux, des hydropisies, des diarrhées, etc., le sulfate de quinine les prévient, en s'opposant au retour des accès. C'est, il n'en faut pas douter, la répétition des accès que l'on dois accuser seule de ces accidents consécutifs qui, à la fin des épidémies de fièvres intermittentes viennent enlever les malades que les accès pernicieux avaient épargnés. "
Ce que j'exprimais se fondait sur des faits authentiques et consignés dans un de mes rapports aux officiers de santé en chef de l'armée, en date du 11 janvier 1835: " Au premier du mois, disais-je, il me reste 208 hommes qui ne me donneront, selon toute probabilité, qu'une très faible mortalité, eu égard surtout à la fin d'une épidémie aussi longue. Vous jugerez facilement, Messieurs, combien j'ai peu d'affections chroniques dans mon service, puisque, bien qu'ayant reçu 236 entrants dans la dernière dizaine de décembre, j'ai pu réduire, par mes sorties, à 208 mon mouvement qui, le 21 décembre, s'élevait à 344. " Ce m'est une bonne fortune inespérée de pouvoir mettre, en regard de ces documents, ce que raconte l'un de mes antagonistes les plus décidés, M. Casimir Broussais, de ce qu'il a trouvé, dans les hôpitaux, en arrivant à Alger, au mois de décembre 1844 : " Une grande quantité de corps chétifs, épuisés, languissants ; une foule de pauvres malades, ruinés par la diarrhée ou la dysenterie chronique et enflés par l'hydropisie. "
Quel contraste! J'en accuse, sans hésitation aucune, l'incohérence et l'insuffisance des méthodes thérapeutiques, contre lesquelles j'avais cependant, depuis dix ans déjà, si hardiment réagi sans avoir été assez heureux pour entraîner, du premier coup, toutes les convictions. Si M. Casimir Broussais était venu à Bône en comme il a été à Alger en 1844, il aurait pu, sans sortir de l'enceinte de notre hôpital, voir d'une manière saisissante ce double tableau: d'une part, le mouvement général de mon service, exposé dans mon rapport précité, et dont le double, par le même courrier, avait été adressé au Conseil santé ; d'autre part, il aurait facilement constaté que, dans les diverses divisions de fiévreux, les résultats étaient en raison directe de l'empressement que l'on avait mis à suivre mon exemple ; de telle sorte que dans l'une d'elles, celles de son frère, à la doctrine physiologique battait son plein, il eût facilement chargé sa palette de couleurs aussi sombres que celles sous lesquelles il a rendu les impressions qu'il a ressenties, en mettant le pied dans les salles de l'hôpital du Dey.
Raconterai-je maintenant comment, avant des critiques de médecins mal inspirés, j'avais eu déjà à subir celles tout aussi imméritées de la part du public ? L'aventure ne manque pas de piquant. Dés l'origine de mes tentatives, il y avait un tollé général contre moi, dans la population civile tout comme dans la garnison. Les jeunes officiers, pour se soustraire à ma médication, s'étaient organisés un dispensaire sous la direction d'un aide-major du 59° de ligne assez instruit, assez intelligent, orateur d'estaminet. Leur algarade, du reste, ne dura que quelques semaines ; ces dissidents ne tardèrent pas à déserter, d'un commun accord, leur hôpital interlope pour venir s'abriter dans nos salles et nous demander des soins, dont l'expérience avait promptement démontré I'efficacité.
Cette malheureuse croisade contre le sulfate de quinine à haute dose était si universelle dans l'armée que le duc d'Orléans, lui-même, cet homme si intelligent et si bienveillant, cédant à l'entraînement général, a écrit que, lors de l'expédition de Constantine, en 1836, des ballots entiers de ce poison avaient été avalés en quelques jours dans les régiments, transformés en infirmeries (Campagnes de l'armée d'Afrique, 1835-1839, par le duc d'Orléans, p. 195) ; publication faite par ses fils en 1870. Voilà des expressions bien malheureuses, dépassant de beaucoup le droit de la critique, car, présentées dans une acception rigoureuse, sans que rien ne les atténue, elles transforment tout simplement en empoisonneurs publics des médecins instruits, actifs, dévoués, exposés à tous les dangers, à toutes les misères du soldat, comme le démontre si bien elle-même cette terrible campagne, dont la relation princière est un modèle de style et de haute appréciation dans les choses du commandement et de l'administration, mais non dans celles de la médecine. Ce n'est pas que je m'émeuve outre mesure de cette accusation; je la revendique même pour moi seul, attendu que je suis le plus grand coupable, car ce qui est si fortement incriminé ici n'était que l'application de la méthode que j'avais crée en 1834, dans cette même contrée, et dont l'extension a fini par dompter, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, le grand mal qui dévorait l'armée et les colons.
A SUIVRE
| |
| CAHIERS DU CENTENAIRE DE L'ALGÉRIE
N° 1
|
|
L'ALGÉRIE
Jusqu'à la Pénétration Saharienne
PAR M. J.- M. BOURGET
Ancien élève de l'École Normale Supérieure
Agrégé de l'Université
Capitaine d'Infanterie honoraire
Rédacteur militaire au " Journal des Débats "
 PUBLICATIONS DU COMITÉ NATIONAL MÉTROPOLITAIN
PUBLICATIONS DU COMITÉ NATIONAL MÉTROPOLITAIN
DU CENTENAIRE DE L'ALGÉRIE
INTRODUCTION
Une histoire de l'Algérie a forcément quelque chose d'un peu factice, d'un peu arbitraire. L'unité politique ou administrative que nous désignons sous le nom d'Algérie est de création récente : c'est seulement au XVIe siècle que les deux frères Arroudj et Khayr ed Din Barberousse la constituèrent, sous la vassalité du Sultan de Constantinople. Encore la Régence d'Alger ne s'étendit-elle jamais que sur un sixième des territoires aujourd'hui réunis sous le nom d'Algérie, et le pouvoir du Dey d'Alger n'était-il pas reconnu sans contestation dans tout le pays qui lui était théoriquement soumis.
Aux époques antérieures l'unité de l'Algérie n'était pas mieux établie.
La légendaire chevauchée d'Oqba et de ses compagnons au VII° siècle de notre ère les avait bien conduits de Kairouan jusquà l'Atlantique; mais, par la suite, il se constitua des royaumes ou des confédérations indigènes qui englobèrent seulement une partie de l'Algérie (Royaume de Tahert, Etat Hammadite, Royaume de Tlemcen); très souvent ces Etats furent en lutte avec des Etats plus puissants situés à l'Est ou à l'Ouest, doués d'une unité mieux définie, et qui les réduisirent à une vassalité plus ou moins étroite.
A l'époque romaine, la domination des empereurs s'étendait à toute l'Afrique du Nord, au moins, sauf exception dans la région côtière. Mais il n'y avait pas d'unité administrative pour tous ces territoires. L'Algérie elle-même comprenait (de l'Ouest à l'Est) les provinces de Maurétanie Césarienne, de Maurétanie Sitifienne, et, pour partie, de Numidie : les autres portions de l'Afrique du Nord étant réparties entre la Maurétanie Tingitane (partie septentrionale du Maroc actuel moins le Riff), la province d'Afrique (ancien territoire de Carthage), le Byzacène. Ces diverses provinces douées d'une civilisation unique ne formaient pas un ensemble politique ; aucun des gouverneurs n'avait autorité sur les autres : tous étaient égaux, et le pays se trouvait morcelé. A l'époque de Dioclétien, qui groupa les provinces en diocèses, il y eut bien un diocèse d'Afrique, mais la Tingitane n'en faisait pas partie et était rattachée au diocèse des Espagnes.
Cet état de division politique et administrative trouve une explication naturelle dans la configuration géographique du pays. On rencontre, du Sud au Nord, en venant de la mer, des régions diverses ayant des caractères physiques et économiques très tranchés (Tell, Hauts-Plateaux, Atlas). Et, de l'Est à l'Ouest, ces régions elles-mêmes se trouvent morcelées, compartimentées, par un relief tourmenté, assez complexe, qui dessine une succession de massifs montagneux plus ou moins facilement pénétrables et séparant des plaines entre lesquelles les communications sont relativement pénibles.
*
**
Inversement, si l'on cherche ce qui peut faire l'unité dans les populations algériennes, on s'aperçoit qu'alors on dépasse singulièrement le cadre algérien proprement dit.
Ces éléments d'unité sont le sentiment religieux et les caractères ethnographiques. Or, ce qu'on peut dire de ceux-ci, comme de celui-là, s'il s'applique d'une façon générale à l'Algérie tout entière, ne s'étend pas à elle seulement mais bien à toute l'Afrique du Nord, c'est-à-dire, outre l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Il y a des variantes locales, incontestables et aisément perceptibles, mais ce ne sont que des variantes ; le fond commun reste le même.
L'Algérie est musulmane, comme le sont le Maroc et la Tunisie. Il y subsiste des îlots isolés dont la population se rattache à une secte qui date des premiers âges de l'Islam : c'est le cas des Ibadites de la Région du Mzab, qui sont des Kharidjites, dont l'origine remonte au temps du khalife Mi. D'autre part le mahométisme des populations de l'Afrique du Nord connaît des nuances variables qui tiennent souvent à des traditions, à des souvenirs locaux. L'Islamisme, principe unificateur, n'est pas exactement le même des Syrtes aux colonnes d'Hercule et au Sahara.
Quant à la population, elle présente. des caractères généraux communs, mais avec des différences appréciables. On a affaire dans l'ensemble à une population berbère à laquelle sont venus se mêler des Arabes. Il est souvent difficile de faire la distinction des uns et des autres. Beaucoup de Berbères se sont arabisés ; mais aussi un certain nombre d'Arabes se sont berbérisés. Les deux mouvements ont été plus ou moins lents, plus ou moins contrariés, et le résultat final présente une bigarrure très variée.
En tout cas, que ce soit du point de vue religieux ou du point de vue ethnique, les différences que l'on peut reconnaître ne coïncident pas avec les frontières politiques qui séparent l'Algérie du Maroc et de la Tunisie. Aussi le général Azan a-t-il pu écrire au sujet d'Abd el Kader, qui incarna l'esprit de résistance indigène à la pénétration française en Algérie :
" Il conduisait au combat de fidèles musulmans, mais non des patriotes algériens. "
Il n'y avait pas, il ne pouvait pas y avoir de patriotes algériens.
*
**
L'unification relative introduite par l'Islam s'est accompagnée d'une transformation profonde dans le caractère des populations algériennes, mais sans faire disparaître les raisons naturelles de divergences.
Les Berbères avant la conquête musulmane étaient assez perméables à l'influence des civilisations supérieures. Les Phéniciens et les Carthaginois, puis les Romains, les façonnèrent aisément, bien que ni les uns ni les autres ne soient venus en très grand nombre : l'idée de colonie de peuplement n'était pas née encore. Ceux des Berbères qui le pouvaient, étaient fiers d'acquérir le titre de citoyen romain, de même que, plus anciennement, nombre de leurs ancêtres avaient pris des noms carthaginois, c'est-à-dire phéniciens. Des Africains d'origine remplirent de hautes charges dans l'Empire romain, certains accédèrent à la dignité suprême.
C'est avec la même facilité que fut acceptée la première arabisation par la religion et la langue. A ce fait contribua d'ailleurs la nature même de l'action musulmane, qui mêlait étroitement la religion à toutes les relations sociales, ne laissant le choix aux populations qu'entre la conversion et l'exil ou la mort.
L'âme berbère se trouve profondément modifiée à partir du XIe siècle par les conséquences de l'invasion des Arabes hilaliens. Les Hilaliens représentent l'apport ethnique le plus considérable qu'ait subi l'Algérie, comme le reste de l'Afrique du Nord; mais, en même temps, les Hilaliens apportèrent, surtout par leur action politique, un nouvel élément d'instabilité où l'on doit voir l'origine du fatalisme algérien sous la forme résignée qu'il a prise. Habituée aux brusques changements de fortune, à l'incertitude du lendemain, la population a perdu le goût des entreprises de longue haleine dans lesquelles l'énergie humaine lutte contre les forces naturelles et réussit à leur arracher sa subsistance quotidienne dans des conditions toujours améliorées. Cette énergie fit place à l'apathie ou bien elle se tourna vers d'autres domaines.
Cette tendance trouvait dans certaines parties de l'âme berbère un terrain tout préparé. En dépit de l'influence romaine, en dépit de l'unification qu'elle imposait dans les idées, dans la civilisation et dans les moeurs, les ferments de discorde y germaient facilement : aux premiers âges de la chrétienté, l'hérésie donatiste trouva en terre berbère un domaine d'élection ; de même, après l'islamisation, les Kharidjites, puis les Chiites purent s'assurer en Berbérie, et spécialement en Algérie, de puissants et agissants appuis. Cette exaspération du sentiment religieux allant jusqu'à l'hérésie est un trait à retenir.
Autre trait à retenir : les rivalités entre les personnes ou entre les clans, aussi difficiles à expliquer qu'à apaiser. Ces rivalités, ces haines, semblent dues, la plupart du temps, à la jalousie et au désir d'indépendance : ne pas céder volontairement devant le voisin est un sentiment qui atteint aisément son paroxysme en terre berbère.
Les conditions géographiques elles-mêmes y contribuent. Nulle part ce sentiment n'est plus puissant, plus ardent, plus vivace, que dans certaines régions montagneuses où la rudesse de la vie laisse aux habitants leurs caractères primitifs dans toute leur violence. Certaines régions de l'Algérie ont été de tout temps le refuge des Berbères animés de la passion de résister à toute pénétration guerrière ou pacifique : les Romains, comme après eux les Arabes et les Français, ont eu à compter sérieusement avec le Djurdjura, la Kabylie, l'Ouarsenis, l'Aurès, comme, au Maroc, avec le Riff.
Il semble que la seule différence d'habitat suffit à donner aux populations des sentiments opposés. De même que, au Maroc, au XIXe et au début du XXe siècles, les habitants de Rabat tremblaient dans la crainte d'une attaque des Zaërs, de même, lors de la décadence de l'Empire romain, les habitants des villes et des plaines avaient à redouter les incursions des montagnards : il n'y avait pas, dans un cas plus que dans l'autre, de haine de races ; les habitants des cités " romaines " étaient dans leur immense majorité des Africains romanisés.
*
**
La permanence de certains caractères fondamentaux des populations de l'Afrique du Nord a, en dehors des conditions géographiques, imposé une marche à peu près semblable à toutes les civilisations qui se sont trouvées y prendre pied. L'Algérie fait partie du bassin méditerranéen, et, par suite, elle a été soumise aux divers efforts d'unification qui s'y sont produits. C'est un perpétuel recommencement : les Phéniciens par le commerce, les Romains par la paix romaine, les Musulmans par la foi conquérante, les Turcs par besoin de domination, se sont essayés, en suivant des principes divers, à faire l'unité des pays méditerranéens.
Le cas de la France est spécial. Quand, à la fin du premier tiers du XIXe siècle, elle se décida à une action militaire en terre algérienne, elle y fut poussée principalement par la volonté de mettre fin à une situation qui durait depuis des siècles et que les nécessités vitales de I'Europe moderne, comme ses principes, rendaient décidément intolérable. En même temps, elle se trouvait être la principale puissance de la Méditerranée occidentale, et, dans une certaine mesure, les circonstances lui imposaient la mission civilisatrice que d'autres avaient remplie autrefois.
Enfin, l'affirmation plus ou moins consciente du sentiment national dans la plus grande partie de l'Europe, le fait que la France était la plus forte des puissances européennes parvenues à achever leur unité, devaient donner à son expansion une forme nouvelle qui se réalisa en Algérie.
Quant au processus de pacification, il se développa jusqu'à des limites non encore atteintes auparavant, mais il prit une allure analogue à ce qu'on avait déjà constaté dans le passé, notamment à l'époque romaine. Une circonstance précise provoque la première intervention. Et peu à peu l'entreprise grandit de par la nécessité de protéger les portions de la population qui se rallient à l'action pacificatrice, On aurait bien surpris Charles X et ses ministres si on leur avait dit que le débarquement à Alger conduirait leurs successeurs jusqu'au Tchad. Mais la pacification de l'Algérie, puis la pénétration saharienne étaient une nécessité : en se substituant à l'administration turque, la France acceptait la tâche de rendre aux populations indigènes, avec des possibilités de vie plus large, une complète sécurité.

Le problème était d'envergure, puisque si, par le Nord, l'Algérie touche à la Méditerranée, elle touche, par le Sud, à une sorte de mer intérieure, le Sahara, dont les riverains, plus encore que ceux de la Méditerranée, ne peuvent trouver la sécurité que dans l’unité.
PREMIÈRE PARTIE
L'ALGÉRIE AVANT L'ISLAM
Les Populations Primitives
Les Phéniciens et les Carthaginois
La première civilisation venue du dehors qui ait marqué son empreinte en Algérie, comme dans le reste de l'Afrique du Nord est la civilisation phénicienne, d'abord par l'emprise commerciale des négociants de Tyr, puis, une fois la métropole disparue, par l'emprise politique de Carthage, sa florissante colonie.
Il y a cependant des traces de civilisations préhistoriques, dont les caractéristiques générales sont les mêmes que dans tout le bassin méditerranéen : armes et outils de pierre plus ou moins primitifs, emplacements de stations en plein air, abris sous roches, tumuli, sépultures de pierre brute ou peu travaillée, dolmens, se rencontrent en Algérie. Les sépultures sont attribuées par les Berbères à des peuples plus anciens qu'eux-mêmes, aujourd'hui disparus, qu'ils appellent les Djouhala et les Beni Sfao, ce qui tend à confirmer l'hypothèse suivant laquelle les Berbères ne seraient pas des autochtones.
Ce qui semble certain, c'est que, de très bonne heure, la distinction s'établit entre les populations sédentaires des plaines côtières, et les nomades ayant leurs terrains de parcours plus au sud. De même aussi, on peut démêler des rapports évidents entre l'Algérie primitive et l'Egypte antique : la langue des Berbères est de la même famille que celle des Egyptiens, des Nubiens et des Abyssins ; la religion des premiers Algériens, après avoir suivi les cultes naturistes, adopta le Dieu Ammon, personnification égyptienne du soleil.
Les Phéniciens, qui furent les premiers à prendre pied sut la côte, semblent avoir établi leurs comptoirs en Algérie vers le XII° siècle avant notre ère. Il s'agissait uniquement de places de commerce maritime.
L'effort des Phéniciens fut prolongé par celui des Carthaginois, dont l'activité fut assez grande en Afrique du Nord pour écarter les Grecs, eux-mêmes colonisateurs dans tout le bassin méditerranéen à partir du VIll° siècle. Mais, contrairement à leurs devanciers, les Carthaginois ne purent s'en tenir à l'activité commerciale.
Leur territoire proprement dit ne dépassa jamais vers l'Ouest les limites occidentales de la Tunisie actuelle. Si réduit que fût ce territoire, le voisinage des Berbères à la périphérie obligea les Carthaginois à pratiquer ce que nous appelons aujourd'hui une politique indigène. Sans reculer leurs frontières, ils travaillèrent activement les tribus et réussirent à s'en concilier un grand nombre, notamment en donnant en mariage des filles de l'aristocratie à des chefs indigènes. Ceux-ci fournirent des contingents auxiliaires. La cavalerie qu'Hannibal emmena contre Rome était en grande partie composée de Numides.
L'influence de Carthage se fit sentir loin de son territoire. La langue punique devint la langue officielle dans les tribus.
Nombreux furent les Maures et les Numides qui prirent des noms carthaginois. Au temps de saint Augustin encore (fin du IV° siècle de notre ère, début du V°) les paysans des environs de Bône et de Guelma parlaient le punique. Certaines cités de l'intérieur adoptèrent des institutions copiées sur celles de Carthage. Cirta (Constantine) et Calama (Guelma) étaient gouvernées par des Suffètes.
Dans le domaine religieux également, l'emprise de Carthage, fut manifeste. L'Ammon égyptien se confondit avec le Baal Hammon phénicien ; de même, fut introduit le culte de l'Astarté phénicienne.
Si l'emprise politique des Grecs fut écartée de l'Algérie par Carthage, ce fut par l'intermédiaire de la grande cité punique que l'art grec s'y introduisit, et, avec lui, certains cultes. Des monuments comme le Médracen, le mausolée du Kroub et le " tombeau de la Chrétienne " (qui sont des sépultures de rois indigènes) témoignent de l'influence hellénique. Celle-ci se traduisit encore par l'introduction des cultes de Démèter et de Perséphone, de Dionysos, de Hadès.
Le Médracen.
 Dès cette époque l'Algérie semble avoir connu une grande prospérité. Le Tell était déjà producteur de blé et l'agriculture se développa largement : la vigne, l'olivier étaient florissants. Les richesses minières étaient exploitées.
Dès cette époque l'Algérie semble avoir connu une grande prospérité. Le Tell était déjà producteur de blé et l'agriculture se développa largement : la vigne, l'olivier étaient florissants. Les richesses minières étaient exploitées.
La nature spéciale de la domination punique n'empêchait pas les indigènes de s'organiser suivant leurs tendances. Carthage entendait seulement assurer sa sécurité : de grands royaumes indigènes se constituèrent, ou plutôt englobèrent des tribus unies en confédérations sous l'autorité d'un souverain commun.
L'histoire des débuts de ces royaumes indigènes est assez mal connue. Ce qui semble établi, c'est que, au fur et à mesure de l'affaiblissement de Carthage, absorbée par sa lutte contre Rome, ces royaumes devinrent de plus en plus puissants, au point de pouvoir imposer leur autorité à certaines cités phéniciennes englobées dans leur territoire.
A la fin du III° siècle avant notre ère, l'Afrique du Nord comprend, en dehors du territoire carthaginois, deux grands royaumes. Celui des Massyles situé vers l'Est, a comme ville principale Cirta, et comme souverain Massinissa ; celui des Massessyles, à l'Ouest, est gouverné par Syphax. La puissance de celui-ci est montrée par le fait qu'il prit parti contre Rome et entra en campagne contre Scipion l'Africain, à la tête de 60.000 hommes.
La bataille de Zama (202 av. Jésus-Christ) et la ruine de Carthage allaient marquer le début d'une période agitée dans l'histoire de l'Algérie.
II
La conquête Romaine
L'installation définitive de Rome en Afrique du Nord se fit par étapes et dura deux siècles et demi, si l'on compte à partir de la bataille de Zama.
Au début, les Romains se contentèrent de détrôner Syphax, et de donner son royaume à Massinissa qui se trouva régner ainsi du Maroc à la Tripolitaine. En 146, trois ans après sa mort, Rome annexa le territoire de Carthage (province d'Afrique ou Proconsulaire).
A la mort de son successeur 1Vicipsa, qui avait été comme lui fidèle à l'alliance, ou mieux à la domination de Rome, le grand royaume fut partagé entre plusieurs prétendants. L'unité fut reconstituée par Jugurtha, qui fit assassiner ses cousins Adherbal et Hiempsal. Jugurtha n'accepta pas la vassalité de ses prédécesseurs vis-à-vis de Rome. Celle-ci subit un certain temps les manifestations violentes de son indépendance (assassinat d'Italiens amis de Hiempsal, corruption des envoyés du Sénat, puis de magistrats dans Rome, et, dans cette même ville, assassinat d'un prince indigène rival). Après la défaite d'une première armée romaine, il fallut quatre ans de dures campagnes pour réduire Jugurtha, et encore par trahison. La province romaine fut agrandie et le royaume partagé entre Hiempsa II et Mandrestal.
La période des guerres civiles qui marquèrent la fin de la République romaine donna quelque répit aux souverains indigènes de l'Afrique du Nord. L'un d'eux, Juba 1er prit parti contre César et se mit à la tête de 30.000 fantassins et de 20.000 cavaliers. La bataille de Thapsus (46 av. Jésus-Christ) ruina ses espérances, mais sans que Rome se décidât à annexer tout le pays. Une nouvelle province, dite de Numidie, dont l'historien Salluste fut le premier gouverneur, fut créée. Mais Sittius, un chef de bande italien, et un prince Numide, Bocchus, qui avaient affaibli Juba 1er, en se jetant sur ses Etats, eurent en récompense, le premier Cirta, le second Sétif.
Après la mort de Bocchus, Auguste, son héritier, établit dans ses Etats des colonies de vétérans, mais, en 25 après Jésus-Christ, il donna son royaume, augmenté de territoires au sud de Cirta et des provinces romaines, à Juba Il. Profondément imprégné de culture gréco-latine, artiste et littérateur avant tout, Juba II, dans sa capitale Cæserea (Cherchell), fut toute sa vie fidèle à l'alliance romaine.
Son fils et successeur Ptolémée le fut aussi. Mais les poli-tiques de Rome jugeaient le moment venu d'annexer toute l'Afrique du Nord. Le faste que le roi déploya dans un voyage à Rome suscita la jalousie de l'empereur Caligula, qui le fit jeter en prison et assassiner. Deux nouvelles provinces furent constituées : la Maurétanie Tingitane (partie septentrionale du Maroc, moins le Riff, qui resta indépendant) et la Maurétanie Césarienne (partie septentrionale des départements d'Oran et d'Alger, partie occidentale du département de Constantine.
Même après la réduction complète en provinces, l'apport ethnique des Romains fut extrêmement faible. Il y avait eu déjà les bandes italiennes de Sittius à Cirta, puis les colonies fondées par Auguste pour établir ses vétérans : sur la côte Igilgili (Djidjelli), Saldæ (Bougie), Rusazu (Azeffoun), Rusguniæ (Matifou), Gunugu (Gouraya), Cartennæ (Ténès), et, à l'intérieur, Aquæ (Hammam Rirha), Zucchabar (M liana), Tubusuctu (Tiklat, au sud-ouest de Bougie).
Dans la plupart des cas, comme les noms mêmes l'indiquent, il s'agit d'établissements effectués dans des centres indigènes déjà existants. Il en fut de même par la suite. On connaît Oppidum Novum (Duperré), sur le Chélif Madauros (au sud de Soukh Ahras), Sitifis (Sétif), Cuicul (Djemila).
L'administration romaine en Afrique du Nord se caractérise par le petit nombre des fonctionnaires. La base de la vie publique était la Cité ; suivant sa politique ordinaire, Rome reconnaissait plusieurs espèces de cités jouissant de droits particuliers et plus ou moins étendus, élisant annuellement leurs magistrats assistés d'un conseil de décurions. La collation des diverses dignités entraînait l'obligation de verser une somme importante au trésor, et les fonctions étaient exercées gratuitement.
En dehors des Cités, les tribus étaient administrées par leurs chefs, désignés par l'Empereur, ce qui assurait leur indépendance, mais choisis dans les mêmes familles, ce qui assurait la permanence de l'autorité. Ces chefs, connus officiellement sous le nom de préfets ou princes, prenaient souvent le titre de roi et avaient auprès d'eux une assemblée des anciens.
Au-dessus des cadres locaux, l'administration romaine était représentée d'abord par le gouverneur de la province et sa maison (familia) : son domaine comprend, outre la vérification de la comptabilité, la justice criminelle, et la justice civile pour les affaires importantes. Il existe des préfets militaires, chargés des rapports avec les tribus, ou pour mieux dire de leur surveillance ; des agents du cadastre, des agents du recrutement. Le personnel de l'administration financière et fiscale est réduit au minimum, les impôts étant affermés.
Les forces militaires romaines, dans la partie soumise de l'Algérie, ne furent jamais très considérables ; elles étaient essentiellement formées par une seule légion, la Tertia Augusta, qui, stationnée sous Auguste à Ammaedara. en Tunisie, au nord-est de Tebessa, fut transportée de bonne heure dans cette dernière ville. La légion était renforcée par des auxiliaires qui, au début, étaient recrutés dans les autres parties de l'Empire romain, et par des formations indigènes, à effectifs variables, appelées en cas de besoin.
Ces forces suffisaient pour tenir les régions occupées, dont la frontière, au début du premier siècle, restait au nord de l'Aurès, englobait les plaines de Sétif et de la Medjana, et était jalonnée plus à l'ouest par Berrouaghia, le Chélif, Relizane, Perrégaux et l'embouchure de la Moulouya.
Par la suite, sous la pression des insoumis et pour mettre les provinces à l'abri de leurs incursions, la légion fut portée à Lambèse, avec des postes au sud de l'Aurès, qui ne fut réduit qu'après 50 ans de luttes; et la frontière militaire atteignit (au III° siècle) la région sud-ouest du Hodna, Boghar, Teniet, Tiaret, Chanzy, Lamoricière, Tlemcen et Lalla Maghrnia. Les troupes tenaient alors un système de défense constitué par un fossé continu avec, au moins par place, un remblai ; des voies de communications permettaient des liaisons faciles entre les postes et les camps. Quelques Postes se trouvaient aux avancées, à Laghouat, Djelfa, Sfissifa.
III
La Paix Romaine en Algérie
Si mince que nous paraisse aujourd'hui cette armature de sécurité, elle suffit cependant pour assurer à l'Algérie pendant des siècles le bénéfice de la paix romaine. Le trait essentiel est la romanisation des populations africaines. Cette romanisation, qui fut poussée très loin dans les régions de plaines de la partie soumise, se réalisa de plusieurs façons.
Un de ses agents les plus efficaces fut l'armée. Dès l'origine la Tertia Augusta amena à sa suite des mercantis déjà formés à la vie romaine; puis, suivant la politique en honneur dans tout L'Empire, des légionnaires recrutés sur place remplacèrent les Gaulois, qui au début avaient composé la Légion. Il en fut de même plus tard pour les auxiliaires. La colonisation des confins militaires trouva dans les anciens soldats de précieux pionniers. Ces volontaires, qui servaient 25 ans, et pouvaient se marier, touchaient une retraite et recevaient des terres elles-mêmes exemptes d'impôts à la condition que les fils fussent militaires à leur tour.
A l'intérieur, le principal moyen de romanisation fut la hiérarchie des droits variés conférés aux cités et aux individus. Les villes nouvelles (Thamugadi, Lambèse, Mascula, Bagai, Diana Veteranorum, Gemellæ, etc...), des villes anciennes furent dotées plus ou moins vite de l'organisation municipale, latine ou romaine, l'accession à l'échelon supérieur étant considérée comme une récompense très enviée.
Les particuliers pouvaient eux aussi s'assurer des privilèges toujours croissants : le titre glorieux de citoyen romain n'en marquait pas le terme. L'aristocratie formée dans les magistratures locales fut admise peu à peu à exercer les grandes fonctions romaines. Un habitant de Cirta devint consul sous l'Empereur Titus. Par la suite, un nombre important de ses compatriotes siégèrent au Sénat. Dès le début du III° siècle, Macrin, originaire de Cæsarea, devint empereur.
 Cette accession au droit de cité et de citoyen romain avait comme base la langue. Le latin fut accepté, au moins dans les villes, avec la même facilité que l'avait été auparavant le punique. Avec lui s'intronisa le culte de Rome et des Empereurs, fondement moral de la puissance impériale ; en même temps l'ancien Baal Hammon se confondit avec Saturnus Augustus et même avec Jupiter Optimus Maximus, et d'autres cultes romains furent acceptés (la Victoire, la Fortune, la Paix). La facilité avec laquelle ces différents cultes s'ajoutèrent aux cultes anciens, ou se confondirent avec eux, permet de mesurer par comparaison la transformation que la conquête mulsumane a fait subir à l'âme algérienne. Cette accession au droit de cité et de citoyen romain avait comme base la langue. Le latin fut accepté, au moins dans les villes, avec la même facilité que l'avait été auparavant le punique. Avec lui s'intronisa le culte de Rome et des Empereurs, fondement moral de la puissance impériale ; en même temps l'ancien Baal Hammon se confondit avec Saturnus Augustus et même avec Jupiter Optimus Maximus, et d'autres cultes romains furent acceptés (la Victoire, la Fortune, la Paix). La facilité avec laquelle ces différents cultes s'ajoutèrent aux cultes anciens, ou se confondirent avec eux, permet de mesurer par comparaison la transformation que la conquête mulsumane a fait subir à l'âme algérienne.
L'adoption du latin à une époque où Rome possédait une langue classique complètement formée fut un puissant agent du développement culturel en Algérie. Dans les villes s'établirent des écoles où l'on étudia les grands auteurs grecs et latins : en tête de ceux-ci, comme dans tout le monde romain, Virgile. Certaines cités furent célèbres comme centres intellectuels. Tel fut le cas de Madaure et de Cirta. La future Algérie et la future Tunisie (Césarienne, Numidie, Proconsulaire) fournirent de nombreux médecins, de nombreux légistes, surtout de nombreux littérateurs.
Beaucoup de ceux-ci vinrent tenter la fortune à Rome. Le plus célèbre d'entre eux fut Apulée, né à Madaure. Saint Augustin, avant sa conversion, enseigna la rhétorique à Rome et à Milan.
Dans le domaine de l'art, les Africains romanisés rivalisèrent avec les autres peuples soumis à Rome. Ils ne semblent pas, d'ailleurs, avoir apporté rien de nouveau, ni d'original. Toutes les richesses artistiques de l'époque romaine retrouvées sur le sol algérien relèvent du goût hellénistique de l'époque. Du moins attestent-elles le niveau élevé de civilisation atteint par les Africains. Les ruines de Timgad et plus encore peut-être celles de Cuicul (Djemila) en sont d'éloquents témoins.
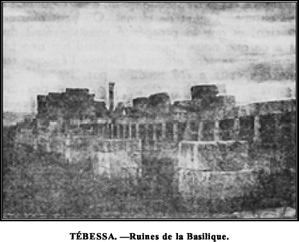 Le développement de la culture latine en Algérie favorisa, comme dans le reste de l'Empire, celui du christianisme. Au commencement du III° siècle, on signale la présence d'évêques de Numidie dans les Conciles tenus à Carthage, celle d'évêques de Maurétanie au Concile de 256; six ans auparavant un concile s'était tenu à Lambèse. La future Algérie fournit de nombreux martyrs dans les persécutions, notamment, de Valérien et de Dioclétien. Et, dès le moment où la conversion de Constantin assura l'appui officiel au christianisme, celui-ci connut une floraison considérable en Algérie. Le développement de la culture latine en Algérie favorisa, comme dans le reste de l'Empire, celui du christianisme. Au commencement du III° siècle, on signale la présence d'évêques de Numidie dans les Conciles tenus à Carthage, celle d'évêques de Maurétanie au Concile de 256; six ans auparavant un concile s'était tenu à Lambèse. La future Algérie fournit de nombreux martyrs dans les persécutions, notamment, de Valérien et de Dioclétien. Et, dès le moment où la conversion de Constantin assura l'appui officiel au christianisme, celui-ci connut une floraison considérable en Algérie.
Cette contrée vit naître des pères de l'Eglise, dont le plus illustre, saint Augustin, 'évêque d'Hippone (Hippo-Regius fixa la langue théologique et mystique du christianisme. Ses idées ont été exploitées non seulement par l'Eglise elle-même, mais encore par beaucoup de ceux qu'elle a condamnés comme hérétiques. La puissance des chrétiens d'Afrique, ainsi que leur attachement au latin, est marquée par le fait que ce sont eux qui l'imposèrent comme langue liturgique à l'église d'Occident.
Païenne ou chrétienne, grâce aux bienfaits de la paix romaine, l'Algérie connut une prospérité quelle ne retrouva pas avant de longs siècles. Quand on songe à ce qu'était l'Algérie turque, on a peine à croire que l'Afrique du Nord ait pu fournir à Rome la moitié ou les deux tiers de son blé, et même la totalité après la fondation de Constantinople.
La différence est si frappante qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas eu changement de climat. On peut affirmer qu'il n'en est rien, et que la prospérité romaine était due simplement à ce que nous appelons aujourd'hui une politique de l'eau singulièrement efficace. Depuis l'époque romaine, le régime des eaux a été modifié par les déboisements qu'ont entraînés les dévastations provenant des invasions successives. Surtout on a laissé se dégrader des travaux hydrauliques qui avaient été réalisés non pas à la diligence du gouvernement central, mais sur l'initiative des Cités (dont le territoire comportait normalement une banlieue étendue) et des particuliers, des grands propriétaires. La distribution de l'eau avait été l'objet de soins particuliers, et elle était soumise à une réglementation précise empêchant le gaspillage et l'abus.
En même temps que la culture du blé, s'étaient développées celles de la vigne, de l'olivier, de l'amandier, du figuier, encouragées par des exemptions d'impôts et dans certains cas par la concession d'un droit de propriété héréditaire. L'élevage était aussi très florissant, celui du mouton, du boeuf, et surtout celui du cheval. La petite histoire enregistre des victoires de chevaux algériens sur les hippodromes de Rome; ce qui apporte une confirmation à la théorie suivant laquelle les étalons barbes, loin d'être des descendants du cheval arabe, ont au contraire contribué à lui donner sa valeur.
Les différentes parties de l'Algérie étaient reliées entre elles par des routes telles qu'en avait construit Rome dans toutes les autres parties de son Empire. Nées de la conception stratégique qui cherche la sécurité dans le mouvement, ces voies de communication servaient également au commerce. On en comptait trois principales allant de l'Est à I'Ouest et complétées par des rameaux détachés et des rocades parallèles. Ce réseau suffisait parfaitement aux besoins de l'époque.
Bref, l'Algérie romaine présentait comme une contrée riche, peuplée, civilisée. Son plus beau moment se place dans les dernières décades du deuxième siècle et dans la première moitié du troisième.
IV
Les Vandales et les Byzantins
Si avantageuse qu'ait été, pour celles qui l'acceptèrent, l'administration romaine, toutes les populations englobées dans la frontière militaire ne s'y soumettaient pas avec une égale bonne volonté. Dès le milieu du III° siècle, des révoltes se produisirent chez les Maures, puis en Kabylie. Des erreurs administratives, des exactions en furent peut-être l'occasion; la raison profonde semble avoir été la romanisation moins profonde résultant des conditions géographiques (Aurès, Djurdjura, Ouarsenis) et provoquant le réveil des instincts ancestraux de pillage. Ces premiers soulèvements furent réprimés péniblement.
La décadence progressive de l'Empire romain en favorisa de nouveaux par la suite jusqu'au moment où elle permit l'invasion des Vandales. Les causes générales de cette décadence sont assez connues. Elles prirent un aspect particulier en Afrique du Nord et en Algérie.
La tendance à l'exploitation purement fiscale du pays se fit jour assez vite, et la population ne trouva pas les appuis naturels sur lesquels elle aurait pu compter. L'aristocratie romanisée constituée dans les provinces de l'Afrique du Nord fut bientôt plus romaine qu'africaine. Les grands domaines administrés par des intendants prirent une extension toujours plus considérable, les moyens et petits cultivateurs ne trouvant pas de crédit en cas de crise agricole et étant obligés de vendre leurs terres. L'exploitation par les intendants fut dirigée de manière à assurer non seulement les revenus du maître, souvent absent, mais encore l'enrichissement de son représentant.
L'affaiblissement du pouvoir central fut également très marqué. Le IV° siècle voit des indigènes alliés se proclamer indépendants, et les campagnes entreprises pour les réduire, dévastent le pays : des villes sont brûlées ou pillées, entre autres Icosium (Alger). Cette instabilité encourage et facilite les révoltes agraires et les soulèvements indigènes.
L'autorité des évêques parvint bien, pendant un certain temps, à maintenir un cadre d'apparence régulière et à remplacer en fait l'administration défaillante. Mais l'église d'Afrique ne resta pas longtemps unie. La querelle des Traditeurs (on appelait ainsi les personnes qui, lors de la persécution de Dioclétien, avaient livré les livres sacrés aux autorités civiles) se prolongea par celle des donatistes. Ceux-ci, condamnés dans plusieurs conciles, ne se soumirent pas. A la fin du IV° siècle et au début du V°, saint Augustin lutte contre eux, obtient des lois extrêmement sévères et réduit l'hérésie. Il lutte en même temps contre les païens à qui s'appliquent aussi des édits rigoureux. L'orthodoxie finit par triompher ; mais le souvenir de ces dissensions avait ruiné l'unité morale.
L'Eglise toute-puissante négligea, on se l'explique, les précautions matérielles de défense, et notamment les précautions militaires. L'organisation ancienne des confins s'était altérée d'assez bonne heure. Dès le milieu du III° siècle, après les premiers soulèvements, la Légion Tertia Augusta avait été reconstituée. Mais les évêques n'étaient pas faits pour organiser des troupes et pour se mettre à leur tête : le service militaire, d'ailleurs battu en brèche pour des raisons doctrinales, tomba peu à peu en désuétude, l'impôt remplaçant la conscription, les citadins se jugeant à l'abri derrière leurs murailles.
Toutes ces circonstances provoquèrent en Algérie, un état de choses voisin de l'anarchie, le banditisme se développant normalement à la faveur de l'instabilité. C'est dans cette situation que survient la première invasion, celle des Vandales.
Ces Germains venant d'Espagne abordèrent l'Algérie par l'Ouest. Il n'est pas impossible que ce fait leur ait donné des avantages militaires particuliers : le système de défense des provinces romaines (ou du moins ce qui en restait) était tout entier tourné vers le sud, du côté d'où pouvait venir antérieurement la menace principale, celle des nomades ; et nous avons fait nous-mêmes, en 1914, lors de la bataille des frontières, l'expérience de la tyrannie qu'exerce sur les esprits un système de défense stratégique traditionnel.
Les Vandales furent appelés en Afrique par le comte Boniface qui s'était révoltés contre, Placidie, tutrice de l'Empereur Valentinien III. A leur tête Genséric s'empara de la Maurétanie, et, quand Boniface, sur les remontrances de saint Augustin, voulut l'arrêter, il était trop tard : en 430, l'Evêque d'Hippone, au moment de sa mort, était assiégé dans sa ville épiscopale.
Un essai de négociation aboutissant à reconnaître à Genséric la possession de ses conquêtes moyennant un tribut annuel et un serment de fidélité n'eut pas de lendemain. En 439, le chef vandale entrait dans Carthage et s'y installait : une fois de plus l'attraction de la région orientale de l'Afrique du Nord se manifestait. En 455, au moment où il, prit Rome, avec des auxiliaires berbères (descendant des Numides, compagnons d'Hannibal, et des Africains qui avaient servi l'Empire romain jusqu'en Dacie), toute l'Afrique du Nord reconnaissait l'autorité de Genséric.
Les Vandales arrivés en petit nombre s'établirent en Tunisie. Pour administrer le reste du pays, ils laissèrent en place ce qui subsistait de l'ancienne organisation. Mais ils jetèrent aussi les bases d'un système nouveau, le vasselage. Des comtes germains furent chargés de missions d'inspection dans les provinces occidentales. L'autorité de l'Eglise fut ruinée : les Vandales étaient eux-mêmes des hérétiques chrétiens et suivaient la doctrine d'Arius. Ils mirent en vigueur contre les orthodoxes africains les lois que ceux-ci avaient appliquées aux donatistes.
Mais ils ne se souciaient guère d'administrer la contrée et d'y faire régner l'ordre.
Les Berbères des montagnes se jetèrent sur les villes pour satisfaire leur goût du pillage, Les Vandales de Tunis ne, songèrent pas à arrêter les gens de l'Aurès, quand ils dévastèrent Lambèse, Bagai, Théveste, Timgad.
Les débris de la civilisation romaine semblaient à la veille de disparaître. Ils furent sauvés pour un siècle encore par l'intervention des Byzantins. Ceux-ci se considéraient comme les successeurs des empereurs de Rome et voulurent refaire l'unité de leur domaine.
L'Empereur Justinien envoya Bélisaire en Afrique (533) pour réduire les Vandales. Il battit leur roi Gélimer à Tricaméron. Les Byzantins arrivés par l'Est s'étendirent peu à peu vers l'Ouest, mais ne purent reconstituer l'ancienne unité romaine : l'Aurès, un moment occupé, leur échappa; ils réussirent à s'installer au Hodna et jusqu'à Sétif. Plus à l'ouest ils durent se contenter d'occuper quelques points : Rusguniæ Tipasa, Cæsarea, Cartennæ.
Du moins s'attachèrent-ils à rétablir l'ordre et la sécurité en construisant des remparts et des forteresses (comme celle de Madaure). Ce travail considérable fut accompli rapidement, les matériaux les plus divers étant employés dans la maçonnerie, et d'abord ceux qui provenaient des ruines déjà accumulées par les Vandales et les Berbères. A cette oeuvre est attaché le nom de l'eunuque Solomon. Les Byzantins tachèrent de reprendre la politique de défense des Romains, en particulier l'institution des soldats colons;
 Ils surent exploiter les divisions entre les tribus. Sans que le succès obtenu fût complet, un regain de prospérité s'affirma dans l'ordre généralement rétabli. Ils surent exploiter les divisions entre les tribus. Sans que le succès obtenu fût complet, un regain de prospérité s'affirma dans l'ordre généralement rétabli.
En dehors de la domination byzantine, il se constitua des états berbères. Ils sont mal connus, comme tout ce qui touche à cette période. On sait toutefois qu'il exista un royaume indigène à Tiaret; son existence est attestée par celle treize mausolées dynastiques, dont le plus élevé (Djedar) atteint quarante-cinq mètres de haut. Le christianisme se maintint dans certains de ces Etats, qui reconnaissaient peut-être la suprématie des Byzantins.
A SUIVRE
| |
NOS BUVARDS D'ANTAN
Envoyé par M. Jean Pierre PEYRAT
|
|
Source : collection personnelle de M. Paul Rost de Constantine.
|
|
| LE DÉCALOGUE DE LA SOCIÉTÉ
Envoyé Par Chamaloo
| |
La société est ainsi faite :
1- Le pauvre : il travaille
2- Le riche : l'exploite
3- Le soldat : il défend les deux
4- Le contribuable : il paye pour les trois
5- Le vagabond : il se repose pour les quatre
6- Le poivrot : il boit pour les cinq
7- Le banquier : il escroque les six
8- L'avocat : il trompe les sept
8- Le médecin : il tue les huit
9- Le croquemort : il enterre les neuf
10-Et le politique : il vit des dix !
|
|
|
Retrouvailles de la famille PAGANO
à Carnoux le 26 septembre 2010
Envoyé par M. D. Bonicori
|
Melchior Calandra, maire-adjoint de Carnoux et président de Carnoux racines, organisait le 26 septembre une réunion de la famille Pagano, dont tant de membres s'étaient perdus de vue depuis des décennies voire ne s'étaient jamais rencontrés.
Angelo Pagano, né en 1847 à Roccapiemonte (près de Naples), avait fondé à Bône, rue Bouscarein, une menuiserie. Il avait épousé en 1892 Marie-Rose Acampora , née en 1866 à Résina (aujourd'hui Herculanum, dans la banlieue de Naples). Il décéda en 1909, Marie-Rose lui survivant 51 ans.
De cette union de 11 ans étaient nés six enfants :
Marguerite (épouse de René Sollacaro),
Angelo (qui épousa Elisabeth-Blanche Gilli),
Gaëtan (qui épousa Anna Chamboissier),
Vincente (épouse de René Risler, maire d'Aïn-Mokra),
Thérèse (épouse de Jean Boenko),
Christiane (épouse d'Antoine Calandra).
Vincente - Christiane - Thérèse Angélo (1895-1940)
Marguerite - Marie-Rose le jour de ses 95 ans - Gaétan
Ainsi que 14 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants qui habitèrent pour beaucoup la maison familiale de la rue Bouscarein.
Se retrouvaient donc à Carnoux, autour de Melchior Calandra et Pagano, sa cousine Yvette, épouse d'Henri Bonocori (décédé en 2009), fille d'Angélo Pagano et d'Elisabeth Gilli, une cinquantaine de descendants et alliés d'Angélo et Marie-Rose.
Lignée de Marguerite épouse René SOLLACARO
- Nicole SOLLACARO, fille de Gilberte SOLLACARO, petite-fille de Marguerite PAGANO
- Denise SOLLACARO née DEBONO, veuve de René (fils de Marguerite PAGANO), et sa petite-fille
Lignée d'Angelo PAGANO et Elisabeth-Blanche GILLI
- Yvette BONOCORI née PAGANO, fille d'Angelo, doyenne de la famille à 82 ans
- son fils Daniel BONOCORI (dont la soeur Colette, les fils Vincent (ainsi que sa compagne Diana) et Paul, et la petite-fille Cléa, fille de Vincent, n'avaient pu accomplir le déplacement)
- les enfants de Rose-Marie PAGANO épouse TIBERINO, sœur d'Yvette (décédée en 2009)
- Eric TIBERINO, son épouse Françoise née VOILHAS, leurs enfants Thomas et Marie
- Martine TIBERINO, son compagnon Patrick CHAMP, son fils Nicolas avec son épouse Audrey, et leur fils Mayron, le benjamin de la réunion
Lignée de Gaëtan PAGANO et Anna CHAMBOISSIER
- Jean-Claude PAGANO, fils de Robert, petit-fils de Gaëtan, et sa femme Annie née SANDINI
- n'avaient pu se déplacer Colette, veuve de Claude PAGANO, (fils de Gaëtan PAGANO), ses enfants et petits-enfants.
Lignée de Thérèse PAGANO épouse Jean BOËNKO
N'avaient pu se déplacer
- Liliane BOËNKO (veuve de Georges, fils de Thérèse, née PAGANO)
- Pascale et Wladimir BOËNKO (fille et petit-fils de Georges)
Lignée de Christiane PAGANO épouse Antoine CALANDRA
- Melchior CALANDRA et Jacqueline, sa femme (née LAILLET, deux fils Antoine et Stéphane, leur petite-fille Maëlle (fille d'Antoine
- Jean-Angelo CALANDRA et sa femme Ghislaine (née BORG)
- Jacqueline DRAGON (jumelle de Jean-Angelo), née CALANDRA, avec sa fille Christine et son gendre Bruno GUILLAUME, son autre fille Valérie, son autre gendre Thierry LUC, et ses petits-enfants Albane et Ethane
- Philippe CALANDRA
- Marguerite et son mari Jean-Claude D'ARCO
- Marie-Rose et son mari Bernard PHILIPPON, leur fils Jean-Maxime, leur bru Caroline, le petit-fils Zadig
- Pierre CALANDRA, sa femme Renée (née DELBOY), leurs deux filles Valérie et Laurence (avec son ami Fabien)
Lignées parallèles
- Sylviane (fille de Carmen BIÉ, petite fille de Raphaël ACAMPORA lui-même frère de Marie-Rose PAGANO) avec son mari Claude ROSEN, leur fils Pierre et sa femme Manuelle (avec trois petits-enfants), leur fille Sophie et deux petits enfants.
- Marie-France PAGANO, fille d'Alphonse PAGANO, arrière-petite nièced'Angelo PAGANO
|
UN BÔNOIS À L'HONNEUR
Envoyé par M. D. Bonicori
|

Le 18 octobre 2010 a été décoré de la légion d'honneur Jean Tenneroni, un des plus jeunes bônois en activité (il est né le 6 février 1962).
Son père Jean Tenneroni (cité deux fois en Italie avec le 3ème RTA),
sa mère Odette Vitiello,
son grand-père le commandant Léon Tenneroni,
son cousin François Tenneroni (capitaine de l'équipe de foot de l'ASB) ; étaient aussi bônois.
|
NOTES
Bulletin de l'Algérie
N° 6, février 1856
|
|
DES EAUX MINÉRALES DE L'ALGÉRIE.
" L'hydrologie minérale est appelée à rendre de grands services en Algérie, écrivais-je en 1850, dans un travail sur l'Emploi thérapeutique des eaux ferrugineuses de Ténias-el-Hâd ; les richesses minéralogiques de son sol donnent le droit de l'affirmer. " Les renseignements suivants, que j'ai recueillis depuis cette époque sur l'emplacement et les propriétés des nombreuses sources thermales de cette colonie, démontrent la justesse de cette prévision, et. tout l'intérêt qui doit s'attacher à cette étude, au double point de vue de la médecine et de l'exploitation locale.
EAUX SULFUREUSES
Dans le cercle de Guelma, chez les Ouled-Messaoud, il y a une source thermale sulfureuse.
On trouve, dans le même cercle , celle de Hammam (1) Meskoutine (95° centigrades). Les Arabes y lavent leur linge, y plongent les végétaux dont ils ne veulent obtenir que la fibre ligneuse pour en faire des cordes et des nattes, y font cuire enfin des fèves, du blé, du gibier, des oeufs , etc.
Dans le cercle de La Calle, on compte cinq ou six sources thermales sulfureuses ; il y en a deux dans le cercle de Biscara : l'une, située à 6 kilomètres N.-O. de cette ville, se nomme Hammam-Sid-el-Hadj. En décembre 1.852, j'ai constaté que, sa température étant de 48' centigrades, ses propriétés et sa composition l'assimilent aux eaux de Baréges; les Arabes l'appellent Hammam-Mkebrit (le bain soufré ). L'autre source, à mi-chemin d'El-Kantara à El-Outaïa, sert aux habitants voisins du Koudiat-Kourbazet : elle est également chaude (39° centigrades), d'une odeur sulfureuse, d'une saveur saline très prononcée, et offre les vestiges d'une ancienne piscine romaine.
L'Aïn-el-Baroud (la Fontaine de la poudre), ainsi nommée à cause de son odeur sulfureuse, est une source froide, sur les bords de l'Oued-Bou-Roumi, à 4 kilomètres de Mouzaïa-les-Mines. Elle fournit environ un litre cinquante par minute.
A 25 kilomètres sud. de Médéa, on trouve l'Hammam-Berrouaguia, source chaude (45°), sulfureuse, abondante, très en usage contre les affections du foie et contre la gale.
Chez les Béni-Mehessen, près de la frontière tunisienne, à côté d'un grand établissement romain, on rencontre l'Hammam-ouled-Mdellem, fontaine thermale qui a trois sources.
A 90 kilomètres sud de Bône, et à 24 kilomètres est de Souk-Ahras, il y a la source thermale gazeuse de Kheng el-Hammam (45°).
A 45 kilomètres est-sud-est de Bône, celle de Hammam-Chafia, gazeuse {35°), avec un établissement romain en bon état de conservation.
Au Sud des Bibans, une source très sulfureuse.
Entre Alger et le cap Caxine, une autre assez abondante.
Près de Milianah, des eaux très chaudes.
Plusieurs sources de 50 à 60°, sur le plateau qui domine l'Oued-Sémor, et principalement à la rencontre de cette rivière avec l'Oued-Surff.
Une source d'eau thermale près de l'Oued-Zaïan, dans la vallée de l'Oued-Sahel, province d'Alger;
Enfin, une source thermale (35°) et gazeuse à l'entrée de la vallée de la Châfia, entre la Calle et Bône, etc.
EAUX FERRUGINEUSES.
Comme appartenant à cette catégorie, nous mentionnerons, dans le cercle de La Calle, l'Hammam-Sidi-Labrak (35 à 38°), à 12 kilomètres sud-est de La Calle.
Près de Dahla, une source très renommée pour le traitement des fièvres intermittentes anciennes.
Dans le cercle de Bouçade, plaine de Dréat, une source.
Près de Téniet-et-Dâd, une source abondante dont j'ai expérimenté les propriétés en 1848.
Près d'Hammam-Meskoutine, une source de 75°.
Près de Store, au pied de la montagne des Kabyles, deux sources froides.
Entre Alger et le cap Caxine, une source très fréquentée par les indigènes. -
Plusieurs sources gazeuses, abondantes, à 4 kilomètres de Bordj-Bouïra, dans le cercle d'Aumale.
Puis, différentes autres chez les Ouled-Aziz, à Ben-Aroun (Kabylie de la province d'Alger), au Djebel-Dirah, etc.
EAUX ACIDULES.
A l'Est de l'Hammam-Righa, chez les Béni-Menad, on trouve l'Aïn-Karsa (la fontaine acide), aux eaux qui rappellent celles de Seltz.
A deux kilomètres d'Arcole, une autre source qui donne deux cent cinquante litres en vingt-quatre heures, et dont l'eau se vend comme eau de Seltz à Oran.
EAUX THERMALES SALINES.
Dans le cercle de Guelma, il y a quatre sources de ce genre renommées pour le traitement des douleurs rhumatismales et des affections cutanées. Ce sont l'Hammam-Mtà-el-Hachaïch , l'Hammam Nbaïls, l'Hammam des Béni-Foughal et l'Hammam-Borda (29° 5), qui est légèrement gazeuse.
Sur le Rummel, on trouve l'Hammam-si-Yacoub (26°).
Dans le cercle de Sidi-bel-Abbès, il existe de nombreuses sources très vantées pour le traitement des syphilis invétérées. Ce sont l'Hammam bou-Hadjar, l'Hammam des Ouled-Sidi-Abdelli, l'Hammam-Si-Ali-ben-Youb et plusieurs autres (58°) à l'Oued-el-Hammam, sur la route de Sidi-bel-Abbès à Mascara.
Dans le cercle de Lella-Magrhnia, encore plusieurs sources, parmi lesquelles on cite celle de la Moula et celle de la Tafna, sur la route de Tlemcem à Lella-Magrhnia.
En Kabylie, chez les Béni-Aïdel, une source que les montagnards ont entourée de constructions.
L'Hammam-Melouane (le bain bigarré), près d'Alger, est très connu des habitants de cette ville.
L'Hammam-Righa, chez les Béni-Menad (451°), est fréquenté pour les affections de la peau.
L'Hammam-Oued-Alala, près du Vieux-Ténès (30°), a un bain maure tout à côté.
Au N.-E. du Djebel-Amour, est I'Hammam-el-Rorfa (40 à 45°).
A 3 kilomètres O. d'Oran, sont les bains dits de la Reine (47°). Quatre sources y donnent 350 litres à la minute. Les Arabes les préconisent pour les engorgements abdominaux et les affections rhumatismales invétérées.
L'Hamnam-ben-Hadjar, à 50 kilomètres S.-O. d'Oran (50°), a six sources donnant 12 à 15 litres chacune par minute ; un bain maure est tout à côté.
A 26 kilomètres de Mascara, l'Hammam-Sidi-ben-en-Nefta (63 à 65°), est très renommé pour les maladies cutanées et syphilitiques, ainsi que pour les engorgements abdominaux.
Sur le bord du Chéliff, à 4 kilomètres au-dessus de son affluent avec la Mina, on rencontre l'Hammam-Sidi-bou-Abd-Allah, source considérable, bouillante, dans laquelle les Arabes font cuire des oeufs, des poules, etc.
Au confluent de la Mina et du Chéliff, l'Hammam-Sidi-bou-Zid (50°), qui est considérable.
Au nord des précédentes, dans les ruines de Técha, I'Hammam-Sidi-ben-Chaâ (35 à 40°).
Près des ruines d'Aquæ Cresaris, un Hammam, à 18 kilomètres de Tébessa.
L'Hammam-Djebel Nadoun, près de Guelma (32°), est à proximité de ruines romaines.
A Séniour, au S.-S.-O. de Guelma, il y a plusieurs sources de 50 à 60°, avec des vestiges romains.
A Ghellaïa, entre Philippeville et Bône, trois sources de 41 à 58°.
A Grouss, au sud-ouest de Constantine, sur la rive droite du Rummel, une source de 35°.
Le Sidi-Mémoun, au pied de Constantine, sous une voûte (31°).
Au nord-ouest de Constantine, El-Hamma (36°), source très abondante, est située près de la route de Philippeville à Constantine.
Celle de Bou-Taleb, à 60 kilomètres S. de Sétif, est très chaude et fort abondante.
Le Baraï jaillit au pied de l'Aurès (60 à 70°).
A Bou-Sellam, à 20 kilomètres S.-O. de Sétif, on trouve plusieurs sources (41 à 49°).
L'Hammam-Beni-Kecha, à mi-chemin de Constantine à Sétif (45°), est renommé pour les affections des os et de la peau.
Le Gueurgour, à 40 kilomètres N.-O. de Sétif, près de la route de Bougie , est très chaude et très abondante.
A Béni-Sermen, chez les Berbacha, près de Bougie, il y a des sources très chaudes.
La Mansoura, sur la route de la Medjana à Aumale, coule dans un ravin.
On rencontre une source fort chaude, sur la rive gauche de I'Isser territoire de Tlemcen).
Une autre, sur la rive gauche de la Tafna.
Près de Zaatcha, des sources de 28°, très chargées de sels magnésiens.
Dans le voisinage de Salah-Bey, aux environs de Constantine, un grand bassin flanqué de cinq petites loges, couvert de briques rouges (27° centigr.).
Entre El-Kantara et El-Outaïa (cercle de Biskra), l'Hammam-Salahin (44°)
Près de l'Hammam-Meskoutine, diverses eaux thermales salines, de 64°. La présence de l'arsenic a été démontrée dans leur composition.
Il existe encore, dit-on, dans le Djerrid et le Sahara plusieurs eaux salines d'une température assez élevée, etc.
Des renseignements précis me font complètement défaut quant à l'emplacement , aux propriétés et aux qualités des eaux minérales fréquentées par les indigènes dans les cercles de Collo, de Batna, etc.
Je termine en faisant remarquer que, dans l'énumération sommaire que je viens de donner des richesses principales de l'Algérie en hydrologie minérale; il y a pu se glisser des inexactitudes, ayant écrit sur des renseignements dont je suis redevable, soit à des Arabes de chaque province, soit diverses publications de la colonie. Il est à désirer que l'attention du gouvernement, des administrations locales et des habitants de l'Algérie se porte enfin sérieusement sur une question qui intéresse à un aussi haut degré le trésor, l'hygiène publique et l'industrie.
Dr E. L. BERTHERAND,
ancien médecin des affaires arabes.
(
1) Quand les eaux sont chaudes, les Arabes les appellent Hammam (bain), mot qui vient de hamm, chauffer. Si elles sont froides et de médiocre importance, ils les nomment le plus ordinairement Aïn (fontaine).
|
|
COQUILLAGES
Envoi de M. Charles Ciantar
|
|
Les Souvenirs militaires
de M. le Colonel Henri Fabre-Massias
|
|
VOYAGE AUX ZIBANS (1848)
PRÉAMBULE
Définissons d'abord ce qu'on appelle les Zibans. C'est la lisière du grand désert et le pays des riches oasis. C'est la partie nord de la vallée de l'Oued-Djedi, du fleuve Triton des anciens.
L'Oued-Djedi vient du Djebel-Amour, montagne située au sud-sud-ouest d'Alger, et se dirige vers les Syrtes, entre Tunis et Tripoli. Mais il n'arrive pas à la mer ; et la partie inférieure de son cours n'est indiquée que par une série de lacs d'inégale grandeur. La vallée de l'Oued-Djedi est fort basse et le lac Melrbir paraît être tout entier au-dessous du niveau de la mer. M. Duboc n'a trouvé que 114 mètres pour l'altitude de Biskra, qui est à quelque dix lieues du thalweg du fleuve.
Cette vallée, parallèle à la mer, en est séparée par deux chaînes de montagnes enfermant entre elles la région des lacs. Ainsi, le vieil Atlas est double, et les deux frères, regardant des horizons opposés, reposent leurs pieds, l'un dans la mer, l'autre sur le sable du Sahara, tandis que leurs reins robustes portent à mille mètres au-dessus de la mer le riche plateau, au climat presque européen, où Sétif, Batna, Tébessa s'élèvent, capitales promises à un nouvel empire, sur les ruines des cités détruites du vieil empire romain.
Chacune des deux chaînes présente, sur 60 kilomètres d'épaisseur environ, un sol extrêmement tourmenté, difficile, à peine coupé de quelques vallées étroites. Ces caractères sont bien plus marqués dans l'Atlas du Sud que dans celui du Nord, que nous connaissons mieux. La région des lacs, au contraire, est partout aisément praticable, et, bien que sa largeur ne dépasse pas celle de chacune -des chaînes qui la limitent, elle offre, à la culture un espace bien plus étendu, un sol plus uniformément riche ; aux populations, des communications plus multipliées; au gouvernement, une action plus facile.
C'est sur le plateau que prennent naissance la plupart des grands cours d'eau qui se rendent, d'une part à la mer, de l'autre à l'Oued-Djedi. Les lignes de partage des eaux entre les bassins de la Méditerranée et de l'Oued-Djedi sont à peine marquées. Les fleuves du nord, le Roumel, la Seybouse, coulent parallèlement à la mer d'abord, puis ouvrent des brèches à travers l'Atlas et les creusent en vallées profondes. A l'est, le plateau s'incline vers Tunis, et y verse la Medjerda, dont les sources le sillonnent de leur large réseau. Au midi enfin, des rivières nées à la limite sud du plateau se précipitent à travers d'étroites ouvertures, traversent l'Atlas du Sud en y pratiquant d'affreux défilés ; mais, au sortir des montagnes, elles trouvent la vallée de l'Oued-Djedi et la parcourent, avant de parvenir au thalweg, sur des longueurs qui varient de 10 à 20 lieues. C'est là le fait caractéristique de cette contrée. L'eau, qui peut seule la rendre féconde, lui vient, abondante, des montagnes qui la dominent et lui versent la fertilité; comme fait le Nil, apportant à l'Égypte les eaux de l'Abyssinie, au lieu de celles qu'un ciel toujours serein dénie à la terre des Pharaons.
Je n'ai pas parlé d'une région intermédiaire, d'une dépression du plateau comprise entre des soulèvements parallèles au grand Atlas du Sud. Cette région qui, sons le nom de pays des Chotts, prend une grande importance dans la province d'Oran, se réduit presque à rien dans l'est de nos possessions, et ne s'agrandit qu'au Hodna, sous le méridien de Dellys.
CHAPITRE PREMIER
MOTIFS DU VOYAGE.
Les rapports des bureaux arabes, ceux du capitaine de Larminat, et quelques renseignements venus de Tunis, avaient révélé l'existence de terres salpêtrées exploitables dans plusieurs localités de l'Atlas du Sud et de la vallée de l'Oued-Djedi. C'est là une richesse spéciale à certains sols et à certains climats. Le nitrate de potasse était exploité depuis longtemps sur le sol de l'Inde anglaise. Il s'agissait de savoir si l'Algérie, en cas de blocus maritime, pourrait reconstituer, par ses propres ressources, la poudre qu'elle consommerait. Je fus chargé d'aller voir de mes yeux l'industrie indigène du salpêtre, de rapporter des échantillons de la poudre, du salpêtre obtenus par elle, et des terres qu'elle exploite. Ce fut là l'occasion du voyage que je vais raconter.
CHAPITRE II
DE CONSTANTINE A BATNA.
Je partis de Constantine le 22 octobre 1848 avec le capitaine Chambeyron. Nous primes à Batna dix hommes appartenant à la deuxième section de la batterie que je commandais alors (9° du 13° régiment), avec autant de mulets portant des caisses vides : le 31, nous étions à Biskra.
Cette route, de Constantine à Biskra, est sans cesse parcourue depuis que le duc d'Aumale a établi ce dernier poste, qui surveille et prend à revers la -contrée qu'enferment les deux Atlas. Aussi n'ai-je pas la prétention de rien dire de nouveau en la décrivant. Peut-être, cependant, l'histoire rapide des premiers jours de ce voyage ne sera-t-elle pas sans intérêt pour quelques lecteurs.
Déjà, au contraire de ce qui arrive dans les régions montagneuses, les horizons y sont très étendus. De la Casbah de Constantine, on aperçoit, à 40kilomêtres de distance, le Djebel-Guerioun, au pied duquel naît le Bou-Merzoug, qui porte au Boume], à Constantine même, les eaux de ces contrées. Pendant toute la durée des deux premières étapes, on peut se diriger sur cette énorme borne de la région des lacs. On suit d'ailleurs, à une distance du Bou-Merzoug qui varie de 4 à 10 kilomètres, la vieille route romaine, presque partout reconnaissable, qui joignait Cirta à Lamboesis et à Biskra.
Le sol qui avoisine cette route est fertile, et nous le ferons riche un jour, je l'espère. Mais, en ce moment, le pays est presque désert, et nous avons à peine aperçu, dans l'intervalle des étapes, trois ou quatre bergers et un seul laboureur, je crois. C'est que, dans ces contrées si facilement abordables, le despotisme des beys a détruit toute existence communale sans pourvoir à l'impérieux besoin d'une police protectrice ; c'est que la population a fui ces champs oit rien n'eût protégé son travail. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une terre de parcours pour les innombrables troupeaux qui viennent chaque année chercher, sous un ciel moins brûlant, la nourriture que leur refuse le sol desséché du Sahara.
Le second jour, nous arrivâmes, vers dix heures. M. J. Renier assure que c'est là le vrai nom de la ville que nous appelions Lamboesa. Je n'ai vu ce nom mentionné que dans une inscription : Genio Lambossitanorum, ce qui ne résolvait pas la question. Je m'incline, bien entendu, devant l'autorité du savant archéologue qui interroge avec un si intelligent dévouement les restes intéressants de la domination romaine dans ces contrées.
Du matin, près d'un étang alimenté par l'Ain-Gerchi, affluent du Bou-Merzoug. C'est le lieu de halte ordinaire, et cette circonstance attire là, comme en Europe, une population fixe : deux ou trois constructions européennes s'y montrent déjà, ainsi qu'un village indigène qui nous vendit des oeufs et des poulets. Nous avions à gauche le Guérioun, à droite le Nif-en-Nser (bec de l'aigle), dont le nom indique assez bien la forme. Nous l'avions vu pendant les dernières heures de marche, et nous devions le voir encore aussi longtemps le lendemain. Sa hauteur égale ou dépasse celle du Guérioun : il tient la tête des montagnes de l'Occident dont la chaîne sépare des lacs le bassin du Roumel. Entre les deux, une montagne de forme conique et beaucoup plus petite semble avoir été jetée après coup, et la légende explique en ce sens sa présence entre les deux monts géants.
On conte, en effet, qu'autrefois les deux fiers rivaux, séparés seulement par la plaine et le petit lac, se combattaient sans cesse à grand renfort de tonnerre et d'éclairs. Sans cesse, la colère chargeait de nuages leurs fronts sourcilleux, et de continuels ouragans désolaient la contrée. Enfin, les habitants recoururent à Dieu, et le supplièrent de mettre un terme à la haine et aux luttes des deux terribles chefs des montagnes de l'Orient et de l'Occident. Dieu eut pitié d'eux et jeta entre le Guérioun et le Nif-en-Nser cette autre montagne, petite, mais pleine de sagesse et d'esprit de conciliation. Elle sut apaiser les deux adversaires, et les habitants, rendus au bonheur et au repos, l'appelèrent la montagne de la Pacification.
Le soir, nous vîmes arriver M. le général de Ladmirault, parti le matin de Batna. II venait de commander, pendant quelques semaines, la subdivision dont cette ville est le chef-lieu ; une nouvelle décision l'ayant appelé à un commandement beaucoup plus envié dans la province d'Alger, il avait voulu parcourir et apprécier le gouvernement qu'il allait quitter. Les ressources et la richesse de la subdivision de Batna l'avaient frappé, et il nous faisait part de sa surprise. a C'était, disait-il, le plus beau commandement de l'Algérie. a Il y avait trouvé partout le calme, une population assez serrée, le commerce et l'agriculture en vigueur, l'administration française acceptée, obéie. Le général m'avait connu en 1839 et 1840, à Coléa, où je commandais l'artillerie du camp sous les ordres du colonel de Lamoricière. M. de Ladmirault était alors adjudant-major des zouaves, et l'un des officiers les plus estimés parmi ceux qui avaient, à cette excellente école, appris la guerre d'Afrique. Nous devisâmes longtemps du passé et de nos amis communs, puis du présent et de l'avenir de Batna, dont les cartes étaient déroulées sous nos yeux.
Le matin, après avoir dit adieu au général, nous continuâmes notre route vers le sud. Après 5 kilomètres, nous franchîmes le col presque insensible qui sépare les deux régions, et nous aperçûmes à notre droite un lac s'étendant sur une longueur de 3 à 4 kilomètres, au pied du Nif-en-Nser. Une longue bande de flamants s'en éleva, volant en lignes régulières et faisant briller à la fois, suivant des évolutions exécutées avec un remarquable ensemble, ou le pourpre de toutes les ailes, on le blanc de tous les corps.
D'autres oiseaux aquatiques sont toujours en grand nombre au bord des lacs. Bientôt un second lac s'étendit à notre gauche, et nous nous trouvâmes sur une étroite langue de terre où se montrent pour la première fois, à ma connaissance, depuis la nier, des rochers (le sulfate de chaux cristallisé.
Après une étape de 28 kilomètres environ sans eau potable (celle des lacs est chargée de sels et surtout, je crois, de sulfate de chaux), nous trouvâmes un ravin plus profond que les précédents, et qui remonte à grande distance dans une plaine peu accidentée. Peu à peu il devient humide, puis on trouve quelques flaques d'eau, puis une eau courante, vers laquelle se précipitent bêles et gens. C'est l'Ain-Yagout (fontaine du Rubis), près de laquelle j'avais campé, en 1847, au milieu d'un paysage désolé et couvert de neige. Aujourd'hui, je voyais de loin une grande construction en maçonnerie en marquer la source ; c'est le sceau de la civilisation imprimé au front de cette sauvage nature ; et là, comme presque toujours dans cette province, c'est un bienfait qui signale l'intervention française.
Dans ce lien de halte obligée, le voyageur isolé trouve un abri contre la tempête et les bêtes fauves; la source, reçue dans un conduit en dalles, lui fournit une eau toujours pure et commodément disposée; une tribu, établie au pied du caravansérail, profite de l'abreuvoir et des petites dépenses des voyageurs ; elle veille à leur sécurité et fournit un relais à la poste. Enfin, au besoin, le caravansérail deviendrait une forteresse, et sa vue seule impose la tranquillité au pays. Si l'on parvenait à planter les bords de l'Ain-Yagout, à garantir ces plantations de la dent des chameaux et de l'insouciante malfaisance des Arabes, sans doute on prolongerait son cours, et l'on augmenterait, au grand bénéfice de la contrée, le volume de ses eaux.
Pour la première fois depuis Constantine, on trouve un peu de bois entre les lacs.
Entre Ain-Yagout et Batna, les signes de la transformation de cette contrée se multiplient. Ce sont d'abord des maisons de caïd, plus loin des moulins que fait tourner la rivière qui vient de Batna. Entre les deux, les ruines d'une ville romaine et le point d'où l'on voit, au loin, le Madrassen, monument d'une époque antérieure à la domination romaine et que les Français désignent sous le nom de " tombeau de Syphax "
Dans toute cette partie du voyage, on aperçoit le Djebel-Tuggurtb, à la cime conique couronnée de cèdres. Il est réellement à 3 lieues sud-ouest de Batna.
Enfin les montagnes qu'on laissait à gauche s'effacent et laissent voir la plaine de Chemora, au sud de laquelle Lamboesis s'appuie aux pentes des Aurès. La vallée que l'on vient de remonter s'élargit en continuant à s'élever vers le sud, sillonnée par les mille sentiers qu'y ont tracés les caravanes et les grandes migrations annuelles, dont c'est là la route principale. Batna est à la rencontre de ces deux larges trouées ouvertes aux vents dont s'abritait Lamboesis. Les édifices grands et réguliers que le génie affecte an service des troupes y tiennent la place principale.
Plus près de la rivière et des jardins sont les constructions basses qui complètent le camp; puis, au delà du rempart et d'un fossé, la ville, que j'avais vue dix-huit mois auparavant et que je retrouvais deux fois plus vieille qu'à mon premier voyage. Je passai une partie de cette journée à admirer avec une vraie joie les progrès qu'elle avait accomplis dans l'intervalle. Ses plantations s'étaient étendues; sa pépinière avait pris, sous l'intelligente direction d'un officier de la légion, un développement considérable. Deux fois la ville elle-même avait franchi les enceintes qui devaient l'enfermer. Ses progrès m'intéressaient comme ceux de l'enfant qu'on voit avancer en âge. J'avais vu, l'année précédente, en passant de l'expédition des N'Memchas à celle de Bougie, Sétif, alors vieille de neuf ans, et représentant un moment déjà plus avancé de l'enfance des cités.
Nous passâmes la journée du 26 à parcourir, guidés par nos camarades de l'artillerie et du génie, les ruines de Lamboesis, à lire les inscriptions, à compléter en pensée les monuments mutilés. L'insouciance arabe et le climat de I'Algérie ont préservé ces souvenirs du passé comme aurait pu le faire la lave d'Herculanum ou la cendre de Pompéi.
CHAPITRE III
DE BATNA A BISKRA.
Nous quittâmes Batna le 27 à midi. Le matin, les dix canonniers qui devaient me suivre dans tout le voyage s'étaient mis en route, et nous les joignîmes à cinq heures aux Ksours. Cette étape se fait, comme la dernière partie de la précédente, dans une vallée d'une lieue de largeur, fermée de hautes montagnes des deux parts. A gauche est l'Aurès, presque partout impénétrable ; à droite les montagnes du Belezma. La route suit le pied de l'Aurès. Les pentes de celui-ci sont boisées en cyprès, en tamarins, souvent égayées par la verdure plus fraîche des pins d'Alep et presque toujours couronnées par des arêtes de rochers. A quatre lieues de Batna environ, on franchit sans s'en apercevoir la ligne de séparation des eaux. On campe, aux Ksours, au bord d'un affluent de l'Oued-Djedi.
Le lendemain, nous suivîmes la vallée de plus en plus tourmentée qui traverse l'atlas du sud. Souvent il fallait passer la rivière, souvent monter, plus souvent et plus longtemps descendre; car on s'abaisse, pendant cette étape, de 500 mètres environ. Nous nous dirigions sur le Metlili, comme, les jours précédents, nous avions marché sur le Guérioun, le Nif-en-Nser, le Tuggurth. Sur toute cette route, des montagnes remarquables semblent veiller, sentinelles gigantesques, pour indiquer le chemin au voyageur et lui marquer d'avance le terme de sa journée.
Enfin, vers quatre heures, on a traversé une dernière fois la rivière. La route, désormais tracée avec l'énergique fermeté de la science et le travail patient de la civilisation, s'élève en s'attachant au flanc du Metlili. A gauche, la rivière devient plus profonde; à droite, la montagne plus abrupte. Devant soi, on voit une autre montagne arriver à angle droit sur le Metlili, s'infléchir en l'atteignant, et incliner fortement les assises de ses rochers, comme si le sol manquait à sa base. Les deux chaînes semblent s'être rencontrées et fermer tout passage. Bientôt, en effet, les rochers s'accumulent; la route n'a pas d'issue, barrée qu'elle est par une avalanche de pierres.
A ce moment un pont hardiment jeté vous ouvre accès sur l'autre rive. Vous vous y engagez inquiet, presque oppressé par cette absence d'horizon.
A peine avez-vous fait quelques pas, du moins il en fut ainsi pour moi, qu'un cri de surprise et d'admiration vous échappe : un autre monde vous est apparu!
Qu'on me pardonne de m'arrêter sur cette impression, la plus vive que l'aspect des beautés naturelles m'ait jamais fait éprouver. Quiconque aura, comme je l'avais fait, parcouru péniblement les 34 kilomètres qui précèdent et arrivera à El-Kantara un peu avant le coucher du soleil, la ressentira au même degré. C'est au moment où les montagnes se sont, à la fois, haussées et dénudées autour de vous, où tout le paysage s'est fait affreux, triste, obscur, - que tout à coup, à travers une étroite et longue brèche, vous retrouvez les horizons lointains, les teintes chaudes du soleil couchant; et, à 500 pas de vous, un bouquet de 15.000 palmiers, à la fraîche verdure, comblant, comme un vase trop plein de fleurs, l'intervalle des deux montagnes ! A vos pieds bouillonne la rivière réfléchissant un ciel plus joyeux. Le monde du nord est derrière vous : voici la première oasis !
Désormais ces montagnes, à travers lesquelles il semble qu'un coup d'épée de Roland ait ouvert un passage, arrêteront les vents du nord. Vous n'êtes déjà plus dans les climats tempérés. Cependant, des chaînes plus étroites et plus basses barrent encore le chemin du sud. Ce n'est qu'à 50 kilomètres d'El-Kantara qu'on trouve le climat des tropiques et des différences tranchées, radicales avec les choses et les productions de l'Europe.
A SUIVRE
| |
BULLETIN N°11
DE L'ACADÉMIE D'HIPPONE
SOCIÉTÉ DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ET D'ACCLIMATATION
|
OBSERVATIONS
SUR LE MÉMOIRE DE M. L'ABBÉ MOUGEL
Relatif au Madrazen
Par M. GOUJON, architecte, membre titulaire.
MESSIEURS,
J'ai lu attentivement le Mémoire de M. l'abbé Mougel sur le Madrazen, et tout en rendant hommage au consciencieux travail de notre honorable collègue, je ne puis adopter ses conclusions, et me permets de faire à son sujet les observations suivantes
Le style indiqué par les chapiteaux des colonnes engagées dans la base du monument est le dorique grec, dont l'astragale est mal fait; la forme de la corniche, très simple, rappelle seule les monuments égyptiens : c'est un très fort cavé avec filet au-dessus, saillant sur une frise unie, séparée de l'architrave:par un simple filet. Ce genre d'architecture ne : permet pas de faire remonter la date de l'origine du monument bien au delà du temps d'Alcibiade et de l'expédition malheureuse qu'il .a dirigée sur la Sicile; car les temples grecs les plus anciens, construits en maçonnerie et de style dorique, paraissent avoir été élevés du temps de Périclès. J'en citerai comme exemple le temple de Thésée à Athènes et celui de Minerve, connu aussi sous le nom de Parthénon. L'imperfection du travail d'ornement indique un architecte venant d'un pays lointain, sans doute de la Grèce, et peu au courant du style qu'il a voulu imiter.
L'origine de ce monument ne peut remonter au temps où les dieux du paganisme étaient inconnus sur les rives de la Méditerranée et où le dieu Soleil aurait été considéré comme la seule divinité. Le culte du Soleil a existé un peu partout, mais c'est surtout en Perse qu'il avait la prépondérance sur les autres cultes; il avait les mages pour prêtres et le feu pour représentant sur la terre. On ne connaît pas les monuments anciens antérieurs à Cyrus qui pouvaient servir au culte du Soleil, et on ne peut les comparer au Madrazen. Tout porte à penser qu'il n'en a pas existé d'aussi important pour la forme que celui-ci.
La supposition d'un puits, ou tube, au centre du monument est toute gratuite. Rien n'indique l'existence de ce puits. Il a été fait un sondage à la barre à mine et à la profondeur de deux à trois mètres au milieu de la plate-forme du monument. Ce sondage n'a révélé que la présence d'un massif de maçonnerie, sans aucun vide. L'enceinte juxtaposée à l'est du monument, dont parle M. Mougel, est d'ailleurs hors de proportion par sa petitesse avec l'immensité d'un autel de ce genre. On ne peut se faire à l'idée d'un autel colossal à côté d'une enceinte insignifiante. .Elle devrait renfermer l'autel, si c'en était un. Le développement considérable des enceintes de temples est commun, dans la plus haute antiquité, à Ninive, à Babylone, aussi bien que plus tard à Palmyre. En Grèce et à Rome, elles étaient plus restreintes, mais toujours assez grandes.
Les pierres du monument sont calcaires. Elles ont été extraites dans le voisinage, et si quelques-unes avaient été atteintes par le feu, elles seraient ou réduites en poudre, ou fêlées, et ne rendraient aucun son.
Pour que les gradins aient servi à recevoir le peuple pendant les sacrifices, il aurait fallu qu'il eût existé un escalier pour y monter; on n'en voit aucune trace.
Il est parfaitement établi que les grands monuments funéraires isolés et connus pour leur haute antiquité n'ont servi à la sépulture que d'un seul souverain, et parfois à celle de sa famille. Nous en voyons la preuve dans les pyramides d'Égypte, dans lesquelles on n'a souvent trouvé qu'un seul sarcophage. Le tombeau de Mausole est aussi dans ce cas. En Grèce et en Étrurie, la même coutume existait. Le peuple était inhumé dans les nécropoles ; mais les rois ou les héros l'étaient dans des monuments généralement grands, qui leur étaient particuliers, tels que le tombeau de Patrocle sous les murs de Troie, celui d'Achille sur le promontoire de Sigée, et bien d'autres. Les fouilles faites dans le Madrazen n'ont fait découvrir à l'intérieur qu'une galerie très étroite pénétrant seulement jusqu'au milieu du monument et ne permettant pas de penser qu'on ait pu y placer plusieurs morts.
La forme générale du monument se rapporte de très loin à celle des pyramides, mais de très près à celle des anciens tombeaux grecs, qui le plus souvent se composaient d'un mur circulaire, vertical, plus ou moins élevé, servant de soubassement à un cône en terre, ou tumulus, qui le surmontait. Les tombeaux de Patrocle, d'Achille, etc., en Asie, ont été construits sur ce plan, et la même forme se retrouve dans une quantité de grands sépulcres. On peut citer à l'appui de cette assertion le tombeau d'Alyatte, père de Crésus, décrit par Hérodote. Les Phrygiens ont cité des tombeaux de cette forme chez les Amazones. En Étrurie, on a retrouvé des souterrains surmontés de tumulus, ou cônes en terre, placés sur un soubassement circulaire en pierres appareillées, avec une ou plusieurs portes. Plus récemment, chez les Romains, cette même forme existe encore, notamment pour le tombeau d'Auguste, I1 ne paraît pas que la forme en question, en grand ou en petit, ait été employée pour autel. Le culte des hauts lieux n'a donné occasion â aucune construction connue sur le sommet des montagnes. Le plus souvent les autels très anciens étaient formés par des amas de pierres brutes.
Dans l'état actuel des connaissances que l'on a du Madrazen, il ne semble pas avoir eu une autre destination que celle de tombeau. Les gradins en pierres y remplacent le tumulus en terre. C'est encore une preuve que l'ancienneté du monument est loin de se perdre dans la nuit des temps. Il n'est pas déraisonnable de penser que ce monument date de la fin de la puissance carthaginoise en. Afrique. L'idée de sacrifices qui ont pu être faits aux mânes du mort pendant un certain temps, près du monument, dans une enceinte restreinte ; paraît juste ; mais très probablement l'enceinte a été faite et conçue comme adjonction omise par les premiers constructeurs.
Il parait difficile d'admettre, ainsi que nous l'a expliqué M. le docteur Sistach, président de l'Académie, que le sang des victimes puisse, après trois ou quatre mille ans, avoir laissé des traces rouges dans une galerie comme celle du Madrazen. En effet, le sang se compose de trois éléments : les globules, la fibrine et le sérum. Si une partie du sang a pénétré l'enduit en question, ce ne peut être que le sérum, qui est peu coloré. Les globules et le sérum, dans lesquels se trouve la très petite quantité d'oxyde de fer contenue dans le sang, n'ont pu pénétrer l'enduit et ont dû être détruits par la putréfaction. Le peu de matière inorganique qui serait resté sur place a dû se confondre avec les matériaux du sol qui contiennent presque toujours bien plus d'oxyde de fer que le sang. Quant au sérum, s'il avait coloré les enduits, il les aurait colorés en brun et non en rouge, et surtout la couleur rouge n'aurait pu pénétrer à travers l'enduit, qui n'en a pas conservé trace dans son épaisseur, pour se retrouver sur la face attenante à la maçonnerie.
La couleur rouge de l'enduit dont M. Mougel a montré des fragments ne peut donc être attribuée qu'à une peinture d'ocre rouge. Les monuments .anciens ont souvent été peints avec cette couleur très commune.
M. GOUJON

Le Medracen en 2009

Tombeau du Kroubs 2009
|
|
GRAVURES et PHOTOS Anciennes
De BÔNE
Envoi de M. Cinobatti
|
|
|
| Pour nos chers Amis Disparus
Nos Sincères condoléances à leur Familles et Amis
|
Décès de M. Charles-Henri Pons
"Chers(es) amis (es),
Bonjour
C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Charles-Henri Pons qui s'est éteint brusquement le 11 octobre 2010.
Il était à peine âgé de 63 ans.
Ses obsèques ont eu lieu le 14 octobre 2010 dans l'intimité à Saint Jean le Blanc (45), sa résidence en France.
Accompagné de sa sœur Maryline et de sa nièce Patricia, Charles-Henri était avec nous en 2005 lors de notre premier retour à Bône. Il avait pu revoir son lycée et surtout Randon où il avait retrouvé son école dont son père était le directeur et où ils avaient passés toute leur jeunesse. L'accueil avait été mémorable.
Nous présentons nos sincères condoléances et notre soutien à sa famille et à ses proches.
Repose en paix, Charles-Henri !
J.P.B.
Décès de Mme Monique Bartolini
Epouse Villalonga
"Chers(es) amis (es),
Bonjour
J'ai la tristesse d'annoncer le décès de ma tante Monique Bartolini épouse Villalonga, partie rejoindre son époux Georges le 25 septembre 2010.
Elle était âgée de 74 ans.
Entourée de ses enfants, familles et nombreux amis qui lui ont rendus un dernier et vibrant hommage, ses obsèques ont eu lieu le 28 septembre 2010 au cimetière de Grammont à Montpellier.
J.P.B.
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
|
|
| Bienvenue à nos Jeunes Pieds-Noirs
La Seybouse souhaite bonheur et longue route aux novis et leur présente ses chaleureuses félicitations.
Mariage de Pierre-Yves et Alexia
Chers(es) amis (es),
Un petit message à faire partager
Le dernier descendant du Docteur Teddé de Bône (rue à la Colonne Randon)
Pierre-Yves Teddé (fils de Bernard)a épousé le Samedi 12 Juin 2010 en l'église Notre Dame de La Ciotat la jolie Alexia.
Toutes nos félicitations aux époux et leurs Familles Teddé/Bailly de Bône et Bernet / Perettoni de Marseille.
Salutations fraternelles
Georges de Bône
|
|
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
De M.
Bonjour
Mon adresse :
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Septembre 2010.
Son adresse: http://www.piednoir.net/guelma
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
Le Guelmois
M. Antoine Martinez vous annonce la mise en service du nouveau site sur l'EXODE de 1962.
Son adresse: http://www.exode1962.fr/
Nous vous invitons à visiter ce site pour se rendre compte ce que fut cet exode.
Chers amis,
Pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, Skikdamag a migré vers WordPress.com. Ce n'est pas de gaieté de cœur mais nous y étions contraints faute de quoi votre blog aurait dû quitter définitivement la toile. Nous continuerons cependant à vous faire vivre de bons moments en vous rappelant de biens bons souvenirs en publiant, comme auparavant ; contes, anecdotes, photos, diaporamas, vidéos… pour l'heure il faut batailler pour récupérer l'essentiel de nos publications mais nous sommes déterminés et même si la tâche n'est pas facile, nous y parviendrons.
Pour le moment, pour accéder au site, vous pouvez conserver l'ancien lien à savoir : http://spaces.msn.com/members/skikdamag/ (une " passerelle " permettant la migration vers notre nouvel espace). Toutefois, n'ayant pas la certitude qu'à terme cette procédure soit maintenue, nous vous invitons, dès à présent, à utiliser la nouvelle adresse dont voici l'URL : http://jakcol6478.wordpress.com/
En nous excusant pour ce désagrément nous vous adressons toute notre amitié et espérons que vous resterez fidèle à SkikdaMag.
Jacky Colatrella et Claude Stéfanini
jpp-lecteurs de Flash-15-10-2010
Chers amis, Nous sommes le 15 du mois d'Octobre.
56 ans plus tard et Comme depuis 1 AN, chaque 15 du mois PENDANT l'année scolaire.
'' FLASH'' le Journal des Etudiants Constantinois revient avec son N°9 d'Octobre 1955.
Vous pouvez continuer à revivre l'aventure FLASH - en visitant Le site d'André ADMENT. QUI n'a pas raté Ce rendez-vous
http://www.constantine.fr.
- ou en utilisant le lien (s'il fonctionne)
http://www.constantine.fr//pages_perso/peyra_flash/flash9-oct1955.pdf
Pour cette reprise 2ème année, 2ème équipe de rédaction, 6 pages grand format, vous REtrouverez les articles de Christian ARRIGHI, Michèle CARRON, Paul CLEMENTI, Guy COSTA, Jacques DESBOURDES, Gustave DESGRANDCHAMP, Jean-Pierre HASSAM, Jacques NOUCHY, Jacques RIVA, Guy SULTAN, Luc THIERY, et d'autres signataires plus ou moins anomymes dont C. C . (Hum !), Double Zéro ( ? ), le technicien de service pour la rubrique Photo (qu'il se signale si nous ne nous trompons pas), un ancien (déjà), une envoyée spéciale à Paris (Mode oblige),….
Vous saurez, grâce aux Publicités, que
- les derniers choix de disques de surprise-partie SE VENDENT CHEZ G. BOUCHET,
- vos lunettes préférées VOUS ATTENDENT à la Maison d'Optique Ch. SANTRAILLE,
- les meilleurs ouvrages pour ''bacheliers en devenir'' SONT REUNIS dans les collections Littérature et Philosophie de la Librairie CHAPELLE
Bonne lecture et au prochain numéro
Amicalement : jean-pierre peyrat
| |
| Le Caniche, le Léopard et le Singe
Envoyé par Henri
| |
|
Une vieille dame décide d'aller faire un safari photo en Afrique. Elle emmène son fidèle vieux caniche pour lui tenir compagnie.
Un jour, le caniche part à la chasse aux papillons et s'aperçoit qu'il s'est perdu. Errant au hasard en tentant de retrouver son chemin, il voit un léopard courir vers lui avec l'intention visible de faire un bon repas.
Le vieux caniche pense : "Oh, oh! Je suis vraiment dans la merde, là !"
Remarquant les quelques os d'une carcasse qui traîne sur le sol à proximité, il se met aussitôt à mâcher les os, tournant le dos au léopard qui approche.
Quand celui-ci est sur le point de lui sauter dessus, le vieux caniche s'exclame haut et fort :
"Ouais, ce léopard était vraiment excellent ! Je me demande s'il y en a d'autres par ici ?"
En entendant cela, le jeune léopard interrompt son attaque en plein élan, il regarde le caniche avec effroi et s'enfuit en rampant sous les fourrés.
"Ouf !", soupire le léopard, "c'était tout juste. Ce vieux caniche a failli m'avoir !"
Cependant, un vieux singe, qui avait observé toute la scène d'une branche d'arbre à proximité, se dit qu'il pourrait mettre à profit ce qu'il sait en négociant avec le léopard et obtenir ainsi sa protection.
Il part donc le rattraper, mais le vieux caniche, le voyant courir à toute vitesse après le léopard, réalise que quelque chose doit se tramer. Le singe rattrape le léopard, lui dévoile le pot aux roses, et lui propose un marché.
Le jeune léopard est furieux d'avoir été trompé : "Viens ici le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce qui va arriver à ce petit malin !"
Le vieux caniche voit le léopard accourir avec le singe sur son dos et s'inquiète : "Que vais-je faire maintenant ?"
Mais au lieu de s'enfuir, le chien s'assied dos à ses agresseurs, faisant semblant une fois de plus de ne pas les avoir vus, et juste au moment où ils arrivent à portée de voix, il s'exclame : "Où est donc ce foutu singe ? Ça fait une heure que je l'ai envoyé me chercher un autre léopard !"
Morale de cette histoire
On ne plaisante pas avec les vieux de la vieille. L'âge et la ruse arriveront toujours à triompher de la jeunesse et de la force ! L'astuce et l'esprit viennent seulement avec l'âge et l'expérience.
|
|






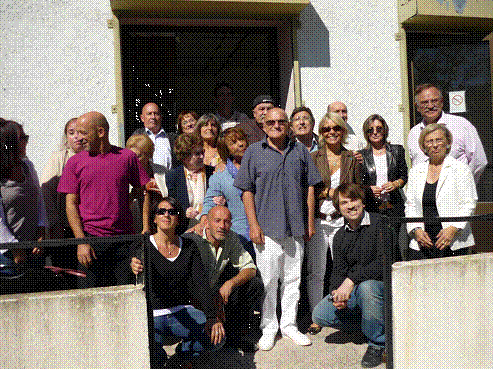


















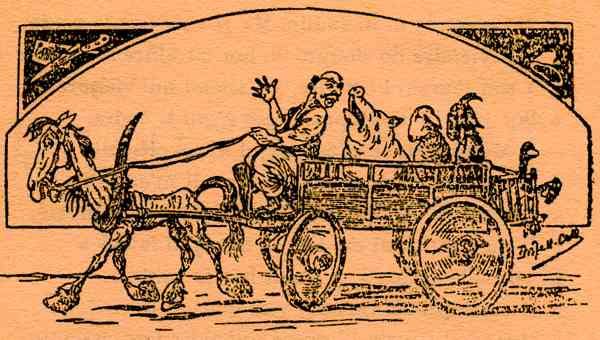


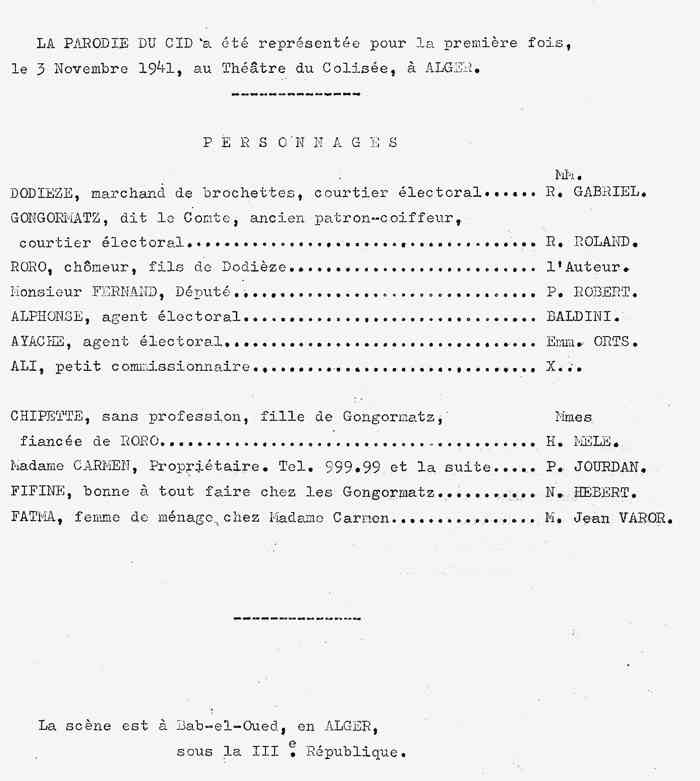



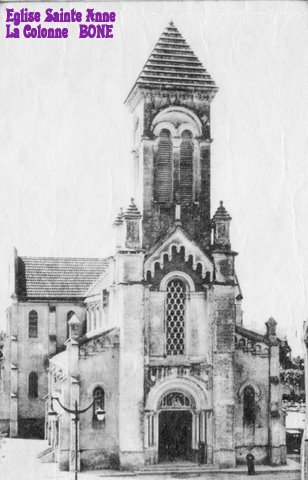








 Dès cette époque l'Algérie semble avoir connu une grande prospérité. Le Tell était déjà producteur de blé et l'agriculture se développa largement : la vigne, l'olivier étaient florissants. Les richesses minières étaient exploitées.
Dès cette époque l'Algérie semble avoir connu une grande prospérité. Le Tell était déjà producteur de blé et l'agriculture se développa largement : la vigne, l'olivier étaient florissants. Les richesses minières étaient exploitées.
 Cette accession au droit de cité et de citoyen romain avait comme base la langue. Le latin fut accepté, au moins dans les villes, avec la même facilité que l'avait été auparavant le punique. Avec lui s'intronisa le culte de Rome et des Empereurs, fondement moral de la puissance impériale ; en même temps l'ancien Baal Hammon se confondit avec Saturnus Augustus et même avec Jupiter Optimus Maximus, et d'autres cultes romains furent acceptés (la Victoire, la Fortune, la Paix). La facilité avec laquelle ces différents cultes s'ajoutèrent aux cultes anciens, ou se confondirent avec eux, permet de mesurer par comparaison la transformation que la conquête mulsumane a fait subir à l'âme algérienne.
Cette accession au droit de cité et de citoyen romain avait comme base la langue. Le latin fut accepté, au moins dans les villes, avec la même facilité que l'avait été auparavant le punique. Avec lui s'intronisa le culte de Rome et des Empereurs, fondement moral de la puissance impériale ; en même temps l'ancien Baal Hammon se confondit avec Saturnus Augustus et même avec Jupiter Optimus Maximus, et d'autres cultes romains furent acceptés (la Victoire, la Fortune, la Paix). La facilité avec laquelle ces différents cultes s'ajoutèrent aux cultes anciens, ou se confondirent avec eux, permet de mesurer par comparaison la transformation que la conquête mulsumane a fait subir à l'âme algérienne.
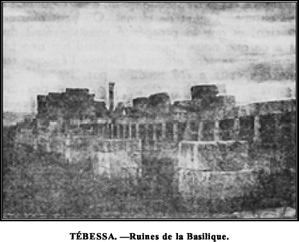 Le développement de la culture latine en Algérie favorisa, comme dans le reste de l'Empire, celui du christianisme. Au commencement du III° siècle, on signale la présence d'évêques de Numidie dans les Conciles tenus à Carthage, celle d'évêques de Maurétanie au Concile de 256; six ans auparavant un concile s'était tenu à Lambèse. La future Algérie fournit de nombreux martyrs dans les persécutions, notamment, de Valérien et de Dioclétien. Et, dès le moment où la conversion de Constantin assura l'appui officiel au christianisme, celui-ci connut une floraison considérable en Algérie.
Le développement de la culture latine en Algérie favorisa, comme dans le reste de l'Empire, celui du christianisme. Au commencement du III° siècle, on signale la présence d'évêques de Numidie dans les Conciles tenus à Carthage, celle d'évêques de Maurétanie au Concile de 256; six ans auparavant un concile s'était tenu à Lambèse. La future Algérie fournit de nombreux martyrs dans les persécutions, notamment, de Valérien et de Dioclétien. Et, dès le moment où la conversion de Constantin assura l'appui officiel au christianisme, celui-ci connut une floraison considérable en Algérie.
 Ils surent exploiter les divisions entre les tribus. Sans que le succès obtenu fût complet, un regain de prospérité s'affirma dans l'ordre généralement rétabli.
Ils surent exploiter les divisions entre les tribus. Sans que le succès obtenu fût complet, un regain de prospérité s'affirma dans l'ordre généralement rétabli.












