|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
236,
237, 238, 239,
240, 241, 242,
243, 244, 245,
| |
ET C’EST REPARTI !
Chers Amies, Chers Amis,
Comme l’année dernière, 2024 a démarré avec des manifestations, agriculteurs, pêcheurs, pour le pouvoir d’achat et que fait le pouvoir ? Il annonce des hausses de tarifs car il faut bien payer les dépenses qui ne concernent pas les français comme l’Ukraine, Gaza, Afrique, etc…
Bien sur, on a changé de 1er Sinistre car l’autre n’a gouverné qu’avec le 49,3, comme les retraites ou la loi immigration entre beaucoup d’autres lois avec la complicité des députés qui ne voulaient pas repasser par les urnes. Blanc bonnet et bonnet blanc.
Donc, on continue jusqu’à la révolution espérée par les néfastes du pays.
En attendant, le peuple a accepté les diktats sur les retraites, sur les hausses de tarifs, les restrictions de libertés… Les verts sont contents, ils engrangent les taxes additionnelles et continuent d’enfoncer le pays avec leur minorité agissante à Bruxelles. Ils sont comme leurs moulins à vent, leurs éoliennes qui coûtent une fortune au peuple qui les paye sur leurs factures EDF mais qui rapportent à la Chine et aux sociétés qui font des reversements occultent, à qui.. ?
Je me répète : Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme les actes de terrorisme avec les crimes qui suivent une courbe ascendante (plus de 700 actes en 2023), mais d’autres le feront mieux que moi avec beaucoup de virulence. Quoi qu’il en soit, citoyens du pays, prenez conscience de ce qui se passe. Ne laissez plus vos libertés s’envoler plus qu’elles s’en sont déjà allées ! Ne laissez plus s’effacer les acquis que vos ascendants ont gagné à la sueur de leurs batailles ! Les élections Européennes arrivent, envoyez un signal très fort aux dictateurs du « gouvernement de l’Europe ».
En attendant, bonne chandeleur.
Bon mois de Février à tous et toutes
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
« TONTON POURQUOI TU TOUSSES ! »
Envoyé par M. Georges Barbara
|
UN PLAGIAT du SKETCH DE FERNAND RAYNAUD….
.
CASTING :
 JEANNOT BELVISO :….. Un mafieux de première, chickeur sur les bords….. Il tient un Bar dans le quartier de la place d’Armes à Bône. Plus précisemment rue Louis Philippe JEANNOT BELVISO :….. Un mafieux de première, chickeur sur les bords….. Il tient un Bar dans le quartier de la place d’Armes à Bône. Plus précisemment rue Louis Philippe
GUGU : Le neveu de Belviso, quelque peu simplet, qui vit aux crochets de ce milieu malsain... une vraie Gougoutse. Celui-ci a été à son insu, chargé de passer de la cocaïne au Liban. ( il ne se doute de rien le pôvre )
La scène va se dérouler dans les bureaux de la douane à La Croix, poste frontière Tunisienne, où il est depuis peu en garde à vue, avec sa marchandise. Il appelle donc son oncle au téléphone !
GUGU - » Allo c’est bien le 46 à Bône ? Allô Jeannot ? C'est Gugu !….. Allô ? ….Allô Jeannot ? Eh madone,... c’est Belviso qu’y l’est au bout du fil ? ALLO !
Et Diocane, tu te rencontres toi, avec ces cats de téléphones de main’nan ... Va t’entendre quelque chose toi ? C’est quoi encore ça qu’y nous ont inventé ces fugures écrasées des chinois, ouille’man ? Allo ?…. Jeannot ???...Ouais !!! c'est Gugu « « J’suis bien chez Belviso à Bône ??? Ouais, Pisque j’te dis que c’est moi o tonton, c’est GuGu, GUUUU …..GUUU ! Diomadone ! Ah ‘oila t’yentends main’nan ?
JB- » Ouais, Ouais !
GUGU- » Alors, ‘oilà pourquoi j’t’appelle... Tout y va bien tonton ! Et non, et pis de quoi t’ya peur ? Et n’a pas peur O Falso ! Ouais,….ouais. J’suis en train d’ passer la frontière Tunisienne à La Croix, là je suis dans les bureaux d’la douane... Même qu’y z’arretent pas de fouiller le taxi d’l’arabe d’laCalle qu’y m’a amené ... Michkine ! Et main’nan moi, et ben J’suis dans le bureau juste en face de Monsieur le douanier qu’y l’est bien trop gentil. Ah c’est un brave homme, et te sais pas toi, ça qu’c’est rare, et ben y m’a même payé le café te t’rends compte !
Et pis alors, avant d’partir de Bône, j'ai bien pris le billet d’l’avion comme tu m’as dit.
A’c bien sur, direction Beyrouth au Liban pour apporter le colis. C'est comme ça que te m'as dit, non ? Ouais à l'adresse que te m'as marqué t’sur le morceau d‘papier.
Te veux que je t’la répète l’adresse Tonton ? Où qu'y faut que j'apporte le colis à Beyrouth ? Assaoir que des fois je me trompe.
JB- » - NON !!! NON !!!
GUGU- » Comment Non ???...Allô Jeannot ?
JB » - Keuf... keuf...keuf (et laisse que l’autre dans son café d’la rue Louis Philippe y te tousse sans arret)
GUGU- » Allô Jeannot... T’yes pas bien, ça va ? Et Madone, o Dandalon pourquoi tu tousses ? Comme te m’as dit, qu’il n’y a que moi avec cette putain de tête que j’ai que je peux traverser les frontières sans qu’ya personne qu’y fait entention. Alors où y l’est le mal, n’a pas peur !
Hé, Comment te dis… ? Que j’vais me faire romarquer ? Et non !
Dis on rovient aux choses qu’elles sont sérieuses, et ben ‘oila alors pourquoi j’t’appelle. C’est à cause des vingt kilos de la Carbonate de soude que tu m'as demandé de transporter au Liban...
Allô Jeannot…. ? Allô…. Jeannot ??? Pourquoi te tousses Diocane ? Arogards que tu nous as pas attrapé le COVID ! Juste main’nan ! Bois un coup aller !
Ouais,…. non, j’te parlais d’la carbonate...
( A debon on peut s’lever de bonne heure, avant qu’y te comprend quelque chose c’te fausse couche… A tous les coups y l’a du encore oublié de te mettre ses appareils auditives en dedans les oreilles!)
Je disais...LA-CarBoNate !!! LA CARR..BOO..NATE.. Madone ça qu’je parle c’est en français là ! LA Carbonate !
- Maaaa.. Par Saint Augustin cet enfifré de téléphone lui aussi !
Alors, carbonate... Je vais t’l’appeler
C comme C’est dangereux...
A comme arrestation..
R comme l’Air de rien...
(Ce boujadi y te comprend que dalle à ça qu’j’lui dis...T’ya beau l’appeler le mot,…. va va t’en toi de là, mais à qui te parles ?)
Allô Jeannot ? Adebon T’yes quand même stupéfiant te sais !
(Et Jeannot lui quartier libre, pire que cette locomotive du Bône La Calle, qu’elle est poussive, y te fait que de te tousser dans le téléphone )
Allô, Jeannot, et qué cats t’tya que tu tousses comme ça ? C’est pas normal que ta tousse a passe pas ! Arogards quand on a fini fais moi plaisir o tonton, va te voir un peu le docteur !
Alors, ‘oilà pourquoi j’t’appelle. J’suis dans le bureau en face du brigadier comme je t’ai dit, même qu’il est bien trop genti !. Ouais, y sont même venu aussi le lieut’nant et le commandant d’la brigade d’la Calle! Y sont familers ce monde là !. Y savent te recevoir !
Allô, Jeannot, encore te tousses ? Ma t’le fais exprés ou quoi ? Adebon si te continues comme ça, te vas t’affoguer ? Quoi ? Te me demandes où elle est la carbonate ??? N’a pas peur a risque rien,…. A l’est dans les mains du sous-chef douanier !
Ouais, alors ‘oilà, tu sais pas pourquoi j’t’appelle, euh, trois fois rien, c’est pas grave.
Te sais, les vingt kilos d’la carbonate ? Le douanier et ben il les a pesé... et là agas tiens toi bien, c’est la catastrophe….Y z’ont trouvé qu’il y a vingt kilos cinq cent.
Ouais, cinq cent grammes de plusque !.
Et alors ? Et alors, y z’ont le courage de me demander du fade et de payer une taxe pour les cinq cent grammes : Çà fait deux francs cinquante. Y z’y vont pas de main morte hein, mais Je trouve que c'est pas exessive !
Oui mais main’nan pour le reçu... ? ... J’dois le mettre : à mon nom ou à ton nom ???
- » Keuf Keuf !Keuf !Keuf ! ( et laisse le qu’y tousse l’autre )
Et c'est pour ça que j’te donne ce coup de fil Tonton ? Ouais c’est pour ça que je téléphone bien sur... Ouais pour ça Tonton… ! Et toi que t’ya attrapé la tousse main’nan !
Alors oui aussi, ya le chef là qu’y me demande l’adresse de l’expéditeur. Parce que, ton adresse exacte c'est bien 235 rue Louis philippe dans la vieille ville à Bône, le bar « Tout va bien », c’est ça ???
JB » - NON !!!( d’un ton sec)
GU- » Bon. Eh ben, écoutes, la p’tite taxe, qu’elle est tellement signifiante que je va la mettre à mon nom… Ah attends y faut que j’te dise aussi... Même le douanier laisse le qu’y se casse le ventre de rire. C’est bien la première fois que je vois un douanier qu’y te rit quand y l’est en service commandé... et pourtant c’est pas un dégourdi si t’le ‘ois hein ! Y l’a sur la tête de ma mère, tout de Paris soir j’te jure !
Ah attends j’allais oublier un petit truc, trois fois rien : tu sais qu’y z’ont analysé ta carbonate de soude !
Allô Tonton, pourquoi te tousses ? ( Oilà que sa quinte a recommence main’nan ! A la fin y va te cracher les poumons pas possible. Et arosement que c’est pas contagieux !)
Et ben atiens toi bien tonton…. Çette poudre blanche, y m’ont dit que c’est pas d’la Carbonate ! (rire)…...…. C’EST DU SUCRE EN POUDRE !!!
Allô Tonton ? T’yes pas bien ? ... Pourquoi te tousses plus ? Et y m’a même raccroché ce mal appris te crois pas ? (Putain dieu en préserve, te vois pas qu’y va nous faire un LA ..WC çuila main’nan non ? ) !…..
Tonton… ! Tonton…! Tontonnnnn !, fais le pour l’âme de tes morts…. Ne me laisse pas dans cette madone de caguade….ne raccroche pas !
Georges Barbara, Octobre 2022
|
|
| Il était une fois
Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.
|
Deux agents de Police Callois.
C'était une autre fois, dans la bonne vieille ville de La Calle et en ce jour-là, allez savoir pourquoi ? Deux de nos jeunes agents de police, tout juste sortis de l’école de police d'Alger, avaient décidé d'un commun accord, de faire une belle balade un après-midi sur la route du Boulif, en charmante compagnie de leurs épouses. Ils faut dire, que tous les deux, étaient mariés depuis peu, avec deux mignonnes et belles jeunes femmes. C'est ainsi, que par un bel après-midi ensoleillé, ils s'en allèrent tous ensembles jusqu'au Boulif, là, où, la route prenait fin.
Le temps était radieux et la nature superbe à voir. Des chants d'oiseaux, ne cessaient de venir rompre le silence des lieux et tout en bas la mer dansait dans son immensité et avait revêtue son beau vert émeraude le plus étincellant. Nos quatre tourtereaux très amoureux, ne cessaient de se faire discrètement, de petits baisers d'amour tout le long du chemin et arrivés à destination, ils devaient confortablement s'assoir, sur un arbre mort gisant au sol et poursuivre leurs ébats amoureux, en échangeant tout plein de mots gentils. Au bout d'un bon moment, l'un de nos agents de police, eu une idée remarquable en disant à son collègue et si on faisait un peu de tir au pistolet dans cet endroit, cet exercice serait sans danger dans la mesure où, le coin était désert de toute âme ? L'idée était très bonne et fut accueillie avec enthousiasme par toute la compagnie. Il faut dire que nos deux flics, avait gardé sur eux leurs armes de service et voulaient sûrement épater leurs jeunes épouses par leurs prouesses.
Non loin d'eux, se trouvait là un gros figuier de barbarie, qui se languissait au soleil et ils décidèrent d’un commun accord, qu'il leur servirait de cible. Après avoir fierement dégainé leurs armes, ils se mirent à canarder posément le pauvre figuier. Un coup de feu pour l'un d'eux, un autre coup pour l'autre. A ce moment, ils étaient particulièrement fier, d'un tel exploit devant leurs jeunes compagnes, lesquelles, quelque peu fières. ne cessaient de glousser de bonheur. Combien de temps, durèrent ces salves au pistolet ? Aujourd'hui, je suis incapable de vous le dire, mais, au bout d'un long moment, dans le lointain, un bruit de moteur de camions se fit entendre et ce bruit qui se rapprochait lentement, devenait de plus en plus fort et manifestement, il semblait que les véhicules, ne faisaient que se diriger dans leur direction.
Au bout d'un moment, à la grande surprise de nos deux agents de police, des G.M.C. apparurent tout à coup sur la route, avec à leurs bords une horde de soldats, qui sautèrent prestement des véhicules, pour se mettre en position de combat. Je vous laisse imaginer, la stupeur de nos deux agents de police, qui, voyaient soudain débarquer, toute une compagnie de jeunes appelés armes à la main. Pourquoi ? tout ce déploiment de militaires, qui ne trouvèrent sur les lieux, que deux jeunes flics très embarrassés et leurs douces compagnes.
Ce n'est que bien plus tard, que, j'ai pu avoir une explication, par l'un de ces braves agents de police, à l'occasion d'un grand Rassemblement des Callois à Giens dans le Var =
- Il faut dire, que les nombreux coups de feux tirés par nos deux flics, furent clairement entendus par les cultivateurs riverains, qui, un moment effrayés, ne manquèrent pas de sérieusement les inquiéter. C'est pourquoi, ils ont immédiatement prévenu les autorités Calloises, qui ont tout de suite diligenté les forces armées, croyant que ces tirs étaient le fait, d’une attaque d'un groupe de felhagas.
L'histoire devait ainsi se terminer, mais, pas pour les deux agents de police, qui, rentrèrent à La Calle, en rasant les murs la queue entre les jambes, sachant, qu'ils se devaient de justifier à leur chef, de toutes les balles tirées alors qu'ils n'étaient pas de service.
Cette petite histoire m'a été contée, par le regretté Charles DI AMOR +.
Charles DI-AMOR + et Daniel, alias Dédé VUOSO +.
Jean-Claude PUGLISI
de La Calle de France
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
( Hyères le 28 Avril 2023.)
|
|
|
LE STAC
Ange CARAMANTE
Echo de l’Oranie N° 267, janvier 2000
|
|
Quelle est I'origine de ce mot ? Depuis quand était-il employé dans nos quartiers?
Peut-être ce mot a-t-il été créé par les américains, lors de leur débarquement en Afrique du nord?
Peut-être l'origine est-elle plus ancienne et viendrait d'ailleurs?
Pas de réponse précise à ces questions, mais aujourd'hui, nous dirions "le lance-pierres" ou "la fronde". Là-bas, dans les années cinquante, nous disions « le stac» pensant même, que ce mot figurait dans le dictionnaire.
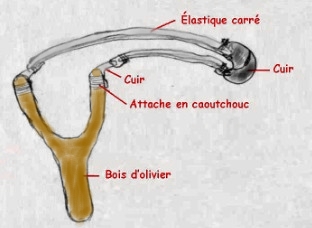 Mais qu'est-ce que c'était que ce stac? Mais qu'est-ce que c'était que ce stac?
C'était, disons, un outil, que chaque garnement se fabriquait lui-même et portait souvent autour du cou ou dans la poche arrière de son short (là-bas on disait «pantalon court"). Il servait, surtout dans mon quartier, à tuer les oiseaux.
Il nous arrivait aussi quelquefois de nous battre à coups de stacs, mais alors il fallait être en groupe et en colère, nous n'avions pas conscience, alors, que c'était extrêmement dangereux.
Pour "se faire un stac", il fallait avant tout repérer un olivier. Cet arbre était commun dans la campagne des faubourgs d'Oran.
Une fois au pied, nous cherchions une branche solide mais pas trop grosse en forme de "Y" dont les branches du haut formaient une courbe alors que le bas ferait office de manche.
Une fois la plus belle fourche choisie, il suffisait de vite grimper à l'arbre et de se servir du canif sans se faire repérer.
Ensuite, à la maison, après séchage, le stac était taillé pour lui donner la proportion voulue. Passé à la flamme, son bois durcissait et prenait sa forme idéale. Deux encoches pratiquées de chaque côté de la fourche permettaient de fixer solidement, avec du fil de fer, un élastique gris à section carrée (c'était le meilleur), comprenant en son milieu, donc à I'arrière, un rectangle de cuir destiné à recevoir le projectile. Celui-ci était le plus souvent, une pierre bien proportionnée ou une bille.
Le stac était prêt, ou presque. Il fallait d'abord l'essayer pour, éprouver sa solidité, sa maniabilité et son équilibre.
La main gauche empoignant le manche le plus loin possible devant le visage, bras tendu, il fallait tirer, avec la main droite, les élastiques par le petit rectangle de cuir contenant le projectile, et plaquer celui-ci contre la joue, un peu à la façon d'un arc. La main droite s'ouvrant, libérait les élastiques et la pierre passait entre les branches de la fourche en sifflant. On jugeait de la qualité de l'engin, à la distance parcourue, souvent plus de soixante dix mètres.
La dernière opération consistait à "vieillir" le stac, car il était hors de question de se montrer avec celui-ci s'il avait l'air neuf. On le roulait donc dans la terre pour le patiner. A force d'entraînement, nous tirions de plus en plus loin et de façon plus précise.
Certains possédaient plusieurs stacs : "des qui tirent loin,,," des qui visent juste", "des qui tirent haut" etc. Mais cet "engin" trouvait sa véritable vocation dans la chasse aux oiseaux.
Nous partions donc à deux ou trois, jamais plus nombreux, chacun armé de son meilleur stac vers la Cité des Palmiers ou la Cité Petit, où les oliviers s'alignaient en rangs serrés.
Il fallait d'abord se remplir les poches de cailloux ronds et bien calibrés. Cela nous prenait un long moment. Lorsque les poches sortaient sur les côtés du «pantalon court" tant elles étaient chargées, nous commencions la "chasse".
A pas lents, dans la terre rouge qui se soulevait et pénétrait dans nos sandales, nous cheminions, le stac armé, courbés, la tête en l'air, surveillant le moindre mouvement. Le silence était indispensable et il fallait progresser comme des chats.
Quelquefois il fallait guetter patiemment au pied d'un arbre, attendant que des oiseaux viennent s'y poser.
Il fallait alors repérer la cible la plus proche, ou la plus "intéressante», fort gênée par une quelconque branche et tendre son stac, viser attentivement, pour tirer. Il fallait le faire à coup sûr, car bien sûr, dès le tir effectué tous les oiseaux s'envolaient pour un long moment.
Mais bien souvent le coup portait et un malheureux «gorion», moineau, verdier, ou chardonneret, dégringolait de l'arbre, souvent "éclaté" par notre projectile.
Il suffisait de déposer le pauvre volatile dans un sac porté autour du cou, et nous repartions à la recherche d'une autre cible .
De temps à autre il nous arrivait de tomber sur des oiseaux de belle taille communes «gros becs", mais le plus souvent notre sac ne contenait que de petits oiseaux au plumage merveilleux que nous n'avions, hélas, garnements que nous étions, aucun scrupule à sacrifier.
Après notre partie de « chasse», nous allions chez mon ami Mohamed Bouzikri pour vider, plumer et flamber au *kanoun,, toute notre chasse. Nous dégustions avec plaisir,. chacun notre brochette d'oiseaux.
Maman eut la bonne idée un jour de faire disparaître mes stacs, et de m'inscrire autoritairement aux Scouts de France, pensant à juste titre qu'on me proposerait des activités plus... "éducatives".
Mais aujourd'hui, dès que je vois un olivier je me souviens des parties de stac avec mon cousin Guinou et mon ami Mohamed.
Janvier 2000
Ange CARAMANTE
| |
CONSTANTINE
par Jean Michel Leray
ACEP-ENSEMBLE N° 295
|
Caractérisée par sa situation physique sur un plateau rocheux culminant à 650 mètres d’altitude, cerné sur trois faces par l’oued Rhummel que la ville domine, face Sud, d'une hauteur de 105 mètres, depuis la grande arche de 70 mètres d’ouverture du pont Sidi Rached, à 175 mètres, face Nord, sous le pont suspendu et à 220 mètres au pied des chutes de Sidi M'Cid.
Le pont d'El Kantara, bâti par les Romains, tenait lieu d’entrée Est de la ville dont le quartier extra muros hébergeant le cirque.
Faute d'entretien par l’occupant arabe, celui-ci s'effondra et durant plus de deux siècles l'accès de la ville s’est fait, face Ouest par une crête étroite. La restauration du pont d’El Kantara fut entreprise par Salah Bey qui confia les travaux à I'ingénieur mahonnais Bartolomeï. La France réalisa, face sud, sous le pont Sidi Rached, le pont du diable, régulièrement mis à mal par les crues d'hiver, le magnifique ouvrage en pierre coffrant le béton, du pont Sidi Rached, la passerelle Perrégaux, la reconstruction du pont d’El Kantara, dont l’effondrement se fit derrière les talons du dernier soldat de la compagnie de fantassins qui venait de le traverser.
C'est en 2014, la population de la ville étant passée de 120 000 habitants en 1995 à près de 1 000 000 en 2010, que l’Algérie nouvelle construira un nouveau pont en 2014
Le pont Sidi Rached, comme le pont Suspendu, ayant en leur temps, représenté des prouesses techniques internationales, c'est à bon droit que Constantine doit en partie à ses ponts la renommée qui est la sienne.
C'est de la volumineuse collection de photos CAMPUS-MOUNIER constituée par Jean Michel LERAY, petit-neveu de notre concitoyen CAMPUS Edouard du Kroubs, qu'ont été extraites les merveilleuse vues des différentes étapes de la construction du pont Suspendu qui sont présentées ci-après.
C'est en votre nom que nous lui adressons ici, tous nos remerciements.
Fred ARTZ
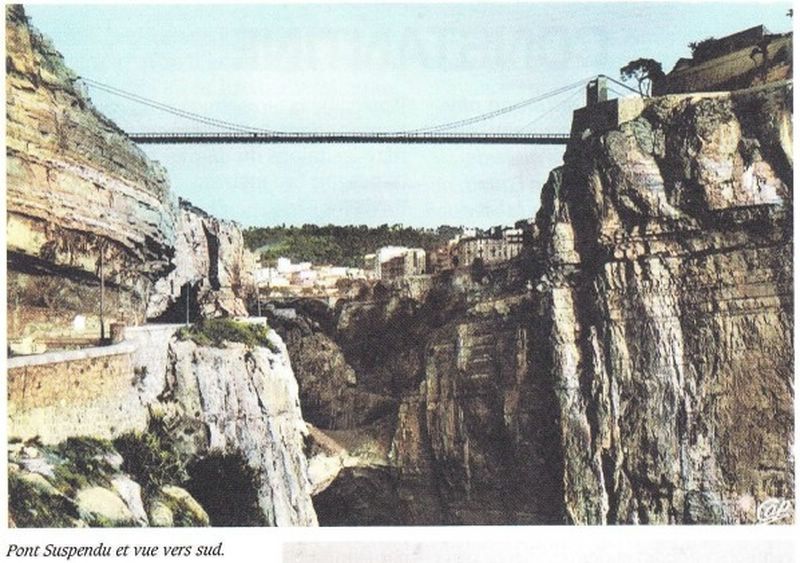
Histoire du Pont suspendu de Constantine
ou pont de sidi M’Cid,
dit aussi "passerelle de Sidi M'Cid.
Entrepris en 1911 sous le mandat d'Emile Morinaud, Maire de la ville et également Délégué à la puissante Commission des Finances de l'Assemblée Algérienne, il fut inauguré en grandes pompes le 19 avril 1912, en même temps que le pont Sidi Rached.
C'est un Pont suspendu à haubans, dit parfois passerelle de Sidi M Cid en raison de sa proximité avec le mausolée d'un marabout appelé Sidi M’cid,
Dominé par le monument aux morts, à l’époque surmontée de la victoire ailée, il relie les deux falaises des gorges 175 mètres au-dessus du cours d’eau il est long de 164 mètres et large de 5,70 mètres. Son poids est de 17 tonnes.
Conçu et construit par l’ingénieur Français François Ferdinand Arnedin il a été réalisé par l'entreprise Witte, immédiatement après la construction en 1908 du pont Sidi Rached.
Il fut présenté à la commission financière comme une passerelle pour piétons destinée à la traversée des gorges vertigineuses du Rhummel afin, d’accéder par le boulevard de l’Abîme et par la rue Danrémont sur la rive droite des gorges à I’hôpital (bâti en 1876). au monuments aux morts, au cimetière israélite, au faubourgs d'El Kantara et de Sidi Mabrouk supérieur.
La détermination du Maire fera qu’il sera, dés sa construction, accessible aux calèches et aux automobiles.
La subvention, inscrite au budget global du département de Constantine, s'élevait à 500 000F, le budget de la ville y contribuant aussi.
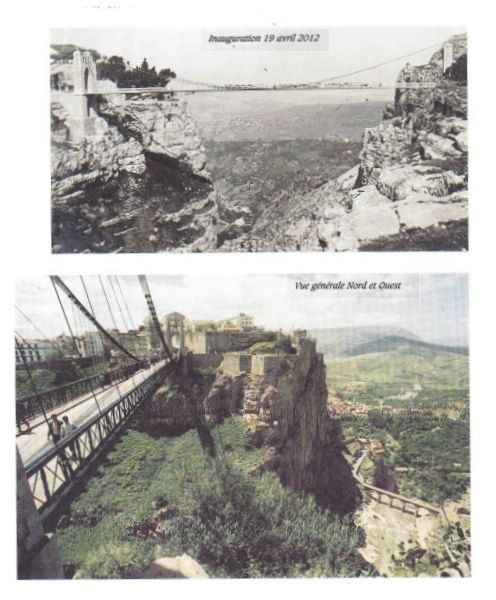 La traversée de l'ouvrage permet de contempler une superbe vue : au Sud, sur les gorges depuis le pont d'El Kantara, le faubourg du même nom à gauche et la ville arabe à droite ; au nord, sur les chutes du Rhummel, les cascades, le pont des chutes et, au-delà, sur la vallée du Hamma.
La traversée de l'ouvrage permet de contempler une superbe vue : au Sud, sur les gorges depuis le pont d'El Kantara, le faubourg du même nom à gauche et la ville arabe à droite ; au nord, sur les chutes du Rhummel, les cascades, le pont des chutes et, au-delà, sur la vallée du Hamma.
Hélas, tant avant qu'après I'indépendance de 1962, il sera le lieu de prédilection des âmes désespérées qui y trouveront le lieu grandiose mettant immanquablement un terme à une destinée sans lendemain.
Aux dernières nouvelles, la Ville a fait remplacer, en 2000, 72 câbles, dont 4 principaux.
Avec le génie et les labeurs déployés par la France afin de donner à Constantine les accès qui lui étaient nécessaires, la ville entrée de plein pieds dans l'ère moderne a bien mérité le surnom de «ville des ponts ».
Jean Michel Leray
Photos :collection Leray Campus.
| |
|
MUTILE N° 191, 1er mai 1921
|
ELOGE DU COLON ALGERIEN
Jadis, belle. Algérie, ton sol était stérile ;
L'haleine du désert martyrisait tes fleurs ;
L'oranger, l'olivier laissaient couler des pleurs
Et le troupeau, de faim, allait d'un pas débile.
Le Colon algérien, de sa charrue féconde,
Après de durs travaux, a reverdi les près.
Regarde étinceler les anciens minarets
Convoités par les yeux des Nations du monde !
Vois la belle campagne ! Elle toute fleurie !
Qui donc a ravivé et ton sol et ta vie ?
Ce n'est point Jupiter, car, regarde ma fille :
Là-bas, parmi ces blés, dis-moi, ne vois-tu rien ?
- France ! Mère ! Je vois la féconde faucille
Du joyeux moissonneur, le Colon algérien !
Joachim GAMPILLO.
| |
QUAND PEPE Y SE MET AU JUDO
Envoyé par M. Georges Barbara
|
 CASTING :
P- » Le Pépé ….Avec un gros rhume
F- » Frédo le petit fils, qui joue à l’infirmier CASTING :
P- » Le Pépé ….Avec un gros rhume
F- » Frédo le petit fils, qui joue à l’infirmier
F- » Aller o Pépé, te t’l’ouvres cette bouche de chcougniatte, au lieu de te faire ces grimaces ? Eh Diocane te crois pas que j’va passer ma vie dans ta chambre moi ? Que j’ai un monde de travail à faire c’matin !
P- » Et ben voila, plusque ça ouille’man, et qu’estce te veux encore par dessur le marché ! Te vas pas me faire sortir la mangeoire des fois non, pour tes caprices. Main’nan que pour une fois que te veux faire l’infirmière, te vois pas la patience que t’ya tout d’un coup a’c ton grand-père, o oualioune ?
F- » Et ben fais ça qu’j’te dis ...AAAAAAH!.... Aller ouvre un peu de plusque pour l’amour de dieu. Ouvre la en grand, Pépé !
P- » Qué AAAAAAH, tu vois pas qu’a debon si j’ouvre un peu de plusque la bouche, y va me tomber ce cats de dentier ? Et aussi que je m’arrappelle quand j’lui disais à Monsieur Aloï le dentiste, quand y m’a mis ce cataplase des fausses dents en bakélite dedans la bouche, que ce machin y l’était trop large. Encore y me rigole au nez cette fausse-couche ! Assaouare pour qui y m’a pris çuila la, cet aviateur de mes deux ! Et te ‘ois comme j’avais raison moi, que main’nan quand j’te mange un buftèque de chez Ciantar, tout le ratelier y se balade dans ma bouche ! Presque que je m’affogue j’te jure ! Mais crois moi aussi t’sur la tête d’ma mère avant que ce parvenu y me rovoit, même pas si Giovacchini y te passe maire de Bône !
F- » Aller marche, marche, ouvre-moi bien c’te bouche, oila c’est bon ! …..Dis o Pé, tu t’arapelles quand j’etais p’tit et que te me donnais le sirop de l’huile de foie de morue ? Tu me disais « une pour papa, une pour manman » ? Et adebon tu m’embrouillais bien bien, hein ! Alors que c’est mon tour main’nan, laisse que je rigole un peu !
P- » Ca y’es toi tu t’las prends à la légère quand moi que j’ai pas la tête à rire en ce moment je sais comment j’me sens !
F- » Comment tu t’sens, et ben y fallait que t’le penses avant. Pour l’amour de dieu, t’ya une putain de figure toi, vous avez vu le monsieur qu’y te voulait faire le jeune, main’nan y l’a aussi le courage de se plaindre non ? Et aller le Zazou de service y va encore faire les arappedes en bas des rochers du lever d’l’aurore en plein mois de décembre, et même quand ça te tombe en hiver ! Main’nan, t’yavais besoin toi de faire le fanfaron à 88 ans. Et ‘oila ça qu’il est arrivé...T’ya attrapé la crève, alors tu t’la gardes ! A’seul’ment toi que t’ya toujours été un madone d’orgueilleux, adebon ça qu’je ‘ois c’est que t’ya un pois chiche dans la tête. Et qu’y cats y va te changer à ton age ? Te vas pas nous lacher main’nan, non ? Surtout que maman l’autre jour a l’a dit à tata Lucie ...et là c’est la franche vérité, hein…. « Areusement que nous avons la p’tite pension des ponts d’chaussés de pépé pour nous payer un peu des caprices ! Le pauvre que le bon dieu y lui prête vie et qu’y vive 100 ans » !
P- » Atso, te m’apprends rien du tout là o Fredo, surtout quand ça vient de cette bella robe de ta mère, qu’elle est radin comme pas deux, elle qui te manges pas pour pas caguer ! Celle-là, mon fils, J’la connais comme si je t’l’avais fait !
F- »Te sais Pépé main’nan que j’te soigne, ça qu’je suis entrain de ‘oir, mais c’est pas possible ...comme si j’étais tombé le darrière dans un cageot des oursins !?
P- » Tu ‘ois quoi dans ma bouche ? Y me manque des dents, j’en ai envalées ?
F- » Non mais je ‘ois que t’ya un de ces madone de peignoir d’appartement dessur toi ! Et comme y dit Chichette : » Et Zeck le type y fait grand luxe madame Antoine...Grand luxe !
P- » Et oui c’est ta mère qu’elle a fait un fiel et qu’elle m’l’a fait cadeau pour la Noel...A’c le cheque de 100 euros que le gouvernement y l’a donné à tous ceux qu’y sont dans la mouïse comme moi. Te sais cette opération qu’y z’appellent ... « Quoique ça coute »…. Elle fait la large main’nant a’c l’argent des autres ! A pour ça a l’est bonne !
F- » Non j’te dis ça à cause d’la couleur que t’ya choisie, ça fait tout drôle...C’est plein des damiers !
P- » Et alors j’en ai rien à foutre moi, Et pis d’abord ça te gène les damiers ?
F- » Non mais toi que t’yes à fond pour la JBAC et que tu portes la couleur des maillots de La.. ESSE..BE ? Alors là enttention les yeux o oualioune..hein, on aura tout vu ! La honte elle risque pas de te monter à la fugure en venant vieux ?
P- » Aoua ! Qu’est ce te me dis là ? J’avais même pas vu. Où te ‘ois des damiers fais moi ‘oir un peu ? Ah oui atso ta mère celle-là, a changera jamais. A m’a même pas demandé ça que j’voulais dans la couleur. Te crois que on peut pas le rapporter pour qu’y vont m’en donner un autre à la place ?
F- » Ouais o Pépé, ça fait deux semaines que tu t’le portes t’sur le dos ce cats de burnous, qu’on dirait Marie la Longue de la rue Burdeau et que tu dors même avec ...Et main’an toi te te crois que la maison Laussat c‘est comme les chères sœurs de l’orphelinat ? Te l’as et ben main’nan tu t’le gardes.
P- » Dis moi Fredo, mon fils fais-moi plaisir tu donnes un conseil à ton Pépé, ...Comment j’va faire que Augu mon copain, que ta mère avec la langue qu’elle a, et que quand a l’a sort cette langue de vipère, adebon c’est pas pour lui faire prendre le frais, et ben a l’a été lui dire, que j’étais malade. Alors lui, comme j’le connais, qu’y l’est curieux comme une canule à lav’ment, et ben à tous les coups cet après-midi y va sur’mement venir me ‘oir !
F- » Et alors ? C’est gentil quand même non, ou y l’est le mal ?
P- » Non mais comme y l’est lui aussi pour la JBAC, y va te croire que main’nan comme le pourpre, j’ai tourné ma calotte dans les vieux jours!
F- » Et alors te vas pas le roce’oir en caleçon moltonais non des fois ?
P- » Ossinon si te veux que ça serait bien je pense, si te me passais comment ça s’appelle déjà ce genre de pyjama blanc que te mets quand tu vas faire le sport à la colonne… Ah oui le ‘Eskimono’ que ça va m’aller et que ça serait bien !
F- » Te veux dire le Kimono que je mets quand je vais faire le judo ? Mais t’ya un fromage dans la tête pas possible ?
P- » Et non, même qu’avec ça y me verra pas ce madone de ventre que j’ai !
F- » Bon si te veux Pépé mais pour que ce linge y te tient bien dessur y faut mettre la ceinture. Te veux ma ceinture aussi ?
P- » Ouais mon fils te seras gentil. Mais de quelle couleur a l’est ta ceinture ?
F- » A l’est marron c’est la ceinture qu’y z’ont droit les débutants !
P- » Les débutants ?...Aussinon...non attends c’est pas la peine, moi j’vais m’arranger pour la ceinture...je vais attacher avec ma cravate à la place, c’est la même chose. Tu sais celle que je mettais le dimanche pour aller à la messe !
F- » La cravate noire ? Mais Augu y va se croire que t’ya été champion dans ta jeunesse !
P- » Et pourquoi champion ? Mais qué cats te veux dire ! Alors là te me laisses axe !
F- » Et ben les ceintures noires c’est seulement que les champions qu’y te la portent dans le Judo !
P- » Ah ouais tu m’en apprends une belle là toi main’nan ! Et ben ; mange et bois, ça sera pas la fin du monde si le Gugu y va raconter dans toute La Colonne que j’ai été cravate noire dans le Judo !!!
F- » Bon avec tes embrouilles à la six quatre deux, pour le moment sorts moi en vitesse les pieds de la cuvette que l’eau a doit sur’ment t’etre froide depuis longtemps et entention que tu glisses pas, hein,. Pourquoi y nous manque plusque tu te casses un os par dessur le marché, alors là on aura gagné le grelot d’la loterie Algerienne !
P- » Ouais et pis ta mère comme tu disais, a perdrait ma pension et pour ses caprices a debon a l’ira t’les chercher à tataouine !……
F- » Aller bon Pépé moi j’me casse ….et à ce soir champion !…. Champion du monde ! Et main’nan te pourras plus sortir dans la colonne à cause que tous les enfants y vont te courir darrière en te criant….
« OH LE TEDDY RINER DU P’TIT JARDIN D’LA COLONNE» …...OH LE…...
Août 2022 Georges Barbara
|
|
| Les Filles de La Calle.
par Jean Claude PUGLISI,
|
| Filles de La Calle !
Filles de ma rue !
Filles de ma maison !
Il est grand temps aujourd'hui de vous rendre le plus affectueux des hommages.
Vous le susurrer par des mots tendres serait bien banal à nos yeux, et puis, après de si longues années, la timidité et la pudeur ne s'étant point altérées, comment vous dires de bien jolies choses aussi tendres que pures ? Avec infiniment de sincérité et au plus profond de nos âmes de Callaiouns.
Permettez-nous dans ces quelques lignes de chanter notre amour, en vous fredonnant doucement quelques petites parcelles de ces belles chansons d'hier et d'aujourd'hui, qui, bien mieux que quiconque, oseront enfin égrener toute la romance nostalgique des temps heureux de jadis.
C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile…
Mais c’est pour vous toutes ! Jolies perles de Corail du Bastion de France.
Pour vous toutes à qui vont s’adresser maintenant, toutes ces tardives mais sincères et belles déclarations d‘amour.
Si l'on chantait… Si l'on chantait... Si l'on chantait...
Oh, oui ! Chantons à cœur-joie mes frères.
Chantons encore et toujours ! Mais rien que pour vous, divines nymphes Calloises au parfum de bruyères.
Chantons en cœur mes amis ! Même si notre singulière romance, n’est faite seulement que de quelques petits bouts.
Elle est à toi cette chanson...
Mais aussi à vous toutes ! Superbes créatures du bastion de France.
Mais aussi à toi ! Que je n'ai pu oublier, ma douce et tendre petite sirène de la méditerranée Calloise.
Dans le soir qui descend doucement sur l’horizon lointain, élève lentement ton beau visage sur le ciel profond et pur de ces naïves canzonettas, et puis, regarde un moment toutes les étoiles du firmament, pour enfin choisir suivant tes sentiments l'astre qui te semblera le plus brillant et que dans tes beaux yeux le mieux se reflètera.
Alors seulement et pour toi seulement - sera destinée la chanson !
Aïe ! Qu’elles sont jolies les filles de mon pays...
Elles n'étaient pas que jolies, nos délicieuses petites Calloises !
Elles étaient plus que cela ! Le dernier chef-d’œuvre apporté à la nature, par les dieux du Bastion pour la mieux embellir.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison..
Quitté aussi peut-être pour toujours, nos deux éternels amours d’autrefois : La Calle et les filles de chez nous.
Il pleut sur la route, dans la nuit j'écoute, le bruit de tes pas...
Le temps qui passe ramène parfois dans les ténèbres d'une nuit sans sommeil, l'écho lointain et nostalgique de quelques beaux souvenirs à jamais enfouis.
Alors, Callois mon frère ! Écoute le vent qui hurle et le tempo monotone de la pluie.
Peut-être bien qu'un soir d’hiver il t'arrivera d'entendre par moment, le bruit léger de ses pas au-dessus du vacarme de la tourmente.
Ne souriez pas ! Chéries de nos cœurs.
Vous aussi, dites-le vous bien !
Vous êtes condamnée à subir toutes ces rumeurs d'autrefois, qui viendront sûrement papillonner tout prés de votre âme, pour sonner à toute volée dans votre cœur attendri, le plus beau des carillons de Saint Cyprien de La Calle.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... Tu vois ! je n'ai pas oublié...
Oublier le passé ! c'est un peu perdre la fraîcheur de son âme.
Soyez tranquilles et dormez en paix blanches Angelinettes, amours ardents des jours radieux de notre tendre jeunesse.
Tu vois, je n'ai pas oublié !
Mais aujourd'hui lorsque le ciel se fait triste et que bien grise nous semble la mer, que reste-t-il dans le plus profond de nos vieux couffins ? !
Sinon quelques beaux souvenirs d'autrefois et la douceur angélique des fruits merveilleux du jardin des Hespérides Callois : là, où les pommes faites d’or pur, font toujours courber docilement la branche.
Ma patrie, où le ciel et la mer me rassurent... La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs...
C'était là-bas, jadis sur les côtes de barbarie.
Il y a longtemps, si longtemps déjà.
Et pourtant mes amis ! là-bas rien n'est changé.
Le ciel est toujours bleu dans son infinité et la mer immense poursuit inlassablement sa danse éternelle le long des golfes clairs.
Une cloche sonne, sonne...
Je m'souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu...
C'était Saint-Cyprien de La Calle de France.
Sonnent, sonnent toujours dans nos têtes Joséphine et les autres : nos trois cloches elles aussi exilées quelque part du côté de Nice.
Un peu comme vous toutes merveilles de notre jeunesse, que nous allions parfois rechercher au coin de notre rue.
Mais hélas ! la rue de notre tendre enfance a depuis bien changé et s'il nous arrivait par quelque hasard de décider un jour de l'emprunter, le carrosse du passé ne nous conduirait nul part !
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent... Tchitche pescadore...
Sur les quais de chez-nous, il y avait Joseph et Janvier et puis Pien et Titin.
Félix et Toto et puis tous les autres - fièrement campés sur leurs bateaux.
Des Coundjadours attentifs et patients assis et courbés sur de longs filets.
Des piles de casiers vides bien rangés sur le pavé.
A côté faisant les cent pas on pouvait apercevoir, quelques coquets goélands en quête de beauté, côtoyant de près chevelure au vent, de gracieuses et riantes mouettes belles à croquer.
C'était vous mesdames !
C'était nous mes amis !
C’était un jour de promenade ! au bord de la mer le long des quais.
Elle était si jolie... Elle était trop jolie, quand le vent l'emmenait... Jolie... Trop jolie...
Il y avait vous ! charmantes demoiselles.
Il y avait aussi toi ! mon cœur.
Le vent ? il n'y en avait pas ! Car c'était le temps de l'été - l'été de nos jeunes années.
Que vous étiez belles et sublimes filles des temps jadis.
Belles à rêver, belles à croquer, belles à adorer !
Aujourd'hui, j'ai voulu vous rendre le plus parfait des hommages que vous méritez, alors, mes chères petites Calloises, SVP, ne riez pas de ma naïveté et surtout soyez gentilles :
Laissez moi chanter et encore chanter, pour ne pas pleurer !
Tout le bleu du ciel, danse dans tes yeux...
Mais, qu'est-ce que t'as dans les mirettes ? Mais, qu'est-ce que t'as !
Domino, Domino, le printemps chante en moi Dominique...
Au bal Dimanche, si mon cœur penche, ce sera sûrement pour elle...
La tacata tactique du gendarme...
Le plus beau, de tous les tangos du monde...
Vous permettez, Monsieur, que j'emprunte votre fille...
Pour une amourette, qui passait par-là...
J'ai perdu la tête, lorsque j'ai vu Suzette...
J'ai perdu la raison, quand j'ai rencontré Suzon...
Petit cordonnier qu't'es bête, bête...
Je te donnerai des perles de pluie, venues d'un pays, où, il ne pleut pas...
Elle m'a dit, d'aller siffler là-haut sur la colline... De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines...
Qu'il fait bon, sur la colline chanter tout là-haut... Là-haut, sur la colline, la colline aux oiseaux...
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir...
Ce sont les carabiniers de Castille, habits et galons dorés qui scintillent...
Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule...
Malgré tes baisers, tes caresses... Malgré tes serments, tes promesses...
Buongiorno tristessa... Malinconia… Malinconia...
Tu es partie un beau matin... Sans regret, sans chagrin...
Tu t'en vas...
J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours, ton retour...
Reviens, veux-tu, ton absence a brisé ma vie...
Impossible, de t'aimer davantage...
Mignonne, quand le soir descendra sur la plaine et que le rossignol viendra chanter encore...
Quand nous chanterons le temps des cerises... Les gais rossignols, les merles moqueurs, seront tous en fête...
Quand refleuriront les lilas blancs...
Je m'en vais revoir ma blonde... Un jour, tu verras, on se rencontrera, quelque part n'importe où guidés par le hasard...
Comme un p'tit coqu'licot, mon âme, comme un p'tit coqu'licot...
Docteur Jean-Claude PUGLISI,
de La Calle de France -
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage
Janvier 2002.
|
|
|
PHOTOS DE ALGER
Envoyées par M. Pernice
|
|
Algérie catholique N°8, 1936
Bibliothéque Gallica
|
La chasse au fiancé
L'élégante Hœlia, l'une des baigneuses les plus remarquées de la saison, se dirige nonchalamment vers le tennis.
La chaleur accable. La mer reflète un ciel lourd d'orage ; les flots prennent une couleur phosphorescente et les vagues se brisent sur les roches, avec un grondement sourd ; sillonnant l'immense étendue, des bateaux de pêche, aux voiles décolorées rentrent précipitamment au port pour y chercher un abri.
Mais, la promeneuse passe, indifférente à ce spectacle, si prenant pour d'autres. Que lui importent les beautés de la nature...
Elle vient ici, rendez-vous du «monde chic », pour y trouver le sport, le mouvement, les distractions ultra-nouvelles, et surtout... ! un fiancé...
Elle atteint vingt-cinq ans. Il est temps de clore sa vie de jeune fille. Elle a prévenu sa famille, ses amies, qu'elle allait prendre la peine de faire « une conquête », qu'elle annoncerait ses fiançailles en octobre et son mariage en décembre !...
Alors, c'est la chasse au fiancé Donc, les thés, les pique-niques, les jeux, l'esclavage de la mode, le teint de homard cuit, les bras enflés, brûlés, sous les coups de soleil, dont le dernier lui a valu deux jours de fièvre, à 39°. Simple détail !
Il faut bien suivre le courant, le devancer même, se fatiguer, se tuer, sur une plage «de tout repos » pour arriver à la victoire : les jeunes gens, s'image-t-elle, n'épousent que des femmes modernes. Elle a de la vogue..., le porte-monnaie garni, belle allure et parole séduisante ; autant d'atouts dans son jeu. Fatalement, elle a déjà reçu des hommages, des déclarations, mais elle les dédaigne royalement. Son choix s'est fixé sur un jeune homme distingué, intelligent, qui trop longtemps réservé à son égard, paraît lui accorder, aujourd'hui une certaine attention. A l'instant même, elle va le rencontrer au tennis.
Elle est donc sous les armes impeccable toilette blanche, sandalettes dernier cri, visage peint comme une voiture ! Le tableau doit être réussi ; elle vient d'y passer une grande heure.
Tout en marchant, elle poursuit sa rêverie, quand, une voix masculine jette, près d'elle : «Comme vous êtes absorbée ! Vous serait-il arrivé malheur ?...»
Elle a reconnu la voix de l'être désiré. Elle sourit : « Je prenais le temps de songer...
— Alors, asseyons-nous sur la plage, avant de gagner le tennis ? »
— Oh ! Parfait !...»
Cuirassée pourtant, elle éprouve une émotion. Serait-ce enfin le jour de la bienheureuse allusion qu'elle attend, qu'elle recherche ?
On échange des propos banals sur les baigneurs de droite et de gauche. Avisant au milieu d'un groupe d'enfants une lointaine amie de pension, Hœlia s'écrie soudain : «Voyez-vous cette personne au corsage clair... Croiriez-vous qu'elle était jadis la troisième d'une famille de dix enfants..., qui sont peut-être seize aujourd'hui ! Ajouta-t-elle en ricanant... Ses vacances se passaient à gouverner ses frères et sœurs. Elle y prenait son plaisir, disait-elle... Suivez-moi... Je ne résIste pas à l'envie de vous présenter quelques numéros de cette famille préhistorique. Vous jugerez et ce sera désopilant !...»
On échange présentations, amabilités et l'on cause.
Marguerite G., une belle jeune fille saine et calme, sans gaucherie aucune, parle des siens. Les trois aînés sont mariés ; elle est tante plusieurs fois. Trois autres travaillent et les cinq derniers sont aux bains avec la maman, qui s'est absentée pour aller chez le coiffeur.
« Vous étiez élevés à la baguette, questionna Hœlia ?
— Pas du tout, assure Marguerite. Mais, maman avait l'intelligence de ne nous passer aucun caprice. Chez nous c'est l'entente parfaite, la bonne humeur, la gaieté. Nous partageons les distractions et le travail.
— Vous assurez le travail de la maison ?
— Mais oui... Les quatre jeunes filles ont un emploi fixe qu'elles échangent chaque semaine. L'une se charge de la cuisine, l'autre du nettoyage, la troisième de l'entretien du linge, la quatrième des travaux de broderie ou d'art, pour la maison.
Nous ne nous ennuyons pas, soyez sûre !...
— Mais, à ce compte là, vous ne trouverez jamais à vous marier ! Eclate Hœlia qui ne contient plus son fou-rire.
— Oh ! Je ne le pense pas, ajoute près d'elle une jolie femme aux cheveux ondulés et à peine blanchis. Savez-vous, Mademoiselle, qu'une belle famille de douze enfants bien élevés, aux yeux des gens sérieux, c'est la meilleure des réclames ? Mes trois aînés sont fort bien établis et le sort des jeunes ne m'inquiète guère !
— Madame, reprend le jeune homme, comment avez-vous pu rester aussi jeune avec tant de soucis et de tracas ?...
— C'est ma fierté. Je parais l'aînée de mes filles ! Et, ma recette est toute simple. J'ai habitué mes enfants à l'obéissance, à la justice. Ils nous vénèrent. Nous nous entendons parfaitement ; le cercle de la famille nous suffit. C'est le bonheur qui m'empêche de vieillir !
— Nous vous aimons tellement, maman chérie ! Ajoute Marguerite.
L'intrigante Hœlia se retourne. Son fiancé éventuel fixe avec une admiration non dissimulée la vénérable maman et la sympathique jeune fille.
Elle brusque les adieux : «Nous allions oublier le tennis. Excusez-nous ! »...
Elle songe amèrement : «Je viens de faire une belle gaffe !...»
La saison se poursuit. Le fiancé rêvé délaisse Hœlia, le tennis, les parties bruyantes. Il se dirige souvent à la plage, vers une jeune fille réservée et simple, instruite et maîtresse de maison, délicate et dévouée, qui continue près des petits frères et sœurs son apprentissage de maman.
Et n'y tenant plus, il avoue son désir.
« J'accepterais peut-être après que mes parents auront pris les renseignements d'usage, dit Marguerite, si vous adoptiez le programme de famille. Nous sommes des chrétiens pratiquants, noues aimons la vie simple, les bandes d'enfants, le devoir, le travail... Réfléchissez ?...
— C'est tout réfléchi. Puisque (vous ne m'en voudrez pas) votre belle vie de famille et votre idéal, m'ont séduit, avant vous !...»
Et c'est ainsi que la mondaine et tapageuse Hœlia est rentrée chez elle, exténuée, rongée de jalousie, sans fiancé !...
Tandis que la calme et vertueuse Marguerite G..., murmure à son entourage la date prochaine de ses fiançailles.
Toute la nichée bat des mains.
«Quelle délicieuse mariée, tu feras ! » disent les grands
«Et quelle bonne maman ! » ajoutent les tout petits.
Jeanne TALLIER.
| |
M. Louis LAVIE
BONJOUR N°4 du 20 octobre 1932
journal satyrique bônois.
|
|
Politicien et homme du monde
Il y a des gens jeunes ou vieux, qui savent que même en période électorale la plus aiguë, il y a des trêves que le hasard produit et au cours desquelles les hommes doivent à leur prochain, et à eux-mêmes, d'être polis ou, tout au moins d'en avoir l'air. M. Louis Lavie, qui se prend pour un aristarque, ignore cela.
Si on lui demande ce qu'il est, il peut répondre : « Je suis le fils d'un homme considérable dans la région, fort riche, délégué financier, conseiller général, etc. » Ce qui est vrai. Il peut ajouter : « Je suis le gendre d'un homme non moins considérable, conseiller général, maire d'une grande ville, etc.. » Ce qui est encore vrai.
Ce jeune homme nous rappelle tel minus habens que nous connûmes jadis, ici, et qui, lorsqu'on lui demandait qui il était et ce qu'il faisait, répondait avec candeur : «Mon frère est avocat » M. Louis Lavie est fils et gendre, c'est tout. C'est peu.
Ce n'est pas son avis.
A pied ou dans sa superbe voiture, qu'il prend pour un trône, il fait du volume et de la poussière.
On se rappelle, non sans joie, qu'il se vantait auprès des dames et des demoiselles, lors de la dernière campagne, d'avoir, à chaque numéro, écrit « Le Cri de Bône » depuis A jusqu'à Z. Par parenthèses et si c'est vrai, nous plaignons les correcteurs dudit journal. Tout le monde sait que ce jeune érudit est parvenu à son bachot, encore n'en est-on pas bien sûr, à l'heure où les jeunes gens de son âge avaient achevé leur service militaire. On sait aussi que M. Louis Lavie, dans la rue, est un champion du «Bras d'Honneur » ce geste élégant ; ce qui établit, avec surabondance, les réflexes éclatants d'une mentalité raffinée. Pour fixer définitivement l'attention des foules et passer à la postérité, il ne manque à cette couronne qu'un fleuron. Outre qu'il est un politicien inutile, qui a fait rire ses adversaires et ennuyé fortement ses amis, M. Louis Lavie est-il mal élevé ? Il l'est. C'était en cette année 1932 qui fit la fortune des courtiers électoraux, L'Automobile-Club et le Moto-Club bônois donnaient leur diner annuel à l'Hôtel Continental. La Presse avait été invitée.
Quatre journalistes s'étaient réunis, deux à notre droite et un en face de nous.
A côté de celui-ci et séparé seulement par une jeune fille, vint s'asseoir un jeune couple fort plaisant à voir et inconnu de nous. Elle était charmante et blonde, sa robe de soirée de haut goût, peu de bijoux mais fort beaux et de valeur. Les cheveux calamistrés, habit de bonne coupe, plastron éclatant, rasé, ciré, verni, la bouche en fleur, content de soi, il était joli.
Les convives n'étaient pas encore tous présents. Le sympathique Président, M. Chaulet s'empressait au devant des retardataires.
On attendait. Les doigts distraits tapotant la nappe, le menu relu quinze fois, nous échangeâmes ces sourires vagues des gens de bonne compagnie qui ne se connaissent pas.
Enfin, le service commença. Après le potage, le jeune homme, aimable, prit une bouteille et servit à la ronde, notre verre compris. Le repas se poursuivit, excellent d'ailleurs, pas un repas de banquet, un vrai dîner de gourmands. Félicitations à l'Hôtelier.
Les quatre journalistes causaient entre eux de tout et de rien ; c'était pour eux, un repos.
Les langoustes cardinalices n'étaient plus que carapaces et le jeune homme bien habillé s'empara, de nouveau, de la bouteille. Notre tour vint. Machinalement, nous soulevâmes un peu notre verre. La bouteille passa par-dessus et servit le voisin.
Nous regardâmes le serveur croyant à une distraction. Son visage frais s'était ébouriffé comme celui d'un chat en colère, le regard fuyait et a bouche dessinait une insolence. La jeune femme avait un Contrôle parfait !
- Tous les Appareils de Contrôle marqué une nette surprise et sa gêne demeura pendant tout le reste du repas.
Dans notre carrière, longue, nous avons rencontré des gens de mauvaise compagnie sous tous les vêtements. La grossièreté était calculée et évidente. Que faire en ce lieu et en cette occurrence ? Rien ! Il fallait s'informer.
Entre-temps, le journaliste placé a côté de la jeune fille intermédiaire, et qui avait vu la scène, avait pris la bouteille et, avec un sourire, nous avait servi.
Qui est-ce, ce monsieur ? Avons-nous demandé à notre confrère le plus voisin.
Il se pencha et, dans notre oreille, murmura un nom. Tout s'éclaira.
Nous avions entendu parler, déjà, de cette personne et on nous avait signalé, à plusieurs reprises, ses écarts de langage et de geste.
Malgré les sollicitations dont nous avions été l'objet à son endroit, nous l'avions négligée. Lorsque l'on attaque un homme puissant on ne disperse pas son effort sur la marmaille qui l'entoure.
Tout de même, on demeure confondu devant une semblable offense d'autant plus inqualifiable que l'insulté avait plus du double de l'âge de l’insulteur et que, dans le moment même et en un tel lieu, elle demeurait impunissable.
Cependant que s'était-il passé ?
Notre voisin continua à voix basse : Il s'était informé avant vous, dit-il. Vous ne vous en êtes pas aperçu. Il a interrogé notre confrère qui est sur la même rangée que lui et celui-ci, par derrière la jeune fille qui les sépare, lui a passé votre nom écrit sur un morceau de papier.
C'était, précisons le temps, en pleine bataille du scrutin Serda-Pantaloni. Non loin de nous, était M. Munck, adversaire politique autrement redoutable. S'était-il aperçu du manège du sigisbée d'en face ? Nous ne le sûmes point et ne le saurons, probablement, jamais.
Nos regards se sont croisés à plusieurs reprises et, machinalement, nous nous sommes souri. Pour M. Munck, il y avait trêve, seulement, lui, c’est un homme bien élevé.
Le jouvenceau semblait ravi de son exploit. Il bissa puis trissa son geste. Chaque fois, ostensiblement, il servit à boire à ses voisins et, chaque fois, la bouteille passa par-dessus notre verre.
Sa compagne en paraissait peu fière et il nous apparut qu'elle le lui dît. Ajoutons, pour être complet, que, chaque fois, le confrère, qui s'amusait en silence, nous servit aimablement.
Il commençait à nous monter au nez une moutarde non prévue sur le menu. Nous nous demandions, si à la sortie, nous n'allions pas exiger une explication sévère de cet Antinoüs descendu du Pinde et qui s'était égaré parmi les humains. Diable !
Sa jeune femme ne le quitterait pas et on ne s'offre pas certains plaisirs devant pareil témoin. Comment faire ?
Le jeune homme nous tira d’embarras. De sa poche, il sortit un étui élégant, l'ouvrit et offrit des cigarettes ; un photographe connu qui était en face de lui, refusa et tout le monde imita le photographe.
Il ne nous offrit rien, mais, prit une cigarette. Sa compagne lui parla bas, à l'oreille, il haussa les épaules et flamba une allumette.
On n'était pas encore à la fin du premier service. Nous étions redevenu de bonne humeur. L'affaire se présentait bien, la punition venait et elle serait publique comme l'offense.
Pendant tout le repas, le jeune homme nous enfuma copieusement et les femmes qui l'entouraient durent, plusieurs fois, dissiper d'une main légère l'atmosphère embrumée et mal odorante que l'on supporte mal lorsque l'on mange. Sur une soucoupe, les mégots s'entassaient en cercle gracieux. Quelquefois, il les jetait par terre. Il paraissait très nerveux. Presque tout le contenu de l'étui y passa.
Le dîner prit fin. Le charmant causeur qu'est M. Chaulet se leva au moment du champagne et, en termes très heureux, dit son plaisir de voir réunis autour de lui ses invités. Il lut le palmarès de la course qui avait eu lieu le jour même et trouva, dans son esprit, assez de ressources pour décerner à chacun un éloge. On l'applaudit beaucoup.
Il y eut un court silence. Nous en fîmes notre profit. A voix haute et qu'on entendît fort bien, nous avons demandé a la ronde :
- Croyez-vous que, maintenant, on puisse fumer ?
- Certainement, si ! Répondirent sur le même ton tous les hommes de l'entourage. Personne ne regarda du côté du jeune couple. Nous, non plus.
Cependant, nous avons vu. La jeune femme eut un mouvement nerveux violent. C'était une victoire que nous n'avions pas souhaitée.
Mais les doigts du mari avaient cassé en deux une innocente cigarette d'un geste rageur. Ça, c'était gagné. C'est tout. Il suffit.
On se demande, en vérité, comment il se fait que, fils et gendre de deux hommes dont on peut ne pas partager les opinions politiques mais que l'on doit reconnaître d'éducation et de courtoisie que personne ne discute, M. Louis Lavie soit un garçon tellement mal élevé ?
Pierre MARODON.
| |
La Semaine Politique
Par : P.R.
Effort Algérien N°247, 28 octobre 1932
|
Le Parlement vient de rentrer : il a devant lui une charge formidable dont la moindre n'est certainement pas celle de trouver près de 9 milliards pour boucher un budget de 56 milliards.
Quand un individu n'a plus de sou, il a deux moyens de s'en procurer : taper son voisin ou réduire son train de vie.
L'Etal, qui vil de la substance des autres, choisit le premier remède. C'est commode... ça ne demande pas beaucoup d'effort...et quand on a la force pour soi, on est sûr d'arriver à son but.
Ainsi les belles promesses que l’on a faites au corps électoral au mois de mai dernier se sont muées en une vulgaire facture à payer !
Et le bon public après quelques grognements de façade — accepte cela, le dos courbé... prêt à crier aujourd'hui comme hier : Vive la République !..
Qu'on me permette de dire sans ambages que l'Etat se f… lui.
Quand on connaît le gaspillage qui règne en maître dans les deniers publics, on ne peut s'empêcher d'être indigné de cette façon désinvolte de pressurer le contribuable, le petit rentier, le petit fonctionnaire, l'ancien combattant...
On ne fera jamais croire à personne que sur 9 milliards à trouver, l'Etat ne pourrait pas en percevoir au moins les deux fiers sur ses propres caisses.
Quelle nécessité y a-t-il à avoir 30 ministres et sous-secrétaires d'Etal alors qu'une demi-douzaine suffirait ?..
Pourquoi trois directeurs de service là où un seul ferait l'affaire...
Et les écoles sans élèves ? El les tribunaux sans plaideurs ? El les employés sans emploi ?.. Et les monceaux de papiers pour un acte administratif insignifiant ?.. Et les prêts intempestifs à des gouvernements étrangers qui nous aiment dans la mesure où ils nous tapent ?..
De tous cotés on crie à l’Etat : Faites peau neuve, réformez-vous, réduisez votre train de vie.., modernisez vos organes...
Et l’Etat, paresseux et gouailleur, répond en nous montrant la grille du percepteur...
Pont cela aura un jour une fin : les institutions politiques ne tombent jamais parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles le deviennent.
P.R.
| |
| Instruction publique.
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Cultes : catholique, protestant,
israélite, musulman.
L'Algérie est la terre promise de la liberté de conscience, et on trouverait difficilement une autre contrée où des cultes aussi divers vivent en meilleur accord et sur un pied plus parfait d'égalité : l'église catholique à côté de la mosquée, le temple près de la synagogue.
Toutefois il ne faudrait pas induire de cette situation commandée par la diversité des religions que professe la population algérienne que les fidèles appartenant au culte catholique trouvent de ce côté de la Méditerranée plus de difficultés qu'en France pour accomplir les devoirs de leur religion, qui est celle de la grande majorité des Européens.
D'après le recensement de 1872, on en comptait près de 234.000 contre 6.000 protestants.
Alger est le siège d'un archevêché dont le titulaire, Monseigneur Lavigerie, a signalé son apostolat par la création de nombreuses œuvres catholiques ou de charité.
Oran et Constantine sont chacun le siège d'un évêché et, en 1872, on ne comptait pas moins de 221 paroisses qui, depuis, ont été très sensiblement accrues par la construction de nombreuses églises dont ont été pourvus ou seront pourvus les nouveaux villages créés depuis cette époque.
Dans le seul département d'Oran, douze églises sont actuellement en construction à l'aide de subventions de l'Etat.
Sous peu on ne verra pas un seul centre de quelque importance qui ne soit dominé par le clocher de son église.
Dès à présent les fidèles ont, en moyenne, beaucoup moins de chemin à parcourir pour se rendre le dimanche à la messe que les habitants d'un grand nombre de départements de la métropole.
Les secours religieux ne font donc pas plus défaut à ceux qui les réclament que les secours médicaux.
Les dépenses des cultes, sauf celles du culte musulman qui figurent aujourd'hui au budget spécial, sont inscrites au budget du ministère des cultes et de l'instruction publique ; elles se sont élevées, en 1874, à la somme de 1.052.000 francs.
150.00 francs sont, en outre, inscrits au budget spécial à titre de subventions aux communes pour construction d'églises.
Une part est également prélevée annuellement sur le budget spécial de colonisation dans le but de doter d'églises les centres nouvellement créés ; 46.500 francs ont été affectés à cet usage en 1874.
Des crédits également prélevés sur le même chapitre pourvoient aux frais de première installation du culte et à un service d'indemnités alloué aux curés qui desservent plusieurs paroisses en attendant la nomination des titulaires.
Un consistoire provincial, institué au chef-lieu de chacune des trois provinces, administre les biens consistoriaux et les établissements de bienfaisance protestante.
Les membres de ces assemblées sont éligibles : les laïques sont en nombre double de celui des pasteurs et sont choisis par parties égales dans l'Eglise réformée et dans celle de la confession d'Augsbourg.
La présidence des consistoires est annuelle et élective ; elle appartient tour à tour aux pasteurs luthériens er réformés.
Un consistoire provincial israélite existe également au chef-lieu de chacune des trois provinces ; chaque consistoire est composé d'un grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques qui choisissent l'un d'entre eux pour président.
Chaque consistoire a, en outre, un représentant auprès du consistoire central qui siège à Paris ; il nomme un délégué à chacune des synagogues de sa circonscription.
En 1872, on comptait 39.812 personnes appartenant au culte israélite.
La diffusion de l'instruction a été, dès le moment où la conquête s'est affermie, une des préoccupations les plus constante de l'administration supérieure.
Lorsqu'on en suit la marche depuis quarante ans, on demeure stupéfait de la rapidité des progrès accomplis.
Ils sont d'ailleurs hautement affirmés par ce fait résultant des constructions établies dans le rapport de M. Levasseur, membre de l'institut, sur l'instruction secondaire et primaire à l'exposition de Vienne, que l'Algérie, avec un élève sur 109 habitants appartenant à la population européenne fréquentent le lycée ou le collège, et 19,9 enfants sur 100, appartenant à la même population, fréquentant l'école primaire ou l'asile, occupent le premier rang, marchant avant : l'Allemagne, la France et l'Angleterre.
Suivant une expression très juste et très pittoresque de M. le recteur de l'académie d'Alger, les établissements de toute nature qui, de l'asile à l'école de médecine : distribuent l'enseignement, forment un vaste réseau dont les ramifications s'étendent aux villages les plus minimes et les plus éloignés.
L'école, en effet, avec l'église et la mairie, le premier bâtiment public qui s'élève dans les nouveaux centres.
En 1875, 64.397 enfants des deux sexes ont fréquenté les 73 écoles publiques ou libres et les 133 salles d'asile ouvertes dans les trois provinces et occupant, les premières : 1.149 maîtres ou maîtresses laïques et congréganistes les secondes : 247 personnes.
La population scolaire des écoles primaires proprement dites a été de 45.273 élèves se divisant, au point de vue du sexe, de la façon suivante :
garçons 23.852 - filles 21.421.
La part de la nationalité arabe, dans ce chiffre, a été seulement de :
1.643 garçons et 211 filles.
Quant aux établissements d'instruction secondaire ils se composent actuellement :
1° du lycée d'Alger recevant à lui seul 809 élèves et comportant un personnel de 86 fonctionnaires
2° de neuf collèges communaux entre lesquels se répartit une population scolaire de 1.623 élèves.
Constantine est à la veille de voir son collège communal qui a reçu 330 élèves en 1875 et dont l'aménagement ne laisse rien à désirer grâce aux sacrifices de la municipalité érigé en lycée.
Le collège d'Oran qui au 1er mai 1875 comptait 217 élèves ne peut aussi tarder de mériter cette distinction.
Le chef lieu de chaque province deviendra alors le centre d'un foyer d'instruction répondant aux aspirations les plus élevées de la population qui rayonne autour, tandis que les autres collèges communaux : deux dans la province d'Alger Blida et Miliana -- deux dans la province d'Oran Mostaganem et Tlemcen -- trois dans la province de Constantine Sétif Bône et Philippeville permettront aux pères de famille qui ne destinent pas leurs enfants aux carrières exclusivement libérales, de leur faire donner, à proximité de la maison paternelle une éducation correspondante aux professions qu'ils doivent embrasser.
Nous citons pour mémoire quatre établissements libres d'instruction secondaire.
Enfin l'Algérie compte quatre établissements d'instruction supérieur préparatoire de médecine supérieure : une école préparatoire de médecine d'Alger qui comporte onze professeurs titulaires ou suppléants et qui délivre des diplômes d'officier de santé de pharmacien et de sage-femme et trois chaires d'enseignement supérieur de la langue arabe une au chef-lieu de chaque département dont les cours sont destinés à perfectionner l'éducation commencée sous ce rapport dans les écoles et dans les collèges.
Une école normale à Alger pour les garçons et une école normale pour les filles à Miliana sont chargées de pourvoir en partie au recrutement du personnel enseignant des écoles primaires ; les élèves y sont admis au concours.
Leur instruction y dure trois années. Le prix de la pension est payé au moyen de bourses fondées par le département. Le personnel enseignant du lycée et des collèges est détaché de la métropole par le ministre de l'instruction publique et placé sous la haute autorité du recteur de l'Académie d'Alger assisté d'inspecteurs secondaires et primaires.
Le budget de l'instruction publique dans lequel l'état participe pour 245.000 francs environ, est annuellement de 2.378.000 francs dont 1.0526414 francs plus de la moitié, sont supportés par les communes.
Ce chiffre indique par lui-même l'importance des sacrifices que consentent les municipalités algériennes pour assurer aux enfants de leurs administrés les bienfaits de l'instruction primaire gratuite.
Des subventions de l'Etat des départements des communes permettent aussi de répartir au concours, entre les jeunes élèves les plus méritants, des bourses ou demi-boursess au lycée d'Alger ou dans les collèges communaux.
L'initiative privée participe de son côté à cette grande croisade contre l'ignorance cette grande plaie de l'humanité : en stimulant par des prix l'émulation des élèves en aidant par des dons la création de bibliothèques populaires ou scolaires.
A Alger et dans quelques autres villes, la ligue de l'enseignement a pu fonder à ses frais une bibliothèque des écoles en pleine voie de prospérité et des cours d'adultes qui, conjointement avec ceux que professent les titulaires des écoles communales partout où la population d'un centre est assez nombreuse pour leur assurer un auditoire, fournissent à la jeunesse et même à l'âge mûr les moyens d'utiliser leurs loisirs à la perfection de leur instruction.
Bien que forcément rapide en raison des dimensions que nous devons donner à cet ouvrage, ce tableau de l'instruction publique est suffisant, nous l'espérons du moins, pour enlever au père de famille immigrant en Algérie toutes les préoccupations qu'il pourrait avoir au sujet de l'accomplissement du premier et plus grand des devoirs qui lui incombent, donner à ses enfants une instruction et une éducation en rapport avec les professions auxquelles il les destine.
L'Algérie pratique par V. Loizillon Directeur
de la correspondance générale algérienne. 1876
| |
| Pistachier atlantique
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Cet arbre magnifique n'a été observé nulle part en massifs d'une grande étendue, et semble peu propre à entrer, en grande proportion du moins, dans la composition des forêts.
Il serait très bon au contraire, à employer comme arbre d'alignement et pour border les grandes routes, usage auquel convient si peu le mûrier blanc, le seul généralement adopté jusqu'ici pour les routes de l'Algérie.
Le caractère qui distingue cet arbre du lentisque ordinaire, c'est que les folioles au lieu d'être en nombre pair et opposées deux à deux, sont en nombre impair, ce qui donne à la feuille un aspect plus acuminé, parce qu'elle est terminée par la foliole impaire.
On en trouve de toutes les dimensions. Ils s'étendent en branches d'une manière extraordinaire, et l'on rencontre de ces arbres dont les rameaux couvrent une superficie circulaire de 20 mètres de diamètre.
Leur tronc est d'une venue droite et généralement régulière ; mais au-delà de deux mètres d'élévation ils se bifurquent et les branches s'y multiplient en telle quantité qu'ils forment, pour ainsi dire, une masse sphérique légèrement aplatie, qui, vu de loin, rappelle les arbres taillés des jardins.
La hauteur de ces pistachiers atlantiques n'est point en proportion avec leur grosseur ; le tronc mesuré à un mètre du sol, porte deux ou trois mètres de circonférence.
Cette disproportion entre la hauteur et la grosseur de ces arbres se remarque surtout chez les individus isolés, de sorte qu'il y a tout lieu de croire qu'ils s'élèveraient davantage si ces arbres étaient rapprochés en massif et convenablement dirigés.
Le bois du pistachier atlantique est : dur, compact, à grain très fin susceptible d'acquérir le plus beau poli, et présentant en cet état une certaine ressemblance avec le palissandre.
Il sera, à coup sûr, très recherché pour l'ébénisterie lorsqu'il sera connu.
Cet arbre, au reste, n'est pas particulier au Nord de l'Afrique, il a été trouvé aux Canaries, par M. Webb, auteur de l'histoire naturelle de ces îles et qui possède chez lui de très beaux meubles de ce bois, comparable, en effet, au palissandre. Ce savant rapporte dans son ouvrage, que ce bois est tellement dur qu'il est employé par les laboureurs du pays pour faire des socs de charrue, en guise de fer.
Il est compact, bien veiné et très propre à faire de beaux meubles.
M. le capitaine Durieu de Maisonneuve, frappé des avantages que l'on pourrait tirer de ce bois en Algérie, n'a négligé aucune occasion pour appeler l'attention : des directeurs des pépinières algériennes et des employés supérieurs de l'administration des forêts que cet arbre intéressant à plus d'un titre et qu'on a négligé jusqu'à ces derniers temps, parce que ne croissant sur aucune partie du littoral, il avait été peu remarqué.
Généralement les personnes qui rencontrent dans l'intérieur du pays quelques individus isolés les prenaient pour des lentisques gigantesques.
Sur les instances du savant botaniste de la commission scientifique M.Hardy, directeur de la pépinière centrale, a fait récolter un demi-hectolitre de grain de cet arbre qui doivent avoir été semés l'automne.
On rencontre le pistachier atlantique auprès de la province de Constantine, auprès de Mila et dans la province d'Oran sur l'Oued Safsaf à 40 ou 50 kilomètres Sud de Mascara, et dans la direction de Saâda, entre Aïn-Branès et Tarmaret.
Th. Scribe, Administrateur Gérant.
L'Algérie courrier d'Afrique d'Orient
et de la Méditerranée (01-12-1845)
| |
| Margaritas ante ...
Envoyé par M. Christian Graille
|
Malgré moi, je suis hanté par le souvenir de cette expression latine lorsque je songe à la visite annuelle que l'on fait faire aux jeunes moniteurs indigènes, tout frais émoulus du corps normal de la Bouzaréa qu'un cornac administratif promène à travers la France.
Ce n'est pas que je manque de sympathie et d'estime pour ces jeunes gens qui ont consacré leur intelligence : à apprendre notre langue, à s'initier à notre histoire, aux bienfaits de la science et qui ont le désir d'instruire, à leur tour, leurs coreligionnaires.
L'institution est bonne, elle peut, elle doit produire d'excellents résultats, mais tout en approuvant le gouvernement d'avoir fondé ces cours, qui sont une pépinière de jeunes maîtres destinés à franciser les Arabes, je ne puis m'empêcher de trouver que si un régime de faveur devait être appliqué, il fallait le réserver à nos enfants.
Cette caravane scolaire, dont la visite charme, à chaque vacance nouvelle, les loisirs de l'oncle Sarcey, est un privilège dont bénéficient seuls les indigènes et qu'on refuse aux jeunes Français qui sortent de nos écoles normales. Parmi ceux-là, combien n'ont jamais vu la France et ne la verront peut-être jamais !
Lorsqu'on se destine à l'enseignement, c'est assez généralement qu'on est peu fortuné, et les voyages d'agrément dans la mère-patrie sont rayés du chapitre des dépenses.
Certes les parents auraient été heureux de conduire leurs enfants au berceau de leur famille, de leur faire connaître la métropole et peut-être même Paris, quitte à faire un crochet à l'Est ou à l'Ouest, mais le budget ne permet pas de réaliser ce rêve que tant de jeunes algériens se plaisent à caresser et l'on se résigne, comptant sur quelque chance imprévue qui permettra l'accomplissement de ce souhait.
Ce qui est refusé à l'un des nôtres, dont les parents ont aidé à la colonisation de l'Algérie, un Mohamed ou un Abd-El-Kader quelconque, venu d'un point ou de l'autre du pays pour suivre les cours de la Bouzaréa, l'obtint de droit.
Et tout pimpant dans ses blancs haïks, ceinturé de couleur tendre, coiffé de l’irrésistible chéchia, notre jeune indigène s'embarque pour cette France qui ne lui dit rien, à lui qui est Arabe, qui ne parle ni à son cœur ni à ses souvenirs, où il n'a aucun des siens, voyageant en curieux, en indifférent ...
Il traverse des villes qui n'ont pour lui qu'une signification géographique et l'intérêt d'un tableau passant devant ses yeux.
On a publié les impressions de quelques-uns de ces touristes scolaires, et il est plus que probable qu'on a trié dans les meilleures narrations, néanmoins, on a été navré de leur nullité du superficiel des observations faites par ces voyageurs qu'on supposait ébloui par les magnificences de notre civilisation.
Notre industrie, nos mouvements, nos établissements de toutes sortes auraient dû remplir d'admiration ces jeunes naturels qui n'ont pas encor eu l'occasion de voir les merveilles du vieux continent.
Qu'ont-ils remarqué ?
Surtout l'effet qu'ils produisaient sur les naïfs et excellents roumis et plus encore celui qu'ils cherchaient évidemment à produire chez les roumias, les fines et élégantes parisiennes, aux irrésistibles séductions.
Ah ! la femme, la femme française voilà sûrement ce qu'ils ont le plus remarqué pendant leurs pérégrinations à travers la France, charmés d'attirer son attention et selon l'expression d'une fine observatrice pensant immédiatement un peu plus de mal d'elle et un peu plus de bien d'eux lorsqu'elle répondait à leurs œillades.
Ce n'est probablement pas pour faire ce genre d'études de mœurs que le ministre de l'Instruction publique fait accorder les crédits nécessaires à cette promenade à travers la France.
Cependant il est assez juste de penser que ce qui frappe le plus l'imagination de jeunes hommes de vingt ans, c'est cet éternel féminin, surtout lorsqu'il diffère autant de ceux qu'ils sont accoutumés à voir autour d'eux.
S'ils étaient consultés, ils préféreraient sûrement une soirée passée : aux Folies-Bergères, dans les Eldorados, des théâtres à exhibition de jeunes et faciles beautés plutôt qu'aux classiques représentations de la maison de Molière.
Mais le voyage est un voyage instructif, et il faut s'instruire, bon gré mal gré.
Si vous le trouvez si profitable aux jeunes intelligences, pourquoi ne le faites-vous pas faire aux Normaliens français qui sortent chaque année de nos écoles algériennes pourvus du brevet supérieur et destinés à instruire, à former leurs petits compatriotes ?
Parmi eux, beaucoup, nés dans la colonie, ne connaissent pas la mère-patrie et considéreraient comme une inestimable faveur un séjour, si court fût-il, dans cette France tant aimée, dont les vieux parlent avec un si filial enthousiasme. Pourquoi ne pas les traiter aussi bien que les moniteurs indigènes ?
On prétend que nous finirons par devenir séparatistes et qu'un jour ou l'autre nous briserons le lien qui nous unit à la patrie française. C'est une erreur profonde.
Les Algériens sont et resteront Français ; mais il faut bien convenir que le gouvernement s'y prend mal pour faire connaître et aimer la France aux fils de colons.
La presse, depuis quelques années, a pris à tâche de démontrer l'inutilité de la caravane scolaire indigène ; il n'est pas un d'entre nous qui, d'accord avec ses confrères, n'ait blagué les jeunes Anarchistes.
L'expérience est faite, elle est loin d'avoir réussi, après les notes de voyages recueillies par ces messieurs.
Eh bien ! qu'on la tente avec nos Normaliens français qu'on choisisse chaque année les meilleurs sujets de nos écoles et qu'on leur procure l'instructif agrément d'un voyage en France. On comparera ensuite les résultats.
Ce n'est donc pas la suppression de la caravane annuelle des jeunes moniteurs de la Bouzaréa que je demande, c’est simplement que cette faveur soit étendue à nos Normaliens.
A nos enfants, cette nombreuse et intéressante petite population qui fréquente nos écoles primaires, bénéficieront du voyage de leurs jeunes maîtres, car ceux-ci s'empresseront de leur redire leurs impressions et d'exciter leur amour pour cette belle France, qui nous est si chère et que beaucoup d'entre nous sont réduits à aimer de loin, sans oser espérer la connaître jamais.
Est-ce trop demander que de souhaiter voir les nôtres admis à profiter des avantages si libéralement accordés aux jeunes indigènes ?
G. A. L'Impartial oranais (04-10-1895)
| |
Souvenir du départ de 1962
Envoyé par J.P. Ferrer
|
|
Où es tu, mon pays ?
Comment te dire que tu n’es plus là
Je tends la main, je veux te sentir
Je me couche, avide, sur toi
Je te prends dans mes bras
Ton parfum est en moi,
Odeur d’épices.
Je ne t’ai pas quitté
Je ne t’ai pas oublié
Comment le pourrai-je ?
Aucun ciel au monde
Aucune mer au monde
Ne pourront te ressembler
Ta pluie ne me mouille pas
Mais mes larmes coulent sur toi
Ton soleil ne me brûle pas
Ta chaleur, même au Sahara
N’est qu’une douce caresse
Que dire du froid du Djurdjura
Pourquoi m’as-tu laissé partir
Pourquoi m’as-tu laissé m’enfuir
Toi, Kader, toi Mahfod, toi Farouk
Vous mes amis, mes frères
De toujours
Toi Djemila, toi Ranhya, toi Keltouma
Vous mes amies, mes sœurs.
De toujours
Sans un mot, vous m’avez vu avec ma valise,
Monter dans l’auto de votre boulanger
Et disparaitre au premier virage,
Les larmes coulant sur mon visage
Jean Pierre Ferrer 26 mai 1962
| |
| Légion étrangère
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
" Jamais : garde de Roi, d'Empereur, d'Autocrate, de Pape ou de Sultan ; jamais nul régiment, chamarré d'or, drapé d'azur ou d'écarlate, n'alla d'un air plus mâle et plus superbement ! " De Borelli.
La célébration du Centenaire de l'occupation d'Alger a commencé, à juste titre, par la glorification de notre chère et valeureuse Armée d'Afrique.
La France se devait de rendre ce légitime hommage aux descendants de ceux qui conquirent au prix de leur sang et de leur vie, le sol aujourd'hui fortuné dont s'enorgueillit notre pays.
Certes, dans cette lutte de plus de 80 ans : où furent cueillis tant de lauriers mais où nos troupes peinèrent, souffrirent se battirent et perdirent tant de braves soldats, où tant d'illustres chefs écrivirent en lettres d'or les noms resplendissants d'épiques combats : tous se distinguèrent, luttèrent de courage et d'abnégation.
Zouaves, Chasseurs, Tirailleurs, Génie, chasseurs d'Afrique, Spahis, Artilleurs, rivalisèrent d'ardeur et immortalisèrent leurs drapeaux et leurs étendards.
Parmi ces superbes troupes, cependant, il en est une qui : pour la splendeur de ses exploits, par la continuité de ses campagnes, par la solidarité sans pareille de ses cadres et de ses unités, par son farouche mépris du danger, la fidélité de ses soldats, l'héroïsme légendaire et la multiplicité de ses actions d'éclat et les services, qu'elle n'a cessé de rendre partout où la France a porté son drapeau : en Afrique, en Asie, en Europe sous toutes les latitudes : s'est acquis une place de choix un droit imprescriptible à notre reconnaissance, c'est la Légion !
Vous tous qui avez pu voir, les 11 et 12 avril 1930 acclamer les drapeaux des corps algériens, tunisiens, marocains ornés : de croix de guerre, de fourragères, de médailles militaires, vous n'avez pas manqué, parmi tous ces emblèmes glorieux, de remarquer ceux de la Légion étrangère représentés par le drapeau des 1er et 2e Etrangers, qui portent les numéros des corps de la vieille Légion.
A ceux-là il aurait fallu joindre ceux des 3e et 4e Etrangers, issus des précédents, dont la valeur ne le cède en rien aux autres.
Et avant tout, le drapeau du 3e Etranger, qui fut tout d'abord le drapeau remis par M. Poincaré, en France en 1915, au 2e Régiment de marche du 1er Etranger et qui, en 1923, lors de l'inscription des batailles a été marqué au chiffre du 3e Etranger. C'est lui qui porte ces noms célèbres :
Camerone 1863
Artois 1915
Champagne 1915
La Somme 1916
Les Monts 1917
Verdun 1917
Picardie 1918
Vauxaillon 1918.
Sa hampe qui se courbe sous le poids de la gloire s'orne :
de la croix de guerre avec huit palmes
de la Médaille Militaire de la Légion d'honneur et
de la double fourragère rouge aux couleurs de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre : de l'Algérie - du Tonkin - du Dahomey - de Madagascar - du Maroc - de la Syrie que symbolise la Légion. L'ancienne, comme la nouvelle.
C'est aussi toute l'histoire des campagnes : de Crimée, d'Italie, du Mexique, des armées de la défense nationale en 1870-71, de la grande guerre aussi, sur le front de France comme sur le front d'Orient.
Partout où l'on se bat où l'on pacifie où l'on colonise où le fusil ou l'outil en main, il faut agir lutter mourir.
La légion est au premier rang : soldats d'élite, troupe d'allant, bâtisseur-constructeur de postes, de villes, de pistes, de routes, servants des pièces d'artillerie, conducteur d'équipages, cavaliers, auxiliaires d'aviation, mécaniciens d'automobile pour le tourisme, les poids lourds, les chenilles, dessinateurs,
Topographes, Pontonniers, hommes de compagnies montés à mulet, demain des compagnies motorisées et des autos blindées..
Les Légionnaires sont aptes à tout : adroits, forts, intelligents, infatigables sous tous les climats sous toutes les latitudes.
Détestant l'inaction vite lassés de la vie monotone des garnisons ils n'aiment que : le mouvement, l'existence du bled, les difficultés la lutte.
Le danger les attire : la brousse, les randonnées fantastiques à travers la montagne, le désert l'action sous toutes ses formes tel est le rêve de ces incomparables guerriers.
Voilà ce que symbolise le drapeau du premier Etranger, décoré de la Légion d'honneur, régiment d'où sont nés les trois autres.
La Légion a eu et a encore ses détracteurs, hélas ! A l'étranger c'est un sentiment d'envie. La basse jalousie qui la fait abreuver, sciemment d'outrages dans l'espoir vain de tarir son recrutement.
En France, c'est par ignorance qu'on a médit d'elle ; nombreux sont nos compatriotes qui ne savent même pas ce qu'elle est.
Pour bien des Français en effet, quiconque s'éloigne du foyer natal est pour le moins une forte tête : colonial ou soldat de l'armée d'Afrique.
De là à cataloguer à faux l'armée d'Afrique toute entière sous l'étiquette " " Biribi et à confondre les Légionnaires avec les Joyeux, il n'y a qu'un pas.
Et même sans aller jusque-là admettre que les Légionnaires sont, par définition, de fortes têtes, difficiles à mener est faire preuve d'une généralisation erronée.
Certes, il y a de fortes têtes et des cerveaux brûlés à la Légion. Mais quelles complètes satisfactions donne le commandement de cette belle troupe ! J'en appelle à tous ceux qui comme nous ont eu l'honneur de servir et de la conduire au feu.
D'ailleurs " ceux qui savent " ceux qui en ont l'expérience ont pu constater, il y a là de quoi surprendre bien des gens, même des officiers que beaucoup de légionnaires ont des folios de punitions " blancs" et que beaucoup d'autres ne comptent, ce qui a sa valeur dans un corps où la discipline est d'une sévérité stricte et où les hommes ont jusqu'à 15 ans de services, que fort peu de punitions importantes.
Bien des historiens, des " épisodistes " qui n'ont fait qu'entrevoir la Légion au cours d'un rapide voyage d'information ont imaginé de la décrire en des récits parfois étincelants mais presque toujours faux : soit qu'ils aient eu tendance à en louer des tableaux superbes, exagérés, soit qu'ils n'y aient vu que des " phénomènes " archevêques, princes du sang, viveurs décavés, aristocrates, déchus, débauchés, perclus de dettes.
La réalité est plus simple.
A la Légion comme disait un de ses vieux chefs, il n'y a pas que des " demoiselles ". Des défauts il en est certainement .... Comme partout. Mais les vertus il en existe aussi.
Et la balance est à l'avantage de celles-ci. Ce qu'il faut voir et bien voir, à la légion, c'est qu'elle constitue un "véritable ordre militaire laïc " cloître, à proprement parler, qui sert d'abri aux désemparés, aux désillusionnés, à tous ceux qu'a brisés la vie dure pour beaucoup de refuge pour ceux aussi qui ne peuvent pas vivre de la vie du siècle trop ardents trop droits, pour chercher à en trouver l'ordre. Trop généreux, trop pleins de besoin d'action pour se confiner dans les bornes étroite d'une existence terre à terre sans horizon, épris de grand air d'aventures, poussés par le besoin de se dévouer à un idéal.
Un milieu d'abnégation de renoncement où l'on cultive les vertus du soldat : la solidarité, la vaillance, le dévouement, un prieur, un ordre militaire laïc oui, il y a un supérieur qui est le chef, une règle qui est la discipline, un culte celui du drapeau.
Mais la vie du légionnaire n'a pas pour cadre le couvent du moine ou la cellule du chartreux. Il s'en va courir : le bled saharien, l'Atlas ou, la brousse, les fatigues et les dangers.
Tel est son couvent et son refuge, c'est l'action.
On rentre parfois à la légion : par désespoir d'argent, d'amour, d'honneur - par dégoût de la des hommes que sais-je ?
Mais on y entre aussi : par passion, par goût du risque et du danger.
Bien des hommes y sont venus qui n'avaient commis d'autre faute que celle, si c'en est une, de n'avoir se plier à quelque mesquinerie de la vie moderne.
Il y a aussi les sans travail, il y a aussi les déshérités du sort, il y a les aventuriers !, il y a eu jadis les Alsaciens-Lorrains et quelques hommes !
Il y a les étrangers que le renom de la vieille légion a séduits.
Nous ne leur demandons pas pourquoi ils sont venus à nous. Peu nous importe.
Pas plus que, qui ils sont exactement sous leur nom d'emprunt. A tous venus : pour s'engager, pour payer une dette, pour tenir un serment solennel ou secret, pour obéir à, un élan du cœur, quel qu'en soit le mobile, nous ne demandons qu'une chose servir ! Tenir son serment selon la fière devise de son drapeau : honneur et fidélité, valeur, discipline.
N'allons pas chercher plus loin ! et admirons ces hommes qui pour un morceau de pain, une solde infime vont contribuer si pleinement à porter au loin, avec les trois couleurs, le renom de la France et les bienfaits de la civilisation.
Car ce n'est pas une conduite banale que celle de l'homme qui, volontairement : réclame et accepte le devoir militaire, s'attache fidèlement à son drapeau, jure le défendre jusqu'à la mort ... et tiennent rigoureusement son serment.
Tel est, en un mot, la Légion son histoire est d'une richesse inouïe.
Elle s'enrichit chaque jour de nouveaux faits d'armes. Saluons-là.
L'Africain (25-04-1930).
| |
| La féodalité arabe, Le bordj, la diffa
Envoyé par M. Christian Graille
|
Il ne suffit pas de jeter les yeux sur les échelons inférieurs de la société arabe, il faut aussi pénétrer dans les rangs élevés, et si bien murée que soit l'existence intime des riches indigènes de l'Algérie, il faut savoir en pénétrer les mystères pour faire surgir la moralité du tableau que l'on offre à la méditation du lecteur.
Ce que nous allons raconter est écrit depuis dix ans, depuis l'époque où parurent nos Lettres de l'Algérie. Cette description de la société arabe dans ce qu'elle offre de plus relevé conserve aujourd'hui toute sa fraîcheur, et on nous saura gré de la publier telle que nous l'avons écrite, car elle est l'expression exacte de nos impressions au lendemain d'une excursion dont tous les détails offrent un aliment à l'instruction et à la méditation. Nous avons dit ce qu'est la tente, c'est-à-dire l'échelon inférieur de la civilisation arabe, nous allons essayer la description de l'état le plus parfait qu'ait atteint la famille dans la tribu.
Qui ne connaît en Algérie, dans la province d'Oran, l'agha Kaddour-Morfy, ce beau vieillard qui depuis le commencement de la conquête, a lutté à nos côtés avec une fidélité à toute épreuve et avec une bravoure légendaire.
Serviteur dévoué, il a combattu sous les ordres du général Mustapha et à côté du neveu de ce grand chef des douairs, Si Ahmed Ould Kaddi, aujourd'hui bachaga de Frendah, et c'est à leurs efforts réussis qu'a été due la pacification de la province d'Oran. L'agha Kaddour a soixante-dix-huit ans.
Grand et majestueux comme Abraham, dont il rappelle la beauté biblique, il domine tout ce qui l'entoure autant par la beauté de son visage que la tranquille et mâle énergie répandue dans toute sa personne.
Soldat et premier chaouch du bey Hassan, il s'attacha comme lieutenant à la fortune du général Mustapha, qui l'aimait comme un fils et dont il a de sa propre main vengé la mort, en détruisant un à un ses assassins.
Il suivit partout le général, et dans les rangs des douairs il combattit jusqu'au bout. Blessé quatorze fois, la main droite mutilée, il n'avait qu'à paraître à la tête de ses goums pour mettre en fuite un nombre dix fois plus considérable d'ennemis.
Combien de fois, armé de son tromblon, ne s'est-il pas avancé seul contre les réguliers d'Abd-el-Kader, avec cette assurance tranquille de l'homme sûr de son prestige ... " Voilà Kaddour, voilà Mustapha ! ... " tel était le cri des cavaliers de l'émir, et à la seule apparition de ces deux hommes, une terreur superstitieuse s'emparait des compagnons intrépides d'Ab-el-Kader, et ils fuyaient.
Ce prestige étrange est particulier à certaines natures, et il n'est pas rare d'en constater le pouvoir chez les Arabes, dont l'imagination atteint les limites extrêmes de la superstition.
Bou-Maza (le père de la chèvre) n'était qu'un gardien de troupeaux, lorsqu'à vingt ans à peine, il se présenta au milieu des tribus se disant l'envoyé de Dieu.
Un vieux marabout lui dit : " Si tu es l'envoyé de Dieu tu dois être invulnérable.
Je le suis " répond l'intrépide berger.
Le marabout sort un pistolet de sa ceinture, ajuste Bou-Maza et tire ....
Le pistolet rate, tombe des mains du marabout qui s'incline, baise le bas du burnous du gardien de chèvres et s'écrie : " Tu es bien l'envoyé de Dieu."
De ce jour le chevrier fut Bou-Maza !
Kaddour-Morfy fut, pendant deux ans, mis par le général Lamoricière à la tête d'un goum de huit cents chevaux et reçut l'ordre de soumettre les tribus qui se soulevaient entre Mostaganem et Mascara.
Enfermé dans un bordj, espèce de fortification turque, il planait comme l'aigle, et chaque fois qu'une fraction de ses tribus menaçait de se joindre aux rebelles, Kaddour descendait à la tête de ses cavaliers, et rasait impitoyablement les récalcitrants.
Ami et compagnon d'arme de toutes nos illustrations militaires, il a combattu partout, et, depuis qu'il est rentré dans son aghalick : il commande en maître, il rend la justice en patriarche et il fait tous ses efforts pour infuser à sa tribu les idées qu'il a lui-même puisées au contact de notre armée.
Kaddour-Morfy est une grande figure dans l'histoire de notre conquête, il n'est pas sans utilité de la saisir au passage et de lui accorder, dans le pays qu'il a aidé à conquérir et à pacifier, la place d'honneur qu'il mérite.
La tribu d'El-Bordj, dont il et l'agha, est limitrophe de Mascara, elle est placée au cœur de la province d'Oran, théâtre de nos dernières luttes avec l'émir. El Bordj est un mot turc qui signifie " château fort ".
C'est dans cette tribu à quelques kilomètres de la demeure de l'Agha, que se trouve la petite ville de Kalaa, où se fabriquent les plus beaux tapis de l'Algérie. La curiosité, autant que les aimables invitations de Kaddour, m'entrainait à El-Bordj, car je sentais que là je trouverais tous les éléments de la société arabe.
J'étais accompagné par deux amis, officiers des bureaux arabes, dont la présence ne pouvait que faciliter mes projets d'observation, car ils avaient tous les deux une connaissance complète des mœurs indigènes et possédaient à fond la langue et la pensée de notre hôte. Sur notre route la tente le douar disséminés au milieu des palmiers nains et des lentisques sur des pente rougeâtres et sur un sol déchiqueté par les pluies beaucoup plus que par la charrue ; à El-Bordj, le gourbi le château féodal ; plus loin la ville industrielle Kalaa, si pittoresque et si active dans ses maisonnettes ombragées : de figuiers, d'orangers et de citronniers et fermés aux regards indiscrets par d'épaisses haies de cactus, entourant des jardins remplis d'arbres fruitiers et notamment de pêchers et d'abricotiers dont l'Europe serait jalouse.
El-Bordj est un grand village, placé entre deux collines et entouré d'une mauvaise muraille à hauteur de ceinturer, tombant en ruine et crénelée de distance en distance. De plus loin qu'on l'aperçoive, trois monuments frappent les yeux. C'est le bordj, la demeure de l'agha, qui l'a fait construire lui-même ; haute et borgne, comme toutes les habitations musulmanes, elle présente à l'œil une masse imposante sans fossés ni mur d'enceinte.
Puis la mosquée blanche, aux tuiles imbriquées et arrondies, bâtie par les Français, mais trop fraîche d'origine pour mériter une description. Aux pieds de la mosquée et sous la protection du maître, une sorte de caravansérail, bâti par Kaddour-Morfy, et divisé en étroites boutiques, où s'étalent les marchandises que : des Mzabites, des Juifs et des Maltais vendent aux indigènes.
Sur un monticule, le cimetière, avec ses innombrables pierres pointues et son marabout dédié à Sidi-Abd-el-Kader. Ce Sidi-Abd-el-Kader n'a rien de commun avec l'émir, c'est un saint de grande classe très vénéré dans la province d'Oran.
Tous les marabouts qu'on voit sur les montagnes, rompant par leur blancheur immaculée et leur coupole gracieuse la monotonie d'une solitude désolée, lui sont dédiés. Les mendiants tentent la main au nom de Sidi-Abd-el-Kader.
Partout " Sidi-Abd-el Kader ! ! "
Je ne connais pas de saint dans notre calendrier aussi ardemment invoqué que celui-là, c'est le saint Janvier des lazzaroni de la province d'Oran. Trois ou quatre cent gourbis s'étalent uniformément dans l'enceinte des murailles : noircies et bistrées par les pluies et par la fumée, sans verdure autour, sans cette poésie sauvage que donne au gourbi de la campagne les haies de cactus et la large et ombrageuse protection du figuier.
Il y a une cour, avec quelques broussailles pour limite, et partout une boue fétide et noirâtre qui provient des fumiers abandonnés sans souci de leur utilité agricole.
Deux rues principales se croisent du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest, ayant pour point d'intersection une grande place mal nivelée et sans arbres.
Nous arrivions vers le soir, la teinte du ciel était légèrement brumeuse, les Arabes rentraient au village, le burnous sur la tête et sur l'épaule un grand bâton à la main et poussant devant lui de maigres troupeaux.
La journée avait été froide et le soleil qui colore tout en Algérie d'une teinte de feu et qui communique à la pensée la chaleur dont s'imprègnent toutes les parties de la création avait été voilé par les nuages : le sol était humide et détrempé, les terres avaient un aspect plus sombre et les gourbis une physionomie plus misérable que d'habitude.
Le contraste était plus saisissant entre : la solidité la blancheur et la bonne mine du château féodal et le délabrement de la muraille qui parquait, plutôt qu'elle ne protégeait des centaines de familles si mal abritées.
Il était évident que l'agha n'avait d'autre préoccupation que sa propre sûreté ; quant aux malheureux qui grouillaient dans son village, il lui importait peu que leurs familles et leurs troupeaux fussent à l'abri d'une razzia.
Quatre misérables portes, toutes disloquées, figuraient comme mémoire au débouché des quatre rues principales. Le village s'incline légèrement vers le Nord et, au bas, on trouve la fontaine ombragée de magnifiques trembles, autour desquels s'enlacent, folle et lascive, la vigne abandonnée à tous les caprices d'une végétation sans rivale. Le lierre couvre, de ses larges et belles feuilles d'un vert émeraude sombre, les racines des trembles, et les protège contre les ravinements des pluies. Ses fines et tortueuses branches enlacent les troncs énormes de ces beaux arbres en cachant aux regards leur blanche écorce et donnant ainsi aux abords de cette fontaine un aspect de fraîcheur inconnu dans nos climats, et une physionomie pittoresque dont la richesse est toute entière empruntée aux magnificences de la végétation.
Le bordj domine ces gourbis, de toute la majesté dont le maître domine la tribu. Il n'existe point de villages semblables dans nos contrées où les révolutions ont abaissé les châteaux et amélioré les chaumières où le donjon ne s'élève plus là comme une menace, là comme une amère dérision du sort.
Il fallait remonter par la pensée à une période historique où les hommes et les choses offrissent des rapports analogues, et il fut unanimement reconnu qu'à la période mérovingienne seule pouvait se rapporter un pareil assemblage.
L'agha Kaddour-Morfy est sorti de la tradition de ses pères : Les patriarches couchaient sous la tente, lui a eu les occasions de fortune des soldats d'aventure ; et, s'appuyant sur le conquérant, il n'a songé à se protéger que contre ceux dont il connaissait les moyens d'attaque et la faiblesse de résistance.
Nos chevaux entrèrent plein d'ardeur dans le village, et nous portèrent rapidement devant la porte principale du bordj.
Cette vaste demeure est composée de deux bâtiments contigus. Au milieu, une immense tour, carrée, sans ouverture extérieure, prenant l'air et le soleil par une cour intérieure, absolument comme on l'observe dans les maisons mauresques.
C'est là que l'agha renferme : sa famille, ses femmes et ses enfants.
Vient ensuite un corps de bâtiment intermédiaire, au milieu duquel est une immense tour où vingt négresses vont et viennent se livrant à toutes les manœuvres de la domesticité.
Puis le corps du logis, où l'Agha reçoit les étrangers ; bâti avec des idées plutôt qu'avec de la maçonnerie, et exprimant bien la préoccupation de ce chef sur le rang et la distance sociale de ses hôtes.
Une seule porte donne accès dans cet imposant bâtiment ; nous dûmes, selon l'étiquette, la franchir à cheval afin de pouvoir mettre pied à terre dans la cour.
Le fils de l'Agha, entouré de nombreux serviteurs des caïds et des cadis de la tribu, nous attendait. Il prit la main de chacun de nous, et chaque fois il porta le bout de ses doigts à ses lèvres, en entremêlant ces gestes rapides : de paroles, de salutations et de souhaits.
L'agha nous attendait dans une grande salle de réception. Cet homme étrange a créé sa fortune, puis il a assis sa puissance et il a enfin, présidé lui-même à la distribution de sa demeure.
Il n'est venu en France qu'une seule fois, en 1863, invité aux fêtes de Compiègne ; jusque-là il avait vécu de sa propre substance, dans sa propre pensée, et au milieu d'évènements qui devaient donner à tout ce qu'il avait entrepris une teinte particulière.
Aussi, tout ce que nous allons décrire est-il comme le résumé de cette existence, qui ne laisserait rien à désirer à un baron du moyen âge.
Il me souvient qu'au retour de son voyage de Compiègne, j'interrogeai l'Agha pour savoir de lui qu'elle avait été son impression, et qu'il me répondit, avec ce calme particulier aux gens de sa race et ce sens profond des choses pratiques : " Ce que j'ai trouvé de plus beau dans ton pays, ce sont les rivières où il y a toujours de l'eau. "
La cour, dans laquelle hennissaient encore nos chevaux abandonnés dans les mains des serviteurs de l'Agha, est carrée, et sert à la domesticité des gens de la maison et à la réception des chefs des douars qui viennent rendre visite au maître.
Aussi le premier objet qui frappe les yeux, c'est le fourneau du kaouadji (cafetier) où la braise fait chauffer nuit et jour la liqueur aromatique de l'hospitalité. De hautes murailles crénelées encadrent cette cour de tous côtés.
Deux étages sont superposés, auxquels on arrive par des escaliers en bois et des galeries grossièrement charpentées, tournées vers l'Orient.
La porte des chambres donne sur ces galeries ; au premier étage est une espèce d'entre sol où sont reçus les officiers jusqu'au grade de capitaine. Le chef du bureau arabe, quel que soit son grade, est reçu dans un splendide appartement que l'agha appelle dans son langage pittoresque " Byt marychân " (la chambre du maréchal) où sont reçus également les officiers supérieurs.
Il est évident que dans l'esprit de Kaddour-Morfy, le chef du bureau arabe personnifie le gouvernement, et que la fonction implique à ses yeux une supériorité réelle, quelle que soit d'ailleurs l'importance de l'épaulette.
Ce jour-là nous fûmes reçus tous sur le même pied : capitaines et lieutenants durent coucher dans ces espèces de dortoirs où sont dressés plusieurs lits en bois larges comme les couchettes des bateaux à vapeur et garnis de coussins et de longues couvertures de laine.
Au milieu de quelques escabeaux et pas d'autres meubles, et, dans un coin, une table sur laquelle j'aperçus tout d'abord le plus étrange coffre que l'imagination puisse rêver.
Je frottais plusieurs fois mes yeux, doutant que j'eusse bien vu, puis je me tâtai pour sentir si je ne rêvais pas ; j'avais devant moi une énorme boite à réactifs sans couvercle et sans flacon avec ses planches bien étagées et ses trente trous béants ! Que faisait là cette boite à réactifs ?
D'où venait-elle ?
A quel usage la destinait-on ?
Je dus interroger le fils de l'agha Morfy, celui qui nous avait reçu dans la cour et nous avait tenu l'étrier ; il me répondit gravement que c'était son frère aîné Mohamed, qui, lors de son voyage à Paris, l'avait rapportée, et que depuis lors, elle était là sur cette table.
Notre toilette un peu réajustée, nous étions prêts à paraître devant notre hôte. De l'étage où se trouvent les chambres que nous occupions, on a vu que sur la cour, où grouillaient : les serviteurs, les sloughis, les parasites et les curieux, attirés par notre présence.
Nous montâmes à l'étage supérieur part une longue galerie, à l'extrémité de laquelle s'ouvre une porte qui donne accès dans les appartements réservés (byt marachâm).
A cet étage, il n'y a qu'une seule et grande pièce, c'est la salle de l'akouma ; l'Agha y rend la justice. C'est de plus la salle des festins, nous devions y prendre ces repas homériques qui ont pris le nom de diffa en langue arabe. C'est aussi le salon de conversation et le fumoir.
Des portes vitrées s'ouvrent sur la galerie d'où la vue s'étend du côté de l'Orient et vers la mer, et plonge dans ces horizons sans fin qu'on ne retrouve nulle part ailleurs que sur le continent africain.
Des croupes de montagnes des plaines à l'aspect verdoyant ou plus loin, la teinte laiteuse du ciel se fondant avec la brune blanchâtre de la mer, l'infini se mariant avec l'infini.
Autour de cette vaste pièce, des divans recouverts d'épais tapis du Djebel-Amour à longue laine ; des tentures en guise de rideaux, formées de légers tapis de Kalaa. Puis par terre, de distance en distance, de nombreux coussins placés en rond, comme si des groupes avaient causé là et les avaient abandonnés subitement. Autour de la pièce, de longues tapisseries clouées au mur forment un bizarre soubassement ; les murailles sont peintes à fresque et entrecoupées de lignes rouges et vertes, on dirait une étoffe d'algérienne plaquée au mur.
La salle n'a pas de plafond, on peut étudier la charpente tout à l'aise et entendre la pluie frapper les tuiles imbriquées comme dans mes demeures italiennes ; au point de vue de la grâce, c'est affreux à l'œil au point de vue de l'hygiène c'est plus supportable car on a un plus grand volume d'air à respirer.
L'Agha vint au-devant de nous et, par son accueil plein de cordialité, détourna sur lui une attention qui n'avait été qu'une furtive impression de voyageur curieux.
On n'oublie tout en présence : de cette noble et belle tête, de ce port majestueux, de cette voix grave et sonore et de cet œil bleu d'une douceur infinie qui attire et qui charme. Il nous offrit sa main droite sa main mutilée par des balles ennemies et j'avoue que ce n'est pas sans un redoublement de vénération et de respect que je la pressai dans la mienne.
Je me souvenais de la manière toute orientale dont son fils nous avait accueillis ; qu'il baisait l'extrémité de ses doigts après avoir touché notre main, et je pensais que c'était bien à nous de renouveler cette étiquette touchante, surtout au contact d'une si noble individualité.
Nous prîmes place près de lui sur des coussins et il nous offrit alternativement son tchibouk (longue pipe turque). Kaddour est trop habitué aux allures libres des officiers français pour se formaliser d'un refus, motivé par le désir ou l'habitude de rouler une cigarette ou de fumer un cigare ; mais refuser à un musulman de porter son tchibouk aux lèvres est un signe qui lui déplaît, d'autant qu'il ne l'offre qu'aux personnes qu'il tient en considération.
Il me souvient, à ce propos, que le soir, après avoir humé quelques bouffées de cette longue pipe où brûlait du tabac du Levant et dans mon ignorance des coutumes arabes, je fis un signe au second fils de Kaddour, qui se tenait debout à quelques pas devant nous, de prendre le tchibouk et de fumer à son tour.
L'Agha, la tête penchée sur la poitrine, ni vit ni mon geste ni celui bien plus qu’éloquent que fit pour me faire comprendre que je commettais une énormité et que la pipe du chef ne devait servir qu'à lui-même ou à ses hôtes.
A quelque distance des étrangers, se tiennent : debout silencieux et immobiles les caïds les cadis et les enfants de l'Agha.
Seul il parle, seul il reçoit ; sur les marches de l'escalier sont échelonnés des serviteurs qui attendent, muets et les pieds nus qu'un signe ou un ordre les fasse mouvoir. Ses enfants n'ont pas le droit à se mêler à la conversation ni de s'asseoir sur les coussins sans y être invités.
Kaddour-Morfy a trois enfants : Mohamed, l'aîné, est destiné d'après la loi de succession à hériter du rang et des prérogatives de l'agha ; il est caïd de la tribu.
Âgé d'environ trente-cinq ans il a les traits de son père sans en avoir ni la taille élevée ni le port majestueux, et sans cette beauté étrange qui donne à la physionomie de Kaddour une expression de grandeur biblique.
Le visage de Mohamed est d'un calme parfait, déjà flétri : le regard, tour à tour, si puissant et si doux chez son père n'exprime chez lui que l'indifférence, sa taille un peu voûtée ferait croire qu'il est d'un âge plus avancé, il est grave et sérieux, fort peu communicatif et semble avoir plus de tendance à une existence solitaire et contemplative, qu'à l'existence tourmentée qu'a menée son père depuis qu'il sert la France.
Le second fils, Morfy, est le type le plus curieux du cadet de famille : élancé, Vif, nerveux il a le fond du caractère diamétralement opposé à celui de Mohamed.
Pendant que celui-ci récite jusque sur la selle de son cheval des versets du Coran et roule sans cesse les grains de son chapelet, Morfy, la tête ardente l'œil animé rêve : fantasias, courses effrénées, meutes et bêtes fauves ...
Excellent cavalier, il se dresse sur ses larges étriers et accomplit par simple amour-propre des évolutions prodigieuses ; il n'est pas de ravin que son cheval n'ait parcouru ; ses yeux petits et d'un bleu sombre ont un éclat insolite ...
Sa taille plus élevée que celle de son frère est droite sa tête haute sa voix vibrante. Placé dans la guerre à côté de son père, Morfy serait devenu un terrible soldat. Il aime la chasse avec passion et il accapare tous les chiens qu'il trouve sans maîtres ; c'est chez lui qu'on trouve les sloughis les plus vaillants et les plus forts. Celui qui l'accompagne, arrête lui seul, et saigne un sanglier.
A voir ces deux fils qui ont à peu près le même âge, on dirait que le vieux Kaddour s'est divisé en deux parts : d'un côté la gravité musulmane le sentiment religieux la circonspection, c'est Mohamed de l'autre, le guerrier vaillant l'esprit de rapine et de pillage le mouvement le bruit l'amour des plaisirs c'est Morfy.
Le troisième des enfants de Kaddour est un garçon à peine adulte, sorte de Benjamin, qui commence à figurer sur ses côtés dans les réceptions et dans les actes de sa vie publique.
Le respect que l'aîné des enfants professe pour son père, la distance qu'il garde avec lui le second des fils les professe pour son frère aîné ; il ne l'appelle qu'en faisant précéder son nom du terme Sidi qui est l'équivalent de Monsieur employé dans les grandes familles de France dans le siècle dernier.
Là où le frère aîné préside, le frère cadet n'apparaît pas.
Il suffit d'un instant pour saisir toutes ces nuances d'étiquette qui constituent le fond de la vie patriarcale chez les Arabes.
Un grand mouvement se fit parmi nos hôtes, le dîner allait être servi, la diffa !
J'allais donc analyser la civilisation arabe sous une face nouvelle.
J'aimais pouvoir étudier cette cuisine dont j'avais entendu parler avec des opinions si diverses, et que je n'avais goûtée qu'imparfaitement dans les tribus, chez des personnages relativement inférieurs.
C'était l'occasion de faire appel à mes connaissances en histoire naturelle pour donner à tout ce qui allait passer sous mes yeux un nom, et pour en formuler la composition culinaire. Une grande table était dressée dans le milieu de la salle dans laquelle nous nous trouvions et, par une délicatesse très grande, l'Agha avait fait servir à la française ; de magnifiques candélabres en bronze dorés soutenaient douze bougies qui éclairaient un service d'argenterie splendide.
Les mets seuls étaient d'origine arabe. Kaddour prit place à table, et un négro, assez bien dressé un ancien turco la serviette sur le bras en large culotte blanche sur une jambe noire et en veste maltaise, commença le service.
Dans un coin de la salle Mohamed, le fils aîné, s'accroupit sur un tapis et, ayant réuni en cercle une dizaine de caïds ou de cadis attendit avec une patience admirable qu'il vînt quelque chose de la table des étrangers.
Les autres fils de l'Agha se tenaient debout à une certaine distance et présidaient au service, par gestes, et sans proférer une parole. Ils ne peuvent prendre place près du père ou du frère aîné.
Un mouton entier, rôti, est porté par deux nègres, embroché par une longue perche ; on le dépose à terre sur un immense plat en cuivre rouge, tout orné d'arabesques, et l'un des négros tirant la perche, d'autres serviteurs le mouton, il reste sur le plat toute la bête, sauf la tête et les pattes qu'on s'empresse de faire disparaître, puis le plat est triomphalement porté au milieu de la table.
A ce moment commence une opération des plus bizarres, c'est de saisir avec les mains les morceaux qui peuvent paraître les plus agréables ; armé d'un long couteau, espèce de yatagan, le nègre : dépèce avec soin les lanières croquantes des parties grillées qui sont à la surface, et les met sans façon, avec ses doigts dans l'assiette des convives. il plonge sa main dans le corps de l'animal, va chercher le cœur les reins et les déchirant de manière à y laisser adhérente une certaine quantité de graisse il en jette les morceaux dans l'assiette des convives les plus considérés.
J'eus l'honneur de recevoir un morceau réputé très délicat que je fis passer au capitaine W ..., plus habitué que moi à ces offres galantes.
Manger avec ses doigts n'a rien qui surprenne ; quel est celui qui n'a pratiqué cent fois cette méthode primitive ; mais recevoir de la main luisante de graisse d'un négro un morceau de cœur arraché à cette bête, qui est là, étendue comme un cadavre, cela a de quoi faire reculer le moins délicat et ôter l'appétit au plus vorace ...
Les premiers instants furent durs, puis enfin l'exemple de mes compagnons les invitations pressantes de l'agha et, aussi, l'odeur délicieuse répandue dans la salle par le rôti, firent disparaître la pénible impression que j'avais ressentie, et sans attendre que le négro remplit mon assiette, je portai hardiment la main sur la victime, et je tirai de mon côté, tandis que capitaine lieutenant et Agha tiraient chacun du leur. Nous avions à faire honneur à un repas homérique, et il fallut, quoique à regret, laisser emporter l'immense plat sur lequel s'étalaient les débris que nous n'avions pas consommés.
Un mouvement se fit derrière nous, et le cercle silencieux présidé par Mohamed s'émut, le mouton passait de notre table au milieu de ce cercle.
Dix bras se détendirent, dix mains s'attachèrent à ces muscles déjà attaqués par nous et chacun se mit en devoir d'en tirer à qui mieux mieux.
Il faut se souvenir que la maison de l'agha se compose d'une cinquantaine de personnes et que le mouton doit faire sa migration à travers toutes les catégories sociales qui composent cette famille, jusqu'à ce qu'enfin les sloughis se chargent de débarrasser la salle des derniers vestiges de la carcasse de l'animal.
Jamais mouton ne fit plus de profit.
Après le mouton, un délicieux potage au vermicelle fut servi, chacun attaquait avec une cuiller. Pour nous les assiettes fonctionnaient ; une fois le potage placé au centre des caïds, la cuiller en bois plongeait dans l'énorme terrine, et, comme autrefois nos braves troupiers, chacun puisait à son tour, en silence et dans un ordre parfait. Une douzaine de terrines pleines jusqu'au bord succédèrent à ce premier service.
C'était de la cuisine arabe pure : des poulets, du mouton, puis de l'agneau, puis encore du mouton, des poulets et de l'agneau.
Des légumes frais ou secs, mêlés à tous ces plats avec un trait d'union commun à tous, représenté par : des œufs, l'oignon farci, l'artichaut, la fève, le pois chiche, le piment doux se retrouvaient partout avec des nuances dans la quantité. L'usage des piments et des sauces relevées est très répandu chez les Arabes, mais je n'ai point remarqué qu'ils en fissent plus d'abus que certains peuples méridionaux de l'Europe. La préparation de ces aliments faite au beurre n'avait rien de bizarre ni de répugnant.
Le couscous est le potage national et il mérite, à plus d'un titre, l'analyse du physiologiste. Les femmes arabes consacrent la majeure partie de leur temps à préparer sous la tente ce plat, le plus simple dans sa composition et le plus complet au point de vue de la nutrition.
Avant que l'art des pâtes alimentaires fût répandu en Europe et eut acquis le degré de perfection qui en a fait une des branches d'industrie des plus importantes, les femmes italiennes, en Sicile ou dans la Calabre procédaient Les Juives de l'Algérie et les femmes des pêcheurs napolitains emploient encore les mêmes moyens pour rouler ces farines humectées qui servent dans leur cuisine.
Le couscous est tout simplement de la farine de blé dur, humectée et roulée entre les doigts avec un dextérité extrême, puis séparée en petits grains qui sont grossis par de la farine surajoutée dans de larges sébiles en bois.
Depuis que la conquête a introduit en Algérie la fabrication des pâtes alimentaires, les Arabes portent leurs grains sur le marché et achètent en échange de la semoule qui sert de gangue au grain que la main habile des ménagères grossit à volonté dans des tamis en alfa artistement tressés.
A voir un immense plat de couscous, on dirait une énorme pyramide de riz cuit, fumant et sans bouillon.
Lorsque la femme arabe a préparé sa pâte, elle la place dans un pot de terre, percé de trous à la partie inférieure ; ce pot de terre est ajusté sur une marmite, où cuit un quartier de mouton ou une poule, la vapeur passe à travers les petits trous et va se répandre dans la pâte qu'elle cuit et auquel elle communique le parfum de la viande qui fait le pot-au-feu.
Il est facile de comprendre, par cette simple explication que le couscous est un mets très complet et de nature à satisfaire tout à la fois la faim et le goût.
Quand le couscous est cuit à point, la ménagère met sur un plat creux toute la pâte fumante et simplement humectée par la vapeur qu’elle a absorbé ; elle orne sa pyramide, çà et là, de quartiers de viande ; le tout est couronné par la poule bouillie ou par un morceau de mouton et offert à l’époux et à la famille.
On mélange à la pâte : des fèves, des pois-chiches ou du raisin sec qui en relèvent le goût et le rendent très succulent.
Le bouillon est mis à part et l’Arabe le boit après avoir mangé le couscous ; les Européens préfèrent le mélanger dans leur assiette pour rendre le plat plus commode à avaler.
Le négro armé de deux marmites en terre contenant, l’un du bouillon, l’autre du lait, versait dans nos assiettes l’un ou l’autre de ces liquides, à notre choix.
La méthode arabe pour manger ce plat traditionnel consiste à plonger l’extrémité des doigts dans la pyramide à former une boulette qu’on lance dans la bouche et qu’on avale sans trop de difficulté.
Nous mangions dans des assiettes avec des cuillers et pendant que je savourais ce met que je trouvais délicieux, je pensais involontairement à Judas l'Iscariote et à ces paroles de Jésus le Nazaréen :! " celui qui mettra le premier avec moi, la main dans le plat, celui-là me trahira ! ".
C'est surtout lorsque l'énorme soupière, un peu allégée par nous, passa de notre table dans le cercle des caïds que présidait Mohamed, et que je vis leurs mains s'allonger pour plonger avidement dans la pâte succulente, que je compris ce qui avait dû se passer au dernier repas que le Christ prit avec ses disciples.
Il ne resta pas plus du plat de couscous qu'il n'était resté du mouton rôti ; en quelques instants la soupière fut vide.
Les Arabes ne boivent guère pendant le repas, aussi vers la fin, je vis circuler les terrines de lait et de bouillon, et chaque caïd boire à son tour, et dans un ordre parfait. Après le couscous, la salade, mets exquis et préparé avec un soin tout particulier qui la rend préférable à celle que l'on mange en Europe.
Elle est toujours haché menu assaisonnée d'oignons et de piments qui en relèvent le goût et la font désirer, après ces copieux repas de ragoûts et de viandes rôties. Le dessert se compose d'une infinité de pâtisseries, assez grossières par la forme, mais très succulentes parce que le miel y domine.
Des fruits de toutes sortes : la banane, mandarine, l’orange du Portugal, la pêche de Calaa, l’incomparable raisin de muscat de Mascara, la grenade, s’éparpillaient sur la table, formant le plus délicieux assemblage de tons, de nuances et de parfums.
La grenade que son acidité fait rejeter dans les repas de l’Europe, est préparée par les Arabes de façon à en faire un mets des plus fins et des plus délicats : on égrène une grenade dans une assiette creuse, on y ajoute de l’eau de fleur d’orange et du sucre et on laisse macérer deux ou trois heures.
J’avoue qu’il n’est rien de plus agréable au goût et de plus propre à rafraîchir un palais fatigué par un copieux repas.
Le Kaoua (le café) nous fut servi dans des tasses en porcelaine de Sèvres et sans anses. Cette délicieuse liqueur aromatisée et ambrée était servie dans un service emboîté par des filigranes de Gênes, précieux cadeau du marichal Pellissier auquel l’agha tenait par-dessus tout.
Quel contraste entre ces vases délicats qu’une main de marquise pourrait seule manier sans profanation, où s’étalent sur un fond d’azur de fines fleurs dues à des pinceaux habiles, et ce milieu rude, étrange rudimentaire où le sentiment de l’art est inconnu ! Pour Kaddour, l’homme qui lui avait donné ce magnifique service était tout, l’objet en lui-même parfaitement indifférent.
La diffa avait duré trois heures, un immense couscous, un vrai coucou planté comme un Dieu therme dans un coin de la salle, faisait entendre, au milieu d’un silence somnolent, ses régulières et sonores oscillations.
Il paraissait étrange de trouver un pareil meuble chez un Arabe, pour qui le temps ne compte pas, qui ne sait ni l’époque de sa naissance ni son âge et à qui il est défendu de révéler l’heure de la mort de l’un des siens.
Tout le monde se taisait, les pipes allumées à un brasero placé vers le milieu de l’appartement semblaient autant de cassolettes où brûleraient des parfums ; les candélabres avaient été emportés avec les débris du festin et une lampe fumeuse accrochée au mur éclairait doucement cette étrange scène.
Une sorte de somnolence gagnait tous les convives. Je ne sais combien dura cette sorte de sieste, mais je n’entendais autour de moi que les oscillations du pendule et je n’avais plus ni force pour me lever ni intelligence pour analyser.
Les caïds s’étaient peu à peu éclipsés, les serviteurs, pieds nus, avaient, muets comme des automates, fait disparaître toutes les traces de la diffa, il était temps d’aller prendre du repos. Notre hôte se leva, tout le monde en fit autant ; ce qui restait des caïds vint en silence toucher la main du chef, chacun d’eux porta le bout de ses doigts à ses lèvres puis plaça sa main sur son cœur et se retira en silence. Ses enfants restèrent pour nous accompagner dans la chambre qui nous était réservée et qui était à l’étage inférieur.
Nous saluâmes l’agha qui attendit pour se retirer que nous eussions disparu, et, précédés par ses trois fils, nous fîmes nos préparatifs de retraite.
C’est à ce moment que nous pûmes voir combien est grande la déférence que l’Arabe professe pour ses hôtes.
J’étais brisé de fatigue, ému de tout ce que j’avais vu et entendu, et cependant au lieu de saluer les enfants de Kaddour, ce qui est d’usage lorsque l’on veut que le maître de la maison aille se livrer au sommeil, je pris un plaisir infini à garder près de nous Morfy, le chasseur intrépide, le cavalier par excellence dont la main caressait la tête intelligente d’un magnifique sloughi, tout couturé de cicatrices faites par la défense du sanglier. Il n’était pas fâché lui-même de se venger de la contrainte que l’étiquette lui avait imposée et de se trouver sans gêne et sans façon avec les Français qu’il aime passionnément.
Morfy est l’incarnation de la vive imagination de l’Arabe ; il est naïf dans ses expressions et dans ses croyances, violent dans ses désirs et dans ses passions, il aime à raconter la chasse … presque autant qu’Alexandre Dumas.
Il n’a point encore eu l’occasion de se mesurer avec le lion et la panthère, et c’est là son désespoir, mais il a littéralement dépeuplé l’agalick de son père des halloufs (sangliers) qui y pullulaient.
Il méprise le chacal et garde la hyène pour ses menus plaisirs et pour. Un jour même, il en avait fait prendre une de forte taille, et voici le récit qu’il fit de la manière dont on s’en était emparé : La hyène est lâche et se retire dans des trous où elle entre en rampant.
Trois Arabes se placent devant le repaire, deux d‘entre eux se tiennent à l’orifice, un burnous à la main, le troisième se glisse sur la trace de l’animal. Il allume une petite bougie pour voir à quelle distance peut se trouver la bête, puis, arrivé près d’elle, il lui adresse les paroles suivantes : « Deba, donne la patte, je te mettrai du henné, tu sais, du henné comme celui dont Fathma rougit ses mains et ses ongles » et ajoute imperturbablement Morfy, la bête donne la patte.
L’Arabe lui entoure la tête avec un burnous et la traine hors de la caverne où ses compagnons achèvent de la lier et l’emportent triomphalement dans le village.
Lui passer deux points de suture sur le museau de manière à rendre toute défense impossible et la livrer ensuite à sa meute affamée est pour Morfy un divertissement sans égal.
Quelques jours auparavant il en avait nourri une pendant trois jours avec un mouton pour l’offrir en spectacle à des officiers supérieurs invités chez son père ; le lendemain de notre visite, même sort était réservé à celle qu’il avait prise, je n’eus aucune envie d’assister à cet horrible hallali.
Le renard en Algérie, un très petit animal, inférieur au chacal, plus petit que le renard de France, avec de très longues oreilles, et dont les Arabes ne font aucun cas. Les indigènes croient fermement à l’accouplement de l’aigle et du renard. « J’ai vu, disait Morfy, j’ai vu cet accouplement ! Et qu’en résulta-t-il ? lui demandai-je, des serpents ! As-tu vu les serpents ? Non, oh ! pour cela je ne les ai pas vus, mais les arabes les ont vus. Il était tant qu'il cesse d'être aussi affirmatif. Il existe, nous disait-il, dans le Sahara un animal qui n'a qu'un pied c'est le lamt ; il est grand comme l'autruche et il n'y a pas de cavalier qui puisse l'atteindre à la course. Lorsque les Arabes veulent le prendre ils lui tendent un piège. Comme le lamt n'a qu'un pied il est obligé pour dormir de s'appuyer contre un palmier ; ainsi appuyé il dort sans inquiétude.
Les Arabes qui savent en quel lieu il vient se reposer, scient l'arbre au pied ne lui laissant qu'une très légère épaisseur pour que le vent ne puisse pas le renverser avant que le lamt s'en soit approché.
L'animal s'appuie contre son arbre favori, le renverse et tombe avec lui ; c'est ainsi qu'on peut parvenir à s'en emparer ; mais quant à le suivre à cheval, impossible, il est rapide comme le simoun. "
La chasse à la perdrix l’occupe beaucoup, et elle est l’objet d’une pratique bizarre. Les Arabes fabriquent un mannequin : soit avec la peau d’une panthère, soit avec des tissus imitant cette peau ; placés dans un champ, ils abaissent graduellement ce mannequin vers la terre en imitant le chant de la perdrix et s’emparent facilement de ces volatiles confiants, qui ont, au dire de Morfy, l’habitude de picorer la vermine sur le corps de la terrible bête.
Le lynx est bien l’animal le plus vaniteux de la création, et ce sentiment qui le livre aux Arabes : Ce n'est point avec la poudre qu'on lui fait la chasse mais avec de douces paroles. L'Arabe qui en rencontre un sur son chemin lui lance avec un appel particulier le nom du lion à la tête : Sbaa ! Sbaa ! et il est dans le burnous de l'indigène qui n'a plus qu'à se garantir de ses griffes aiguës en l'enfermant complètement dans son vêtement.
Le brave Morfy n'aurait cessé de nous raconter ses histoires de chasse avec une animation bizarre et une foi profonde, si l'heure avancée ne nous avait privés du plaisir d'entendre ces naïves confidences, derrière lesquelles on peut étudier le désordre d'imagination d'un peuple superstitieux comme l'enfance.
La matinée devait nous offrir son contingent de surprises. Le vieil agha nous attendait pour nous faire les honneurs de la partie réservée du bordj.
Nous allions analyser la pensée architecturale de cet homme dans tout ce qu’elle pouvait avoir de délicat. Après avoir franchi un perron de sept à huit marches, on entre dans une cour autour de laquelle les chevaux du maître sont attachés par les pieds de devant à une corde tendue près du sol, et abrités des rayons du soleil par une toiture en tuiles. On franchit lestement cette cour, aussi malpropre et plus mal entretenue que la cour de la dernière ferme européenne, et après avoir jeté un regard d’admiration sur ces beaux animaux, qui allongent leur tête intelligente, comme pour supplier qu'on les délivre de leurs entraves, et qui hennissent en secouant leur crinière longue et flottante, on pénètre dans un escalier étroit comme ceux qui étaient pratiqués dans l'épaisseur des tourelles des anciens châteaux.
On arrive, un à un, sur une galerie intérieure à colonnades torses, comme celles qui ornent les maisons mauresques.
Du haut de cette galerie nous respirions l'odeur de la cuisine que les négresses préparaient sur de petits fourneaux en terre. Il y avait autant de fourneaux que de terrines et autant de négresses que de fourneaux. Deux d’entre elles préparaient le couscous avec une dextérité vertigineuse qui retenait nos yeux sur cette préparation.
Une autre balançait une outre en peau de chèvre, complètement gonflée et suspendue par ses deux extrémités à une corde assez élevée, absolument comme une balançoire. A chaque oscillation, la partie inférieure de l’outre venait heurter une barre de bois, arrondie et placée transversalement ; le choc se transmettait dans la masse du liquide, et ainsi s’accomplissait une opération dont L’outre renfermait au moins quarante litres de lait, et la négresse paraissait un automate, tant ses mouvements offraient de régularité.
L’agha fut obligé de nous arracher de notre contemplation, car nous éprouvions un grand plaisir à saisir sur nature ces secrets de l’existence intime.
Nous entrâmes dans la chambre du marichâne et autant nous avions été frappés de la simplicité des appartements que nous avions visités, autant nous fûmes émerveillés de l'harmonie parfaite et du luxe d'ornement qui régnaient dans cette vaste et belle salle. Elle avait au moins quinze mètres de longueur sur quatre de largeur. Un tapis de Calaa le plus beau le plus délicat de nuances que j'aie jamais vu, couvrait le parquet d'une extrémité à l'autre.
En face de la porte cintrée et ogivale, un marabout recevait le jour par trois petites rosaces garnies de verre de couleur ; autour du marabout garni d'un épais tapis du Sud, régnait un véritable divan, composé de coussins empilés les uns sur les autres et garnis d’étoffes de soie et d’or à grands ramages.
Une panoplie d’armes étincelait au-dessus d’une rosace, et ces armes-là n’étaient pas des joujoux de dandy faits pour orner un boudoir ; il y avait là : des tromblons des fusils arabes aux longs canons turcs qui avaient fait parler la poudre des yatagans qui s’étaient plongés dans des poitrines et des sabres recourbés qui avaient fait voler des têtes.
Je connaissais le passé de Kaddour et les relations que j’avais eu avec lui étaient assez intimes pour me permettre de satisfaire un mouvement de curiosité auquel je ne pus résister. « Montre-moi, lui dis-je en souriant, ce que tu portais lorsque tu étais au service du bey Hasssan. L’agha : n’eut pas un tressaillement son œil n’eut pas un éclair, ses sourcils d’aigle ne se contractèrent point, il releva simplement son burnous, étendit sa main mutilée et, d’un geste, il me désigna une arme magnifique, petite, recourbée et dont le fourreau était tout en cuivre guilloché. Cette arme-là avait fait voler plus d'une tête sur la place du marché à Mascara car la fonction du chaouch du bey Hassan, mission de confiance et toute honorifique chez les musulmans, consistait à faire l'office de bourreau !
Je considérai quelque instants cette arme terrible et je me détournai sans affection pour ne pas laisser entrevoir l'émotion qui m'agitait.
Sur un autre pan de la muraille, des pipes magnifiques étaient rangées sur les crochets de ces délicieuses crémaillères peintes, qu'on ne fabrique bien qu'à Alger et qui ont le mérite de supporter tant de choses sans empiéter sur l'espace, et sans troubler l'harmonie des peintures murales.
Cette alcôve était bien le plus délicieux sanctuaire que l’amour mystérieux ait pu rêver. Une épaisse tenture d’algérienne, relevé à droite et à gauche, fermait en retombant cette voluptueuse retraite et plongeait la grande salle dans une obscurité complète.
Aux deux extrémités de cette galerie on apercevait deux grands lits en fer, garnis de draps de laine excessivement fins et de couvertures de Tunis ; ces deux lits étaient réservés aux grands personnages que l’agha pouvait recevoir. Les murs étaient entièrement peints le plafond relevé d’arabesques avec une splendide rosace argent rouge et or du plus délicieux effet.
De tous côtés des étagères peintes, d’un aspect charmant soutenaient des aiguières et des vases turcs.
Le pas s'amortissait sur ces tapis moelleux ; tout respirait : la vie orientale, le luxe asiatique, le repos, le mystère et l'oubli du monde.
Le peintre avait compris l'agha, et il avait apporté dans l'exécution de sa pensée un soin et une délicatesse qui prouvait combien il était initié aux coutumes des indigènes riches et magnifiques dans leurs capricieux désirs.
En sortant, et après avoir visité toutes les parties des étages inférieurs, jusqu'au bain maure que Kaddour avait fait installer avec soin pour le service de ses femmes, il nous restait une pénible impression, c'était de n'avoir aperçu nulle part, même à travers un étroit et indiscret judas, le sourire d'une femme.
Il fallait pourtant se résigner à quitter cette demeure somptueuse et claustrale sans voir l’ombre, même voilée, d’une des épouses de Kaddour.
Nous jetâmes un regard de regret vers une aile de bâtiment qui renfermait ses joies intimes et nous reprîmes le chemin tortueux de notre logement.
Là, assis sur des coussins et fument le tchibouk, nous assistâmes à la kouma.
La kouma est l’heure de la justice : chaque jour l’agha entend, entouré des cadis, les plaintes de ses sujets.
Tout nous était réservé même la vue des châtiments corporels infligés par les chaouchs, immobiles jusqu’au moment où le maître fait signe.
Un malheureux fut amené et poussé dans la salle ; je ne sais pas ce qu’il avait fait, mais après quelques mots d'explication et un signe de Kaddour, je le vis s'étendre à plat ventre les mains croisées autour de sa tête.
L'agha projeta son immense coiffure sur la partie postérieure de son cou, et à l'instant deux chaouchs abattirent leurs bâtons sur les reins du patient avec la régularité des batteurs en grange ...
Au vingt-cinquième ou trentième coup, la coiffure de l'agha reprit sa place et son aplomb sur sa tête et le supplice cessa.
Pas une parole n'avait été prononcée, pas un gémissement de la part d’un patient qui se releva avec une rapidité extrême et s'enfuit sans rien dire et sans se plaindre.
Quand la kouma fut terminée, l’agha s’abandonna à une causerie assez animée et son sourire effaça l’impression que nous avait produit le justicier.
J’osais risquer une question délicate mais je savais d’avance que la réponse serait explicite et franche. Où caches-tu tes trésors ? lui demandais-je en souriant. Cette question peut paraître indiscrète, mais elle ne l’était pas pour, à qui elle avait plus d’une fois été adressée.
J’ai montré au marichâne quarante marmites de douros couvertes de beurre, me répondit-il. Il y avait là à peu près un million ; mais depuis lors, j’ai fait bâtir à Mostaganem et à Mascara, et les marmites ont diminué : le beurre a fondu, ajouta-t-il en souriant.
L’agha a des idées toutes françaises, il aime mieux toucher le fruit de la propriété que d'enfouir les douros, persuadé que le temps est proche où la loi nivellera les héritages.
On peut dire de celui qui n'est pas riche, si on compare sa fortune à celle du bachagha Si Hamed Ould Cadi, ou bien à celle des fils de Si Hamza que l'on prétend avoir plus de trente millions enfouis dans le sol.
Il me souvient d'avoir entendu la réponse de Si Boubekeur, l'aîné des fils de Si Hamza qui n'avait point assisté à la mort de son père retenu qu'il était par l'expédition contre le chérif Mohammed Ben Abdallah qu'il fit prisonnier à Ouargla.
« Sais-tu, lui demandait un chef de bureau arabe où ton père a caché ses trésors ? Je l'ignore, répondit-il, mais le nègre de mon père me le dira. »
Le chef indigène ne prend jamais son fils pour confident, quelque affection qu'il ait pour lui ; c'est un confident étranger, un serviteur qui désigne à son héritier le secret de la fortune qui lui reviendra. Le serviteur honoré d'une semblable confiance ne trahit jamais son maître.
Une promenade matinale dans le village et aux environs nous permit d'étudier les efforts que Kaddour-Morfy avait tentés pour introduire à El-Bordj un rudiment de commerce. Quelques Juifs quelques Mozabites trois ou quatre Maltais occupaient les boutiques et humides d'une sorte de caravansérail que l'agha a fait construire à ses frais, progrès dont on doit lui tenir compte ; car, ce qui est le plus difficile d'obtenir des indigènes, c'est l'emploi de leur argent dans la construction. El-Bordj est un point admirable comme position, et, un jour, ce sera une petite ville charmante.
Le déjeuner nous attendait, avec le même cérémonial que nous avons décrit les mêmes visages et les mêmes terrines, il n'y manquait que le mouton rôti, réservé pour le repas principal, qui, chez les Arabes comme les peuples du Nord, a lieu le soir.
L'instant du départ est celui des protestations des souhaits des regrets et des attentions délicates chez tous les peuples.
Chez les Arabes il s'y ajoute un sentiment particulier, celui de la sûreté des voyageurs. Morfy : le beau conteur, l'habile cavalier nous accompagnait, monté sur son cheval le plus fougueux auquel il laissait une grande liberté d'allure et qu'il excitait parfois dans les passages difficiles pour montrer sa souplesse et sa vigueur ; c'était un beau spectacle au milieu d'une grande et splendide nature.
Arrivé à la limite de l’agalick, il nous salua et mettant la main sur son cœur, tourna bride et partit au galop, suivi de ses grands sloughis qui volaient comme des gazelles sur les grandes touffes de palmier nain.
Cette visite m’avait permis de saisir au passage les principales nuances de la civilisation arabe, mes impressions, jetées dès le lendemain sur le papier sont restées fraîches et conservent tout leur enseignement.
Aujourd’hui le beau Morfy dort dans le cimetière qui couronne à l’Est la petite ville d’El-Bordj, il s’en est allé dans le pays des rêves et son père le vieil agha lui a survécu pour le pleurer.
Des compagnons que j'avais à mes côtés, plusieurs ont été moissonnés par la guerre. Rien n'a changé à El-Bordj, et le vieux château féodal domine toujours le gourbi du pauvre !
La saison d’hiver en Algérie par le Docteur Amédée Maurin (1873)
| |
| Une noble femme
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Ce sont les hommes qui font les bulletins ; il est facile de s'en apercevoir. Sur les cent voix de la Renommée ils n'en ont pas laissé une seule à la déesse pour honorer les gloires de son sexe.
Les femmes ont pourtant, elles aussi, leurs actions d'éclat ; elles ont aussi leur courage, non pas le courage qui tue, mais le courage qui sauve et qui protège.
Si les faiseurs de bulletins étaient moins absorbés par leur glorification personnelle, ils réserveraient une petite place à ces dévouements modestes, et une seule parole de reconnaissance rencontrerait dans plus d'un cœur de tendres et fécondes sympathies.
Depuis quatorze ans l'Algérie a été pour la France une sanglante couronne d'épine ; si la charité y fait y fait briller quelques fleurs, bénies soient les mains qui les ont attachées !
Pendant le second hiver de 1855, Bône vit éclater dans ses murs le choléra. Entourée de marais, réduite à l'eau impure de ses citernes, cette ville assainie maintenant, était alors renommée pour son insalubrité.
Le nouveau fléau trouva donc dans la disposition maladive des habitants un auxiliaire dont il n'avait certes pas besoin.
L'invasion fut prompte et terrible.
Français et indigènes, hommes et femmes tous payèrent leur tribut dans une effrayante proportion.
Jamais, peut-être cette maladie ne se présenta avec un caractère aussi foudroyant.
Un médecin militaire le docteur Fortier venait d'accompagner un officier à l'hôpital ; une heure après le malade témoigna le désir de voir son médecin, et on n'osa pas lui dire qu'il n'existait plus.
La porte de la Casbah que les Arabes appellent porte des Tombeaux était l'issue qui conduisait au champ des sépultures, et il n'était pas rare d'y trouver plusieurs convois obligés, pour passer, d'attendre leur tour.
Enfin dans l'espace de quelques semaines, Bône avait perdu la dixième partie de sa population. Dès les premiers jours, l'encombrement de l'hôpital força de recourir aux casernes.
Toutefois une salle y avait été réservée aux femmes. Le nombre de ces infortunées s'accrut rapidement ; on ne pouvait compter, pour leur donner des soins, que sur quelques bonnes sœurs de Saint-Joseph toujours prêtes à se dévouer.
Mais elles étaient en bien petit nombre : elles se devaient d'ailleurs à d'autres malades encore, et au milieu de l'effroi général, il était bien difficile, même à prix d'argent, de leur trouver des aides. Cette difficulté et l'embarras où elle allait jeter l'administration parviennent aux oreilles de Mme. *** .
Aussitôt elle accourt à l'hôpital et vient solliciter le modeste emploi de garde-malade surnuméraire. Elle entre immédiatement en fonction, et dès lors elle n'a plus d'autre domicile que la salle infecte des cholériques.
A peine prend-elle quelques heures de repos. Le jour, la nuit la retrouvent au lit des malades les consolant quand elle ne peut rien pour les soulager. Parmi les femmes que l'épidémie livra à la charité intrépide der Mme. *** il s'en trouva une plus malheureuse que les autres.
Aux tortures physiques, compagnes inséparables de l'affreuse maladie, se joignait en elle une souffrance de cœur assez vive assez profonde pour les dominer.
C'était la femme d'un ouvrier qui avait succombé la veille, et elle se voyait avec désespoir enlevée, elle aussi, de ce monde, parce qu'elle y laissait une pauvre petite créature, d'un an à peine, dont l'avenir l'épouvantait.
" Ma fille ! Ma fille ! Que vas-tu devenir ? Telles avaient été ses premières paroles en entrant dans cette salle qui devait être sa chambre mortuaire, et dans les courtes trêves que la douleur lui accordait, elle ne cessait de répéter d'une voix déchirante : " ma fille ! Ma fille ! Que vas-tu devenir ?"
Mme. *** était une de ces belles natures qui ne calculent jamais avec l'infortune.
Dès qu'elle connut la position de cette pauvre femme, son parti fut pris. " Consolez-vous, lui dit-elle ; s'il plaît à Dieu de vous rappeler à lui, votre enfant retrouvera une mère ; je lui en tiendrais lien. "
Un regard d'ineffable reconnaissance fut le prix de cette résolution généreuse ...
Et la pauvre mère eut encore la force de baiser la main de sa bienfaitrice et de la bénir avant d'expirer ! ... Ce fut Mme *** qui lui ferma les yeux, et quand elle se fut acquittée de ce pieux office, elle courut à la maison que la malade habitait encore quelques heures avant, prit la petite orpheline dans son tablier d'infirmière, et l'emporta ainsi chez elle.
" Tiens, dit-elle à son mari, nous nous désolions de n'avoir pas d'enfants, en voici un que le bon Dieu nous envoie. "
Et elle remit le précieux dépôt entre les bras de M. *** qui le reçut sans témoigner aucun étonnement.
Puis rassurée sur le sort de sa petite fille adoptive, Mme *** retourna auprès de ses malades ; elle avait rempli son devoir de mère, elle redevint sœur charité.
Quelque temps après le choléra suspendit ses ravages sans lui avoir fait expier le courage qu'elle avait mis à les affronter.
Pénétrées de reconnaissance pour tant de générosité et de dévouement la garnison et la population de Bône résolurent de solliciter une dérogation à l'usage qui exclut les femmes de la Légion d-Honneur.
Nous ignorons si la demande a été faite, mais l'usage a été maintenu.
L'Algérie, courrier d'Afrique, d'Orient
et de la Méditerranée (12-02-1844)
| |
| Le belge et sa voiture
De Mme Eliane
| |
C'est un Belge qui se rend à la braderie de Lille. En repartant, il a un léger accrochage. Il commence à engueuler le Français avec qui il a eu l'accident. Alors le Français dit au Belge :
- Ho, calme toi le Belge", y a pas de raison de s'exciter. Ta voiture, elle est géniale. Si elle est cabossée par un accident, tu n'as qu'à souffler dans le pot d'échappement. C'est comme les nouvelles bouteilles d'eau de Spa, tu souffles dedans, et ça reprend sa forme initiale.
Le Belge remercie alors chaleureusement le Français du conseil et rentre à la maison. Il gare sa voiture devant chez lui, et commence à souffler dans le pot d'échappement.
Un de ses amis passe alors devant la maison et dit :
- Qu'est-ce que tu fais ?
- L'autre répond :
- J'ai eu un accident à la braderie de Lille avec un Français. Mon pare-chocs était cabossé mais il m’a dit que ma voiture était comme les nouvelles bouteilles d'eau de Spa. Tu souffles dedans, et ça reprend sa forme initiale.
- L'ami répond :
- T'es con, ça marchera jamais !
Le Belge : - Pourquoi ?
- Tu as laissé les fenêtres ouvertes !
|
| |
| Les marchés algériens
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Le marché est l'un de nos plus puissants instruments d'association, puisqu'il donne lieu à des échanges continuels de choses et d’idées. Il peut devenir le gage de la soumission comme de la prospérité des indigènes. Quand l'Algérie sera gouvernée, c'est lui qui se chargera de donner à tous des garanties de sécurité. Malheureusement les fonctions de cet organe deviennent de plus en plus anarchiques et les garanties de sécurité manquent aux Arabes aussi bien qu'à nous.
En Algérie, la discorde est un ulcère rongeur ; deux tribus voisines sont presque toujours en guerre et chacune compte pour alliées toutes les ennemies de l'autre. Le territoire que nous avons dit être facilement divisible en circonscriptions commerciales et judiciaires, ce qui est un germe d'ordre, est donc aussi partagé en circonscriptions répulsives et hostiles ; ce qui est le comble du désordre.
Ces différents partis forment autant de petites lignes offensives et défensives. Obligés de fréquenter les mêmes marchés, ils trouvent dans ces réunions des occasions nombreuses d'en venir aux mains.
Le marché serait donc encore un champ de bataille, si la nécessité n'avait créé une sorte de droit des gens qui prévient ou plutôt qui ajourne les luttes.
C'est le danger de ces collisions qui toujours imminentes qui a fait reconnaître en principe la neutralité et l'inviolabilité de ce lieu. Toutefois la discorde n'y perd rien.
Une dispute a-t-elle éclaté entre deux ennemis, celui qui se croit outragé va, séance tenante, demander justice à ses alliés : on s'excite, on s'exalte de part et d'autre, on forme un plan d'attaque, on prend jours pour l'exécution ; et ce jour ne se passe jamais sans éclairer des scènes horribles.
C'est l'absence d'une médiation supérieure qui donne lieu à ces débauches de la guerre civile qui les entretient et qui les propagent.
S'il existait une tribu assez forte : pour dominer tous les partis, aussi humaine pour s'indigner de leurs violences, assez éclairé pour juger leurs griefs leurs prétentions, cette tribu serait bientôt, rien que par ce droit de haute police qu'elle s'arrogerait sur toutes, élevée par toutes sur le pavois.
L'exercice de ce haut protectorat est la mission providentielle de notre pays. Armé de ressources bien inférieures aux nôtres, soi-disant émir avait tenté ce rôle et presque partout il avait tenté, il avait réussi. Sa volonté de fer avait endormi des animosités éveillées depuis près de deux siècles c'est ainsi qu'il est parvenu à maintenir sa dictature improvisée, sans autres auxiliaires que sa volonté et son génie. Que son exemple ne soit pas perdu pour nous cette unité qu'il était obligé de rendre oppressive parce qu'il était faible, nous pouvons la constituer protectrice, parce que nous sommes forts.
C'est avant tous, sur les marchés qu'il avait assuré son autorité. C'est sur les marchés que nous devons asseoir la nôtre.
Le président de cette réunion hebdomadaire de cette assemblée à la fois industrielle politique judiciaire ne doit pas être un Arabe, mais un Français.
Si nos négociants y paraissent, devons-nous abandonner à des mains étrangères le soin de les protéger ?
Et s'ils n'osent s'y montrer, que sommes-nous donc en Algérie ?
La mosquée ne sera jamais chrétienne, l'église ne sera jamais musulmane ; le marché seul, peut-être doit être à la fois, nous ne disons pas chrétien ou musulman, mais Français et Arabe.
C'est le double siège d'une cour d'assises et d'un tribunal de première instance. Le tribunal de première instance doit rester arabe mais la cour d'assisses doit être française.
En France la loi ne permet aux journaux de paraître que sous la garantie d'un énorme cautionnement. Le marché, nous le répétons, remplace les journaux et Algérie. Nous ne lui demanderons pas aussi quelques garanties ?
Souffrirons-nous que le premier énergumène monté sur la pierre d'un édifice romain puisse crier à ses coreligionnaires : guerre aux chrétiens ?
Le souffririons-nous sans avoir d'autres défenseurs de notre cause qu'un chef indigène d'une fidélité équivoque, notre ennemi de la veille ?
Suivant-nous, la police des marchés pourrait être réglée d'après les bases suivantes : En principe, lorsqu'une tribu, qui tient marché, vient se soumettre, la première condition à lui imposer, c'est que le marché sera présidé par un Français.
Ce fonctionnaire prendra le titre bien connu de kaïd el souk (kaïd du marché) ; Il sera assisté du cheik de la tribu qui sera chargé de percevoir le meks ou droit d'octroi.
Le cheik sera accompagné et contrôlé dans cette opération par un employé indigène, attaché au service particulier du kaïd en qualité de khôdja (secrétaire).
Il enregistrera toutes les recettes. Le kaïd aura une garde proportionnée à l'importance du marché ; elle sera composée par moitié de cavaliers arabes et de cavaliers français.
Si le marché est le siège du cadi, ce magistrat devra être confirmé par le gouverneur ; il siégera à côté du kaïd.
Si c'est un siège de second ordre, le kaïd fera élire parmi les taleb qui fréquentent l'assemblée un juge civil destiné à remplacer le cadi, et il le fera siéger à côté de lui.
Le juge civil (cadi ou taleb) aura droit à une rétribution proportionnelle sur le produit du meks. Le kaïd, outre les attributions dévolues à cette charge aura pour mission spéciale de prévenir les collisions des tribus entre elles d'examiner et de juger sur place leurs différends, sauf, dans les cas graves, à en référer à l'autorité supérieure ; il se fera rendre compte à huitaine, de l'exécution de ses sentences.
Si dans la semaine un meurtre a été commis ou une violence exercée sur la personne d'un indigène par une des tribus qui fréquentent le marché ou seulement sur son territoire ; si une collision a eu lieu entre deux tribus il en sera rendu compte au kaïd qui prononcera après enquête.
Nous ne présentons ici, on le comprend bien, que les dispositions principales d'un règlement sur la police des marchés. L'idée qui nous domine, c'est la nécessité de l'intervention française.
Le but que nous proposons, c'est d'obtenir pour nous des garanties de fidélité et de donner en échange des garanties de sécurité.
Voilà ce que les indigènes nous demandent avant tout.
Que leur importent à eux nos routes carrossables si, par suite du désordre que nous occasionnons ou que nous tolérons dans le pays, il leur devient impossible d'aller chercher des denrées à la source, sans crainte d'être dépouillés ou assassinés, s'ils sont obligés de les recevoir de deuxième ou de troisième main ; et conséquemment de les payer plus cher ?
Les routes que nous construisons sont excellentes, mais elles sont toutes françaises ; le bienfait correspond pour les indigènes consisterait à tenir les communications libres et sures entre un marché et les tribus qui en ont besoin, à favoriser les rapports directs entre le producteur et le consommateur.
Là est l'avenir glorieux de notre domination en Algérie.
Voilà qu'on prépare une expédition contre les Kabyles : Malheureuse et ruineuse pensée ! O exterminateurs monomanes ! Cherchez donc plutôt, par une protection efficace à faire baisser le prix des denrées nécessaires à la vie ; faîtes payer l'huile moins chère aux Arabes et le blé moins cher aux Kabyles ; Arabes et Kabyles, tous viendront à vous car tous y trouveront leur compte, et soyez sûrs que vous y trouverez largement le vôtre.
L'Algérie, courrier d'Afrique, d'Orient
et de la Méditerranée (06-02-1844)
| |
| L'influence des femmes
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Avec leur esprit fin et pénétrant, les femmes semblent destinées à apprécier les beautés littéraires. Incapables de bien lire dans leur âme, elles aiment en secret le poète qui a su exprimer jusqu'à ces émotions vagues et indéfinissables dont on ne peut parler à soi-même et qui néanmoins ne laissent pas de peser sur le cœur. Mais lire et goûter nos poètes, tel n'est pas leur unique rôle.
Par un contact incessant avec des écrivains de mérite, elles ont participé à l'élaboration de nos chefs-d'œuvre littéraires.
Et peut-être leurs sommes-nous redevables de cette élégance dans la précision, de cette perfection dans la mesure qui caractérisent l'esprit français.
Peut-être aussi faut-il les rendre responsables de la pauvreté de notre langue, plus brillante que riche et qui paraît mériter le nom de " gueule fière ".
Encore toute virile et pleine de sève au commencement du XVIIe siècle, elle demandait à être épurée.
Ce fut l'œuvre des Précieuses, et on ne peut que savoir gré d'avoir formé le goût.
Mais ce qu'on ne saurait leur pardonner, c'est d'avoir châtier sans pitié l'esprit gaulois et porté le souci du bien dire jusqu'au raffinement. Ne fallait-il pas s'y attendre ? Les femmes sont extrêmes.
Leur laisser le soin d'une réforme littéraire, c'est à la soumettre à leurs caprices changeants à leur préciosité naturelle comme aussi à cette exagération qu'elles mettent en toutes choses.
La langue savoureuse et parfois grossière qu'avaient parlé Rabelais et Montaigne ne pouvait charmer leur esprit aussi délicat que superficiel.
Et l'érudition pédantesque de Ronsard les empêchait d'avoir accès dans les belles-lettres. Aussi en égoïstes, veulent-elles rompre définitivement avec le passé.
Après avoir émondé à plaisir cette verve gauloise trop libre dans ses débordements, elles bannissent les questions sérieuses de la littérature.
Voiture pour leur plaire, fera de l'art un véritable jeu, exerçant sa virtuosité à dire des riens avec grâce.
D'ailleurs, que faisait-il d'autre dans la salle bleue d'Arthénice et les salons à la mode ? : Poètes, grands seigneurs, dames de qualité aiguisaient leur esprit dans des conversations pleines d'agrément, où la philosophie et la religion seraient entrées de mauvaise grâce.
Les femmes n'aiment guère à aborder des sujets aussi graves ; elles préfèrent toujours un élégant mensonge à une haute vérité déplaisante.
Dès lors, ces grandes idées sur la destinée humaine qu'exprimaient quelques littératures étrangères ont été écartées de l'esprit de nos écrivains.
Le plaisir de plaire les a entraînés : à peindre avec finesse des sentiments délicats à rendre littéraire ce qui ne l'était pas, à effleurer plus qu'à approfondir.
Aussi sont-ils restés indifférents à ces problèmes qui tourmentent l'âme de Faust ou d'Hamlet. La France n'est ni Goethe ni Shakespeare.
En même temps que la vie de salon, développée exclusivement par les femmes, enlevait à la littérature un fond vraiment solide, elle privait les poètes d'une heureuse inspiration : celle de la nature.
Nos classiques paraissent ignorer la mystérieuse intimité qui existe entre nous et les choses célestes.
Aussi la nature qui forme dans quelques-unes des tragédies de Shakespeare un cadre magnifique dont les teintes s'harmonisent avec les sentiments des héros, n'a-t-elle rien à faire avec notre théâtre.
L'homme n'y apparaît pas au milieu d'un univers prêt à s'associer à ses joies comme à ses douleurs, mais isolé, n'ayant pour reposer ses regards que les tristes parois d'une antichambre, tandis " qu'un concert de rossignols chante pour le vieil œdipe aveugle dans le bois sacré de Colonne, et que le duo du rossignol et de l'alouette rassure tour à tour Juliette et Roméo, comme la voix caressante de l'ombre et la fanfare de l'aurore. "
Ainsi les femmes, en privant les écrivains de cette vie de recueillement et de solitude que réclame la poésie, semblent avoir tyrannisé la littérature et mit un frein au génie.
Sans doute, l'excès de la vie de société nuit à l'abandon, mais elle développe la finesse et l'habitude d'observer. C'est dans les réunions mondaines du XVIIe siècle que se sont formés les moralistes ; sans elles nous ne connaîtrions peut-être pas le La Rochefoucauld des maximes.
Ce grand seigneur désenchanté aurait exprimé les troubles de son âme avec une profondeur semblable à celle de Pascal, mais ce à quoi il n'aurait jamais pensé.
La Rochefoucauld la condense enfin dans un trait brillant, en fait un véritable joyau, à la satisfaction de tous ces raffinés.
Le désir de plaire l'a porté à perfectionner sa langue en même temps que son observation.
Et on peut dire que la plupart des écrivains du XVIIe siècle se sont affinés de la même manière. Par une anomalie apparente, ce sont les femmes, esprits superficiels s'intéressant à des riens qui ont donné aux moralistes la pleine conscience de leur génie.
Il faut aussi leur attribuer cette élégance et cette finesse qui sont le propre de notre langue. " Il n'appartient qu'aux femmes de faire dire dans un seul mot tout un sentiment et de rendre délicatement une pensée délicate. "
Tel est le secret de l'art voilé des classiques, de La Fontaine et plus particulièrement de Racine. Chez lui rien n'éclate : tout est nuance.
Il aime les tons amortis, les sous-entendus et nous les aimons aussi parce qu'ils permettent à notre imagination de se donner libre carrière et de rêver sur une pensée du poète.
Quand la Phèdre de Racine, honteuse de son amour, ne peut pas révéler à ce none qui l'interroge le nom de celui qu'elle aime et que de proche en proche ce none finit par le deviner et s'écrit : " Hippolyte, grands Dieux ! " Phèdre répond : " C'est toi qui l’a nommé ". Si le poète eut seulement ajouté " ce n'est pas moi ", la pensée perdait tout son prix.
Mais Racine sait faire parler les femmes avec une exquise délicatesse. Il les avait observées et son âme d'artiste s'était enrichie de toute la finesse de l'esprit féminin. C'est le même esprit qui a fait l'art classique qu'on pourrait définir par ces mots : précision et délicatesse.
Mais n'oublions pas qu'il a fallu Racine pour écarter de la littérature les mièvreries qu'on admirait tout d'abord dans Quinault.
Les écrivains de génie ont emprunté aux femmes leurs qualités littéraires en les atténuant. Leur influence n'en reste pas moins réelle ; elles ont donné sa forme à l'esprit français.
Juin 1902. Marcel Lenoir.
Les clochettes algériennes et tunisiennes (01-06-1902)
| |
ALEXANDRE GALERA
Pieds-Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°202, décembre 2011
|
|
Ma mémoire du SCUEB
En naissant le 19 Juin 1933 à El-Biar dans la proche banlieue d'Alger Alexandre Galera n'imaginait pas que I'amour qui porte tous les hommes vers leur terre natale exalterait encore ses jours quelque soixante années plus tard.
Et pourtant, Alex est ce qu'il est convenu d'appeler un historien de sa bonne ville d'EI-Biar. Ses rues, ses places, ses petits et grands commerçants, ses cinémas et son église n'ont encore à ce jour, aucun secret pour cet homme qui a cadenassé sa mémoire d'authentique Pieds-Noirs.
 Amoureux de sa ville et de son club, le Sporting Club Union EI-Biar, Alex a pratiqué le football dès ses premiers pas. Dans la rue, sur la Place de la Mairie et plus tard au SCUEB. Piloté et façonné par Robert Tixador qui fit travailler sans relâche la technique de ce sprinter des stades (Alex fut chronométré balle au pied en seniors dans le temps record de onze secondes sept dixièmes !), cet ailier gauche de métier jouait indifféremment à tous les postes de l'attaque. Sa fougue juvénile perturba plus d'une défense algéroise et dès qu'il fut junior, son entraîneur Sydney Regan, qui avait remplacé Robert Tixador à la tête des Sportingmen, le titularise épisodiquement afin de I'aguerrir. Amoureux de sa ville et de son club, le Sporting Club Union EI-Biar, Alex a pratiqué le football dès ses premiers pas. Dans la rue, sur la Place de la Mairie et plus tard au SCUEB. Piloté et façonné par Robert Tixador qui fit travailler sans relâche la technique de ce sprinter des stades (Alex fut chronométré balle au pied en seniors dans le temps record de onze secondes sept dixièmes !), cet ailier gauche de métier jouait indifféremment à tous les postes de l'attaque. Sa fougue juvénile perturba plus d'une défense algéroise et dès qu'il fut junior, son entraîneur Sydney Regan, qui avait remplacé Robert Tixador à la tête des Sportingmen, le titularise épisodiquement afin de I'aguerrir.
Mais c'est auprès de Louis De Villeneuve qui prône un entraînement à la britannique qu'Alex et ses camarades accéderont à la Division d'Honneur en 1951-1952.
Après 23 ans d'efforts, le SCUEB rejoint ainsi l'élite du football algérois. Après cinq saisons en dents de scie, avec descente et remontée en division d'honneur, c'est le départ de "Louisou" de Villeneuve et I'intronisation au poste d'entraîneur de Guy Buffard qui travaillait, déjà, dans l'ombre du "bombardier Saint-Eugènois".
Alex, contacté par I'OGC Nice en 1953, reste au club et participe à l'épopée du SCUEB en Coupe de France version 1956-1957 avec des victoires sur Montpellier 2 à 0, sur Aix-en-Provence 1 à 0 et sur le Grand Stade de Reims 2 buts à O.
Alex Galera ne jouera pas ces rencontres mais, faisant partie intégrante du groupe, il revendique, avec juste raison, ces victoires retentissantes.
Après une saison à I'ASSE, il reviendra au club de ses amours balayé par le vent du succès.
 Beaucoup de joueurs sont partis sous d'autres cieux et les dirigeants repartent avec une équipe très jeune, où Alex, à peine âgé de vingt six ans fait figure d'ancien. Beaucoup de joueurs sont partis sous d'autres cieux et les dirigeants repartent avec une équipe très jeune, où Alex, à peine âgé de vingt six ans fait figure d'ancien.
L'année suivante, il mettra un terme à sa carrière de footballeur pour embrasser celle de Sapeur-Pompier qu'il achèvera avec le grade de Commandant.
En 1963, il reprendra du service en Métropole comme entraîneur-joueur du CSL Aulnay-Sous-Bois. Puis en 1969, il rejoindra le staff technique de I'ES Juvisy en compagnie de Roger Pellegrino et Jean Ripoll, qu'il remontera en CFA. Il entraînera pour terminer l'équipe junior de I'AS Evry.
A présent retraité avec le grade de Commandant du Corps des Sapeurs-Pompiers, il vit au Val, près de Brignoles, auprès de son épouse, entouré de ses souvenirs El-Biarois et de son cher SCUEB.
H.Z.
La Mémoire du Football
d'Afrique du Nord
| |
| EXPO
Par M. Bernard Donville
|
|
Bonjour chers amis,
Oui je romps le silence que je vous avais imposé par d'autres activités. Je vais tenter de vous ramener vers notre pays perdu , mais comme je vous l'avais laissé entendre mes sujets s'amenuisent .
Dans un premier temps je vais vous faire faire quelques révisions sous une forme qui vous est inconnue. En 2002 au Cercle de Toulouse nous avons élaboré 40 panneaux pour constituer une exposition éventuellement itinérante sur notre Algérie et ce que nous y avions fait.
Je vais vous les offrir pas à pas pour vous remettre dans l'ambiance .
Après nous verrons ; c'est la surprise !
Je vais commencer ce jour par un rappel géographique sur le cadre de notre ancien pays .
Comme toujours j'attends vos critiques éventuelles et vous incite à la diffusion
Amitiés, Bernard
Cliquer CI-DESSOUS pour voir les fichiers
EXPOSITION 1
A SUIVRE
|
|
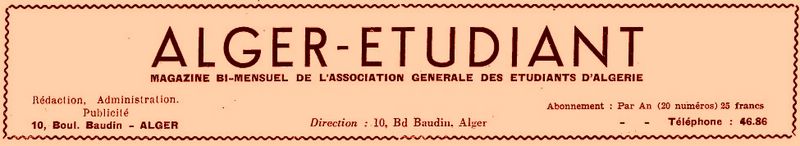 Source Gallica - N° 194, 29 mai 1935
Source Gallica - N° 194, 29 mai 1935 |
CAMILLE
J'étais laid. Des boutons parsemaient mon visage : j'accordais à ces disgrâces de l'adolescence une importance qu'elles ne méritaient pas : j'avais quinze ans. Je ressentais vivement ces souffrances, qui ont marqué mon caractère : je leur dois de m'être vu sans indulgence. Je me complaisais dans un mépris plein de tristesse, qui partait de moi pour s'étendre à l'univers, et qui s'est décanté peu à peu. J'avais les tics de la jeunesse.
Je m'égarais fréquemment dans des rêveries. Je songeais, les yeux vagues, délaissant le livre ouvert sur ma table. Ma mère relevait vertement ces distractions : «Jules, ne te crotte pas le nez!» disait-elle.
Ces réflexions m'exaspéraient : j'y voyais ; non la marque d'une tendresse attentive, mais le signe d'une prosaïque sollicitude. Je n'avais pas encore compris la beauté d'une affection vigilante, et je ne voyais de vrai dans l'amour que les grands mouvements de la passion.
C'est vers cette époque, sans doute, que je dus me mettre à rimer.
Mes premières oeuvres portèrent la trace d'une nature pleine de feu. Je tentais d'exprimer, avec l'habituelle maladresse de ces sortes d'essais, des choses que je prenais pour des sentiments. Et, comme notre vanité a besoin d'un encens, un jour, le cœur battant, je vins soumettre mes vers à Germaine, notre cuisinière.
Son jugement me paraissait précieux. Notre professeur de français venait précisément de nous donner un critère infaillible pour reconnaître la qualité de nos travaux.
Avant de recopier votre brouillon, disait-il, faites-en lecture à quelque bonne âme, dont la simplicité d'esprit égale l'humilité de condition. Si vous en êtes compris, soyez sûr de vous : votre devoir est un chef-d’œuvre. Germaine épluchait des pommes de terre et n'interrompit pas ma lecture. Même, quand j'eus fini, elle continua de peler un légume en silence. Cependant, l'angoisse m'étouffait.
Enfin, elle leva vers moi son regard pur : «Que c'est beau, Monsieur Jules, ce que vous venez de me lire !
— C'est de moi, fis-je, rougissant.
Germaine joignit les mains : — «Ce que c'est que l'instruction, dit-elle. A votre âge. Monsieur Jules, vous écrivez déjà des choses que je ne comprends pas !»
Je n’ai pas mangé de purée ce jour-là, et je fus plongé quelque temps dans la plus noire neurasthénie, ce qu'un redoublement d'acné ne manqua pas de traduire aux yeux du monde. Ma mère, sur les conseils de Germaine, me contraignit même à boire de la tisane de salsepareille.
Mais la Providence n'allait pas tarder à me fournir une éclatante revanche, en me ramenant doucement vers un emploi plus rationnel des forces qui bouillonnaient en moi.
C'est de Camille que je veux parler.
Camille habitait mon quartier. Elle était mon aînée de six mois.
Une amitié était née entre nos deux familles. Des réunions périodiques, qui comportaient d'habitude le service d'un goûter, nous rapprochaient. Nous nous retrouvions tantôt chez Camille, tantôt chez moi, car chaque maîtresse de maison avait le privilège d'un entremets. La bourgeoisie transmet ainsi par les mâles les vertus guerrières, tandis que les vertus domestiques sont l'apanage des femmes, qui les héritent de mère en fille. Mais ce corollaire de la loi salique n'est point remarqué, parce qu'en apportant au foyer ce bagage dotal insoupçonné, la femme abandonne à la fois son nom et l'orgueil pourtant légitime de cette sorcellerie culinaire.
C'est ainsi que, tous les dimanches matins, les cheveux de Camille avaient une odeur particulière, qui me plaisait, et dont je lui faisais compliment. J'ai su depuis qu'un jaune d’œuf, savamment distillé dans un verre de rhum, donne une incroyable souplesse aux cheveux : et c'est sous le parfum du jaune d'œuf que l'amour naquit entre nous...
A l'époque, outre son droit d'aînesse, Camille avait sur moi le précieux avantage que les filles d'Eve ont sur les adolescents : la nature les instruit plus vite sur les devoirs de leur sexe, et cette enfant blonde savait déjà des choses que je soupçonnais seulement, bien que les conversations du collège m'eussent renseigné sur quelques principes élémentaires de la connaissance humaine. Je dois le confesser à ma honte, dans la lutte que nous allions tous deux mener contre notre propre inexpérience, les premiers pas vinrent plutôt de ma jeune amie. Heureusement pour mon amour-propre, je peux dire que je ne m'en aperçus jamais. C'est seulement le recul du temps qui m'en donne conscience. Et j'admire à présent sans réserve le tact infini qu'elle déploya pour vaincre cette sotte inertie du jeune âge masculin, et m'amener précisément où elle le voulut bien, ni trop loin, ni trop près.
Je me rappelle aussi les premiers mots de Camille, quand nous nous fûmes embrassés : «Je t'aime et je veux que tu m'aimes ! » me dit-elle. Guidée par un sûr instinct, Camille résolvait ainsi le difficile problème de l'égalité dans l'amour, dont elle posait l'équation dès le commencement : donnant donnant.
Nous fîmes des serments. Nous coulâmes, dans la première ivresse, des jours délicieux. Nous vécûmes un rêve très doux et cependant très pur.
J'aimai. J'attrapai trois zéros en thème.
Mais je ne tardai pas à descendre de ce domaine immatériel où la force d'un amour sincère m'avait maintenu tout d'abord. Instruit par une expérience où je fus entraîné quelque soir, et que je n'ose vous conter ici, je voulus demander mieux et plus que ces baisers, dont je trouvais à présent la saveur incomplète.
J'ai souvenir de mon essai malencontreux : Camille y résista fort bien. Sans doute, elle estima mieux que moi l'importance de ce que je demandais, retrouvant tout à coup une lucidité qui me désenchanta, et qui mit fin à nos amours.
Voilà comment, par une belle matinée d'avril, pleine de chants et de frissons, j'ai, sur ma première désillusion, reboutonné ma dignité.
Pierre ALBERTINI.
|
|
PHOTOS DE ALGER
Envoyées par M. Pernice
|
|
L'ALGÉRIE AUX CENT VISAGES
LA GÉOGRAPHIE N° 5-6 Mai-Juin 1934 pages 32-41
|
|
Chez les musulmanes non voilées de la Kabylie.
Lors de plusieurs voyages en Kabylie, cette petite Suisse algérienne située aux portes mêmes d'Alger, j'avais eu maintes fois l'occasion de croiser des fillettes, ainsi que des jeunes filles et des femmes indigènes, les premières gardant des troupeaux de moutons ou de chèvres sur les flancs ombragés des montagnes ; les secondes, une amphore sur l'épaule, se rendant par groupes, avec des allures de déesse, à la fontaine communale. Non seulement leurs vêtements différaient du tout au tout de ceux des autres musulmanes, mais encore, contrairement à ce qui se passe chez ces dernières, aucune n'avait le visage voilé.
Tandis que les petites bergères, au minois rieur et aux grands yeux cernés de khol, tendaient la main vers ma voiture en demandant avec un large sourire: « un sou, monsieur ! », leurs aînées et leurs mamans, du plus loin qu'elles m'apercevaient prenaient la fuite ou, s'il était trop tard, détournaient la tête à mon passage, moins par timidité que par respect pour l'étranger que j'étais. Et c'était dommage, car la plupart, habillées à l'antique, la taille cambrée, les traits du visage réguliers, étaient d'une beauté remarquable.
L'an dernier, je devais faire plus ample connaissance avec l'élément féminin de ces rudes montagnes, grâce à un de mes amis instituteur indigène, M. Ouakli, qui avait bien voulu m'inviter à passer une partie de ses vacances scolaires avec lui dans sa petite maison natale, perchée au sommet d'un piton au cœur même de la Grande Kabylie, dans la tribu des Aïts Kheélili, à trois ou quatre cent mètres d'altitude au-dessus de la mer.
Mon premier contact, je ne dis pas avec les vieilles femmes, à la peau cuite et recuite par le soleil, et que l'apparition d'un mâle ne peut plus effaroucher, mais avec ces nymphes des eaux, si souvent entrevues dans les sentiers ombreux bordés d'oliviers et de figuiers, devait avoir lieu le jour même de mon voyage, avant même d'atteindre le village de mon ami.
A défaut de route carrossable, en effet, nous avions dû faire une bonne partie du trajet à dos de mulet.
A un détour du sentier, nous tombâmes sur un groupe de jeunes filles entrain de puiser de l'eau à une fontaine publique.
Plusieurs connaissaient mon ami. A ma stupéfaction, loin de détourner pudiquement la tête, elles nous dévisageaient d'un œil complaisant, après nous avoir accueillis par le salut coranique « Aslam ! » (Que la paix soit sur vous !)
Bien mieux, deux se détachant de leurs compagnes, s'en vinrent vers nous avec leurs amphores pleines pour nous offrir à boire !
Eh quoi ! me trouvais-je encore en pays musulman ?
« On connaît mal les mœurs des Kabyles », fit mon ami, qui avait deviné ma pensée. Certes, nos femmes et nos filles sont par certains côtés, tenues très sévèrement, mais par d'autres, elles jouissent de libertés assez grandes qu'ignorent les gynécées de mes coreligionnaires de la plaine et du sud. »
Je devais m'en rendre compte, le soir même. Entendons-nous bien, ces libertés surprennent parce que nous nous trouvons ici en pays soumis au Coran, c'est-à-dire dans un pays où la pudeur veut, autant que la bienséance, que la jeune fille n'adresse la parole à aucun jeune homme, pas même à son fiancé tant que celui-ci n'a pas franchi le seuil de la chambre nuptiale ! Mais, justement, ces mœurs n'en paraissent que plus curieuses.
Donc, ce soir-là, mon ami m'emmena voir une centenaire, sa grand-tante maternelle. Elle habitait, à l'écart du village, une ferme avec deux arrière-petites-nièces, jeunes femmes de vingt-cinq à trente ans, dont les maris étaient alors en France.
La vénérable dame, presque aveugle, se tenait dehors, sous un olivier, encore plus vieux qu'elle. Une enfant de cinq ans, la fille d'une des jeunes femmes, lui tenait compagnie.
Elle et l'aïeule semblaient faire de muettes confidences à l'arbre sacré des Grecs, dont les branches touffues les protégeaient de leur ombre durant le jour. Cependant, l'une des jeunes femmes était sortie.
« Le cousin Gualdi ! » cria-t-elle, toute joyeuse, à sa belle-sœur qui, presque aussitôt, apparut à son tour sur le seuil de la porte. Elles voulurent à toute force nous faire entrer dans l'unique pièce de l'étroite demeure aux murs en pisé et au toit couvert de tuiles rouges.
Nous nous assîmes sur la natte traditionnelle, entre un métier à tisser qui prenait toute la longueur de la chambre, et les jarres ventrues remplies de provisions, celles-ci d'huile, celles-là d'orge et de figues sèches.
Et tandis que l'une des deux brus donnait au cousin les dernières nouvelles du douar, l'autre, après avoir allumé à même le sol un feu de bois, posait une cafetière sur trois grosses pierres servant de foyer.
« La kaoua ! » fut bon, aussi bon que fut charmante et simple la réception, une réception qui semblait me reporter tout d'un coup dans quelque village de la vieille France. « De plus en plus étrange! » ne puis-je m'empêcher de dire.
Évidemment, cet insigne honneur que j'avais d'être accueilli chez elles par deux jeunes musulmanes et ce, par surcroît, en l'absence de leurs maris, je le devais à mon ami, francisé jusqu'au bout des ongles, ce que n'ignoraient pas ses deux cousines, heureuses de montrer à un « Roumi» leur connaissance de la politesse occidentale d'autant plus que cela leur donnait l'occasion d'une diversion dans leur vie, à l'ordinaire si monotone. En vérité, vie monotone comme elle peut l'être dans ces villages perdus, repliés sur eux-mêmes, et où tout de même l'Orient, d'une manière générale, étend sa chape de plomb sur les moindres faits et gestes de la femme. Et pourtant, cette monotonie laisse passer de temps à autre quelques échappées sur le monde extérieur, je veux dire au-delà du village, ses cancans journaliers et ses querelles.
Il est vrai que la femme kabyle ne peut aller dans les marchés, sortes de foires rurales comptant, certains, jusqu'à 5000 personnes, et que leurs maris et leurs frères prennent un plaisir extrême à fréquenter autant pour vendre ou acheter que pour voir les amis, apprendre ou donner les dernières nouvelles.
Par contre, la fontaine communale lui appartient, c'est son lieu de réunion par excellence, son forum à elle, d'où les hommes et les jeunes gens sont impitoyablement exclus sous peine d'amendes de la part du village.
Le matin dès l'aurore et le soir au déclin du jour, mamans suivies de leurs marmots et jeunes filles au torse souple s'y rendent, d'un pas léger, comme à une fête. Parfois, souvent même, la fontaine se trouve loin du village, à 500, 800 mètres. Pour y accéder, il faut emprunter des sentiers de chèvre, descendre, puis grimper, puis descendre encore. Mais, qu'importe la fatigue, quand on a vingt, trente, trente-cinq ans, qu'on a la langue bien pendue, qu'on est curieuse et avide de nouvelles !
Là, entre elles, loin des oreilles indiscrètes de leurs seigneurs et maîtres, elles se racontent les potins locaux, donnent leur avis sur les futures fiançailles ou les divorces en perspective, cassent du sucre sur le dos de ceux qui, à Paris ou dans telle autre grande ville de France, ont « mal tourné » en prenant comme épouses des Françaises. C'est là enfin que les jeunes filles forment des projets pour se réunir après le dernier repas du jour afin de passer chez l'une d'elles une agréable soirée chantante et dansante, dont elles seront tour à tour exécutantes et spectatrices.
Parfois, une troupe de troubadours et de danseuses professionnelles s'arrête dans le village, et voilà un autre sujet de divertissement pour ces dames.
Les hommes jouent de la flûte et du tambour, cependant que les femmes dansent et chantent. De temps à autre, on interrompt le concert pour permettre à un « aède » de célébrer en vers les hauts faits d'un des compagnons du prophète.
Les jeunes filles du village qui, ayant atteint leur vingtième année, craignent de coiffer Sainte-Catherine, profitent du passage de ces baladins en burnous pour lancer discrètement à l'un d'eux, qui un foulard, qui un bijou, l'un ou l'autre objet devant dans leur esprit conduire infailliblement les pas d'un prince charmant sur leur route.
Même geste de la part des jeunes femmes mariées, soit pour avoir des enfants, soit pour qu'Allah leur accorde un garçon si elles n'ont que des filles.
Mais ces tournées théâtrales ne forment, pour ainsi dire, avec les circoncisions et les mariages, que des exceptions dans le train-train quotidien d'une villageoise kabyle.
Il n'en est pas de même des pèlerinages aux marabouts célèbres de la contrée. Quelle jeune fille n'a pas rêvé d'accomplir, une ou plusieurs fois l'an, ces pieux voyages par monts et par vaux pour implorer par l'intercession d'un saint, mort ou vivant, la protection d'Allah tout-puissant!
Les marabouts sont nombreux en Kabylie, à croire qu'ils ont été créés pour permettre à la jeunesse féminine de respirer, de temps en temps, le grand air du dehors.
J'ai été témoin d'un de ces pèlerinages. Ce fut peut-être le spectacle qui m'a le plus impressionné au cours de ce voyage.
Ce jour-là, je me rendais en auto, toujours avec, mon ami, au sanctuaire fameux de Taka, à une trentaine de kilomètres de Michelet pour y saluer le marabout, jeune homme de grande distinction, dont le père, sidi Mohand à qui il avait succédé en qualité de seigneur de la prière, était mort depuis un an.
En cours de route nous rencontrâmes tout un groupe de femmes et de jeunes filles. Elles étaient bien une vingtaine, en chemisettes blanches, bleues ou rouges, suivant leur tribu, et retenues à la taille par une ceinture de velours, lamée d'or et d'argent.
Elles se rendaient, elles-mêmes, en grands habits de fête, au sanctuaire de Taka, à la sainte demeure de sidi Chérif c'était le nom de notre jeune marabout. Elles allaient lentement, les unes à dos de mulet, les autres à pied et elles accompagnaient leur marche de pieux chants. Mon ami se tourna vers moi.
« Nombre de ces jeunes personnes, me dit-il, viennent de très loin. Elles sont parties de chez elles, seules, et sont en route depuis trois, quatre jours, s'arrêtant, chaque soir, pour y passer la nuit dans quelque village, sous l'hospitalité duquel elles se placent. Combien, ajouta-t-il, en clignant de l'œil, combien de parents, en France, oseraient ainsi laisser partir leurs filles, seules, pour de si longues randonnées? »
Et tandis qu'il me parlait ainsi, l'écho des vallées, à chaque détour du chemin, nous renvoyait les voix fraîches et argentines des pèlerines.
Le lendemain, nous les revîmes mais, cette fois, mêlées à d'autres femmes et jeunes filles dans la cour du sanctuaire, et venant, les unes après les autres, déposer le baiser de paix d'abord sur l'épaule, puis sur le front de sidi Chérif, impassible, avant que d'aller prier sur la tombe de son père et y remettre l'offrande rituelle.
Je me souvins alors que les ancêtres lointains de ces femmes avaient coutume, au temps de saint Augustin, de s'assembler dans les églises pour y prier le Christ, dont la religion est la seule à avoir relevé la femme de son antique soumission en exaltant sa dignité.
(Un village kabyle, Djemaa-Saharidj [la Réunion des bassins] et où se voient encore maints vestiges de la civilisation romaine, fut même le siège d'un évêché.) Je compris mieux alors cette liberté d'allure que la Kabyle a gardée dans ces montagnes abruptes, liberté que le cadre étroit des coutumes musulmanes n'a pu étouffer, et qui frappe également dans la fréquentation, de plus en plus grande, des écoles pour filles, écoles publiques et écoles confessionnelles, écoles purement primaires aussi bien que les écoles professionnelles.
Apprendre à lire et à écrire en même temps qu'à tisser des tapis, à faire de la broderie et de la dentelle, voilà le rêve qui hante aujourd'hui le cerveau de nombre de fillettes kabyles.
Tant mieux ! car, c'est une formation excellente, d'autant plus que celles qui la reçoivent commencent à faire prime sur le marché des mariages, chose nullement à dédaigner, on en conviendra, dans un pays où l'épouse ne peut voir son mari pour la première fois, que la nuit même de ses noces!
En effet, les jeunes gens, surtout ceux qui dans les grandes villes ont vécu en contact journalier avec les Européens, jettent, de plus en plus, leur dévolu sur ces anciennes élèves de nos écoles publiques ou religieuses. Ils les trouvent plus affinées, moins paysannes que leurs compagnes des douars et de plus, apprécient à sa juste valeur le métier qu'elles ont en mains.
Au fait, c'est peut-être par l'école que les femmes berbères des montagnes de la Kabylie arriveront peu à peu à prendre ou à reprendre le plaisir véritable qui leur revient, soit dans la famille, soit à leur foyer. Ce sont des femmes de « chez nous », « orientalisées » par la loi du prophète, dont les hommes, semble-t-il, se sont octroyés tous les bons côtés, en laissant les mauvais à leurs moitiés.
Cette coutume, renforcée par les « Kanouns » du village, suivant laquelle une jeune fille ne peut rencontrer son époux qu'à la dernière minute c'est le cas de le dire n'est-ce pas un peu un abus d'autorité de la part des parents, lesquels, je m'empresse d'ajouter, sont eux-mêmes de gré ou de force soumis à la tradition ancestrale ?
Hélas! Toute choquante que soit pour nos idées la tradition en pareil cas, elle devient non seulement encore plus choquante, mais tout simplement monstrueuse en d'autres cas, lorsque, par exemple, l'honneur de la famille est en jeu.
Est-il reconnu qu'une jeune fille entretient des relations coupables avec quelqu'un du village, le père ou le frère aîné n'hésiteront pas à le faire disparaître soit en le tuant « accidentellement » d'une balle de fusil, soit en l'empoisonnant.
Dureté de cœur ? Amour de la vertu poussé au sublime ? A mon avis, ni l'un ni l'autre; mais, plutôt, la peur du qu'en-dira-t-on, cet autre tyran de tous les villages, de n'importe quel pays. Si le père ou le frère aîné n'agissaient pas, ils seraient montrés du doigt par les voisins. A chacune de leurs sessions, nos cours criminelles ont à évoquer de ces drames sanglants. La femme, cependant, est loin d'être une esclave, la chose de sa famille ou de son mari, je l'ai montré. En voici un nouvel exemple : Un jour, il me fut donné d'assister à une séance de la Djemaa ou réunion publique des notables du village.
Ils avaient à se prononcer sur quelques affaires en litige : vols de poules, délimitation de champs, disputes, etc. Les juges avaient pris place sur les bancs en pierre, servant de sièges à la Djemaa, installée dans une sorte de hangar ouvert à tous les vents. Tout le village était là pour entendre le prononcé des sentences.
Or, quelle ne fut pas ma surprise de voir, à l'appel du président, une jeune femme se lever de la foule et venir devant l'aréopage non pas pour se disculper de quelque faute, mais bien pour donner son avis dans une affaire intéressant l'ensemble de la communauté.
Cet avis, elle le soutint avec force et éloquence, scandant chacune de ses phrases d'un geste énergique, ayant réponse à tout et à tous. Bref, elle fit tant et si bien que finalement, sa thèse prévalut.
J'appris par la suite que c'était une veuve et que, d'après les «Kanouns », toute femme d'un village, qui ne peut se faire représenter à la Djemaa, soit par son mari, soit par son père ou un oncle, a le droit d'y venir elle-même en personne pour y défendre la cause qu'elle croit juste.
C'est ainsi que dans ces rudes montagnes que domine l'imposante muraille du Djurdjura, le « Mons Ferratus » des Romains, la femme kabyle se meut dans un cadre millénaire qu'éclaire tout un jeu de lumières et d'ombres, les unes et les autres offrant le plus vif intérêt.
MICHEL RAINEAU.
|
|
| PLEURNICHAGES
De Jacques Grieu
| |
0n dit souvent que rire est le propre de l’homme.
On pourrait dire aussi que pleurer, c’est tout comme.
On a rarement vu un animal pleurer,
Sauf les gros crocodiles et ça n’est pas prouvé.
Rire et pleurer aussi sont donc notre dada.
« Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera »
Pourtant, rire et pleurer, chacun devra décrire :
On « donnait» à pleurer alors qu’on « prête » à rire !
Si le vin fait chanter, c’est l’eau qui fait pleurer ;
Mais chanter, c’est pleurer si l’on veut méditer.
On vieillit bien plus mal à se gausser des autres
Qu’à pleurer sur soi-même avec des patenôtres.
Est-ce bien un hasard si les gouttes des pleurs
Ont un goût si salé ? L’auteur ou le lecteur,
L’affligé, le peiné, le triste ou le grognon,
Tous en font l’expérience, l’amère observation.
Pourquoi ne sait-on pas interdire à nos yeux
De laisser échapper sur nos joues cet aveu ?
Si pour faire pleurer, il faut pleurer soi-même,
Pour savoir faire rire, restez digne à l’extrême.
On a des mots qui pleurent et des larmes qui charment ;
La bouche sourit mal quand les yeux sont en larmes
Mais la larme de l’œil rit du bruit de la bouche.
Mieux vaut pleurer pour rien que trop rire à la louche.
Qui n’a jamais pleuré, ses larmes a bien masqué,
Car souvent le mouchoir les a dissimulées.
Où sont allées les larmes empêchées de couler ?
Parfois sous les lunettes où on les a cachées !
La vie est un oignon qu’on épluche en pleurant
Et l’on n’a pas trouvé de légume hilarant…
Jacques Grieu
|
|
|
HISTOIRE
PAR MANUEL GOMEZ
Envoi de M. Algudo.
|
Algérie : de Gaulle craignait la jonction
de l’armée et des insurgés

En ce début d’année 1960, l’objectif du Président de la république, Charles De Gaulle, est de larguer l’Algérie française.
Il lui faut donc :
1/ Retourner l’opinion publique en France.
2/ Neutraliser l’armée.
Si retourner l’opinion de la population métropolitaine ne présente aucune difficulté, les communistes, les syndicats, la presse dans sa majorité, s’en chargent à longueur d’écrits, d’actes et de paroles. En revanche, neutraliser l’armée devient une priorité pour De Gaulle car la 10e Division Parachutiste, sous la conduite du général Massu, a gagné la bataille d’Alger et bénéficie d’une reconnaissance sans faille des algérois.
Le 19 janvier 1960, recevant à Paris des élus d’Algérie, De Gaulle leur affirme : « L’intégration est une connerie d’ailleurs l’armée ne fait que des conneries ».
De Gaulle sait l’effet que va produire sa déclaration sur la population et l’armée. Il sait qu’Alger va s’enflammer. Il met en place tous les éléments nécessaires au scénario de son plan et c’est le «clash» très attendu.
Une manifestation est prévue pour le 24 janvier. Elle n’est pas interdite. Il est acquis qu’en évitant tout contact entre les manifestants et les gendarmes tout devrait bien se passer.
Dès 9 heures la foule (environ 50.000 personnes) arrive en masse, civils, femmes et enfants, avec à leur tête la musique des Unités Territoriales, formées par le rappel des réservistes européens et commandés par Sapin-Lignères.
L’ordre est donné à la 10e Division Parachutiste, en opération en Kabylie, de rejoindre en urgence Alger afin d’encadrer la manifestation organisée dans la soirée. Dès que les parachutistes seront présents sur les lieux du rassemblement l’ordre sera donné aux gendarmes mobiles de dévaler les escaliers du Forum en ouvrant le feu et l’irréparable sera créé : ce sera l’affrontement inévitable entre les manifestants, les gendarmes et la 10e Division Parachutiste, chère au cœur des algérois.
C’est la tactique préparée et organisée par De Gaulle, mais elle ne fonctionne pas comme il le prévoyait.
Les manifestants commencent à se disperser et il ne reste environ que 5 à 6000 personnes lorsque le colonel Debrosse donne l’ordre aux gendarmes d’intervenir.
Alors qu’ils descendent les escaliers du Forum, des CRS mettent en batterie des fusils mitrailleurs sur l’un des murets. Comme cela se passe, et se passera, le plus souvent un coup de feu est tiré et c’est le déclenchement de l’enfer : les Fusils-Mitrailleurs des CRS tirent dans le dos des gendarmes et dans le ventre des manifestants. Les Fusils-Mitrailleurs des Unités Territoriales répondent aussitôt. Des gendarmes s’écroulent. Les manifestants fuient dans tous les sens.
De Paris, De Gaulle dénonce le « mauvais coup porté à la France ».
Pour la première fois, en Algérie, des français ont tirés et tués d’autres français.
*27 morts, dont 14 gendarmes, et 150 blessés.
Une barricade se construit sous les yeux des parachutistes qui ne font rien pour l’empêcher.
Le délégué du gouvernement, Paul Delouvrier, ne sait pas si l’armée lui obéira.
Arrivé à Alger le 26 janvier, Michel Debré, premier ministre, constate avec inquiétude l’union qui se réalise entre insurgés et militaires. Il est informé que l’armée, même si l’ordre lui en est donné, ne tirera pas sur les insurgés.
Le colonel Argoud, ex chef d’état-major du général Massu, ne s’en est pas caché : « De toute façon, si on me donne l’ordre de tirer, je ne l’exécuterai pas. Je donnerai l’ordre à mes subordonnés de désobéir. »
====================
Algérie : de Gaulle voulait
que la troupe tire sur les insurgés
Barricades d’Alger – Janvier 1960 (suite)
Dans un premier temps, de Gaulle condamne fermement l’action des insurgés, des « usurpateurs » dit-il. « Il faut savoir en finir avec une affaire comme celle-là. Il ne faut pas avoir peur de verser le sang si l’on veut que l’ordre règne et que l’État existe. Donnez l’assaut si c’est nécessaire. »
Mais il n’est pas suivi et devant l’urgence de la situation qui lui échappe, le chef de l’État s’exprime de nouveau : « Comment pouvez-vous douter que si un jour les musulmans décidaient librement et formellement que l’Algérie de demain doit être unie à la France, rien ne causerait plus de joie à la patrie et à de Gaulle que de les voir choisir entre telle et telle solution, celle qui serait la plus française ».
Entendant ces phrases, les officiers des régiments de parachutistes négocient la reddition des «insurgés» et le 1er février ils sortent des barricades devant l’armée française qui leur rend les honneurs en présentant les armes au garde à vous. Ils seront incorporés immédiatement dans un commando de la Légion, le 1er REP, à Zeralda, près d’Alger.
Ce qu’il faut admettre en toute objectivité, c’est que de Gaulle fait preuve ensuite d’une intelligence machiavélique pour tirer un profit maximum de cette opération qui a été un échec pour lui.
La décision qu’il va prendre sera très lourde de circonstances pour la suite de cette « guerre d’Algérie » car, sans elle, il aurait pu en être tout autrement.
Profitant de la situation présente, il ordonne de dissoudre les unités territoriales.
Ces unités territoriales avaient été formées, en 1955, par le rappel sous les drapeaux de tous les réservistes européens de l’armée française mobilisables d’Algérie (jusqu’à 48 ans), soit 250 000 hommes.
Les unités territoriales sont donc dissoutes sur ordre de l’Élysée pour avoir pris part à la semaine des barricades.
Hier je vous ai exposé mes faits tels qu’ils se sont déroulés, tels que nous les avons vécus, mais il est préférable d’avoir des preuves, n’est-ce pas ?
J’ai assisté, comme chroniqueur judiciaire du quotidien « L’Aurore », du 3 novembre 1960 au 3 mars 1961, à ce procès des « inculpés d’Alger » ; accusés : les officiers Gardes, Argould, Joudes, Sapin-Lignères, Marcel Ronda, Sanne et les civils Alain de Sérigny, Pierre Lagaillarde, Jean-Claude Pérez, Lefèvre, Marcel Rambert. Ils étaient défendus par maîtres Tixier-Vignancourt, Isorni, Goutermanoff et Charpentier.
Lors de son témoignage, le capitaine de la Bourdonnaye affirme : « J’ai arrêté le tir d’un FM qui avait déjà utilisé trois chargeurs. Le colonel Godard l’a vu comme moi et le commandant Allaire également ». Ces deux derniers officiers confirment devant le président du Tribunal, M. Thiriet, le témoignage du capitaine.
Usant de son pouvoir discrétionnaire, le président Thiriet convoque le général Morin, commandant la gendarmerie d’Algérie, qui témoigne à son tour et déclare que « contrairement aux prescriptions permanentes, le colonel Debrosse avait donné l’ordre de prendre des FM. Il n’avait reconnu que le tir d’une rafale par ses gendarmes ».
Lors d’une audience les experts légistes révèlent que sur les 14 gendarmes tués, 9 l’ont été par des balles tirées dans le dos. Des douilles récupérées sur place, par le colonel Godard, permettent de prouver que les munitions qui ont abattu les gendarmes avaient été distribuées quelques jours auparavant aux « auxiliaires du service d’ordre ».
L’accusation, par ordre, se charge de noyer l’incident et les juges acquittent tous les inculpés
Prévoir alors qu’elle aurait été la détermination de De Gaulle, désavoué par son armée et par une partie importante des parlementaires : poursuivre sa politique d’abandon à l’aide de son référendum et de ses « accords d’Évian » ou se retirer devant l’impossibilité d’appliquer l’autodétermination et d’offrir l’indépendance au FLN et à l’ALN, vaincus sur le terrain des opérations ?
====================
Pourquoi occulter ces côtés sombres
du personnage de Gaulle ?
Nous vivons une époque où, de la gauche extrême à la droite ultra, « ils sont tous gaullistes ». C’est la mode du jour : pour être entendu, pour être crédible, il est absolument nécessaire de se référer à De Gaulle. Dès lors les Historiens se mettent à l’ouvrage qui publiera le meilleur De Gaulle. On se plonge dans les archives, on se noie dans les écrits du général, dans ses mémoires abondantes. Chacun le connaît mieux que tel autre ou que celui-ci ou même que le prochain qui publiera sa vérité sur un De Gaulle que, pour la plupart d’entre eux, ils n’ont jamais connu, ni rencontré, ni vu (en dehors des images d’archives de télévision).
Il est tout de même bizarre (oui, j’ai bien dit “bizarre”) qu’aucun de ces historiens du nouveau gaullisme n’ait ni le courage, ni l’objectivité, ni même la tentation de mettre en évidence et de tenter d’expliquer ses déclarations, pour le moins destructrices de l’image gaullienne, l’une à Raymond Tournoux (1967) « Les Français sont des veaux. La France entière est un pays de veaux » (déclaration confirmée par son propre fils Philippe De Gaulle) et la seconde à Albert Camus, lors de leur rencontre le 5 mars 1958 : « Je n’ai jamais vu un Français tuer d’autres Français… sauf moi ».
Et pourtant, j’aimerais tant que tous ces historiens ne passent pas sous silence la complicité de De Gaulle sur tant de crimes, d’assassinats, de massacres. Par exemple :
– La livraison aux Soviets de Staline de plus de 100 000 prisonniers russes de l’armée Vlassov détenus en France.
– L’assassinat du commandant Rodier organisé par Michel Debré (qui visait le général Salan).
– Son organisation d’un « clash » meurtrier à Alger, en janvier 1960 (barricades).
– D’avoir programmé le sacrifice de jeunes soldats français, en mars 1962 à Souk-Ahras.
– D’avoir programmé le massacre de la rue d’Isly, à Alger le 26 mars 1962 (confirmé par Christian Fouchet).
– D’avoir programmé le massacre de dizaines de milliers de harkis.
– D’avoir autorisé les enlèvements et les assassinats du 5 juillet 1962 à Oran.
– D’avoir ordonné la condamnation à mort des généraux Salan et Jouhaux et d’être ainsi responsable du suicide du général de Larminat.
– D’avoir refusé la grâce présidentielle et ordonné les exécutions du lieutenant-colonel Bastien-Thiry et du lieutenant Degueldre.
– De sa complicité dans tous les meurtres, les assassinats, etc. des “Mission C”, du SAC et des barbouzes sous ses ordres jusqu’en 1968.
Et je pourrais poursuivre cette liste avec la Syrie, Dakar, Mers-el-Kebir, etc.
Désolé, surtout ne vous plongez pas dans mon livre « J’accuse De Gaulle » et poursuivez la lecture idyllique de tous ceux qui vous présentent cette image d’un De Gaulle que vous êtes obligé d’encenser puisqu’ils vous le disent et vous l’écrivent !
|
|
PHOTOS DE ALGER
Envoyées par M. Pernice
|
|
L'ORTOLAN
Tirailleur Algérien, N°510, octobre 1900
Source Gallica
|
|
L'ortolan n'est point un gibier,
Nul chasseur ne dit le connaître.
L'ortolan pour un cuisinier,
C'est la «Topaze » culinaire.
II
L'ortolan pour un amateur,
C'est une aimable friandise,
Un bonbon rempli de liqueur
Que la nature aromatise,
III
O Parisiens ! Etat-Major
De notre beau pays de France,
Vous tous qui payez à prix d'or
Un ortolan huileux et rance
IV
O Financiers, ô gens heureux.
Gourmets auxquels la table est chère,
Or ça, lisez, ouvre: les yeux,
Permettez que je vous éclaire :
V
Dans le Midi les ortolans
Sont engraissés à l'entreprise,
Et vous êtes les seuls chalands
De cette triste marchandise.
VI
Si vous voulez au plat des dieux,
Piquer la «bouchée à la Reine »,
Allez visiter les saints lieux
De St-Chamond et de St-Etienne.
VII
Allez voir dans chaque canton,
Au beau milieu des champs d'avoine,
Tuer, même à coups de bâton,
Le becfigue, gras comme un moine,
VIII
Pour en manger, plus d'un bec fin
Tous les ans se met en voyage ;
De ceci, «Brillat-Savarin »
Nous a fourni le témoignage.
IX
Voici d'un abbé de Citeaux
La manière vraiment exquise
De manger ces petits oiseaux
Engraissés en terre promise.
X
Il faut poser très doucement
L'oiseau dans la fosse buccale,
Puis mordre et mâcher vivement
D'une dent ferme et magistrale.
XI
L'organe s'inonde aussitôt
De quintessence d'osmazane,
Parfum subtil, juteux et chaud
Duquel n'approche aucun arâme.
| |
ALGER
Texte Auteur Inconnu
Envoyé par Mme Bouhier
|
|
LA CASBAH, RUES
Par Benjamin Sarraillon
Posée comme une blanche carapace de cubes imbriqués sur sa colline couronnée par l'ancien palais des deys, la ville arabe, source d'inspiration pour les écrivains, est aussi une mine inépuisable pour les peintres et les chasseurs d'images.
Rue de la Casbah
Des rues escarpées, zigzagantes, finissant en culs de sac... Des voûtes, des encorbellements, des terrasses surplombantes qui dispensent un jour parcimonieux à des tunnels vétustés et suintants... On va de trous noirs en flaques de soleil, de sinistres réduits en boutiques inondées de néon. Fontaines crasseuses, minarets étincelants, c'est un festival de contrastes.
Le suave jasmin fleurit en blancs colliers sur un fond de puantes entrailles de moutons.
De fugitifs fantômes en haïks immaculés côtoient de lamentables loques humaines perdues dans leurs guenilles...
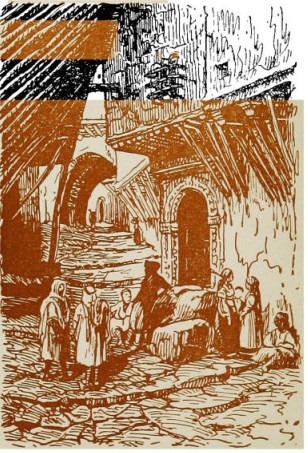 Parfums entêtants, relents épicés, musique obsédante et cris gutturaux. Avec son cortège de mirages et de sortilèges, c'est déjà tout l'Orient où le sordide se mêle au divin. Parfums entêtants, relents épicés, musique obsédante et cris gutturaux. Avec son cortège de mirages et de sortilèges, c'est déjà tout l'Orient où le sordide se mêle au divin.
Rue du Nil... Une rue! Plutôt un dédale d'escaliers sinuant entre des murs lépreux. Une porte s'ouvre, une mauresque en jaillit, suivie d'une horde de gosses qui s'échappent en piaillant et dévalent les marches...
Dans une «épingle à cheveux», une belle porte bien proportionnée atteste une riche demeure. L'encadrement en plein cintre est de marbre sculpté et peint. Des encorbellements s'appuient sur de longues béquilles de thuya dont la solidité nous semble bien précaire, et empruntent à la rue la place qui manque à l'intérieur.
Sous la cruelle clarté d'une lampe électrique qui met en évidence l'indigence du lieu en accentuant les reliefs et en creusant des zones d'ombre, l'impasse Berbrugger n'est digne de son nom que par son pittoresque.
En plein quartier réservé, l'impasse du Regard, riche seulement de ses grands murs écaillés, termine son court trajet sous une voûte obscure, véritable coupe-gorge.
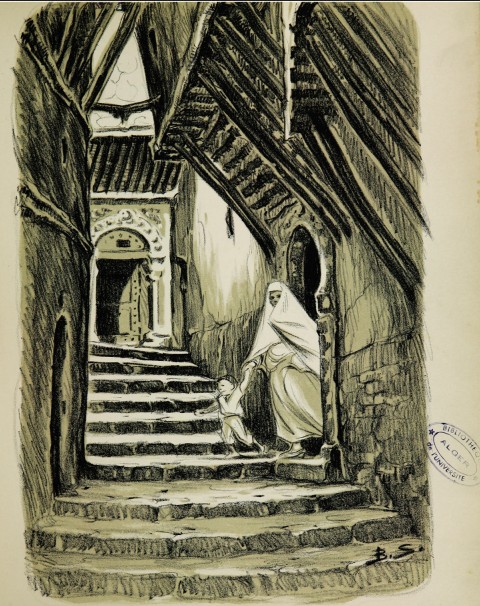

Dépassant d'une fenêtre défendue par de lourds barreaux, la fleur écarlate d'un géranium s'étire vers la lumière et pique une note colorée dans toute cette grisaille.
Minuscules boutiques de toutes sortes: coiffeurs, bijoutiers, cordonniers; vendeurs ambulants de brochettes, de légumes, de poissons; joueurs de cartes ou de dominos ; cafés maures, marchands d'encens balançant leur cassolette à bout de bras...
 C'est toute la vie frémissante d'un peuple fataliste et laborieux... C'est toute la vie frémissante d'un peuple fataliste et laborieux...
Séduit par Alger dès son premier contact, Sarraillon s'attacha, dans toute son œuvre picturale, à traduire tout l'amour qu'il portait à son pays d'élection
Né à Lyon en 1901, Benjamin Sarraillon, après avoir suivi les cours de l'Ecole des Beaux-arts de cette ville avec le professeur Mangier, s'établit en Algérie en 1924 avec son épouse. Son fils Albert naîtra en 1926.
Séduit par les vastes horizons et la luminosité de la capitale, il s'installe à Alger et y ouvre un atelier de dessin. L'année suivante il a la chance d'être présenté au grand peintre orientaliste Etienne Dinet, qui s'intéresse à ses œuvres et qui le conseille. Il doit aussi ses progrès aux sages conseils de son nouveau maître, le peintre portraitiste et sculpteur Flamand Jules Van Biesbroeck, dont il fut l'élève pendant quatre ans et qui le marqua profondément. Fort de l'enseignement ainsi reçu, il s'attache à réaliser des œuvres authentiquement arabes et kabyles et à traduire avec un grand souci de vérité les mœurs et coutumes des autochtones.
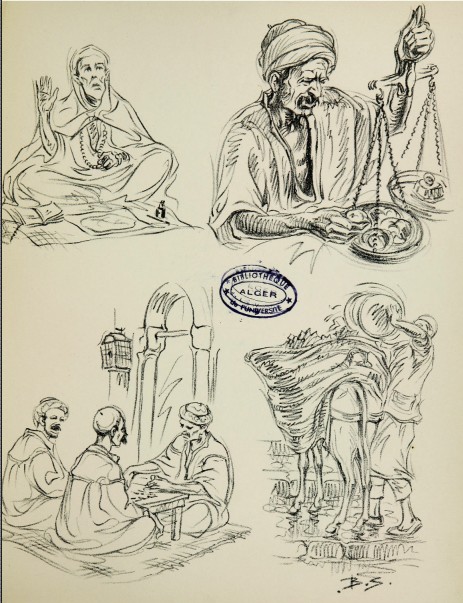 Il s'inscrit à la Société des peintres orientalistes et commence à exposer dans différentes sociétés artistiques locales. Il s'inscrit à la Société des peintres orientalistes et commence à exposer dans différentes sociétés artistiques locales.
C'est à Alger qu'il fait en 1932 sa première exposition à la « Maison des Livres » Cette rencontre avec le public algérois connaît un franc succès. Encouragé par les critiques qui reconnaissent son talent, il expose ta régulièrement chaque année jusqu'en 1962.
Durant les premières années de son installation en Algérie, le peintre collabore à plusieurs journaux, revues et magazines (L'Echo d'Alger : dessins de presse; Afrique du Nord Illustrée : dessins, illustrations, diverses mises en pages), allant même jusqu'à la création complète d'un journal pour la jeunesse franco-musulmane, en couleurs et bimensuel : Jeunesse Algérienne.
En 1925, c'est le livre de l'écrivain algérianiste, Robert Randau, Cassard le Berbère, qu'il illustre de trois cents dessins et qu'il réécrit lui-même à la main.
Il se remarie en 1937 avec Floriane Moutte avec laquelle il partage la passion de la peinture et de la nature. A l'occasion de captivantes expéditions dans l'Aurès avec son épouse, il rapporte des documents exceptionnels lui permettant de réaliser un livre d'art sur Rouffi, faisant revivre pour le grand public dans leur décor hostile et grandiose, les farouches Chaouïas qui hantent les habitats semi-troglodytes du canyon d'Oued-el-Abiod. Grâce à ses qualités techniques, il illustre, lithographie et imprime lui-même son ouvrage. Cette édition connaissant un grand succès, il va consacrer une part plus importante de son temps à illustrer d'autres livres. et à collaborer à des journaux, sans pour autant cesser de peindre.
Si Sarraillon, illustrateur, a eu recours à plusieurs techniques, c'est à la lithographie qu'il doit ses plus grandes réussites, Son œuvre d'illustrateur représente un aspect si caractéristique de son art que certains pourraient croire qu'il y a consacré l'essentiel de son activité. Il n'en est rien cependant. Mobilisé le 30 août 1939, il est affecté au grand quartier général en qualité de cartographe. Muté le 1er janvier 1940 au gouvernement général de l'Algérie, il est nommé au centre d'information et d'étude. En 1943, il est au secrétariat du général Giraud et réalise durant cette période quarante-huit portraits d'officiers français, américains et anglais.
Réincorporé au deuxième bureau comme chef cartographe, il réalise des plans et des dessins « top-secret » pour les armées alliées et pour le débarquement en Provence ainsi que diverses missions et travaux confidentiels.
Démobilisé fin 1945, il reprend ses activités graphiques et ses pinceaux et participe à routes les expositions et salons organisés à Alger. Mais l'indépendance de l'Algérie sonne le glas pour la vie de l'artiste en ce pays. La mort dans l'âme, serrant près de son cœur meurtri une poignée de souvenirs, Benjamin Sarraillon, après quarante ans de présence et de travail ininterrompu, quitte cette terre d'Afrique qui l'avait tant inspiré.
Il poursuivra son œuvre avec courage. La Provence a remplacé les plaines algéroises. Les amateurs d'art découvriront à leur tour ce peintre attachant et talentueux, cet homme simple et charmant. Malheureusement la maladie qui le frappe ne lui laisse pas le temps de poursuivre son œuvre.
Il meurt le 25 février 1989 et repose à Cassis entre soleil et mer.
|
|
| PENSEMENTS
De Jacques Grieu
|
|
PANSAGES
« Qu’est-ce que la pensée ? », songeons-nous, quelquefois :
« Qu’y avait-il avant ? », avant qu’on l’entrevoie ?
Car l’homme sait qu’il pense et connaît sa pensée ;
Entre le tout et rien, là, sa pensée est née…
Depuis combien de temps sait-il qu’il peut penser ?
Sans doute dès le singe, il a du commencer…
Il sait bien qu’il n’est pas tout au centre du monde,
Mais il y est un peu où sa pensée se fonde.
Sans pensée, tout est vide et rien n’a d’existence.
Tout l’univers n’est là que parce qu’on le pense.
Le discours qu’on se tient, avant même la science
Nous a montré jusqu’où va son omnipotence.
La pensée est physique, elle est dans nos cerveaux,
La boîte où nos neurones installent leur bureau.
Mais elle aime douter, se poser des questions
Elle adore se nier dans des complications.
Si certaines pensées viennent spontanément,
Penser, en général, est un effort constant.
Parfois c’est un conseil, d’autres fois un diktat :
Contre nos sentiments, souvent, elles combattent.
D’où viennent nos pensées ? Y a-t-il une mine ?
La mine est le réel, l’idée qui se dessine.
Parfois, c’est le hasard qui l’aura fait venir ;
Souvent on l’a voulue et l’a fait aboutir.
Pascal et Cicéron, Sénèque ou bien Montaigne
Ont dit ces choses-là ; nos esprits s’en imprègnent.
Ce sont bien nos pensées qui bâtissent nos vies ;
Nos arrière-pensées y contribuent aussi !
Mais de toute pensée, somme nous responsables ?
On n’a pas souhaité les pensées inavouables !
Qui pourra établir qu’on en est bien l’auteur ?
Nos pensées nous dépassent et parfois nous font peur…
Pour penser vite et mieux, on a fait des robots
Dont certains nous ont dit le pire et le plus beau.
Mais qui les a pensées, ces machines à penser ?
Contre nous, leur pensée pourrait se retourner ?
Les rêveries aussi génèrent la pensée ;
Elles sont sa vapeur, son parfum, sa fumée ;
Comme nuages en ciel, la pensée prend sa forme
Et quelquefois retombe en pluies qui nous transforment.
« Je pense et donc je suis », a dit un grand génie
« Je panse et donc j’essuie », en fait la parodie.
Descartes, dans sa tombe en aurait-il bondi ?
Du sourire, on nous dit qu’il était un ami…
Il y a des pensées qu’il faut garder pour soi,
Et qu’un beau jour on veut ressortir à bon droit.
Comme moi, on les cherche, on ne les trouve plus.
Pensée trop retenue est pensée disparue…
Jacques Grieu
|
| |
LES CHEFS ARABES A PARIS.
Gallica : Revue d’Orient 1852-2 pages 380-387
|
Les chefs arabes qui sont venus en France, sous la conduite du colonel de spahis Durrieu, pour prendre part à la fête militaire de la distribution des aigles, ont été fort remarqués par la population parisienne. Leur hardiesse comme cavaliers, la magnificence de leurs costumes, la beauté de leurs armes, leur mâle physionomie éclairée par des yeux étincelants, la fierté de leur tournure et de leur attitude, lorsque, lancés au galop, ils laissaient flotter derrière eux les plis de leurs burnous, ont attiré tous les regards. Leur politesse exquise, leur gravité pleine de réserve ne leur ont pas valu un moindre succès dans les salons de l'Élysée ou de la présidence du Corps législatif.
Ce succès a pu étonner ceux qui se faisaient une idée de nos fonctionnaires indigènes d'après les cavaliers de l'Hippodrome, pauvres diables qui n'avaient dans leur pays que le rôle de mendiants ou de saltimbanques.
Quand on connaît l'Algérie, on sait, au contraire, à quoi s'en tenir sur la noblesse militaire et religieuse de ce pays, qui rappelle, par sa libéralité, par l'éclat de son existence, par l'empire qu'elle exerce autour d'elle, notre ancienne féodalité du temps des croisades. Le chef arabe, véritable roi de sa tribu, peut en effet être comparé au chevalier du moyen-âge, tenant une sorte de cour au milieu de ses vassaux, toujours à cheval, amoureux du luxe des vêtements, des armes, et obéi au moindre signe par ses hommes liges.
Les chefs arabes qui se trouvaient à Paris représentaient la classe nombreuse et de plus en plus méritante des fonctionnaires indigènes qui ont été investis par nous de commandements importants, et qui se sont associés â notre politique. Ils ont été choisis tout naturellement parmi les plus considérables et les plus considérés. Plusieurs d'entre eux nous ont d'abord combattus, et, depuis leur soumission, nous ont rendu de bons et loyaux services. D'autres appartiennent à la jeune génération d'indignes qui ont vécu et grandi sous notre domination, qui se sont familiarisés avec nos institutions et avec nos lois, et qui ont vu s'émousser â notre contact leurs antipathies de race et leurs préjuges religieux.
Ces derniers nous ont toujours été fidèles, et l'on peut attribuer en grande partie à leur influence et à leur exemple les progrès que nous avons laits sur l'esprit de la population arabe.
La députation des fonctionnaires indigènes de la province d'Alger se composait de six chefs investis de commandements importants. Nous indiquerons en quelques mots leur origine, leur caractère, leurs services passés.
BOU-ALEM-BEN-CHERIF, qui vient de recevoir la croix d'officier de la Légion d'Honneur dans la promotion faite à l'occasion de la cérémonie des drapeaux, est le Bachagha des Djendels. Il est né sur le territoire de cette puissante tribu, d'une des grandes familles aristocratiques du pays, celle des Ouled-Hakredar. Sa naissance et son mérite personnel lui avaient acquis beaucoup d'empire sur les populations indigènes. Sa soumission date de 1842. Avant cette époque, nous avions trouvé en lui un adversaire redoutable. Depuis lors, nous n'avons eu qu'à nous louer de sa fidélité. C'est un homme plein d'activité et d'intelligence; ses immenses richesses et sa générosité lui ont créé une fort nombreuse clientèle
BOU-MEDIN est l'agha des Sbeah, l'une des tribus les plus guerrières et les plus remuantes de la province d'Alger. Pour la maintenir dans l'obéissance, il ne faut rien moins qu'un chef aussi capable et aussi ferme que Bou-Medin. Né parmi les douars du Sbeah, ayant une grande fortune et un esprit très-libéral, il sait à merveille suivre la politique mêlée d'énergie et de douceur nécessaire pour conduire ses populations arabes. Cet agha est justement renommé pour sa bravoure : il a montré en mainte occasion de véritables qualités militaires. C'est un des plus intrépides cavaliers dans ces contrées où tout homme libre vit à cheval.
SI-BEN-ÂLI-BEN-CHÉRIF est un marabout des Hiloula, l'une des confédérations kabyles de la province d'Alger.
Les Kabyles sont soumis à deux influences : celle des nobles et celle des prêtres ou marabouts. Ces derniers surtout, quand une naissance illustre vient ajouter au mérite d'une réputation de sainteté, ont une autorité presque sans bornes. Telle est la situation de Si-benAli-Chérif. Toutes les tribus de son commandement ont la plus grande vénération pour lui. Il est propriétaire d'une zaouia. On sait que dans la Kabylie les zaouïas sont des établissements semi-religieux, semi-séculiers, qui servent à la fois de couvents pour les marabouts, d'écoles pour les lettres, d'hôtellerie pour les voyageurs et pour les pèlerins, et d'hôpitaux pour les malades.
Chaque zaouïa est pour son propriétaire la source de revenus considérables. Si-ben-Ali-Chérif, qui est fort riche, dépense, la presque totalité de sa fortune en aumônes. Sa soumission est récente, mais il nous a été fort utile dans les dernières expéditions de la Kabylie.
Le voyage qu'il vient de faire en France, et qui a vivement impressionné son imagination, aura une grande influence sur l'esprit des montagnards lors de son retour en Algérie.
SI-KASSEM-OU-KASSY est le bachagha du Sebaou.
Nous avons souvent eu occasion d'entretenir nos lecteurs de ce chef, qui a joué un grand rôle dans les derniers événements de la Kabylie. Son commandement embrasse toute la vallée du Sebaou, c'est-à-dire la plus grande partie des versants sud du Djurdjura. Nul n'a lutté plus énergiquement contre les tentatives multipliées du faux chérif connu sous le nom de Bou-Bagherla ; nul n'a plus contribué à sa ruine. Parmi les tribus qu'il gouverne, se trouve celle des Flissa, dont la rébellion partielle, d'après les instigations de Bou-Bagherla, a motivé la dernière expédition du général Pélissier ; Si-Kassemou-Kassy sort d'une famille très-ancienne et très-influente de l'aristocratie militaire, laquelle, depuis longtemps, a exercé le commandement. C'est un homme très-actif et très-courageux, à qui nos autorités supérieures ont accordé la plus grande confiance.
SI-SLIMAN-BEN-SIAM est hakem de la ville de Milianah ; il est originaire d'une famille d'Alger, alliée à celle d'Omar-Pacha. C'est lui qui a engagé un grand nombre d'Habitants de Milianah à se soumettre à notre domination. Depuis lors, ses services ont été constants ajoutons qu'il a pris part à toutes les expéditions militaires qui se sont laites de ce côté.
A ces chefs s'est joint SI-TAHAR-OULD.-MAYDIN, qui commande au pays difficile et montagneux des BeniSliman. Si-Tahar est le frère du khalifa Si-Mohammed, dont nous avons annoncé récemment la mort prématurée et regrettable. Si-Tahar est issu d'une famille de marabouts qui a un grand ascendant sur l'est de la province d'Alger. Il est le propriétaire d'une école célèbre, qui fournit tous les tolbas (lettrés) du pays. Bien que très-religieux, Si-Tahar est un homme de progrès, qui aime nos institutions, et qui ne néglige rien pour les introduire parmi les siens. Il obéit à nos ordres avec une ponctualité et une docilité qui sont les traits distinctifs de son caractère.
La province d'Oran est représentée par cinq chefs arabes.
Parmi eux, on compte le neveu et le fils du général MUSTAPHA-BEN-ISMAEL, l'ennemi déclaré d'Abd-el-Kader, qui nous a si bien servis à la tête du fameux maghrzen d'Oran, et gui avait reçu des Arabes le surnom de Mustapha- la-Vérité, le plus beau titre, assurément, qui puisse être décerné â un indigène. Mustapha est mort sur-le-champ de bataille, à l'âge de plus de quatre-vingts ans. Sa famille devait être adoptée par la France.
SI-MOHAMMED-BEN-HADRI est l'agha en premier des Flittas. Il avait été successivement l'agha des Douairs du Tiaret, du Tessala et des Ouled-Sliman. La croix d'officier de la Légion d'Honneur vient de lui être accordée. Si-Mohammed-ben-Hadri est actuellement le chef de la famille des Behaitia, la plus influente et la plus accréditée parmi celles de ces contrées. C'est un homme de trente-cinq ans environ, d'une grande finesse d'esprit et d'une intelligence supérieure, qui, dans la paix et dans la guerre, nous a été fort utile. C’est le digne neveu du général Mustapha-Ben-Ismael.
MOHÀMMED-OULD-MUSTÀPHA-BEN-ISMAEL est le fils du général Mustapha et d'une négresse. C'est un jeune homme de vingt-trois ans dont on a remarqué la belle et expressive physionomie. Adopté par la France, il a grandi sous nos yeux. Nous aurons toujours en lui un serviteur fidèle.
ISMAEL-OULD-EL-HADJ-MEZARY, agha de la Yagoubia, est le fils de Mezary, qui, à la mort du général Mustapha, a eu l'honneur d'être appelé au commandement du maghrzen d'Oran. C'est un jeune Homme très-amoureux de luxe et de plaisirs, qui goûte volontiers les délices de notre civilisation, et qui s'est toujours montré dévoué â notre cause. C'est un de ceux qui attirent le plus les regards par la fierté de sa prestance et par l'éclat de son costume.
SI-MOHAMMED-BEN-DAOUD, agha des Douairs, peut être placé à la tête de cette génération de Musulmans qui apprécient la justice et la loyauté de notre administration. Il en est de même de Mohammed-ben-Mokhtar, agha des SmeIas. Occupant un poste difficile, BenMokhtar a toujours fait courage déterminé, et, il a été plusieurs fois blessé en défendant notre drapeau.
Sept chefs arabes ont été envoyés par la province de Constantine
SI-ALY-BEN-AHMED, khalifa des Haractas, s'est rangé à notre domination presque aussitôt après la prise de Constantine. Il a suivi à la tête de son goum les colonnes expéditionnaires qui ont amené la soumission des tribus indigènes. Ses services lui ont valu le cordon de commandeur de la Légion d'Honneur. Ce khalifa est accompagné de son fils, Si-Mohammed-el-Arbi, âgé de douze ans, qui est déjà un excellent cavalier, et qui annonce beaucoup de vivacité et d'intelligence.
SI-MOKTAR-BEN-DEKRA, caïd des Ouled-SeIlem et des Ouled-Derradj, est le fils d'un marabout très-influent.
Sa soumission remonte au commandement du général Négrier. Réunissant, comme presque tous les marabouts, le caractère religieux au mérite militaire, il s'est signalé comme chef de goum. II a contribué à la soumission des Ouled-Soulthan, et, en 1846, au fort d'une insurrection, il a su maintenir dans l'obéissance les tribus qu'il gouverne.
Si-BEN-HENNI-BEN-BOUDHEAF, caïd des Zulmas, a beaucoup d'autorité sur les tribus sahariennes des OuledMadhy et des Ouled-Naïls. Il avait été nommé par Abdel-Kader agha du Hodna; mais il ne tarda pas à abandonner le parti de l'émir pour embrasser le nôtre, et il est venu faire sa soumission entre les mains du général Négrier. Depuis lors, nous n'avons eu qu'à nous louer de son énergie et de son dévouement.
SI-LAKDAR-BEN-MOKRANI, caïd des Beni-Abbès, descend d'une famille illustre qui a longtemps habité le Maroc et qui offre cette particularité curieuse qu'elle se vante d'une origine commune avec la maison française des Montmorency. D'après les traditions, un des Montmorency aurait embrassé l'islamisme et aurait été admis au titre de chérif (parent du prophète). Les Mokrani portent une croix dans leurs armes. Quoi qu'il en soit, cette famille s'est fixée depuis longtemps dans la Medjanah, et elle commandait dans le pays sous les beys de Constantine. Le maréchal Valée avait reçu la soumission du père de Si-Lakdar, qu'il avait nommé khalifa de la Medjanah. Si-Lakdar, qui est le type de la race chevaleresque de la frontière saharienne, est fort honoré parmi les tribus de la subdivision de Sétif.
SI-MÀGOURA-BEN-ACHOUR est le neveu du célèbre Bou-Akkas, cheikh du Ferdjouiah et caïd du Babour. BouAkkas qui commande à douze tribus importantes, nous a été fort utile lors de l'expédition de la petite Kabylie, et son nom a figuré souvent dans les récits de cette campagne. La soumission de cette famille, qui est l'une des premières de la noblesse militaire de la Kabylie, date de 1838. Si-Magoura exerce les fonctions de caïd du Telegma ; un autre membre de la famille de BouAkkas est venu en France avec lui. C'est un autre neveu du cheik du Ferdjouiah, Si-Ahmed-Krodja-ben-Achour, qui prend une part active à l'administration de son oncle.
SI-ISMAÏL-BEN-MSERLY-ALY est le fils d'un chef qui nous a rendu les plus signalés services. Si-Smail a été nommé, en 1850, caïd des Ouled-Abd-el-Nours.
Tel est le passé des chefs arabes qui viennent visiter la France, et qui, après avoir vu la richesse de nos villes, la beauté de nos campagnes, le nombre et la discipline de nos soldats, iront redire en Algérie la force et la grandeur de la France. La cérémonie à laquelle ils ont assisté à dû surtout les frapper vivement. Ils n'avaient aucune idée d'un tel déploiement de forces. Bien que notre armée en Algérie ait présenté un effectif très considérable, la dissémination de nos troupes n'a guère permis de montrer sur un point plus de 40,000 hommes.
La fête de la distribution des aigles, en faisant voir aux délégués des trois provinces une armée de 60,000 soldats, une cavalerie si brillante, une si formidable artillerie, leur fournira plus d'un argument quand, à leur retour dans leurs foyers, des brouillons ou des fanatiques leur demanderont s'il faut obéir à notre autorité et reconnaître la suprématie de notre civilisation.
HENRY CAUVAIN.
| |
VICTOR PROUVE
Pieds-Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°203, janvier 2012
|
|
Fer de lance de l’Art nouveau en France
Victor Prouvé, né le 13 août 1858 à Nancy - mort le 15 février 1943 à Sétif (Algérie) est un peintre, portraitiste, paysagiste, sculpteur et graveur français. Il appartient au mouvement de I'Art Nouveau.
Fils d'un dessinateur en faïence qui travaillait pour la fabrique dirigée par le père d'Emile Gallé, Victor Prouvé naît à Nancy en 1858.
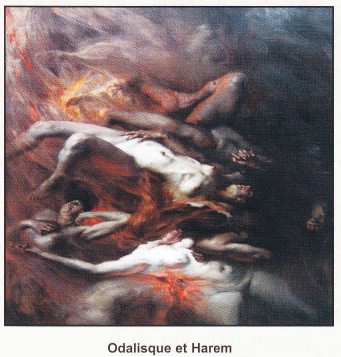 Très tôt il manifeste un goût et des dons pour le dessin. Elève à Nancy de Devilly il monte ensuite à Paris pour suivre le cours de I'Ecole Nationale des Beaux-Arts. Au Louvre il connaît ses véritables chocs esthétiques : Véronèse, Michel Ange et autres grands maîtres le conduisent sans transition à se passionner pour des contemporains tels que Manet, Renoir ou Degas. Très tôt il manifeste un goût et des dons pour le dessin. Elève à Nancy de Devilly il monte ensuite à Paris pour suivre le cours de I'Ecole Nationale des Beaux-Arts. Au Louvre il connaît ses véritables chocs esthétiques : Véronèse, Michel Ange et autres grands maîtres le conduisent sans transition à se passionner pour des contemporains tels que Manet, Renoir ou Degas.
Entré chez Cabanel il perfectionne sa technique, mais la fréquentation de Puvis de Chavanne.. le marque tout autrement.
A 24 ans il fait enfin ses débuts au Salon avec son envoi du portrait de Mme Gallé et ses filles. Suit une série de portraits (Mysette Wiéner, le violoniste Louis Hekking) que la critique salue. En 1888 sa découverte de la Tunisie, dont la lumière et la couleur le captivent littéralement," redéfinit son art qui gagne en puissance. La maîtrise n'est pas loin. De retour à Paris il travaille inlassablement à des panneaux décoratifs comme le Cercle des Voluptueux d'après I'Enfer du Dante.
C'est à cette époque qu'il retrouve Emile Gallé, de douze ans son aîné, avec lequel il a été le plus jeune lorsque son père travaillait pour la faïencerie de Saint Clément. Gallé lui commande des projets de tables ou de vases (Orphée implorant I'ombre d'Eurydice, etc...), Majorelle suit. C'est une période riche et passionnante où Prouvé apporte sa contribution à ce qu'on appellera plus tard Modem style et Art Nouveau. La fin du siècle, le début du nouveau voient les commandes officielles récompenser son travail : médaillons pour le grand salon de I'Hôtel de Ville de Nancy, décoration de l'escalier de la mairie d'Issy-les-Moulineaux, plafond de la préfecture de Meurthe-et-Moselle et, surtout, I'exceptionnelle décoration pour la salle des fêtes de la mairie du XIème, à Paris.
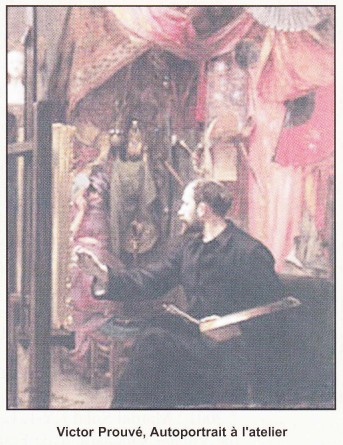

L'artiste a trouvé ses marques. A I'heure de la mort de Puvis de Chavannes la critique salue un nouveau symboliste. C'est le triomphe des mairies et des expositions universelles, la IIIe République connaît ses plus belles années et Prouvé prend le temps de voyager. La Bretagne à laquelle il restera toujours attaché, au Gers où réside sa belle-famille, le pays Basque sont I'occasion de nouvelles sources d'inspiration. Choses vues et croquées avec brio telles ces scènes de corrida ou encore ces ramasseuses de varech sur une plage bretonne. Infatigable, curieux de tout, il s'adonne à la gravure et manie le berceau avec dextérité pour laisser quelques belles manières noires (portrait de Charles Sadoul, Marie Prouvé à sa fenêtre...).
Sculpteur (la Lorraine reconnaissante au président Carnot), admirable relieur, ciseleur, orfèvre, il n’y a rien que les mains de Prouvé ne sachent travailler, modeler, ciseler. A l'origine de la fondation de l’Ecole de Nancy aux côtés d'Emile Gallé il en prend naturellement la tête à la mort de ce dernier, en 1904, après être définitivement "rentré" à Nancy.
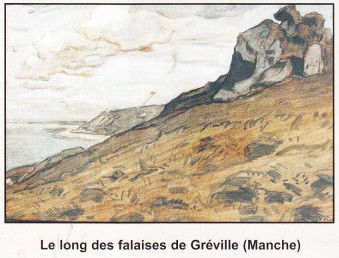 Ces années de la maturité sont aussi celles du questionnement, parfois de I'abattement ou de la résignation quand il accepte, pour des raisons matérielles mais peut-être au détriment de son œuvre, la direction de I'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy, pourtant sa fécondité ne tarit pas et il sait être tout à son art malgré des phases de dépression aggravées par I'arrivée d'une nouvelle guerre. Ces années de la maturité sont aussi celles du questionnement, parfois de I'abattement ou de la résignation quand il accepte, pour des raisons matérielles mais peut-être au détriment de son œuvre, la direction de I'Ecole Nationale des Beaux-Arts de Nancy, pourtant sa fécondité ne tarit pas et il sait être tout à son art malgré des phases de dépression aggravées par I'arrivée d'une nouvelle guerre.
Lorsque éclatera la seconde guerre mondiale, cet humaniste socialisant et patriote qu’est Victor Prouvé n’aura pas sa place dans l'hexagone occupé. Il partira en Algérie rejoindre sa fille dans ce Maghreb qui avait illuminé sa palette à la fin des années 1880 et moura à Sétif le 13 février 1943.
| |
| LES MONTECAOS A LA CONSTANTINOISE
par Jacques GATT
|
|
ACEP-ENSEMBLE N° 296- juillet 2015
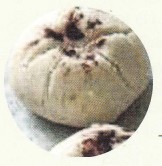
INGREDIENTS
- 1kg de sucre glace tamisé
- 1kg de beurre frais
- 500g de farine ou plus
PREPARATION
Commencer par faire fondre le beurre à feu doux et flltrer toutes les impuretés. Puis, très important, il doit être mis au frais pendant toute une nuit afin qu'il durcisse.
Le lendemain, le travailler sur un grand plateau en y incorporant petit à petit le sucre. Remuer le tout une trentaine de minutes pour obtenir une pâte légère d'un volume double.
Après cela, ajouter la farine tamisée jusqu'à alfermissement de votre pâte.
Ensuite former des boulettes ayant la forme de petites pyramides, bâtonnets, en couronnes ou encore les pousser à la poche à douille.
Faire cuire sur une plaque non beurrée à four doux, ces délicieux gâteaux seront cuits lorsqu'ils auront pris une belle couleur,
|
|
|
QUAND LA PATRIE
EST TRAHIE PAR LA REPUBLIQUE
Par Jean Raspail
ACEP-ENSEMBLE N° 298- décembre 2015
|
|
J'ai tourné autour de ce thème comme un maître-chien mis en présence d'un colis piégé. Difficile de l'aborder de front sans qu'il vous explose à la figure.
Il y a péril de mort civile. C'est pourtant I'interrogation capitale. J'ai hésité.
D'autant plus qu'en 1973, en publiant « Le Camp des saints », j'ai déjà à peu près tout dit là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que je crois que les carottes sont cuites.
Car je suis persuadé que notre destin de Français est scellé, parce qu'« ils sont chez eux chez moi » (Mitterrand), au sein d'une « Europe dont les racines sont autant musulmanes que chrétiennes » (Chirac), parce que la situation est irréversible jusqu'au basculement définitif des années 2050 qui verra les « Français de souche » se compter seulement la moitié - la plus âgée - de la population du pays, le reste étant composé d'Africains, Maghrébins ou Noirs et d'Asiatiques de toutes provenances issus du réservoir inépuisable du tiers monde, avec forte dominante de l’islam, djihadistes et fondamentalistes compris, cette danse-là ne faisant que commencer.
TOUTE L'EUROPE
MARCHE À LA MORT
La France n'est pas seule concernée. Toute l'Europe marche à sa mort.
Les avertissements ne manquent pas - rapport de l'ONU (qui s'en réjouit), travaux incontournables de Jean-Claude Chesnais et Jacques Dupâquier, notamment -, mais ils sont systématiquement occultés et l'lned pousse à la désinformation.
Le silence quasi sépulcral des médias, des gouvernements et des institutions communautaires sur le krach démographique de l'Europe des Quinze est I'un des phénomènes les plus sidérants de notre époque.
Quand il y a une naissance dans ma famille ou chez mes amis, je ne puis regarder ce bébé de chez nous sans songer à ce qui se prépare pour lui dans l’incurie des « gouvernances » et qu'il lui faudra affronter dans son âge d'homme.
Sans compter que les «Français de souche », matraqués par le tam-tam lancinant des droits de l'homme, de « l'accueil à l'autre », du « partage » cher à nos évêques, etc., encadrés par tout un arsenal répressif de lois dites « antiracistes », conditionnés dès la petite enfance au «métissage » culturel et comportemental, aux impératifs de la «France plurielle » et à toutes les dérives de l'antique charité chrétienne, n'auront plus d'autre ressource que de baisser les bras et de se fondre sans moufter dans le nouveau moule « citoyen » du Français de 2050.
LA PREMIÈNE
HYPOTHÈSE : LES ISOLATS RESISTANTS
Ne désespérons tout de même pas.
Assurément, il subsistera ce qu'on appelle en ethnologie des isolats, de puissantes minorités, peut-être une quinzaine de millions de Français - et pas nécessairement tous de race blanche - qui parleront encore notre langue dans son intégrité à peu près sauvée et s'obstineront à rester imprégnés de notre culture et de notre histoire telles qu'elles nous ont été transmises de génération en génération.
Cela ne leur sera pas facile. Face aux différentes « communautés » qu'on voit se former dès aujourd'hui sur les ruines de l’intégration (ou plutôt sur son inversion progressive : c'est nous qu'on intègre à « I'autre », à présent, et plus le contraire) et qui en 2050 seront définitivement et sans doute institutionnellement installées, il s'agira en quelque sorte - je cherche un terme approprié d'une communauté de la pérennité française.
Celle-ci s'appuiera sur ses familles, sa natalité, son endogamie de survie, ses écoles, ses réseaux parallèles de solidarité, peut-être même ses zones géographiques, ses portions de territoire, ses quartiers, voire ses places de sûreté et, pourquoi pas, sa loi chrétienne, et catholique avec un peu de chance si ce ciment-là tient encore.
Cela ne plaira pas. Le clash surviendra un moment ou l'autre.
Quelque chose comme l'élimination des koulaks par des moyens légaux appropriés.
Et ensuite ? Ensuite la France ne sera plus peuplée, toutes origines confondues, que par des bernard-l'ermite qui vivront dans des coquilles abandonnées par les représentants d'une espèce à jamais disparue qui s'appelait l'espèce française et n'annonçait en rien, par on ne sait quelle métamorphose génétique, celle qui dans la seconde moitié de ce siècle se sera affublée de ce nom.
Ce processus est déjà amorcé.
LA SECONDE HYPOTHÈSE:
LA « RECONQUISTA »
Il existe une seconde hypothèse que je ne saurais formuler autrement qu'en privé et qui nécessiterait auparavant que je consultasse mon avocat, c'est que les derniers isolats résistent jusqu'à s'engager dans une sorte de « Reconquista » (lire «De la Reconquête Française» - de Marc Noé) sans doute différente de l'espagnole mais s'inspirant des mêmes mots.
Il y aurait un roman périlleux à écrire là-dessus. Ce n’est pas moi qui m'en chargerai, j'ai déjà donné.
Son auteur n'est probablement pas encore né, mais ce livre verra le jour à point nommé, j'en suis sûr.
Ce que je ne parviens pas à comprendre et qui me plonge dans un abîme de perplexité navrée, c'est pourquoi et comment tant de Français avertis et tant d'hommes politiques français concourent sciemment, méthodiquement, je n'ose dire cyniquement, à l’immolation d'une certaine France (évitons le qualificatif d'«éternelle» qui révulse les belles consciences) sur l'autel de l’humanisme utopique exacerbé.
Je me pose la même question à propos de toutes ces associations omniprésentes de droits à ceci, de droits à cela, et toutes ces ligues, ces sociétés de pensée, ces officines subventionnées, ces réseaux de manipulateurs infiltrés dans tous les rouages de l'État (éducation, magistrature, partis politiques, syndicats, etc.), ces pétitionnaires innombrables, ces médias correctement consensuels et tous ces intelligents " qui jour après jour et impunément inoculent leur substance anesthésiante dans l'organisme encore sain de la nation française.
LES RENÉGATS DE LA FRANCE
Même si je peux, à la limite, les créditer d'une part de sincérité, il m’arrive d'avoir de la peine à admettre que ce sont mes compatriotes.
Je sens poindre le mot « renégat », mais il y a une autre explication : ils confondent la France avec la République.
Les « valeurs républicaines » se déclinent à l’infini, on le sait jusqu’à la satiété, mais sans jamais de référence à la France.
Or la France est d'abord une patrie charnelle.
En revanche, la république, qui n'est qu’une forme de gouvernement, est synonyme pour eux d'idéologie, idéologie avec un grand « I », I'idéologie majeure.
II me semble en quelque sorte qu'ils trahissent la première pour la seconde.
Parmi le flot de références que j‘accumule en épais dossiers à l’appui de ce bilan. en voici une qui sous dés dehors bon enfant éclaire bien l'étendue des dégâts.
Elle est extraite d'un discours de Laurent Fabius au congrès socialiste de Dijon.
Le 17 mai 2003 : " Quand la Marianne de nos mairies prendra le beau visage d'une jeune Française issue de l’immigration, ce jour-là la France aura franchi un pas en faisant vivre pleinement les valeurs de la République.»
Puisque nous en sommes aux citations, en voici deux, pour conclure.. Aucun nombre de bombes atomiques ne pourra endiguer le raz de marée constitué par les millions d'êtres humains qui partiront un jour de la partie méridionale et pauvre du monde, pour faire irruption dans les espaces relativement ouverts du riche hémisphère septentrional, en quête de survie. » (Président Boumediene, mars 1974.) Et celle-là, tirée du XXe chant de l'Apocalypse : Le temps des mille ans s'achève.
Voilà que sortent les nations qui sont aux quatre coins de la terre et qui égalent en nombre le sable de la mer
Elles partiront en expédition sur la surface de la terre, elles investiront le camp des saints et la ville bien aimée.
Jean Raspail
Ecrivain auteur du Camp des Saints
| |
Comment ça va ?
par M. Robert Charles PUIG.
|
La manipulation élyséenne, vous connaissez ? Personnellement, j'en suis mort de rire, en constatant combien nous avions quelques temps tiré la langue en attendant TOUT de ce remaniement et ce changement de gouvernance en commençant par un premier ministre pour finalement n'aboutir à rien. Une propagande digne d'un temps nazi ou stalinien, pour nous tenir en halène, nous faire espérer en un vrai renouveau et aboutir à une équipe où les têtes mal-pensantes ne changent pas, sauf ce nouveau joker issu des Républicains, Rachida Dati. Fallait il l'exclure des LR ? Non, juste la mettre en "sommeil" car elle reste de la droite molle et sarkosiste avec ses défauts, même si c'est une prise de guerre de Macron qui trahit son camp et fait l'évènement "people" de ce nouveau - mais pourquoi dire "nouveau" ? - gouvernement.
Bien entendu, il y a dans la marre où se mire Macron, comme Narcisse en son temps, un autre visage qui apparait, son double - Gabriel Attal - Il sait s'exprimer et enrober ses propos de la façon la plus soft pour amadouer le chaland et lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Un beau parleur... Une belle personne ?
Aussitôt nommé, le voilà aux pas de course sur le terrain détrempé du Nord. Rien ne l'arrête et il a le pouvoir, comme Moïse, d'assécher le sol de Calais... de ses mots. C'est du "Tout va très bien madame la Marquise", et demain vous aurez les pieds au sec... Toujours bien dans ses pompes, il aborde un autre sujet sans rire, l'éducation nationale. Une institution qui croyait avoir un chef et en aura deux pour le prix d'un, même si pour les enseignants un doute sur le futur subsiste. L'abaya sera-t-elle toujours interdite ? L'école soutenue dans sa transformation annoncée trop vite, avant que le magicien de l'Elysée change son ministre de l'éducation nationale en "autre chose", aura-t-elle sa mutation ? Des questions sans réponses.
Encore et toujours le meilleur ! Voilà que Gabriel Attal court au chevet de la police qu'il salue en prenant la lumière, laissant Darmanin dans l'ombre. Il est quasiment éteint celui qui voyait les anglais comme des terroristes.
Toujours le mot pour plaire, le nouveau premier ministre. Lorsqu'il parle au peuple des quartiers, des cités, il fait rêver. Il annonce du vin, du pain et des voitures électriques et flute et re flute, en joueur de pipeau socialiste s'il n'y a pas assez de bornes électrique - l'autre est partie - on fera avec. L'élyséen n'a-t-il pas prôné la marche à pied pendant 30 minutes ?
A l'hôpital, il va redonner la vue aux aveugles, faire marcher les paralytiques et c'est sûr qu'il nous en bouche un coin avec ses engagements en monnaie de singe. Non seulement demain des policiers en plus mais aussi des infirmiers et des médecins avec des investissements... à perte de vue, dépassant le temps de Macron à son poste. ! Finalement juste élu, déjà il a bouclé son programme. C'est la Cène, cette mise en scène ! C'est Jésus et ses miracles. C'est plus que la "Renaissance" ou le Christ après la Croix ! Est-ce un changement de cap ou juste un jeu d'ombres chinoises pour amuser la galerie, face à ses apôtres dont il a légèrement augmenté le nombre en attendant de le multiplier dans les jours à venir ? C'est la résurrection et une nouvelle révolution après sept ans d'apathie, de catalepsie. J'ai des doutes !
Bien entendu nous devons nous incliner. J'en suis mort de rire. Pourtant avant que le couvercle sur mon cercueil m'interdise d'aller manger des pissenlits par la racine, soudain j'ai décidé de ne pas mourir. En partie submergé par des discours si argumentés, rythmés, balisés par le Grand Maître de l'Élysée, il me vient tout à coup à l'esprit qu'il manque quelque chose. Il manque des "choses" dans ses discours. Par exemple il veut - ordre de son chef - que l'on se souvienne de la révolution, de la Shoah, du Vel d'hiv, mais pourquoi pas évoquer les événements de la guerre d'Algérie ? Tant de jeunes métropolitains ont participé pour rien à ces combats. Il y a ceux qui sont revenus, mais il y a eu des blessés, des morts et cela a duré huit ans ! Faut-il passer ces militaires et aussi des civils à pertes et profits, sans leur histoire ? Une fois de plus il ne faut pas mécontenter Abdel Tebboune à Alger... et socialiste depuis de nombreuses années, Attal sait, avec Hollande et Macron, qu'il faut contre vents et marais préserver les privilèges et les exigences que ce pays a sur nous. C'est ça le progressisme, le macronisme et notre honte de patriotes.
Je contestais tout à coup un jeu hypocrite et je sentais le désarroi de mon ange gardien. Il me suppliait d'arrêter de me moquer de la macronie. "Tu dois, me disait il, faire pénitence et t'excuser de te moquer de ce nouveau premier ministre... Oui, je te comprends - ajouta mon ange - enfin un qui a un homme, mais reconnais qu'il parle bien. Des propos nets et sans bavure. Il annonce en deux mots beaucoup de choses et elles sont toutes agréables à entendre. En fait, il est meilleur qu'Hollande, spécialiste des promesses non tenues et même de Macron qui sait agiter devant un public étonné son théâtre de marionnettes qui ne bougent que lorsqu'il lève un doigt pour désigner qui danse, mais qui a tout faux".
Tandis que les croque-morts s'approchaient pour définitivement visser les planches de mon couvercle en pur chêne, je réalisais que vraiment je ne pouvais pas "partir". Qui allait évoquer la vraie histoire de France, dénoncer les contrevérités, défendre l'honneur de ce pays face à l'immigration sauvage et servir de garde-fou à une loi que des institutions vont vouloir modifier, effacer ? Qui allait évoquer le besoin d'un drapeau fort et respecté, d'alliances qui ne soient pas la soumission, la capitulation, l'asservissement ? Qui allait s'élever contre cet envahissement du Sud et ce pourrissement de nos vieilles lois pour installer un nouvel ordre et la charia ?
Des mains et des pieds, évidemment pieds-noirs, j'ai fait sauter telle une "strounga", le couvercle de mon habitat. Ce n'était pas encore mon heure... Peut-être demain, mais j'avais encore trop de choses à dire ou à écrire à tous mes amis. Robert.
Robert Charles Puig / janvier 2024
| |
Infamie institutionnalisée !
Envoyé Par M. A. Algudo
|
Discours prononcé par Alain ALGUDO Président CDFA/UCDARA lors du Congrès de VERITAS à VALRAS le 22 Juin 2013
Dire qu’un assassin est un assassin, et un traître, un traître, et que tous les faits avérés et les documents sont en place pour le prouver, dire ces vérités est devenu aujourd’hui un crime de lèse-majesté justiciable.
Quand une infâme propagande crucifie un peuple de pionniers et de bâtisseurs, en l’assimilant aux pires des exploiteurs, et que cette désinformation perdure de nos jours, asséner ces mensonges sortis du caniveau est devenu aujourd’hui le sport principal d’une fange de « journaleux » à mémoire sélective. Alors ces comportements nauséeux ne sont-ils pas de l’infamie ?
Quand après le sinistre 19 mars 1962, toutes les preuves des exactions de masse contre les populations laissées à l’abandon étaient entre les mains des autorités de l’époque et que celles-ci les ignoraient sciemment, n’était-ce pas de l’infamie ?
Ne faut-il donc pas considérer que nous sommes depuis notre exode, les victimes d’une escroquerie mémorielle politico-médiatique en bandes organisées ?
Alors il ne faut pas s’étonner si une population qui subit plus d’un demi-siècle… le mépris et le mensonge, il ne faut pas s’étonner si cette population écœurée, désabusée, voire découragée se réfugie dans le communautarisme et joue avec son bulletin de vote d’une manière qui surprend encore ces nervis des pouvoirs de la forfaiture.
Cependant, Il est du devoir de chacun d’entre nous de « gueuler » son exaspération et si je le fais encore brièvement aujourd’hui, c’est en pensant à ceux des nôtres encore de ce monde qui, dans la douleur de la perte cruelle de leurs disparus, assistent à ce déploiement journalier de compassion pour les otages Français actuels ( aujourd'hui libérés... ou plutôt « achetés »), compassion que nous jugeons légitime, mais qui nous rappelle ce rejet total du malheur que nous subissions et de cet acharnement à faire disparaître des mémoires le crime de haute trahison dont nous avons été les victimes.
« Souffrir » était notre destin puisqu’un Général que nous avions sorti de sa retraite pour notre grand malheur, devenu alors chef d’Etat de l’époque, nous le souhaitait ouvertement en plein exode, et ce dans l’indifférence générale. Une indifférence qui perdure de nos jours où tous les moyens sont bons, même les plus honteux, pour justifier un abandon aux conséquences sanglantes occultées par certains médias qui ne font pas ainsi honneur au si dangereux, si beau, et si important métier de journaliste.
Nous ne sommes pas ici pour généraliser mais ceux dont la mémoire et les sources d’informations sont sciemment orientées se reconnaîtront. Une anecdote récente : avec M. NEGRI Président du Cercle Algérianiste de Béziers, nous avions participé avec mon Association et Veritas à une collecte pour faire passer un article (payant) contre la honte nationale officialisée du 19 mars : Le grand quotidien départemental nous a refusé cet article pour non-conformité à son éthique ! Et on nous parle de liberté d’expression ?
Mais les professionnels de l’honneur, et ceux de nos compatriotes de métropole qui se sont penchés sur notre drame et nous comprennent, nous soutiennent aujourd’hui encore, soient ici remerciés, car dans l’hostilité d’une grande majorité, shootée à la désinformation, leur soutien n’en a eu, et n’en a encore, que plus de valeur.
J’ai eu l’honneur de mener un long combat, parfois musclé, au service de mes compatriotes dans divers domaines et je ne regrette rien, même si ce fut souvent au détriment de ma vie de famille et professionnelle. Alors je peux évoquer savamment l’ostracisme avec lequel tous nos problèmes ont été traités, et mon propos aujourd’hui n’abordera pas les questions matérielles… mais je vous affirme cependant que les lois existaient, la volonté du parlement existait aussi, mais l’interprétation des textes était toujours dévoyée par une voyoucratie administrative aux ordres qui les interprétait et les interprète encore toujours au détriment de nos compatriotes en difficultés économiques et financières. Les problèmes actuels planant sur les toits familiaux en sont une illustration, et bien des fois j’ai eu l’impression d’être devant un véritable tribunal en défendant à la Mission Interministérielle aux Rapatriés des compatriotes au bord d’une seconde spoliation d’Etat !
Non, mon propos aujourd’hui est là pour dénoncer une fois pour toute, puisque le sujet est d’actualité, cette infamie mortelle du mépris pour nos otages à l’époque, aujourd’hui disparus….comment ? Volontairement effacés des mémoires, je le répète car l’infamie est là aussi patente, effacés de la mémoire collective et de celle de tous ces Présidents de la République qui se sont succédé sans qu’aucune commission d’enquête officielle ne soit diligentée, ni pour le 26 mars à Alger, ni pour le 5 juillet à ORAN, ni même après l’aveu, le 26 janvier 1971, d’un certain chacal nommé Houari BOUMEDIENNE alors Président de la « Ripoublique Algérienne » …. qui déclarait dans le quotidien « L’Eclair » détenir des otages, alors qu’il y avait un ambassadeur de France à Alger, sans que M. G. POMPIDOU Président Français de l’époque jouant les PONCE PILATE NE BOUGE, LE PETIT DOIGT….., sans que la presse et les télés dans leur ensemble ne soient agitées comme aujourd’hui, pour la libération de nos compatriotes civils aux mains de ceux qui ne sont, ni plus ni moins, que les clones de ceux qu’à tour de rôle, nos édiles politiciens de tous poils vont donner l’accolade dans ce pays.
Ce pays qui, n’en déplaise à ces caricatures de représentants d’Etat, restera toujours notre fierté, notre bijou dans son écrin aujourd’hui aux mains des maîtres assassins de l’époque, dont ce fossile hospitalisé chez « l’affreux colonisateur, » mais restant toujours aussi haineux. Quant à leurs complices…copains coquins… qui les accueillent, à nos frais, ils ne valent pas plus cher qu’eux, ces héritiers complices qui ne savent pas dire NON, au nom de l’honneur. Non, au contraire, ils se succèdent sous nos yeux et notre rage au cœur, à droite comme à gauche, même politique de la honte et de la repentance, et ce indifférents au sang et aux larmes versées à cause de comportements ou la duplicité génère l’infamie, sous les applaudissements des reliquats nauséabonds des porteurs de valises qui paradent encore aujourd’hui, eux sous les vivats de ces « combattants Fnacaïstes » dont le cri de guerre était pour beaucoup d’entre eux: « La quille bordel ! »
« Il faut tourner la page » nous dit-on et, hélas, parfois cette réflexion vient des nôtres ! Alors je réponds à tous en leur demandant s’ils connaissent le sens du mot dignité… je leur réponds s’ils ont connu la douleur de perdre un être cher et la douleur que cela procure dans des conditions de disparition liées au déroulement de la vie. Certainement ! Alors, pensent-ils à cette douleur, quand elle est exacerbée par l’incertitude du sort d’une mère, d’un père, d’un époux, d’une épouse, d’une fille, d’un fils, d’un proche disparu ? Cette douleur doit être atroce, et à mon avis ceux qui veulent « tourner la page » sont aussi capables de la déchirer aussi facilement et entrent pour moi dans le cercle de ceux dont le cœur est fait de pierre.
Nous devrions donc tourner les pages de notre drame….de notre histoire…. voire les déchirer, mais surtout bien conserver celles de la Shoah… de la rafle du Vel d’hiv… d’Oradour sur glane et de toutes les misères du monde !!!
Avec notre association et VERITAS nous menons un combat désintéressé pour la justice et la vérité et nous ne pourrons continuer à le mener dans ces conditions que si chacun d’entre vous comprend que nous ne pouvons rien seuls, refusant toutes subventions, toutes publicités, évitant ainsi toute compromission, et la page réservée à la future chaîne de télévision « notre antenne » où nous pourrons nous exprimer, est attribuée gratuitement. Alors vous êtes notre seul moyen de continuer à faire exploser la vérité au visage de cet aréopage qui non seulement nous ignore pour la plupart, mais continue à nous mentir de la plus sordide des manières, à quelques exceptions près qui n’en ont que plus de valeur.
Mais que les hypocrites sachent que les larmes de crocodiles qu’ils versent sur notre histoire tragique au moment des élections, qu’ils sachent qu’ils ne trompent plus ceux des nôtres qui nous aident à mener ce combat, et pour certains d’entre nous, certainement l’ultime, pour des vies brisées par des hommes démoniaques. Mais qu’ils sachent aussi que nous resterons toujours fiers de l’avoir mené au service de nos compatriotes expatriés.
Mais je pense que tout ce que je viens d’exposer, est encore un plaidoyer à l’attention de convaincus de longue date, mais le fait de les asséner régulièrement, de les répéter ces vérités, cela finira bien un jour par mettre au grand jour ces infamies prouvées qui sont devenues, au fil des ans, une institution. Mais aujourd’hui, face à un danger mortel de changement de société, les œillères et les bandeaux des égoïstes doivent tomber !!!
Je dédie cet exposé à « Myrtille » la petite Oranaise, encore de ce monde, qui a perdu le 5 juillet 1962 à ORAN, 14 membres de sa famille, ainsi qu’ à mon épouse Monique, décédée le 6 mars dernier qui, avec son Amour, sa patience et sa compréhension, m’a permis de mener ce combat que j’espère continuer, pour vous, mes compatriotes.
Merci mes Amis d’avoir écouté encore un de mes cris du cœur.
NDRL : les documents numérotés que j’ai montrés à l’assistance sont des preuves irréfutables en ma possession sur les évènements que j’ai cité.
|
|
Les vœux 2024
Par M. Jacques Guillemain.
Envoyé par M. J.P. Ferrer
|
|
De notre président.....rigolo !
Mes chers compatriotes,
Pour la septième fois, j’ai la joie de partager avec vous ce moment privilégié des vœux de fin d’année. J’en suis très heureux car mon bilan, c’est avant tout le vôtre. Sans votre soutien indéfectible rien ne serait possible.
Or, comme vous le savez, j’ai été missionné en 2017 pour détruire la France. Souvenez-vous du coup d’État politico-médiatique qui a torpillé Fillon. Fait unique dans les annales de la Ve République !
Et j’avoue que grâce à votre adhésion totale à ma politique de démolition, puisque vous m’avez réélu haut la main en 2022, les résultats dépassent toutes mes espérances : notre France millénaire est en train de disparaître et plus aucun service public ne fonctionne. À vrai dire, il n’y a plus d’État et c’est très bien ainsi.
Dans tous les domaines nous détenons le bonnet d’âne de l’OCDE. Soyez-en remerciés. Je n’ai jamais vu une nation aussi riche et aussi prospère il y a trente ans s’effondrer de la sorte en quelques années, sans la moindre réaction populaire. C’est bien le signe que la mondialisation heureuse, vous y croyez.
Les Gilets Jaunes ? Une bande de poivrots illuminés qui croyaient encore au drapeau et à la Marseillaise. Mais tout cela est terminé. Nous allons bâtir le grand village mondial de demain, sans frontières, sans nations, faisant de vous les citoyens du monde, au même titre que les Papous, les Jivaros ou les Esquimaux.
À vrai dire, je me fichais totalement de ce mouvement sans leader ni organisation, jusqu’au jour où ils ont voulu me déloger de mon bunker élyséen. J’ai dû mettre 600 policiers et gendarmes autour du Palais pour être en sécurité. Mais revenons à notre bilan commun.
J’ai liquidé le corps des diplomates car une nation appelée à disparaître n’a nul besoin d’une diplomatie propre. C’est ainsi que la France n’a plus aucun pays ami et j’en suis ravi.
Au Liban, j’ai copiné avec le Hezbollah et ce fut un désastre diplomatique.
En Ukraine, je me suis mis à dos Poutine en pratiquant un double jeu qu’il n’a pas apprécié. Tout en lui parlant de paix, j’ai envoyé en même temps nos canons Caesar à Zelensky pour canarder les Russes.
À Gaza, en usant d’une argumentation la plus alambiquée possible, j’ai réussi à mécontenter à la fois les Israéliens et les Palestiniens. C’est cela le secret du “en même temps”. Je sais bien que je dis tout et son contraire, mais c’est intentionnel. Plus personne n’accorde de crédit à la parole de la France.
N’oublions pas les Anglo-Saxons. À vrai dire, depuis Azincourt, on ne peut pas dire que la situation ait beaucoup évolué. Les Anglais viennent encore de nous poignarder dans le dos en torpillant le contrat des sous-marins australiens. Voilà mille ans que ça dure…
J’ai également mis fin à la Françafrique. Nous sommes chassés de partout. Cela dit, la jeunesse africaine est la bienvenue pour pallier la baisse de natalité de notre pays. Nous avons besoin de consommateurs pour satisfaire le patronat. Rien n’est pire qu’une population qui diminue. Vu que nous n’avons plus rien à exporter, seule la consommation de masse fait tourner l’économie.
D’ailleurs, j’ai demandé à mes amis Laurent Fabius et Alain Juppé de nettoyer la nouvelle loi sur l’immigration de tous ses articles racistes et antimondialistes. Cette 30e loi depuis 1980 sur ce sujet sensible ne servira donc à rien, mais c’est voulu. Que l’intégration ait échoué n’est un secret pour personne. Mais je ne vais pas demander à nos immigrés de se sentir français et d’adopter notre histoire, alors que je bâtis le grand village mondial supranational et que je déconstruis tout ce qui est gaulois. Disons le, la France arrive au terminus de son Histoire.
L’école républicaine est l’un de mes plus beaux succès. Chaque classement Pisa révèle l’efficacité de ma politique de démolition. Bientôt, nous aurons les bacheliers les plus illettrés de la planète. Mon but n’a jamais été de faire de nos écoliers des prix Nobel scientifiques. Je veux uniquement des consommateurs.
Le patriotisme, le travail, la famille traditionnelle, tout cela doit disparaître.
Je suis un patriote du grand village mondial et certainement pas un franchouillard nostalgique de la Gaule de Vercingétorix. Le nationalisme est un fléau. Dans le monde sans frontières de demain, nous vivrons la diversité heureuse et harmonieuse, loin des conflits actuels. Le roman national gaulois, que je juge débile et porteur de frictions, doit disparaître de nos programmes scolaires.
J’ai développé la plus formidable politique d’assistanat de la planète. La France est le seul pays au monde où on peut vivre des décennies sans travailler. Avec 33 % de budget social partagé avec toute la misère du monde, nous avons la chance d’être la destination privilégiée de tous les déshérités de la Terre. Nous sommes le paradis du tout gratuit qui n’expulse jamais. J’ai d’ailleurs divisé le nombre des expulsions par deux et comme les pays étrangers refusent de coopérer pour reprendre leurs ressortissants, la nouvelle loi soi-disant durcie ne sera jamais appliquée.
Quant à la famille traditionnelle, elle est un vestige du passé. Soyons ouverts à toutes les révolutions sociétales et aux grandes avancées LGBT. Ne restons pas figés dans cette France rance de nos Anciens.
J’ai détruit notre industrie et revendu nos plus beaux fleurons industriels. J’ai surtout liquidé la filière nucléaire, ce qui fait que nous importons de l’électricité polluante à prix d’or au lieu d’exporter des mégawatts décarbonés. En fait, nous savons encore tout faire, mais nous importons tout, grâce à la judicieuse politique de délocalisation menée depuis trente ans. Du fabuleux héritage des Trente Glorieuses, il ne subsiste que quelques débris résiduels. Gardons le cap car tout doit disparaître.
Nos paysans manifestent depuis des semaines mais j’ai donné ordre aux médias de taire cette jacquerie. Je sais bien qu’ils sont soumis à une concurrence sauvage et déloyale, mais c’est ainsi. Nous étions exportateurs en agroalimentaire, le but a été atteint : nous sommes désormais importateurs. Si on veut mener une politique mondialiste, cela implique de sacrifier nos paysans, irrémédiablement condamnés par les accords de libre échange européens. Je ne m’opposerai jamais à la politique de Bruxelles car Ursula von der Leyen fait un travail magnifique.
Nous avons été dépossédés de notre monnaie, de notre souveraineté budgétaire, diplomatique, judiciaire, militaire et territoriale. N’est-ce pas magnifique de voir que nous ne maîtrisons plus rien et que le grand gouvernement mondial se met en place et pense pour nous ?
C’est reposant.
Notre dette de 3 000 milliards ? Où est le problème ? Vu que personne ne la remboursera, je ne comprends pas cette focalisation hystérique sur la dette. Oui, j’augmente la dette publique de 10 milliards par mois, mais il faut bien financer le social pour éviter la révolution. Et si les intérêts atteignent des sommets, j’augmenterai les impôts.
J’ai d’ailleurs l’intention de faire payer aux propriétaires un loyer fictif. Il n’est pas normal que les retraités propriétaires soient logés gratuitement, tandis que les travailleurs sont majoritairement locataires. Mes services s’en occupent. Il y aurait 11 milliards à gratter… De plus, j’envisage de réquisitionner bientôt tous les logements vacants et d’imposer à tous ceux qui possèdent une pièce vide chez eux d’accueillir au moins un migrant. La France ne peut plus devenir un immense bidonville avec des camps sauvages qui envahissent nos trottoirs. A six mois des JO, Paris est un cloaque.
L’insécurité ? Quelle insécurité ? Comme le dit le ministre de la Justice, ce n’est qu’un sentiment d’insécurité totalement injustifié. Au Moyen Âge, c’était pire. Et si les chiffres de la délinquance ont quintuplé depuis 1980, c’est uniquement parce que les statistiques de la police sont meilleures. Ceux qui affirment que la France est devenue le pays le plus dangereux d’Europe mentent. Quant au lien supposé entre immigration et insécurité, c’est encore une fable d’extrême droite. Gérald Darmanin l’a confirmé : durant les émeutes, on n’a vu que des Kevin et des Mattéo se déchaîner dans la violence.
Notre armée est laminée et le peu d’armements qu’elle avait, je l’ai donné à Zelensky. Je sais bien qu’une partie des matériels livrés à l’Ukraine se retrouve en vente sur le darknet et que des armes de guerre remplissent les caves de nos banlieues, mais comme je ne prévois à terme ni une guerre de haute intensité, ni une guerre civile, il est nul besoin d’entretenir des légions de soldats aussi inutiles que coûteuses. Une belle armée du 14 juillet me suffit. Du pain et des jeux et tout ira bien.
Enfin, pour l’hôpital et les services publics, j’ai fait de mon mieux pour que tout s’effondre. Manque de moyens, manque de personnels, pénurie de médicaments. Comme pour la crise Covid, nous manquons de tout.
Nos campagnes sont privées de tous les services publics mais ce n’est pas nouveau. On va repeupler ces zones rurales avec une immigration de masse et nous aviserons. Il n’est pas juste que nos villages ruraux ne bénéficient pas des joies du vivre-ensemble. La diversité heureuse ne doit pas être un privilège réservé aux citadins. Ruinés par la mondialisation, nos paysans ont besoin de sang neuf.
Voilà mes chers compatriotes le fruit de votre engagement total à mes côtés. La France n’est plus que l’ombre d’elle-même. Grâce à moi, et à vous, notre pays est passé du 5e au 7e rang mondial en termes de PIB. Parvenir à cela en moins de sept ans, c’est un exploit dont je suis fier. On peut en dire autant de notre armée, tombée au 9e rang mondial.
Une armée qui ne tiendrait pas trois jours face à celle de Poutine. Comme quoi, le fait de récolter les dividendes de la paix pendant trente ans a porté ses fruits. Un vrai succès. D’ailleurs, au Sahel, notre armée était à bout de souffle en alignant seulement 5 000 soldats qui manquaient de tout. Il fallait désosser un hélicoptère pour en faire voler un autre. Tout véhicule en panne est une aubaine car il sert de magasin de pièces détachées.
Mais j’ai peu de temps devant moi pour déclasser la France encore davantage. Cela dit, tout espoir n’est pas perdu. Il me faut un nouveau mandat pour parachever le désastre et j’y réfléchis.
Une modification de la Constitution me parait impossible. Mais si je démissionne six mois avant la fin de mon mandat, je pourrai me représenter en 2027. En effet, un deuxième mandat non exercé dans son intégralité, m’autorise à me relancer dans la course selon le Conseil d’État. C’est donc jouable si vous me soutenez. Mais sachez que de toutes façons, je me représenterai en 2032. Ce qui me donnera 10 ans de plus pour laisser un champ de ruines derrière moi.
Mes chers compatriotes, mes fidèles compagnons de route, je vous souhaite une excellente année 2024. Nous avons encore un long chemin à parcourir ensemble et je compte sur votre ténacité pour soutenir ma politique mondialiste dévastatrice.
Vive notre République bananière, vive la France tiers-mondisée, vive le grand village mondial de demain.
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
| |
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
Développement Rural À Annaba
Envoyé par Adrien
https://lestrepublicain.com/2024/01/26/developpement-rural
-a-annaba-le-mont-de-ledough-mis-en-valeur/
lestrepublicain.com - Par: B.Salah-Eddine, 26 janvier 2024
Le Mont De L’Edough Mis En Valeur
En plus de l’injection de projets de développement au profit des populations rurales, les services des forêts de la wilaya d’Annaba, en collaboration avec l’Assemblée Populaire Communale (APC) de Seraïdi, aspirent à mettre en œuvre un programme spécial de création de forêts récréatives.
Cela concerne principalement les régions boisées non côtières de la municipalité. Les activités de loisirs, sportives et environnementales, dans le cadre de la promotion et la valorisation du tourisme écologique et de montagne, sont actuellement perceptibles à Seraïdi.
Ces initiatives touristiques visent à faire du mont de l’Edough un véritable pôle de tourisme de montagne. À cet effet, les responsables prévoient l’organisation d’initiatives liées aux sports de montagne et aux activités environnementales pour les jeunes dans le mont de l’Edough.
Cela implique l’ouverture des pistes au sein de la forêt pour la pratique de sports tels que la marche, le motocyclisme, le Vélo Tout Terrain (VTT), les randonnées et les explorations. Par ailleurs, d’importantes opérations ont été lancées dans le cadre du programme national de développement rural, notamment dans les régions moins loties de l’antique Bugeaud.
Les différents programmes des circonscriptions forestières ont ciblé l’ensemble des régions rurales forestières, comme Aïn Barbar et Romanet. Ces programmes, initiés par la Conservation des forêts de la wilaya d’Annaba sur instruction du wali, visent divers objectifs, notamment l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et leur fixation sur les terres
B.Salah-Eddine
Nouveaux produits finis
Envoyé par Adrien
https://www.tsa-algerie.com/lalgerie-interdit-limportation-
de-nouveaux-produits-finis/
- tsa-algerie.com - Par: Ali Idir 20 Janv. 2024
L’Algérie interdit l’importation de nouveaux produits finis
L’Algérie continue de restreindre ses importations. Cette fois, le gouvernement a décidé de ne plus importer de nouveaux produits finis à partir du 18 janvier.
Selon une note de l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) algériens, les banques ne sont plus autorisées à domicilier les factures d’importation de produits en marbre et en céramique, sous leur forme finale.
Cette note partagée sur les réseaux sociaux est datée du jeudi 18 janvier. La décision de ne plus importer ces produits a été prise par le ministère du Commerce, selon la note de l’Abef qui ne précise pas si tous les produits en céramique étaient concernés par l’interdiction, y compris les tasses et les assiettes, ou uniquement ceux destinés au bâtiment.
L’Algérie interdit l’importation des produits finis du marbre et de la céramique
Cette décision d’interdire l’importation des produits finis en céramique et en marbre survient dans un contexte où l’Algérie essaie d’attirer les investisseurs étrangers et de développer sa production nationale, afin de réduire la facture des achats à l’étranger.
Elle survient aussi quatre jours après le rétablissement des relations commerciales avec l’Espagne après 19 mois de rupture, suite à la crise diplomatique qui a éclaté entre les deux pays après la décision du gouvernement espagnol en mars 2022 de changer de position sur le conflit au Sahara occidental en apportant son soutien au Maroc.
En réaction, l’Algérie avait rappelé son ambassadeur à Madrid et décidé de geler le traité d’amitié et le commerce avec l’Espagne. En novembre dernier, Alger a nommé un nouvel ambassadeur à Madrid, ce qui a mis fin à la crise diplomatique entre les deux pays.
La levée du gel des relations commerciales avec l’Espagne a été actée par la décision de l’Algérie d’autoriser l’importation de ce pays de certains produits avicoles comme les poussins, et d’intrants agricoles.
Avant la crise de mars 2022, l’Espagne était l’un des plus importants fournisseurs de poussins à l’Algérie, mais aussi de la céramique destinée à la réalisation de logements.
Pendant cette crise, les producteurs espagnols de céramique de la région de Castellón ont été durement impactées par la perte du marché algérien.
Ali Idir
| |
|
|
Un retrait d’espèces
Envoyé par Eliane
|
|
Une vieille dame se présente à une agence bancaire pour effectuer un retrait d’espèces.
Elle remet sa carte bancaire au caissier de la banque et lui dit :
- Je voudrais... retirer 10€, s’il vous plaît.
Le caissier lui répond : - Pour les retraits de moins de 100€, veuillez utiliser un guichet automatique.
- Je peux savoir pour quelle raison ? demande la vieille dame.
Le caissier lui répond en lui rendant sa carte bancaire :
- Ce sont les instructions, madame. S’il vous plaît, il y a des gens derrière vous... en attente !! S’il vous plaît partez, si vous n’avez rien d’autre à demander !
La vieille dame reste silencieuse quelques secondes, puis rend la carte au caissier et dit :
- S’il vous plaît, je voudrais retirer tout l’argent de mon compte.
Le caissier est étonné quand il vérifie le solde de la vieille dame et lui dit :
- Vous avez 50.000 € sur votre compte et la banque n’a pas ce montant pour le moment. Pouvez-vous revenir demain ?
Froidement, la vieille dame demande : - Combien est-ce que je peux retirer sur place ?
Le caissier lui dit : - Tout montant jusqu’à 3.000 euros.
- Eh bien, s'il vous plaît, donnez-moi 3.000 euros maintenant, dit la vieille dame.
Le caissier retourne avec colère dans l'armoire, en sort des paquets de 20€ et 10€ et passe les 10 minutes suivantes à compter les 3.000 euros. Il les tend à la vieille dame et lui demande :
- Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd'hui ?
Tranquillement la vieille dame met 10 euros dans son sac à main et dit :
- Oui, je veux déposer 2.990€ sur mon compte."
Je le dis toujours : Il ne faut pas emmerder les "vieux" !!!
|
| |
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|