|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
233,
234, 235, 236,
237, 238, 239,
240, 241, 242,
| |
Fêtes de Novembre...
Comme chaque année, la fête de la Toussaint est ressentie par des sentiments nostalgiques de l’automne : les feuilles qui tombent, le vent qui s’engouffre dans les vestes qu’on vient juste de ressortir et les jours qui raccourcissent.
Mais, en cette année si particulière avec une économie à l’agonie, l’actualité vient encore plus assombrir ce climat déjà morose avec les lâches et barbares meurtres dans plusieurs endroits de la terre. L’attaque sanguinaire sur des civils en Israël en est une preuve irréfutable.
La liturgie de ce temps, en nous faisant remémorer tous nos défunts, n’a pas pour intention d’ajouter du tragique à ces pensées déjà sombres. Se souvenir de tous ceux qui nous ont quittés, évoquer la mort, c’est aussi s’interroger sur nos raisons de vivre, sur le sens de notre vie, à nous, aujourd’hui ?
La fonction de tout croyant en ce jour de Fête de tous les Saints ne consiste pas à exprimer des condoléances aux familles de nos chers disparus mais à redire nos pensées en leur souvenir. La mort fait partie de notre histoire, la vie est comme l’univers dont nous ne verrions qu’une partie.
Célébrons donc la Toussaint comme un rayon de soleil qui traverse le ciel gris de novembre en allant fleurir les tombes, même les lointaines où il y a sûrement une solution.
Pour notre communauté, le 1er novembre nous rappelle qu’en 1954, cela était le commencement de la fin et sonnera le glas de l’exil presque huit ans plus tard après des milliers de victimes innocentes.
La France n’a pas voulut comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de "libération" mais d'une guerre de "civilisation", Le FLN se servait de la religion pour imposer sa vision du monde en Algérie française
La France ne veut toujours pas comprendre la signification de ce 1er novembre et malheureusement, elle en paiera le prix dans les années prochaines car la guerre n’a jamais été finie et elle continue plus sournoisement sur son sol.
Les crimes au nom d’un islam et d’un communautarisme en fait foi. Et dire que des hommes politiques pourris encouragent et soutiennent les criminels comme ils l’ont fait en Algérie à l’exemple de J.P. Sartre.
Dans quelques années, nos jeunes n’auront pas d’autres choix que de se défendre par les armes en éliminant la pourriture qui gangrène leur pays. J’espère ne plus être là pour voir ces horreurs qui se préparent.
Nos ancêtres ont pris les armes pour éradiquer d’autres fléaux en 14-18 et 39-45. Ne les oublions pas le 11 novembre. Que les jeunes ne les oublient pas…
Avec un groupe d’amis nous avons fait fleurir nos tombes à Bône, La Calle et le Tarf. Certes nous n’avons pas été très nombreux, car beaucoup de compatriotes n’ont pas répondu à nos appels, c’est dommage et c’est à déplorer. Chacun a ses raisons et sa conscience.
 (La camionnette avec les bouquets de fleurs prêts à être déposés)
Jean Pierre Bartolini
(La camionnette avec les bouquets de fleurs prêts à être déposés)
Jean Pierre Bartolini
A tchao.
|
|
| Toussaint Calloise 2012.
Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.
|
( A tous nos êtres chers restés sur notre terre d'Afrique.)
Ô mon pays perdu,
Ô mon petit village.
Que de larmes amères je verse en ce jour.
Jour sacré où les gens vont en pèlerinage,
Sur la tombe d'êtres chers disparus pour toujours.
Je t'ai perdu,
Ô toi ! pays de mon enfance.
Mon âme d'exilée jamais ne pourra mieux,
Sentir son dénuement, combler ce vide immense.
Je ne t'ai pour prier, tombe de mes aïeux.
Lorsque j'étais enfant,
j'accompagnais ma mère.
Qui fleurissant la tombe priait doucement.
Sans trop comprendre, émue, je la regardais faire.
Sans bien savoir, troublée par son recueillement.
M'éloignant lentement au hasard des allées,
Oui ! je m'en souviens bien.
Il m'arrivait parfois,
Lorsque je trouvais une tombe abandonnée,
De mes mains d'enfant de redresser une croix.
Une croix que le vent,
Sans pitié, sans colère avait couchée,
Ainsi la mort fauchant l'humain.
Sur cette pauvre tombe où pas une prière,
Ne serait murmurée en ce jour de Toussaint.
Et j'allais demander à ma mère une rose,
Puis, je m'en revenais.
Pieusement alors,
A ce mort inconnu j'offrais,
Oh ! peu de chose.
Mais avec tout mon cœur,
Oui, j'offrais mon trésor.
Toussaint !
Jour où le glas sonne triste en mon âme.
Ô Dieu !
Si ce n'est une enfant avec candeur.
Qu'un de tes anges dépose,
avec mes larmes sur la tombe des miens,
une modeste fleur.
Poème anonyme
Confié par M et Mme Hugues PIRIS de Bab El Oued ( Algérie ).
Jean-Claude PUGLISI
de La Calle de France
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
|
|
|
NOS MAMANS, ELLES ETAIENT IMPAYABLES....
C'EST LE MOINS QUE L' ON PUISSE DIRE!
Envoyé par M. Georges Barbara
|
Remontons le temps et transportons nous à Bône t’sur la placette de l'église St Anne à la colonne !

.
- » Ô les belles en cuisses, vous allez bien ? Houille, et toi Conchette, enfin j’te ‘ois un peu, comment tu restes, ça va ? A debon comme j’suis contente de vous ‘oir, si vous savez. Ca fait un moment moi que j‘me suis pas mis un pied à la Colonne. Depuis la Kermessee de Saint Anne je crois ? Y faut dire qu’avec tout c’travail que j’ai, et aussi que main’nan j‘habite en galère à Joanonville que c’est au Bon Dieu... Diocane. Vas te trouver le temps toi pour venir ’oir ma pauvre mère qu’elle habite à la rue du 14 juillet, et par la même occasion pour faire un peu la causette a’c les copines t’sur la placette de l’église. Encore toi Conchette avant j’te 'oyais un peu de temps en temps le samedi au marché mais Diomadone, là ça fait plus d’un mois que t’yes pas venue te faire tes commissions. J’ai même demandé à Vito t’sais l’italien celui qu’y te vend le fromage en face de Mickey le marchand de légumes en haut des escaliers quand tu montes ? Alors j’te lui ai dit: « T’ya pas vu Conchette o Vito ?.. ». Heï Conchette qu’y m’a repondu, ! Ca te fait un moment moi que j’l’ai pas vue, A te viens au marché quand y tombe d’la neige ! A sa’oir ousqu’elle est passée. A doit t’être malade, parcequ’à debon la dernière fois qu’a l’est venue pour m'ach'ter un morceau d'Sardaigne, j’ te lui ai trouvé une madone de tête fatiguée que t’aurais dit qu’a s’avait passé d’la poudre de riz t’sur la fugure.
- » Ca y’est entends moi ça Diocane, pour un jour que te vas pas au marché vite vite on te fait morte main’nan. Et madonne ! Te sais dans la vie des fois y te vaut mieux que t’ya des bouchons de Tannieres dans chaque oreille, que t’y’entend ces gougoutses du dimanche qu’y te sortent des trucs pareils. C’est aussi gros que les buts de Truglio quand y l’est dans le stade! .. Dieu benisse, tu ‘ois pas que j'suis fraiche et rose comme une Matsagoune de chez Salem le marchand d’poissons ? Et pis y faut dire aussi que depuis que Toinette ma Fi main’nan qu’elle te fréquente le fils d’un Maltais qu’y l’habite au Pont Blanc à coté de l’orphelinat des chères sœurs, j’manque de rien Dieu bénisse a’c tout ça que son copain ’y m’apporte, T’yen veux toi des legumes ? Et zek laisse que j’me rempli la glacière ! Ah bien sur ça, c’est pas venu tout seul, hen. Te ‘ois Cyprie moi que j’te ‘oi les choses du promier coup et ben quand j’ai vu que c’était un p’tit que ses parents y z’avaient du terrain et qui devaient etre plein aux As, comme tous les maltais du Pont Blanc, laisse que j’t’e l’invite à manger et comme ça de fil en aiguille et pour pas t’la porter à la longue, un jour au dessert, moi qu’j’ai la fugure comme mon darrière, j’te lui ai balancé le Broumèdge. J’lui ai dit : Dites moi, Jeune homme vos parents y doivent faire de beaux légumes, dans vot’ famille c’est des gros travailleurs, comme tous les Maltais, ça on peut pas leur reprocher ! Alors michkine là j’l’ai vu qu’il etait géné le pauvre, j’avais peut-etre sur’ment été trop loin, mais qu’à même tout’suite y m’a dit : « vous voulez que j’vous apporte un peu des légumes, madame ? Et moi bien sur avec ma fatche de Poutane que t’yen trouve pas deux com’moi dans toute la rue Sadi Carnot, et même si y m’a appelait Madame j’lui ai dit ; si vous voulez ; mais faut pas qu’ça vous dérange, hen, et bien sur pas beaucoup à la fois !
- » ET ZEK ! Te vas pas ‘ac le dos d’la cueillère toi !
- » Te crois pas qu’y faudrait que je sois con à ce point o Toinette, pour que j’te refuse ? Et main’nan à chaque fois qu’y te vient chercher la p’tite , merci mon dieu, il a les mains pleines, mais pleines que tu croirais que c’est les Rois Mages qu’y z’arrivent, et moi la canemourte de promière que je suis, je t’arrête pas de lui dire merci... Et pis de toi à moi un merci ça t’coute pas cher !
- » Y t’apporte des legumes ? Et ben toi avec ta fatche de Poutane comme tu dis... a debon ça se voit que t’ya toujours le cul brodé. Parceque moi, ma fille elle a beau te sortir avec un oualio que son pere y l’a un chalutier, que j’vous dirai pas le nom…. et pis d’abord .. que vous le savez deja, comme les bruits y te courent vite à la Colonne, et ben te me crois si tu veux, j’connais pas la couleur du poisson et pourtant, quand y vient les après-midi pour te sortir la p’tite, c’est pas les cafés qu’y lui manquent à ce mal apris ! Mais entre nous, ‘ac tout cette crème qu’elle me rentre à ma maison cette trainée, je me demande où c’est qu’elle va s’les trouver dis moi un peu ! Et entention ça te fait le troisième cet’année que cet’coureuse de garçons a nous fait rentrer dans la maison ! Et y z’ont tous les doublures des poches des pantalons qui se touchent !
- » Conchette de toi à moi comme tu nous dis là, entention que cette Pitchaquelle de ta fille a te fait pas Pacques avant les Rameaux !
- » Qué Pacques ? Alors là oui y manquerait plus qu’ça ! Pour qu’je sois la risée de toute La Colonne ? ! Aller les Fis laissez-moi que je vais voir un peu ma mère, que je crois que celle là aussi elle commence à partir d’la caf’tière ! Et pis y faut qu’j’te rentre bonne heure à cause du type d’la Poste qui va venir m’ installer le telephone !
- » Et Zek mis Stougats, attrapez-moi que j’vais me trouver mal …. vous avez vu un peu, ça se met le telephone main'nan Madame, depuis qu’a t’habite dans le beau quartier de Joanonville que c’est la choumarelle…. on aura tout vu ! Ca quelle etait et ça quelle est devenue.... Elle qu'elle arrive même pas à te payer ses dettes au Gagne Petit chez Madame Allouche, que ça fait trois fois que cet’ femme ‘a lui envoie le p'tit arabe pour l'encaisser !
- » Aller mieux que m'en vais là parce que je ‘ois qu'avec vous on peut pas discuter comme tous les chretiens. Je ‘ois que rien y l’a changé dans le quartier et avant que le bafougne y va te commencer ! Au Revoir, et pour que vous me revoyez ici….. y faudra qu’y me tombe un œil ! Allez au revoir !
- » Ô gracieuse, quand te seras à ta maison si ton téléphone y marche: APPELLE NOUS... EN POSTE RESTANTE,….. !
Georges Barbara, Août 2022
|
|
LE ZEZU
Amédée MORENO
Echo de l'ORANIE N° 247 novembre/décembre 1996
|
|
Histoire vraie en forme de conte
L'explosion avait été aussi soudaine que brutale en ce premier après-midi de l'hiver 1959. La bombe avait éclaté vers cinq heures devant les grands magasins des "Galeries de France", en plein centre d'ORAN.
A quelques jours de Noel, la foule se pressait ce lundi de décembre, pour les achats de cadeaux et de victuailles, désireuse sans doute d'oublier pour un temps cette guerre pourrie qui empoisonnait notre vie depuis cinq ans. Mais le terrorisme veillait, méprisant cette trêve universelle qui souhaitait la "paix aux hommes de bonne volonté".
Les vacances scolaires avaient commencé et Maria avait emmené Marc, son petit-fils âgé de cinq ans, pour lui faire admirer tous ces décors féeriques, ces milliers de guirlandes et de lumières magiques multicolores dont se paraient les bourriques du centre-ville, mais aussi toutes ces montagnes de jouets qui émerveillent tellement les enfants... Et voila que maintenant son petit Marc chéri gisait inconscient sur ce lit de douleur, couvert de pansement et encombré de sondes médicales.
"État comateux" avait simplement annoncé le chirurgien de la clinique, après son intervention. La tête avait été touchée, ainsi que les membres du garçonnet. Le pronostic était "réservé". Des mots cruels qui veulent tout dire et ne rien dire. Non I Cela ne se pouvait pas... Personne ne lui arracherait son petit-fils adoré !...
Elle-même avait été atteinte aux jambes, à un bras et au bassin, de façon superficielle. Elle ne sentait nullement I'effet de ses blessures et avait refusé de garder le lit, en dépit des ordres de l’infirmière qui l'avait soignée. Son cœur éclatait de douleur devant ce petit corps inerte qui représentait toute sa vie.
Céline et Alain, les parents de Marc immédiatement prévenus, étaient accourus aussitôt. Fous d'inquiétude et en larmes, ils avaient longuement attendu, dans la chambre de Maria, la fin de l’intervention chirurgicale sur leur garçonnet. Le médecin-chef leur annonça que l'attentat avait provoqué trois morts et une quinzaine de blessés. Il s'était voulu rassurant. "Avec les gosses on peut s'attendre à tout.." Avait-il déclaré.
La nuit était tombée et le chirurgien demanda aux parents de quitter la clinique. Toutefois, il permit que la grand-mère restât près de l'enfant comme accompagnante, en lui interdisant de le déranger et même de le toucher. Une infirmière de garde passerait régulièrement jusqu'au matin, pour la surveillance et le contrôle. Maria, son mouchoir sur le visage en pleurs, hocha péniblement la tête. Pendant trois nuits et trois jours, elle veilla son petit Marc, attentive au moindre râle ou au moindre mouvement du garçonnet. Seuls les soins qu'elle devait subir elle-même et les quelques instants pendant lesquels elle cédait au sommeil, la distrayaient de son attention. Les parents aussi passaient le plus clair de leur temps, en silence, dans cette chambre qu’ils quittaient à la nuit. Marc était toujours dans le coma...
Pendant ces trois journées, Maria n'avait cessé de prier, de penser, de se souvenir, de retracer dans son esprit tous les moments de sa vie. Pourquoi Dieu la punissait-elle ainsi ?...
Lorsqu’elle était jeune, Maria connut la Grande Guerre qui vit périr son père: puis celle de 39-45 où elle perdit son mari. Restée veuve, elle dut travailler durement pour élever Céline son unique fille et sa seule raison de vivre. Celle-ci était employée à la poste et avait épousé Alain, un collègue de bureau.
-Aussi, quelque mois après la naissance de Marc, les jeunes époux consentirent à le confier à Maria pendant la journée, ce qui les arrangeait bien pour leur travail. Chaque soir, ils venaient reprendre le petit et le ramenaient tôt le matin à sa grand-mère.
Les dimanches et les jours de fêtes se passaient dans la maison de Maria à Saint-Eugène, ce grand faubourg d'ORAN. Quand Marc fut en age scolaire, sa grand-mère fut toute fière de l'emmener à I'école du quartier ; puis elle Ie ramenait ; lui servait ses repas et ses goûters, le choyait, le gâtait. Ce gosse était son grand Bonheur et le petit le lui rendait bien car il adorait sa "Mémé".
Elle revivait la journée du dimanche précédent, au cours de laquelle ils avaient dressé et décoré le sapin de Noël et la Crèche.
Elle se souvint combien l'enfant avait insisté pour installer le petit Jésus sur la couche: "Mémé y faut mettre le Zézu..." Et comment elle lui avait longuement expliqué que Ie Seigneur, étant né à minuit le 24 décembre, ne pouvait apparaître entre l'âne et le bœuf qu'à partir de cette heure là.
- Ça fait rien, Mémé, on le met quand même... avait supplié Marc
- Non, mon chéri. Le petit Jésus ne descendra du ciel que dans la nuit du jeudi en même temps que le Père Noël mais, si tu veux, tu pourras l’installer toi-même dans la crèche, à minuit après la messe.
Les larmes remontèrent aux yeux de Maria et son coeur se serra.
L’enfant avait tant et tant insisté pour que "le Zézu" figure avant l'heure au milieu des personnages de l'étable et elle le lui avait refusé, alors qu'elle s'était toujours conformée à ses moindres désirs... Et il gisait la, presque sans vie depuis trois jours malgré les soins, en cette nuit de la Nativité qu'ils avaient préparée avec fièvre. "Mon Dieu, pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi tant de haine sur cette terre ? Pourquoi cet innocent ?... Prenez ma vie contre la sienne, je vous en prie à genoux !..." ElIe refondit en larmes et se mit à prier, de toutes les maigres forces qui lui restaient après ces journées épuisantes. Le sommeil la gagnait, mais elle résistait..
Elle se sentait faiblir et quitter la réalité. La lumière de la veilleuse paraissait dans la chambre... Elle ferma les yeux...
...La cloche d'une église égrena douze coups dans la nuit. A demi-inconsciente, Maria revoyait le sapin et la crèche qui attendaient chez elle et son petit Marc qui lui demandait d'une petite voix douce:
- Mémé... Mémé... y faut mettre le "Zézu" ...
- Oui, mon petit chéri..." répondit-elle à haute voix. Et soudain elle sursauta violemment. Non, elle ne rêvait pas I Marc avait parlé, Marc venait de LUI parler mais oui ! Mon Dieu, O mon Dieu ! Faites que ce soit vrai !... Elle se pencha sur Ie petit corps, puis poussa un hurlement tragique en se précipitant sur la sonnette d'appel. Son cri avait été perçu dans le couloir et déjà l'infirmière entrait dans la chambre en donnant la lumière Le spectacle la laissa sans voix et elle éclata en sanglots.
Le petit Marc avait repris connaissance. Il appelait sa Mémé.
Celle-ci était à genoux, la tête posée sur le lit contre l'épaule de son petit-fils et elle ne cessait de dire a voix haute:
- Merci, Seigneur Jésus ! Merci Sainte Vierge de Santa-Cruz et tous les Saints du Paradis !... Mon petit ange est vivant il m'a parlé !... O Dieu du Ciel, soyez loué ! Mille fois merci pour cette joie de Noël !...
Deux autres infirmières étaient accourues, ainsi que I'interne de garde qui venait tout juste de prévenir les parents de I'enfant. Les cloches des églises annonçaient la naissance du "Divin Enfant,.
Dans la petite chambre, une grand-mère folle de bonheur, trois infirmières en pleurs et un médecin très ému entonnèrent un Ave Maria avec une grande ferveur. En arrivant à la dernière phrase « Sainte Marie, mère de Dieu..." ils se turent avec un même ensemble car le petit Marc parlait. Les yeux clos, il disait faiblement:
- Mémé... y faut mettre le "Zézu.."
Amédée MORENO
Noël 1995
| |
ENTREMET LE MALTAIS
ACEP-ENSEMBLE N° 295
|
Préparation Pour 6 personnes : 20 mn ; Cuisson :40 mn
 Ingrédients :
Ingrédients :
- 150 g de riz rond
- 7 dl et demi de lait
- une pincée de sel
- une gousse de vanille
- 225 gde sucre en poudre
- un dl et demi de crème fraîche
- 6 jaunes d’œufs
- 3 feuilles fines de gélatine
- 2 oranges, 50 gr d'écorces d'oranges confites
- 3 cerises confites
- 3 cuillerées à soupe de Cointreau.
Préparation:
Jetez en pluie le riz dans de l'eau bouillante légèrement salée et laissez-le blanchir pendant huit minutes. Ensuite, passez-le, égouttez le bien et mettez-le à cuire dans cinq dl de lait préalablement bouilli et vanillé. Cette cuisson doit s'opérer lentement à feu très doux en une quarantaine de minutes environ. Le riz doit gonfler doucement et absorber peu à peu le lait. Ne remuez pas le riz au cours de la cuisson.
Tandis que le riz cuit, préparez la crème anglaise. Battez six jaunes d’œuf avec 200 g de sucre et le reste du lait. Ajoutez un zeste d'orange pour parfumer. Cuisez cette crème à feu doux en tournant sans arrêt. Dès qu'elle nappe la cuillère, ajoutez hors du feu trois feuilles de gélatine préalablement bien amollies à l'eau chaude et égouttées. Remuez la crème jusqu'à ce que la gélatine soit fondue.
Fouettez la crème fraîche jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme.
Mélangez alors au riz cuit et tiédi la crème anglaise, la crème fouettée, deux cuillerées de Cointreau et l'orange confite coupée menu.
Huilez un moule cannelé et versez-y cette préparation. Mettez au frais pendant cinq heures environ.
P
elez les oranges, ôtez les peaux blanches, faites macérer les tranches avec un peu de sucre et la dernière cuillerée de liqueur.
Pour servir, démoulez le gâteau, décorez le dessus avec des tranches d'oranges bien égouttées, disposées en une rosace dont le coeur sera formé par les cerises confites.
| |
PHOTOS DE TIMGAD
Envoyées par Groupe de voyage Bartolini
|
|
|
MUTILE : N° 170, 171, de 1920
|
LES CRIMES DES CONSEILS DE GUERRE
QUATRE CAPORAUX
ARBITRAIREMENT MIS A MORT
La Ligue des Droits de l'homme donne la publicité de ses Cahiers à une tragique affaire de Conseil de guerre au cours des hostilités.
La voici succinctement rapportée.
Le 9 mars 1915, une compagnie du 336° d'infanterie devait, d'après les prévisions de l'Etat-Major, se porter sur Souain. Pour des raisons mal déterminées, la compagnie ne sortit, pas à l'heure H. L'autorité militaire voulut voir là un refus d'obéissance concerté. Après la relève, on rassemble les hommes ; au hasard, en éliminant les officiers et chefs de section, on choisit deux soldats par section et six caporaux et on les défère au Conseil de guerre.
Celui-ci fait, une nouvelle sélection.
Et, froidement, sans enquête préalable, sans se préoccuper d'assurer la défense des malheureux, il déclare coupables quatre caporaux qui sont condamnés à mort et exécutés.
Ces hommes s'appelaient : Maupas, classe 1894, instituteur au Chefresne (Manche) ; Girard, mécanicien à Paris ; Lefoulon, cultivateur à Condé-sur-Vire ; Lechat, cultivateur au Ferré (Mayenne)
A la Ligue des Droits de l'Homme qui, depuis de longs mois, demande la révision de ce procès, l'autorité militaire répond : « Il n'y a pas d'affaire Maupas.
Mais cela ne résout pas la question.
Laissons de côté les arguments d'ordre sentimental, humain, qui figurent au dossier. Oublions un moment la lettre d'agonie qu'à la veille de sa mort le caporal Maupas, innocent, écrit à sa femme.
La question actuelle est de savoir s'il y a des raisons de droit pour justifier la révision.
Nous disons tout d'abord qu'à l'origine de l'affaire, il y a illégalité flagrante. Il y a eu illégalité à procéder, dans la compagnie soi-disant coupable, à une décimation arbitraire, dont ne furent victimes, qu'une certaine catégorie de combattants, les plus humbles. Coupables, ils l'étaient tous ou pas un. Et on les devait tous les juger, ou personne — les chefs en tête.
Si on nous dit qu'à l'heure H, les chefs ont bondi sur le parapet, donné l'exemple du sacrifice et n'ont pas été suivis, nous répondrons à priori : « Cela n'est pas vrai ! Cela ne s'est jamais vu ! » Et, d'ailleurs, des témoignages précis le nient. Les chefs ne sont pas sortis plus que les hommes.
En fait, lorsqu'on parcourt les dépositions des hommes qui se trouvaient en ligne et que la Ligue des Droits de, l'Homme a recueilli, on acquiert la certitude, qui l'ordre d'attaque n'arriva pas aux hommes de la compagnie incriminée.
Toute la question est là. S'il est avéré que les hommes n'ont pas été touchés par l'ordre d'attaque, cela constitue bien le « fait nouveau », juridiquement nécessaire pour provoquer la révision. Car, alors, il est bien évident que les hommes n'ont pu obéir à un ordre qui ne leur avait pas été transmis.
Autre fait nouveau : une cinquantaine de témoignages viennent tous attester que le jugement qui condamna les quatre caporaux fut abominable. Ils proclament l'innocence des camarades exécutés. Ils étaient là : ils disent comment les choses se sont passées. Pourquoi le Conseil de guerre n'a-t-il pas entendu ces hommes ?
Et d'ailleurs quels témoins a-t-il entendu ? Et dans quelles conditions ?
M. le Ministre de la guerre esquive la difficulté. Ces témoignages si sincères qu'ils apparaissent, ne le convainquent pas.
Car il ne prend pas la peine de les vérifier.. Ceux qui sont morts sont morts. Qu'ils laissent, donc tranquilles les vivants !
Que la mort des quatre victimes soit légère à, ceux qui l'ordonnèrent à ceux aussi qui, contre toute évidence, veulent que la mémoire de ces hommes gardent la flétrissure de la lâcheté.
Mais les anciens combattants, et l'opinion publique éclairée par eux, savent exactement ce que signifie cette fin de non recevoir. Ils savent bien que si l'accusation, portée contre les quatre caporaux, était débattue au grand jour, elle ferait surgir des responsabilités qui se cachent, des fautes que les auteurs ont voulu se faire pardonner en chargeant ceux qui ne pouvaient, se défendre.
1915 / Le temps où on « grignotait » les boches ! Le temps des attaques folles et des massacres inutiles !
Dites-nous : Avez-vous eu connaissance que ceux qui les ordonnèrent, ces massacres, par ignorance ou bêtise, ou pour se faire « mousser », aient jamais été appelés à rendre compte de leur faute, collés au poteau et fusillés ?
Et puis, il faudrait savoir aussi quels considérants ont présidé au choix des victimes ? Un instituteur comme Maupas, c'était, n'est-ce pas, un « intellectuel » ! Peut-être en a-t-il porté la peine.
Toutes les suppositions sont permises.
Et le silence gêné de l'autorité militaire, silence sans courage et sans dignité, les autorise toutes, en effet, y compris les pires.
Henri LAMY.
MAIS IL Y A PIRE, LA SUITE AU PROCHAIN NUMERO
| |
| UN GOÉLAND.
par Jean Claude PUGLISI,
|
- J'ai fait un rêve étrange !
Un bien étrange rêve qu'il me faut vous conter :
- C’était aujourd’hui...
Un grand goéland est venu sans un cri, pour tourner un moment au-dessus de ma tête.
- Par ce vilain jour de Novembre, le bel Oiseau blanc m’a semblé très harassé, comme au terme d'une longue et pénible randonnée.
- Le ciel d'orage et le vent déjà frais ne l'ont pas pour autant découragé, et, sans discontinuer, inlassablement il a poursuivi sa ronde majestueuse, sans même tenter de varier une seule fois de trajet.
- Il volait, volait doucement, tournait inlassablement toujours fier et altier, me fixant au passage de son regard jaune et singulier.
- Un moment, je me suis adossé au tronc rugueux du vieil Arbousier, qui, depuis toujours, calme et serein, gîte au fond de mon jardin.
- Puis, vers les nues attristées, j'ai relevé lentement la tête pour mieux le regarder et par la pensée, je lui ai demandé très gentiment ce qu'il me voulait ?
- Silencieux, il poursuivit quelque temps encore son manège gracieux, et puis, se rapprochant enfin de moi, le grand goéland pencha sa belle tête, pour me dire dans un murmure mille et une choses que rien que pour moi je ne puis garder.
- Surtout aujourd’hui, en ce jour de fête de tous les Saints du ciel.
- Il planait à présent presque à me toucher.
Peut-être que sur ma joue, voulait-il transmettre par le bout de son aile, une caresse douce et lointaine,
Mais aussi, un affectueux baiser de quelque au-delà apporté ! ?
- Il ne m'en a rien dit !
Mais moi, je crois bien l'avoir compris.
- Enfin, c'est alors qu'il me souffla dans le creux de l’oreille,
Que, par-dessus la mer, il venait d’entreprendre un long et rude voyage, pour venir me colporter quelques nouvelles d'une terre lointaine : celle-là même - me dit-il - qui s'étend du côté de là-bas, vers le Sud, sur certain rivage de Barbarie.
- Je ne sais pas pourquoi, il évoqua d'abord Cyprien de Carthage, et puis, sur le Corail, se mit à discourir.
Pensait-il peut-être ? que le Saint-homme m'était étranger, et que du Corail tout j'ignorais !
- Mais comment ! ? lui dis-je.
Ne pas connaître celui qui dans sa grande bonté, fût un temps notre Saint-protecteur, et ignorer d'une Méditerranée Calloise cet éclat familier de l'or rouge qui longtemps fût, le sang merveilleux de notre peuple et le symbole éclatant de notre chère Cité ! ?
- Il planait le grand goéland et planait encore en glissant lestement dans les airs,
Avec un bruissement d'ailes qui me paru d'une infinie douceur.
C'est alors que je compris d'où il venait !
- Cyprien de Carthage ! ?
- C'était aussi Cyprien de La CALLE !
Et le plus beau du Corail ne pouvait bien prospérer,
Que dans les mystérieux abysses par les Dieux du Bastion habités !
- Bel Oiseau de la mer, maintenant je le sais !
Comme Cyprien et le Corail, mais aussi, comme nous autres, tu es de là-bas !
Tu es de La CALLE de France notre patrie bien-aimée !
- Alors je t'en prie, Goéland de mon cœur, racontes-moi ! ?
En ce jour de mélancolie, les nouvelles que pour nous on a pu te confier.
- Que vas-tu me dire ! ?
Bel oiseau voyageur et que m'apportes-tu sous ton beau plumage ! ?
Un message ! ? De joie ou de tristesse .
Un cri d'espérance ! ? Ou de désespoir.
- Impassible, il avait repris un peu de hauteur et de nouveau, inlassablement, il poursuivit sa ronde en petits cercles réguliers sans jamais se presser, mais si prés, si prés de mon front, que je n'avais aucun mal à l'écouter.
- Alors, il m'avoua être venu jusqu'à moi, pour me dire que là-bas, quelque part vers le sud, même, si tristes et abandonnés que sont les lieux, ceux qui reposent pour l'éternité, nous adressent toutes leurs caresses et leurs plus affectueux baisers.
- En ces jours de Novembre, me dit-il, ils vous font savoir combien leurs âmes se sont rafraîchies, depuis que vers eux s'en vont toutes vos pensées.
- Tous les ans, pendant la Sainte Messe du Père Louis Géraud, ils savent maintenant que ce jour-là et par la grâce de Dieu, ils pourront ressusciter et communier l'espace d'un moment, avec ceux qui ne les ont pas oublié, et qui, aujourd'hui encore, dignement les honorent une larme dans les yeux.
Vous ne pouviez pas leurs faire si grande joie ! Ajouta-t-il en battant de ses ailes. Eux, qui sont invisibles pour les humains,
Sachez-bien, qu'ils sont toujours là prés de vous, pour protéger vos pas et vous entourer de tout leur amour.
- Ces profonds sentiments venus de l'au-delà, que venait de me transmettre le grand Goéland, pas même un seul instant ne m'ont surpris.
Mais ! ô combien, en ce jour triste et froid, de mon cœur toutes les fibres, ont dû vibrer de ce céleste bonheur, que seuls, peuvent prétendre les bienheureux.
- Et puis, je me suis aperçu, que l'oiseau fabuleux, continuait doucement à monter vers le ciel, en tournoyant au-dessus de ma tête.
- Un moment, je crûs que son discours était terminé, mais, il me fixa alors de son œil jaune et perçant, pour me dire de ceux qui ne sont plus, quelques ultimes recommandations :
« Gardez entre-vous cette fraternité Calloise qui vous va si bien, et sans laquelle, vous risquez de perdre à tout jamais, les plus belles fleurs du passé ! »
« Ne vous faites jamais de la peine, car le chagrin que vous causerez à l'un des vôtres, c'est à nous que vous le ferez ! »
« N'oubliez jamais les temps d'autrefois et surtout, les racines, qui dés le premier jour de votre existence, vous ont nourris de leur sève généreuse ! »
« Surtout, si vous voulez que votre avenir soit radieux et plein de promesses, dites-vous bien, enfants de La CALLE, que pour bien grandir et affronter l'avenir en toute sérénité, un arbre se doit de posséder de bonnes et solides racines ! »
« Soyez nostalgiques, sans limites et tant que vous pouvez : pour des racines, il n'y a pas meilleur terreau et l'arbre que vous êtes, ne pourra que mieux s'en porter ! »
« Ils vous disent surtout et pour finir ! » Cria le Goéland, qui, à présent, volait bien haut, presque dans les nuages :
« n'oubliez jamais les préceptes de vos ancêtres et faites de votre existence de tous les jours, cette remarquable réflexion léguée dans la Divine Comédie, par l'illustre
Signore Dante ALIGHIERI :
" fatti non foste vivere come bruti, ma, per seguire vertute i conoscenza ."
( " Vous n'avez pas été faits pour vivre comme des brutes, mais, pour suivre vertu et connaissance." )
VERTU et CONNAISSANCE ! ?
« Parfaitement ! » hurla-t-il.
« Même si l'on vous dit, que les temps ont changé ! ? »
« - Poursuivez sans relâche, les belles et anciennes traditions familiales de nos aïeux, car, depuis longtemps, leurs preuves ne sont plus à faire ! »
« Veillez scrupuleusement, à préserver jusque dans sa plus petite parcelle, l'honneur sacré de la famille ! »
« Soyez respectueux de tous et surtout des vôtres ! »
- Je ne l'entendais presque plus, tellement haut dans le ciel était l'oiseau, mais, une dernière fois, il claironna de toutes ses forces :
" ils vous disent d'honorer par-dessus tout, vos pères et mères ! "
Sur ces dernières recommandations, du Sud, il pris alors la direction...
- C'est en vain que je lui criais de revenir et de rester prés de moi, telle, la Divine Colombe, que parfois fait planer, l'Esprit saint sur les cœurs affligés.
- Mais, retournant pour la dernière fois sa belle tête, son regard jaune étincelant me dit sa tristesse, de retourner là-bas vers sa terre lointaine :
- Ici, sur cette terre étrangère, ajouta-t-il, je ne pourrais jamais cohabiter avec mes semblables, qui, je l'ai bien vu au passage, préfèrent pour bâtir leurs nids et pondre leurs œufs, la platitude du toit des humains, aux rochers majestueux de la mer.
- Sans compter, ajouta-t-il, que, sans hauts- le cœur, ils hantent maintenant la puanteur des dépotoirs, pour se délecter des immondices les plus écœurants !
- Non ! Même si les temps ont changé !…
- C'est vrai goéland ! messager de nos cœurs, ta place est ailleurs !
- En ces temps de Toussaint si jusqu'à moi tu es venu, ce ne fût que pour te faire l'écho d'un message d'outre-tombe : celui qui répond aux questions que depuis longtemps, je ne cesse de me poser.
- Le grand Oiseau blanc avait-t-il compris, que, même paré du plus enjôleur des ses sourires, l'exil reste toujours une bête cruelle ! ?
- Adieu goéland, Phœnix de notre cher Bastion, surtout, dis-leurs bien, de venir souvent nous visiter dans les rêves pour parler avec nous.
- Rêver ! ?
- C'est la seule grâce, que Dieu dans sa grande bonté, a bien voulu concéder au genre humain !
- Sur cette terre d'exil, c'est tout ce qui nous reste de là-bas : rêver... rêver encore...
Et toujours rêver !…
Pensif, tout prés de mon arbousier, je restais là encore un moment.
Mais comme c'est étrange !
Au cours de ce singulier conciliabule, le vieil arbre n'avait pas dit mot, et, comme moi, il me paru alors très absorbé par d'obsédantes pensées.
- En vérité, je me suis bien gardé de l'interroger : il y a parfois dans l'existence, des silences qu'il vaut mieux respecter !
- Aurais-je rêvé ! ?
Je ne me suis même pas posé une fois seulement la question.
Car, quelquefois, ce n'est que dans les rêves, que l'on peut dialoguer avec les spectres du passé.
- C'est le seul moyen que le bon Dieu nous a donné !
- Un vent très fort s'était alors levé, et, je percevais, les fracas de la vague sur les noirs rochers de la presqu’île de Giens, et puis, à grosses gouttes, soudain, le ciel s'est mis à pleurer.
- J'observais avec curiosité, ô ! combien le bruit des éléments, était différent sur cette terre d'exil, un peu comme les us et coutumes d'un pays étranger,
Qui, sieds si mal à tous ceux qui d'aventure seraient tentés de renier un instant leurs racines, et ainsi, de voir avant l'heure, leur arbre lamentablement crever !
- Adieu bel oiseau blanc !
Merci du message que tu m'as apporté. Je le transmettrai à tous ceux de chez nous, qui auront peut-être un jour l’envie de méditer sur la Divine Comédie du Signore DANTE :
" Fatti non foste vivere come bruti, ma, per seguire Vertute i Conoscenza."
Docteur Jean-Claude PUGLISI,
de La Calle de France -
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage
- le Mercredi 20/10/99.
- Par un jour triste et froid et infiniment Nostalgique.
|
|
|
QUAND LES POULES A Z’ONT DES DENTS !
Envoyé par M. Georges Barbara
|
Tchitche qui ne sais pas quoi faire de sa journée, va voir un matin son copain Titin qui est menuisier à Joanonville.

- » Salut Titin, toi au moins t’ya pas le temps de t’la couler douce grace à Dieu a’c tout le travail que t’ya en ce moment je ‘ois!
- » Aller le’oila de bon matin, encore lui le porte Chcoumoune. Areusement qu’à chaque fois j’te fais les cornes aussinon ma munus’rie ya longtemps qu’avec tes yeux secs elle t’aurait fait les toiles d’araignée !
- » T’les a bien à l’envers ce matin toi, et moi que comme un tchoutche j’te passais juste pour te donner des nouvelles d’en ville que toi tu descends même plus au café de Gestoni boire l’anisette. T’sur la placette de Diane la Sécheresse, laisse que le monde y me demande où t’y’es, ça qu’y t’es arrivé ? Et aussi pour le romerciment, ô Frade toi tu t’le prends de haut ! Ca c’est des Cats !
-« Aller mets encore ta tournée va z’y, te vas me sortir quoi main’nan ?
- » Non o frade écoute moi un peu Titin. Tu t’arrappelles de Tonin le fils du maltais monsieur Schembri qui te tient l’épicerie dans le passage Sens Olive ?
- » Ouais et ben ? Il est mort ?
- » Et non il est pas mort… Avec toi tout le monde y l’est mort. Mais hier au soir comme y’avait plein du monde t’sur les quais à cause que le bateau « la Ville d’Alger » y te rentrait dans le port, je suis été te faire un tour, comme j’avais le temps, pour ‘oir qui je connais dans tout ce monde qu’y te venait pour les vacances ? Et qui je te ‘oi qu’y te débarque, dio madonne j’en croyais pas mes yeux, …. à peine que je t’lai roconnu,... et ben c’était ce galant homme de Tonin. Sapé à mort que t’yaurais dit qu’y te venait de faire un Ol d’Upe dans la vitrine de chez Laussat au Reveil du Lion !
Moi j’savais qu’il était parti travailler en France mais jamais je pensais qu’y t’avait pu te réussir vite comme çà ? Et fallait ‘oir t’yaurais dit adebon Tonton Christobal qu’y l’est de retour !
- » Zotch ! Il était partit en France pour travailler ? C’est çà qu’te me dis ? Aller va va delà, lui ce gougoutse qu’y l’etait du lever au coucher du soleil au Maxéville le café d’en bas du cours, quand y l’était ici ? Alors elle est belle celle-là ! Te me laisses Axe o frade.
- »Parce que si t’aurais vu çà Titin, t’sur la tombe de mes morts entention les yeux, y l’avait plus assez des doigts pour te mettre les bagues en or dessur. Manque un peu si il aurait pu y t’en aurait mis aux doigt des pieds. De ‘oir çà, diocane je me suis mangé le sang !
- » Et ben tant mieux si y’a un de nous qu’y réussit de temps en temps, nous autres on jette tellement le noir ici du matin au soir pour trois fois rien !
- » Yavait diocane toute sa famille et y l’en manquait pas un bien sur, tous y z"étaient venus pour le ‘oir, mais y’avait aussi Gino tu sais celui que c’était son copain et qu’y l’avait fait d’ la prison pour la fauche qu’y t’avait fait à chez Feloux le bijoutier ?
- » A oui un beau numéro çui’la la aussi, tiens .
- » Et ben agas bien ça que je vas te dire. A un moment, moi j’ai posé la question à Gino, pas que je suis curieux Dieu m’en preserve, mais juste pour sa’oir ça que Tonin y te faisait en France, et ben tu sais ça qu’y m’a repondu ? Y m’a répondu que Tonin y l’avait à Marseille des poules pondeuses et qu’y vivait bien avec çà !!
- » Te me dis des poules pondeuses c’est çà. ?
- »Et ben oui, comme Monsieur Beguin çuila qui te fait les poulets de Brest à l’Alelik !
Enfin comme un Agriculteur tu ‘ois ?
- »Aouah ? Mais madonne ô Tchitche nous deux on s’est connus tout p’tits au quartier de la cité Bona et je sais que t’yes pas tombé du pont d’la tranchée t’sur la tête, et que tu manques pas de l’enstruction aussi, t’yétais le seul de la bande qu’y l’a eu le cerfiticat d’étude ? Non ? Mais ça qu’je crois c’est que t’yas du freiner en 1940 ô Frade. Pour que te mélanges main’nan agriculteur et Chikeur alors là adebon te tombes dans mon estime.
- » Atso, alors tu te crois que j’ sais pas comment c’est une poule moi ?
- » Tchitche, je vas te dire une chose que tu sais pas….Les poules de ton Tonin o frade, et ben elles te portent des culottes ‘ac la dentelle et des talons à z’aiguilles ! Et comme on dit à la place d’Armes, ton ami et ben c’est un type du milleu. Un chickeur voila t’as compris ?
- » Non, alors là scuse moi, les aiguilles, le millieu,…. Que dalle, j’ai rien compris. Mais ça que je sais, si ça qu’tu dis c’est vrai, j’va aller te trouver le Gino pour lui en chanter quatre. Ah pour mentir y l’est bon, et me faire envaler des sonnettes que c’est pas des poules, à moi que je suis pas tombé ‘ac la pluie de l’ année darnière, Aller Tonin je me taille, que je dois rendre service à ma mère pourquoi je vais l’amener à la poste. A doit retirer quelques sous t’sur son livret, pour que moi je m’achete un peu du linge pour l’été! Aller à un de ces quatres Oualio !
- » Vas y o Frade mais entention main’nan te sais que les poules de Titin a z’ont des dents !
Août 2022 Georges Barbara
|
|
Algérie catholique N°8, 1936
Bibliothéque Gallica
|
Les Vestiges du Christianisme antique
dans le Département d'Alger

Malgré l'obscurité qui enveloppe les premiers temps du christianisme africain, on peut supposer, avec la plus grande vraisemblance, que deux points de la côte africaine ont été évangélisés les premiers : Carthage et Césarée, l'actuelle Cherchell. Ports actifs, tous les deux largement ouverts aux influences orientales, ils ont accueilli, dans le cours du deuxième siècle sans doute, les premiers adeptes de la foi nouvelle.
Pour Carthage, les renseignements archéologiques et historiques sont assez nombreux et concordants.
Pour Césarée et pour la province de Maurétanie Césarienne dont elle était la capitale, les débuts du christianisme sont moins connus. Le document le plus anciennement daté de la région est une épitaphe de Tipasa : elle fait mention d'une chrétienne, Rasinia Secunda, morte le 17 octobre 238.
Une autre inscription de Cherchell est plus intéressante encore. Elle rappelle, en six vers, la donation faite à l'Eglise de Césarée par un personnage de rang sénatorial, Marcus Antonius Julius Severianus, d'un terrain destiné à servir de cimetière à la communauté chrétienne. L'inscription faite par un certain Evelpius est d'ailleurs très postérieure à la donation. Que dit-elle ?
« Un adorateur du Verbe a donné l'area (l'enclos) pour les sépultures et a construit la cella (la chapelle) entièrement à ses frais. A la Sainte Eglise, il a laissé ce monument. Salut, mes frères au cœur simple et pur. Moi, Evelpius, je vous salue au nom du Saint-Esprit.»
On a de fortes raisons de penser qu'il s'agit là du martyr Severianus qui fut brûlé vif à Césarée avec sa femme Aquila, un 23 janvier, sous le règne de Valérien ou peut-être de Septime-Sévère. La donation remonterait donc à la première moitié du Il° siècle.
D'ailleurs la présence sur des sculptures chrétiennes de l'ancre, symbole de l'espoir du salut, à côté de l'olivier et de la colombe, la colombe de l'arche, est un indice de plus en faveur de l'antiquité du christianisme à Cherchell.
De la Capitale et des ports, la religion nouvelle a pénétré dans la province. Mais à la différence de la Numidie qui s'étendait loin vers le Sud au-delà même de l'Aurès, la Maurétanie Césarienne offre l'aspect d'une bande assez étroite de territoire, allongée parallèlement au rivage de la mer et qui va en se rétrécissant de plus en plus vers l'Ouest. A l'Ouest d'Alger la Romanisation n'a guère dépassé, vers l'intérieur, les limites du Tell.
Aussi dans le département d'Alger, est-ce le long de la côte et dans les ports que les plus beaux vestiges de l'antiquité chrétienne ont été retrouvés.
Il faut faire cependant une exception pour la vallée du Chélif. Voie de passage très fréquentée à travers la province, de bonne heure elle a été peuplée de villes florissantes. L'une d'elles, Castellum Tingitanum, la moderne Orléansville, possède les vestiges d'une basilique construite en 324 : la plus ancienne église chrétienne authentiquement et explicitement datée.
Les admirables mosaïques qui en recouvraient le sol, l’inscription commémorant la construction de la basilique, l’épitaphe de l'évêque Reparatus, inhume dans l'église en 475, un siècle et demi après sa construction, tous ces vénérables témoins d'un christianisme à son apogée ont été pieusement restaurés et placés dans la nouvelle Eglise d'Orléansville.
Ils nous prouvent que peu de temps après la fin des persécutions, douze ans à peine après ce que l'on appelle communément « la paix de l'Eglise », sous le règne de l'Empereur Constantin, la communauté chrétienne de Castellum Tingitanum était assez florissante et assez riche pour construire un édifice de vastes dimensions et pour l'orner de mosaïques dont l'intérêt religieux et artistique a inspiré une belle étude, sur le point de paraître, de M. l'Abbé Vidal, Curé d'Orléansville.
Il faut aussi faire mention de la découverte assez récente d'un monastère, non loin de la frontière méridionale de la province. Il se trouve à Aïn-Tamda, entre Rapidum, l'actuel Masqueray et le centre de Stéphane-Gsell, sur !a route qui menait d'Aumale à Berrouaghia, d'Auzia à Tanaramusa Castra.
A côté d'une église de petites dimensions, s'étendait un bâtiment rectangulaire de 60 mètres de long sur 30 de large. L'unique entrée de l'édifice était percée dans le mur Est. Un couloir conduisait dans une grande cour, autour de laquelle s'ouvraient de grandes pièces de longueur variable, mais large de 4 m. 50.
Plutôt que de cellules, il s'agit de dortoirs M. Seston, l'auteur de la découverte, dans un article des Mélanges de l'Ecole de Rome de 1936, compare cet édifice aux monastères retrouvés en Syrie. Il est, en tout cas, à rapprocher de ceux de Timgad et de Tébessa, dont il est loin cependant d'égaler l'importance.
Après cette courte incursion vers le Sud de la province, il nous faut revenir sur le littoral où nous trouverons des monuments dignes de retenir notre attention.
Dans la Capitale Césarée, sauf l'inscription de Severianus, que nous avons mentionnée plus haut, et quelques épitaphes chrétiennes, il reste peu de vestiges chrétiens. Le fait est dû à la superposition des deux villes, la moderne et l'antique, qui rend les fouilles extrêmement délicates. Il est juste cependant de rappeler la belle mosaïque placée dans le chœur de l'église actuelle : elle représente deux paons encadrant un grand vase eucharistique d'où s'échappent les rameaux d'une vigne touffue et chargée de grappes.
Sans la mémoire des Martyrs Marcienne et Arcadius, la communauté de Césarée n'aurait laissé à l'histoire que le récit de la défaite infligée en 418 à l'évêque donatiste Emeritus par le fougueux apôtre de l'Unité, Saint Augustin.
 Si l'histoire à Césarée est plus riche que l'archéologie, il n'en est pas de même à Tipasa. Ici les deux sciences rivalisent, ou, pour mieux dire, collaborent étroitement. Si l'histoire à Césarée est plus riche que l'archéologie, il n'en est pas de même à Tipasa. Ici les deux sciences rivalisent, ou, pour mieux dire, collaborent étroitement.
Le récit de la mort de la petite sainte Salsa, retrouvé sur un manuscrit de la Bibliothèque Nationale, a permis d'identifier la basilique élevée en l'honneur de la martyre par les fidèles de Tipasa.
Des fouilles commencées par le regretté Stéphane Gsell il y a plus de quarante ans et poursuivies par les Monuments Historiques de l'Algérie sous la direction actuelle de M. Christofle, ont mis au jour, non seulement l'emplacement du tombeau de la Sainte, mais, autour de l'église, une nécropole chrétienne admirablement conservée.
Le sanctuaire se dresse sur une colline, en dehors de l'enceinte de la ville, du côté de l'Est. Plusieurs fois remanié, il se présente sous l'aspect d'une église à trois nefs, précédée d'un vestibule à portique. Des tribunes surmontaient les nefs latérales. Au centre de la nef principale, en avant de l'autel, les restes de Sainte Salsa reposaient dans un sarcophage en marbre qui fut brutalement mis en pièces et dont les fragments ont été recueillis. Autour du sarcophage une mosaïque du cinquième siècle portait une inscription en vers : « Ces dons que vous voyez, au lieu où brille le Saint Autel, sont dus aux soins, sont l'œuvre de Potentius qui se réjouit d'accomplir la tâche à lui confiée. C'est ici que repose la martyre Salsa, toujours plus douce que le nectar, qui a mérité d'habiter toujours au ciel, en pleine béatitude. Heureuse d'accorder au pieux Potentius une faveur qui puisse le récompenser de sa peine, elle rendra témoignage de son mérite dans le royaume des cieux. »
En avant de cette mosaïque, se dressait un massif en maçonnerie, retrouvé en partie et qui devait supporter le sarcophage de la martyre. Autour régnait une balustrade dont des fragments gisaient encore sur le sol. Elle était en pierre et ajourée. Les fragments conservés composent un chrisme accosté de l’X et de l'Y.
Que sont devenues les reliques que renfermait le tombeau ? La tradition veut qu'à l'époque vandale, en 484, sous le règne de Hunéric, les Tipasiens, plutôt que de se convertir à la religion des envahisseurs, à l'arianisme, s'embarquèrent en masse pour l'Espagne avec laquelle leur port entretenait certainement des relations commerciales. C'est sans doute de cette époque que date la dévotion à Sainte Salsa qui fleurit en Espagne, dans la région de Tolède. Les quelques habitants qui n'avaient pu s'enfuir furent condamnés, à cause de leur persévérance dans leur foi, à avoir la langue et la main droite coupées. Victor de Vite raconte qu'ils continuèrent néanmoins à parler. C'est sur le récit de ce miracle que se clôt l'histoire de Tipasa chrétienne.
L'archéologie confirme que vers le VIe siècle la ville connut une décadence profonde. Ses remparts furent démantelés et, en ce qui concerne la basilique de Sainte Salsa, une chapelle de construction grossière fut élevée au cœur même de l'ancienne église qui avait sans doute beaucoup souffert de la fureur des hérétiques. Cette persévérance à maintenir un sanctuaire même au milieu des ruines, non moins que les documents fournis par la fouille, tout confirme que la basilique a été élevée en l'honneur de Sainte Salsa et que son corps dut y reposer. Peut-être la famille, encore païenne, de la Sainte avait-elle dans le cimetière préexistant une sépulture de famille dont il ne resterait que la pierre ornée d'une épitaphe païenne qui, chose curieuse, a été retrouvée au centre de l'église.
 Autour du sanctuaire, selon l'usage, des constructions s'élevèrent. L'une d'elles, vers le Sud, renfermait une chapelle et de nombreux sarcophages. Sa destination était-elle funéraire à l'origine ?
Autour du sanctuaire, selon l'usage, des constructions s'élevèrent. L'une d'elles, vers le Sud, renfermait une chapelle et de nombreux sarcophages. Sa destination était-elle funéraire à l'origine ?
L'absence de toute inscription empêche de l'identifier à coup sûr.
Bientôt au pied des murs de la basilique se serrèrent les tombes des fidèles qui désiraient reposer le plus près possible de la Sainte afin de jouir de sa protection céleste. Il s'est passé ici quelque chose de semblable à ce que l'on voit dans les Catacombes de Rome, une accumulation de sépultures auprès de tombeaux particulièrement vénérés.
Le cimetière de la colline de Sainte Salsa, presque entièrement dégagé à l'heure actuelle, est un des lieux les plus évocateurs du christianisme antique. Les sarcophages de pierre se pressent, se chevauchent, s'accumulent sur deux ou trois rangs.
Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été ouverts. Ils sont encore scellés au plomb comme au jour lointain des funérailles. Ils renferment le squelette du défunt que l'on y a couché, enveloppé dans un linceul, sur un lit de chaux, sans objets, sans bijoux, à la différence des tombes païennes.
On est frappé du caractère anonyme de ces tombes. Bien peu portent un nom. Mais cela tient peut-être à ce que, tracées sur de fragiles mosaïques, beaucoup d'épitaphes ont disparu au cours des siècles. Celles qui subsistent sont très significatives. A côté de la mensa ou table de repas funéraire qui mentionne la mémoire d'Avianius et de Bavaria, sa fille sans doute, car elle recouvrait un squelette d'homme et un squelette d'enfant, couchés côte à côte, on trouve une épitaphe en vers grecs où est déploré le sort funeste de Maxima, femme originaire de Tripoli de Syrie, qui est morte loin de sa terre natale à l'âge de trente ans. Une autre inscription est celle de Verus Icositanus, Verus l'algérois, mais qui portait aussi un surnom : l'homme de Iomnium, aujourd'hui Tigzirt. Etait-ce un Kabyle d'origine ? Januarius, négociant des environs de Biskra, a été enseveli là par son fils. Une, enfin, est très émouvante dans sa brièveté : « Una Italorum » une femme du groupe des Italiens. S'agit-il d'un pèlerinage ?
On a l'impression, en effet, que ce sanctuaire, où des miracles s'étaient produits, a connu pendant des siècles une vénération particulière.
Le champ de repos qui l'entourait a dû, bien des fois, accueillir des étrangers venus de fort loin pour invoquer la Sainte. Et certaines de ces tombes, à leur tour, ont reçu des marques spéciales de respect et d'honneur.
Au Nord de l'église, du côté de la mer, à une petite distance d'une porte latérale de la basilique, une tombe a été recouverte d'un massif de maçonnerie semi-circulaire comme ceux qui servaient de table dans les salles à manger des Anciens. Les convives s'y allongeaient sur le côté et appuyés sur le coude gauche, ils puisaient de la main droite dans les plats déposés au centre du massif. Cette partie là, en général, était recouverte d'une mosaïque portant le nom du défunt qui reposait au-dessous. Tel était le cas pour la tombe d'Avianius dont nous avons parlé plus haut. Bien que la mosaïque ait ici disparu, la table funéraire est parfaitement conservée. Elle était enfermée dans une salle quadrangulaire, aux murs percés de nombreuses fenêtres, destinées autant à donner du jour à l'intérieur qu'à permettre aux gens du dehors de contempler le tombeau. On dut y célébrer aux dates anniversaires du défunt les repas funéraires, les agapes, dont la coutume profondément ancrée dans les mœurs indigènes a si longtemps persisté en Afrique et n'a guère disparu qu'à l'époque de Saint-Augustin.
Une pierre, retrouvée près de la mensa, porte gravé en grandes lettres le mot grec qui signifie « poisson ».
Le poisson, symbole à la fois des fidèles du Christ et du Christ lui-même, puisque les lettres grecques qui forment son nom sont les premières lettres de chacun des mots suivants : Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur. »
Certains détails des tombes laissent entrevoir d'autres rites funéraires. Plusieurs sarcophages ont leur couvercle creusé vers la tête d'espèces de coupes. Elles devaient contenir de petits récipients où l'on déposait soit des fleurs, soit de menues offrandes de parfum. De petits morceaux de charbon retrouvés dans l'une d'elles peuvent laisser supposer qu'on y brûlait de l'encens.
Deux ou trois tombeaux, d'ailleurs groupés, présentent la particularité suivante : la maçonnerie en forme de caisson semi-cylindrique qui les recouvre, renferme un tuyau en terre cuite ou une amphore sans fond. Il y a là comme une communication établie avec l'intérieur de la tombe et permettant de faire parvenir des offrandes au défunt qui est censé résider dans le tombeau. Avec la coutume des repas funéraires, ces usages sont des résidus du paganisme que l'Eglise a eu beaucoup de mal à faire disparaître.
Peu de détails dénotent un souci d'art : les rares sculptures que l'on rencontre ont une signification symbolique : chrisme avec l’X et l'Y), dauphins et poissons. Une scène à plusieurs personnages, plutôt gravée que sculptée au flanc d'un sarcophage reste assez énigmatique : un taureau a lancé en l'air d'un vigoureux coup de corne, un homme qui retombe la tête en bas, en même temps qu'il foule aux pieds un homme renversé. Derrière l'animal deux hommes armés de lances contemplent la scène et sur une banderole sont écrits ces mots : « Du bonheur pour les Annii.».
Une feuille de lierre, porte-bonheur fréquent chez les païens, est représentée auprès du taureau.
Si vraiment la scène est chrétienne, si le sarcophage n'a pas été réutilisé, on peut songer à une scène de martyre et y voir deux chrétiens livrés aux bêtes.
Un sarcophage proche de la grande mensa est orné d'une inscription : « Utere felix ». Sois heureux en t'en servant !
Le sarcophage voisin de celui-ci était recouvert d'une mosaïque déposée maintenant au petit musée de Tipasa. On y voit, maladroitement figurés, Daniel dans la fosse aux lions, et à côté de personnages qui semblent en prières, Noé, dans l'arche représentée comme un coffre ouvert, accueillant la colombe qui porte dans son bec le rameau d'olivier. Cette œuvre curieuse nous fournit un échantillon de ce que l'on pouvait voir sur les tombes dans leur état primitif.
Quelque soit son état actuel, la nécropole de Tipasa, par le nombre, par la variété des tombes, par leurs détails peut rivaliser d'intérêt avec les plus beaux vestiges que nous ait légués le christianisme antique.
Il est certain que l'existence à Tipasa d'un foyer ardent de vie chrétienne et orthodoxe fut pour beaucoup dans la résistance que la ville opposa victorieusement aux assauts de Firmus, prince maure allié aux donatistes. Elle fut plus heureuse en cela que Cherchell qui fut prise et saccagée en 372.
Il est d'ailleurs d'autres vestiges de la foi vivace des Tipasiens. Sur le cap qui fait suite vers l'Ouest au promontoire que surmonte le Capitole, en un point qui s'appelle en arabe Ras-el-Knissa, le Cap de l'Eglise, on voit les vestiges d'un vaste édifice.
C'est une basilique qui mesure 52 mètres de long sur 42 de large. Elle comprenait neuf nefs. Avec ses travées relativement étroites, sa forêt de colonnes elle devait assez bien offrir à l'intérieur l'aspect que présente une mosquée. Le sol de la nef principale était recouvert d'une mosaïque qui mesurait environ 700 mètres carrés, mais dont il ne reste que des débris. L'entrée était précédée d'un portique qui s'ouvrait sur le rempart de la ville.
Ce devait être l'église principale, la cathédrale de Tipasa, car auprès d'elle on voit les restes assez complets d'un baptistère. Il comprenait des thermes où les néophytes purifiaient leur corps avant le Sacrement, puis la cuve baptismale où ils descendaient recevoir le baptême par immersion, et une chapelle où avait lieu la Confirmation. Des mosaïques qui ornaient le vestibule du baptistère, deux sont au Musée d'Alger. L'une d'elles, en vers, invite ceux qui veulent acquérir la vraie science de la vie à venir se laver dans l'eau du baptême, don céleste.
L'autre représente des oiseaux, des fruits et des poissons.
L'ensemble de ces édifices date sans doute du IVe siècle. C'est ici que sous le règne de l'Empereur Julien, vers 341, eut lieu une bagarre entre catholiques et donatistes. L'ampoule contenant l'huile sainte fut jetée sur les rochers du rivage par une fenêtre de l'église. Celle-ci, en effet, surplombe la falaise et son abside s'est en partie effondrée dans la mer.
Faisant pendant à la basilique de Sainte Salsa, s'élevait au milieu du cimetière de l'Ouest, à quelques centaines de mètres du rempart, la chapelle de l'évêque Alexandre. Il en reste peu de chose. La plupart des mosaïques qui l'ornaient sont au Musée d'Alger.
Celle qui est placée dans la cour du Musée représente sept rangées de poissons. Les autres portent des inscriptions. C'est grâce à elles que nous connaissons le nom de l'évêque qui a fait construire la chapelle : « Ce monument illustré et admiré, ces toits éclatants, ces autels que tu vois, ne sont pas l'œuvre des grands de la terre. La gloire de ce grand fait s'attache à travers les siècles au nom de l'évêque Alexandre. La renommée montre ses travaux honorables et l'on se réjouit d'avoir placé dans une belle demeure les justes des générations précédentes.
Eux qui, endormis depuis longtemps, étaient peu à peu soustraits aux regards, brillent maintenant en pleine lumière, portés par un autel digne d'eux, et se réjouissent de voir fleurir la couronne formée par leur réunion, œuvre accomplie par la sagesse d'un vénérable gardien. De tous côtés, désireuse de voir, la foule chrétienne accourt en une seule masse, heureuse de dire les louanges de Dieu, et de toucher de ses pieds le seuil sacré. Tout entière, chantant des hymnes, elle se réjouit de tendre les mains pour recevoir la communion. »
Neuf tombes étaient disposées côte à côte sur une sorte d'estrade. L'autel devait se trouver au-dessus. Dans une abside, en face de l'autel, Alexandre a été inhumé, et l'on a retrouvé son épitaphe : « Alexandre, né pour l'observation des lois et pour les autels, appelé aux honneurs dans l'église catholique, gardien de la pureté, consacré à la charité et à la paix, par l'enseignement duquel fleurit l'innombrable peuple de Tipasa, ami des pauvres, dévoué à toute aumône, qui jamais n'a manqué de faire œuvre pieuse, a son âme au Paradis. Son corps repose en paix, attendant la résurrection et sa couronne future dans le Christ, pour devenir compagnon des Saints dans la demeure du royaume céleste. »
Ces inscriptions étaient connues depuis assez longtemps lorsque les archéologues eurent la surprise de découvrir les mêmes textes appliqués avec de légères variantes à un évêque de Djemila, l'évêque Cresconius. Il faut donc admettre qu'ils proviennent d'un même modèle, un recueil d'épitaphes et des dédicaces en vers qui circulait à travers le monde chrétien.
On y retrouve, semble-t-il, comme un écho des inscriptions en vers par lesquelles à Rome le Pape Saint Damase dans la deuxième moitié du IVe siècle, célébrait les mérites des martyrs.
Une brève inscription en quelques lignes énonce le double précepte qui résume la loi évangélique : l'amour de Dieu qui porte à souhaiter le martyre, et l'amour du prochain qui commande de faire l'aumône selon ses moyens.
D'autres fidèles que les dix évêques de Tipasa furent enterrés dans la chapelle d'Alexandre. Une table d'agapes y a été construite qui, lorsque les repas funéraires eurent été interdits dans les églises, a été transformée en tombe pour un enfant d'origine germanique, peut-être un Vandale, du nom d'Ostaric.
On ne peut quitter Tipasa sans jeter les yeux sur les pièces archéologiques conservées dans le Parc Trémaux. Deux beaux sarcophages chrétiens attirent les regards. L'un, surtout, qui représente le Bon Pasteur portant la brebis égarée sur ses épaules. Aux extrémités de la cuve, deux lions dévorent des gazelles : motif ornemental ou de signification symbolique ? L'interprétation symbolique est nécessaire à coup sûr pour comprendre le second. Il est malheureusement mutilé, mais on y reconnaît encore le Christ enseignant, au centre.
De part et d'autre se déroule le cycle des saisons.
Le Printemps avec une branche fleurie et une corbeille, l'Eté avec une gerbe d'épis et une faucille, l'Automne portant une grappe de raisin vers laquelle rampe un lézard, l'Hiver, emmitouflé, portant une houe et deux canards sauvages.
A l'extrémité de droite, figure une scène mutilée où l'on croit voir soit Moïse faisant jaillir l'eau du rocher, soit le baptême du centurion Corneille.
Que signifie cette représentation du Christ entouré ainsi des saisons, sinon que Dieu préside à la marche du Temps et aux bienfaits que chaque moment de l'année apporte aux hommes ? Le motif était fréquent dans l'art païen : désormais le voici adopté par les chrétiens avec un sens apologétique.
Tel est cet ensemble chrétien de Tipasa. Tout concourt à lui donner un intérêt et un charme. Les récits qui s'y attachent, au parfum de vieilles légendes, les monuments, dans leur simplicité plus éloquente que tous les discours, et surtout le cadre, grandiose à la fois et familier, des ruines. Décor admirable, où la verdure, le ciel, la mer et la montagne forment une symphonie unique au monde.
Aussi, à côté des restes de Tipasa, la plupart des vestiges chrétiens de la côte algérienne dans le voisinage d'Alger font bien modeste figure.
A l'extrémité de la presqu'île de Sidi-Ferruch, tout au bord de la mer, s'élevait une église dont il ne subsiste presque rien. Naguère encore on y voyait les restes du baptistère attenant à la chapelle : il était possible de reconnaître dans un massif de blocage, la cuve baptismale de forme ronde, avec trois petites marches. Une chapelle voisine, aujourd'hui détruite, renfermait le tombeau d'un nommé Januarius et était placée sous l'invocation d'un martyr dont le nom a disparu. Une mosaïque y souhaitait la paix à celui qui pénétrait dans l'édifice.
A disparu également l'église fouillée à Castiglione par M. Grandidier en 1893, et publiée dans le Tome 1 du Bulletin de la Société d'Archéologie du Diocèse d'Alger. Elle possédait une crypte creusée sous. l'abside et qui servait de baptistère.
A disparu aussi l'église de Matifou dont les Turcs avaient jadis détruit les murs, mais dont M. Chardon a pu relever le plan et sauver quelques mosaïques. Elles sont au Musée Stéphane Gsell, à Alger.
Celle qui décore l'entrée du Musée représente des moutons, des béliers et des chèvres, parmi des plantes et des fleurs. Ces animaux sont gardés par deux pasteurs : l'un, debout porte une brebis sur les épaules dans l'attitude traditionnelle du Bon Pasteur et tient à la main un seau plein de lait, l'autre dont la tête est entourée d'un nimbe presque disparu, trait une brebis.
La scène prend toute sa valeur si on la rapproche d'un passage de la Passion de Sainte Perpétue, martyrisée à Carthage en 203. L'auteur anonyme prête à Perpétue le récit d'une vision qu'elle a eue dans sa prison : « Alors je vis un jardin immense. Au milieu était assis un homme à cheveux blancs, en tenue de berger, de haute taille, occupé à traire des brebis. Autour de lui, se tenaient debout des gens vêtus de blanc au nombre de plusieurs milliers. Il leva la tête, m'aperçut, et me dit : «Tu es la bienvenue, mon enfant.»
Il m'appela, et, du fromage qu'il faisait, il me donna comme une bouchée. Je la reçus, les mains jointes, et je la mangeai, pendant que tous les assistants disaient : Amen. »
Ce sont la même idée et les mêmes symboles qui inspirent l'œuvre du mosaïste et le récit de la jeune martyre.
Pour rencontrer des vestiges chrétiens qui approchent de ceux de Tipasa, il faut aller, en partant d'Alger, jusqu'en Kabylie. Dellys, l'antique Rusuccuru a fourni le plus beau sarcophage chrétien que possède le Musée Stéphane Gsell. Il figure en tête de cette étude. Divisé par des colonnes à chapiteaux en une série de niches, il offre en son centre l'image du Christ enseignant. Le Christ est figuré imberbe comme sur les peintures des Catacombes. Il tient dans sa main gauche un rouleau de parchemin à moitié déroulé, et fait de la main droite le geste du maître qui enseigne. Auprès de lui se trouvent deux disciples, peut-être Saint Pierre et Saint Paul. Une tête colossale, sur laquelle semble posé le siège du Christ, représenterait sans doute une personnification de la montagne sur laquelle fut prononcé le Sermon qui renferme les enseignements principaux du Maître.
De part et d'autre de la scène centrale se succèdent des épisodes empruntés aux Saintes Ecritures.
Ce sont, de la gauche à la droite : Daniel empoisonnant le Serpent qui était adoré par les Babyloniens ; le miracle de l'eau changée en vin aux noces de Cana ; la guérison de la femme malade d'un flux de sang ; le miracle de la multiplication des pains ; la guérison du jeune aveugle ; la prédiction du triple reniement de Saint Pierre. Cette dernière scène, où l'on voit jésus montrer un coq à Saint Pierre et lever trois doigts de sa main droite, est très curieuse dans son réalisme familier.
De Dellys proviennent encore des fragments d'un autre sarcophage où l'on voyait Daniel dans la fosse aux lions et le baptême du centurion Corneille.
Que la Kabylie ait été profondément christianisée, du moins sur la côte, la preuve en est fournie par la basilique de Tigzirt.
Les ruines de Tigzirt, qui, pour le pittoresque, le cèdent de peu à celles de Tipasa, sont les vestiges d'une cité dont le nom n'est connu que depuis peu d'années. On a longtemps cru que Tigzirt était l'ancienne Rusuccuru.
Des découvertes épigraphiques et une étude des ruines de la côte kabyle ont permis de lui restituer son véritable nom qui était Iomnium.
La petite ville occupait un promontoire à l'extrémité duquel se trouve un îlot, site admirable et qui dut être habité dès l'époque punique. Parmi ses ruines, que recouvre malheureusement la ville moderne, figure une grande église qui a été fouillée par Pierre Gavault en 1894. Restaurée de façon convenable, elle offre d'intéressants sujets d'étude. Sa longueur de 38 mètres et sa largeur de 21 mètres, la classent parmi les églises moyennes d'Afrique. Elle comprenait trois nefs, séparées par de doubles rangées de colonnes.
Une triple baie, aujourd'hui restaurée, donnait accès dans l'église.
A l'extrémité de la nef principale l'abside est surélevée d'un mètre environ. On y accédait par deux petits escaliers latéraux. Une particularité de cette église, c'est qu'une rangée de doubles colonnes sépare l'abside de la nef. De plus l'autel semble avoir été dans l'abside, ce qui est rare en Afrique.
Cette partie de l'édifice était, en règle générale, réservée au clergé. Il y a là comme un désir de séparer l'autel des fidèles qui rappelle l'iconostase des églises grecques.
Comme à Tipasa, un baptistère était accolé à l'église. Il offre la forme d'une croix à branches arrondies en absides. Il s'apparente aux chapelles en forme de trèfle, comme celle de Carthage ou de Tébessa. Cette forme cruciale se retrouvera en France à l'époque romane. La cuve baptismale, de forme ronde, mesure 1 m. 80 de diamètre, et présente trois degrés. Le bassin était flanqué de quatre colonnes. Elles devaient supporter un dais comme au baptistère de Djemila.
Le principal intérêt de l'édifice réside dans sa décoration : toutes les surfaces planes apparentes à l'intérieur de l'édifice avaient été systématiquement recouvertes de sculpture. Mais nous sommes loin de l'art classique. Ces reliefs représentent des motifs symboliques : la colombe, les poissons, un lion, un lièvre, Daniel dans la fosse aux lions, toute une imagerie d'une gaucherie naïve. Mais on trouve aussi des motifs géométriques : damiers, rosaces, couronnes, entrelacs, qui sont traditionnels dans l'art kabyle. Il y a une grande parenté entre la sculpture sur bois ou les motifs peints sur les poteries kabyles et les sculptures qui ornaient l'église d'Iomnium. C'est que les uns et les autres sont l'œuvre d'artisans qui recopiant des sujets fournis par l'art classique dans ses monuments de bonne époque ont cherché à les styliser. Le résultat est surtout très net pour les chapiteaux. Partis de la corbeille en feuilles d'acanthe, les artistes chrétiens sont arrivés aux chapiteaux à feuilles d'eau, où le détail importe moins que le dessin.
Pierre Gavault, l'auteur de l'étude de l'église, aboutit à cette conclusion que la basilique de Iomnium date de la fin du Ve siècle ou de la première moitié du VIe siècle. Elle serait donc le fruit du dernier effort du christianisme africain, après la tourmente vandale, pour reconstituer ses forces sous la protection plus nominale qu'effective, en Maurétanie, des Byzantins. Le résultat nous prouve combien les racines de la civilisation chrétienne pouvaient sembler profondes, à en juger par la vitalité des communautés de la côte kabyle. Plutôt qu'une décadence, il convient de voir dans l'art qui décore un édifice comme celui que nous venons de décrire, les premiers balbutiements d'une conception nouvelle à la fois maladroite et hardie.
Pour donner à ces aspirations leur forme épanouie, pour permettre à ces sociétés chrétiennes de survivre dans l'isolement où les laissait l'affaiblissement de la Romanité, et peut-être en eussent-elles été capables, il eut fallu la paix. L'Afrique de ces temps-là ne l'a guère connue. Révoltes, guerres intestines, invasions barbares, tous les fléaux se sont abattus sur elle. Malgré les efforts des grands Papes : Léon, au Ve siècle ; Grégoire, au VIe siècle, les liens moraux qui unissaient l'Afrique à l'Europe se relâchent de plus en plus jusqu'au jour où les invasions musulmanes vont en quelque sorte et pour plus de dix siècles, séparer l'Afrique du monde occidental et de la vie universelle.
Que de remarques concernant l'art, l'histoire, la vie sociale, les mœurs entraînerait une revue moins sommaire des édifices chrétiens. C'est qu'à ces époques de foi ardente, comme au Moyen Age, qui leur fait suite et que par bien des côtés elles annoncent, la construction d'une église met en œuvre toutes les ressources matérielles des fidèles et aussi toutes les ressources morales, intellectuelles et artistiques.
De là, ces inscriptions en grand nombre qui répètent jusque sur le pavement des églises les grands préceptes de la foi. De là, ces décorations de mosaïques dont une infime partie est parvenue jusqu'à nous. De là, enfin, ces décors sculptés où revivaient, de façon concrète et mise à la portée de tous, les épisodes les plus célèbres des Saintes Ecritures.
Pour être moins bien partagé que la région de Constantine, le département d'Alger possède de beaux vestiges du christianisme antique. Il faut souhaiter d'ailleurs que l'archéologie n'ait pas dit son dernier mot en ces matières et que des découvertes nouvelles nous fassent avancer encore plus profondément dans la connaissance de ces époques à la fois si lointaines et si proches de la notre.
Louis LESCHI,
Professeur à la Faculté des Lettres,
Directeur des Antiquités de l'Algérie.
| |
Quand on a un nez, on est bien obligé de s'en servir.
BONJOUR N° 6 du 10 novembre 1936
journal satyrique bônois.
|
|
Notre Théâtre Municipal est une écurie, nous l'avons déjà dit et personne n'a protesté. Mieux ! Tout le monde nous a approuvé.
Son « confort » répond à son aspect extérieur. Lézardes et surfaces lépreuses au dehors, laideur exposée comme à plaisir sur la plus belle place de notre ville ; poussière qui date de la conquête, incommodités de tous genres et, aussi, dit-on « petites bêtes » à l'intérieur.
Tout cela est peu ragoûtant et nous connaissons des personnes, nous ne l'affirmons pas pour les besoins de la cause, qui ne vont plus au Théâtre et qui déclarent nettement que c'est à cause de son mauvais entretien.
Mais, depuis quelque temps, il y a pire que les désagréments des yeux. Outre la crasse et le délabrement, il faut supporter des odeurs inattendues.
Quand on va au Théâtre, on ne peut pourtant pas laisser son nez à la maison.
Lors de la représentation du jazz Bianco, nous avons entendu, autour de nous, aux fauteuils d'orchestre, des protestations parfaitement justifiées. Il régnait, par moments, une odeur difficile à supporter- -.
Nous nous sommes enquis. Depuis le changement de saison, la température de la salle, par l'agglomération qui s'y trouve, est plus élevée que la température de la scène. Chaque fois qu'on lève le rideau, il se produit un courant d'air qui vient du plateau et ce n'est pas drôle : « On en prend plus avec son nez qu'avec une pelle ! » Comme dirait l'autre. L'odeur nauséabonde est, tout à fait, caractéristique.
Elle a été identifiée par des gens mieux informés que nous et on l'impute aux urinoirs qui se trouvent, parait-il, de l'autre côté du plateau.
Un refrain du vieux Montmartre, à l'époque où l'on chansonnait Camille Pelletan, disait : « Où c'qu'y a d'l'hygiène, y a pas d'plaisir ! »
C'est une erreur des temps passés.
On peut prendre son plaisir même où il y a de l'hygiène.
Nous transmettons cette protestation à M. Qui de droit et nous sommes convaincus qu'on va faire, tout de suite, le nécessaire.
Le Gérant : P. MARODON
| |
Le chien "Perdreau"
Envoyé Par A. Algudo
|
Le titre fait d’emblée penser à une de ces blagues à la C.. qui circulent en boucle…
Finalement beau texte et parabole bien trouvée….
Ce n’est pas la première fois que cette République trahit ses serviteurs…..
Souvenez-vous en 1961…de ces régiments d’élite gagnant la guerre d’Algérie dissous et traités comme des…
...et bien comme Perdreaux. !!..le chien.
Ces vaillants soldats sous/officiers ..officiers… devenus des parias..par la seule volonté d’un de leurs Pairs qui ne leur arrivait même pas à la cheville.
Moralité de l'histoire, mort aux cons....
===============
" Il était une fois, un imbécile qui avait un chien appelé Perdreau.
Ce chien était comme tous les chiens, c'est-à-dire qu'il ne jugeait pas son maître et lui était raisonnablement attaché.
Il lui rendait les services que rend un chien.
Il grognait quand il voyait un individu à l'allure inquiétante.
Il aboyait quand quelqu'un sonnait à sa porte.
Un jour deux types à moto descendirent de leur engin et s'avancèrent d'un air menaçant vers l'imbécile qui les regardait venir avec un sourire d'imbécile, il croyait qu'ils venaient lui demander du feu, en fait, ils voulaient lui prendre son portefeuille.
Le chien ne s'y trompa pas, il leur sauta dessus en hurlant et les mit en fuite.
L'imbécile criait « Perdreau, viens ici ! Messieurs pardonnez lui, il n'est pas méchant.
Ah la sale bête ! Tu vas voir la tournée que tu vas prendre.
Les deux voyous sautèrent sur leur moto et partirent très loin.
L'imbécile corrigea le chien qui n'y comprit rien, mais n'en continua pas moins à aimer son maître, car les chiens sont fatalistes.
Ils savent que les hommes ont des réactions illogiques.
Il y eut plusieurs incidents de ce genre, chaque fois que le chien croyait faire son métier de chien, l'imbécile lui tapait dessus et se confondait en excuses auprès des chenapans, voleurs, et bandits de tout poil que mordait le malheureux animal.
Il disait que celui-ci était idiot, sanguinaire, et qu'il n'arrêtait pas de commettre des bavures.
On a beau être chien et plein de bonne volonté, on finit par se lasser de recevoir des coups. Le chien Perdreau se lassa, cela se sut assez vite dans le quartier.
L'imbécile habitait un pavillon, une nuit, un cambrioleur escalada le mur, le chien entrouvrit un œil dans sa niche pour chien et le referma, incontinent.
Le cambrioleur cambriola en toute tranquillité.
L'imbécile s'arracha les cheveux et corrigea le chien, lequel reçut philosophiquement sa correction, n'étant pas à une inconséquence près de la part de son patron.
Une autre nuit, ce fut un autre cambrioleur qui vint, ce cambrioleur-là avait un surin qu'il planta dans la bedaine de l'imbécile qui en mourut.
En partant, l'assassin caressa le chien en disant " bon toutou ".
Le chien pensa, car les chiens pensent : " Voilà la première parole aimable que j'ai entendue depuis longtemps ".
Cette histoire est celle des Français, de leur Police et de leurs élus. Ils s'étonnent de ne pas comprendre la désaffection du peuple Français ?
Exemple :"Sur une route où la vitesse est limitée à 50 km/h le quidam Franchouillard qui roule à 51 km/h est un ASSASSIN.
Il n'a aucun recours.
Ceux qui brûlent 400 voitures, qui incendient les véhicules de police, qui jettent des pierres sur les forces de l'ordre et les pompiers sont conviés avec tous les égards à l'Élysée pour exposer leurs revendications...
"Ils battent leur chien depuis trente ans, et s'étonnent aujourd'hui que le chien ait des états d'âmes.".
Jean DUTOURD, de l'Académie Française.
Ce texte de jean Dutourd, célèbre académicien et ex-pensionnaire des grosses têtes, est d' actualité... je le dédie à tous ceux qui nous gouvernent, à tous les penseurs qui vomissent sur les forces de l'ordre et manipulent l'opinion, à tous les représentants du show-biz qui vivent dans les beaux quartiers (ou à LA) et s'expriment sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, avec leur propre pub comme seule motivation, à tous les journaleux qui aiment jeter de l'huile sur le feu pour faire monter les audiences, à tous les bourgeois de gauche caviar qui critiquent mes camarades en rotant du champagne dans leur luxueuse propriété, à tous les magistrats qui ne condamnent pas les fauteurs de troubles et ne soutiennent pas les auxiliaires de justice que sont les forces de l'ordre, etc. etc. …
A force de leur taper dessus, ceux qu'on appelle les "flics" feront bientôt comme le chien de l'imbécile et laisseront faire …
| |
L’Insurrection de Mokrani
Bachaga de la Medjana
Maurice VILLARD
rédacteur en chef honoraire de I’ACEP-ENSEMBLE
ACEP-ENSEMBLE N° 294-Février 2015
|
|
Chapitre 2
LE KHALIFAT AHMED-EL- MOKRANI
La nouvelle de l'entrée des Français à Alger fut vite connue dans toute la Régence. L'oligarchie turque, renversée avec ce dernier Dey, n'avait ni racines ni sympathies dans le pays. Le retour dans les tribus des contingents vaincus provoqua partout des désordres et des révoltes.
Le Dey Hussein était à peine embarqué qu'en dehors de l'étroit territoire occupé par nos troupes et des cantons jusqu'alors indépendants, l'anarchie menaçait I'existence de la société indigène. Mais presque aussitôt, les personnalités politiques ou religieuses, en pays arabe, et les anciens des tribus en pays berbère, s'entremirent pour reconstituer soit les fiefs héréditaires, soit les confédérations démocratiques ou guerrières, que le despotisme et la politique des turcs avaient amoindri ou brisé.
Compétition entre l'élément maraboutique et la noblesse d'épée pour s'accaparer du vide laissé par le départ des turcs.
En dehors de ces confédérations, établies surtout dans les massifs montagneux peu accessibles, la noblesse d'épée et l'élément maraboutique furent tout de suite en compétition d'intérêts, chacun voulant accaparer au profit de sa caste la direction des masses affolées qui cherchaient des maîtres et des protecteurs.
Dans l'Ouest, l'élément maraboutique triompha. Aux luttes fratricides entre l'élément musulman il opposa la défense sacrée de l'Islam, et montra le pouvoir politique comme devant revenir de droit à ceux qui se seraient le plus distingués dans la guerre sainte contre les chrétiens envahisseurs. Dès le début, les marabouts de l'ouest entrevirent ce qu'on appela plus tard l'ère des cherfa, et, préparant la voie à Abd-el-Kader-ben-Mahieddine encore ignoré. Ils nous forcèrent à conquérir les armes à la main, et parfois tribu par tribu, la majeure partie de territoire à I'ouest du méridien d'Alger, et cela, malgré l'appoint considérable que nous donnèrent les douars et smala, dont l'élément maraboutique n'avait su se concilier ni l'affection ni les services.
Dans l'est et dans tout le Sahara, la noblesse d'épée garda la prééminence sur les marabouts. Là, les djouads avaient en effet plus qu'ailleurs conservé leur autorité politique, leurs privilèges et, leurs influences. Par les grands fiefs, reconnus comme cheikhats héréditaires, ils détenaient en réalité tout le pays, de Médéa à la frontière tunisienne, et la suzeraineté des beys du Titteri et de Constantine était bien plus nominale qu'effective.
Il y avait en outre, en 1830, à la tête du beylik de Constantine, un homme d'une réelle valeur, entouré de conseillers intelligents qui surent tirer partie de la situation et furent servis par les circonstances. Au lieu de commettre la faute comme ses collègues du Titteri et d'Oran, de demander une investiture ou un secours aux chrétiens victorieux, ce qui heurtait le sentiment islamique et faisait le jeu des marabouts, le bey Ahmed se posa en défenseur de la foi, et utilisa les rouages existants et les alliances familiales avec les grands feudataires du beylik. Sachant bien qu'avec les musulmans toute innovation est dangereuse, il ne se proclama pas indépendant et affecta d'agir en qualité de khalifat successeur du Dey renversé, attendant disait-il, du sultan de Stamboul des secours et le titre de Pacha. Cette attitude à la fois correcte et habile lui fut facilitée par une déclaration solennelle du chikh-el-Islam de Constantine, qui, au nom du mufti, des imams, des jurisconsultes et des notables de la ville, publia une fetoua ou consultation disant en substance que « telle était la conduite que devait tenir le Bey pour sauvegarder les intérêts de la religion et empêcher l'anarchie ».
Les circonstances étaient graves. En effet, à la nouvelle de la prise d'Alger, les janissaires de Constantine s'étaient retirés sur le Mansourah et avaient proclamé bey Mahmoud, fils de l'ancien bey, Tchakeur. II était, disaient-ils, déshonorant que des Turcs obéissent à un couIoughli, à un sang mêlé. Beaucoup d'habitants de Constantine s'étaient immédiatement ralliés au nouveau Bey et avaient fermé les portes de la ville pour empêcher la rentrée d'Ahmed-Bey.
Celui-ci avait quitté Alger accompagné d'Ahmed-el-Moqrani et des contingents de la Medjana. En arrivant aux Bibans, il avait appris qu'un Moqrani des Ouled-Gandouz s'était mis à la tête d'un mouvement insurrectionnel dirigé contre lui par les grandes tribus des Ameur, des Abdenour et des Télaghma, aidés des qbaïls des montagnes voisines de Sétif.
A cette nouvelle, le Bey s'arrêta, et, en même temps qu'il dépêchait des émissaires à ses parents, les Bengana de Biskra, pour leur demander des secours, il expédiait à Ben-Gandouz une très longue lettre se terminant par la promesse de Ie nommer chikh de la Medjana et par une invitation à venir conférer avec lui. Ben-Gandouz se laissa prendre à ces belles paroles, et il arriva au camp du Bey, qui le maintint prisonnier.
Cette trahison, exécutée sur le territoire de sa principauté, indisposa le vieux chikh ben-Abdallah-el-Moqrani et son fidèle lieutenant Abdesselem, qui déjà voyaient d'un mauvais oeil la faveur croissante de son rival Ahmed-el-Moqrani, néanmoins ils laissèrent le Bey traverser tranquillement la Medjana.
Celui-ci arriva sans encombre au-delà de Sétif, l'arrestation de Ben-Gandouz avait fait avorter le plan des rebelles, qui n'osèrent d'abord attaquer le Bey. Mais Ben-Gandouz-el-Moqrani avait sa fille mariée au caïd des Ameur, Salah-ben-Illès, et, quand cel1e-ci connut l'aventure de son père et l’inertie des Ameur, elle se mit à parcourir à cheval les campements de son mari, et, Ie visage découvert, les cheveux épars, elle appelait les guerriers à la délivrance de son père. Cet acte insolite, l'éclatante beauté et l'exaltation de la jeune et noble dame, firent un tel effet que, le surlendemain, au point du jour, le camp du Bey, installé à Dra-el-Toubal, chez les Ouled-Abdelnour, était cerné par plusieurs milliers de cavaliers. Le bey Ahmed leur envoya des agents sûrs et discrets qui engagèrent 1es rebelles à parlementer. Il reçut des députés qu'il acheta à « prix d'argent » et l'attaque fut remise au lendemain.
Les Ameurs sous les Turcs, disposait de mille cavaliers, ils avaient pour caïd, sous le bey Ahmed, Salah-ben-Illès, qui descendait d'un des janissaires, échappé de Zamora en 1659.
Dans la nuit, Ben-Gandouz était étranglé et enterré en un endroit du camp bien en évidence. Puis le Bey, laissant ses allumés, décampa et arriva au point du jour à Kef-Tarzout. Quand les goums rebelles, mystifiés et furieux, le rejoignirent, il leur tint tête bravement et fut secouru en temps utile par les nomades des Bengana.
Après quoi, à la tête des Sahariens victorieux, il arriva sous les murs de Constantine. Abandonné alors par les janissaires, qui allèrent rejoindre leurs camarades révoltés, le Bey campa sur le bord du Rhumel, près de I'aqueduc romain.
Les ruses, les manigances, les assassinats du Bey Ahmed
Ce fut là que la diplomatie des Bengana, admirablement servie par l'intelligente mère du bey, El-hadja-Rekia, réussit à obtenir le fetoua dont il a été question plus haut, ce qui ouvrit les portes de la ville à Ahmed.
Le premier soin du Bey, rentré dans son palais, fut de se débarrasser de sa milice turque et du prétendant Mahmoud-ben-Tchakeur, ce à quoi il réussit par la ruse et par de nombreuses exécutions. Ensuite, il songea à couper la ligue des seigneurs arabes.
Mais tous ces crimes, l'assassinat de Ben-Gandouz, l'affaire de Kef-Tarzout, et un nouveau guet-apens dans lequel Mohammed-ben-e1-hadi-Bengana, opérant pour le compte du Bey, avait attiré les Abdelnour et la Telaghma à Ain-Soltane, avaient eu pour effet de resserrer l'union de tous les anciens ennemis du Bey.
Cette fois, le vieux chikh de la Mejana, Ben-Abdallah ou plus exactement son khalifat, Abdesselem-el-Moqrani, était à la tête de la ligue avec les Ameur, les ouled-Illès, les Abdelnour, les Telaghma, les Righa-Dhara de Si-Mohammed-sghir-ben-chikh-Saad, Ies Ouled-Mosly, les Ouled-Madi du soff Ouled-Bouras, etc.
Quant à Ahmed-ben-Mohammed-el-Moqrani, il resta fidèle au Bey, et, appuyé par les ouled-Madi de l'oued-Chellal (soff de Bouaziz), par quelques fractions de l'Ouennougha, par les Righa-Guebala de chikh Messaoud, il vint grossir les contingents des Bengana et d'Ali-ben-Aïssa.
Le clan hostile au Bey Ahmed s'organise.
Mais bientôt le parti hostile au Bey de Constantine reçut des renforts inespérés. L’ancien bey Ibrahim-el-Gueritti, destitué par Hussein, arriva un beau jour chez Salah-ben-illiès, précédé de lettres apocryphes annonçant que les Français, débarquant à Bône, l'avait nommé bey de Constantine. Ibrahim était le gendre de Ferhat-ben-Said-Bouokkaz, le chich-el-Arab effectif du Sahara. Celui-ci arriva avec les Arab-Cheraga, les ouled-Sahnoun, etc.
Le quartier des rebelles fut d'abord à Aïn-Kareb, chez les Ouled-Abdelnour, puis i1 se transporta, à l'automne de 1830, à Biar-Djedid, près de Mechira.
Le bey Ahmed contre attaque
Le bey Ahmed marcha contre eux. En une nuit, son argent et la diplomatie de Mohammed-ben-el-hadj-Bengana réussirent à semer la division entre les divers chefs et à en acheter quelques-uns, entre autres Salhi-ben-Boubeghi, qui, le lendemain, fit volte-face avec les Ouled-Sahnoun au début du combat
Cette trahison entraîna la déroute générale des ennemis du Bey.
Après cette affaire, dans laquelle il reçut en pleine figure un coup de feu qui lui brisa quatre dents, Ahmed-el-Moqrani rentra dans les environs de la Medjana, et, pendant que le Bey allait guerroyer dans le sud de Biskra, il reprit, pour son compte personnel, la lutte contre Abdesselem-el-ben-Illès, qu'il réussit à rejeter momentanément vers le sud.
Offre de soumission et de coopération à la France adressées au général Berthezène à Alger.
C'est alors qu'en février 1851 Abdesselem-el-Moqrani, Salah-ben-lllès et Ferhat-ben-Saïd-ben-Bouokkaz envoyèrent au généra1 Berthezène, à Alger, des lettres dans lesquelles ils offraient leur concours et leur soumission à la France, à condition qu'on les aidât à débarrasser le pays du bey Ahmed.
A cette époque, nous n'étions pas à même d'apprécier la valeur de ces propositions, et encore moins en état de les accepter. L'affaire en resta là, pour être reprise l'année suivante, en janvier 1832, avec une nouvelle instance, par Ferhat-ben-Saïd-ben-Bouokkaz.
Quoiqu'il en soit, comme point de départ de nos relations avec les grands chefs de la province de Constantine, cette triple démarche de février 1831 est à retenir.
Déçus à cette époque de leurs espérances de soutien par la France, Abdesselem-el-Moqrani et ses alliés s'adressèrent au Dey de Tunis. Le Bey de Constantine intercepta la lettre d'Abdesselem, et, quelques années plus tard, s'étant emparé de lui par surprise, il l'emprisonna à Constantine. Cette fois encore Abdesselem ne dut la vie que grâce aux instances de sa fille, Aiouch, femme du Bey. Profitant de la captivité de son cousin, Ahmed-el-Moqrani, investi par le Bey du cheikhat de la Medjana, prit le commandement des Hachem et la direction du pays, en remplacement du vieil Ben-Abdallah, qui venait de mourir.
Renversement de situation pour la prise du pouvoir à la Medjana
En 1836 et 1837, lors des deux expéditions de Constantine, Abdesselem resta détenu à la kasba, et Ahmed-el-Moqrani combattit contre nous. Ses contingents eurent de nombreux blessés, notamment dans la retraite que couvrit, en 1836, le général Changarnier
A la prise de Constantine, Abdesselem put s'échapper à la faveur du désordre qui suivit notre entrée dans la ville. Profitant à son tour de I'absence et de l'éloignement de son cousin, resté avec le bey Ahmed, il se hâta de rallier à lui les contingents de la Medjana et de prendre possession du fief héréditaire.
Ahmed-el-Moqrani suivit quelque temps le Bey vaincu et fugitif. Il lui offrit de le conduire à la Qalaa des Beni-Abbès ou dans le Djebel-Maadid, mais le Bey préféra se confier aux Bengana, et chercher un refuge dans le Djebel-Aorès. Un peu froissé de cette préférence et n'ayant rien à faire de ce côté, Ahmed-el-Moqrani reprit le chemin de la Medjana avec ses quelques cavaliers. Il était trop tard, la place était occupée, et Abdesselem en force lui interdit l'entrée du pays. Ii alla alors chez les Ouled-Madi de I'oued Chellal, puis finit par gagner la Qalaa des Beni-Abbès, restés fidèles au soff des ouled-el-Hadj.
En décembre 1837, l'émir Abd-el-kader, que le traité de la Tafna avait sacré, aux yeux de tous les indigènes, souverain légitime des musulmans d'Algérie, vint dans l'ouennougha organiser son nouveau royaume et faire reconnaître ses prétentions sur les pays environnants.
Abd-el-Kader investit Abdesselem-el-Moqrani en qualité de khalifat de la Mediana.
Ahmed-el-Moqrani et Abdesselem allèrent à lui, se déclarant prêts à accepter sa suzeraineté si les conditions étaient à leur convenance. Abdesselem était alors bien plus en situation d'être utile que Ahmed, ce fut donc lui qu'Abd-el-kader agréa et investit en qualité de khalifat de la Medjana. Les Ouled-Gandouz reçurent aussi des caïdats dans le Hodna.
Ahmed, ne voulant à aucun prix accepter l'autorité de son cousin, essaya de le renverser, mais il ne put lutter avec succès car Abdesselem était soutenu par les Hachem, les Ouled-Madi de M'Sila, et aussi par I'élément maraboutique, et ses intérêts qui 1e ralliait à l'émir et chérif Abd-el-Kader-ben-Mahieddine.
Bientôt, aux Ouled-Abbès même, la position ne fut plus tenable, les gens des villages de Tazen, Azrou, et une partie de ceux d'lghil-Ali et de Chaourikh, lui étaient hostiles, et, pour ne pas être bloqué à la Qalaa, il dut se réfugier chez les Beni-Yadel d'El-Main.
Un jour dans une sortie contre son cousin, Ahmed-el-Moqrani fut fait prisonnier, Abdesselem se contenta de l'exiler dans Ie Hodna et de lui faire jurer de ne pas rentrer à la Medjana.
Ahmed-el-Moqrani sollicite sa soumission à la France.
Un pareil serment ne pouvait avoir une longue durée. Ahmed-el-Moqrani, à bout de ressources, songea alors à reprendre pour son compte I'alliance française que son cousin avait sollicitée huit ans auparavant. Il se rendit dans ce but chez le chikh héréditaire du Ferdjioua, Bouakkaz-ben-Achour, qui avait été comme lui un ami du dernier bey, et qui depuis s'était rallié aux Français.
Le chikh Bouakkaz encouragea Ahmed-el-Moqrani dans ses intentions de soumission. Ce dernier se mis en relation avec A1i-ben-Baahmed, caÏd des Aouassi frère de Salah-ben-Illès, qui venait d'être tué accidentellement dans une rixe des Ameur. Sur les encouragements de ce dernier, il se présenta vers la fin juillet 1838 au général Galbois, qui commandait à Constantine.
Quand il arriva, nous venions de recevoir les offres de service de Benhenni-ben-Illès, qui profitant de notre inexpérience du pays, s'était fait donner le titre de chikh de la Medjana, fonctions que d'ailleurs il n'exerça jamais.
Tout ce que I'on put faire pour Ahmed-el-Moqrani fut de le nommer caïd des Ameur. Deux mois plus tard, en septembre, Benhenni-ben-Illès ayant été tué dans une expédition contre les Righa-Guebala, Ahmed-el-Moqrani obtint le titre qu'il désirait ou plutôt celui de khalifat, qui fut inauguré officiellement le 30 septembre, et conféré à nos principaux alliés ou lieutenant indigènes venus spontanément à nous.
Nomination des khalifats dans la province de Constantine, acte d'une haute portée.
Cet arrêté du 30 septembre, aujourd'hui oublié, fut à cette époque, un acte politique d'une haute portée et le point de départ de nos relations avec les grandes familles de la province de Constantine.
Il contenait une sorte de contrat synallagmatique entre la France et ses khalifats, et les clauses de ce contrat expliquent la résistance que plusieurs d'entre eux ont apportée plus tard à des mesures qui leur parurent restrictives des hautes fonctions dont nous les avions revêtus, en échange de leur concours volontaire et spontané. Tout d'abord, il convient de remarquer que les fonctions de khalifat ne devaient être conférées que pour « le gouvernement des territoires dont la France ne se réservait pas l'administration directe » Aussi les khalifats relevaient directement du général commandant la province, dont ils étaient « les lieutenants ». Aux temps de la conquête, alors que tout était militaire en Algérie, cela les assimilait implicitement à des généraux de brigade. Ces hauts fonctionnaires avaient droit, « dans l'étendue de leur commandement, aux honneurs attribués au khalifat sous le gouvernement du Bey »
Ils nommaient les cheiks des tribus soumises à leur autorité et présentaient leurs candidats pour les emplois de caïd, qui restaient à la nomination du commandant de la province.
Ils percevaient divers impôts pour le compte de l'Etat et gardaient le tiers du hokor comme traitement et frais de représentation. Ils devaient gouverner les musulmans suivant les lois du Prophète, et enfin, ils avaient une garde particulière d'un escadron de spahis irréguliers, en partie soldés par la France.
Cinq indigènes seulement obtinrent cette haute situation dans la province de Constantine :
Ali-ben-Arssa, ancien lieutenant du Bey, khalifat du Sahel - Ali-ben-Hamlaoui, khalifat du Ferjioua, et remplacé, dès 1840, par Ouakkaz-ben-Achour, dont il était l'homme de paille, et qui avait préféré d'abord ne pas exercer de fonctions officielles - Ahmed-el-Moqrani, khalifat de la Medjana - Ferhat-ben-Saïd, et, à partir du 19 janvier 1840, Bouazid-Bengana, chikh-el-Arab (un paragraphe de l'arrêté spécifiait que le chikh-el-Arab avait rang de khalifat). - Ali-ben-Baahmed, caïd el Aouassi, nommé khalifat un peu plus tard.
Le caïd des Hanencha, ancien chikh héréditaire et celui des Ameur avaient d'après I'arrêté, la même situation que les khalifats, sauf l'escadron de spahis.
Les escadrons de spahis des khalifat avaient chacun cent cavaliers et quatre sous lieutenants indigènes. Ils s'équipaient et se montaient à leurs frais, et n'avaient pour distinctive, suivant l'arrêté « qu'une flamme bleue sur la tête », en réalité, leur uniforme fut le burnous bleu
Dispositions prises par la France, pour gouverner dans ces territoires.
Sous les Turcs, Ie beylik de Constantine se composait de: onze grands fiefs héréditaires reconnus, dont 1es chefs portaient Ie simple titre de chikh, et étaient de grands vassaux avec lesquels on comptait.
Vingt caïdats de tribu, quatre caïdats de ville, dix-huit tribus, apanages du bey, et enfin vingt trois tribus reconnues indépendantes, c'est-à-dire ne relevant nominalement d'aucun chef investi par les Turcs ou reconnaissant leur suzeraineté.
Un certain nombre de petits fiefs maraboutiques étaient en fait indépendants et en bonne relation avec les turcs, qui les déclaraient exempts d'impôts.
Aujourd'hui, il peut nous paraître bien étrange que la France ait consacré et régularisé de pareilles situations à des indigènes, Mais au lendemain de la prise de Constantine, alors que l'ex-bey Ahmed tenait encore 1a campagne, alors qu'à l'ouest nous avions à lutter contre l'émir Abd-el-Kader, alors que dans la métropole l'absurde idée d'occupation restreinte avait tant de partisans et faisait refuser à nos généraux les moyens d'action nécessaire, notre intérêt nous imposait ces procédés pratiques et peu dispendieux. Ce qu'il nous fallait alors, ce n'était ni des administrateurs ni des fonctionnaires, c'était des alliés puissants et influents, des gens dont le nom, les antécédents, la situation familiale, nous fissent accepter par les populations travaillées par l'émir au nom de I'Islam.
A ces alliés inespérés, qui, venaient nous offrir des pays que nous ne connaissions pas, et dans lesquels on ne nous avait jamais vus, il eut été puéril de demander autre chose qu'un concours politique et guerrier. C'est ce que l'on fit, et, dès que notre autorité se fut affermie, il ne fut plus créé de khalifat, alors même que d'autres grands personnages vinrent se ranger spontanément sous notre autorité, avec les populations dont leur familles avaient eu jusqu'alors le gouvernement effectif.
Ceux-là, dans la province de Constantine, furent de simples caïds, c'est ce qui arriva aux anciens chikhs héréditaires de l'Aurès, du Bellezma, de Qsar-Tir, du Zouagha, du Dir et des Guerfa. Leurs caïdats au début furent immenses, mais ils entrèrent, dès Ie premier jour, à notre service comme fonctionnaires et non comme alliés.
Les deux plus grands commandements de khalifat furent, en 1838, celui du chikh-el-Arab, à qui on donna tout le Sahara (y compris le Djérid, qui est et a toujours été tunisien) et celui de la Medjana, qui comprenait tout le territoire s'étendant entre Ie khalifat du Ferdjoua à l'est, l'arrondissement du chikh-el-Arab au sud, et la province du Tittery à l'ouest. Parmi les principales tribus explicitement désignées dans l'arrêté de nomination se trouvaient celle du Hamza, celle de Bou -Saâda et celle du Hodna.
Le double de cet arrêté du24 octobre, fut, à cette date, remis en grande cérémonie à Ahmed-el-Moqrani par le maréchal Valée, dans le palais de Constantine.
Le procès-verbal de cette remise et la prestation de serment du khalifat furent signés par dix sept personnes.
Moins de deux mois après son investiture, le khalifat Moqrani se faisait fort de faire passer à travers les Bibans deux colonnes françaises qui seraient parties d'Alger et de Constantine par Sétif, opération que le gouvernement voulait faire afin d'affirmer ses droits sur un pays que l'Emir s'attribuait, en vertu d'une interprétation discutable des stipulations si étrangement libellées du traité de la Tafna.
La colonne de Constantine, commandée par le général Galbois, se mit en route par Djemila et arriva à Sétif, sans coup férir, Ie 15 décembre 1838, mais celle d'Alger ayant été immobilisée par les pluies, l'expédition fut remise à l'année suivante.
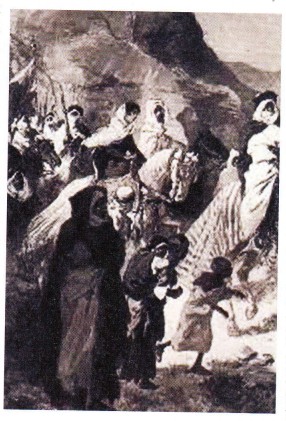 Le khalifat profita de ce retard pour consolider ou étendre ses alliances, et les circonstances favorisèrent ses démarches. En effet, au commencement de 1839, er à la suite d'un échec infligé à Abdesselem, près du Djebel-Youcef, parle chikh de Qsar-Tir, chikh Messaoud, chef indépendant des Righa-Quebala, l'émir Abd-el-kader avait rappelé son khalifat à Médéa, et I'avait remplacé par Ahmed-ben-Omar, le propre khodja d'Abdesselem-el-Moqrani. C'était la mise en pratique, par l'Emir, de la substitution de l'élément maraboutique à la noblesse d'épée dans la direction des affaires. Pour quelle raison Abdesselem-el-Moqrani accepta-t-il l'humiliation d'avoir à s’incliner devant son secrétaire, on ne le sait pas au juste, mais il est permis de penser que ce fut la haine qu'il portait à son cousin, qui lui fit dévorer cet affront, dont son orgueil de djouad dut cruellement souffrir. Le khalifat profita de ce retard pour consolider ou étendre ses alliances, et les circonstances favorisèrent ses démarches. En effet, au commencement de 1839, er à la suite d'un échec infligé à Abdesselem, près du Djebel-Youcef, parle chikh de Qsar-Tir, chikh Messaoud, chef indépendant des Righa-Quebala, l'émir Abd-el-kader avait rappelé son khalifat à Médéa, et I'avait remplacé par Ahmed-ben-Omar, le propre khodja d'Abdesselem-el-Moqrani. C'était la mise en pratique, par l'Emir, de la substitution de l'élément maraboutique à la noblesse d'épée dans la direction des affaires. Pour quelle raison Abdesselem-el-Moqrani accepta-t-il l'humiliation d'avoir à s’incliner devant son secrétaire, on ne le sait pas au juste, mais il est permis de penser que ce fut la haine qu'il portait à son cousin, qui lui fit dévorer cet affront, dont son orgueil de djouad dut cruellement souffrir.
Au mois de mai 1839, le général Galbois revint à Sétif, où le Khalifat Ahmed-el-Moqrani vint au devant de la colonne avec un goum de brillants cavaliers des Hachem, Righa-Quebala, Ameur et Eulma. Le chikh Messaoud, de Qsar-Tir, l'accompagnait et venait, à son incitation, se mettre, avec les Righa de son soff, à la disposition du Général et au service de la France.
Abdesselem s'était retiré devant nos troupes et avait pris position à Sidi-Embarek.
Le colonel Lanneau met en fuite Abdesselem-el-Moqrani.
Le 25 mai au soir, le colonel Lanneau, avec trois cents chasseurs et le goum du khalifat Moqrani fort de mille cavaliers, se portait dans cette direction.
Le 26, au point du jour, Abdesselem prenait la fuite, notre cavalerie se lançant à sa poursuite jusqu'au-delà de Zemora, lui enleva tous ses mulets et une partie de ses troupeaux.
Cette belle razzia était le premier fait de guerre exécuté par une de nos colonnes en coopération avec le khalifat Moqrani. Elle eut un grand retentissement chez les Indigènes. C'était d'ailleurs un acte de vigueur remarquable, car, en vingt neuf heures, nos chasseurs et nos goumiers avaient parcouru, presque sans repos, plus de 100 kilomètres (aller et retour).
De nombreuses soumissions en furent la conséquence immédiate, et quand, au mois d'octobre suivant, le maréchal Vallée et Ie duc d'Orléans arrivèrent à Sétif, ce fut au milieu d'une véritable ovation des tribus du voisinage.
Première traversée des portes de Fer par nos colonnes.
Le 25 octobre 1839,le Maréchal et le Prince s'étaient arrêtés à Aïn-Turc, quand dans la nuit, le khalifat Moqrani vint annoncer que la route était libre.
Le 26, on campait à Bord-Medjana, dont on prit possession en plaçant cinquante tirailleurs dans les ruines de l'ancien fortin turc.
Le 28, la division d'Orléans traversait les Bibans que les Turcs avaient nommé les Portes de Fer, et arrivait à Alger le 2 novembre.
Au point de vue de notre action politique en Algérie, cette marche militaire avait une grande portée. La présence à la tête des troupes d'un prince cher à l'armée d'Afrique fit qu'on donna à ce fait un énorme retentissement, et notre khalifat de la Medjana fut I'objet d'une considération toute spéciale.
En réalité, s'il avait été actif et habile, il avait surtout travaillé en vue de la restauration de son fief héréditaire, et il avait été très heureux de faire voir aux populations ces brillants et nombreux soldats appuyant ses droits et son autorité sur le pays.
On ne sut pas non plus, et surtout on ne raconta pas à cette époque, qu'en diplomate prudent, Ahmed-ben-el-hadj-el-Moqrani avait, de ses propres deniers, payé à ses vassaux, comme venant de nous, le fameux tribut que les colonnes turques avaient toujours payé aux riverains des Bibans.
De Médéa, le 5 novembre 1859, l'émir Abd-el-Kader nous déclare la guerre.
Le 31 octobre, trois jours après le passage du duc d'Orléans aux Bibans, deux cavaliers, envoyés par Ben-Abdesselem-el-Moqrani, arrivaient à Tagdempt ( près de Tiaret ), ayant franchi avec des relais 400 kilomètres en trente six heures, rendaient compte à l'Emir de cette expédition et de l'attitude des populations traversées.
Le 3 novembre 1839, Abd-el-Kader se trouvait à Médéa et nous déclarait la guerre. Pour faire tomber les oppositions de la féodalité indigène disposée à se rallier à la France, pour vaincre l'inertie des démocraties berbères désireuses de s'isoler de la lutte, le 20 novembre, le jour de l'Aïd-el-kébir, I'Emir, parlant avec le double prestige de chérif du Prophète, et de moqaddem des Qadria, proclamait le djihad, la guerre sainte, qui est d'obligation pour tous les musulmans dès qu'elle est proclamée.
Aussitôt la Mitidja est envahie, et partout les lieutenants ou les émissaires de l'Emir semaient la trahison et la désaffection autour de nos meilleurs agents. En quelques jours le bénéfice de l'expédition des Portes de fer était perdu.
Entouré de contingents ennemis trop nombreux, notre khalifat aurait du quitter la Medjana et regagner les Beni-Abbès, et autour de Sétif notre rayon d'action diminuait rapidement.
Pour faire face à cette prise d'armes générale, nous n'avions ni effectifs suffisants ni chef à la hauteur des difficultés.
Le maréchal Valée avait toutes les qualités qui commandent I'estime et le respect, mais ce n'était ni un homme de guerre ni un homme de gouvernement.
Il connaissait pour les avoir traversées, ces vastes plaines au sud et à l'ouest de Sétif, il avait vu à l’œuvre nos cavaliers et nos goumiers, et, au lieu de faire razzier tout ce qui en pays plat appartenait aux partisans de l'Emir, il prescrivit, afin de protéger Sétif et appuyer l'action de notre khalifat, la création d'un petit camp retranché à Aïn-Turc. Ce point ne commandait ni ne défendait quoi que ce soit , et, de plus, il était situé à quelques kilomètres seulement de montagnes habitées par des populations kabyles très denses, restées indépendantes sous les turcs, et avec lesquelles nous n'avions aucun contact.
Combats dans la Medjana et autour de Sétif contre les partisans de I'Emir.
Il y eut sur ce point, contre Abdesselem-el-Moqrani et ses contingents, une série de combats très brillants, mais absolument inutiles, notamment celui du 9 mai 1840 du colonel Lafontaine, du 9 mai du commandant Richepanse, du 11 mai, du lieutenant Bourbaki et du commandant Richepanse, du 20 mai, aux Righa-Ouebela du colonel Levasseur.
Pendant ce temps nos goums fondaient, et El-hadj-Mostafa, beau-frère de l'Emir, et Ahmed-Chérif-ben-chikh-Saad, son allié avec les Righa-Dahra, faisaient autour de Sétif, au détriment de nos alliés indigènes, une guerre de courses et de razzias qui coupaient nos communications et nous montraient impuissants à protéger nos nouveaux sujets.
Le Khalifat Moqrani guerroya sans grand succès, jusqu'au 20 mai 1840, où une sortie du colonel Levasseur et de la garnison de Sétif amena la soumission des Righa-Quebela et de Mohamed-Sghir-ben-chik-Saad, frère d'Ahmed-Chérif, chef du soff des Quebala, jusqu'à ce jour lieutenant actif d'Abdesselem et de l'Emir. Cette affaire, à laquelle notre khalifat prit une part honorable, éloigna pour quelques semaines les contingents d'Abdesselem.
Mais cette accalmie fut de courte durée, la nécessité de démonstrations armées du côté de Philippeville et d'autres points menacés nous avait forcés à réduire la garnison de Sétif et à supprimer le camp d'Aïn-Turc. Cela ressemblait à une retraite, et il n'en faut jamais avec les indigènes. El-hadj-Mostafa, khalifat et beau-frère de I'Emir, profita de cette diminution de nos troupes pour arriver de M'Sila au mois de juillet, à travers les Ayad et Bordj-Redir, il avait avec lui, disait-on, 5.000 cavaliers et 1.500 fantassins. Devant de pareilles forces, Ie khalifat Moqrani fut obligé de se replier avec sa smala dans les montagnes près de Zemora. La garnison de Sétif fut bloquée. On se battit jusque sur l'emplacement du marché et sur celui du cimetière. Depuis les Abdelnour jusqu'au Sahara, les contingents ennemis affluèrent.
Brillants combats de I'armée d'Afrique, les contingents ennemis mis en déroute.
La situation, au mois d'août 1840, était devenue critique, c'est alors que le colonel Levasseur reçut enfin les renforts qu'il sollicitait depuis quelque temps.
Aussitôt il se porta sur le camp que El-hadj-Mostefa avait installé à 20 kilomètres seulement de Sétif, à Merdj-Zerga, et battit. complètement les contingents du khalifat de l'Emir. Dans ce combat, deux bataillons de ligne, deux compagnies de tirailleurs, quatre escadrons de chasseurs d'Afrique, une demi-batterie, sept à huit cents goumiers, eurent raison de 6.000 cavaliers et de 1.200 réguliers ennemis.
Ce combat qui fut un des plus brillants de ceux livrés par I'armée d'Afrique, ne fit pas grand bruit chez les Français, mais il produisit un grand effet sur les Indigènes. El-hadj-Mostefa fut forcé de se replier à Bordj-Redir, et plus tard à M'Sila. Le khalifat Moqrani dégagea la Medjana, reprit possession de son commandement et put dès lors affirmer son autorité et aider utilement nos opérations militaires.
Le 15 octobre 1840, création de la subdivision de Sétif.
La Suite au prochain numéro
| |
Des histoires ...
... qui n'avaient émus personne !!!
PAR MANUEL GOMEZ
Envoi de M. Algudo.
|
FLN 1962 et Hamas 2023 :
même barbarie, même méthodes

L’air était doux, le soleil brillait, et cela laissait supposer une journée des plus radieuses, lorsqu’un groupe de musulmans fait irruption dans la conciergerie du stade de La Marsa, tout près de la base militaire.
Dans une véritable crise de folie meurtrière collective, les hommes s’emparent de la gardienne, Mme Josette Ortéga, une Européenne âgée de trente ans et, sans la moindre raison, faisant preuve d’une barbarie monstrueuse, ils la massacrent à coups de hache.
Couverte de plaies affreuses et dans un ultime effort, Josette Ortéga tente de s’interposer entre ses bourreaux et son petit garçon, André, âgé de quatre ans. Déchaînés, ils la frappent encore et encore puis, quand il ne reste plus qu’une loque sanguinolente, ils se jettent sur l’enfant et lui broient le crâne contre le mur.
Ils s’apprêtent à partir lorsqu’ils voient arriver une petite fille avec des fleurs à la main. C’est Sylvette, 5 ans, qui vient de cueillir les fleurs dans le jardin. Aussitôt ils se ruent sur elle et la frappent à coups de pieds et de poings puis, pour l’achever, la saisissant par les pieds, ils la fracassent contre le mur, comme son petit frère.
Quand Jean Ortéga, employé à la direction des constructions navales, franchit la grille du stade, le silence qui règne le fait frissonner. D’habitude, ses enfants accourent, les bras tendus dans un geste d’amour. Une angoisse terrible le submerge. Il s’approche lentement, regardant autour de lui puis, là, dans la cour, le petit corps désarticulé, tenant encore dans ses mains crispées des géraniums, la tête réduite en bouillie et baignant dans une flaque de sang noirâtre.
Ce n’était pas le 7 octobre 2023 en Israël mais le jeudi 1er mars 1962 dans une banlieue d’Oran, en Algérie encore française.
Ce n’était pas non plus le 7 octobre 2023 en Israël mais le 20 août 1955 à El Halia, petit village minier près de Philippeville, où les Arabes et les Français cohabitaient en parfaite osmose. 250 familles algériennes ainsi que 130 familles européennes travaillaient dans la mine, dirigée par un jeune ingénieur, M. Revenu, nommé tout récemment.
Le responsable local du FLN se nommait Zighout Youssef.
A 12 h, une katiba (bande de terroristes-égorgeurs du FLN), armée jusqu’aux dents, a massacré 123 habitants (71 européens, 52 musulmans et 120 disparus). Des bébés et des enfants écrasés contre les murs, des femmes violées et éventrées, des mères égorgées
Mais plutôt que de laisser des gens raconter ce qu’ils n’ont pas vécu, je préfère laisser la parole à Marie-Jeanne Pusceddu, qui était sur place ce jour-là. Marie-Jeanne a été recueillie, après l’indépendance, et dès son arrivée en métropole, par les sœurs de Saint-Vincent de Paul à Lacanau-les-Bains (Gironde) :
« Il était 12 h lorsque nous avons entendu des coups de feu et les youyous des mauresques. Tous les hommes travaillaient à la mine. Ma belle-sœur, Rosé, sa petite dernière, Bernadette (3 mois) dans les bras, et ses enfants, Geneviève 8 ans, Jean-Paul 5 ans, Anne-Marie 4 ans et Nicole 14 ans, sont venus se réfugier chez nous. Il y avait ma mère, mon frère Roland, 8 ans, mes sœurs Suzanne, 10 ans, et Olga 14 ans, et mon mari qui venait de rentrer pour déjeuner avec nous. Mon autre fils, Roger, 17 ans, travaillait à la mine.
*Les fellaghas ont fait irruption en cassant la porte à coups de hache. C’était Chérif qui les dirigeait. Chérif, le chauffeur de taxi, notre ami, lui qui avait assisté à notre mariage et était venu nous chercher à la gare à notre retour du voyage de noces. C’est lui qui commandait les fellaghas qui hurlaient : “Nous voulons les hommes !”
Chérif a tiré en pleine poitrine sur ma pauvre mère avec son fusil de chasse. Elle est morte sur le coup, avec Roland dans ses bras, grièvement blessé. Rosé a été tuée dans le dos et son bébé écrasé contre le mur. Ensuite Chérif a tiré sur moi et j’ai reçu la balle à hauteur de ma hanche. Olga, ma sœur, a été violée puis assassinée et mon autre sœur, Suzanne, blessée à la tête (elle en porte encore aujourd’hui la marque).
*Toute la famille Azaï a été également massacrée à coups de couteaux, la sœur de ma mère, son mari, ses deux filles, dont l’une était paralysée, et son autre fille, qui arrivait de France en vacances, déchiquetée à coups de couteaux avec son bébé.
*A la mine, le massacre s’est poursuivi. Mon frère assassiné, mon cousin Julien également alors qu’il se trouvait au restaurant. Pierrot Scarfoto, à coups de fourchette et les testicules coupées et enfoncées dans la bouche, tout comme mon neveu, René. Mon père, sourd de naissance, blessé s’est réfugié dans une galerie abandonnée où on ne l’a retrouvé mort que 15 jours plus tard. 13 membres de ma famille abattus ce même jour. »
Le 19 mars 1962, je jour même de la signature des « Accords d’Évian », à Eckmühl (Oranie) 16 européens, dont 3 femmes, enfermés dans un hangar, et le FLN met le feu. Ils seront tous carbonisés.
Ce n’est pas le 7 octobre en Israël mais c’est tout aussi horrible et ce sont les mêmes assassins, les mêmes égorgeurs, les mêmes éventreurs, les mêmes barbares, et cela se passait dans (encore) trois départements français, les 91, 92 et 93.
Pas une ligne dans la presse de la Métropole, par un mot, une phrase, dans les médias (radios et tv). L’Europe n’était pas bouleversée, elle était muette, aveugle.
Sans doute que « ces vies de Français d’Algérie » valaient beaucoup moins que « la vie d’un Israélien, d’un Palestinien ou d’un Français d’aujourd’hui ».
Qu’en pense notre président ?
| |
| Fleurs d'outre-tombe
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Mes yeux plongeaient plus loin que le monde réel ....
Victor Hugo
Les chrysanthèmes d'or sur les pierres tombales
Au déclin des jours d'août moelleux ont des chansons
Palpitantes sous les ramures automnales
Des ifs où le vent passe avec de noirs frissons.
Les attristantes croix sont comme enveloppées
Des mystiques blondeurs du crépuscule aimé
Qui tombe infiniment calme ... Et les mélopées
Des chrysanthèmes vont vers le ciel embrumé.
Elles parlent d'espoirs leurrés, d'amours perdus,
De tendresse trop tôt déclose, de bonheur
Effacé pour jamais, de gloires confondues
Dans le cruel Néant implacable vainqueur.
Le vol des Souvenirs en cercle papillonne
Sous les cyprès ; le vent apporte frémissant,
Les plaintifs angélus d'une cloche qui sonne
Dans le lointain avec des cris d'agonisant.
Déjà pointe au ciel des étoiles dorées,
Des étoiles d'amour, aux pâles chatoiements
Qui semblent être au cœur froidi des nuits sacrées,
Des yeux de bayadère adorés des amants !
Bientôt la lune met ses teintes sépulcrales
Sur le gazon du grand cimetière qui dort
Tandis que doucement sur les pierres tombales
Bruissent les chansons des chrysanthèmes d'or.
Bône, juillet
Ninus. Les clochettes algériennes et tunisiennes (10-08-1902)
| |
| Fête de Lella-Bôna
Envoyé par M. Christian Graille
|
On sait que les Arabes appellent les ruines d'Hippone du nom de Lella-Bôna (Madame Bône).
Madame Bôna est une sainte dont la mémoire est en grand honneur ; elle est enterrée dans les citernes dont on retrouve à Hippone les ruines colossales.
Le 3 août c'était la fête de Lella-Bôna-Bent-el-Hamra : c'était le jour où la sainte fut inhumée. Ce jour-là la mémoire de cette sainte demande du sang ; aussi lui immole-t-on des coqs, toujours des coqs rouges, parce que Lella-Bôna est fille de la rouge, Bent-el-Hamra.
Cette fête est célébrée par les nègres qui passent la nuit en divertissements dans les vastes souterrains dont tous les voyageurs ont admiré les ruines.
Le soir les bougies s'allument, le Kouskoussou est préparé par les négresses.
Le tambourin et le fifre ne cessent de faire entendre leur bruit assourdissant. Alors nègres et négresses dansent chacun de leurs côtés chacun à leur manière : d'abord les mouvements ont de la lenteur et une sorte de nonchalance puis, petit à petit, la mesure se précipite les cadences deviennent plus vives danseurs et danseuses haletants de fatigues ruisselants de sueur finissent par tomber dans un état d'ivresse magnétique au milieu de laquelle ils poussent de grands cris incohérents.
Tout cela, vu à la lueur incertaine de quelques bougies par une nuit sombre dans de vastes souterrains auxquels tous ces visages noirs donnent une certaine ressemblance avec l'enfer. Cà et là des feux allumés des femmes, des enfants accroupis le long des murs d'autres qui courent, échevelés à travers les danses.
Au-dessus de toutes ces têtes en mouvement, une voûte énorme, en partie détruite, à travers laquelle on aperçoit les étoiles du firmament et les hautes cimes des arbres qui ont poussé dans les crevasses formées par le temps dans l'extrados de la voûte.
Toute cette fantasmagorie forme un spectacle éminemment curieux et pittoresque, spectacle dont on pouvait, le 3 août, se donner le divertissement gratuit, en sortant de la ville vers huit heures du soir et s'acheminant vers les ruines d'Hippone.
Le lendemain, au point du jour, une caravane : de nègres, de négresses, de négrillons, revenait à la ville, fatiguée, mais satisfaite des plaisirs de la nuit.
La fête de cette année avait un intérêt de plus que l'intérêt habituel : le cheikh des nègres s'était marié et sa nouvelle épouse avait voulu se charger de faire les honneurs de la solennité, ce dont elle s'acquittait avec toute la grâce de sa race. Le lendemain de cette fête, à la pointe du jour, les Arabes venant au marché trouvèrent sur la route, dans le voisinage d'Hippone, le cadavre d'un nègre portant au cou une large blessure. Aussitôt M. le juge d'instruction se transporta sur les lieux.
Il fut reconnu à la suite d'une première enquête, que cet homme, employé à la ferme de M. Jeantet était parti la veille pour assister à la fête de Lella-Bôna, et qu'il était porteur d'une somme de 100 francs, passés dans sa ceinture ; la ceinture et l'argent avaient été enlevés.
On reconnut également par l'inspection du cadavre l'effet instantané du coup de poignard, et que le commencement de décollation n'avait eu lieu qu'après le décès.
On attribue généralement ce crime à un nègre, compagnon de travail de ce malheureux et qui n'aurait attenté à ses jours que pour le voler.
Algérie, courrier d'Afrique, d'Orient
et de la Méditerranée (22-08-1845)
| |
| Correspondance de trois fermiers de France
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
La lettre suivante que nous publions textuellement et avec confiance, car elle porte le caractère de la plus entière franchise et renferme d'ailleurs des renseignements très précis et très intéressants sur certains détails peu connus du service de la colonisation, à Alger.
Seulement, nous avons cru devoir supprimer les trois noms que ces braves gens n'ont pas hésité à mettre au bas de leur réclamation ; on comprendra les motifs de notre réserve.
Monsieur le rédacteur,
La création de quelques villages en dehors du Sahel n'a été décidée, comme vous le savez, qu'au commencement du second semestre 1843.
A cette époque les solliciteurs de concessions ne manquaient pas à Alger ; aussi les futurs habitants de ces villages furent-ils promptement trouvés.
Nous arrivions alors de France avec nos familles, et on nous comprit au nombre de ceux qui devaient être installés.
La saison était bien avancée ; nous n'avions pas de temps à perdre pour nous bâtir une maison et nous mettre en mesure de cultiver la terre à l'automne.
Il est évident que si nous ne labourions pas cette année, il fallait vivre pendant dix-huit mois sur nos faibles économies, ce qui était impossible.
La direction de l'intérieur nous promit beaucoup, ce qui nous engagea à rejeter les propositions que nous faisaient alors MM. le baron de Vialar et Cossidon qui venaient d'être autorisés à établir un village, celui de Saint-Jules, à l'entrée de la plaine.
Nous regrettons aujourd'hui d'avoir plus compté sur le gouvernement que sur des particuliers qui auraient eu intérêt à nous traiter comme des membres de leurs familles. Le temps pressait donc, et cependant il fallut attendre, les bras croisés, pendant plus de deux mois, qu'il plût à l'administration de nous assigner des lots à bâtir. Quand les lots furent distribués, nous demandâmes les matériaux qui nous avaient été promis.
D'ajournement en ajournement, nous vîmes bientôt que si nous attendions ces secours il nous serait impossible de bâtir avant la fin de l'année.
Alors nous construisîmes à nos frais, pendant qu'avoir fait preuve d'activité de zèle, l'administration nous tiendrait compte d'une partie de nos dépenses.
Nous nous savions encore si nous nous sommes trompés ; ce qu'il y a de certain, c'est que nos maisons sont bâties nos champs sont cultivés et que les secours si solennellement promis par la direction de l'intérieur sont encore à arriver. Les lenteurs de l'administration dans la répartition des secours s'expliquent et se justifient jusqu'à un certain point.
D'abord elle donnait de l'argent aux colons pour bâtir leurs maisons.
Quelques-uns ont mangé l'argent et n'ont pas bâti. C'était un abus, et pour y remédier, on donne aujourd'hui des matériaux.
Ce qu'on y a gagné : c'est de compliquer la besogne des bureaux de retarder les constructions et de donner prise à la calomnie, car ceux qui, sont gens à manger des secours en argent, peuvent s'entendre avec les entrepreneurs et échanger leurs matériaux contre de l'argent.
Quelques-uns de ceux-ci qui ont reçu des matériaux, prétendent qu'ils sont de mauvaise qualité et ne représente pas la somme payée par l'administration.
Si ce fait était vrai, quel serait le coupable : l'employé ou l'entrepreneur ?
Nous n'en savons rien car nous n'avons pas été assez heureux pour recevoir de l'administration une somme d'argent à ceux qui ont bâti, que de donner des matériaux à ceux dont on met en doute la bonne foi ?
On éviterait ainsi des accusations, qui à tort ou à raison sont répétées dans la ville.
Autre chose : il est question de donner des maires à ces nouveaux villages ; ces maires ne sont pas encore nommés, mais les choix sont déjà connus.
Nous avions pensé que le maire d'un village qui se crée devait être : celui qui le premier aurait bâti sa maison et cultivé son champ nous avions cru que le magistrat de colons paysans devait être un paysan lui-même, sachant ce que c'est qu'une charrue et un troupeau.
L'administration préfère des messieurs avec des grands noms dont les demoiselles portent chapeau, au bon fermier de la Beauce ou de la Picardie dont les mains sont calleuses et dont les filles ne portent que des sabots.
Les uns sont recommandés par : un préfet un général ou un député les autres ont cru que, dans un pays à défricher, la meilleure recommandation était d'y arriver : avec de bons bras avec une nombreuse famille habituée à l'avance au dur métier des champs.
Nous vous le répétons monsieur le rédacteur la direction de l'intérieur ne tient pas ses promesses à l'égard des vrais colons et les décourage par ses lenteurs et ses demi-mesures.
Elle ne comprend pas leurs besoins parce que dans tous ses bureaux elle ne compte pas un seul homme qui ait habité un village, vu une ferme, conduit une charrue.
Il est réellement malheureux que des familles, qui ont tant de besoins, surtout dans la première année, soient ainsi abandonnées à elles-mêmes alors qu'elles ont à lutter contre tous les obstacles et toutes les misères inséparables de la position que nous avons acceptée et que nous acceptons encore avec courage et persévérance, malgré les vides que les maladies ont faits depuis six mois au milieu de nous.
En nous plaignant, nous ne voulons pas décourager ceux qui voudraient suivre notre exemple, car en dédommagement des tribulations qu'il nous faut subir, nous reconnaissons que nous avons trouvé ici des terres plus fertiles plus riches que nous le croyions, et fallût-il recommencer, nous n'hésiterions pas encore ; mais les avantages qui procure le sol ne nous paraissent pas dégager l'administration de l'exécution de ses promesses.
Malheureusement, ce qui nous est personnel est aussi l'histoire d'un grand nombre de colons (1)
(1) les signataires de cette lettre sont trois fermiers de France qui n'ont quitté leurs fermes que pour être eux-mêmes les propriétaires du sol qu'ils cultivent.
L'Algérie, courrier d'Afrique, d'Orient
et de la Méditerranée (22-03-1844)
| |
" Autre" point de vue!!!!
Envoyé par M. R. Sanchez
|
|
Le VÉLO, c'est la mort lente de la planète ...
Le PDG d'Euro Exam Bank Ltd. a fait réfléchir les économistes lorsqu'il a déclaré :
Un cycliste est un désastre pour l'économie d'un pays
- Il n'achète pas de voiture et ne prend pas de prêt automobile
- N'a pas besoin d'assurance auto
- N'achète pas de carburant
- N'envoie pas sa voiture pour l'entretien et les réparations
- N'utilise pas de parking payant
- Ne cause pas d'accidents majeurs
- Ne nécessite pas d'autoroutes à plusieurs voies
- Ne devient pas obèse ...
Des gens en bonne santé ne sont pas nécessaires à l'économie
Ils n'achètent pas de médicaments
Ils ne vont pas dans les hôpitaux et chez les médecins
Ils n'ajoutent rien au PIB du pays.
Au contraire, chaque nouveau point de vente McDonald crée au moins 30 emplois - 10 cardiologues, 10 dentistes, 10 experts en perte de poids en dehors des personnes travaillant dans le point de vente McDonald.
Choisissez judicieusement : un cycliste ou un Mc Donald ? Ça vaut le coup d'y penser.
PS : la MARCHE c’est encore pire !! Ils n'achètent même pas de vélo !
| |
| Vers de jeunesse
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Une bonne fortune !
L'autre soir, par un clair de lune,
Dans la brume,
Ombre moi-même, je marchais,
Et cherchais
Espérant, dans le premier square
Où s'égare, Parfois un oiseau passager
Et léger
Rencontrer une gente dame
Sur mon âme ! Quelle fortune ! Par les cieux
Amoureux !
Je crus ... Sa main était plus douce
Que la mousse ;
Sa taille comme au bord de l'eau
Le roseau,
Se courbait sous la brise folle ;
Son épaule
De l'ivoire effaçait l'éclat
Blanc et mat.
Je crus en la voyant si belle
Qu'avec elle
Passerait bien vite une nuit
Sans ennui,
Et le plus galamment du monde,
A ma blonde,
Je dis, mon bras s'arrondissant :
" Viens-nous-en "
O lit ! Sous un rideau qui tremble
Et qui semble
Frémir ! Qu'il est doux de poser
Un baiser
Sur une bouche souriante
Et brulante !
A qu'il est doux ce chant d'amour
Las ! Si court !
Combien de fois m'embrasse-t-elle
L'hirondelle ?
Combien de fois ai-je mordu
Son bras nu ?
Fatigués, nous nous reposâmes.
Nos deux âmes
Se parlaient-elles bas après ?
Je ne sais pas.
Mais, je sais que l'essaim des songes,
Frais mensonges
Sonnait sous nos épais rideaux,
Ses grelots.
Le matin surpris par l'aurore
Qui colore
De son doigt nacré, les vallons
Et les monts
Je m'éveillai ... Quelle sorcière ...
Dans un verre
Un de ses yeux prenait un bain,
Et sa main
Qu'hier soir, je trouvais plus douce
Que la mousse
Avait des doigts longs et crochus
Plus de cheveux, de dent d'ivoire
Plus de mine,
Pour l'embellir, vrai ce n'était
Qu'un balai ! ...
La folie,
L'amour veux-je dire, nous conduit,
On le suit
Croyant atteindre un beau rivage.
Un naufrage
Nous attend : comment revient-on
Cher P.... ?
On revient le front couvert de rides,
Le cœur vide,
Se rire des jours heureux,
Amoureux !
B.... Les clochettes algériennes et tunisiennes (10-08-1902)
| |
| Aperçu de la colonisation.
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Main-d’œuvre
La main-d’œuvre coûte à peu près le double des prix de France pour les manœuvres et le triple pour les ouvriers d'état. C'est sans doute une gêne : si les prix étaient les mêmes que ceux de France, on pourrait faire beaucoup de choses que l'on ne fait pas ; les bénéfices seraient plus considérables sur les opérations que l'on fait maintenant.
Mais qu'importe si, avec ces prix, les bénéfices, tels qu'ils existent, peuvent offrir une ample satisfaction au spéculateur ! C'est sous l'influence de cette idée qu'il est à propos, nous le pensons, d'examiner cette question.
La base de la main-d'oeuvre c'est le prix de la journée. Nous allons donc ici dresser la nomenclature des salaires dans les principaux états.
Maçons, charpentiers : Les maçons sont tailleurs de pierre, charpentiers etc., payés 5 à 6 francs par jour : leurs prix les plus modérés sont pour les ouvrages de ville ; leurs prix les plus élevés quand ils vont travailler à la campagne, surtout lorsque c'est un peu loin.
Presque tous ces ouvriers viennent du Nord de l'Italie et du Tessin.
Charretiers, Maîtres valets : Les charretiers sont diversement payés aux environs immédiats d'Alger. Le commun des charretiers reçoit 30 francs par mois la nourriture le logement ou bien simplement une somme de 70 francs. Mais ceux qui ont quelque surveillance à exercer ou qui sont chargés de transport de routage, reçoivent un peu plus, comme 40 à 45 F par mois et nourris ou seulement 80 à 85 F
A mesure que l'on s'éloigne de la ville, ce prix augmente, et nous avons vu, dans la Mitidja des charretiers principaux payés 60 F par mois et nourris seulement 100 F par mois. Le commun des charretiers était alors payé de 80 à 90 F par mois. Maintenant on emploie indistinctement comme charretiers des indigènes ou des Européens et sans différence de prix.
Manœuvres européens. Il n'en est pas de même pour les manœuvres terrassiers et autres ; les indigènes sont payés beaucoup moins chers que les Européens. Le prix ordinaire du manœuvre européen est tombé maintenant à 2 F 50 c., sans nourriture, et même plusieurs colons notamment : M. Vialar à Kouba en ont parfois employé à 2 F ; mais dans le fort de l'ouvrage, surtout au moment des foins, ces prix changent complètement : un faucheur dans le massif demande encore 5 F par jour, et dans la plaine on lui donne ces 5 fr., on le nourrit et on l'abreuve à discrétion ; car en toute espèce d'ouvrage, plus on s'éloigne du centre, plus il devient cher.
Manœuvres indigènes. Quant aux manœuvres arabes on les paye depuis 1 fr. jusqu'à 1 fr. 50 c., et de plus, en tout cas on leur donne chaque jour un pain de munition de 30 c.; mais cette différence de prix est généralement compensée par la différence d'ouvrage, car ils sont fort paresseux, et surtout par la différence d'intelligence et d'habitude dans les travaux ; il est même certaines choses auxquelles on ne peut les employer, comme par exemple, à faucher : ils n'en avaient jamais eu la notion avant nous, et n'ont pas encore pu s'y former. Ils sont par exemple : bons moissonneurs et excellents pâtres ; un pâtre kabyle se paie 1 F par jour, plus le pain de rigueur. Maintenant il est inutile de prévenir que les travaux ne s'exécutent pas, la plupart de temps, avec cette forme de salaire ; ils sont ordinairement payés à la tâche : ainsi le quintal de foin coûte 1 F à faire faucher.
La maçonnerie se paie, au mètre cube 4 F 50c. à 45 F, ainsi des autres.
Ces différentes formes de prix trouveront leur place au fur et à mesure qu'il sera besoin de les montrer.
Conclusion: Qu'il suffise ici : d'avoir indiqué dans le prix de journée de chaque ouvrier la base de tous les prix d'ouvrage d'avoir montré que les ouvriers ne manquaient point en Algérie à ceux qui voulaient faire exécuter quelques travaux.
Aperçu sur la culture et la colonisation
de l'Algérie par MM E Rameau et L. Binel (1844)
| |
| Vendetta
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Les titres de propriétés
Il était 9 heures du soir et l'agent Paoli venait de prendre son service de nuit.
Après avoir allumé une cigarette, il s'assit sur un banc de la place publique, à proximité d'un réverbère et tire de la poche de sa capote une lettre que son brigadier venait de lui remettre au bureau pendant qu'il s'apprêtait à sortir.
Il brisa le cachet, et à peine eut-il lu quelques lignes que son visage se couvrit d'une pâleur cadavérique et se yeux brillèrent soudain d'une lueur fauve, pareils à ceux d'un jaguar.
Néanmoins il continua jusqu'au bout la lecture de la missive. Puis se passant la main sur les yeux, comme pour en écarter un voile, il murmura, les sourcils froncés : " Jura à Dio ! J'en aurais le cœur net ! Cependant ! Eh ma foi ! Il est vrai que cette lettre anonyme peut mentir, mais il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'elle dise la vérité ; d'ailleurs il ne me coûte rien de m'en rendre compte.
" Quoi Mathilde me tromperait avec un ami intime ! D'après ce que dit ce papier.
Comme ami intime, je n'ai pas d'autre que mon cousin Pandolfo. Si le malheur que cela fut. Jura la Madonna ! Je les tuerais tous les deux comme deux poulets!"
Et sa main crispée caressa la crosse de son revolver.
Une heure après, l'agent Paoli, montait en chancelant l'escalier qui le conduisait à son logement, ses mains tremblaient lorsqu'il frappa à la porte de sa demeure.
Du dedans il lui semble entendre chuchoter tout bas : il colla alors son oreille au trou de la serrure et écoutant en retenant son haleine.
Ses jambes se dérobaient sous lui et un léger tremblement le secouait.
Dans sa poitrine, son cœur sursauta tumultueusement, il resta ainsi quelques minutes qui lui parurent un siècle.
Puis plus rien ! Le silence le plus complet.
L'agent Paoli frappa de nouveau à la porte. Alors, il entendit murmurer quelques mots, et il lui sembla entendre marcher pieds nus ; puis on ouvrit avec précaution la porte du water-closet qui se trouvait intérieurement près de la porte d'entrée, et dans lequel une croisée était pratiquée qui donnait sur un terrain vague.
Puis une douce voix demanda de l'intérieur. " Qui est là !
Ouvre ! C'est moi ! Dit l'agent, cherchant à donner à sa voix une intonation mielleuse qu'il n'obtint que médiocrement.
Aussitôt on lui ouvrit. Paoli sans dire un mot referma la porte. Et il voulut ouvrir celle du water-closet ! Elle était fermée en dedans ! Alors il voulut l'enfoncer ! Mais un bruit lourd lui démontre qu'on venait de sauter par la fenêtre.
Alors il prit le poignet de l'épouse adultère et la traînant dans la chambre à coucher, il lui dit brutalement, en jetant un coup d'œil investigateur sur le lit défait et bouleversé.
" Qui était avec toi ?
Personne !
Et ça ! A qui appartient-il ? "
Et il montrait à la malheureuse une cravate en soie crème dont elle avait fait cadeau à Pandolfo quelques jours avant en l'honneur de sa fête.
L'infortunée ne répondit mot, et baissait les yeux en frissonnant.
Alors lui, d'une voix terrible " C'est donc vrai ! C'est le cousin Pandolfo ! ! "
Et tirant son revolver, il fit feu sur sa femme qui fut atteinte au milieu du front, et tomba, baignée dans son sang !
Ensuite il alla au commissariat de police, raconta tout, et se constitua prisonnier.
Le surlendemain, pendant qu'on portait en terre les restes de l'épouse infidèle, on opéra à l'arrestation du cousin Pandolfo.
Après quelques mois de présence ils passèrent aux assisses.
L'agent Paoli et Pandolfo, furent acquittés. Mais Paoli, les yeux hagards, et d'un air menaçant dit à Pandolfo, en sortant du palais de justice :
" La justice est aveugle ! Elle t'a acquitté ; mais moi je t'ai condamné ! Tiens-toi averti ". ! ! !
Pandolfo fut pris d'une frayeur telle, qu'il s'embarqua le jour même pour Ajaccio. Mais quelle ne fut sa surprise lorsqu'il vit un soir sur les quais un individu qu'il reconnut parfaitement pour être son cousin Paoli.
Alors de nouveau il s'embarqua pour la Tunisie et vint s'installer au Kef, où il monta une petite buvette.
Ses affaires allaient assez bien, et demi 2 ans et demi qu'il habitait cette localité, il n'avait plus entendu parler de son cousin paoli.
Un soir d'été la chaleur était accablante, Pandolfo était assis devant sa buvette, et dégustant un café il attendait la clientèle.
Il était pensif, et contemplait mélancoliquement le ciel foncé, où par des intervalles un éclair venait déchirer de ses lueurs sinistres la voûte assombrie du firmament : Soudain, un individu le toucha à l'épaule ; il sursauta.
Devant lui un Arabe drapé dans un burnous lui demanda un (kaoua, un café). Et il s'installa à sa table.
Pandolfo après l'avoir servi, voulut se retirer à une autre table, mais le consommateur lui demanda de lui faire l'honneur de lui tenir compagnie.
Bientôt la conversation s'engagea.
Pandolfo apprit que son partenaire s'appelait Ali Ben Ahmed, qu'il arrivait de Tunis, et qu'il venait au Kef pour y faire le commerce de la laine.
Puis il lui confia qu'il avait été bien malheureux, un de ses cousins lui ayant enlevé sa femme qu'il chérissait comme ses yeux ! Néanmoins il s'était consolé, mais il avait gardé une haine éternelle contre son cousin Ahmed Ben Mohamed. A ces mots Pandolfo voulut se lever.
Mais l'Arabe le saisissant par le poignet l'obligea à se rasseoir, puis rabaissant le capuchon de son burnous il le fixa bien en face. " Tu ne me reconnais donc pas cousin Pandolfo ! " Paoli ! ! ! S'écria celui-ci plus pâle qu'un mort en s'affaissant sur son siège. " Oui Paoli ! Qui te poursuit depuis presque trois ans pour venger l'honneur que tu lui as volé."
Au secours ! Voulut crier Pandolfo, mais il retomba aussitôt le cœur percé par un couteau kabyle sur le manche duquel était incrusté ce simple mot : Vendetta !
Antoine Garofalo.
Les clochettes algériennes et tunisiennes (25-06-1893)
| |
Ciel roux. Ciel de septembre.
De la pourpre et de l’ambre
Fondus en tons brouillés.
Draperie ondulante,
Où le soleil se plante,
Comme un vieux clou rouillé.
Flots teintés d'améthyste.
Écumes en batiste,
Aux légers falbalas.
Horizons de nuées,
Vaguement remuées,
En vaporeux lilas.
Jean Richepin (1849-1926)
|
| |
| Enquête sur les Ouled-Riah
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
La plupart des journaux de Paris demandent une enquête sur l'affaire des Ouled-Riah ; à la tribune de la chambre le comte de la Moskawa et M. le comte de Montalenbert ont demandé que le pays fut éclairé sur les circonstances qui ont déterminé et accompagné ce triste évènement.
Le ministre de la guerre a répondu, qu'il avait écrit à Alger pour demander de plus amples éclaircissements.
Une information est nécessaire pour l'honneur de l'armée pour l'honneur de la France ; et si M. le ministre de la guerre ne l'ordonnait pas M. le colonel Pélissier, les officiers qui servaient sous ses ordres pourraient la provoquer et répondre eux-mêmes aux questions que leur pose le pays, par la presse, organe de ses enquêtes.
Les Ouled-Riah, enfermés dans leur souterrain pouvaient-ils échapper ?
Avaient-ils des vivres de l'eau pour eux et pour leurs troupeaux ?
Combien de temps pouvaient-ils rester dans la grotte sans être obligés d'en Sortir ?
Combien d'hommes en état de porter les armes ?
Combien de vieillards, de femmes, d'enfants par 500 ou 800 cadavres retirés de la grotte après l'évènement ?
Quel jour et à quelle heure le corps d'armée, sous les ordres du colonel Pélissier est-il arrivé devant la grotte des Ouled-Riah ?
Quelles sont les relations entretenues avant de faire pour la première fois le feu à l'orifice de la caverne ?
Combien de temps ce feu a-t-il duré ?
Combien de temps s'est écoulé entre le premier et le jet des fascines ?
Quel a été le résultat de ce second avertissement ?
Quels efforts ont été faits, soit de la part des Ouled-Riah ou de la part du colonel Pélissier pour éviter l'affreux dénouement de cette terrible catastrophe ?
A-t-on cherché dans les environs un homme influent, un marabout pour servir d'intermédiaire entre les révoltés et la colonne française ?
L'officier chargé des Arabes de la colonne était-il nommé ministériellement pour accomplir ces fonctions, ou bien avait-il été pris accidentellement pour tenir lieu du véritable chef du bureau arabe de la subdivision d'Orléansville ?
Dans ce dernier cas :
Connaissait-il le pays, les tribus, la langue les habitudes particulièrement des Ouleds-Riah.
A-t-il été consulté sur les moyens à prendre pour réduire les révoltés ?
Quel avis a-t-il donné ?
Le khalifat Ben-Abd-Allah-Sidi-Aribi, notre lieutenant indigène dans le Dahra, Bou-Medin-Ben-Ali, spécialement chargé de l'administration des Ouled-Riah, étaient-ils près du colonel Pélissier ?
Ce dernier les a-t-il consultés ?
Quelle a été leur opinion ?
Etaient-ils absents ?
Pourquoi l'étaient-ils ?
Où étaient-ils ?
Pouvait-on les mander ou recourir à leur avis ?
L'a-t-on fait ?
Quels efforts ces chefs ont-ils tentés soit pour amener les révoltés à composition soit pour détourner le colonel Pélissier de sa funeste résolution ?
Quel jour et à quelle heure, a-t-on, pour la dernière fois, allumé et entretenu le bûcher qui a fait périr toute la population ?
A-t-il été allumé d'abord de manière à permettre ou à interdire à la population de nous faire des propositions de soumission ?
Combien a duré ce dernier incendie ?
La colonne que commandait le colonel Pélissier pouvait-elle, sans danger, rester campée en face de la grotte ?
Qu'avait-elle à craindre des Ouled-Riah Avait-elle des vivres ?
Pour combien de jours ?
Pouvait-elle se ravitailler sans quitter la place ?
A quelle distance était-elle d'Orléansville de la colonne du colonel Saint-Arnaud ?
Pouvait-elle communiquer, soit avec Orléansville soit avec le colonel Saint-Arnaud ?
Quelles ressources, offrait le pays : en eau, en bois, en fourrages ?
En un mot, le colonel Pélissier était-il contraint par une nécessité quelconque d'en finir immédiatement avec les révoltés, ou pouvait-il attendre indéfiniment la soumission des hommes qu'il tenait captifs ?
Combien de jours pouvait-il attendre avant d'avoir besoin de ravitailler le corps d'armée ?
La France a besoin d'une réponse à toutes ces questions pour porter un jugement définitif.
M. le colonel Pélissier doit à l'épaulette qu'il porte à sa dignité d'homme et de Français de donner des explications sur tous ces points.
Les officiers qui ont été les témoins de l'affreux évènement du 19 juin doivent dire sans haine et sans crainte, à la justice du pays au tribunal de la nation la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
L'opinion publique, juge suprême, cours d'appel les interroge ; ils doivent répondre.
Le silence, en pareille circonstance, serait une adhésion à la flétrissure infligée à l'auteur de l'affreux évènement que nous déplorons.
L'Algérie courrier d'Afrique,
de l'Orient et de la Méditerranée (16-07-1845)
| |
| Féminisme musulman
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
On ne perd jamais son temps à lire les journaux de Paris. Sans doute n'y rencontre-t-on pas les principes de toute science et ne s'y formerait-on guère l'esprit et le cœur, même dans l'étude la plus approfondie des assassinats de demi-mondaines et du dernier combat livré par l'armée apache.
Mais la vieille gaieté française fait dans le torrent de l'information à outrance des pêches miraculeuses.
C'est ainsi que la révolution est à nos portes. Elle va secouer le monde musulman, figé depuis tant de siècles dans son rigorisme fanatique et ses impénétrables mystères.
Il paraît en effet qu'on télégraphe de Constantinople que Mesdames les Mauresques ont décidé de quitter le voile, telles des Carmélites expulsées, et d'exhiber publiquement, aux yeux du peuple aussi laid que fort, ce que la pudeur coranique leur tenait jusqu'aujourd'hui hermétiquement caché : leur visage bien entendu.
Le parti jeune turc exulte. Si la Fronde vivait encore, sa rédaction féminine.
Bas les masques !
Assez d'esclavage !
Guerre aux abus !
A mort les préjugés !
A nous le XXe siècle !
Voilà un des côtés, et non des moins charmants que la diplomatie européenne n'avait pas prévu dans la question d'Orient.
Réjouissons-nous en pensant que ce ne seront plus les navires de guerre qui marcheront toutes voiles dehors dans les parages de Stamboul, mais les ondoyantes sultanes aux charmes épanouis.
S.M Abdul Hamid a dû sursauter sur son trône.
Grand prêtre musulman successeur de Mahomet gardien sévère des traditions religieuses, il voit tout d'un coup lever le rideau que quarante siècles ont pu contempler.
Le petit nez de Fatma troue de ses ailes frémissantes la plus grande page du Livre de Piété : le voilà passé au travers du parchemin respecté au-delà duquel jamais un visage pâle n'a encore osé lire. Notre Evangile a, pour les situations de ce genre, une formule qu'il convient d'appliquer : c'est l'abomination de la désolation.
Il ne reste plus aux dames du harem qu'à se constituer en syndicat.
Le féminisme prendrait-il le chemin de l'Orient ?
Serions-nous débarrassés pour un temps de ses théories fadasses et lancinantes ? Chacun sait que la France étant le plus fertile, est essentiellement favorable aux germinations les plus abracadabrantes et aux éclosions les plus étranges, surtout dans le champ des idées. Sans qu'aucun de ses protagonistes les plus ardents eut jamais daigné en donner une définition approximative, le féminisme, à peine semé, a poussé dru comme l'herbe folle. Il a eu ses prêtresses, il aurait pu avoir ses martyres.
Les bas-bleus : ont infesté les rues, encombré les antichambres, empoisonné les cuisines.
Les femmes savantes qu'on aurait cru condamnées à mort et exécutées depuis Molière, se sont imaginées de ressusciter, glapissantes et vivaces.
Et les femmes qui n'étaient pas savantes, il en reste encore quelques-unes, emboîtèrent crânement le pas, de leurs petits pieds finement chaussés, faisant claquer les talons pour se donner du courage.
Les hommes toujours bons diables : cédèrent sur tous les points donnèrent raison même lorsqu'elles pouvaient avoir tort s'adoucirent de concessions en concessions.
Disons le mot, ils furent conquis. Le moyen de faire autrement ?
Et puis, toutes les réclamations n'étaient pas présentées sur un ton suraigu ; souvent elles étaient délicatement insinuées dans la forme suppliante, avec accompagnement de mains jointes et de mines savamment composées.
Nos femmes ont donc à l'heure qu'il est les mêmes droits que les hommes.
Le seul qu'elles aient consenti à leur laisser, c'est celui de régler les notes de leurs couturières.
Quand elles auront obtenu la recherche de la paternité, ce qui arrivera un jour, elles feront les enfants toutes seules : elles sauront bien leur trouver un père après.
Mais revenons à nos moutons, si ce terme n'est pas trop irrévérencieux dans un pareil sujet. Quand la mode sera définitivement implantée à Constantinople de sortir sans voile, ce qui ne tardera guère, les Mauresques d'Algérie ne voudront pas rester en arrière.
Elles n'oublient pas à l'occasion qu'elles sont restées, nonobstant la domination française, les sujettes respectueuses et soumises du Sultan Rouge.
Il leur faudra donc imiter en toute hâte les usages nouveaux pratiqués le long du Bosphore. C'est la révolution dans les douars. Hormis les négresses hors d'âge et les fillettes mendiantes, pas une femme n'est encore sortie dévoilée.
Et pourtant ces poupées de linge savaient enflammer les cœurs musulmans : d'irrésistibles passions de féroces jalousies.
Le jour où les minois décorés d'étoiles bleues aux tempes vont s'étaler sous notre grand soleil. Le jour où les trésors dissimulés depuis des siècles vont luire aux yeux de tous, ce sera fini de la tranquillité publique.
Le monde arabe danse sur un volcan, dirait M Prudhomme.
La paix du foyer est à jamais troublée dans le gourbi le plus reculé et l'autorité incontesté du mari irrévocablement battue en brèche.
Madame Zohra se rendra à la promenade avec son ombrelle, elle ira écouter la musique des zouaves, elle fera de la bicyclette.
Le pittoresque n'y perdra rien.
Je crois que les maris musulmans arriveront pourtant à enrayer ce mouvement révolutionnaire. Ils ont à leur service deux armes également redoutables.
La première c'est le fanatisme étroit de la religion. Avec de bons sermons des muftis, les idées nouvelles expireront au seuil des mosquées.
Les femmes imbues de plus de superstition que de piété, répugneront à entrer en lutte contre leurs seigneurs, qui, eux, ont jalousement conservé l'intégralité de leurs droits.
Le mari est pour la femme arabe ce que le capitaine est pour son navire : maître après Dieu.
L'autre arme, plus directement menaçante, sera brandie par des mains solides : elles ne manqueront pas d'avoir un effet immédiat et radical.
Les matraques partiront tout seuls.
Et je gage que nous continuerons longtemps encore à n'apercevoir, à la petite fenêtre des haïks, que les yeux de velours, alanguis par le koheul...
Loys. Les clochettes algériennes et tunisienne (04-10-1903)
| |
| ARBRES DES FORETS
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Micocoulier
Le micocoulier, confondu très souvent avec le hêtre, arbre n'existe pas en Algérie, acquiert dans ce pays des proportions considérables et y devient réellement un arbre de première grandeur. Impropre à constituer des massifs de forêts, il n'obtint tout son développement qu'isolé ou en bordures.
Son bois très estimé pour son élasticité et la ténacité de ses fibres, est plus propre que tout autre à la confection des brancards des voitures.
Ces qualités particulières doivent attirer l'attention de l'administration des forêts sur cet arbre qu'il est facile de multiplier et qu'on peut planter avec avantage le long des routes où il réussirait parfaitement bien.
Le micocoulier est répandu dans presque toute l'Algérie, mais on ne le trouve jamais qu'en petite quantité et souvent même sous la forme d'un épais buisson qui s'échappe du pourtour d'une vieille souche, dernier reste d'un arbre détruit. On en voit de très beaux à Mila, dans la province de Constantine.
On en observe également une belle bordure, le long d'une prairie, au-delà du lac El-Hout dans le cercle de La Calle.
Frêne
Le frêne est un arbre assez rare en Algérie et en général fort tourmenté ; cependant il peut arriver aux plus fortes dimensions, ainsi que le prouvent ceux de la vallée du Safsaf, près de Philippeville.
On le trouve en assez grande abondance sur les bords de l'Oued-el-Kébir, dans le cercle de La Calle ; ils y ont communément deux mètres de circonférence, mais ils s'élèvent peu et leur tige présente des gerçures qui probablement sont les résultats des incendies ; quelques-uns s'élèvent à 25 et 30 mètres et leur circonférence atteint 3 et 4 mètres, mesurée à hauteur d'homme.
Le frêne de l'Oued-el-Kébir, comparé au plus beau frêne de l'approvisionnement de l'arsenal de Toulon, présente les ressemblances les plus frappantes avec ce dernier, sauf une teinte légèrement rosée, qu'on peut attribuer à la coupe récente de l'échantillon et que le temps sans doute fera disparaître.
On rencontre également des frênes dans le district de l'Edough, sur l'Oued-el-Aneb, ainsi que sur les rives du Mazafran, mais ils sont moins beaux que ceux de Philippeville et de La Calle.
En général le frêne se plait dans les bas-fonds et dans les lieux humides ; on pourra donc le multiplier avec avantage le long des cours d'eau dans les bas-fonds humides et les parties marécageuses des prairies et des forêts. Le bois de cet arbre peut utilement être employé pour le charronnage.
Orme
Comme le frêne, l'orme est rare en Algérie ; il habite les mêmes lieux et atteint les mêmes proportions. Il constitue environ la moitié du peuplement de la ligne d'arbres de l'Oued-el-Kébir de La Calle.
La comparaison des ormes de La Calle avec les ormes des chantiers de Toulon est encore plus satisfaisante que pour les frênes.
Bien que le port de Toulon soit approvisionné des plus beaux ormes de l'Italie et du Nord de la France, celui de La Calle, qui n'est pas extrait d'un lieu humide, paraît l'emporter sur eux par: sa ténacité, sa densité et la résistance qu'il oppose aux outils.
Toutefois cette différente a bien pu résulter en partie de la fraîche coupe des échantillons et n'existerait peut-être plus pour les sujets dont la croissance s'est développée sur les bords humides des rivières et des marais ; cependant, on peut affirmer que l'orme de l'Algérie sera un arbre aussi précieux que les meilleurs ormes de France et se prêtera comme eux aux destinations les plus variées.
Les ormes et les frênes de l'Oued-el-Kébir fournissent les deux tiers de leur volume de bois d’œuvre et d'industrie.
Peupliers blancs de Hollande
Le peuplier blanc de Hollande, connu des indigènes sous le nom de Safsaf est un des arbres les plus répandus de l'Algérie.
On le rencontre dans les trois provinces dans l'intérieur comme sur le littoral dans le fond des vallées partout où l'on rencontre de l'eau ou un terrain humide, mais nulle part, il ne constitue des massifs de quelque importance. Le peuplier de Hollande croît avec rapidité.
Dans les forêts de La Calle et dans les bois du Mazafran où on le rencontre avec l'orme et le frêne, il parvient à peu près à la même grosseur que ces arbres et s'élance davantage, mais nulle part cet arbre n'atteint des dimensions aussi grandioses que : dans la subdivision de Tlemcen, sur l'Oued Safsaf et sur les rives de la Tafna.
Le bois de cet arbre, à cause : de sa légèreté, de son élasticité et de sa résistance est très employé par les indigènes pour la charpente de leurs selles.
Cet arbre peut être multiplié avec avantage dans tous les terrains humides.
Chêne blanc
Au Sud-Est de Mascara, entre Saïda et Tiaret, existe un immense massif de chênes connus dans le midi de la France et en Espagne sous le nom de chêne blanc ; c'est un chêne à gland doux, quercus ballotta, arbre à la fois précieux par son bois par son écorce et ses fruits. Le bois de chêne blanc est propre à tous les usages du chêne ordinaire. Son écorce est recherchée pour le tannage du cuir, et dans le Maroc où cet arbre existe en grande quantité, on fait un commerce considérable d'écorce qui sont avantageusement vendues dans tous les ports de l'Europe.
Christian Graille
| |
PHOTOS DE TIMGAD
Envoyées par Groupe de voyage Bartolini
|
|
L'EXIL
Pieds-Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°202, décembre 2011
|
|
On était des centaines. On était des milliers.
Entassés sur les quais, les bagages à nos pieds.
Les enfants dans les bras ne cessaient de pleurer.
On quittait cette terre où nous étions tous nés.
On regardait la mer, cherchant à l'horizon
La silhouette enfin du bateau annoncé
On se tournait parfois, regardant les maisons,
Ces maisons toutes blanches qu'on ne reverrait jamais.
On était des centaines. On était des milliers.
Laissant sur cette terre nos aïeux enterrés,
Ceux qui vinrent naguère assécher les marais,
Y retourner la terre, semer et cultiver.
Ceux qui ont de leur vie, construit tant de maisons,
Y créant des villages, et leur donnant pour noms :
Pasteur, Victor Hugo, Bugeaud, Lamartine et Surcouf,
Flottant sur leur clocher les couleurs : Bleu-Blanc-Rouge.
On était des centaines. On était des milliers
A savoir que naguère. ils se sont engagés
Ils allaient faire la guerre pour leur mère-patrie,
Que ce soit en 1914, en 1939 et en 1942, aussi.
Combien de tous ces braves sont enterrés chez vous ?
Habillés de sarouels ou pantalons, coiffés de chéchias ou bérets
Ils s'appelaient Durand, Hamed, Sanchez, Scotto ou Lévy
Et pour vous tous ces gens ont donné de leur vie.
Nous avons débarqué, le cœur meurtri, serré,
Les enfants dans les bras, les valises à nos pieds ;
On nous a regardé avec haine, sans pitié,
On aurait bien voulu à l'eau nous rejeter...
Aujourd'hui, nous Pieds-Noirs on nous voit de partout...
Notre allant au travail les a rendu fous.
On a fait notre place et beaucoup de jaloux...
On a même intégré des « Francaouis » parmi nous...
Edmée Poyet
Née Lemonnier
| |
ALGER ETUDIANT
N°192, 27 avril 1935
Source Gallica
|
PREMIERE BATTUE
Roberte BONHOMME.
Quand Meskine, ce jour-là partit pour la « Grande Expédition », ce fut avec joie, avec courage et, entre nous, avec orgueil.
Il y avait de quoi : de toute la jeune portée qui, onze mois auparavant, avait ouvert sur le monde des yeux de myope, lui seul avait été choisi pour compléter, que dis-je !... pour renforcer la meute...
Très réellement il ne manquait pas d'une certaine robustesse ni de souplesse. Une chute du haut de la terrasse lui avait bien laissé une légère claudication du train arrière, mais c'était une erreur de jeunesse et Meskine, qui commençait à courtiser ses voisines de chenil, n'aimait guère que Boby le vétéran ou Frida la grande bringue bleue d'Auvergne le lui rappellent avec des gloussements ironiques dans la voix. Il était fox et chacun sait que les fox ne manquent pas d'élégance.
Bref, Chaffin, ce matin-là, s'en vint quérir le chiot sous le ventre maternel auquel, malgré l'orgueil de ses onze mois, et son dédain pour des habitudes désormais peu dignes d'un grand chien, il trouvait encore, par les nuits fraîches, l'agrément d'une confortable tiédeur. Le chenil en éveil hurlait d'impatience joyeuse. Les bassets : Cirta, Timimoun, Clairon, Sapho, qui affichaient d'ordinaire une nonchalance rêveuse, frétillaient d'aise, ce matin-là, en retrouvant des odeurs et des sons familiers, et s'imprimaient avec entrain les losanges du grillage sur la truffe.
Pour avoir vu de semblables départs dans le froid acide des matins, le bruit des klaxons, la fumée acre des autos, pour avoir vu des retours au grand soleil de midi, quand les odeurs sont affolantes, pour avoir léché les mains de Mezian le rabatteur et tourné autour de la table où Maurice soignait au crésyl les chiens blessés, Meskine s'était fait une opinion assez exacte sur la chasse.
Il n'avait pas encore vu de sanglier, mais les guêtres qui dorment dans la soupente aux rats et le tapis de la camionnette lui avaient raconté plus d'histoires vraies qu'on n'en entend le soir au chenil, quand Djin radote des faits connus avec des airs condescendants. Il savait encore, pour l'avoir entendu dire, qu'une laie de quatre vingt-dix kilos est un animal gris et redoutable, mais qu'il existe dans son voisinage des petits, plus faciles à approcher, dont les yeux obliques n'ont pas encore de lueurs aiguës et meurtrières.
Après un long trajet durant lequel Meskine, fatigué de tirer une langue démesurée, s'endormait en dépit des cahots pour se réveiller hors d'haleine, on arriva au Melbou au jour clair. Traînés au bout de la longe, les chiens partirent en grappe sur les talons de Mezian.
Et l'affaire commença.
On enjamba les premières broussailles. Il est indiscutable qu'une fois le sommeil secoué, une course de côte est ce qu'on fait de mieux en matière de sport matinal. L'équipe, nez au sol, queue frétillante, tirait maintenant son meneur.
En haut de la montagne, Mezian défit les laisses. Ce fut la grande liberté. Les hommes en vérité n'entendent rien au plaisir de la chasse et leur affût immobile sur la paresse ou l'incapacité.
Le ciel se dorait quand la meute, encouragée de la voix par Chaffin, enlevée par Boby, chef de meute, partit en peloton élargi à la poursuite d'odeurs provocantes et insaisissables.
Il importe, quand on est neuf dans la science des battues, de n'avoir pas l'air d'un sot, de montrer assez d'aisance sans trop d'indépendance. Il serait enfantin de talonner constamment le chien de tête pour en essuyer plus tard des regards protecteurs ou des conseils superflus. Meskine, plus que tout autre, avait son amour-propre et c'est pourquoi il s'appliqua à suivre le train bon dernier: il n'offrirait pas de prise à la critique.
Le soleil se hissant par-dessus les buissons facilitait la tâche en renforçant l'effluve. Peu à peu cependant Meskine ralentit l'allure, et, prétextant une affaire personnelle et urgente, se laisse distancer : il ne lui déplaisait pas de montrer à ces routiniers qu'on peut avoir un peu d'esprit d'initiative. Une réserve de rosée sur une luzerne l'arrêta en un rapide apéritif. En contre-bas, un chien donna de la voix, puis un autre. Puis ce fut le silence. Il s'apprêtait à descendre quand une bouffée de chaleur rabattit vers lui une odeur connue et pourtant nouvelle...
D'où vient que la brise, plus bas, n'a rien appris aux autres ?
Peut-être est-ce déjà la gloire : mieux que la chance.
Meskine se crispe un moment dans l'angoisse de la découverte...
Décidément cette odeur est tenace.
La voici qui traîne sur cette pierre. Puis, accrochée à cette touffe de diss, elle coule le long de la ravine. Trou : où est-elle ?
La truffe agile se dilate, se tortille et la rattrape par un filet sur cette racine de bruyère... et soudain, là, à 5 mètres, tapie dans un creux : la Bête.
Ivre de joie, Meskine clame son triomphe et bondit. Trop tard, elle a fui sans l'attendre. Dans un crissement de feuilles écrasées la poursuite commence.
La bête dévale la pente bon train ; museau levé, le chien la suit et gagne un peu plus chaque minute, malgré les crochets savants autour des genêts et les brusques plongées dans les lentisques.
Le fuyard sent décroître sa chance. Tout en bas, la meute déçue en ses recherches reprend espoir et grimpe la colline à leur rencontre. Meskine la presse d'une voix impatiente. A chaque appel sa langue qu'un soleil écrasant évapore retombe humide et douloureuse; mais quand on va atteindre son ennemi il n'est pas décent de montrer quelque faiblesse.
Soudain la masse grise s'arrête et vire-volte, échine hérissée. Le chasseur n'a que le temps de freiner des quatre pattes pour ne pas tomber sur un museau retroussé et menaçant. A un mètre les deux bêtes immobiles s'affrontent. Duel d'attitudes, où l'ironie du fox brave la masse impénétrable de l'ennemi. Meskine s'apprête à lutter.
Mais l'ennemi, tout à coup, double de volume, se trémousse une seconde et reprend sa course éperdue dans une pluie de traits noirs et blancs .Un genêt peut-il perdre d'aussi longues épines? En talonnant à nouveau Meskine s'étonne.
Il sera temps plus tard d'y réfléchir. Pour l'instant il guide de la voix ses compagnons qui vraiment n'ont aucune idée de ce qu'est une poursuite: il saura le leur dire et marquer son mécontentement, à ces vieux qui ne savent plus chercher ni courir...
Nouvel arrêt. Coincé par une roche abrupte, l'autre s'est arrêté, et, devant le danger plus pressant, revient vers le sentier facile qu'on lui barre. Il s'enfle démesurément.
Meskine sent un pincement glacé au cœur : comment l'autre a-t-il le courage et l'audace de marcher, sur lui, chien de race, seul poursuivant de droit ? Et les autres qui n'arrivent pas ! Que faire ?
Pour ne pas reculer, il fait un saut de côté. Son élan mal calculé l'amène à moins d'un demi-mètre de la bête. Cette fois l'angoisse étrangle son cri. N'est-ce pas là le plus énorme des solitaires ? Ne va-t-il pas se faire découdre comme Boby ? Il voit deux dents longues et jaunes. Mon Dieu ! Comment les éviter ? Risquer si jeune de monter sur la table qui sent le crésyl !
N'importe, il faut savoir vendre sa peau.
Tête baissée, Meskine plonge vers les membres de l'adversaire, mais oh douleur, avant d'avoir achevé son geste il sent une brûlure atroce lui flamber les reins : un coup de boutoir. Des choses dures et pointues déchirent et pénètrent sa chair encore tendre. Dieu des chiens, est-ce la mort ? Tandis que les autres achèveront la victoire, se défaire de ces dards brûlants, fuir, retrouver Maurice, lui montrer ces blessures s'il en est temps encore...
Finir de sentir le chenil accueillant et sa mère aux mamelles tièdes, finies les parties dans le vieux pressoir, plus de bonnes soupes appétissantes ! Meskine sent qu'il va mourir tout seul.
Un hurlement désespéré gonfle sa poitrine haletante. C'est lui qui dévale maintenant en appelant au secours.
L'angoisse puis l'affolement l'enrouent... Les plaies contiennent toujours les choses dures.
Est-ce qu'il va trainer la bête derrière lui ?
Aouaouou... Meskine pousse ce cri des petits chiens mourants...
Aouaouou..., le feu coule dans son corps....
Aouaouou... Le reste se perd dans la plaine...
Et le soir, sur la paille fraîche du chenil, quand les premières grenouilles entonnent l'angélus, Meskine essaye de dormir d'un air convaincu, le nez dans ses pattes, tandis que de l'autre côté du grillage, Djin le bavard raconte paisiblement, oh, avec un rien d'ironie, l'histoire du jeune chien qui avait attrapé des épines de porc-épic dans les fesses et les prenait pour des défenses de solitaire.
Roberte BONHOMME.
| |
LES ALSACIENS-LORRAINS
EN ALGERIE
Envoyé par Mme N. Marquet
|
|
Le territoire d’Azib-Zamoun est situé à 82 kilomètres à l’est d’Alger, à l’embranchement des routes d’Alger à Dellys et d’Alger à Tizi-Ouzou et à Fort-National ; les routes qui le traversent dans toute son étendue sont excellentes, bien entretenues, et desservies journellement par des voitures publiques ; c’est un lieu de bivouac pour les troupes et un point stratégique important. Le gouvernement y avait autrefois fait construire un caravansérail pouvant servir à la fois d’abri pour les voyageurs et de refuge en cas d’attaque. Autour du caravansérail s’étaient groupées quelques fermes ; les eaux sont abondantes et de bonne qualité, le pays a toujours passé pour extrêmement salubre.
Les terres qui proviennent du séquestre opéré sur les indigènes sont toutes défrichées et pour la plupart très fertiles ; elles produisent surtout des céréales, et embrassent une superficie de plus de 2,000 hectares. Quant au village lui-même, l’emplacement choisi domine tout le territoire, et offre ainsi pour les habitants une nouvelle garantie de salubrité. Avant de quitter Alger, M. le comte d’Haussonville s’était entendu avec l’ingénieur des ponts et chaussées chargé des travaux publics du futur centre, et avait obtenu de lui qu’il voulût bien dresser aussi le plan des maisons à construire et en surveiller ensuite l’exécution.
On se mit à l’œuvre, et en quatre mois quarante habitations se trouvaient prêtes ; ce chiffre a été augmenté plus tard d’une vingtaine jusqu’à permettre l’installation totale de soixante familles : c’est tout ce que comporte l’étendue du territoire d’Azib-Zamoun. Les maisons sont bâties solidement, en bonne maçonnerie, avec couverture en tuile ; le type en est unique, comprenant cave souterraine, rez-de-chaussée de deux pièces, grenier et appentis pour le bétail ; elles-sont carrelées et plafonnées, l’intérieur est blanchi à la chaux.
Quelques-unes, occupées par les familles les plus nombreuses, possèdent un étage avec une ou deux pièces de plus ; les autres peuvent en cas de besoin être agrandies de même façon, et l’épaisseur et la solidité des murs ont été calculées en conséquence. Le prix moyen de revient, assez élevé encore, est de 2,500 francs pour les maisons à deux pièces, de 3,000 pour les maisons à trois pièces, et de 3,500 pour les maisons à étage complet. En effet, si l’installation est des plus modestes, si, en ceci comme en tout le reste, la société s’est fait un devoir d’agir avec une sage économie, on a pris-soin qu’une famille de travailleurs établie dans son nouveau domicile pût s’y plaire et s’y bien porter, deux conditions qui font en somme pour une bonne part l’énergie et la moralité du colon.
Toutes les maisons sont réunies sur un même point et presque se touchant les unes les autres ; il serait facile au moindre danger de les entourer d’un mur unique qui suffirait à tenir en échec les forces insurrectionnelles des indigènes. Dans certains villages créés par le gouvernement, les habitations sont placées à 45 mètres de la rue, qui elle-même a 16 mètres de largeur ; cette disposition permet à chaque colon d’avoir son jardin près de sa maison, avantage à considérer, mais il en résulte un isolement qui rendra plus faciles les vols de nuit, pour lesquels les Arabes sont d’une habileté et d’une audace sans pareilles. Ne vont-ils pas, dans les fermes détachées, jusqu’à percer les murs avec un couteau pour y faire passer une vache ou un cheval ?
Il ne faudrait pas oublier d’ailleurs que la province d’Alger fut le principal foyer de l’insurrection de 1871. Les tribus les plus insoumises ont été, par acte de l’autorité, dépossédées de leurs terres, les 2,000 hectares du territoire d’Azib-Zamoun notamment appartenaient à la tribu rebelle des Beni-Amran ; mais il n’a pas toujours été loisible au gouvernement de trouver à l’intérieur d’emplacement convenable pour établir les indigènes punis du séquestre ; aujourd’hui encore, en plus d’un endroit, ils occupent leurs anciens douars. Plusieurs aussi conservaient des droits auxquels on ne pouvait toucher sans injustice ; tel est le cas d’Omar-ben-Zamoun, amin des Beni-Amran et représentant d’une vieille famille qui a donné son nom au pays.
Son père fut jadis dans ces contrées le chef redoutable des ennemis de la domination française ; le fils, qui jouit encore d’une autorité considérable parmi ses compatriotes, n’est point un homme de poudre, comme disent les Arabes, et, bien qu’on puisse douter de sa sympathie pour nous, il cherche à demeurer en bons rapports avec les vainqueurs. Sa tribu cependant a pris en 1871 une part active, avec les Beni-Aïcha, les Beni-Khalfoun, les Ammals, au pillage et à l’incendie des villages voisins de l’Aima et de Palestro. Il fut de ce chef, après l’insurrection, traduit devant l’autorité judiciaire ; l’instruction ne put réunir contre lui des charges suffisantes ; il aurait même, à l’approche de la colonne du général Cérez, protégé efficacement la vie d’une quarantaine de malheureux Européens, et, par son influence personnelle, aidé à la soumission des insurgés.
Il échappa ainsi au séquestre infligé à ceux de sa tribu. Or précisément son domaine se trouvait enclavé dans le territoire concédé à la société ; là-dessus Omar consentait bien à abandonner une centaine d’hectares, sauf à recevoir en échange une quantité équivalente de terres sur un autre point ; mais il voulait conserver à tout prix l’ancienne ferme de ses ancêtres avec un lot de terres environnant. Il écrivit à ce sujet une longue lettre à M. d’Haussonville, où il exposait en style oriental ses droits et sa demande.
Fallait-il donc voir cet indigène, établi au milieu des nouveaux colons ? A sa suite allaient venir tous les Arabes des environs cherchant à vivre, eux et leurs bestiaux, aux dépens d’autrui. N’était-ce pas se ménager pour l’avenir une source de discussions, de conflits, peut-être même de dangers ?
On dut pourtant en passer par là : la ferme d’Omar ne se trouve pas sur l’emplacement même du village, et ne saurait par conséquent être expropriée ; du moins le lot de terrain qu’on lui laisse ne dépasse-t-il guère la contenance d’un hectare ; ce n’est plus qu’un jardin ; il reste en outre bien entendu qu’Omar-ben-Zamoun n’aura jamais aucun droit de parcours ou de vaine pâture pour ses troupeaux, soit sur les terres des colons, soit sur les communaux.
Pendant que s’achevaient les maisons, l’administration avec une égale activité faisait exécuter ceux des travaux à sa charge qui étaient indiqués comme les plus urgents : les rues, les fontaines et l’abreuvoir ; en même temps on plantait des deux côtés, au long des chaussées, un grand nombre d’arbres à haute tige choisis parmi les essences les plus diverses, et tout autour du village, sur une épaisseur de 50 mètres, une vaste ceinturé d’eucalyptus. Ce système de forêt artificielle a été mis en pratique aux environs de Bougie et a fort bien réussi ; outre que le feuillage de l’arbre possède des propriétés fébrifuges, l’eucalyptus grandit avec une rapidité merveilleuse ; il donne un bois très dur, très solide, et convient à tous les usages ; aussi est-il appelé à rendre les plus grands services en Algérie, mais nulle part plus qu’à Azib-Zamoun, où jusqu’ici l’on pouvait faire plusieurs kilomètres sans rencontrer la moindre broussaille.
On avait songé un moment à établir dans le caravansérail tout ou partie des services publics : école, église, presbytère, ce qui eût fait pour le trésor une réelle économie ; mais cet édifice avait été vendu depuis, quelques années par l’état à un particulier, et le nouveau propriétaire refusait de s’en dessaisir ; devant son obstination, on dut se résigner à élever les bâtiments nécessaires au fur et à mesure que le permettaient les ressources limitées du budget colonial : il fut décidé cependant qu’on commencerait par l’école, de peur que les enfants des nouveaux colons ne fussent exposés à demeurer trop longtemps inactifs, et à oublier dans la paresse et le vagabondage le peu qu’ils pouvaient avoir appris déjà. Il fallait aussi, pour éviter toute complication, procéder à l’allotissement des terres avant l’arrivée des immigrants.
Voici la méthode qu’on a suivie : la zone la plus rapprochée du village a été divisée en lots d’une contenance moyenne de 10 hectares qui leur ont été distribués tout d’abord ; après l’installation, un second lot plus éloigné a complété pour chaque famille une concession d’environ 25 hectares.
Le territoire d’Azib-Zamoun n’est pas concentrique autour du village, lequel, dans l’intérêt de la santé générale, a été bâti à un point extrême ; si tous les lots eussent été compactes, les uns se fussent trouvés à proximité des habitations et les autres à une distance relativement considérable, au grand désavantage de leurs possesseurs.
Outre ces 25 hectares, qui forment à peu près l’étendue nécessaire à la subsistance d’une famille ordinaire, chacune d’elles a reçu auprès du village 1 hectare de vignes, aujourd’hui planté, et 30 ares de jardin, sans compter le lot urbain, sur lequel est bâtie la maison. La société se réserve de donner ultérieurement aux familles nombreuses et laborieuses un supplément de terre. Le surplus du territoire, comprenant les crêtes impropres à la culture, sera laissé comme communaux en pâturage pour le bétail.
Jusque-là, pour la construction des maisons et l’habile direction des travaux, la société avait pu s’en remettre presque entièrement à l’intelligence et au bon vouloir de l’administration coloniale. Toutefois, à mesure que l’entreprise prenait plus de développements, un agent particulier lui devenait nécessaire, qui résidât sur les lieux, décidât par lui-même des questions de détail, prit enfin les dernières mesures indispensables à l’installation des colons.
On fit choix d’un homme actif et intelligent, ancien sous-officier du génie, qui avait longtemps vécu en Algérie et connaissait à merveille le pays et les mœurs des habitants. Par ses soins, des marchés furent passés avec des fournisseurs d’Alger qui s’engageaient à livrer à époque fixe, d’après des types acceptés par une commission locale et à un prix déterminé d’avance, le matériel complet destiné aux familles ; objets de literie, mobilier, ustensiles de ménage, herses, charrues et autres instruments de culture.
Tout cela fut pris neuf et de bonne qualité ; du reste il devait être permis aux immigrants d’apporter avec eux le plus d’ustensiles et de mobilier possible, et la société leur en assurait le transport gratuit : on aurait ainsi l’avantage moral d’acclimater plus vite les nouveau-venus en les entourant d’objets auxquels ils attachent une valeur d’affection.
D’Alger également on fit venir les plantes maraîchères et les arbres fruitiers qui convenaient le mieux à la nature du sol et promettaient de réussir dans les jardins ; on réunit de fortes provisions de semences en blé, seigle, orge, sorgho et pommes de terre ; enfin l’agent de la société s’occupa d’acheter sur les marchés voisins un grand nombre de bœufs de labour dont une paire devait être donnée dès l’arrivée à chacun des colons afin qu’ils pussent se mettre au travail sans tarder et ensemencer leurs terres.
Quatre mois avaient suffi pour tous ces préparatifs ; comme d’un coup de baguette, par la volonté de quelques hommes de cœur, en plein pays arabe, un grand village était sorti de terre avec ses maisons, ses rues, ses allées d’arbres, ses jardins et jusqu’à ses troupeaux. Il n’y manquait plus que les habitants.
Dès l’origine, la société avait reçu tant des départements frontières que de l’Algérie un nombre considérable de demandes d’admission dans ses villages ; soit par elle-même, soit par l’intermédiaire des comités de Nancy, de Lunéville et de Belfort, elle examina scrupuleusement ces demandes.
Inutile de dire que la première condition exigée était un certificat d’option en faveur de la France ; quant aux ressources personnelles dont pouvaient disposer les impétrants, peu importait en somme : ils n’avaient pour réussir qu’à profiter des moyens que la générosité de la société allait leur mettre dans les mains ; ce qu’il fallait avant tout, c’étaient des familles de cultivateurs, habitués au travail des champs et présentant des garanties sérieuses d’ordre et de moralité ; ainsi disparaissait une des principales causes qui jusqu’à ce jour ont fait l’insuccès de la colonisation en Algérie. Peut-être était-il bon d’envoyer aussi quelques artisans ; on eut donc soin de prendre à choix égal telle famille de cultivateurs où l’un des membres était capable d’exercer une profession utile à tous les villages, celle de boulanger par exemple, de forgeron ou de cordonnier. M. d’Haussonville avait eu également l’intention d’admettre parmi les colons un certain nombre de militaires alsaciens-lorrains libérés du service, et il s’était adressé dans cette intention aux généraux commandant les trois divisions de l’Algérie pour obtenir avec leur concours les renseignements nécessaires.
Les anciens soldats qui accepteraient le patronage de la société devaient prendre l’engagement de se marier au plus tôt ou d’amener leur famille sur leur concession. Il faut l’avouer, cette épreuve n’a pas complètement réussi ; bien qu’ils eussent été choisis de près et principalement dans les corps du génie et du train militaire, comme ayant gardé davantage des habitudes de travail et d’activité, la plupart de ces hommes n’ont pas su répondre à l’intérêt qu’on leur témoignait ; quelques-uns même, pour cause d’inconduite ou d’insubordination, ont dû être expulsés, et il ne semble pas que jusqu’à nouvel ordre, en dépit de ce qu’avait pensé le maréchal Bugeaud avec ses colonies de vétérans, l’élément militaire puisse fournir un appoint bien sérieux à la colonisation. Peut-être la durée du service de plus en plus restreinte, en retenant le soldat moins longtemps éloigné de la vie de famille et des habitudes régulières, permettra-t-elle de revenir sur ce qu’un tel jugement offre de pénible et d’inquiétant.
Le choix des familles une fois arrêté, celles qui avaient été désignées furent, avec l’assistance des comités de Nancy et de Belfort, dirigées sur Marseille par groupes de douze ou quinze ; le comité de Marseille prit soin de les accueillir et de les embarquer sur le paquebot des messageries, où le transport gratuit leur était accordé par l’état. A Alger, au débarqué, les attendait l’agent de la société assisté d’un membre du comité algérien, et après quelques heures de repos, elles étaient le jour même dirigées sur Azib-Zamoun.
C’était agir sagement ; on évitait par là de les voir errer par les rues de la ville et se mêler à la foule de ces mécontents trop nombreux dont les conseils et l’exemple auraient pu semer parmi elles des germes de découragement. Au village, tout était prêt pour les recevoir : chaque maison garnie de ses meubles avait reçu un numéro auquel était adjoint un lot de terre. On procéda au tirage, et les colons, sur l’heure, purent prendre possession de leur domicile ; le soir ils couchaient sous un toit.
On approchait alors du mois de novembre, le moment le plus favorable pour entreprendre les labours. D’ordinaire en Kabylie les pluies commencent vers la fin d’octobre et durent sept ou huit jours, après lesquels le beau temps se rétablit ; ces premières pluies enlèvent aux marais leurs influences malsaines, détrempent le sol et permettent de commencer immédiatement à labourer. Vers la fin de novembre, les pluies reprennent avec plus d’intensité et continuent à tomber pendant un mois entier ; c’est alors que les labours, s’achèvent. Aussi, arrivés en octobre, la plupart des colons d’Azib-Zamoun avaient-ils pu, dès la fin de l’hiver, cultiver et ensemencer eux-mêmes une bonne partie de leur concession.
Ceux qui sont venus par la suite ont été reçus, installés, traités de la même façon ; c’était peu pourtant de leur donner une maison et un lot de terre ; il fallait encore les nourrir, eux et leurs bestiaux, jusqu’à ce qu’ils fussent en état de se suffire réellement. Pendant les premiers mois, des vivres en nature leur ont été fournis ; plus tard chaque famille a reçu une allocation en argent, calculée à raison de 75 centimes pour les adultes, et de 30 centimes pour les enfants, somme plus que suffisante dans le pays. On avait compté pouvoir, en tout état de cause, limiter ces secours à la date de la première récolté ? mais les pluies, les sauterelles, ont nui tour à tour aux travaux des champs ; pour la même raison, on a dû continuer à plusieurs familles les distributions de semences qu’on leur avait faites. Il n’y a rien là qui doive étonner, et le fait reste bien établi désormais ; les cultivateurs nouvellement installés en Algérie ne sauraient sa tirer d’affaire que dans la troisième année de leur séjour, autrement dit après la seconde récolte.
Du moins les colons de la société ont-ils eu cet avantage, que rien ne leur a manqué comme secours matériels, encouragements ou conseils. On ne peut imaginer tout ce qu’une semblable entreprise soulève pour les promoteurs de difficultés, d’embarras, de complications de tout genre.
Tantôt c’est un des colons qui, trop vite imité par d’autres, vend les bœufs et les meubles à lui confiés, et qu’il faut chasser du village ; tantôt c’est un retard survenu dans l’exécution des travaux de voirie et qui pourrait compromettre la santé des habitants. Intéresser tout le monde à son but, maintenir entière l’autorité morale dont il importe que l’administration supérieure demeure investie, défendre ses droits sans blesser personne, savoir obtenir sans rien exiger, tel est le problème de chaque jour.
Cependant le bienveillant intérêt porté aux familles des Alsaciens-Lorrains émigrés en Algérie ne pouvait dégénérer en faiblesse et faire oublier à la société les règles de l’équité. Elle se doit à elle-même, elle doit à ses souscripteurs de soulager également toutes les misères et de tirer le plus large parti possible de l’argent dont elle dispose.
Aussi, quand elle a fourni à ses colons d’Azib-Zamoun tous les objets nécessaires à leur installation, elle n’a point prétendu les traiter avec une faveur particulière, leur faire un don gratuit : ainsi que le porte un traité sous forme de bail consenti par les colons avant leur départ, ce sont là de simples avances, sans intérêts, il est vrai, mais remboursables en un temps donné sur le produit des récoltes. Il a donc été fait un relevé exact de toutes les choses fournies à chaque colon, y compris la maison, les vivres, les semences, et celui-ci en retour s’est engagé à rembourser à la société par annuités, en l’espace de six ans, à partir de la troisième récolte, le montant complet des avances, après quoi il restera seul et légitime propriétaire de sa concession. Cette combinaison est des plus heureuses en ce qu’elle sauvegarde tout à la fois la dignité du colon, qui devra pour une bonne part à son travail le bien-être de sa famille, et aussi les intérêts de la société, qui pourra faire servir à d’autres besoins ses fonds redevenus disponibles.
Un moment même, pour hâter ce remboursement et permettre à ses protégés d’entrer plus tôt en possession de leur terres sans qu’ils courussent le risque d’être exploités par les Juifs indigènes, M. d’Haussonville avait voulu leur faciliter le moyen de recourir à quelque établissement de crédit. A sa prière, le Crédit foncier s’est chargé d’estimer la valeur qu’il attribue dès à présent à chacun des lots des colons, et, quoique l’estimation, suivant l’usage, ait été faite à un taux bien inférieur au prix vénal des terrains, elle s’est trouvée dépasser déjà, après moins de deux ans, le montant des sommes avancées. Néanmoins, après réflexion, M. d’Haussonville n’a pas jugé bon de donner suite pour le présent à son projet d’emprunt hypothécaire ; comme le général Chanzy, qui s’est préoccupé de la question, il eût craint que plusieurs d’entre les colons ne profitassent de ces facilités de crédit pour liquider leur avoir et vider le pays ; il faut attendre qu’ils soient mieux fixés encore et plus attachés au sol. Quoi qu’il en soit, l’installation et le peuplement du village sont achevés ; cinquante-quatre familles s’y trouvent déjà établies, quelques autres y seront envoyées au mois d’octobre prochain pour occuper les dernières maisons vacantes.
La grande majorité des colons est active et laborieuse ; ils se montrent très satisfaits de leur sort, ils élèvent des porcs, des volailles, entourent leurs jardins de clôtures et se construisent des granges de leurs propres mains ; chacun d’eux a reçu, toujours à titre d’avance, une seconde paire de bœufs, et, bien que les pluies, qui ont causé tant de désastres en France, aient là aussi gravement compromis la prochaine récolte, on peut dès maintenant tenir leur succès pour certain. Tandis que les Arabes se contentent de gratter la surface du sol, la charrue européenne, enfonçant de 20 à 25 centimètres, aide à obtenir de cette terre vierge, admirablement féconde, des résultats prodigieux. Les arbres plantés en bordure le long des rues ont fort bien réussi. Azib-Zamoun dispose d’une quantité d’eau potable suffisante en toute saison aux besoins de sa population et de ses bestiaux ; quelques travaux permettraient de capter encore deux ou trois belles sources et d’irriguer tous les jardins dans le voisinage des habitations.
L’état sanitaire de la petite colonie n’a pas cessé d’être excellent, même pendant la période d’acclimatation des familles : toutes recommandations d’ailleurs avaient été faites et renouvelées aux colons de vivre sobrement, de prendre garde aux changements de température et d’éviter les insolations. Le médecin de colonisation fixé au centre voisin de Bordj-Menaïel est tenu de venir à Azib-Zamoun une fois au moins par semaine. Déjà la maison d’école est achevée, et un instituteur laïque originaire des pays annexés vient d’entrer en fonctions. Des sœurs dirigeront l’école des filles ; elles auront la garde d’une petite pharmacie pour donner, le cas échéant, les premiers soins aux malades. La construction de l’église, déjà commencée, sera terminée dans le courant de cette année même ; jusqu’ici le curé de Bordj-Menaïel se rendait tous les dimanches au village, et l’office religieux était célébré dans la maison d’un des colons ; un desservant du culte catholique est aujourd’hui spécialement attaché à Azib-Zamoun. Dans tout le pays, la sécurité est parfaite.
Cependant les mœurs et le caractère bien connu des indigènes exigeaient encore certaines mesures de prudence : les uns, soit insouciance, soit malignité, coupaient les jeunes arbres nouvellement plantés pour s’en faire des manches de fouet ; les autres avec leurs troupeaux venaient vaguer sur les terres des colons. Pour remédier à cet état de choses, un garde champêtre a été nommé par la société qui veille sur les récoltes et empêche toute déprédation. Du reste il est probable qu’une brigade de gendarmerie sera avant peu installée à Azib-Zamoun ; la question a été déjà agitée dans le conseil-général de la province ; il suffirait pour l’état d’exproprier le caravansérail, que la nature même de ses constructions et sa position stratégique rendent très propre à servir de caserne.
En résumé, la société a tout fait pour assurer avec la réussite de son entreprise l’avenir de ses protégés ; elle n’a pas craint de descendre jusqu’aux détails les plus intimes ; elle a voulu surveiller leurs-dépenses, elle s’est inquiétée même de leur conduite, de leur moralité.
C’est ainsi qu’il est défendu à tout colon, sous peine d’expulsion immédiate, d’ouvrir un débit de boissons sans l’autorisation expresse et par écrit du président de la société, alors même qu’il eût obtenu celle des autorités locales. Sans parler du tort que peut faire à la bourse et à la santé des habitants l’existence dans un village d’un établissement de ce genre, les cafés maures sont réputés à juste titre en Algérie comme les lieux de réunion de tous les voleurs, receleurs et autres mauvais sujets de la race indigène. Cependant il ne saurait être dans les idées ou les obligations de la société de continuer bien longtemps cette surveillance ; aujourd’hui que ses colons sont en bonne voie, elle entend les émanciper et leur laisser suivre leur propre initiative. Par sa situation, par la fertilité de son territoire, par les éléments même qui le composent, le nouveau village est destiné à devenir un centre important.
Le marché le plus voisin est celui des Issers, éloigné pourtant de 16 kilomètres : l’Arabe, lui, ne compte pour rien son temps, sa peine et celle de ses bêtes, et vend toujours au même prix ; mais pour l’Européen, qui raisonne différemment, la distance est fort à considérer. Tout porte donc à croire qu’Azib-Zamoun aura bientôt, comme les principaux centres de la contrée, son jour de marché, qui ne sera certes pas le moins suivi ; c’est aux habitants qu’il appartiendra alors de faire tourner cet avantage au plus grand profit de la commune et des particuliers. Déjà des dispositions sont prises pour que le village d’Azib-Zamoun soit appelé le plus tôt possible à l’existence civile ; mais ici une difficulté se présente : en fera-t-on une commune de plein exercice, une commune mixte ou une section de commune ?
La commune de plein exercice est régie par un maire et un conseil municipal, absolument comme les communes de France ; les principaux centres européens sont dans ce cas. La commune mixte ou circonscription cantonale englobe une localité européenne, c’est-à-dire peuplée d’Européens, à laquelle est joint un certain nombre de douars arabes qui constitueraient proprement la commune indigène ; elle est régie par un maire que nomme le gouverneur, et qui exerce à l’égard des indigènes plusieurs des fonctions de l’ancien officier des bureaux arabes ; un conseil municipal, composé généralement de cinq Européens et de quatre indigènes, a, comme les conseils municipaux ordinaires, mission de sauvegarder les intérêts généraux de la commune en même temps que les intérêts privés des populations.
Ce système a cela de bon, qu’aussitôt fondée la nouvelle commune trouve chez les indigènes des ressources de fonds relativement considérables auxquelles il faut ajouter les prestations en nature, dont elle peut tirer un très grand parti. Ainsi au cas où Azib-Zamoun serait, comme il en a été parlé, érigé en commune mixte, on lui adjoindrait un immense territoire au sud et au nord, au sud depuis la chaîne des Flissas, au nord jusqu’à la mer ; cette commune serait une des plus puissantes parce qu’elle engloberait un pays très peuplé, et se trouverait le centre de rayonnement d’une foule de villages indigènes.
Voici par contre l’inconvénient : la présence des Arabes dans le conseil et surtout le droit pour tous les indigènes du territoire d’avoir leurs troupeaux sur les communaux méritent réflexion ; il y a là dans tous les cas une source évidente de difficultés pour les colons à peine installés et qui, dans un pays nouveau et inconnu, ont besoin d’une situation nettement définie. Si donc il n’est pas possible de faire d’Azib-Zamoun, comme trop peu important encore, une commune de plein exercice, du moins peut-on le rattacher à une commune voisine, Bordj-Menaïel par exemple, tout en lui conservant une existence et des intérêts distincts, d’en faire en un mot une section de commune avec un adjoint à sa tête. C’est là-dessus que le gouverneur-général aura bientôt à se prononcer, et, le jour venu, la société s’empressera d’abdiquer entre les mains des magistrats du nouveau municipe l’autorité et les pouvoirs qu’elle détient jusqu’ici.
A SUIVRE
| |
Les Pieds-Noirs, 50 ans après
 Jean-Marc Gonin - Jean-Marc Gonin -
Le Figaro 28/01/2012
Par Antoine MARTINEZ
|
Le 28 janvier 2012, Le Figaro Magazine publiait un numéro consacré aux Pieds-Noirs, 50 ans après.
Donnant le coup d'envoi à toute une série de parutions qui auront comme thème principal les cinquante ans de l'indépendance de l'Algérie. Nous aurons donc droit au pire comme au meilleur.
Et sans être un grand voyant le pire sera certainement majoritaire.
Témoin cet article. Il est bon de préciser certains raccourcis, résidus d'une désinformation vieille d'un demi-siècle.
L'honnêteté du journaliste n'est pas mise en cause. Il est dans la droite ligne de ce qu'on lui a enseigné, et au milieu de faits avérés, il glisse des affirmations qui sont erronées ou tout au moins, superficielles.
Je livre l'intégralité du texte avec les remarques qui me semblent essentielles.
En 1962, comme si un barrage s'était rompu, 700.000 Français d'Algérie déferlent sur la métropole. Drame national à leur arrivée, cet exode, vu avec cinquante ans de recul, a connu un épilogue heureux : la réussite de leur intégration.
Quelques lignes sur le terme pied-noir. En général, les Français d'Algérie ne l'aiment pas. On leur a collé cette étiquette au moment de l'exode. Ses origines sont contestées. Les uns affirment que le mot remonte aux soldats français débarqués en 1830 qui portaient des guêtres noires. Les autres pensent que le sobriquet vient des colons viticulteurs qui écrasaient le raisin en le piétinant et sortaient du pressoir les pieds noircis par le jus. Quelle que soit son étymologie, l'expression va s'imposer en France et éclipser les autres.
En 1962, au moment des accords d'Evian, la métropole les appelle déjà rapatriés (1). Un secrétariat d'Etat aux Rapatriés a été créé l'année précédente, confié à Robert Boulin. Dans la foulée, des décrets ont été publiés prévoyant l'accueil des Français d'Algérie ainsi que leur accès à des aides spécifiques. Mais ce dispositif, copié sur celui mis en place pour les Français du Maroc, de Tunisie et d'Indochine, va être totalement submergé. Depuis la Toussaint 1954, cela fait plus de sept ans que l'Algérie vit dans la guerre.
D'abord dans les campagnes puis dans les villes avec, pour ne citer que quelques épisodes, la bataille d'Alger, le terrorisme, les assassinats, sans oublier les fameuses nuits bleues où les explosions succèdent aux explosions. Quand des négociations secrètes, à l'initiative du général de Gaulle, aboutissent aux accords du 18 mars 1962 conduisant à un cessez-le-feu, prélude à l'indépendance, fureur et désespoir se mêlent dans le cœur des Européens d'Algérie (2). L'Organisation armée secrète (OAS), créée un an auparavant dans le but de maintenir l'Algérie française, redouble de violence.
À Alger, l'armée impose un blocus au quartier (européen) de Bab el-Oued et en bombarde certains bâtiments. Des soldats français tirent sur d'autres Français rue d'Isly. Pour une immense majorité de Pieds-Noirs, ces combats fratricides, qui s'ajoutent aux exactions récurrentes du Front de libération nationale (FLN), donnent le signal du départ. L'armée n'est plus là pour les défendre (3) et ils refusent de rester dans un pays gouverné par leur ennemi FLN.(4) Les massacres d'Oran (plusieurs milliers de victimes) (5), perpétrés le 5 juillet, jour de la proclamation de l'indépendance, sans que la garnison française n'intervienne, emporteront les doutes de ceux qui hésitaient encore. C'est " la valise ou le cercueil ".
(1) rapatriés : terme impropre pour les européens d'Algérie.
- Définition du Larousse : Personne ramenée dans son pays d'origine par les soins des autorités officielles.
- Définition du petit Robert : Assurer le retour d'une personne sur le territoire du pays auquel elle appartient par sa nationalité.
Les européens d'Algérie sont nés Français sur une terre qui était française (avant les Alpes Maritimes, la Savoie et la Haute Savoie) du 4 novembre 1848 jusqu'au 3 juillet 1962. Ils ont été chassés de leur terre d'origine. Ce vocable ne peut leur être appliqué, sauf à considérer que l'Algérie ne fut jamais française, ce qui est contradictoire avec ce que les membres des gouvernements français successifs ont proclamé plus d'un siècle durant.
(2) " fureur et désespoir se mêlent dans le cœur des Européens d'Algérie ", mais surtout incompréhension. La logique aurait voulu qu'ils fussent conviés à la table des négociations. Il n'en fut rien. Les accords d'Evian ont effacé par leur mise en place, 1 million d'européens (soit 10 % de la population) et un nombre non négligeable de musulmans favorables au maintien de la France.
(3) " L'armée n'est plus là pour les défendre ". Cette affirmation est fausse quant à sa présence physique et à ses possibilités de réaction et de protection des personnes et des biens. Le 5 juillet 1962 à Oran il restait 18 000 soldats français cantonnés dans les casernes avec ordre de ne pas intervenir. En revanche il est vrai que la défense des Pieds-Noirs n'était pas sa priorité et c'est un euphémisme…
(4)"ils refusent de rester dans un pays gouverné par leur ennemi FLN." Voici un autre aspect de la désinformation. Nous aurions refusé de perdre " nos privilèges " en étant gouvernés par des " arabes " (Ah ! Ce racisme congénital). Ceci ne tient pas car les accords d'Evian prévoyait une représentation européenne au gouvernement de la République algérienne. Simplement, les accords d'Evian n'étaient qu'une déclaration de principe qui ne fut jamais respectée. De plus, le slogan " La valise ou le cercueil " était toujours d'actualité.
(5) Plusieurs centaines de victimes serait plus proche de la réalité. 807 d'après Jean Pierre Chevènement, préfet d'Oran par intérim ce jour-là.
Certains pensent encore revenir pour un vrai déménagement
Entre mars et septembre 1962, villes et villages d'Algérie se vident de leur population européenne comme si un barrage s'était rompu. Des rotations incessantes de navires (6) vers Marseille et Port-Vendres ainsi qu'une noria d'avions déversent près de 700.000 rapatriés sur le sol de la métropole - 70 % de la population française d'Algérie. Rares sont ceux qui ont pu déménager. La plupart sont partis dès qu'ils ont décroché un passage maritime ou un billet d'avion. On a bourré les valises à la hâte et chaque membre de la famille en transporte une ou deux. Certains songent à revenir plus tard pour effectuer un déménagement en bonne et due forme. Mais beaucoup croient ce départ définitif. Dans son émouvant ouvrage La Traversée, l'écrivain Alain Vircondelet raconte: " On savait que sitôt partis, la porte serait fracturée et qu'une famille, peut-être déjà aux aguets, occuperait les lieux. "
Ainsi, nombre de portes resteront ouvertes et des voitures abandonnées avec les clés sur le tableau de bord - d'autres, au contraire, incendieront leur véhicule plutôt que de le laisser aux " vainqueurs ".Quand ils embarquent et jettent un dernier regard vers cette terre d'Algérie qui les a vus naître, ces rapatriés éprouvent le goût amer de la trahison.
Le gouvernement, remâchent-ils, a précipité leur perte, détruit leur existence et bradé " leur " pays.(7) Jetés sur les routes de l'exil, beaucoup espèrent trouver le réconfort en gagnant la " mère patrie ". C'est De Gaulle qui les a trahis, pas la France, veulent-ils croire pendant leur traversée sans retour. Du moins la France des livres d'histoire et des manuels de géographie. Car ce peuple d'artisans, d'employés, de commerçants, de fonctionnaires cher à Albert Camus n'a, dans sa majeure partie, jamais foulé le sol de l'Hexagone (8). Ceux qui l'ont visité n'y ont souvent passé que quelques semaines de vacances et n'en ont donc rapporté que des souvenirs heureux. Leur vision idyllique ne résistera pas aux premières heures passées sur les quais de Marseille ou dans les salles de débarquement d'Orly. Policiers suspicieux - l'Intérieur traque les hommes de l'OAS - et douaniers pinailleurs transforment les premiers instants en une attente interminable. Les rapatriés découvrent soudain une France marquée par la guerre d'Algérie, mais pas comme ils l'ont été eux-mêmes. Ces Français-là les accueillent souvent mal, parce que des dizaines de milliers d'appelés du contingent ont été envoyés dans les Aurès " à cause d'eux " (9) ; parce que l'OAS a commis des attentats en métropole et qu'on les tient pour responsables ; et parce que des généraux ont organisé un putsch un an plus tôt contre la République.(10) L'hostilité a été amplifiée par une certaine presse et par la propagande communiste, qui les présentent tous comme des " colons ": propriétaires latifundiaires exploitant de pauvres fellahs ou bourgeois nantis dont les Arabes ciraient les chaussures aux terrasses des cafés. En réalité, les trois quarts des Français d'Algérie avaient des revenus inférieurs de 20 % à ceux des métropolitains. Et les riches que le PC brocardait ne représentaient que... 3 % des Pieds-Noirs.(11)
(6) " des rotations incessantes de navires ".
" Si l'on veut parler d'une mise en place de moyens de transports par le gouvernement : " on aura tôt fait de constater à quel point la participation de la Marine nationale à cette exode aura été numériquement marginale pour l'évacuation de la population européenne encore que fondamentale pour celle des harkis… pour le mois de juillet où elle atteint son maximum, elle ne dépasse pas 8% du total. "
http://www.frenchlines.com/rapatriement/documents/
patrick_boureille_conf_marine_nationale.pdf.
L'emploi de la marine nationale ne fut effectif qu'à partir du 11/06/62 au 22/07/62 et assure le rapatriement de 17500 personnes. Le chef de l'état ayant même refusé des initiatives américaines et espagnoles.
(7) " leur " pays.
L'utilisation des guillemets laisse entendre que le pays en question n'était le leur que par le résultat d'une hallucination collective. Un élément allogène n'aurait donc pas le droit de se sentir chez lui sur une terre qui a vu naître 5 générations des siens. Une arrière pensée un peu étrange alors que le droit du sol est instauré sans contestation possible sur la terre de France. Et qu'il suffit qu'un nouveau né voit le jour sur le quai d'un port ou sur le tarmac d'un aéroport de " notre pays ", pour devenir instantanément, citoyen français et de ce fait être inexpulsable. Mais peut être aussi que cette terre française n'est pas non plus " notre " pays puisque nous sommes nés en terre étrangère...
(8) " Car ce peuple… n'a, dans sa majeure partie, jamais foulé le sol de l'Hexagone. "
Effectivement, sauf pour secourir la mère patrie en danger. Le père de Camus entre autres, perdra la vie dans le premier conflit mondial. Tous n'ont pas rapporté de " souvenirs heureux ", mais souvent laissé " outre-mer " un être cher ou " rapatrié " cercueils, blessés, gueules cassées et handicapés.
(9) " des dizaines de milliers d'appelés du contingent ont été envoyés dans les Aurès " à cause d'eux " ".
Et à " cause d'eux ", à cause des enfants qu'ils étaient, des dizaines de milliers de Pieds Noirs (16,4 % de la population européenne pendant la seconde guerre mondiale) ont été envoyés, en Tunisie, en Corse, en Provence, en Italie, à Colmar, jusqu'à Stuttgart.
(10) " parce que des généraux ont organisé un putsch un an plus tôt contre la République.
" La révolte des généraux d'avril 1961, baptisée Putsch, n'était pas dirigée contre la République. C'était même tout le contraire. L'Algérie était partie intégrante, depuis 1848, de la République française une et indivisible. La politique gaullienne prévoyait d'amputer celle-ci de 15 départements en contradiction avec la constitution du 4 octobre 58
(Article 2 La France est une République indivisible.), (Article 5 Le Président de la République veille au respect de la Constitution…, Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire..)
Le " Putsch " visait donc à conserver l'unité républicaine et s'opposait à des violations de la constitution. Il fut tenté par des officiers républicains qui tous avaient un passé glorieux au service de la France. On les qualifia de fascistes afin de les déconsidérer pour salir leur entreprise.
(11) Sondage I.F.O.P en 1962 : 62% des français de métropole refusent toute idée de sacrifice à l'égard des "Pieds-Noirs ".
Un quart des biens débarqués ont été volés
Gaston Defferre, alors maire de Marseille, se place au premier rang du " comité d'accueil ". Supporter de l'indépendance, il n'éprouve pas de sympathie pour ces intrus qui débarquent par milliers chaque jour dans la cité phocéenne. Le 2 juillet 1962, dans une interview à Paris-Presse, il déclare : " Au début, le Marseillais était ému par l'arrivée de ces pauvres gens, mais, bien vite, les Pieds-Noirs ont voulu faire comme ils le faisaient en Algérie quand ils donnaient des coups de pieds aux fesses des Arabes. Alors les Marseillais se sont rebiffés. Vous-même, regardez en ville : toutes les voitures immatriculées en Algérie sont en infraction ! "(12). " Halte au péril pied-noir " (13), peut-on lire sur des affiches placardées sur les murs du port. Dans ce climat tendu, des Pieds-Noirs verront même leurs caisses jetées dans les bassins par des dockers CGT... L'historien Jean-Jacques Jordi estime que le quart des biens des rapatriés déchargés à Marseille ont été purement et simplement volés. Le gouvernement n'est pas en reste. Le général de Gaulle observe cet exode avec inquiétude (14) : il discrédite les accords d'Evian qui stipulaient des garanties pour les Français d'Algérie et rejette vers la métropole ses plus farouches détracteurs.
Louis Joxe, ministre des Affaires algériennes, qui a mené les négociations avec le FLN, voit ces arrivées massives comme une catastrophe. Robert Boulin, secrétaire d'Etat aux Rapatriés, tente de minimiser l'événement. En Conseil des ministres, il explique que cet afflux cache un grand nombre de vacanciers qui retourneront en Algérie à la rentrée et que seulement 160.000 Pieds-Noirs sont partis pour de bon... En fait, quelles qu'aient été les arrière-pensées politiques des uns ou des autres, l'afflux soudain de Pieds-Noirs prend le gouvernement et l'administration au dépourvu. Ni le secrétariat d'Etat, ni le ministère de l'Intérieur, ni les préfectures ne sont prêts à y faire face. Le problème est énorme. Il faut loger, nourrir, scolariser des milliers de Français arrivés en six mois. Les plus argentés, une minorité, possèdent une maison ou un appartement en métropole et peuvent s'y installer. Mais que faire des autres ? Quand ils ont encore des liens familiaux, les Pieds-Noirs campent chez des parents.
Mais ces solutions de fortune, à cinq ou six dans une pièce, ne sont pas durables. Elles ne font que repousser le problème et grossir les rangs des mécontents. Quant à ceux qui n'ont pas de famille en France - c'est par exemple le cas des Pieds-Noirs d'origine espagnole ou des juifs séfarades -, ils n'ont rien. La question du logement est la plus urgente. Hélas, en ce début des années 60, la France se débat déjà avec ce problème. Les dossiers des rapatriés vont donc épaissir le fichier des mal-logés et s'ajouter aux cohortes de demandeurs de HLM. À l'été 1962, on les héberge dans des internats, vides durant les vacances scolaires, dans des entrepôts désaffectés ou d'anciennes casernes, voire dans de petits hôtels sans confort réquisitionnés par les préfectures. La Croix-Rouge, le Secours catholique, la Cimade (protestante), le Fonds social juif déploient leurs bénévoles pour assister les Pieds-Noirs. Ces " solutions " relèvent toutes de l'expédient ou de la charité plutôt que du plan réfléchi et concerté. Longtemps encore, ils furent des milliers à occuper des logements insalubres en payant des loyers prohibitifs au regard de l'état des locaux.
Il faudra des années pour régler le relogement des Pieds-Noirs en France. Le chercheur Yann Scioldo-Zürcher, (15) auteur d'une étude détaillée sur l'intégration des rapatriés d'Algérie (Devenir métropolitain, éditions EHESS), souligne néanmoins que l'État a veillé à ce que les rapatriés n'échouent pas dans les bidonvilles, nombreux autour des grandes villes françaises de l'époque.
(12) " Ils fuient. Tant pis ! En tout cas je ne les recevrai pas ici. D'ailleurs nous n'avons pas de place. Rien n'est prêt. Qu'ils aillent se faire pendre où ils voudront ! En aucun cas et à aucun prix, je ne veux des Pieds-Noirs à Marseille ". "Il n'est pas question de les inscrire à l'école, car il n'y a déjà pas assez de place pour les petits Marseillais. " Gaston Deferre
(13) D'autres aussi : " Pieds-Noirs dehors ! " " Retournez chez vous ! " " Les Pieds-Noirs à la mer ! "...
(14)" Le général de Gaulle observe cet exode avec inquiétude ".
Il ne fut inquiet que lorsque le flot pourtant prévisible (" Quelle hécatombe connaîtrait l'Algérie si nous étions assez stupides et lâches pour l'abandonner " Ch De Gaulle - conférence de presse 1958), devenait irréversible. Il fut indifférent et sourd aux conseils de certains de ses ministres. " Trois cent Français d'Algérie par semaine, ça fait douze cent par mois, à supposer qu'ils soient tous des rapatriés. Ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est rien ! " Charles De Gaulle à Alain Peyrefitte
(15) A lire les écrits du chercheur Yann Scioldo-Zürcher, le Pieds-Noirs serait environné des mythes qu'il à lui-même fabriqué pour se donner, inconsciemment (ou non), une posture de victime. Il en va ainsi de la description du monde dans lequel il vécut ; de l'image qu'il s'est construit de la société coloniale dans laquelle il s'octroie le " beau rôle " ; de la négation des efforts humains et financiers incommensurables que fit le gouvernement à son encontre.
Si les aides pécuniaires furent effectivement allouées, le chercheur occulte qu'elles furent versées, souvent, comme des avances et prêts soumis à intérêts, ou des remboursements de frais engagés ; qu'elles furent réglées bien tardivement, non convenablement estimées par rapport à ce qu'elles auraient dû être ; que les versements étalés dans le temps ne tinrent pas compte de l'inflation ; que le pretium doloris ne fut jamais pris en compte.
" que si l'État a veillé à ce que les rapatriés n'échouent pas dans les bidonvilles, nombreux autour des grandes villes françaises de l'époque ". Il n'a pas empêché l'inflation du prix des terrains et des loyers qui ont amplifié la précarité des réfugiés ; les taudis et meublés sordides avec paiement exigé en liquide par des bons français qui eux, ne faisaient pas " suer le burnous ".
Attirés par le climat du midi de la France
L'objectif d'origine - veiller à éviter des concentrations trop importantes dans certaines régions de France - n'a pas été atteint (16). Le midi de la France, notamment le pourtour méditerranéen, concentre la majorité des Pieds-Noirs. Viennent ensuite la région parisienne, puis le Rhône et l'Isère. Une répartition géographique qui révèle deux tendances fortes. Premièrement, beaucoup de Pieds-Noirs ont privilégié le climat. N'oublions pas que cette population composite, mêlant Français, Espagnols, Maltais, Italiens, Grecs, Séfarades, représentait une sorte de concentré de Méditerranée qui n'avait que peu, ou pas du tout, de racines en France. D'où l'envie de s'établir près de la " grande bleue " ou, en tout cas, d'éviter les hivers trop rudes. Deuxièmement, les zones de forte expansion ont accueilli de nombreux Pieds-Noirs. Le constat est vrai pour l'Ile-de-France et la région Rhône-Alpes. Mais il l'est aussi pour les grandes villes du Midi : Marseille, Nice, Montpellier, Perpignan, Toulon. L'arrivée des Pieds-Noirs a correspondu avec le moment fort des Trente Glorieuses, marqué par une croissance annuelle supérieure à 6 % jusqu'en 1965. Ils y prirent leur part.
(16) "Il faut les obliger à se disperser sur l'ensemble du territoire. Leur répartition et leur emploi exige des mesures d'autorité ".
(C De Gaulle au Conseil des Ministres du 18 juillet 1962)
" Pourquoi ne pas demander aux affaires étrangères de proposer des immigrants aux pays d'Amérique du Sud ? Ils représenteraient la France et la culture française. "
(Georges Pompidou 1er Ministre, au Conseil des Ministres du 18 juillet 1962)
" Mais non ! Plutôt en Nouvelle Calédonie ou en Guyane qui est sous-peuplée et où on demande des défricheurs et des pionniers ! "
Ch. de Gaulle
Dans l'agriculture, une réussite moins harmonieuse
Il est bien entendu très difficile de mesurer la réussite spécifique de la population rapatriée une fois installée sur le territoire de la métropole. A leur arrivée, l'économie française en général et le marché de l'emploi en particulier n'avaient pas forcément besoin d'eux (17). Artisans, petits commerçants, modestes employés, agriculteurs, ils faisaient irruption dans une France en pleine mutation : exode rural, industrialisation, avènement des grandes surfaces commerciales. Au départ, les autorités ont attribué des aides aux indépendants pour qu'ils se réinstallent tout en octroyant des surprimes, substantielles, à ceux qui optaient pour un emploi salarié. La rabbia,(18) ce mot italien utilisé à Bab el-Oued qui signifie rage, animait-elle les rapatriés à leur arrivée? En tout cas, ces Français qui avaient tout perdu ont tracé leur chemin en créant des PME, notamment dans le bâtiment, dans la confection et dans les services. Dans les professions libérales, médecins, vétérinaires, dentistes, avocats, notaires, les réussites sont patentes. Dans le monde agricole, le tableau est moins harmonieux. À côté de grands succès, notamment en Corse avec la viticulture et les agrumes ou sur la Côte d'Azur avec les pépiniéristes, on déplore de nombreux échecs. Les Pieds-Noirs, parfois incités par les pouvoirs publics ou les chambres d'agriculture, ont repris des exploitations abandonnées par des paysans qui avaient gagné la ville. Payées au prix fort, les terres n'ont pas produit les revenus attendus et ont plongé leurs acquéreurs dans les difficultés, voire la faillite. Les fonctionnaires sont un cas particulier. Les administrations les ont intégrés, parfois avec quelques retards dans la carrière, et les agents des organismes locaux ont fini par être réaffectés au sein de services publics en France. Exemple célèbre dont beaucoup de lycéens des années 60 se souviendront: les infirmières des hôpitaux d'Algérie que l'on réorienta vers la médecine scolaire. N'oublions pas la musique, le cinéma et le show-busines où les réussites sont légion. C'est vrai pour les Séfarades qui dominent la comédie, au grand dam de certains qui se sentent caricaturés par leur genre d'humour.
Mal partis et finalement bien arrivés, les rapatriés auront quand même obtenu de réelles compensations de la République - ce que certains ont semblé oublier. (19) En 1970, le Sénat chiffrait à 26 milliards de francs le total des aides et allocations. Quant aux indemnisations au titre des lois de 1970, 1974 et 1978, elles se montent à près de 29 milliards de francs.(20) Des sommes obtenues de haute lutte, bien après que le Général eut quitté le pouvoir, notamment sous Giscard. Au bout du compte, les Pieds-Noirs n'ont pas " tout " perdu.(21) La France, quant à elle, a gagné des citoyens qui ne demandaient qu'à l'intégrer. C'est une réussite.
(17) Nous venions " manger le pain des Français !! "
(18) Ou Rabia mot espagnol de même signification.
(19) Voir note (15)
(20) Estimation des biens laissés en Algérie 25 à 50 milliards de 1956.
55 milliards d'aides, allocations et indemnisation.
26 milliards réinjectés illico dans l'économie (aides et allocations ont servi à acquérir des biens de consommation de première nécessité) ;
29 milliards d'indemnisation (sans défalquer les intérêts de prêts remboursés).
Cette indemnisation fut si juste et si équitable qu'il fallut rajouter 3 lois (1982, 1987, 2005).
Pour une indemnisation totale en quatre ans, il suffisait d'augmenter le litre d'essence, alors aux environs de 1 Franc, de 1 centime (proposé par M Viard), mais cette augmentation " aurait été mal perçue par le peuple Français ".
Pour mémoire : La France a fourni à l'Algérie (de 1962 à 1965) une aide équivalente au montant du coût des grands travaux prévus au Plan de Constantine, c'est-à-dire approximativement DIX MILLIONS DE FRANCS PAR JOUR, soit pour ces trois années, PLUS DE DIX MILLIARDS DE FRANCS versés à fonds perdus.
(21) " les Pieds-Noirs n'ont pas " tout " perdu ".
Tout non ! Seulement un pays, leurs maisons, leurs amis, leurs cimetières. Pour certains, leur métier, la vie ou la santé, une fin d'existence dans la misère. Et pour ceux qui ont pu bénéficier d'une indemnisation, environ 70 % de leurs biens. Ils y ont gagné par contre, mépris, racisme et xénophobie, accusations diverses et variées, insultes et autres manquements aux droits de l'homme. De quoi se plaignent-ils à la fin ? Merci donc à la France " grande et généreuse ".
| |
| QUINZE AOUT
De Jacques Grieu
| |
Parler de religion, c’est monter sur la brèche
Et des révolutions, c’est allumer la mèche.
Antidote à la chance, à la mort, au malheur,
On ne l’a inventée que pour avoir moins peur.
Moi qui suis un athée, mécréant convaincu,
Jamais à Compostelle, je ne suis apparu.
Je ne connais pas Lourdes. Et au ciel de Lisieux,
Je préfère la Corse au soleil plus radieux.
Aux sonorités d’orgue et chants à l’harmonium,
Aux sermons déclamés dans un grand décorum,
J’ai toujours préféré violoncelle et piano,
Le folklore ou le jazz, cornemuse ou saxo.
Humour et religion sont-ils incompatibles ?
Les pleurs y sont bien vus mais le rire est la cible.
Que ce soient les chrétiens, islamiques ou bouddhistes,
Ils se lamentent et prient sur un ton plutôt triste.
J’aime les jours fériés comme tous les Français.
Pas plus les religieux que ceux de début mai,
Mais j’ai grande passion pour le quinze d’août :
Il génère des ponts dignes des autoroutes.
Et que signifie-t-il ? Et pourquoi cette date ?
Pour moi : aucune idée ! Et quand, en toute hâte,
Je demande à la ronde en posant la question,
Chacun baisse le nez sans une explication.
Une vieille grand-mère, enfin, m’a répondu,
Qui pourtant, à la messe, est fort peu assidue :
Il s’agit, me dit-elle, de « fêter l’Assomption.
Surtout ne pas confondre avec notre Ascension ! »
C’est donc là que j’ai vu comment la religion,
Vient semer ses bienfaits sur nos occupations.
En plus de nos dimanches, elle fait des congés,
Et au repos des ouailles, on voit qu’elle a pensé.
L’oisiveté pensante est très sainte invention
Qui nous fait méditer sur notre condition.
Plus on a de loisirs et plus on devient pieux !
A trois mois de congés on est saint bienheureux.
La fête de Marie nous fait ses processions
Mais surtout des vacances aux douces permissions.
Je vais donc, de ce pas, changer mes préventions,
Et d’un œil plus léger revoir ma religion…
Je vais aller prier pour d’autres jours fériés,
Et tous les salariés pourront me remercier.
On a souvent bien plus de religion qu’on croit ;
A l’auréole en or, je sens que j’aurais droit…
Jacques Grieu
|
| |
Grève des Biskris
Tirailleur Algérien, N°517 23 décembre 1900
Source Gallica
|
|
DIALOGUE des IVRES MORTS
Au coin d'une rue, Pitanchard et Gosiersec se rencontrent ; ils titubent tous deux et la rue n'est pas assez large pour eux.
Pitanchard. — Tiens, tiens, je crois que c'est ma vieille branche de... de Go-Gosiersec.
Gosiersec. — En en chair et et en en os co... comme s. s saint a, amadou.
Pitanchard. — Et ousque donc qu' tu vas comm' ça.
Gosiersec. -- Mo.o.oi je..je marche.
Pitanchard. - Eh ben ma vieille cousine, t'es rien saoul, j' crois ; mais ousqu' ta donc ra ram' massé cette biture là, tu n'fais qu' qu' que zigzaguer d'puis un moment.
Gosiersec. — Eh ben mon cochon, tu trouves qu' qu' que j' je suis cuit et qu' toi tu as rien, t'en as un fameux culot, toi.
Pitanchard. — Tu sais, hein, p' p' pas d'gros mots, car si t'es plein c' c' pas ma faut' à moi.
Gosiersec. — T'es trop vert, toi, pour offrir un' un' une tournée. T'aimes mieux licher tout seul et faire suisse, t'es pas un frère; t'es un poivrot.
Pitanchard. - (Il fait un faux pas et tombe sur son derrière) (à part). J'j' crois qu'il a r r'raison, c' c'pendant j'ai pas bu plus qu' qu' d' coutume) tiens donn' moi la main, qu'j'm' lève car j'j' crois qu'qu' j'ai cassé m' mon verre d'd' montre.
Gosiersec. — (Va pour lui donner la main mais il tombe à son tour.) Ali me voilà propre, moi aussi, et et qu'est ce que nous allons faire si nous pouvons pas nous le le lever.)
Pitanchard. — Eh bien, n' nous r'reste-rons assis, voilà.
Gosiersec. —A.a. assis ch' chez l' mastro..troquet encore passe, mais là jamais d'ma vie. -(Il cherche à se mettre debout mais tombe de plus belle, à ce moment des enfants arrivent et crient hou liou hou).
Pitanchard. - Ah z'vas vous en f'cher des hous bous, tas d'ivro-ognes en herbe.
Les enfants partent en riant et en criant plus fort hou). Une patrouille de sergents ville arrive et emmène nos deux ivrognes au commissaire de police.
Le Commissaire. — Vous voilà encore vous deux ; vous ne pourrez donc jamais vous corriger de boire.
Pitanchard et Gosiersec. — Pa..ardon mon mon coco-mlssaire, c'est pas d' n'otre faute à à nous.
Le Commissaire. — C'est p'eut être ma faute à moi ; ou aux agents qui vous ont ramassé.
Pitanchard. — Non, non, mon commissaire c'est la f f' faute à à...
Gosiersec. — Il a rai-raison mo.on.
Pitanchard. — Tais toi, toi ! qu' qu' tu n'a pas la paro-oole.
Le Commissaire. - Allons, assez ; je vais vous placer dans un endroit où vous serez tranquilles.
Gosiersec. - Mais, mo-on Co-co-mis-saire puisque c'est la a a fau..aute à la...
Pitanchard. — (Continuant) à la grè-grève des Bis-Biskris.
Gosiersec. — Car, si, si ils ils s' c'étaient pas a mis en gré...éve, nous aurions bu de l'eau et nous aurions pas été chez le mas..astroquet licher un petit verre ; mais, c'est sacrés biskris, ils ga..ardaient les fo..nntaines pour pas qu'on boive.
Pitanchard — Et et de cette fa..çon le e maastro-oquet, il a pas pu ba-aptiser son vin.
C'est ça qui nous a tro-ompé.
Gosiersec (pleurant) — C'es la a faute aux biskris.
Pitanchard (pleurant). C'est la a fau-aute au au ma-as-tro-oquet.
La scène se termine par l'accompagnement au violon de nos deux ivrognes.
VRAR-OLUS
| |
| LE SANG DES RACES
Par LOUIS BERTRAND
Source Gallica
|
LE CIMETIÈRE D'EL-KETTAR
XIV
Pages de 132 à 138
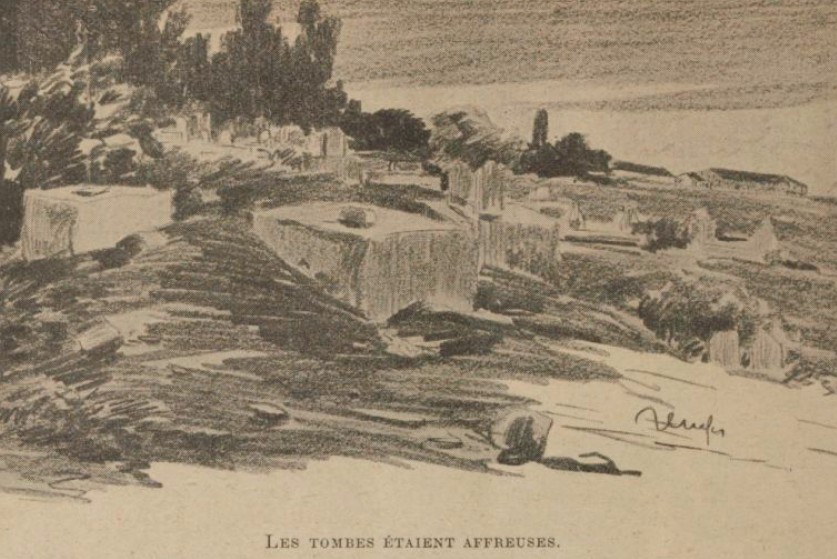
Rafael, en rentrant au logis, trouva son frère malade. Sa mère lui remit urne lettre de son jeune cousin d'Espagne, — l'autre Juanète — qui lui annonçait son arrivée toute prochaine par le bateau d'Alicante et qui le priait de lui chercher du travail. Il avait encore à s'occuper de son mariage, qui était tout proche, et il ne savait comment s'y prendre pour annoncer à la Chusca la mort de son enfant. C'était plus qu'il n'en fallait pour lui bouleverser la tête. Mais tout céda devant la maladie de son frère.
La tia Rosa était désespérée. « Il n'y avait rien à faire, disait-elle : c'était la même maladie que celle de Ramon, elle lui était venue de la même façon. Toute une journée, il avait reçu la pluie, et, le soir, au lieu de venir se changer, il était allé s'amuser à la Casbah avec des camarades. Le médecin lui avait ordonné de garder le lit ; mais il s'obstinait à se lever, bien qu'il eût la fièvre continuellement et qu'une toux sèche lui déchirât les poumons. »
— Vois-tu, Rafaelète, — ajouta la mère, — il me dit des mots qui me crèvent le cœur. Il sait bien que c'est pour mourir.
Alors il refuse tous les remèdes on croirait qu'il veut se détruire plus vite...
La vieille raconta à Rafael que, lorsqu'à force de supplications, elle lui avait fait promettre de prendre une tisane, Juanète s'empressait d'aller répandre le contenu du bol sur l'évier, dès qu'elle avait le dos tourné.
Le malade ne parut pas à la maison de toute la journée. Le soir, vers cinq heures, Rafael le rencontra près du Lycée, rasant les murs, se traînant à peine, avec l'air craintif d'une pauvre petite bête blessée, et si hâve, si décharné, qu'il en était méconnaissable. Les plis de sa blouse trop large laissaient apparaître sa maigreur. Juanète, ayant aperçu Rafael, hâta le pas pour l'éviter, comme s'il avait honte de se montrer à lui dans cette laideur de son corps.
Vraiment il n'avait plus sa poitrine « comme un cheval de France » ; mais Rafael s'en attrista moins que de l'aversion qu'il crut deviner chez son frère.
Ils soupèrent ensemble. Rafael le dévisagea à la lueur de la lampe. La flétrissure du visage, l'épuisement de tout l'être, cette suprême injure à son sang, émurent l'aîné jusqu'aux larmes. Il se contint pourtant, et, prenant un ton affectueux :
— Pourquoi ne veux-tu pas faire ce que dit le médecin ?
— Oui, gronde-le, dit Rosa : il a une si mauvaise tête !
Mais Juanète regardait méchamment son aîné. Il semblait lui en vouloir davantage à cause de sa force et de sa santé. Il ne répondait rien. A la fin, Rafael insistant, il lui jeta à la figure : — Est-ce que ça te regarde, toi ?
Il se leva sur ces mots, et, allumant une cigarette par bravade, il s'en alla de sa démarche de fantôme, et il disparut dans le corridor.
Rafael reprit la route, oubliant presque Assompcion, tellement la préoccupation de son frère le tourmentait. Il ne songeait plus à son mariage. En arrivant à Laghouat, on lui remit une lettre de sa mère qui lui demandait de revenir au plus vite : Juanète lui faisait des scènes épouvantables, et son mal s'aggravait avec une rapidité effrayante.
Après trois longues journées de diligence et de chemin de fer, Rafael tomba au Faubourg en pleine nuit. A la porte de sa mère, il croisa les femmes en fichus noirs qui sortaient. L'une d'elles lui dit : — Tu arrives encore à temps pour le voir, Rafaelète ! on ne l'enterre que demain...
Il s'attendait si bien à cette nouvelle qu'il ne s'en émut même pas. D'ailleurs, hébété par le voyage, sa pensée vacillait.
Il éprouvait en lui comme un grand vide. Il s'imaginait que tout cela se passait dans un autre monde et qu'il n'était que le spectateur de ces choses.
Une agitation silencieuse remplissait toute la maison. On montait derrière lui pour la veillée funèbre. Quelqu'un frappa sur son épaule. C'était Pascualète le Borrégo, le vieil ami de son père, qui n'avait pas remis les pieds chez eux depuis des années : — Tu sais, dit-il, le petit s'est tué. Tu vas voir la blessure !... Les femmes disent que, pendant la nuit, il s'est brisé la tête contre la muraille...
Le Borrégo tout à coup, se mit à pleurer. Mais Rafael, impassible, serra mollement la main du vieux qui avait pris la sienne.
Tout le long du corridor, faiblement éclairé par une veilleuse, les hommes accroupis par terre causaient à voix basse.
Ceux qui devaient travailler le lendemain se levaient déjà pour s'en aller, car il était plus de dix heures. Par la porte ouverte, on entendait les clameurs tragiques de la tia Rosa,
La cuisine était pleine de femmes en mantes noires, les unes assises sur les chaises, les autres accroupies sur les dalles. Plusieurs avaient un nourrisson pendu à leurs mamelles. On se dérangea pour faire place à Rafaël ; et Assompcion, qui se tenait au chevet du mort, se leva lentement, en lui présentant la branche de buis bénit.
Assompcion, les yeux baissés, ne lui dit pas une parole. Personne ne semblait le reconnaître. Il était là comme en visite. En vérité, tout cela avait l'air de se passer dans un rêve.
Pendant qu'il secouait le buis bénit, il regarda fixement le cadavre de son frère, où passaient les reflets tremblants de deux bougies posées sur un guéridon. On avait bandé la blessure de la tête, mais un peu de sang qui avait suinté souillait la blancheur du linge. Rafael, à cette vue, éprouva moins d'attendrissement que de dégoût. Le corps de Juanète lui sembla aussi chétif que celui d'un petit enfant.
Cependant la tia Rosa n'avait pas interrompu sa lamentation. Depuis le commencement de la veillée, elle continuait son cri, s'apaisant de temps en temps pour sangloter, puis reprenant soudain sur des notes plus hautes, avec une fureur et une exaltation croissantes. On eût dit que la présence de Rafael l'avait ranimée. Debout au pied du lit, elle tendait en un grand geste ses bras robustes de travailleuse, les paumes des mains ouvertes. Ses doigts tremblaient par la violence qui secouait tout son corps, et sa bouche hurlante se creusait en un trou noir, comme celle des statues. Elle invectivait la mort et la malédiction de l'aïeul, — cette malédiction dont elle se souvenait toujours et qui, — elle en était sûre à cette heure, — était retombée sur ses enfants. Il ne lui en restait plus qu'un, le premier, celui d'avant la parole maudite et le péché de Ramon. Elle criait, traînant sa voix, suivant une modulation : — « Dieu nous l'a payé ! Dieu nous l'a payé ! Ah tio Rafael, le jour où vous avez dit cette mauvaise parole, — je le jure devant le Christ, — vous avez mal agi, vous avez mal agi, tio Rafaël !...»
Puis, songeant aux folies coupables de Ramon, enivré par l'abondance de l'Afrique, emporté par l'ardeur de la terre, elle reprit : — « Pourquoi n'es-tu pas retourné au pays de ton père ? -- Pourquoi es-tu resté dans cette Afrique maudite ? — C'est son soleil qui t'a brûlé le sang — c'est le soleil maudit qui a tué mes fils!...»
Elle battait avec ses mains ses vastes flancs de mère féconde, capable de concevoir encore. Son visage de pierre s'était noyé au torrent de ses larmes. Elle tomba à genoux, en embrassant les pieds du mort, et elle resta ainsi, la tête cachée dans le linceul et sanglotant. Rafael et Assompcion, jugeant qu'elle devait être lasse, la soulevèrent doucement.
Elle se laissa entraîner dans la pièce voisine pour prendre un peu de repos.
La lamentation était finie. Une femme, qui était renommée dans tout le Faubourg pour sa mémoire et sa belle voix, commença la récitation du rosaire.
Rafael, en rentrant dans la chambre, reconnut le tio Martino, qui s'était installé dans un coin, près du buffet et qui lui fit un signe de la tête. Assompcion lui avança une chaise, et, tandis que montaient les répons des femmes, il se mit à contempler le cadavre, le cœur toujours aussi sec et plein de dégoût et d'épouvante. Ses terreurs d'enfant lui revenaient : « Chimo mort, son frère mort, ne serait-ce pas bientôt son tour ? »
— Il se disait : « Si ma mère m'avait étouffé quand je suis venu au monde, cela aurait bien mieux valu. Mais maintenant que j'ai goûté à la vie...»
La récitatrice achevait les litanies des trépassés. Des enfants pleuraient, demandaient le-sein. Quelques mères sortirent, en les balançant dans leurs bras pour les apaiser.
Puis, petit à petit, les autres, enhardies par l'exemple, désertèrent la chambre mortuaire, et il n'y eut plus, avec Assompcion et Rafaël, que le tio Martino et le vieux Pascualète qui se rapprocha d'eux. Rafael se trouva presque soulagé du départ des femmes. Dans les trois êtres qui restaient auprès de lui, il sentait des affections qui le gardaient, et il tournait des yeux attendris vers la rude figure du Borrégo, avec ses cheveux gris et ses boucles d'oreilles, — ce vieux qui avait aimé sa mère...
Assompcion lui parlait. Dans la pièce voisine, on entendait la forte respiration de la tia Rosa endormie. La voix basse de la jeune fille le pénétrait comme une caresse.
A travers ses paroles, il percevait toute l'agonie de son amour:
— Rafaelète, dit-elle, mon bonheur est fini !
— Ah ! Oui ! Quand nous marierons-nous maintenant?... Tout mon argent va partir chez le médecin et le curé...
Elle se mit à pleurer, puis elle lui dit avec ferveur :
— Ecoute, Rafaelète ! Je ne peux plus attendre. J'aime mieux mourir, vois-tu, j'aime mieux mourir ! — puis, après un silence :
— Ecoute!... veux-tu dans trois mois ? nous nous marierons comme des pauvres...
— Eh bien ! Nous nous marierons comme des pauvres, dit Rafaël.
— Tu me le jures, Rafaelète ?
— A quoi bon jurer ?
Elle se jeta à son cou, et, devant le cadavre étendu, ils se donnèrent leur premier baiser.
Le lendemain fut atroce pour Rafael, surtout le voyage du cimetière. Suivant la coutume, quatre camarades de Juanète, en blouses du dimanche, portèrent le cercueil.
Rafael, vêtu de noir, venait derrière, entre le Borrégo et le père d'Assompcion.
L'aspect lugubre du cimetière, avec ses allées rectilignes, le glaça. La laideur affreuse des tombes et des ustensiles funéraires ajouta encore à son angoisse. Néanmoins il fit bonne contenance jusqu'au bout.
Mais, quand il dut s'avancer pour prononcer l’adieu et jeter de la terre dans la fosse, il fut pris d'une convulsion de sanglots. On dut le ramener au logis.
Après le dîner, le tio Martino vint le chercher à la maison. Ils devaient se rendre tous deux chez le « curé » pour régler les frais de l'enterrement et retirer les bans de mariage. Le soir, l'autre Juanète, le cousin d'Espagne, arriverait sans doute par le bateau d'Alicante. Rafael songeait qu'il serait convenable d'aller l'attendre, et toutes ces démarches l'accablaient d'avance. La vision du cimetière lui était restée : les couronnes de perles désenfilées et rongées de rouille, les hideuses petites croix de bois noir avec leurs grosses larmes peintes en blanc. L’odeur lourde des cyprès l'étourdissait encore.
Le « curé » habitait une petite maison mauresque sur la route de Notre-Dame-d'Afrique- Un sacristain espagnol à figure de brigand introduisit les deux visiteurs dans un cabinet complètement blanchi à la chaux et d'une simplicité toute primitive. Un banc de bois était appuyé au mur sous une niche entourée de guirlandes de papier, où se détachait un grand Christ sur fond d'or, entre deux vases de fleurs artificielles. En face, les douze tomes de saint Thomas sur une planchette. Un bureau et un fauteuil de paille parfaisaient l'ameublement. Mais il y avait une gargoulette pendue aux persiennes à demi-closes, et Je soleil formait une blancheur si fraîche et si gaie dans la pièce qu'on s'y trouvait bien.
Sans même remarquer l'abattement de Rafael, non plus que la mine de circonstance du tio Martino, le « curé » les reçut avec sa jovialité ordinaire. Il se laissa choir sur son fauteuil, où il s'étala, en écartant les jambes et en retroussant sa soutane :
— Alors, voilà ton mariage remis, Rafaelète ! Tu ne perdras pas pour attendre, toi, ce n'est pas comme ta fiancée...
Il éclata de rire à cette gaillardise, si épanoui dans la paix de sa petite maison et si heureux de vivre, qu'un peu de sa gaieté se communiqua à Rafael. Il disait au jeune homme
— Tu entends, chicot si tu te maries, c'est pour avoir des enfants, beaucoup d'enfants, à la mode espagnole... il ne faut pas faire comme les Français!...
Aussitôt il entama une diatribe contre les écoles primaires, où, selon lui, les enfants se pervertissaient.
— A la Carrière, disait-il, les habitudes d'Espagne les maintiennent encore un peu. Mais regarde ceux de Mustapha et de Belcourt, où ils sont noyés au milieu des Français et des Italiens: ce sont déjà de petits bandits, sans respect pour l'autorité, ni leurs parents, ni rien...
Le « curé », en veine d'éloquence, fit de point en point la leçon à Rafael, sans le priver d'ailleurs de plaisanteries fort grasses. Puis, il passa sa blague aux deux visiteurs et termina par l'offre d'un verre d'anisette.
Rafael se trouva tout rasséréné par les propos du « curé ».
Quand il sortit, il dit au tio Martino : — Il n'est pas trop mauvais homme, celui-là, encore que ce soit un curé.
Sur les quais où Rafael était allé attendre son cousin, un grand nombre de gens du Faubourg était accouru. Des barques accostaient sans cesse, pleines d'humains entassés pêle-mêle avec des ustensiles de toute sorte : vieilles malles sans âge ni forme, paquets de linge et couffins de provisions,, jusqu'à des matelas et des bois de lit attachés par des cordes. Presque tous étaient des paysans d'Alicante et de Valence, en blouse de lustrine noire, le menton et les lèvres rasés. Il y avait aussi des tribus de gitanes, les hommes en pantalons collants, une guitare en bandoulière, les femmes en jupons roses, avec des nichées d'enfants sur le dos, dans une espèce de besace, à la façon des pauvresses kabyles.
Tout ce monde poussait des cris sauvages, se disputant pour le prix avec les bateliers arabes, qui parfois menaçaient de l'aviron les plus récalcitrants. Des agents les formaient en file, et ils s'acheminaient vers la douane, courbés sous leurs bagages, éperdus comme un troupeau.
Rafael pensait : « Ah ! Les autres peuvent, mourir ! Il y en aura toujours trop pour venir nous prendre le pain !... »
Le lendemain, il voulut montrer la ville à Juanète. Lui-même avait besoin de sortir pour chasser ce goût de mort, qui, malgré tout, le poursuivait toujours- Ils commencèrent par les Carrières, et Rafael prit plaisir, après une si longue absence, à repasser par ces chemins, où, tant de fois, il avait conduit son équipage avec Ramon : ces Carrières, c'était comme le berceau de leur famille, leur nid à tous !
Puis ils remontèrent par le Frais-Vallon, pour gagner la Casbah et les petites rues de la haute ville. Juanète ne s'étonnait de rien. Il trouvait que tout était comme en Espagne, et Rafael, eu l'écoutant, pensait moins à son frère.
Quand ils furent en haut du sentier, le cimetière arabe d 'El-Kettar apparut devant eux au versant du ravin. Par une large ouverture on voyait la mer déployer vers le Nord ses eaux sans rivages. Les toits du Faubourg s'étageaient en face sous la coupole de Notre-Dame-d'Afrique, et les flancs pierreux de la montagne, éventrée par les carrières, s'ouvraient en une grande brèche violette.
Mille impressions confuses de son enfance revenaient à Rafael. Ce petit cimetière d'El-Kettar, dont les verdures avaient si souvent rafraîchi ses yeux, quand il montait avec sa galère par les chemins tout blancs de soleil, il lui sembla qu'il gardait une part de sa vie. Un vent d'Est fit frissonner les feuillages des eucalyptus. L'air était si pur, on respirait si largement sur ces hauteurs, que Rafaël et Juanète s'assirent sur une pierre, en face des tombes.
A leurs pieds, la maison du gardien des morts laissait voir sa terrasse entre les branches des figuiers et des chênes-lièges.
Les doubles stèles luisaient parmi l'herbe maigre, et, dans les petites coupelles, creusées aux extrémités et aux chevets des fosses, un peu d'eau miroitait sous la lumière. Des enfants nus couraient parmi les tombes.
Alentour, des Mauresques, ayant rejeté leurs voiles, étaient accroupies en cercle.
On les voyait manger des friandises, le vent apportait les rudes intonations de leur babil. Au plus profond du ravin, un vieux fossoyeur vêtu d'une simple gandoura serrée aux flancs par une ceinture de cuir, creusait un trou avec acharnement. De temps en temps il ramassait par terre un bâton, et il s'appliquait à bien prendre les mesures. Puis, l'éclair de sa pioche brillait de nouveau, et il ne se reposait point, bien que la sueur brillât sur ses jambes lisses comme si elles étaient frottées d'huile. Rafael le suivait avidement des yeux.
Le vent d'Est s'était apaisé. Une fraîcheur tempérait la brûlure du soleil déjà haut. La clameur confuse du Faubourg arrivait à peine. Tout était éclatant et paisible dans ce beau jardin des morts, et Rafael, regardant le fossoyeur, songeait : « C'est un métier aussi, cela ! un métier comme le mien!... »
Puis il dit à son compagnon :
— Sais-tu à quoi je pense, Juanète? Je voudrais être enterré ici... pas là-bas, dit-il, en tendant, son doigt vers Saint-Eugène, du côté du cimetière chrétien... Ici, on doit être bien pour dormir!...
Il se leva. Un grand calme l'avait rempli. Peu à peu, le souvenir de son frère mort s'effaçait. Il sentait qu'il avait moins peur de mourir.
Ils rentrèrent dans la ville bruyante et joyeuse. Ils descendirent par le quartier arabe, et, après avoir visité tous les estaminets de la place du Gouvernement — la Plaza del Caballo, comme disent ceux d'Espagne, — ils finirent par s'arrêter dans un café du port.
Cecco le Piémontais était là, attablé avec deux hommes. Dès qu'ils parurent, il interpella les entrants, il les fit asseoir et commanda deux verres. Il y avait si longtemps qu'on ne s'était vu que les effusions furent longues.
L'un des hommes qui accompagnaient Cecco était Manolito, le petit Castillan que Rafael avait connu autrefois au service d'Alvarez. Toujours plus gris et plus cassé, il portait le bras en écharpe, ayant eu trois doigts fracassés par la mécanique de son chariot. L'autre était un tout jeune garçon à peu près imberbe, le torse large sous son tricot à raies bleues, mais avec une petite tête ronde d'enfant aux yeux timides.
Rafaël présenta son cousin, dont l'accoutrement intriguait Cecco et les autres.
— Ah ! dit le Piémontais en riant, encore un pataouète qui ne veut pas aller à Cuba... Il en pleut, des pataouètes, il en pleut ! On ne voit que ça dans les rues !...
Ils ont raison tout de même ils mettent la guerre en grève !... Est-ce que ça ne fait pas pitié d'envoyer à la guerre des enfants comme ça !
— Cecco désigna Juanète et le jeune garçon imberbe.
— Ça serait si heureux de piocher tranquillement la vigne dans son pays.! C'est comme celui-ci ! dit-il.
— Sais-tu d'où il arrive ?... Il vient d'Abyssinie, où on l'a fait prisonnier. Il est venu à pied depuis Bône jusqu'à Alger, et, il y a huit jours, en allant au vin, je l'ai trouvé dans un champ de fèves, qu'il avait ravagé, à moitié nu et crevant de faim. Comme il est Padouan (à peu près de chez nous), je lui ai donné à boire et à manger, et je lui ai trouvé du travail... Aussi regarde comme il est gaillard, maintenant ! Tout de même, ça fait du bien, le vin d'Algérie!... Ho ! Ménélik, raconte un peu à Rafael ce qu'ils t'ont fait souffrir par-là, les sauvages !...
Mais le garçon comprenait mal le français. Baissant les yeux et rougissant très fort, il se mit à jargonner avec Cecco en italien.
— Tu entends ce qu'il dit, Rafaelète ? il dit que les généraux les ont vendus !
Rafael causait avec Manolito. Il ne répondit point, la question ne l'intéressant pas.
— Et ton frère ? demanda-t-il à brûle-pourpoint au Piémontais.
— Mon frère ! Il est fait pour rester sous les jupes de sa mère. Ce n'est pas un homme, ça ! Tu ne sais pas qu'il est retourné au pays, voilà plus d'un mois ? Il voulait m'emmener avec lui. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire chez ces abrutis-là. Moi, il faut que je roule ! Je vais partir pour Madagascar par le prochain bateau !... Oui, à Madagascar ! C'est un planteur de café qui m'engage... Ah! j'en aurai vu, moi, des pays, j'en aurai fait des métiers ! J'ai travaillé au tunnel du Gothard comme terrassier. De là je suis passé à Lyon dans la colle forte, à Rive-de-Gier dans la verrerie, à Grenoble dans les peaux, à Martigues dans les salines, à Gardanne dans, le charbon, à Septèmes dans les produits chimiques. J'ai fait le charretier à Bône, j'ai recommencé ici. Et voilà que je m'embarque pour Madagascar ! Tu viens avec moi, Rafaelète ?...
— Tu sais bien, dit Rafael, que je suis marié avec la route de Laghouat !
— Encore un triste métier ! dit Manolito. Dans l'espace de trois mois, j'ai eu les côtes enfoncées en passant un pont, et les doigts brisés, à peine sorti de l'hôpital...
— Mais ça arrive à tout le monde, ça, fit Rafael.
— Oui ! je le vois bien... Mais tu sais ? tu n'en as plus pour longtemps à la faire, ta route de Laghouat Les Alvarez, avec leur concurrence, ont fait baisser les prix des transports. Les chameliers arabes se mettent à charger du sucre ! Qu'est-ce que tu veux parier que, dans un an, ton patron Bacanète est forcé de vendre ses équipages?...
— Eh bien ! dit Rafael, nous travaillerons pour la gloire !...
— En voilà, des culs-de-plomb ! cria Cecco. Tu préfères claquer la misère ici, parce que c'est ton pays. Moi, mon pays, c'est où je trouve du travail !... Allez ! buvons à Madagascar ! dit le Piémontais en levant son verre : je ne regrette qu'une chose de l'Afrique, c'est le vin Cecco, avec un geste bravache, releva son large feutre, et sa face rouge de Gaulois coureur de mondes éclata comme une fournaise.
Mais Rafaël, très grave et regardant son cousin Juanète, répondit:
— Mon père a gagné son pain par ici, je le gagnerai bien aussi, moi !
Le jour suivant, il fit ses adieux à Assompcion et à sa mère pour reprendre la route. Bacanète, remplacement de Chimo, avait accepté Juanète comme homme de peine. Et le jeune homme ne se sentait pas de joie à l'idée de voyager pour la première fois avec son cousin.
Ils partirent dès l'aube. Au second tournant et la route, un coin du golf apparut, étalant ses eaux bleues dans la lumière matinale. Au loin les montagnes, encore couvertes de neige, resplendissaient comme des marines. Rien n'était changé de cet éternel paysage, et Rafael le contemplait avec la même paix et le même sentiment de délivrance qu'au soir de son premier départ. Il allait s'arrêter en haut de la montée, chez le cabaretier de la Colonne. Les étapes se succédèrent dans leur Ordre invariable et, là-bas, à travers les sables, les mêmes étoiles infaillibles se lèveraient à leur place accoutumée pour guider les pas errants des hommes.
Maintenant Rafael, comme son chariot, était sûr de sa route, Quelqu'un de son sang, entraîné par son exemple, l'avait suivi ; d'autres, en qui bouillonnaient toutes les sèves de la jeunesse, parlaient de lui au repas de famille… bientôt, sans doute, des êtres sortis de sa chair continueraient plus sûrement la beauté de son acte.
De cet endroit on découvrait toute la mer.
Rafael songea à sa fiancée, et, la pensée remplie de ses noces prochaines, dans la joie de sa force, il redescendit vers le Sud.
Louis Bertrand
FIN
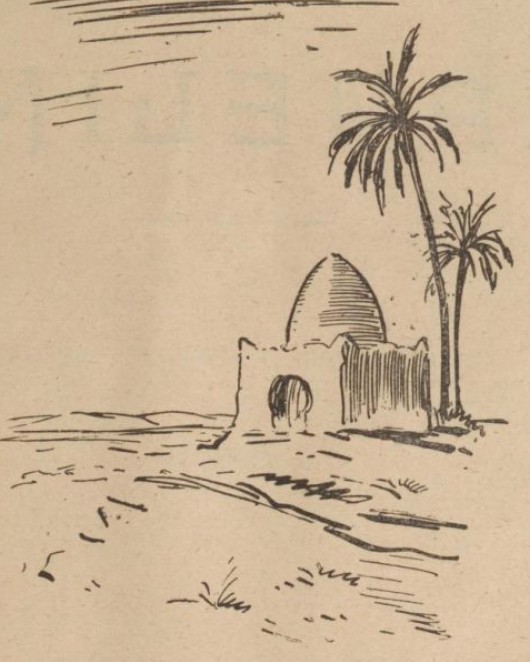
| |
| ÉBARBAGES
De Jacques Grieu
|
|
La mode de la barbe est encor de retour
En séduisant appât qui suscite l’amour ( ?)
Notre gouvernement, flairant là l’occasion,
Comme fit un grand tzar, pense à sa... taxation.
Un impôt sur la barbe ? Une idée à creuser :
Il paraît qu’à Bercy les imprimés sont prêts.
Avec mode d’emploi pour bien la mesurer
Et pour nous expliquer comment la déclarer.
Courte, longue ou naissante, à mouche ou bien à pointe,
On la porte partout fièrement et sans crainte.
Favoris, rouflaquettes, en bouc ou bien sculptée,
Personne n’y échappe, il faut tous y passer.
Tantôt frêle duvet, tantôt dense forêt,
La barbe prend sa place avec rude fierté,
Elle habille le visage mais de mille façons,
Comme belle œuvre d'art, subtile création.
Si « la barbe fait l’homme » et le dicton dit vrai,
La barbe de certains causa bien des forfaits :
Celle des Khomeiny, Ben Laden, Bokassa,
Pour des millions de gens le monde leur changea.
Si le « beau » Charles Quint, à grands coups de ciseaux,
Ou Napoléon III, ou bien Fidel Castro,
Avaient coupé les poils poussant sous leurs mentons,
La terre tournerait peut-être un peu plus rond ?
La barbe, prétend-t-on, donnerait la sagesse :
Donc les chèvres barbues seraient des prophétesses ?
Pourtant si la comète avait des prédictions,
C’est que sa longue barbe était bien sa caution.
On fête sainte Barbe avec les artilleurs
Mais pour la femme à barbe, il faudra voir ailleurs :
Point de barbe au menton avec Sa Sainteté,
Même si bien des saints en ont souvent porté.
Portent-ils une barbe, ces gens qu’on dit « rasants » ?
On leur aurait coupée, s’ils rasaient tellement ?
Etaient-ils si barbants, ces raseurs de barbus ?
Alors, je dis : « la barbe » ! Et ne vous rase plus !
Jacques Grieu
|
| |
PROVINCE D'ORAN.
Gallica : Revue de l’orient, 1852-2, pages 314 à 321
|
LE MONT THESSALA
ET LA VILLE D'AÏN-TEMOUCHENT.
Je crois que lorsque Dieu voulut créer le monde, il était tranquillement assis sur son trône au sommet du Thessala. Plongé dans une méditation recueillie, il promenait ses regards sur tout ce qui l'entourait, et c'est alors que, saisi d'effroi, il s'écria dans l'horreur qu'il éprouvait : que la lumière se fasse, mais que le Thessala subsiste à jamais. Dans cet anathème dont il frappa le malheureux, il voulut, pensant à ses desseins éternels, montrer à l'homme un terme de comparaison entre le chaos et les merveilles qui devaient, d'âge en âge, faire l'admiration des générations futures. Plus tard, il frappait Thessala du déluge, et c'est depuis cette dernière malédiction que l'infortuné vieillard montre à tous les regards sa face rugueuse, la cavité de ses orbites et ses flancs déchirés. Le Thessala a dû être aussi le champ de bataille des Titans lorsqu'ils tentèrent d'escalader le ciel.
Imaginez donc un béant colossal aux mille crêtes, à l'horizon infini ; vous croyez atteindre au dernier sommet, il vous reste encore cent mamelons à gravir si d'un soleil à l'autre vous parcourez ses ravins, vous n'aurez pas plus fait que l'homme nui, après son dîner, en un jour d'automne, va se promener dans son parc en attendant la fin du jour. Si vous vous lancez dans ses mille gorges, dans ses mille sentiers sans le fil conducteur représenté par un indigène armé de son moukala (fusil) et monté sur son haoud (cheval), vous aurez infailliblement le sort de l'infortunée Ariane.
Figurez-vous un effroyable cataclysme, une nature en convulsion et dévergondé, des précipices, des rochers, des ravins, des collines, le tout tellement mêlé, enlacé, que c'est un inexplicable dédale. Cinq fois je suis allé de Bel-Abbés à Aïn-Temouchent et vice versa, et jamais je n'ai pu retrouver les mêmes sentiers.
Ce portrait, vous l'avouerez, n'est pas flatteur, et cependant l'homme a poussé son esprit d'opposition perpétuelle jusqu'à surnommer le Thessala la montagne de la farine. Les peuples pasteurs y promènent de nombreux troupeaux vivant du dis, de l'alfa et du thym qui couvrent la nudité de ses flancs. Rome elle-même a possédé sur son sommet un castellum, et le génie, moderne fondateur de l'Algérie, s'occupe d'exhiber de ses vastes cartons les plans de quatorze villages, qui dans quelques siècles couvriront les Bancs du colosse.
Arrivant à Aïn-Temouchent, poste situé sur la route d'Oran à Tlemcen, à dix-huit lieues de l'une, à quinze de l'autre, entre le Rio-Salado qui se jette dans la mer, et l’Ysser qui va grossir la Tafna ; l'une et l'autre de ces rivières ont un pont.
Aïn-Temouchent est destiné â avoir beaucoup d'importance comme point de ralliement entre deux villes considérables. Un autre embranchement le reliera à Sidi-Bel-Abbès. Ce qui assure la richesse du futur centre de population, c'est d'être aussi à l'affluent de deux cours d'eau, I'Aïn-Temouchent, faible ruisseau, et l'Oued-Snan, plus considérable, capable de faire marcher des usines. Un moulin est indiqué Pour établir un grand commerce de farines.
Ce qui assure sa future prospérité, c'est la haute qualité de son territoire, qui chaque année lui donne d'abondantes céréales. La configuration des terres, toutes en coteaux et en versants, les préserve de ces funestes coups de vent qui, en une heure, brûlent les récoltes dans les plaines d'Oran, du Sig, du Hellat et de Bel-Abbès.
Aussi le marché d'Aïn-Temouchent est un comptoir où il se fait chaque jeudi des échanges considérables en numéraire contre le blé, l'orge, la laine, les troupeaux venant du Maroc et les chevaux peu chers dans ce cercle.
Le territoire d'Aïn-Temouchent possède d'excellente pouzzolane, des carrières de plâtre et beaucoup de minerai de fer, les ruines romaines de l'ancienne ville. Le village sera à quatre lieues de la mer ; grâce à ce rapprochement, les chaleurs de l'été y sont moins fortes.
Le décret du mois de janvier n'a encore reçu aucun commencement d'exécution, et un grand nombre de colons habitent sur le flanc du mamelon, au-dessous du Bordj, des huttes souterraines semblables à celles des Lapons, en attendant impatiemment l'enceinte du village et l'autorisation d'y construire leurs lots urbains.
Aïn-Temouchent est célèbre par l'enlèvement du détachement du lieutenant Marin en 1845 et par son défilé de la Chair, où Abd-el-Kader tenta le 2 décembre d'enlever un convoi considérable revenant de Tlemcen.
Le général de L'Etang qui commandait la colonne sauva le convoi ; il a fait dresser, au ministère de la guerre, le plan de cette journée qui laisse un souvenir intéressant. Le bureau arabe est construit dans l'enceinte du futur village ; il s'est élevé au moyen de touisa, corvées faites par les Arabes, sans frais pour le gouvernement.
A trois mille mètres d'Aïn-Temouchent, sur la route de bel-Abbés, vous trouvez la maison de l'agha Ben-Ganah. C'est un des chefs arabes qui ont le mieux saisi l'esprit français. Il parle assez bien notre langue et en comprend la finesse. Il a fait bâtir un véritable château flanqué de deux maisons inférieures où logent Califa, Crodjat, Caleb. Le flanc de la montagne au pied de laquelle se trouve l'habitation est planté de vignes. Une ancienne plantation de figuiers contiguë à l'aile gauche sert de salon du jour aux habitants. Là, sont étendus de vastes tapis sur lesquels on prend le café d'usage. Sous les mêmes arbres, mais à distance respectueuse, les chevaux attachés à la corde respirent à l'aise.
Tout en observant scrupuleusement sa religion, Ben-Ganah est homme du monde ; il s'assoit avec aisance à la table des Français et les reçoit dans ses vastes salons avec du beau linge, de l'argenterie, du vin de Bordeaux et une excellente cuisine arabe. Son petit nègre Embarraque (heureux) sert la fouta (serviette) sous le bras, et en route remplit les fonctions de grand cafetier. Sa mise est toujours élégante et recherchée, et il emploie des Européens pour ses travaux. Je le crois foncièrement attaché à la domination française. C'est un seigneur de l'ancien temps, un véritable marquis de Carabas. A qui est ce moulin aux Abdéli ? A Ben-Ganah; la moitié de cet autre à Aïn-Temouchent; ces beaux vergers dans les ravins, ces meules de blé et d'orge, ces khramnès (laboureurs) travaillant dans toutes les directions, à Ben-Ganah, toujours à l'agha. Sa maison entretient chaque jour soixante ou quatre-vingts personnes.
Temouchent est un mot berbère dont les Arabes ne connaissent point la signification; ils l'appellent Blad-Ouled-Sultann (la ville des enfants du sultan) ; je n'ai pu retrouver sa dénomination romaine, mais ces ruines indiquent qu'elle était importante. Le nord de la nouvelle ville que l'on bâtit aujourd'hui se trouve au sud de l'ancienne, mais sur le marne plateau et avec cette seule différence que l'enceinte de la nouvelle ville se trouve reculée vers le sud et défendue par la crête au bas de laquelle coulent l'Aïn-Temouchent et l'OuedSnam à leur confluent.
En quittant Aïn-Temouchent pour se diriger vers le sud, on franchit une série de mamelons assis les uns sur les autres. Si l'on se retourne après avoir fait deux lieues, on jouit d’un magnifique Panorama.
A l'est vous avez les versants du Thessala qui prennent naissance au lac Salé, toute la chaîne du Thessala jusqu'à la hauteur de Sidi-Bel-Abbès ; vous dominez toute l'étendue du lac, vous voyez les colonies de Bourchage, Boutelélis, Myserghinn, la tour Combes (Cette tour a été élevée en L'honneur du colonel Combes, tué sur la brèche à Constantine), vous devinez Santa Cruz, et votre pensée vous transporte dans la plaine des Andalouses. En face et à I'ouest une chaîne de montagnes inférieures dont la plus élevée à l'ouest s'appelle Sidi-Kassem, c'est le Point de repère pour ne pas s'égarer quand on se rend à Aïn Temouchent. Ces montagnes isolées les unes des autres sont de formes bizarres, dentelées, crénelées ; elles longent la rive droite du Rio-Salado. Plus loin dans l'espace vous apercevez toutes les montagnes qui bordent la mer, partant de Mers-el-Kébir (le grand port) pour venir en tournant à l'embouchure du Rio-Salado.
Le Rio-Salado (rivière salée) coule de l'est à l'ouest, et prend sa source à l'extrémité du Thessala, reçoit sur sa rive gauche pour affluents l'Oued-Mézesma et plus à l'ouest l'Oued-Snam qui, descendant du sud, sert de ceinture au bassin d'Aïn Temouchent. Son cours est à peu près de dix à douze lieues. Avant de se jeter dans la mer, il forme un vaste et beau canal fort large, puis conduit ses eaux à l'issue de ce canal par un simple ruisseau que l'on franchit presque à pieds joints. Le Rio-Salado coule au travers des forêts de lentisques, où se trouvent quelques clairières cultivées par les Arabes, et ses rives sont très fréquentées par les lions.
Partout le paysage est peuplé de marabouts et d'aouchs, monuments au moyen desquels il semble que le peuple arabe ait voulu écrire son histoire. Le marabout porte le nom d'un saint vénéré, ou d'un illustre guerrier.
L'aouch, diminutif du marabout, est un simple carré clos de murailles en pierres sèches à la Hauteur de trois pieds et dans lequel les Arabes suspendent des lambeaux d'étoffes en souvenir de leurs morts.
A l'ouest de Sidi-Kassem et de I'Oued-Mlouf (rivière des Sangliers) se trouve Djeloul. C'est le lieu où l'on va visiter la mer en partant d’Aïn-Temouchent, à vingt kilomètres environ. Là, un banc de rochers d'une haute élévation surplombe perpendiculairement. Sous ce rocher se trouvent des grottes profondes et curieuses par tes pétrifications qu'elles renferment et par la variété des coquillages que la mer y dépose.
En remontant le Rio-Salado sur la rive droite, à peu de distance de ses sources, on rencontre les eaux chaudes de Sidi-Ait ; elles ont soixante degrés, sont alcalines, sulfureuses et laissent déposer du péroxyde de fer. L'élément sulfureux se dégage en arrivant à la surface, de sorte qu'in analysant les eaux loin de la source, la trace sulfureuse disparaît entièrement. Ces eaux sont favorables aux maladies cutanées et aux engorgements abdominaux. Prés de la source, vous voyez un beau bouquet de palmiers, c'est presque toujours l'indice certain de la présence des eaux thermales. Près de là existe le marabout de Sidi-Abdalla-Berkani. La légende arabe dit que ce marabout a été allaité par une gazelle, et, en vertu de ce souvenir vénéré, les gazelles sont, clans ces parages, des animaux sacrés aux yeux des Arabes, qui ne les chassent jamais et les laissent aller en nombreuse compagnie.
A deus kilomètres plus haut que Sidi-Ait sont les eaux chaudes de Bou-Akjar (le père de la pierre) sur la même rive du Rio-Salado. Cette dénomination provient de hautes murailles naturelles entre lesquelles coulent ces eaux. Elles ont les mêmes propriétés curatives que celles de Sidi-Ait, et sont alcalines, ferrugineuses, mais dépourvues de soufre. Leur chaleur s'élève à soixante trois degrés, et même quatre-vingts à la source. II ne parait pas que les Romains les aient employées, puisqu'on n'y rencontre qu'un établissement de bains mores construit far les Arabes et â leur usage. C'est un bassin de deux mètres de diamètre et simplement recouvert par un gourbi en feuillage de lentisque très épais. Il s'y trouve des cuves, mais, comme il serait impossible de s'y plonger sans être cuit, on se jette l'eau sur le corps, se contentant d'immersions faites à la main.
L'aide-major Bertrant, qui depuis deux ans occupe le poste d'Aïn-Temouchent, a guéri un grand nombre d'Arabes au moyen de ces eaux.
En terminant ce petit travail sur tes lieux que je quitte, je rappellerai ce que Mahomet dit à son peuple «Chaque grain d'orbe que tu donneras à ton cheval te «sera compté dans le paradis des houris. » Je dirais volontiers à l'Européen : Chaque arbre que vous planterez et que vous soignerez sur la terre de l'Algérie, vous sera compté dans l'autre vie. Plantez, plantez, voilà la grande, l'importante question de l'Algérie. Si ce n'est pas pour nous personnellement, que ce soit pour nos enfants. Si nos pères n'avaient rien fait, qu'aurions-nous aujourd'hui ? C'est à ce propos que je saisis l'occasion de parler du beau jardin qu'a créé le capitaine Maurandy, commandant du cercle d'Aïn-Temouchent, avec les utiles travailleurs de la légion. C'est une fraîche oasis au milieu de steppes nues. Ce jardin se fait remarquer par la variété de ses arbres déjà grands, quoiqu'il ait à peine trois années d'existence, par la variété de ses fleurs et par un beau bassin en pierre de taille orné d'un jet d'eau. Ce jardin, qui s'agrandit chaque jour, sera la propriété de la future ville.
Depuis huit années que j'habite l'Afrique, j'ai étudié les mœurs des Arabes. C'est un peuple tout à la fois naïf, simple et rusé, enfant dans sa curiosité, dans son honneur à entendre les récits de la veillée; soyez bon pour l'Arabe, et vous aurez ses sympathies. Tout ce qui porte l'uniforme et les insignes du grade a droit à son respect. Il n'en est pas de même de l'habit bourgeois : aux yeux de l'Arabe, c'est un marchand.
Je suis bien Loin de partager le système que j'ai entendu quelquefois mettre en avant, à savoir la destruction totale des Arabes en cas de reprises d'hostilités de leur part, ou leur refoulement absolu sur les confins du Tell.
Rien ne serait plus impolitique. La population européenne se fixant pour toujours sur le sol de l'Afrique, avec l'intention d'y perpétuer la famille, et non d'y faire une rapide fortune, per fas et nefas, n'a pas besoin de refouler les Arabes, et de leur demander leur place ; laissez-les arriver à vous avec leur bétail, leurs volailles, leurs grains. Dans aucun cas, l'on ne doit désirer l'extinction de la race arabe, car il y a de vastes contrées qui ne seront jamais propres à l'Européen, et qui conservant les tribus de pasteurs nous paieront l'impôt et nous seront toujours utiles.
La colonisation européenne est nouée en Algérie. Trop d'entraves jusqu'ici, trop d'exigences, trop de lenteurs. Ouvrez l'Algérie sans conditions à l'appétit des gens ambitieux de terre. Créez la grande féodalité territoriale sans conditions, et alors vous verrez accourir des capitaux, boiser les landes dénudées, ce que ne saurait faire le petit colon.
Ou bien, d'après ce principe, que la terre conquise appartient au conquérant, colonisez militairement, donnez d’une compagnie, à un bataillon tant d'hectares en toute propriété, et au bout de peu d'années vous aurez des villages qui respireront l'aisance et la prospérité.
Marquis DE MASSOL,
Officier au 1er régiment de la légion étrangère.
| |
PHOTOS DE TIMGAD
Envoyées par Groupe de voyage Bartolini
|
|
Pieds-Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N'202, Decembre 2011
|
|
Bananes imitées
20 minutes : Cuisson : 35 minutes

Ingrédients :
250 g de farine,
3g de sel,
100g de sucre fin,
3 jaunes d’œufs,
150g de beurre,
250g d’amandes moulues,
150g de sucre fin,
de l’eau de fleur d'oranger,
de la cannelle,
1 blanc d’œuf,
du safran,
Du chocolat fondu.
Préparation :
Après avoir reposé l5 minutes, travailler la pâte sablée avec la farine, le sel, le sucre fin, les jaunes d’œufs et Ie beurre.
Aplatir la pâte et y découper des rectangles de 10 cm de long sur 5 de large. Déposer sur chaque rectangle un cordon de pâte d’amandes préparée avec les amandes, le sucre, l’eau de fleur d'oranger ainsi que la cannelle.
Enfermer puis donner la forme la plus rapprochée d'une banane avec les deux bouts légèrement en pointe.
Ensuite, les mettre au four sur une plaque et cuire.
Glacer les gâteaux refroidis avec du blanc d’œuf coloré au safran.
Laisser sécher et tracer au pinceau des rayures verticales avec du chocolat fondu. Vos délicieuses bananes sont prêtes à être dégustées.
| |
|
Piqûre de Rappel - (Toujours d'Actualité)
Par M. Alain Algudo
|
|
LA CHAPE de PLOMB
Le 31 Août 2012
Elle est en train de s’installer sur notre pays ! Facilement ! Le laxisme issu de l’arrivisme politique, l’inconscience d’un peuple conditionné par la désinformation et en face, « le progressisme » enfanté en mai 68 qui met en place ceux qui, sans coup férir, observent et profitent de cet état d’esprit suicidaire qui mène notre pays droit dans le mur de l’obscurantisme.
Cet obscurantisme les révolutions dites des « Printemps arabes» le mettent en place en Afrique du Nord face à la France, l’Espagne et l’Italie d’abord, mais a l’Europe du Nord aussi.
Et ces évidences ne suffisent pas à notre peuple de vacanciers qui se plaint seulement de ses conditions de vie, malgré tout uniques au monde, sans se soucier une seconde que la chape islamiste qui s’abat, avec l’aide de la France, entre autres, sur des pays qui n’étaient certes pas dirigés par des modèles de démocrates, mais qui maintenant sont ouvertement les pourvoyeurs des hordes de la « djihad » qui s’installent tous les jours un peu plus sur l’occident Chrétien, tels ces essaims ravageurs propres à l’Afrique.( cf., à ce sujet, l’avertissement du Juge BRUGUIERE dans sa lettre du 20.12.2011 sur l’affaire AZF de Toulouse)
Et encore, devant les exemples de l’emprise de « la fascismlamisation » de ces pays, devant cet échec retentissant de ce qui n’était que d’utopiques « libérations » qui se transforment en radicalisations rétrogrades prévisibles, si ces mêmes soutiens des « libérateurs » sinon reconnaissaient leurs erreurs, mais au moins se taisaient, nous pourrions comprendre, l’erreur étant humaine.
Eh bien non, ils s’en vantent encore et critiquent ceux qui ne les suivent pas aujourd’hui dans un autre conflit où, encore, « les barbus » ont déclenché les hostilités !
Cependant, comme nos porteurs de valises suppôts de nos assassins de 1954 à 1962, ils n’iront jamais s’installer ou prendre des vacances dans ces « paradis retrouvés ! »
Ils provoquent le chaos et ils se tirent ! N’est-ce pas Monsieur SARKOZY ? affublé de votre « tartarin » BH. Lévy, l’anti-France personnalisé, triste, néfaste et pitoyable complice qui aujourd’hui n’a même plus la « reconnaissance du ventre » pour son « bienfaiteur ! »
Les barbares-destructeurs de TOMBOUCTOU vous disent aujourd’hui… Merci !
Alors depuis votre « refuge de luxe, » ayez au moins la décence de vous faire oublier ou partez « agir» contre les « libérateurs islamistes de la Libye » que vous avez aidés et qui mettent en pièce le nord MALI….. grâce à vous et à l’OTAN comme au KOSOVO, province Chrétienne historique Serbe devenue aujourd’hui islamiste et indépendante.
Tout est en place dorénavant sur le pourtour Méditerranéen. Une logistique terrifiante nous fait face, avec le réservoir de l’Afrique Subsaharienne où les moyens matériels et humains sont d’une ampleur rarement atteinte dans l’histoire.
Il ne s’agit même plus d’une simple réalité mais d’une menace immédiate puisqu’une puissante « 5°colonne » est en place sur l’étendue du territoire Européen et que tous les rouages de la société sont touchés, gangrenés, cancérisés.
Et ce ne sont que les prémices, une goutte de l’océan des possibilités de ce monstre d’une duplicité calculée et d’intolérance affichée, aux moyens financiers considérables qui, déjà, approvisionnent cette menace qui nous infiltre sur le territoire Européen, avec la complicité des financiers de l’immobilier, du sport et des politiciens véreux avides de pouvoir, les pétrodollars font la loi et ne se cachent plus pour installer leurs faisceaux de « baïonnettes » (dixit ERDOGAN) à l’ombre des minarets qui se multiplient, inaugurés par nos Ministres irresponsables d’un État soi-disant laïc, pendant que disparaissent beaucoup de nos églises.
Alors, quand une élection concernant les plus hautes instances de la direction de notre pays et de la promulgation de nos lois mettant l’avenir de notre Nation en jeu, se fait par le basculement des voix des tenants de cette hégémonie menaçant notre civilisation millénaire, le pire est à craindre et il est clair qu’une CHAPE de plomb s’abat sur notre avenir et celui de nos descendants immédiats.
Sans sursaut rapide :
« Aléa jacta est »
« La tolérance, c’est le mépris bourgeois de l’autre. La tolérance, c’est le cache misère d’une société qui se suicide lentement, par persuasion publicitaire, dans le confort et le conformisme intellectuel »
J.H HALLIER (+)
Texte rédigé par Alain ALGUDO
Président des Comités de Défense
des Français d’Algérie et des Agriculteurs Rapatriés
Vice-président de VERITAS
| |
FRAGMENTS MORCELES DE MEMOIRES
Par M. J.C. Perez
ACEP-ENSEMBLE N° 294- décembre 2014
|
|
Sans crainte du malheur
sans espérance de gloire...
Nous sommes en train de vivre une année au cours de laquelle seront célébrés deux anniversaires.
Le centième anniversaire de la « grande boucherie » que représente la guerre de 1914 - 1918 au cours de laquelle les « pol-pots » d'Occident s'en sont donnés à cœur joie.
Le 1er novembre 2014, nous n'oublierons pas le 60ème anniversaire du déclenchement officiel de la guerre d'Algérie. Une guerre qui n'est pas encore terminée. Je ne parle pas d'une guerre contre l'Algérie. J'évoque une guerre qui fut déclenchée en Algérie contre la France, contre l'Occident, contre la Croix, lors de la Toussaint 1954.
Les différentes réflexions dans lesquelles je me suis plongé à propos de la guerre d'Algérie, m'ont appris une chose : il faudra dorénavant revoir très sérieusement la loi de Lavoisier. Celle qui nous apprend que dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
On se rend compte en effet que, dans les milieux bancaires, d'énormes quantités d'argent disparaissent parfois du jour au lendemain. J'insiste, cet argent disparaît. Il n'est pas transformé en investissements de luxe, de prestige, ou tout banalement utilitaires. On fabrique ... du vent.
Jacques MARSEILLE, dans la perspective de clarifier l'évolution des empires coloniaux, aurait expliqué la colonisation par le souci capitaliste de transformer I'argent qui stagnait dans les banques.
Le transformer en production. Ce qui revient à affirmer que ce n'était pas pour faire de l'argent que l'on a colonisé, mais plutôt pour utiliser de l'argent excédentaire. Un argent qui risquait de s'atrophier. Qui risquait de mourir. Qu'il fallait réanimer.
On a colonisé pour transformer de l'argent inutilisé en « matériau » de production et de consommation. En moyen d'existence.
On l'a transformé en « vie ». Dans la perspective de faire encore plus d'argent, certes. Car ces gestionnaires ne sont pas des philanthropes.
Cette perspective était, sans conteste, matérialiste. Matérialiste « hyper-positiviste ». C'est indiscutable. Ce matérialisme avait l'avantage de s'identifier à un vecteur de Vie. Or, c'est au milieu de la vie, ce n'est qu'au milieu de la vie, que les hommes doivent exprimer leur liberté,
Et à partir de leur liberté expérimenter, s'ils le veulent, s'ils en sont capables, s'ils le méritent, la recherche et le vécu de Dieu.
Ce potentiel de I'argent ne conférera jamais à ce dernier la puissance et le rayonnement de Dieu. L argent c'est un moyen. Ce n'est pas un but. Ce serait dénaturer l'argent en tant que moyen d'action que de croire cela.
Moïse l'avait enseigné avec vigueur, même si son frère Aaron ne l'avait pas compris.
Et comme Moïse l'avait annoncé dans le Deutéronome, un autre est venu après lui nous enseigner ce que lui-même avait annoncé.
Il annonçait Jésus. Le Messie. Jésus, nécessaire incarnation de Dieu parmi les hommes, leur fit connaître à travers la vérité de son maître, cet enseignement déjà proclamé dans le Deutéronome par la voix de Moïse.
Le défunt Jacques MARSEILLE est allé plus loin dans son analyse. Il a écrit dans son énorme thèse de doctorat d'Etat qu'à un moment donné ces colonies ont fini par coûter plus cher qu'elles ne rapportaient. Ou plutôt elles ne rapportaient pas assez, parce que les investissements étaient privilégiés, routiniers, conventionnés.
Le capitalisme financier, au nom du sacro-saint principe du sauvetage de l'argent, ainsi que de l'augmentation nécessaire de la valeur ajoutée des investissements, et dans ce but là seulement, décida de mettre en oeuvre le « délestage économique du débouché colonial ». Et tout particulièrement de l'Algérie,
Les terres, les hommes, ça ne compte pas ! La vie, la bio, ça ne compte pas !
Les échanges spirituels entre les hommes, ça ne compte pas ! Ce qui compte au-delà de toute mesure c'est « la valeur ajoutée des investissements ». C'est I'argent que fabrique l'argent.
C'est le message mis au point par Pompidou et les ersatzs du gaullisme : le délestage économique du débouché algérien. Délestage nécessaire d'après tous ces ersatzs pour permettre à la France son accession à la modernité. La modernité que nous expérimentons aujourd'hui à travers les brillants résultats économiques et sociaux que nous constatons.
Le veau d'or est toujours debout. Malingre, porteur de malédiction, mais debout.
On se débarrasse donc de l'Algérie pour employer l'argent sur des sites de rentabilité jugés plus performante. Pour faire encore plus d'argent, le plus rapidement possible.
Seulement ,,, seulement quoi ? Ne voilà-t-il pas que les grands animateurs et laudateurs de la décolonisation sont en train de nous dire que grâce à celle-ci, ou plutôt à cause de celle-ci, on a créé de nouveaux sites économiques qui se révèlent non seulement infructueux, mais surtout ruineux. Car la décolonisation se révèle avoir été, avant tout, génératrice de misère et de drames.
La voilà la vérité : nous, sommes en train de crever de la décolonisation qui lut conduite en dépit du bon sens par un capitalisme financier minable et rampant. Aux perspectives étriquées. Obnubilé par le court terme.
Actuellement, dans la nouvelle construction européenne, une velléité de spiritualité essaie péniblement de se lever à l'est de l'Europe. La Pologne, la Bulgarie, et d'autres pays de l'ancien pacte de Varsovie, affirment leur christianisme. Ils défendent, trop discrètement cependant, la thèse historique d'un fondement chrétien de l'Union Européenne. Il semble, c'est peut-être une illusion me diront certains, que ce courant de foi, encore timide, imprègne aussi le monde russe. Un monde extérieur à l'Union Européenne.
Au-delà du rôle joué par des « syndicats d'argent » et certains manipulateurs de l'argent volé au peuple russe, après l'effacement historique du soviétisme, ce peuple semble se retrouver, en de multiples occasions, dans sa loi et dans le vécu temporel de son culte. C'est-à-dire dans son rituel religieux.
Les Russes, dans une perspective d'avenir, ne peuvent pas faire l’impasse sur leur voisinage frontalier avec le monde turcoman. Ils ont fait, eux-mêmes, un constat. A l'ouest de l'Europe, il n'est plus nécessaire de monter la garde aux frontières du « Désert des Tartares ».
Pourquoi ? Parce qu'à l'ouest de l'Europe, les Tartares sont déjà dans les maisons. Ils ont pris acte, en conséquence, que la défense de leurs terres, contre le nouvel envahisseur raciste et religieux arabo-islamiste, exige d'abord la réintégration de la Russie au sein du christianisme.
Celui-ci se définit désormais comme la place forte ultime de la liberté, dans la mesure où sera sincèrement appliquée la décision de Vatican II sur la suppression mutuelle des anathèmes en vigueur depuis le XIème siècle.
S'agit-il d'une amorce de l'accomplissement du message transmis à Fatima le 13 mai 1917 ? Quelques semaines avant la révolution bolchevique ? A savoir que le monde chrétien sera sauvé lorsque la Russie redeviendra la Sainte Russie ?
L’Occident est encore à créer. L’Occident : un territoire où les chrétiens peuvent s'affirmer chrétiens, sans risque de massacres, de déportations, d'incendies, de privation de liberté et d'humiliations. Ce monde-là n'existe pas au sud de la Méditerranée.
A cause des initiatives politiques, d'inspiration satanique ou gaulliste, pour moi il s'agit de termes synonymes, qui ont refusé d'attribuer à un immense territoire, l'Algérie française, le rôle de terre de rencontre et d'espérance nécessaire à la santé du monde. C'était cela le rôle qui était dévolu à l'Algérie française.
Ne rougissons pas de notre combat. Nous l'avons mené du mieux possible... contre le monde entier.
Dans ce combat est intervenu un de nos frères d'armes. Je peux parler de Pierre Descaves.
Je l'ai connu en novembre 1960, le soir même de ma sortie de prison. Je jouissais d'une mise en liberté provisoire, après 11 mois d'une détention octroyée par le Haut tribunal Militaire de Paris, lors du Procès des Barricades.
Il était venu avec beaucoup d'autres, m'accueillir à la porte de la Santé. II m'a déclaré d'emblée qu'il était nécessaire que lui et moi organisions une rencontre au plus tôt, dans le but d'étudier la suite opérationnelle qu'il fallait donner à la Semaine des Barricades d'Alger, pour sauver l'Algérie française. Je l'ai donc très vite retrouvé, avec celui qui, à ce moment-là, représentait, lui aussi, et je ne savais pas en novembre 1960, un grand espoir de l'Algérie française.
J'évoque Philippe Lauzier qui à cette époque, militait pour I'Algérie française, en étroite collaboration avec Pierre Descaves. Philippe avait exercé de redoutables fonctions au sein de la résistance contre l'occupant. C'était un ancien de brillantes unités militaires, en particulier du 8ème RICM (Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc), une de nos unités parmi les plus décorées, sinon la plus décorée, qui eut très peu de survivants après la campagne de France de 1940.
C'était un patriote viscéral. Total. Convaincu. Il avait trouvé à cette époque-là, un correspondant parfait de ses convictions dans Pierre Descaves qui, lui aussi, cherchait à la France à travers la vie de l'Algérie française.
C'est dans la demeure familiale de Philippe Lauzier, que j'ai tenu avec lui-même et Pierre, une première réunion opérationnelle.
Pierre, comme Philippe d'ailleurs, était informé de mes antécédents dans le combat clandestin, contre-terroriste, que j'avais organisé à Alger depuis 1955. il connaissait dans le détail le rôle réel que j'avais tenu dans la préparation de la Semaine des Barricades, en 1960 à Alger. Le rassemblement du peuple de Belcourt, du Ruisseau, du Champ de Manœuvre, et du Hamma d'une part, puis une heure plus tard, la conduite des territoriaux et des manifestants de Bab-el-Oued que j'ai mené de la place des Trois Horloges jusqu'au boulevard Laferrière, malgré l’opposition musclée et très hostile du 3ème RPIMA d'abord et des gendarmes mobiles ensuite. J'ai souvent décrit ces opérations qui sont traitées avec dédain par ceux qui se définissent « historiens » de l'Algérie française. Qu'ils sachent que si Bab-El-Oued et ses deux bataillons UT privés de leurs officiers qui tous ont déserté ce matin-là seul le commandant Sapin-Lignières, n'étaient pas parvenus en formation, en uniforme et en masse au Plateau des Glières, vers 13 heures, il n'y aurait pas eu de Barricades d'Alger. Un point c'est tout !
Philippe Lauzier comme Pierre Descaves, savaient tout cela à la fin novembre 1960, lors de ma sortie de la prison de la Santé, en liberté provisoire.
Pierre avait soif d'action. Il était normal ou plutôt logique, c'est lui qui me l'a dit, de s'adresser à moi pour la mise au point d'une action qu'il fallait préparer à paris pour sauver l'Algérie française. Car c'était à Paris qu'il fallait agir. C'était sa conviction et c'était la mienne aussi.
Un troisième élément moteur de grande valeur est venu offrir son concours pour la mise en oeuvre de cette action. C’était le cinéaste Jacques Dupont, ancien de la résistance contre l'occupant et son fils Jean-Jacques. Jean Jacques grâce auquel j'eus accès à toute une jeunesse parisienne avide de se jeter dans l'action pour sauver l'Algérie française. Tous ces volontaires avaient conscience qu'en Algérie française, c'était le salut de la France que I'on défendait avant tout. Avec Descaves, Lauzier et Jean-Jacques Dupont, j'ai connu une vie intense d'activiste parisien.
J'avais appris entre temps que le père de Descaves, commissaire de police, avait été tué à Tlemcen en Algérie. J'agissais donc avec un compagnon d'armes algérien et parisien en même temps, parfaitement décidé à tout tenter pour sauver I'Algérie française.
Pendant le temps libre que me laissaient les audiences quotidiennes du Procès des Barricades, je participais à un travail qui fut entrepris dans le but d'établir des contacts. Pour mettre sur pied une formation révolutionnaire métropolitaine qui devait jouer un rôle essentiel dans le déroulement d'un coup de force militaire qui était en préparation.
J'étais personnellement en contact avec les colonels Broizat et surtout Godard. Ce dernier m'apprit, en présence du chef d'escadron Cazati, (Officier dans un régiment blindé de Rambouillet qui décéda en prison un an plus tard.) I'adhésion de Challe à la conjuration salvatrice de la France en Algérie.
Serge Jourdes, qui était mon brillant alter ego dans cette conduite opérationnelle, était en contact avec Pierre Sergent tout particulièrement et d'autres militaires par l’intermédiaire de ce dernier.
Comme tous mes camarades accusés, je fus acquitté au Procès des Barricades. Je me suis inscrit à l'Ordre des Médecins de Paris grâce à un confrère, ami de Lauzier, qui établit un contrat d'association pour consolider administrativement ma résidence à Paris.
Je fus arrêté. Expédié en Algérie. Le pouvoir judiciaire ne disposait pas des moyens de m'inculper. Je fus interné au camp de Tefeschoun, sur les hauteurs d'Alger. le souligne, comme je l'ai fait à maintes reprises, le caractère absolument illégal de cette mesure dont je fus victime. En effet, à cette époque-là, les assignations à résidence n'étaient pas applicables sur le territoire métropolitain.
Or, depuis le mois de février 1960, j’étais interdit de séjour en Algérie.
Je jouissais d'un statut de résident en terre métropolitaine. J'étais inscrit à l'Ordre départemental des médecins de paris. En aucun cas je n'aurais dû être I'objet d'une assignation à résidence.
Cette décision gouvernementale eut pour résultat que je laissai, par la force arbitraire du gouvernement gaulliste à Descaves, Lauzier, Sergent et Jourdes, le soin de poursuivre la mise en place d'un dispositif qui aurait dû être déterminant si Challe avait opéré comme nous l'avions prévu.
On sait que l'imprévision de Challe entretenue par la volonté forcenée de Denoix de Saint-Marc de refuser à Alger, à Oran et à Constantine l’intervention massive du peuple français, des « civils » disait-il, provoqua l'échec du putsch. Et la nécessité pour nous, de nous réunir dans l'OAS pour tenter la dernière opération de sauvegarde.
Descaves et Lauzier qui évidemment restaient en métropole, étaient en relation étroite avec moi. Ils ont mis en oeuvre ce qu'ils ont pu mettre en œuvre pour que l'OAS-Métro, que Descaves, Lauzier et moi-même avions créée en 1960 avant qu'elle ne s'appelât OAS, puisse aboutir au résultat à atteindre en tout premier lieu : l'élimination de De Gaulle.
Descaves, mon frère d'armes Pierre, m'invita à déjeuner avec Jacqueline mon épouse, le jeudi 25 avril 2014. C'est Michel Ximenès, un ancien et brillant cadre opérationnel du secteur Orléans-Marine de l'OAS algéroise qui me transmit cette invitation à laquelle il fut associé avec sa femme Annie.
Nous nous sommes retrouvés à Nice, dans un restaurant de la Promenade des Anglais. De la part de Pierre Descaves, cette réunion était une rencontre d'adieu. « Je sais que je vais mourir bientôt et je suis venu à Nice pour vous embrasser Michel et toi, avant mon départ ».
J'ai contenu mon émotion et je l'ai traité un peu cavalièrement, à la manière irrespectueuse d'un carabin qui refuse de vieillir. Je lui ai dit textuellement : « tu mourras quand tu mourras mais je refuse de prendre le deuil tant que tu es vivant ! ».
Il a pu, malgré son épuisement, malgré la chaise roulante que je véhiculais, évoquer le passé et I'avenir. Chose curieuse, il a tenu à me remercier !
« De quoi ? » lui ai-je demandé.
« De m'avoir permis de tenter l'opération contre De Gaulle à Pont-Sur-Seine, le 15 septembre 1961. Tu l'as fait, alors que tous les autres à Alger se noyaient dans des considérations de préséance, de postes à occuper. Tu as déclaré à mes émissaires : si vous tenez une opération montée contre De Gaulle, n'hésitez pas, foncez ! Dites à Pierre que je prends cette décision sur ma tête.
Donc cette opération c'est toi qui l'as décidé. Je l'ai d'ailleurs écrit dans mon livre " La Salsa des cloportes " et aujourd'hui je le remercie de m'avoir donne cet ordre ».
Je n'ose écrire l'émotion qui fut la mienne à cette évocation qui était, de sa part, un hommage à la décision que j'avais prise, seul, durant I'été 1961, à Alger.
Ce 25 avril 2014, nous étions là, deux responsables majeurs de notre combat clandestin en Algérie française.
Nous étions à la veille de la mort de l'un de nous et nous évoquions avec émotion les orientations que nous avions prises en commun.
Ce 25 avril 2O14, à Nice, Promenade des Anglais, ce fut l'adieu d'un chef, d'un Responsable, d'un Patriote.
Au-delà des banales frontières de la vie. Je lui transmets mon affectueux salut de frère d'armes. Pierre Descaves nous a quittés le 7 mai 2014.
Mais.... La vie continue. Il faut encore se battre.
Nourrir l'ambition d'évoquer ce que fut le drame de l'Algérie française, ce n'est pas un comportement névrotique ou masochiste. C'est un comportement logique. Une logique qui nous permet de comprendre l'agression que la France et l’Occident subissent actuellement.
Une obligation irritante nous est imposée parfois : avaler des couleuvres de la part de certains mini-césars. Certains capitaines-genéraux d'associations qui éprouvent le besoin de nous renier.
Cette évocation du départ de Pierre et de ma rencontre avec celui-ci le 25 avril dernier, me fait un devoir de relever les propos d'un président d'association.
Propos tenus le soir du 1
er mai, qui nous gratifient d'une déclaration d'hostilité. Ce capitaine-général de la mémoire ne veut pas que L'on évoque I'Algérie française à travers les drames qu'elle a connus. Il refuse que soient relatés nos combats, les drames que nous avons vécus, drames subis ou drames que nous avons provoqués.
Pour lui, que des centaines de prisonniers de guerre français n'aient jamais été rendus à la France, des soldats dont on a honte d'évoquer le sort qui fut le leur et sur lequel je me suis exprimé des milliers de fois depuis des années, voilà un drame qu'il faut oublier.
Le massacre de centaines de Pieds-Noirs à Oran le 5 juillet 1962, l'assassinat de dizaines de Français d'Alger le 26 mars 1962 par les gaullistes, l'assassinat de Piegts, Dovecar, Degueldre, Bastien-Thirry, tout cela, on doit le taire.
Il ne faut évoquer que la vie heureuse que nous avons connue en Algérie avant le 1er novembre 1954.
Quant aux dizaines de milliers de Harkis scandaleusement lynchés.... n'en parlons plus ! Nos vies de clandestins, les trahisons dont le peuple français multiconfessionnel d'Algérie fut victime, nos séjours en prison, notre condamnation à mort par contumace pour quelques-uns d'entre nous, nos frères d'arme fusillés, les incertitudes de I'exil avec leurs périls que j'ai connus parfois, tout cela, ça ne compte pas !
Parlez-nous d'autre chose !
Nous ne renions pas l'Algérie heureuse. Nous la connaissons bien. Mais des enthousiasmes sont nés là-bas, des souffrances, des épreuves qui ont ouvert les yeux de ceux qui ont enregistré qu'il faut comprendre pour savoir. Pour expliquer et enseigner la nature de I'agression dont nous fûmes victimes en Algérie française. Ce n'est pas commettre un pêché contre l'intelligence que de dénoncer les crimes, leurs auteurs et leurs complices.
Que de prétendre s'opposer aux même crimes que l'on s'apprête à perpétrer aujourd'hui sur le territoire national contre notre peuple français multiconfessionnel du nord de la Méditerranée. Je suis, moi aussi, nostalgique de la vie que j'ai connue là-bas. Ce pays, qui m'a offert cette vie, je l'ai défendu en jouant tout.
Tous savent que j'aurais pu connaître une vie confortable, paisible, sans danger et fort agréable, si j'avais joué le rôle d'un praticien pas du tout gêné par la perspective de tourner le dos à l'Algérie française. D'exercer ailleurs, dans le confort, mon noble métier, libéré de toutes préoccupations matérielles et judiciaires. Je n'avais qu'à parler pour pouvoir le faire.
L'Algérie Française à défendre et à sauver, c'était une thèse génératrice d'enthousiasmes. Des enthousiasmes à vivre et à transmettre pour permettre à la France de déployer sa véritable identité.
Une thèse qui s'offrait à ceux qui, en Algérie, étaient conduits avant tout par l’instinct du beau vers lequel il fallait faire voguer notre patrie.
Laissez-nous raconter nos combats.
Laissez-nous faire l'effort d'identifier les compagnons de Satan qui en France, ont été complices de l'abandon de l'Algérie française.
Savoir c'est utile, c'est rassurant, c'est reposant. Car au fond de moi, s'affirme avec vigueur la conviction d'avoir agi comme la logique, l'honneur et mon devoir l'exigeaient.
Mais... ce n'est pas fini ! Le combat est toujours d'actualité. Le même combat.
Aujourd'hui encore plus qu'hier. C'est justement parce qu'il y eut un hier exceptionnel qu'il nous faut le connaître, le comprendre, et si possible le faire comprendre.
L'Algérie française doit être racontée, révélée à ceux qui ne l'ont pas connue.
Nos enfants et les autres doivent connaître l'identité de ceux qui l'ont reniée, de ceux qui l'ont empêché de vivre.
L’identité de ceux qui ont tout tenté pour l'abandonner à un destin qu'elle ne méritait pas.
L’Algérie Française vivra encore le temps que vivra dans les mémoires le combat que nous avons mené pour la garder Française et occidentale.
Nice, mai 2014
Jean-Claude PEREZ
| |
REFLEXIONS
par M. Robert Charles PUIG.
|
Danger
L'occident de Dunkerque à Tel-Aviv se trouve attaqué. Il n'y a plus de frontières qui résistent au communautarisme et au terrorisme international.
Nous sommes les innocents qui tendons notre coup au douk-douk assassin et Israël est le dernier exemple de cette machination horrible d'une population soumise à la sauvagerie d'associations jusqu'auboutismes qui espèrent que leur cause, s'il en ont une, réussira à éliminer la démocratie. Ne nous faisons pas d'illusions, ces mouvements terroristes ont des relais qui les soutiennent, au Liban, en Iran et malheureusement dans nos pays en Europe par des franges politiciennes qui croient que leur soutien à la politique du pire leur ouvrira les portes d'un pouvoir qu'ils espèrent. La France dans ce cadre est mal placée. Elle a hurlé avec les loups si souvent dans son "ni-ni" ou son "en même temps" pour montrer du doigt accusateur les patriotes qui justement s'élèvent contre cette façon d'assimiler les extrémistes barbares à des moutons mais Macron a toujours montré sa préférence tactile pour l'Algérie terroriste contre notre Histoire de France. Il a soutenu le Qatar, banquier des mouvements terroristes et organisateur de la dernière coupe du monde du football et maintenant le locataire de l'Élysée ne voit aucun inconvénient à ce que l'Arabie saoudite fasse la même chose. De ce fait, nous sommes en France dépassés par ce tsunami terroriste qui ne voit pas les banlieues désobéissantes à l'ordre publique avec un gouvernement qui abreuve Marseille de financements obscures dont on ne sait pas à qui ils profitent mais toujours avec des crimes en pleine rue mettant la population en danger.
Est-ce que le peuple français se rend compte que nos instituions frileuses refusent de déclarer coupables les associations sanguinaires qui nous veulent du mal jusqu'à obtenir notre fin du monde civilisé en nous éliminant. Je lis, je vois, j'entends. Notre démocratie est trop faible pour répondre aux attaques barbares. Pourquoi ? Parce que depuis trop longtemps, principalement dans notre pays nous avons laissé le champ libre à l'envahissement par le Sud ou l'Orient d'individus qui n'ont que haine et ressentiment contre cet Occident dont nous faisons de moins en moins partie car de nombreux individus dans notre pays sont déjà dans des griffes étrangères avec l'aide d'associations et de partis politiques qui ne voient dans un changement à venir que leur propre émergence irresponsable et la possibilité de prendre le pouvoir.
Que sera demain ? Israël vient de nous prouver que ce pays avait des faiblesses. Des failles politiciennes avec un pouvoir contesté, des failles dans son armée jugée invincible puis avec son "bouclier" anti missiles qui a montré ses limites puis avec certainement un service secret affaibli, mis au pied du mur par son inertie à voir le danger venir du Hamas. Israël a eu plus de 600 morts et de nombreuses victimes. les médias font tourner en boucles ces scènes atroces. Mais qui se souvient de l'Algérie ? Alger et l'armée française qui tire sur une foule pacifique... Oran et ses 3.000 victimes et plus ?
Permettez-moi à ce sujet cet aparté hors notre contexte actuel de blessés et de morts. Jean Pierre Elkabbach décédé, est présenté comme un des meilleurs journalistes que nous ayons eu. Il fait la une et les reportages de tous nos médias. Je veux bien mais, au temps de l'Algérie française, de la ville d'Oran où il est né, a-t-il une fois défendu sa ville et évoqué les attentats du FLN contre les civils ? Tous les morts et disparus du 5 juillet 1962 ? Je crois qu'il se sentait appartenir plus aux juifs magrébins d'un temps millénaire que d'être devenu Pied-noir par le décret Crémieux. Non, il ne me semble pas qu'il ait une fois défendu la cause d'une terre qui a donné à ses ancêtres la liberté d'être français et qu'il n'a jamais montré sa volonté d'être l'avocat de cette Algérie française. Bien entendu, je peux ne pas tout connaître de ses écrits alors j'attends que mes remarques soient infirmées... éventuellement.
Je reviens aux tristes sujets qui nous affligent aujourd'hui. Notre peuple a les mêmes inquiétudes et les mêmes craintes que ce peuple d'Israël avec la politique hésitante du "ni-ni" et du "en même temps" du chef de l'Etat que je pourrai comparer à une politique du "Ni figue ni raisin" aussi inutile. Nous subissons cette idéologie du wokisme qui nous rend vulnérable avec un gouvernement et un président qui croient avec des mots résoudre les problèmes de la migration sauvage, de la sécurité comme celui de la Corse. Des mots. Du vent ! Il y a Marseille toujours aux prises au gangstérisme des rues et depuis peu, la Corse que le président croyait mettre dans sa poche avec ses intentions verbeuses d'une indépendante au sein de la république.
En effet, comment être dans la république et "dehors" ? Je ne pense pas que les corses pouvaient se laisser prendre à ce piège qui tend une main à une minorité d'insulaires et prive la majorité de son attachement à la république et à la France.. Une fois de plus nous avons du "macron", mais rien ne se passe comme il l'entend, et la Corse prouve que son souhait est obsolète après 18 charges explosives dirigées contre certaines maisons ou villas représentant pour certains corses, l'étranger.
Il faut au pays, il faut à l'Occident une poigne nouvelle qui rende à la vraie démocratie sa place sur l'échiquier mondial. Pour le moment le monde est en ébullition. Il y a tout près de nous l'Ukraine et la Russie sous la menace d'une explosion nucléaire... Le Moyen-Orient se réveille avec les attentas en Israël et peut être un nouveau front face à l'Iran et le Liban. Est-ce tout ? Non. Il y a la Chine et Taiwan, l'islamisme qui nous envahit et enfin les propos inquiétants du Pape qui met la chrétienté en péril avec sa tendance progressiste qui rejoint l'aveuglement d'une certaine franc-maçonnerie anti conservatrice.
Quand le réveil de l'Occident ? Quand une nouvelle France ?
Robert Charles Puig / 9 octobre 2023
Le Paradis sur terre, je ne sais pas, l'Enfer, oui !
Israël ! Une horreur apprenons nous que ce massacre atroce de civils. Des femmes et des enfants, des hommes assassinés, égorgés comme au jour d'un Aïd impie. Inimaginable en ce XXI ième siècle. Pourtant c'est la triste réalité. L'enfer sur terre ! En vérité, ce terrorisme du Hamas suppôt des frères musulmans a ses racines et ses références empruntées chez Dae'ch ou Al-Qaïda, bourreaux de victimes innocentes et tueurs de civils.
J'entends, je lis, je vois... Les chaines de télévisions et la presse écrite font depuis samedi une grande place à ces carnages effrayants d'une population inoffensive. Elles trouvent dans le passé de l'histoire du monde des références, des équivalences à ces hécatombes sanguinaires en Israël... Les Balkans, Boutcha en terre d'Ukraine puis plus loin dans le temps Oradour-sur-Glane. Nos journalistes passent d'une époque à une autre mais oublient l'Algérie, cette ancienne province française.... Melouza... El Halia... Palestro ainsi que l'attitude d'un Benjamin Stora applaudissant à la victoire de l'ALN sur l'armée française lors d'une embuscade où des militaires métropolitains furent tués et les blessés égorgés par les villageois algériens. Faut-il oublier, Alger et Oran avec ses 3 000 et plus assassinés et disparus avec les charniers du petit lac ? Non ! Non ! Rien ne change de cette horrible idéologie des terroristes. Elle perdure mais je n'ai rien entendu lu ou vu rappelant ce temps ancien. Aucune allusion au kidnapping, le viol; la torture, l'assassinat en Algérie... Une fois de plus, la France des élus macronistes, progressistes et des médias gauchisants vaccinés au "complexe des colonies" se gardent bien de réveiller la "Bête immonde" d'une Algérie abandonnée. Plus de soixante ans après cette honteuse fuite, ce destin brisé des Pieds-noirs, ils ont peur du communautarisme qu'ils ont encouragé, entretenu, du salafisme qui s'est imposé dans nos régions et des frères musulmans, partisans de notre élimination.
Aujourd'hui, tout à coup le gouvernement se réveille-t-il ? Prend-t-il conscience de ses erreurs et ses mensonges en protégeant les centres religieux ou scolaires juifs de France ? Est-ce un sentiment d'inquiétude, de peur qui l'anime ? Tout à coup, devine-t-il le pays sous l'emprise d'une agression à venir, comme en Israël ? Pourtant, j'ai l'impression d'un malaise, d'une hésitation dans le soutien de nos élites politiciennes à ce pays en deuil. Elles jouent sur une double option. La désolation, devant le massacre des civils israéliens mais aussi la continuation ou plus, la vassalité avec l'Orient... L'Algérie, toujours exigeante, agressive depuis l' indépendance offerte par De Gaulle et des présidents de la république de plus en plus aveugles et soumis qui se plient à ses revendications... Nos élus aujourd'hui s'inclinent devant les exigences étrangères et désignent toujours "coupable" l'O.A.S., défenseur d'une plus grande France mais jamais le F.L.N. responsable des pires exactions et crimes contre des femmes enlevées, violées, assassinées et des hommes torturés, aux membres brulés, au sexe tranché dans un geste machiavélique d'effroi et d'épouvante.
Israël ? C'est l'éternel recommencement de la haine et de l'horreur tandis que la France a fait un choix et des alliances contre nature ave l'Arabie saoudite... Le Qatar fournisseur des terroristes. Nous avons offert des ponts d'or à ces royaumes et nous avons falsifié notre histoire pour mieux les accueillir. Ils en ont profité ! Aujourd'hui, en ce mois d'octobre que constatons nous ? Israël, malgré sa puissance et ses services secrets réputés a été prise en défaut de vigilance. Des civils, comme en Algérie, ont été atrocement mutilés et exécutés. Des assassinés qui méritent vengeance ! Vengeance en se défaisant de cet esprit de prudence et de faiblesse de cette Europe, de cette France, en affirmant que ces crimes méritent le pire châtiment, ce que nous n'avons jamais su faire en d'autre temps.
Soyons nets et précis. La barbarie doit être vaincue et nos lois respectées. Mais savons nous faire ? Saurons nous nous préserver d'un futur plein de danger à cause de responsables politiques qui veulent ignorer le passé ? Ils jouent les pharisiens et nous mentent. Nous avons sur notre territoire environ 10 millions de musulmans. Beaucoup sont là depuis des décennies mais il y a une jeunesse et un nombre incalculable de migrants qui à 70 % contestent d'appartenir au peuple français et préfèrent la charia à nos lois républicaine. Ils demeurent une source d'inquiétude dans des banlieues interdites à nos représentants de l'ordre. Ils sont un danger pour notre civilisation mais le pouvoir se tait. Il s'est trompé longtemps mais ne veut pas assumer ses responsabilités.
Serons nous demain un prochain Israël ? C'est la question. Robert
Robert Charles Puig / 12 octobre 2023
Soumission perverse
Le temps ne compte pas pour l'islamisme terroriste mais l'Occident n'a-t-il pas été en partie responsable de son malheur avec sa condamnation molle des exactions commises sur son territoire au nom d'une humanité plus proche de l'inféodation que de la raison et de l'ordre ? La France dans ce système a montré ses limites en désarticulant son histoire depuis la fin de l'Indochine et la guerre d'Algérie en1962. Elle a étouffé son honneur, piétiné sa fierté de nation pour admettre qu'elle était une perdante et accompagner les fauteurs de troubles et les esprits gauchisants dans leur désir de réduire l'humanisme du pays à une compassion châtrée en devenant un réceptif de toutes les idéologies pernicieuses qui nous accusent. Le "complexe des colonies "est le signe premier qui a détruit nos valeurs et notre histoire pour faire de notre territoire une terre accusée d'ultra droite nationaliste en étouffant nos lois républicaines et notre champ des partisans.
Baissant sa garde depuis de nombreuses années, nos gouvernants ont cru se protéger des rebellions des banlieues. Permettez-moi d'insister, mais je l'ai déjà écrit. Ce n'est pas nouveau. Le pays est en proie à son complexe d'avoir été grand et c'est dans l'indignité d'avoir mal perdu l'Algérie que de mea culpa en mea culpa, nous nous subordonnons aux exigences d'Orient, laissant se développer sur notre territoire une contestation diabolique et la destitution, l'effacement de notre occidentalité. Cela date d'hier et ce fut le début de notre agenouillement. Dès la guerre d'Algérie Ben Bella et le FLN se parent du voile de l'islamisme. Ils comprennent que l'éducation, la liberté donnée aux femmes musulmanes étaient des obstacles au charlatanisme d'une religion musulmane détournée de ses principes humanistes. Il fallait éliminer le fléau de la démocratie et de l'éducation occidentale.
La Toussaint rouge de novembre 1954 sera l'occasion d'appliquer la doctrine de la terreur et c'est ainsi que Guy Monnerot muté comme instituteur dans la commune de Ghassia est assassiné en même temps que le caïd Hadj Sadok. Nous avons avec d'autres exactions sanglantes le début d'une longue série d'attentats et de civils enlevés, torturés et assassinés. Nous sommes dans la guerre d'Algérie qui donne à travers l'histoire du FLN le début d'une longue tradition d'effroi et d'horreur que l'on retrouvera avec Daech et Al-Qaïda puis le Hamas et le Hezbollah avec souvent les yeux fermés de l'Occident se sentant coupable de son passé de colonisateur. Une erreur qui se paie.
C'est pour cette raison que nous subissons les assauts de ces groupes portés par une foi démentielle et une propagande mensongère qui conditions ces "non-humains" à tuer. En France, ils agissent pour faire mal, pour détruire l'enseignement; l'éducation nationale. Nous avons eu le meurtre de manuel Paty il y a trois ans et aujourd'hui Dominique Bernard. Un autre enseignant. Entre temps Israël a été soumis au drame le plus effrayant de sa longue histoire avec des assassinats cauchemardesques qui rappellent ceux de l'Algérie avec des femmes torturées et éventrées, des enfants violés et des hommes châtrés dans d'horribles mises en scène. Il faut le dire; l'écrire. Rien n'a changé des repoussantes, épouvantables furies des terroristes. Ils tuent au nom d'Allah certainement drogués de hach et de propagande.
C'est pour ces raisons dantesques qu'aujourd'hui la France est en danger comme l'est Israël. Nous avons laissé faire trop longtemps les indésirables. Nous nous sommes prosternés tournés vers la Mecque et aujourd'hui nous subissons le contrecoup de notre inertie, notre inaction. En fait, nous ne sommes toujours pas dans le temps de la paix depuis l'Algérie. Nous sommes avec l'Amérique du 11 septembre 2001 à New York et nos morts, assassinés en France, - presque 300 - toujours dans le temps de la guerre. Elle est insidieuse, camouflée, mais présente. Il y a eu le Bataclan, Nice... Il y a dans nos villes, nos régions, des loups - des fous d'Allah - qui attendent leur heure, puis tuent. Souvent nos élus de l'ultra gauche, parfois d'autres formations jusqu'au macronisme, déclarant coupable l'Algérie française de sa guerre en 2017, étouffent par leur silence sinon encouragent les crimes et les actions sauvages, barbares d'étrangers à qui nous offrons le toit, le couvert et la sécurité.
Nous sommes mal récompensés de nos bienfaits. Nous devons nous extraire de l'irresponsabilité de nos gouvernants et cesser d'être une terre à conquérir par le salafisme, les frères musulmans avec la complicité de certains partis qui espèrent devenir roi en 2027. Ils visent le pire pour régner sans se douter qu'ils seront aussi balayés comme l'on été en Algérie ces tristes "pieds rouges" qui croyaient faire de 'l'Algérie un pays satellite du communisme et qui ont désenchanté en revenant en France avaler leur idéologie ratée. Le ciel est sombre, l'univers rouge du sang des innocents. Israël réagit pour défendre son territoire. Sommes-nous capables de défendre le nôtre après ce dernier crime d'un professeur sur notre territoire ?
Robert Charles Puig / 15 octobre 2023
A quand le sans faute ?
Depuis des années, nous vivons dans un monde qui n'est plus républicain. Il n'est plus français aussi.
Notre liberté se trouve observée et contrôlée par une engeance progressiste et socialo-gauchiste qui montrent du doigt ceux qui sont contre la perte de nos valeurs occidentales pour le mythe oriental.
Notre égalité est soudoyée par ceux qui tiennent les rênes de notre industrie et notre commerce passés dans des groupes internationaux et qui font que le prix de l'électricité augmente en dépit de notre nucléaire abandonné, que notre existence est soumise aux lois de sociétés régnantes en maîtres sur les marchés mondiaux qui nous imposent leurs prix et leurs méthodes les enrichissant à notre détriment.
Notre fraternité est bafouée. Depuis François Hollande et malgré Ségolène Royale, le drapeau des trois couleurs n'est plus à la mode. Cette idée des socialistes vient depuis l'abandon de l'Algérie française comme pour étouffer la mort et le sacrifice de ceux qui ont voulu défendre une plus grande France. Que fait-on de la Marseillaise, du chant des partisans et de celui des Africains "venus défendre le pays" et qui seront boutés hors de la province française d'Algérie par des gouvernants sacrificateurs? Une partie de l'Occident change et nous avons pris le train dans le compartiment le plus asservi aux lois étrangères.
Cela a commencé il y a longtemps, plus de soixante ans. Dans le mensonge et les contrevérités nous avons, par la propagande imposée, délaissé notre fierté de grande nation en se courbant face au terrorisme. Il ne voulait pas de démocratie et nous lui avons offert les clés de la dictature. Il ne voulait pas d'une éducation libératrice de l'esprit et nous l'avons laissé assassiner un instituteur - Guy Monnerot, en Kabylie - muté dans le bled algérien pour apprendre à des élèves la base du savoir : la lecture et l'écriture. Mais, la destruction de la connaissance ou de l'instruction ne s'est pas arrêtée là.
Il fallait toujours plus détruire l'œuvre civilisatrice de l'Occident. Alors, en France, terre d'asile devenue terre d'accueil de la misère du monde comme l'avait indiqué en son temps Georges Marchais puis Michel Rocard et enfin dans un éclair de conscience Emmanuel Macron, sans contrôle et sans restriction nous avons avec l'Europe aveugle et libérale accepté des sans papiers étrangers sans loi et des tsunamis d'arrivées massives et incontrôlables de migrants du Sud. Ils ne cherchent pas à assimiler le savoir de ceux qui les accueillent et encore moins à s'intégrer dans la société. Ils restent entre eux, insensibles à la démocratie, à la liberté des femmes. Ils agissent entre eux et veulent une seule chose, imposer leurs us et coutumes et faire de l'Europe et en premier temps de la France, un califat islamiste en imposant les lois d'Allah et de son serviteur, Mohamed.
Notre grande honte, c'est lorsqu'une députée de la Nupes de l'extrême gauche française traite le Hamas de "résistant". Des hommes politiques et les médias poussent des cris d'orfraie à ce terme. Oublient ils que ce même mot a été employé avec le FLN algérien sans soulever de polémique ? C'était en Algérie française et tout était bon pour son élimination. Finalement, sommes nous prêts à accepter ce rôle servile de soumis ?
Il semble que des individus souhaitent dans notre pays ce nouveau mode de vie, de vivre. Alors, comme il y a longtemps, après un instituteur assassiné en Algérie, un nouvel enseignant perd la vie. Il est égorgé comme pour un sacrifice de l'Aïd. Il s'appelait M. Samuel Paty et bien entendu nos institutions françaises et l'éducation nationale comme toujours s'inclinent et se taisent face à cet horrible acte terroriste. Il faut étouffer la vérité, se plier aux ordres de l'Orient que nous acceptons les bras ouverts en nous déculottant devant leurs exigences, leurs ordres. Ce n'est pas tout de notre soumission. 250 écoles sont saccagées, incendiées, détruites lors de récentes émeutes de quartiers qui ne sont plus sous le contrôle de l'État. Elles sont indépendants ces zones de non-droit et préparent la grande invasion en refusant aux enfants le droit d'apprendre notre culture. Que fait le gouvernement ? A-t-il arrêté tous ces semeurs de troubles ? A-t-il puni ceux que ne veulent plus de français en France ? Ne veulent plus parler notre langue ?
N'oublions pas à ce sujet que Macron, président de la république pour une deuxième fois, a imposé d'apprendre la langue arabe dans le primaire aux élèves et aux professeurs des écoles, le nouveau mot pour signaler nos instituteurs d'un temps largué aux oubliettes, pour le plaisir de l'Orient ou de l'idéologie du wokisme qui détruit le passé pour un ordre nouveau, celui de l'ignorance et de la fin de l'histoire de la nation. Ainsi un enseignant succombe sous une lame mahométane, des écoles sont brûlées mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer le massacre des innocents. Il faut encore que la main d'un Coran déformé jaillisse et tue un nouvel enseignant. C'est à Arras, M. Dominique Bernard est assassiné au couteau dans son école tandis qu'à Bruxelles le fanatisme de l'État islamiste - E.I.- élimine deux innocents.
Est ce que le désastre humaniste doit continuer ? L'Europe avoir peur ? Israël vient de nous montrer combien le terrorisme international peut, comme dans nos années de guerre entre 1954 et 1962 en Algérie, incarner l'horreur et la terreur avec des criminels sans loi, sans cœur, seulement imprégnés du désir de tuer dans des conditions affreuses, quasi lucifériennes. Après le FLN, Dae'ch, Al-Qaïda, il y a le Hamas, le Hezbollah et tant d'autres associations criminelles qui agissent, forment par la propagande ceux qui égorgeront, assassineront, pour que l'Europe et dans cette Europe la France, s'inclinent, courbent le front vers la Mecque et offrent nos démocraties à la terreur islamiste, au salafisme et aux frères musulmans avec quelques partis politiciens qui ont vendu leur âme au diable et à la lame d'un douk-douk criminel. Est-ce là notre futur ? Nos responsables politiques au pouvoir finiront ils par ouvrir les yeux, sortir de leur léthargie déshonorante ? J'espère un sans faute, enfin !
Robert Charles Puig / 18 octobre 2023
| |
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
| |
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
Météo
Envoyé par Catherine
https://www.tsa-algerie.com/meteo-vague-de-
chaleur-exceptionnelle-sur-lalgerie/
tsa-algerie.com - Par: Zine Haddadi —18 Oct. 2023
Vague de chaleur exceptionnelle sur l’Algérie
Une vague de chaleur déferle cette semaine sur l’Algérie. En plein mois d’octobre, les températures rappellent des valeurs enregistrées l’été dernier.
L’Office national de la météorologie a émis même une alerte vigilance de canicule jaune ce mercredi 18 octobre.
Les wilayas de Béjaïa, Mila, Guelma, Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, et El-Tarf sont concernées par l’alerte canicule de l’office national de la météorologie.
L’office a annoncé des températures variant entre 26 et 38° sur les régions côtières du pays : 28° à Ténès, 32° à Alger et Tlemcen, 35° à Jijel et 37° à Annaba ce mercredi.
Dans les régions de l’intérieur du pays, l’ONM a indiqué que des températures variant entre 27 et 36° allaient être enregistrées : 29° à Tébessa, 30° à Médéa, 33° à Chlef et Relizane tandis qu’il fera 34° à Mila.
Dans le Sud du pays, il fait plus chaud avec des températures allant entre 31 et 40° : 33° à Djanet, 34° à Biskra et 36° à Tindouf.
Gare aux virus de l’automne
La hausse des températures favorise la circulation d’infections respiratoires dites automnales, selon le Dr Mohamed Bekkat Berkani, président de l’ordre des médecins algériens, contacté par TSA ce mercredi.
Le Dr Bekkat Berkani met en garde contre la grippe, les rhumes, les viroses respiratoires et la bronchiolite, notamment chez les nourrissons.
Il conseille, par ailleurs, de se faire vacciner contre la grippe, notamment pour les sujets vulnérables comme les personnes âgées et les malades chroniques.
« Nous avons des températures élevées durant la journée et une chute de plusieurs degrés dans la soirée. Ce temps favorise la circulation des virus. Les gens continuent d’utiliser les climatiseurs, ce qui pourrait accentuer encore plus le risque », prévient-il.
Le Dr Bekkat Berkani suggère de surveiller les nourrissons qui sont vulnérables aux bronchiolites avec le temps qui prévaut actuellement.
Le médecin appelle les Algériens à adopter des réflexes pour limiter les circulations des virus favorisés par la météo de ces jours-ci.
« Il faut s’habituer à porter des bavettes. Quand une personne malade tousse dans une salle d’attente d’une mairie ou dans un endroit clos, le virus circule rapidement. Il n’y a pas de mal à porter la bavette. Nous l’avons bien fait durant le covid », conseille-t-il.
Zine Haddadi
Un député accuse
Envoyé par Christian
https://www.tsa-algerie.com/un-depute-accuse-
il-ny-a-pas-de-penuries-il-y-a-de-la-corruption/
- tsa-algerie.com - Par: Zine Haddadi —04 Oct. 2023
« Il n’y a pas de pénuries, il y a de la corruption »
Y a-t-il des pénuries de produits de large consommation en Algérie ? Le gouvernement rassure à chaque fois que tout est sous contrôle, les tensions sur certains produits sont fréquentes. Après l’huile de table et la semoule, les Algériens ont connu cet été une polémique sur la disponibilité des légumes secs et du riz dont les prix ont augmenté.
Pour faire face à ces tensions, le gouvernement mène une lutte implacable contre la spéculation, tout en mettant à la disposition des commerçants les produits concernés.
L’Office algérien des céréales qui détient le monopole sur l’importation des légumes secs et du riz, a dévoilé les prix de vente de ces produis dans le but de mettre fin aux tensions.
Avant les légumes secs et le riz, les perturbations avaient déjà touché d’autres produits à l’image de l’oignon dont les quantités étaient insuffisantes sur le marché, ce qui a provoqué une hausse vertigineuse de son prix.
Pénuries en Algérie : graves accusations d’un député
Depuis quelques jours, c’est le poulet dont le kilogramme a dépassé la barre de 600 dinars qui est touché par la flambée des prix.
Dans ce contexte, un député du groupe indépendant à l’Assemblée populaire nationale a donné une autre explication sur les perturbations que connaît le marché des produits de large consommation en Algérie.
S’adressant au ministre des Finances, le député Ali Ben Sebgag a affirmé que les raisons des pénuries sont « connues ».
« Il n’y a pas de pénurie, il y a de la corruption », a-t-il lancé, avant de pointer du doigt les Douanes.
Cette corruption « commence au niveau des douanes dont vous êtes le responsable et où on demande aux opérateurs de payer pour faire sortir leurs marchandises ».
Le parlementaire a cité en exemple un opérateur dont les conteneurs sont bloqués au niveau du port pour son refus de payer. Le député n’a pas cité de quel port il s’agit, ni donné le nom de cet opérateur.
« On lui a exigé de payer pour dédouaner sa marchandise. Il n’a pas payé, sa marchandise est toujours bloquée. Le Premier ministre est au courant. Il faut parler des réalités du pays. Il faut éradiquer la corruption », a-t-il ajouté.
Zine Haddadi
| |
|
|
Émouvant, Magnifique
Envoyé par Eliane
|
|
DIS LEUR, PETIT......
Toi, oui toi ! Le petit "Pied-Noir", qui reste accroché à ton mouchoir et qui, depuis 62, l'agite comme pour dire au revoir !
Ta terre n'est plus en vue. Depuis longtemps ! C'est foutu !
Tu ne reverras plus chez toi, ni les douars, ni Lakhdar. C'est trop tard.
Ton bateau est ancré au milieu de nulle part.
Autour de toi il n'y a qu'horizon. Va falloir te faire une raison.
Les années ont passé, va falloir accoster, et pour toujours tirer un trait.
Tu t'es trop attardé, tes yeux se sont usés sur cette ligne imaginaire qui t'a fait espérer.
Même la Vierge Noire n'a rien pu faire pour toi.
Ni pour eux. Ces "autres" qui sont partis, assommés de chagrin, pour mourir dans un coin.
Il n'en reste pas beaucoup, vous n'êtes plus très nombreux.
Je crois même que tu es un des rares survivants à être né "là-bas".
"Là-bas" c'est ce pays synonyme d'abandon, de départ et d'adieu.
Alors ne reste pas là ! Et viens nous raconter, El-Biard, les Aurès, Cap-Falcon et Oran.
On écoutera même cet Alger LA BLANCHE , le pont sur le Rummel, et Bône si t'as le temps
Les belles orangeraies, les fruits du Père Clément.'
Et le Mascara rouge sur la table le dimanche.
Je te préviens quand même, l'histoire de gens heureux n'intéresse pas grand monde.
Mais quand tu vas parler, on va lire ton regard, embrumé comme Tahat au sommet du Hoggar.
On va enfin comprendre ce qu'est être amoureux.
On sera d'abord deux, toi et moi si tu veux, et puis ils vont venir, les enfants, revenir, les aïeux, attirés par tes yeux brillants de mille feux.
Alors ne reste pas au milieu du néant. Ne laisse pas n'importe qui raconter n'importe quoi ! Jette-le ce mouchoir !
Pour que le monde sache ! Pour tous ceux qui sont morts... Pour ne pas qu'on oublie.
Dis-leur que "là-bas" a un nom !
Celui d'un beau pays qui s'appelle Algérie.
Orphelin d'un autre beau pays, ce foutu pays de France.
Et comme disait Camus : de l’Algérie on ne guérit jamais.
- Michel Mitran
|
| |
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|