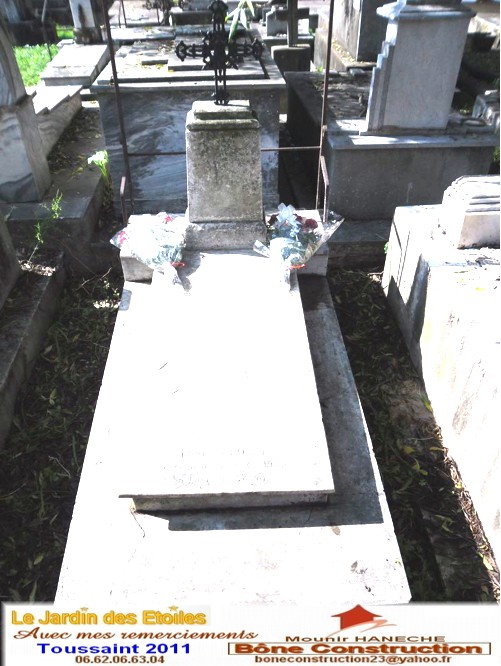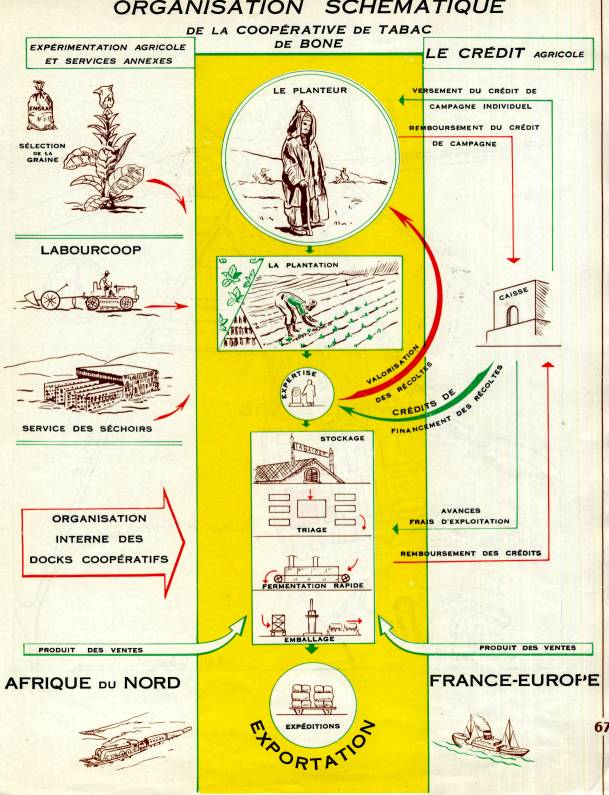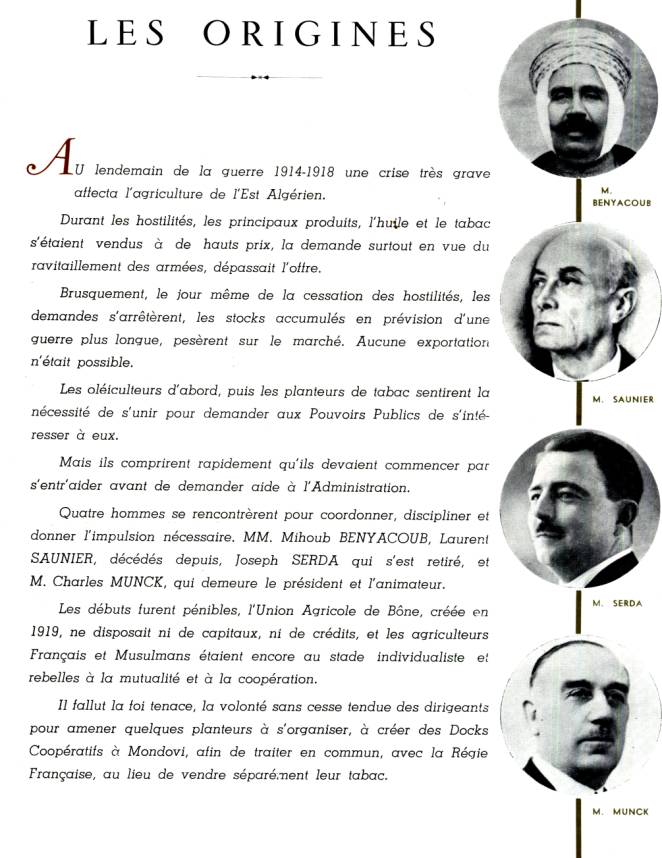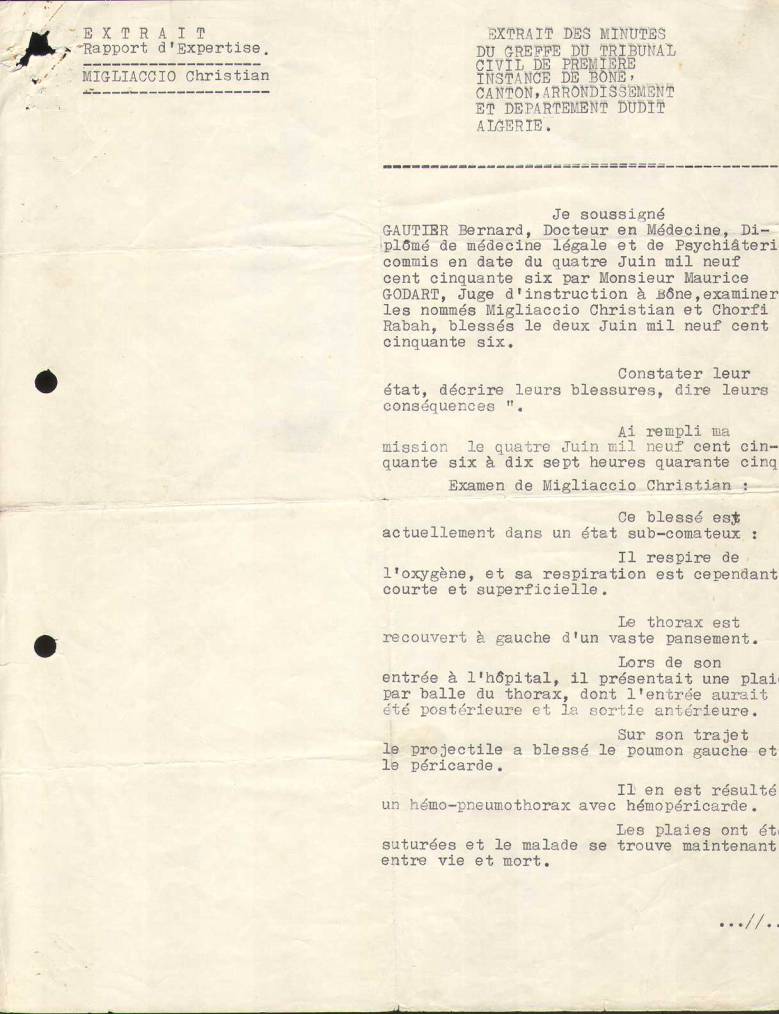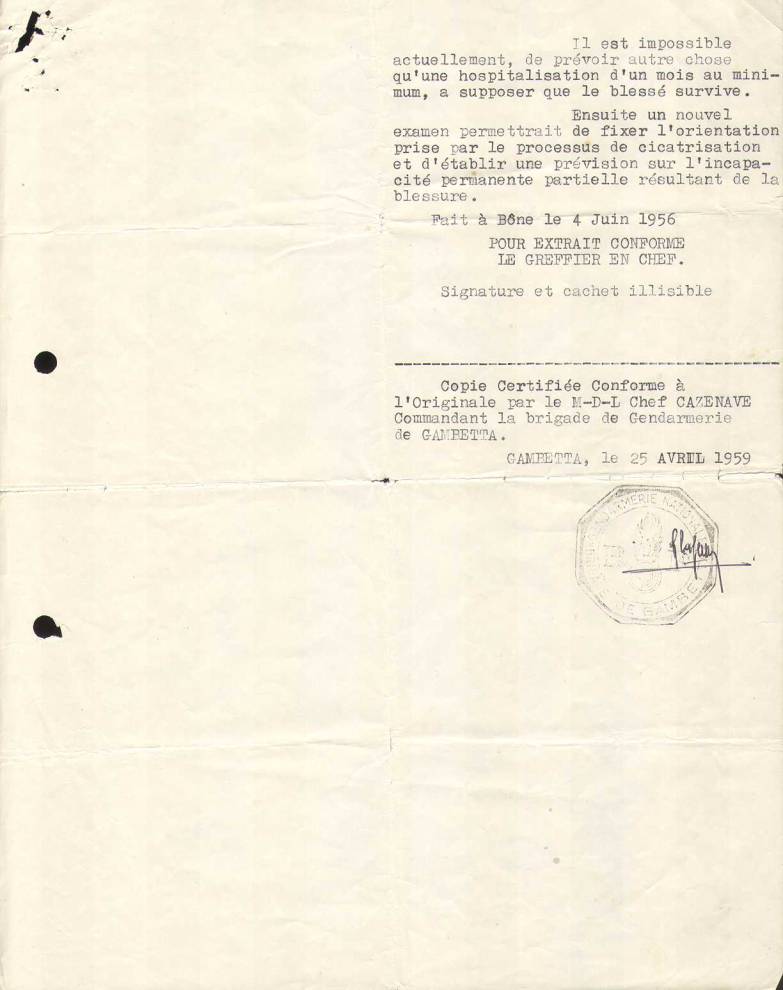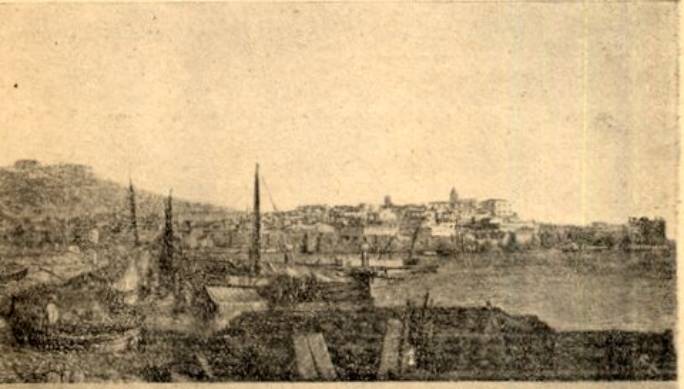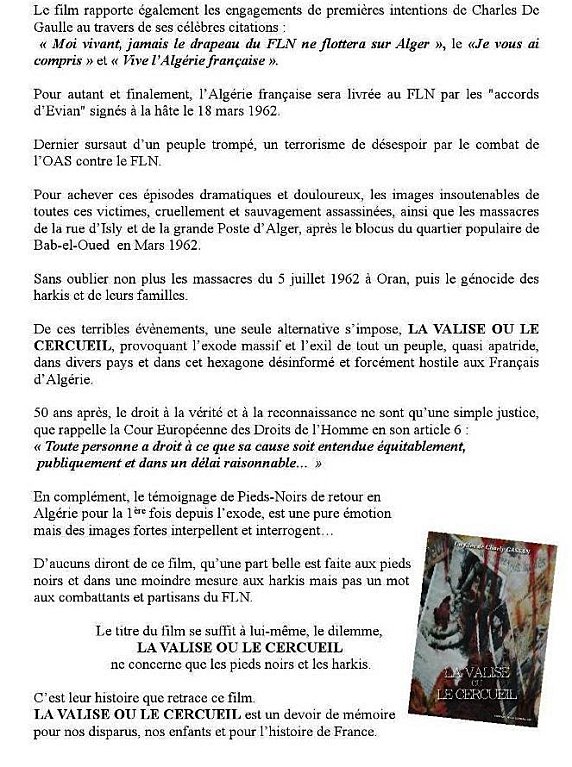|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |
|
|
|
EDITO
LA JOURNEE DU SOUVENIR,
LE JOUR DES MORTS
Le 2 novembre, le jour des morts, est une journée de commémoraison des défunts et c'est le moment de leur faire mémoire afin que l'oubli ne l'efface pas.
A travers le monde, les croyants rendent visites aux morts et prient pour eux et leur repos éternel. Les non-croyants rendent aussi visite aux morts et dans certains pays, ils font la fête. Mais pour tous, c'est l'occasion de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans cette vie et qui nous ont permis d'être là. C'est la journée du souvenir, de la solidarité. On pense à tous ceux, connus ou inconnus, qui nous ont quittés et qu'on n'oublie pas.
Il ne faut pas confondre la Journée des Morts avec la Toussaint qui est une fête religieuse et qui est la journée de tous les saints, célébrée par un jour férié.
Certains pays, dont la France, ont institué des vacances dites " de la Toussaint ".Tous ceux qui le peuvent vont se rendre sur les tombes de leurs disparus et après les avoir rafraîchies et fleuries, ils auront des pensées à extérioriser avec leurs disparus à leurs pieds.
Pour ceux qui sont empêchés par la maladie, par des obligations professionnelles ou qui sont trop loin, il ne leur reste que la très forte pensée intérieure. C'est le cas des exilés comme les Pieds-Noirs mais avec la différence que la plupart ignore s'il y a encore des restes dans les cimetières et dans quel état.
Pour tous ces disparus éloignés, qui sont bien présents dans nos pensées les plus profondes, rappelons-nous leurs qualités ou traits marquants de leur vie afin que perdure cette mémoire de poussière. Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère, déprimant ou ringard, c'est au contraire un vrai témoignage de respect envers eux.
Quand on arpente les cimetières, on voit des tombes qui croulent sous " trop " de fleurs juste le jour des morts comme un air de m'as-tu vu et qui le restant de l'année gardent les fleurs séchées alors que d'autres tombes sont complètement abandonnées. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, même dans la mort.
Donc, le 2 décembre, jours des morts, que vous soyez croyant ou pas, ayez une pensée, la plus profonde qui soit pour ceux que vous avez aimé et qui vous ont quitté, ayez aussi une pensée pour les autres, les oubliés.
Rappelez-vous, qu'un des degrés de civilisation se mesure au respect qu'elle accorde pour ses morts.
La Seybouse et un groupe d'Amis, qui ont fait des voyages en Algérie et constaté l'état des cimetières, ont, dans le respect de la tradition, institué une Opération de fleurissement de tombes appelée " JARDIN DES ETOILES ".
Le Jardin des Etoiles est notre bien-aimé " Cimetière de Bône. "
Il peut le devenir pour d'autres cimetières, il suffit au départ de bonnes volontés et du vrai bénévolat sans arrière pensée ou esprit mercantile.
Cette année, grâce à notre opération, nous avons fleuri plus de 60 tombes dont 22 anonymes (choisies au hasard dans les carrés). Cela a été rendu possible grâce à des dons reçus de personnes dont certaines n'ont pas de défunts dans le cimetière ou qui sont d'une autre ville d'Algérie. Je tiens ici à leur rendre témoignage de leur geste de solidarité et de charité.
Bien entendu cette réussite est aussi à l'actif de notre petit entrepreneur, Mounir Hanéche qui réalise sur place nos souhaits.
Certes, certains vont dire 60 tombes, c'est un grain de sable, mais je leur répondrai qu'il n'en tient qu'à eux de faire grossir ce grain de sable et de le transformer en grosse Rose des Sables. Bienvenue au club si vous le voulez !!!
Cette opération sans aucun rapport associatif, prouve que chacun peut œuvrer pour la sauvegarde de nos cimetières restants afin que notre mémoire d'Algérie perdure. Cette mémoire appartient certes aux Pieds-Noirs mais aussi à l'Algérie d'aujourd'hui car cela fait partie intégrante de son Histoire. Qu'elle le veuille ou non, c'est inscrit dans l'histoire inaliénable et humanitaire.
Cette opération prouve aussi aux pouvoirs publics que s'ils voulaient vraiment œuvrer pour la sauvegarde de nos cimetières, il faut qu'ils s'adressent aux bonnes personnes pour le faire.
Cette opération peut et doit être aussi un réveil des consciences pour les uns, mais elle est avant tout un véritable acte de mémoire pour tous dont nous souhaitons vivement qu'elle perdure avec une véritable aide utile des Etats Algérien et Français.
Cette opération est aussi un acte de paix pour tous nos morts, quels qui soient et c'est pourquoi avec l'accord obtenu en 2006 du Maire de Bône/Annaba et du Consul de l'époque, nous avons fait restaurer une stèle ancienne qui était à l'abandon. Cette stèle, édifiée par la ville de Bône dans les années 1850 à la mémoire de martyrs, nous la dédions depuis sa restauration, à tous les morts sans distinction de race, de religion ou de statut civil ou militaire et nous la fleurissons par une couronne universelle.
Pour bien mettre les choses au clair, seul notre groupe d'Amis a pris en charge cette stèle et en assure l'entretien.
Dans les photos qui suivent vous verrez que toutes les tombes ont les mêmes bouquets de fleurs, ceci pour assurer l'équité et le respect que nous devons à tous nos chers disparus sans distinction de statut.
Pour finir, quelques mots du doyen de notre groupe : " En ces jours du souvenir, ces heures ne doivent pas être uniquement tournées vers le passé. Aux souvenirs teintés de nostalgie et de regrets, ni la mort, ni le temps, ni la tyrannie, ni la haine ne peuvent enfermer la vie humaine.
Et ce qu'il y a de beau, de bon, de grand en chaque être humain, aussi humble soit-il, continuera de briller parmi nous, comme une présence. " Y.J.
Bons souvenirs à Tous
Diobône
Jean Pierre Bartolini
|
|
Tombes fleuries par les familles

Vierge restaurée à l'entrée du cimetière avec fleurissement supplémentaire de Mounir pour nos trois Amis, des voyages, disparus : Marcel Saliba, Marcel Pernice et Gérard Mayer

Tombe : Attanasio, Carré R

Tombe : Bailly, CarréF

Tombe : Blanc, Carré X

Tombe : Caruana, Gonthier, Fug, Carré J

Tombe : Cataldo, Pietri, Carré M

Tombe : Croneiss, Carré U

Tombe : Daubéze, Carré

Tombe : Debono, Carré 4
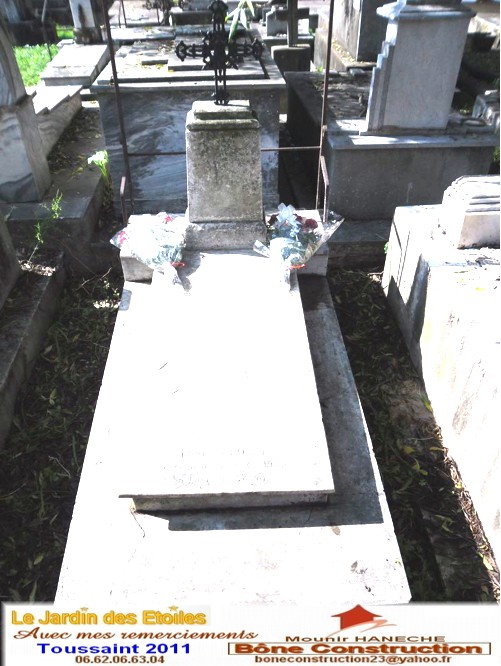
Tombe : Defosse, Carré S

Tombe : Desanti, Carré O

Tombe : Dilettato, Carré M

Tombe : Di-meglio, Carré E

Tombe : Duchene, Carré O

Tombe : Duranti, Carré 4

Tombe : Ferre, Carré Q

Tombe : Gallo, Sciberras, Carré O

Tombe : Gauci, Carré Q

Tombe : Guittard, Carré J

Tombe : Iacono, Carré Q

Tombe : Jacono, Carré 4

Tombe : Jovinelli, Carré X

Tombe : Laumet, Carré 3

Tombe : Lunardelli, Carré Q

Tombe : Madres, Matarese, Mons, Ruth, Carré 3

Tombe : Magro, Carré J

Tombe : Mizzi, Carré J

Tombe : Pardigon, Carré M

Tombe : Pernice, Carré K

Tombe : Rémusat, Carré Q

Tombe : Rosso, Carré 4

Tombe : Sammut, Carré J

Tombe : Sciberras, Sciberras, Carré K

Tombe : Scotto, Latkowski, Carré Q

Tombe : Sultana, Carré O

Tombe : Teddée, Bailly, Carré F

Tombe : Thouvenot, Carré H

Tombe : Veneruso, Carré G

Tombe : Wagner, Carré

M. Mounir Haneche, notre petit frère
sur place qui réalise notre devoir. Merci Mounir
Pour tous ceux qui veulent lui envoyer leurs appréciations, cliquez ICI : MOUNIR HANECHE
Tombes fleuries par les dons reçus
et choisies au hazard

Tombe : Albert, Carré P

Tombe : Aragon, Carré G

Tombe : Bartolini - Girolli, Carré J

Tombe : Cataldo, Carré F

Tombe : Cataldo, Carré Q

Tombe : Ciantar, Carré G

Tombe : Cozzolini, Carré O

Tombe : Debono, Carré R

Tombe : Debono, Carré 3

Tombe : Dilettato, Carré G

Tombe : Eberhardt, Carré M

Tombe : Fontana, Carré J

Tombe : Garrigou, Carré Q

Tombe : Impagliazzo, Carré F

Tombe : Leonti, Carré R

Tombe : Lesavre, Carré X

Tombe : Marchetti, Carré M

Tombe : Migliaccio, Carré Q

Tombe : Pagano, Carré F

Tombe : Pernice, Carré 3

Tombe : Pietri, Carré O

Tombe : Sammut, Carré R

Tombe : STELE DE LA PAIX, Carré J

Tombe : Pionnier de 1830, Carré L
UN GRAND MERCI aux familles et aux généreux donateurs
qui nous ont permis de réaliser cette floraison de quelques
tombes (plus de 60) afin de ne pas oublier ceux qui sont
restés là-bas. Notre souvenir ne peut pas s'eteindre et
faisons en sorte que l'année prochaine soit une année
encore plus "fleurissante".
J.P. Bartolini et Mounir Haneche
|
|
| L'AME
De Germain NOUVEAU
Envoyé par M. Vitus
| |
Comme un exilé du vieux thème,
J'ai descendu ton escalier ;
Mais ce qu'a lié l'Amour même,
Le temps ne peut le délier.
Chaque soir quand ton corps se couche
Dans ton lit qui n'est plus à moi,
Tes lèvres sont loin de ma bouche ;
Cependant, je dors près de Toi.
Quand je sors de la vie humaine,
J'ai l'air d'être en réalité
Un monsieur seul qui se promène ;
Pourtant je marche à ton côté.
Ma vie à la tienne est tressée
Comme on tresse des fils soyeux,
Et je pense avec ta pensée,
Et je regarde avec tes yeux.
Quand je dis ou fais quelque chose,
Je te consulte, tout le temps ;
Car je sais, du moins, je suppose,
Que tu me vois, que tu m'entends.
Moi-même je vois tes yeux vastes,
J'entends ta lèvre au rire fin.
Et c'est parfois dans mes nuits chastes
Des conversations sans fin.
C'est une illusion sans doute,
Tout cela n'a jamais été ;
C'est cependant, Mignonne, écoute,
C'est cependant la vérité.
Du temps où nous étions ensemble,
N'ayant rien à nous refuser,
Docile à mon désir qui tremble,
Ne m'as-tu pas, dans un baiser,
Ne m'as-tu pas donné ton âme ?
Or le baiser s'est envolé,
Mais l'âme est toujours là, Madame ;
Soyez certaine que je l'ai.
|
|
|
|
LA CULTURE DU TABAC DANS LA REGION DE BÔNE
Entre toutes les cultures, le tabac offrit le meilleur champ d'application à la coopération parce qu'il est une culture familiale traditionnelle.
La Tabacoop fut à l'origine un des principaux éléments de l'activité économique de la ville de Bône, à laquelle elle était profondément intégrée. Qu'il le veuille ou non, tout Bônois est plus ou moins "Tabacoopiste " selon l'épithète passée dans le langage courant, ce qui suffirait à indiquer la place qu'elle occupe dans l'existence publique de la ville et de sa région.
La Tabacoop (Société Coopérative des Planteurs de Tabac de la région de Bône) fut créée le 17 février 1921 par la fusion des docks coopératifs et la Société des Planteurs.
 La Tabacoop fut la première des coopératives, la plus puissante et a essaimé toutes les coopératives filiales, groupées autour d'elle, au pied de l'ancienne Hippone.
Cette première création des coopératives Bônoises demeura la base, la pierre angulaire de tout l'édifice de la Mutualité Agricole dans l'est Algérien.
La Société Coopérative des Planteurs de tabacs dans la région de Bône " La Tabacoop " s'était fixée un triple objectif :
- Assurer aux planteurs une rémunération convenable et autant que possible stable (la Tabacoop groupe 11000 adhérents, dont 9000 Français Musulmans).
- Pratiquer une politique de par la distribution de semences sélectionnées pour la culture de variétés appropriées.
- Traiter les tabacs afin de livrer à l'industrie et au commerce un produit irréprochable. Dans les terres qui n'étaient pas propices à la culture du tabac de qualité, on conseillait alors la culture du Coton qui était plus adapté à ce genre de sol.
C'était là des objectifs économiques qui allaient de pair avec des réalisations sociales.
- Fixation à la terre du planteur par une culture familiale.

 Une plantation de Tabac dans la région de Bône
Une plantation de Tabac dans la région de Bône - Elévation de son standing d'existence.
- Assimilation progressive, mais sûre, parce que basée sur l'intérêt, des bienfaits de la coopération et de la mutualité.
Ciantar.charles@wanadoo.fr
| |
| Sachez qu'il est de bons ou de mauvais exilés
ECHO D'ORAN Novembre/Décembre 2005 - N°301
| |
Tous ont la même plaie tapie au fond du cœur,
Quitter ce que l'on est, laisser ce que l'on a,
Partir de désespoir, pour un rêve ou par peur,
Ou l'esprit saccagé de l'horreur du combat...
Peu m'importe vos noms ou votre provenance !
Quand on fuit la folie, on a toujours raison !
Dans le pays d'accueil, aurez-vous de la chance
Ou serez-vous maudits par la fausse opinion ?
Car, selon la tendance on vous accusera
Des fautes du passé ou de crimes infâmes ;
Et selon l'habitant, on vous rejettera
Ou l'on vous dira : " Viens te chauffer à ma flamme ! "
Le peuple est un peu enclin à la fine analyse :
Politique pourrie, ou médias ou partis,
Oubli de vils méfaits, économie en crise
Feront la conjoncture et l'accueil du pays.
Sachez qu'il est de bons ou mauvais exilés,
Que ceux dont l'argent brille au fond de la valise,
Quel que soit leur passé, ont la place assurée,
Les autres, dans les camps, paieront pour la traîtrise !
Pour ceux qui m'ont salie et mise sur la touche,
Je n'ai que du mépris face à leur ignorance !
A ceux qui m'ont donné un toit et une couche,
J'offre un panier d'amour et de reconnaissance !
L'exil est à jamais gravé dans une vie :
Pour certains il est chance ou pour d'autres, blessure,
Mais toujours en secret pleure la nostalgie,
Quand l'injustice faite a brûlé l'âme pure.
Marie-Thérèse BERNABE-GARRIDO
de Frenda-Oran
|
|
|
|
CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS
DE BARBARIE (1857)
PAR M. L'ABBE LÉON GODARD
ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE
AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES
Dominare in medio inimicorum tuorum.
Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.
SOIREES ALGERIENNES
DIXIÈME SOIRÉE
Les lazaristes.
Expéditions modernes contre les corsaires.
" Eh bien ! mon révérend père, dit M. Morelli, vous avez promis de nous parler aujourd'hui de saint Vincent de Paul et des lazaristes.
- Nous y tenons beaucoup, ajouta le jeune marin. Les lazaristes et leur fondateur, c'est la France.
- Je crois que saint Vincent de Paul nous racontera mieux que personne l'histoire de sa captivité à Tunis, dit le père Gervais. L'air est si doux et si calme ce soir, qu'il ne troublera pas la flamme d'une lampe ; et j'ai apporté la vie du saint prêtre, écrite par Abelly, afin que nous lisions cette intéressante lettre où Vincent confie à un ami des secrets que son humilité voulait plus tard ensevelir dans un éternel oubli.
Vincent était déjà prêtre, et il avait vingt-neuf ans, lorsqu'il se rendit de Toulouse à Marseille pour recueillir une part d'héritage qui lui avait été léguée. Au moment de revenir par terre à Toulouse, un gentilhomme de Languedoc avec lequel il était logé l'engagea à retourner avec lui par mer jusqu'à Narbonne. On était en juillet 1605. Vincent agréa la proposition, et nous allons voir ce qu'il en advint. "
Carlotta et la négresse étaient descendues dans les appartements ; elles apportèrent un léger guéridon et une lampe allumée.
Le religieux ouvrit le livre d'Abelly et le passa à Carlotta, en la priant de lire à haute voix la lettre écrite le 24 juillet 1607 par Vincent, délivré alors de l'esclavage. Elle est adressée à son ami M. de Commet. Carlotta fit ce dont on la priait :
" Je m'embarquai pour Narbonne, pour y être plus tôt et pour épargner, ou, pour mieux dire, pour n'y jamais être et pour tout perdre. Le vent nous fut autant favorable qu'il fallait pour nous rendre ce jour-là à Narbonne (qui était faire cinquante lieues), si Dieu n'eût permis que trois brigantins turcs qui côtoyaient le golfe de Lyon pour attraper les barques qui venaient de Beaucaire, où il y avait une foire que l'on estime être des plus belles de la chrétienté, ne nous eussent donné la charge et attaqué si vivement, que deux ou trois des nôtres étant tués et tout le reste blessé, et même moi, qui eus un coup de flèche qui me servira d'horloge tout le reste de ma vie, n'eussions été contraints de nous rendre à ces félons.
" Les premiers éclats de leur rage furent de hacher notre pilote en mille pièces, pour avoir perdu un des principaux des leurs, outre quatre ou cinq forçats que les nôtres tuèrent; cela fait, ils nous enchaînèrent, et, après nous avoir grossièrement pansés, ils poursuivirent leur pointe, faisant mille voleries, donnant néanmoins la liberté à ceux qui se rendaient sans combattre, après les avoir volés; et enfin chargés de marchandises, au bout de sept à huit jours, ils prirent la route de Barbarie, lanière et spelonque de voleurs sans aveu du Grand Turc, où étant arrivés, ils nous posèrent en vente avec un procès-verbal de notre capture, qu'ils disaient avoir été faite dans un navire espagnol, parce que sans ce mensonge nous aurions été délivrés par le consul que le roi tient en ce lieu-là pour rendre libre le commerce aux Français.
" Leur procédure à notre vente fut qu'après qu'ils nous eurent dépouillés, ils nous donnèrent à chacun une paire de caleçons, un hoqueton de lin avec une bonnette, et nous promenèrent par la ville de Tunis, où ils étaient venus expressément pour nous vendre. Nous ayant fait faire cinq à six tours par la ville, la chaîne au cou, ils nous ramenèrent au bateau, afin que les marchands vinssent voir qui pourrait bien manger et qui non, pour montrer que nos plaies n'étaient point mortelles. Cela fait, ils nous ramenèrent à la place, où les marchands nous vinrent visiter tout de même que l'on fait à l'achat d'un cheval ou d'un bœuf, nous faisant ouvrir la bouche pour voir nos dents, palpant nos côtes, sondant nos plaies, nous faisant cheminer le pas, trotter et courir, puis lever des fardeaux, et puis lutter pour voir la force d'un chacun, et mille autres sortes de brutalité.
" Je fus vendu à un pêcheur, qui fut contraint de se défaire bientôt de moi, pour n'avoir rien de si contraire que la mer, et depuis, par le pêcheur, à un vieux médecin spagirique (chimiste), souverain tireur de quintessences, homme fort humain et traitable, lequel, à ce qu'il me disait, avait travaillé pendant l'espace de cinquante ans à la recherche de la pierre philosophale.
" Il m'aimait fort, et se plaisait à me discourir de l'alchimie, et puis de sa Loi, à laquelle il faisait tous ses efforts de m'attirer, me promettant force richesses et tout son savoir. Dieu opéra toujours en moi une croyance de délivrance par les assidues prières que je lui faisais, et à la Vierge Marie, par l'intercession de laquelle je crois fermement avoir été délivré. L'espérance donc et la ferme croyance que j'avais de vous revoir, Monsieur, me fit être plus attentif à m'instruire du moyen de guérir de la gravelle, en quoi je lui voyais journellement faire, des merveilles ; ce qu'il m'enseigna, et même me fit préparer et administrer les ingrédients. Oh ! combien de fois ai-je désiré depuis d'avoir été esclave auparavant la mort de monsieur votre frère; car je crois que si j'eusse su le secret que maintenant je vous envoie, il ne serait pas mort.
" Je fus donc avec ce vieillard depuis le mois de septembre 1605 jusqu'au mois d'août 1606, qu'il fut pris et mené au Grand Sultan pour travailler avec lui ; mais en vain, car il mourut de regret par les chemins. Il me laissa à un de ses neveux, vrai anthropomorphiste, qui me revendit bientôt après la mort de son oncle, parce qu'il ouït dire comme M. de Brèves, ambassadeur pour le roi en Turquie, venait avec bonnes et expresses patentes du Grand Turc pour recouvrer tous les esclaves chrétiens. Un renégat de Nice en Savoie, ennemi de nature, m'acheta et m'emmena en son témat : ainsi s'appelle le bien que l'on tient comme métayer du Grand Seigneur; car le peuple n'a rien, tout est au sultan.
Le témat de celui-ci était dans la montagne, où le pays est extrêmement chaud et désert. L'une des trois femmes qu'il avait était Grecque chrétienne, mais schismatique ; une autre était Turque, qui servit d'instrument à l'immense miséricorde de Dieu pour tirer son mari de l'apostasie et le remettre au giron de l'Église, et me délivrer de mon esclavage.
" Curieuse qu'elle était de savoir notre façon de vivre, elle me venait voir tous les jours aux champs où je fossoyais, et un jour elle me commanda de chanter les louanges de mon Dieu. Le ressouvenir du Quomodo cantabimus canticum Domini in terra aliéna, des enfants d'Israël captifs à Babylone, me fit commencer, la larme à l'œil, le psaume Super flumina Babylonis, et puis le Salve Regina,et plusieurs autres choses, en quoi elle prenait tant de plaisir, que c'était merveille. Elle ne manqua pas de dire à son mari, le soir, qu'il avait eu tort de quitter sa religion, qu'elle estimait extrêmement bonne, pour un récit que je lui avais fait de notre Dieu et quelques louanges que j'avais chantées en sa présence; en quoi elle disait avoir ressenti un tel plaisir, qu'elle ne croyait point que le paradis de ses pères et celui qu'elle espérait, fût si glorieux ni accompagné de tant de joie que le contentement qu'elle avait ressenti pendant que je louais mon Dieu, concluant qu'il y avait en cela quelque merveille.
" Cette femme, comme une autre Caïpha, ou comme l'ânesse de Balaam, fit tant, par ses discours, que son mari me dit dès le lendemain qu'il ne tenait qu'à une commodité que nous ne nous sauvassions en France ; mais qu'il y donnerait tel remède, que, dans peu de jours, Dieu en serait loué.
" Ce peu de jours dura dix mois, qu'il m'entretint dans cette espérance, au bout desquels nous nous sauvâmes avec un petit esquif et nous rendîmes, le 28 juin, à Aigues-Mortes, et tôt après en Avignon, où M. le vice-légat reçut publiquement le renégat, avec la larme à l'œil et le sanglot au cœur, dans l'église Saint-Pierre, à l'honneur de Dieu et édification des assistants. Mondit seigneur nous a retenus tous deux pour nous mener à Rome, où il s'en va tout aussitôt que son successeur sera venu ; il a promis au pénitent de le faire entrer à l'austère couvent des Fate-ben-Fratelli. "
- C'est tout ce qu'Abelly nous a donné de la lettre de saint Vincent, reprit le père Gervais. Il est regrettable que l'on n'en sache pas davantage sur la captivité du saint homme. Son Humilité était si grande, qu'il chercha dans la suite à obtenir l'original de cette lettre pour la brûler ; mais elle fut conservé à son insu. Du reste il ne voulut jamais entrer dans les détails de sa vie à Tunis, parce que sans doute il n exit pu le faire sans parler à sa louange.
- Est-ce qu'on ignore, demanda Mme Morelli, où il a vécu à Tunis, et quel est le lieu où il résida comme esclave du renégat ? - Je ne pense pas, répondit le père, que l'on sache rien à cet égard.
- Y a-t-il à Tunis, dit M. Morelli, quelque monument moderne du séjour de ce grand saint ? Il conviendrait, ce semble, que sa mémoire y fût perpétuée comme celle de saint Louis, eu l'honneur duquel Louis-Philippe a fait bâtir une chapelle sur le point le plus élevé des ruines de Carthage.
- Certainement la France applaudirait à l'exécution de cette pensée, ajouta Alfred. Peut-être Ahmed-Pacha, le bey de Tunis, n'y opposerait-il aucun obstacle, car j'ai vu dans son salon le portrait de saint Vincent de Paul.
- Quoi ! s'écria M. Morelli, dans le salon d'un roi musulman ! et lorsque le Coran proscrit les images de l'homme !
- Oui, mon père, dans le salon d'Ahmed-Pacha. Qui eût prévu pareille chose, lorsque le pauvre esclave fossoyait, inconnu et méprisé, dans la ferme du renégat ? Du reste, Ahmed-Pacha, quelle que soit sa vie privée, n'est pas ennemi des chrétiens. Il honore les capucins missionnaires à Tunis et dans la régence; il a placé à côté du portrait de saint Vincent de Paul celui de Mgr Fidèle Sutter de Ferrare, évêque de Rosalia, vicaire apostolique à Tunis.
- Les vues de la Providence, en conduisant Vincent au milieu des esclaves et dans un pays musulman, percèrent bientôt. Le saint prêtre n'oubliait pas les maux dont il avait été le témoin ou qu'il avait partagés. La tendresse de son cœur et sa charité le portèrent à travailler au soulagement des esclaves de Barbarie et à la conversion des infidèles. Il ne lui fut pas donné de retourner lui-même sur les bords africains ; mais il y établit les prêtres de la congrégation de la Mission, qu'il fonda en 1626, et lui s'installèrent en 1632 à Paris, au prieuré de Saint-Lazare. C'est de là que leur vient le nom de lazaristes.
Louis XIII, rendons-lui cet hommage, eut l'initiative dans l'établissement des lazaristes en Afrique ; du moins les sentiments de ce pieux roi se rencontrèrent merveilleusement avec ceux de Vincent de Paul. Il faut nommer ensuite Mme la duchesse d'Aiguillon, qui fit de grandes charités pour la mission d'Alger.
Le roi, désirant assister les esclaves, ordonna au saint prêtre d'envoyer plusieurs de ses missionnaires en Barbarie, et lui remit à cet effet une somme d'environ dix mille livres. Vincent, pour les employer de la meilleure manière possible, consulta les derniers traités entre la France et les Turcs. Le Grand Sultan s'était montré depuis longtemps déjà favorable à la France.
En 1628, il écrivait à Alger : " O mes serviteurs de la milice d'Alger, vous avez autrefois vécu en frères avec les Français, et toutefois il vous est arrivé depuis de les traiter comme ennemis. Quelques pervers ont commis des hostilités contre le droit et la justice. Je veux maintenant que le passé soit aboli, et que vous teniez à l'avenir les Français comme frères et amis. "
Le divan et la milice répondaient : " Nous désirons que cela soit, et nous voulons tous obéir au commandement de notre empereur, dont nous sommes les esclaves. "
Le roi de France écrivait de son côté " Comme par la lettre que j'ai reçue de mon très-cher et parfait ami l'empereur des musulmans (que ses jours soient heureux !) il me témoigne son intention, qui est que nos sujets vivent en bonne intelligence, je le désire aussi de même, et cette paix me sera fort agréable. "
Les articles du traité assuraient la sécurité des navires français, et condamnaient les violences exercées à Alger contre les jeunes garçons chrétiens pour les faire musulmans.
Le roi de France pouvait avoir, dans les villes maritimes, un consul chargé de protéger les marchands et les esclaves, et chacun de ces consuls avait droit d'entretenir un chapelain auprès de lui.
Vincent de Paul entrevit dans cette dernière disposition un moyen d'introduire ses prêtres sur ces rivages inhospitalier, où les Turcs ne souffraient guère que les rédempteurs. Il obtint d'abord de M. Martin, consul à Tunis, la permission de lui envoyer un prêtre qui ne lui serait point à charge. M. Julien Guérin, accompagné du frère François Francillon, fut, en 1645, le premier lazariste qui mit le pied en Barbarie. Après deux ans d'un laborieux ministère, il se voyait accablé par le bien qu'il avait à faire. Il alla trouver le bey, et lui demanda l'autorisation de s'adjoindre un nouveau prêtre. Le bey y consentit, et Vincent de Paul envoya Jean le Vacher, qui arriva au commencement de 1648, tandis que la peste, la guerre et la famine désolaient Tunis.
Les deux prêtres se dévouèrent dans les bagnes et dans toute la ville, au milieu des pestiférés. M. le Vacher, atteint par le fléau, revint du bord de la tombe. M. Guérin succomba. Le consul le suivit peu après, et le bey ordonna au père le Vacher de gérer le consulat. Vincent n'approuvait pas qu'un de ses prêtres remplit cette fonction séculière ; il fit envoyer, à la place du lazariste, Huguier, procureur au Châtelet; mais les Tunisiens ne l'agréèrent pas ; il revint en France, fut reçu par Vincent dans la congrégation de Saint?Lazare, et alla mourir de la peste à Alger, en 1663, au service des esclaves. M. Martin Husson, pieux avocat, succéda en 1653 au père le Vacher.
Celui-ci s'adonna au ministère spirituel des esclaves avec un redoublement d'ardeur. En 1655, le bey l'exila à Bizerte, comme coupable d'empêcher les chrétiens d'embrasser le Coran. Le père arrivait à Bizerte en mène temps que deux barques chargées d'esclaves. Il obtint du raïs qu'ils fussent un moment délivrés de leurs chaises, et il leur administra le sacrement de pénitence. Rappelé à Tunis, il fut de nouveau persécuté : le dey s'en prit à lui de ce qu'il ne pouvait obtenir en France que par contrebande des toiles à voiles. Les lois du royaume en défendaient l'exportation, et d'ailleurs le saint siége excommuniait quiconque fournissait aux musulmans des moyens de guerre contre les chrétiens. Cependant M. le Vacher ne fut pas banni, et il dut même reprendre la charge de consul en 1657, lorsque le bey chassa M. Husson, auquel il reprochait des prises faites sur les Turcs par les Florentins. En 1612, il avait obtenu de la congrégation de la Propagande un décret qui lui donnait juridiction sur tous les prêtres de Tunis, esclaves ou libres. Il resta vingt ans dans cette ville en qualité de vicaire apostolique, et, en 1672, il alla faire sa résidence à Alger, où Vincent de Paul avait aussi établi les lazaristes dès l'an 1646.
Alger, avec ses vingt mille esclaves et son fanatisme sans bornes, avait encore plus besoin de ces missionnaires que Tunis, où il y avait six mille esclaves et moins de férocité. Grâce au zèle de Vincent, le nouveau consul, M. Jean Barreau, partit avec MM. Nouëli, le Sage et Dieppe. Nuit et jour, en 1647 et 1648, ces trois prêtres assistèrent les esclaves durant une horrible contagion. Tous les trois succombèrent, martyrs de la charité. M. Dieppe, durant son agonie, le regard attaché sur le crucifix qu'il tenait à la main, répétait sans cesse les paroles du Christ : " Majorem hac dilectionem nemo habet ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Personne ne peut avoir un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. "
Philippe le Vacher, frère de Jean le Vacher, qui était à Tunis, succéda aux missionnaires morts à Alger. Le consul, M. Barreau, fut plusieurs fois emprisonné et maltraité par les pachas. Ces tyrans se vengeaient sur lui de tout ce qu'ils reprochaient aux chrétiens d'Europe hors de leurs atteintes. En 1657, par ordre du pacha Ibrahim, il reçut tant de coups de bâton sous la plante des pieds, qu'il tomba en syncope ; il ne fut reporté au consulat qu'après avoir promis de payer douze mille livres pour un débiteur marseillais. Mais le pacha voulait être payé de suite, et le consul, n'ayant que cent écus, allait être de nouveau torturé et peut-être mis à mort, si les esclaves eux-mêmes, par une charité vraiment héroïque et au-dessus de tout éloge, n'avaient satisfait le pacha en donnant pour le consul le pécule qu'ils avaient ramassé pour leur propre liberté. On apprit en France cette action admirable. Vincent dédommagea les captifs au moyen d'aumônes ; et, en juin 1661, lorsque M. Barreau fut rappelé à Paris, il rentra en France accompagné de soixante-dix esclaves rachetés par lui et par M. Philippe le Vacher.
- Est-il possible que la France ait souffert une telle conduite de la part des pachas ? dit Alfred.
- Je ne sais ce qui me frappe le plus, de la faiblesse de la France, de la brutalité de cet Ibrahim, de l'héroïsme des esclaves, ajouta M. Morelli.
- Il n'est donc pas permis, révérend père, d'exprimer un doute sur l'inique châtiment infligé au consul ?
- Hélas ! Madame, rien de plus conforme à l'histoire. La France, l'Angleterre, la Hollande, achetaient la paix avec la Turquie. On adressait des plaintes à la Porte, qui désavouait les pachas et leur faisait des reproches, mais tout en partageant les prises des corsaires. Et savez-vous ce que les Algériens eurent un jour l'audace de répondre au sultan : " Si l'on prétend nous gêner par des traités avec l'empire ottoman, il ne nous reste qu'à brûler nos vaisseaux pour nous faire chameliers. "
Cependant ils avaient dès longtemps excité en Europe une indignation qui devait tôt ou tard se traduire par une guerre. En 1617, une flotte française sous les ordres de M. de Beaulieu, met à la voile pour aller ruiner Alger. Tout se borne, à cause du mauvais temps, à la destruction de quelques navires. L'amiral Mansel et une flotte anglaise ne furent pas plus heureux, En 1638, les Vénitiens attaquèrent la flotte d'Ali-Pichini, qui dévastait les côtes de l'Adriatique et menaçait Notre-Dame-de-Lorette ; ils tuèrent quinze cents Turcs et Maures, et délivrèrent seize cents esclaves chrétiens qui servaient sur les galères ennemies. Deux ans après, les Algériens reparaissaient avec soixante-cinq vaisseaux de course, sans compter les navires qui desservaient les côtes de la régence. Vous comprenez comment, en 1657, ils osèrent bâtonner le consul de France.
- Et l'on doit avouer, observa M. Morelli, que l'injure était faite à toute la chrétienté ; car le consul de France était chargé de protéger toutes les nations européennes à Alger, sauf les Anglais.
- Et le consul d'Angleterre, croyez-vous qu'il fit mieux traité que celui de France ? A cette époque il était au bagne et travaillait à la charrue avec les esclaves ! Ruyter, le grand amiral hollandais, obtenait avec peine le rachat de quelques esclaves, et consentait à la visite des navires de sa nation par les corsaires.
Enfin Louis XIV, qui avait à cœur de mériter le surnom de Grand, ne put tolérer cet excès d'avanies dont on couvrait la France et l'Europe. En 1664, le duc de Beaufort s'empara de Djidjelli, qu'on eut le tort de ne pas conserver ; et en 1665 il détruisit une escadre algérienne à la Goulette, et signa en 1666 un traité qui fut un instant respecté des corsaires.
Mais Hadj-Mohammed-Treck, le premier roi d'Alger qui porta le titre de dey, et son gendre Baba-Hassan, recommencèrent les hostilités, Baba-Hassan déclare ouvertement la guerre à la France en 1682 Louis XIV envoie contre Alger Duquesne. L'amiral fit usage des bombes. C'était la première fois qu'on s'en servait sur mer. La ville fut affreusement ravagée ; mais le mauvais temps obligea les Français à la retraite. Duquesne reparut l'année suivante (1683). Le bombardement commença, et fut si terrible, que le père Jean le Vacher fut envoyé par les Turcs pour négocier. On accorda à Duquesne la remise des esclaves français ; puis Mezzomorto, chef de la marine, et un raïs, furent livrés en otage. Mais Baba-Hassan ne pouvait consentir à payer un million cinq cent mille francs d'indemnité. Mezzomorto obtient de retourner à terre comme pour l'y décider ; mais il le fait poignarder, se déclare son successeur, et fait feu contre les Français de toute son artillerie, en annonçant à Duquesne qu'il mettra les chrétiens à la gueule des canons si la flotte continue à se servir de bombes.
Or, les Anglais jouaient dans tous ces événements un rôle déshonorant, qui est trop souvent le leur dans l'histoire. Ils avaient acheté la paix, en 1682, en abandonnant aux Algériens trois cent cinquante bâtiments de commerce et les esclaves anglais enfermés dans les bagnes.
Au moment où Duquesne reprit le bombarderaient contre Mezzomorto, un Anglais influent, voyant des linges qui séchaient sur la terrasse du père le Vacher, fit croire aux Algériens que le consul faisait des signaux à la flotte. Aussitôt on se rua sur la demeure du vénérable lazariste, accablé par l'âge, les fatigues et les infirmités qu'il avait contractées à la peste de Tunis. L'éléphantiasis enflait ses membres. Les forcenés, qui conservaient encore quelques égards pour son caractère religieux, le portèrent dans sa chaise le dos tourné vers la mer, et conduisirent cette innocente victime à la mort qu'ils voulaient lui faire souffrir sans aucune formalité. Car, l'ayant mené sur le môle, ils chargèrent un canon de poudre, et, après avoir mis le serviteur de Dieu à la bouche, toujours assis dans sa chaise, ils lui firent mille indignités ; enfin ils mirent le feu au canon, et sacrifièrent ce saint homme à leur rage et à leur désespoir. Le canon creva; mais il avait eu tout l'effet que ces malheureux en avaient attendu, car il consuma la plus grande partie de la victime. Les restes de son corps et de ses habits furent ramassés par les chrétiens, qui les conservèrent comme de précieuses reliques, il y eut même des Turcs qui en voulurent avoir, pour se ressouvenir d'un homme dont les vertus et la rare prudence les avaient charmés pendant sa vie.
- La pièce de canon qui servit au supplice du père le Vacher, et qu'on surnomma la Consulaire, était énorme, dit Alfred. Elle a été transportée en France, et j'ai vu ce trophée à Brest, sur la place d'armes.
- Vingt-deux autres chrétiens, reprit le trinitaire, furent ainsi mis en pièces à la gueule du canon. Un jeune de Choiseul y est amené; le coup va partir, lorsqu'un raïs, autrefois prisonnier et qui a reçu du jeune homme les traitements les plus humains, le reconnaît et se jette sur lui pour le sauver ; mais les Algériens poussent au comble la barbarie, et le même coup fracasse les deux hommes, qui se tenaient embrassés !
Le désastre était grand dans la ville et dans le port, lorsque Duquesne, n'ayant plus de bombes, fit lever l'ancre et se retira.
Tourville ramena la flotte devant Alger en 1684, et Mezzomorto signa la paix le 25 avril, en rendant les esclaves. Deux ans plus tard, les corsaires violaient le traité, et le consul de France, M. Piolle, était mis au bagne. Le vice-amiral d'Estrées recommença, en 1688, l'œuvre de destruction tentée par Duquesne, et lança dix mille bombes sur la ville. Les algériens répondirent en plaçant à la gueule de leurs canons le père lazariste Michel Montmasson, originaire de Savoie, ancien curé de Versailles, le consul Piolle, un religieux, sept capitaines et trente matelot. D'Estrées, que l'inondation transportait hors de lui, fit égorger dix-sept Turcs, dont les cadavres furent lancés vers le port sur un radeau, et il revint à Toulon. Mezzomorto ne demanda la paix qu'en 1689, et Chaaban, son successeur, persévéra dans les bonnes relations avec la France. Les Algériens se tournèrent contre les Espagnols, qu'ils chassèrent d'Oran en 1708 ; mais cette ville. fut reprise, en 1732, par Philippe V.
Pendant le XVIIIe siècle, malgré les renouvellements des anciennes conventions, les faits de piraterie de la part des Algériens contre les nations d'Europe furent innombrables. La flotte de Danemark échoua, en 1770, devant Alger. Vingt-deux mille hommes, amenés par O'Reilly, en 1775, sur celle d'Espagne, ne débarquèrent que pour se faire battre ; et en 1792, deux ans après un épouvantable tremblement de terre qui renversa Oran, les Espagnols évacuèrent cette ville, et les Algériens y entrèrent.
L'Europe entière était donc abaissée encore au siècle dernier devant les corsaires d'Alger. Et cet abaissement était accepté, car il avait pour signe des tributs fixes à payer au dey, ou des présents à faire officiellement lors de l'installation des nouveaux consuls. Alors même que les traités ne rendaient pas ces présents obligatoires, on ne laissait pas de les offrir.
La France avait obtenu la situation la moins déshonorante. Notre commerce était représenté par la compagnie royale d'Afrique, héritière des établissements qu'on appelait les Concessions françaises d'Afrique, et où nous faisions la pêche du corail. Le plus ancien de ces comptoirs est le Bastion de France, fondé près de la Calle, en 1561. Il y avait une chapelle voûtée, dédiée à sainte Catherine. Au?dessus de cette chapelle étaient des chambres pour les chapelains, et l'hôpital s'élevait entre ce bâtiment et un jardin. Lorsque les bateaux corailleurs n'étaient pas inquiétés, on comptait sept à huit cents Français au Bastion de France, dont on ne voit plus que les ruines. Nous eûmes d'autres maisons au cap Nègre, à la Calle. Mais, tout en payant de fortes redevances pour ces concessions, nous y avons souffert bien des outrages et des injustices ; elles recevaient le contre-coup de nos guerres avec Alger. Aussi furent-elles abandonnées et saccagées à diverses reprises.
Avant la révolution, la France offrait encore des présents au roi-corsaire pour l'installation de ses consuls ; mais elle n'y était pas tenue, et elle avait affranchi comme elle de toute redevance légale les États de l'Église.
Le Portugal et Naples payaient par an vingt-quatre mille piastres, sans compter les présents.
La Toscane, vingt-trois mille piastres au renouvellement des consuls.
La Sardaigne faisait des présents analogues.
L'Autriche, quoique exemptée par la Porte, se ménageait par des cadeaux les faveurs du dey.
La Hollande, les États-Unis, l'Angleterre, la Suède et le Danemark payaient de fortes sommes à chaque changement consulaire, et de dix en dix ans, au renouvellement des traités.
Quant à ma chère Espagne, mal lui en aurait pris de ne pas se montrer généreuse. En juillet 1791, lorsque Hassan?Pacha succéda au dey Mohammed, notre vice-consul don Miguel de Larrea s'empressa d'offrir les cadeaux d'usage. Vous pouvez voir le procès-verbal de cet acte officiel aux archives du consulat d'Espagne, où je l'ai lu récemment. Le total de l'offrande monte à la valeur de cinq mille trois cent quatre-vingt-douze écus de cinq francs.
Au dey :
Un caftan d'or 120 écus.
Un anneau, anillo solitario 700 écus
Un autre en diamants et en forme de rose 500 écus
Une plume en diamants et en émeraudes 700 écus
Une paire de pendants d'oreilles en diamants et en rubis 320 écus
Une rose en diamants, pour la femme du dey 2200 écus
Total : 4540 écus
Au khasandji, premier ministre, ou ministre des finances et de l'intérieur.
Un caftan d'or 36 écus.
Un anneau 360 écus
Deux pièces d'étoffe 60 écus
Total : 456 écus
A l'agha, ou ministre de la guerre.
Un caftan d'or 96 écus.
Un anneau 300 écus
Total : 396 écus
On était trop heureux que ces messieurs voulussent bien, en échange de si jolis deniers, accorder leurs bonnes grâces à l'Europe.
- Et que devenaient donc, révérend père, les esclaves chrétiens durant cette période moderne, ou depuis que les dignes prêtres de Saint-Lazare avaient réussi à s'établir en Afrique ?
- Nous avons vu, Madame, deux pères lazaristes, Jean le Vacher et Montmasson, martyrs du devoir, comme d'autres de leurs confrères le furent de la charité. L'Algérie et la Tunisie, depuis 1651, formaient un vicariat apostolique gouverné par un lazariste, qui résida, depuis 1672, à Alger.
Les conséquences de la révolution française ont mis fin à l'exercice d'une charité qui depuis un siècle et demi ne se démentait pas.
- Les trésors de cette vertu, dit Mme Morelli, sont inépuisables au cœur des fils et des filles de saint Vincent de Paul.
- L'Algérie en est témoin chaque jour, ajouta M. Morelli. Le zèle qui se déployait dans les bagnes agit aujourd'hui dans les hôpitaux et dans les prisons, au grand séminaire de Kouba, dans les orphelinats et les écoles.
- Il est probable, révérend père, dit Carlotta, que les lazaristes nous ont gardé la mémoire de quelques martyrs comme l'ont fait les religieux des autres ordres établis en Afrique.
- Assurément, ma fille; vous pouvez ouvrir de nouveau le livre d'Abelly, où vous lisiez tout à l'heure, et vous y trouverez plusieurs histoires intéressantes. Prenez connaissance de cette lettre de M. Guérin, un des premiers lazaristes que saint Vincent de Paul envoya en Afrique. "
Et la jeune fille lut ainsi :
" Deux Anglais se sont convertis à notre sainte foi, qui servent d'exemple à tous les autres catholiques. Il y en a un troisième qui n'a que onze ans, l'un des plus beaux enfants qu'on puisse voir et un des plus fervents que l'on puisse souhaiter, et d'ailleurs grandement dévot à la sainte Vierge, laquelle il invoque continuellement, afin qu'elle lui obtienne la grâce de mourir plutôt que de renier ou offenser Jésus-Christ : car c'est le dessein de son patron, qui ne le garde que pour lui faire renier la foi chrétienne et qui emploie toutes sortes de moyens pour cela. Si on pouvait nous envoyer deux cents piastres, nous le retirerions de ce danger, et il y aurait lieu d'espérer qu'un jour, avec la grâce de Dieu, ce serait un second Bède, tant il a d'esprit et de vertu ; car on ne voit rien en lui qui tienne de l'enfant. Il fit profession de la foi catholique le jeudi de la semaine sainte du carême dernier (1646), et communia le même jour, ce qu'il réitère souvent. Il a déjà été battu deux fois de coups de bâton pour être contraint de renier Jésus-Christ. A la dernière fois, il dit à son patron, pendant que celui-ci le frappait : " - Coupe-moi le cou, si tu veux ; car je suis chrétien et je ne serai jamais autre.
" Il m'a plusieurs fois protesté qu'il est résolu à se laisser assommer de coups plutôt que de renoncer à Jésus?Christ. Toute sa vie est admirable en un âge si jeune et si tendre. "
- On pourrait ajouter à cet exemple, dit M. Morelli, celui d'un renégat protestant de la Rochelle, Soliman-Raïs. En 1621, ce corsaire redoutable fut pris aux îles d'Yères par M. de Beaulieu, commandant la galère la Guisarde. Il était forçat depuis cinq ans, lorsque la grâce lui donna le désir d'embrasser la religion catholique. Il obtint d'être échangé contre un Marseillais de distinction, esclave à Alger. Les habitants de cette ville éprouvèrent une grande joie du retour du fameux Soliman, et on lui confia bientôt un beau navire. Il le charge de Turcs, de renégats et d'esclaves, et se met en mer. Il relâche à Sousa, non loin du port, fait descendre les Turcs, et déclare aux autres qu'il va fuir en terre chrétienne. Au cri de : Liberté ! on enchaîne les Turcs encore à bord, et le grand maître de Malte accueille peu après le raïs et ses compagnons. Soliman se fit instruire, abjura ses erreurs, reçut du grand maître de Vignacourt le grade de chevalier de Grâce de la Religion, et, couvert de gloire par maints prodiges de valeur, mourut enfin frappé d'un boulet dans un combat contre les Turcs de Rhodes.
- Si Mademoiselle veut poursuivre sa lecture, une lettre d'un autre lazariste nous révélera d'autres fruits de salut obtenus par les missionnaires. "
Et Carlotta continuait :
" Nous ouvrons dans ce pays une grande moisson, qui est encore accrue à l'occasion de la peste ; car, outre les Turcs convertis à notre sainte religion, que nous tenons cachés, il y en a beaucoup d'autres qui ont ouvert les yeux à l'heure de la mort, pour reconnaître et embrasser la vérité de notre sainte religion. Nous avons eu particulièrement trois renégats, lesquels après la réception des sacrements sont allés au ciel ; et il y en eut un, ces jours passés, lequel, après avoir reçu l'absolution de son apostasie, étant à l'heure de la mort environné de Turcs qui le pressaient de proférer quelques blasphèmes, comme ils out accoutumé de faire en une telle occasion, n'y voulut jamais consentir; mais, tenant toujours les yeux vers le ciel et un crucifix sur son estomac, il mourut dans les sentiments d'une véritable pénitence.
" Sa femme, qui avait, comme lui, renié la foi chrétienne, et qui était religieuse professe, a reçu pareillement l'absolution de sa double apostasie, y ayant apporté de son côté toutes les bonnes dispositions que nous avons pu désirer. Elle demeure à présent retirée dans sa maison sans en sortir, et nous lui avons ordonné deux heures d'oraison mentale chaque jour, et quelques pénitences corporelles outre celles de sa règle ; mais elle en fait beaucoup plus par son propre mouvement, étant si fortement touchée du regret de ses fautes, qu'elle irait s'exposer au martyre pour les expier, si elle n'était point chargée de deux petits enfants, que nous avons baptisés, et qu'elle élève dans la piété, comme doit faire une mère vraiment chrétienne.
" Il est mort encore un autre renégat près du lieu de notre demeure, lequel a fini sa vie dans les sentiments d'un vrai chrétien pénitent. J'attends de jour à autre quelques Turcs pour les baptiser. Ils sont fort bien instruits et grandement fervents en notre religion, m'étant souvent venus trouver la nuit en secret. Il y en a un entre les autres qui est de condition assez considérable en ce pays. "
- A cette époque, reprit le P. Gervais, deux enfants d'environ quinze ans, l'un Anglais, l'antre Français, se trouvaient esclaves à Tunis dans deux maisons rapprochées. Le Français convertit au catholicisme l'Anglais, qui était protestant. Des marchands anglais proposèrent à ce dernier de le racheter; mais, fortifié par M. le Vacher dans son attachement à la vraie foi, il préféra rester esclave, parce qu'il y voyait plus de sûreté pour sa religion.
Les maîtres brutaux de ces deux enfants les assommaient de coups ; parce qu'ils refusaient d'apostasier. Un jour le petit Français fut tellement frappé, qu'il resta comme mort. En ce moment l'Anglais s'introduisait furtivement auprès de son ami, ainsi qu'il le faisait souvent pour s'encourager mutuellement à la persévérance. Le voyant dans cet état, il l'appela par son nom : " Je suis chrétien pour la vie, dit le petit Français en reprenant ses sens. "
L'Anglais, à cette parole, se met à baiser les pieds meurtris et sanglants de son cher compagnon, Des Turcs le voient et lui demandent :
" Que fais-tu là ?
- J'honore les membres qui viennent de souffrir pour Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu. "
Les barbares le chassèrent en l'injuriant.
Guéri de ses plaies, le Français, allant voir un jour son ami, le trouve à son tour étendu sur une natte de jonc et brisé de coups. Il s'approche sans craindre le patron ni d'autres Turcs qui étaient présents, et dit au jeune Anglais :
" Lequel aimes-tu mieux de Jésus-Christ ou de Mahomet ?
- J'aime Jésus-Christ seul ; je suis chrétien et veux mourir chrétien. "
Les Turcs se fichent contre le Français ; l'un d'eux tire son couteau et s'avance en le menaçant de lui couper les oreilles. Le Français saisit lui-même le couteau, se coupe une oreille, et la tenant toute sanglante devant ces barbares, il leur dit :
" Voulez-vous encore l'autre ? "
On lui arracha le couteau des mains, et leurs maîtres, désespérant d'abattre ces jeunes héros, les laissèrent tranquilles. L'année suivante, ils moururent de contagion, et allèrent recevoir au ciel la récompense de leur foi.
Il y aurait beaucoup à dire si l'on voulait reprendre tout ce que les lazaristes firent pour le soulagement, pour le salut de l'âme et du corps des esclaves.
Nous les voyons sauver de la servitude des prisonniers qu'on veut y plonger au mépris des traités ; faire fleurir la piété dans les bagnes, en y établissant les saints exercices des paroisses de France ; distribuer de petits rafraîchissements à ceux qui succombent sous le travail, à ceux qui scient le marbre, par exemple, aux rayons d'un soleil dévorant, et jusqu'à tirer la langue comme les chiens haletants ; corriger les vices qui se déclarent dans cette foule d'hommes de tous pays ; visiter, confesser, administrer les malades, le jour et la nuit ; parcourir les campagnes pour y soutenir le courage des esclaves isolés et mourants de fatigue sur la glèbe ; en un mot, s'exposer eux-mêmes aux avanies, aux coups, à la mort, pour le salut de leurs frères bien-aimés.
Ils n'épargnaient rien pour le rachat des captifs, et surtout des femmes, dont le sort était le plus à plaindre. Un d'eux l'écrivait à saint Vincent de Paul, et lui citant divers traits où la foi et l'honneur de ces infortunées étaient en grand péril, il disait :
" Il n'y a pas longtemps que pour en contraindre une de renier Jésus-Christ, ces cruels lui donnèrent plus de cinq cents coups de bâton, et, non contents de cela, comme elle était à demi morte par terre, deux d'entre eux la foulèrent avec les pieds sur les épaules avec une telle violence, qu'ils lui crevèrent la poitrine, et elle finit ainsi glorieusement sa vie en la confession de Jésus-Christ. "
Le même missionnaire montre assez que les lazaristes ne reculaient devant aucune démarche pour sauver un esclave, lorsqu'il dit :
" Nous avons ici un petit garçon de Marseille âgé de treize ans, lequel, depuis qu'il a été pris et vendu par les corsaires, a reçu plus de mille coups de bâton pour la foi de Jésus-Christ, qu'on voulait lui faire renier par force. On lui a, pour ce même sujet, déchiré la chair d'un bras, comme on ferait une carbonnade pour la mettre dessus le gril; après quoi, ayant été condamné à quatre cents coups de bâton, c'est-à-dire à mourir ou à se faire Turc, j'allai promptement trouver son patron, je me jetai trois ou quatre fois à genoux devant lui , les mains jointes, pour le lui demander; il me le donna pour deux cents piastres, et n'en ayant point, j'empruntai cent écus à intérêt, et un marchand me donna le reste. "
Pour le dire en terminant, ajouta le vieux trinitaire, il est infiniment regrettable que le dépôt des archives de Saint-Lazare ait été détruit. Si l'on en juge par ce qu'on sait des premiers temps de leur mission d'Afrique, les lazaristes ont fait un bien immense aux esclaves dans ce pays. Au vivant de saint Vincent de Paul, ils avaient dépensé près de cent vingt mille livres pour les secourir, et ils avaient rendu plus de douze cents de ces malheureux à leur pays et à la liberté.
Enfin, par un trait où se manifeste bien la tendresse de son âme, saint Vincent de Paul s'était chargé de payer le port des lettres des esclaves à leurs parents et des parents aux esclaves.
- Oh' s'écria Carlotta, il n'y a rien de plus beau ni de plus touchant dans la vie de saint Vincent de Paul.
- Nous sentons bien cela, dit Alfred, nous autres qui vivons presque toujours séparés.
- Une lettre ! une lettre qu'on apportait à un esclave, disait de son côté M. Morelli, mais c'était un bonheur dont on ne peut se faire d'idée. Il n'a de comparable que celui des familles qui recevaient les réponses datées du bagne.
- Eh ! mon ami , répliquait Mme Morelli, ne pouvons-nous pas en juger par ce qui se passe entre nous ?
Alfred est aux Antilles. Le courrier arrive aujourd'hui. Nous sommes impatients. Personne ne peut vaquer à son ouvrage. On va, on vient pour savoir si le navire est signalé. Le voilà. Nous découvrons en mer sont panache de fumée, que personne ne voit encore rien. C'est lui, c'est lui. L'impatience va croissant. On maudit la lenteur de l'administration des postes. Le facteur sonne à casser la clochette. Carlotta se précipite dans l'escalier. Elle court en apportant la lettre collée sur ses lèvres. C'est elle, quoi qu'on en puisse dire, qui arrache l'enveloppe et qui fait la lecture. Mais elle dévore si vite toutes les phrases que je n'entends rien, ni vous non plus, monsieur Morelli, bien que vous ayez mis vos lunettes pour mieux écouter.
Enfin une nouvelle lecture plus calme nous fait venir pour l'ordinaire les larmes aux yeux. Fatma elle-même est debout derrière nous, interrogeant nos visages, lorsqu'elle ne comprend pas la lecture.
Et cette scène se renouvelle autant de fois que le courrier nous arrive.
Jugez des émotions si douces, même dans leur violence, que la charité de saint Vincent de Paul a causées en payant les ports de lettres des esclaves."
A SUIVRE
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LI KABYLE, SON FILS Y SON BOURRIQUOT
FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!
Ji voir, y a lontan, to pris de Balistro,
On Kabyle, y son fils, afic son bourriquot.,
Qui son marchi la rote, di côté d'Arbatache.
Por vendre li bourriquot, pour achetir one p'tit vache,
Bor qui 'soit bian jouli, y por pas fatigué
Li Kabyle y son fils y li pran par li pié,
Y li mite sur son dos, por partir au marchi.
- On torco qui bassi, qui voir cit affir là
Y son rir mon zami -- Y di : " Ti po sarchi
Bian lontan por trovi, plous bête qui cit gens là ! "
Li Kabyle y compran, qui ça fouti di loui
Y lach' l' bourriquot por marchi divant loui.
Ci lui là bian contan, y si mit à corir,
Ma Li fils y l'attrappe, y por fir son blisir
Y Monti sor son dos ; son pire y vian darrière.
On arabe qui passi, y si mi en coulère :
Quis qui ci grand finian ? Encore qui ti es jone
" Ti bisoan qui cit vio, qui ji soye ton garçone ?
" Discendi gran rossard, y march' afic ton pied,
" Y lisse montir cet vio, qui son bian fatigué.
" Li p'tit y descend, por qui monte son pire,
For suivre por Barrière, bisoan qui son corir.
Trois mazmazilles qui basse, y qui voir cit pitite
Tout rouge à la figoure, barce qui son marchi vite,
Y dire : " Ci digotan, di voir cit vio là
" Qui fir son malin assi come on hacha,
" Quand cit joli garçone, y son bientôt crévi "
" Moi hacha qu'il bonhor ! qu'il sanche qu'il m'a trovi ;
" Ti pas honte akarbi (1), bougre di vio finian,
Di fir corir la rote vot fils, vot zenfant ?
" Li vio y son pensi, pit être il a raison,
Par darrière ji va fir monter mon p'tit garçon.
Y son marchi la rote, pit être un kilomitre.
Quand y son rencontri, mossiou li gran champitre
Qui dir : " Quis qui ci ? ispice di vio coillon,
Ji fir procès-verbal, ji conni loi Grammon,
" Bian sor qui vos alli, por li vendre al marchi ? "
" - " Ça ci vri mon zami, ti trovi sans sarchi,
" Moi ji vian di mon douar' (2) y ji va Arbattache
" Por vendre cit bourrico, por achetir une p'tite vache.
" Toi ti conni la loi, moi ji ni conni pas :
" Ji m'en va discendi afic mon fils aussi,
" Y lis lo l' bourriquot marchi comme y voudra.
" L' bourriquot bian content, y son fir la mousic,
" Lorsqui basse un spahis sor on chval manific.
" Y rigardi cit vio qui peu bian marchi :
" Pourquoi ti march'à pié, vos usi vot soulier,
" Lorsqui ton bourriquot, y fir sa mariol "
" Ti es blous borriquot, blous qui loui ma barol.
- Moi ji souis bourriquot ? Blous qui vous. Ti m'embite.
" Y ji crois ji souis libre pour ji fir à ma tite.
" Quis qui ci toi to l' tan, vous ti vian m'agueuler
" Toi ti dir fo descendre, l'autre y dir fo monter.
" Ti m'embite à la fin. L' bourriquot cit à moi,
Ji fir quis qui ji veu, ça rigarde pas toi. "
MORALE
Li mon Diou qui li grau, y qui la conni biais,
Jami y po fasir qui li monde son contns.
Aujord'hui ti vodra por mangi bon couscous;
Diman ti vodra pas à ton femme fir bousbous;
Jami ti po savoir quis qui ci bor blisir,
Ti po pas fir contan y ta mir y ton pir..
(1) Parole d'honneur
(2) Village
|
|
MES SOUVENIRS
Par Mme ETIENNE Paulette (93 ans)
|
|
LES PETITS METIERS DE CHEZ NOUS
- Le LAITIER -
J'étais encore une fillette et mon grand plaisir était, le mercredi soir après la classe d'aller dormir et passer le jeudi chez ma grande sœur nouvellement mariée. Elle habitait la rue Garibaldi et pour moi, petite campagnarde venant des hauteurs de la Ménadia, qui à l'époque, ne comptait qu'une dizaine de villas et dont les nuits n'étaient troublées que par le glapissement des chacals menant leur sarabande entre la Casbah et les Beni-Ramassés, les bruits de la rue me fascinaient et me tenaient éveillée. C'était le raclement des chaises et des bancs sur les trottoirs où les gens s'assemblaient pour bavarder - les pas des noctambules revenant d'un spectacle - le roulement des calèches et vers le matin les maraîchers portant leur récolte au marché. Les charrettes à bras et les carrioles se succédaient, leurs grosses roues ébranlant les pavés.
Vers les cinq heures, on entendait dans le lointain un bruit étrange. On aurait dit le crépitèrent d'une pluie d'orage accompagné d'un son de clochettes; une voix d'homme s'élevait parfois, incompréhensible. Cela s'arrêtait, puis le crépitement reprenait, les clochettes tintinnabulaient, s'arrêtant à nouveau, recommençant encore. Le bruit se rapprochait. N'y tenant plus, ma curiosité plus forte que tout, j'ouvrais doucement les volets.
Et alors au bout de la rue, venant du pont Blanc, un troupeau de chèvres apparut. Elles étaient toutes blanches comme celles de Monsieur SEGUIN et trottinaient allègrement faisant tinter leurs sonnailles. Un homme, le feutre cabossé sur le crâne, un foulard rouge roulé autour du cou, les conduisait. Il portait sur une épaule un tabouret de bois et dans sa main il tenait un gros bâton noueux. A son autre bras se balançait un seau en zinc duquel dépassait le manche d'une "mesure". C'était lui que j'avais entendu qui disait "voilà l'laitier...é"
Devant la porte des immeubles apparaissaient en peignoir, bigoudis ou papillotes sur la tête, les ménagères tenant l'une, un pot à lait, l'autre, une casserole, cette autre une marmite, cette autre encore une bouteille surmontée d'un entonnoir. L'homme s'arrêtait, les chèvres assemblées autour de lui. Il posait son tabouret sur lequel il s'asseyait, docilement une chèvre s'approchait se laissant traire et sur un claquement de langue de l'homme, s'écartait laissant sa place à une autre - et ainsi, selon le nombre de clientes, quatre ou cinq chèvres se succédaient. Le lait giclait dans le seau tout mousseux. Usant de sa mesure le laitier remplissait les récipients qu'on lui tendait, faisant chaque fois "bonne mesure". Une fois payé, il reprenait son chemin s'arrêtant un peu plus loin pour recommencer sa vente, directement du " producteur au consommateur ".
Il faisait ainsi les rues de la Colonne mais bientôt les gens firent une pétition pour en demander la surpression par mesure d'hygiène et à cause du bruit.
Il est vrai que longtemps après leur passage, l'odeur tenace des chèvres persistait et leurs nombreuses crottes jalonnaient leurs parcours. Comme il y en avait une bonne vingtaine...les balayeurs de rue avaient, les pauvres, fort à faire!
Paulette ETIENNE
|
|
ANECDOTE
Copie de la dépêche du 25-26 avril 1954
Envoyé par M. Charles Ciantar
|
|
Match entre les associations de Bône
et le
personnel de la dépêche de l'Est.
| |
| HISTOIRE DES VILLES DE LA
PROVINCE DE CONSTANTINE N°8
PAR CHARLES FÉRAUD
Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général
de l'Algérie.
|
|
LA CALLE
ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DES ANCIENNES CONCESSIONS
FRANÇAISES D'AFRIQUE.
Au GÉNÉRAL FORGEMOL
Ancien Capitaine Commandant supérieur,
du Cercle de La Calle
Troisième destruction du Bastion en 1637
Le Corsaire Ali Bitchinin, aborda au Bastion le 13 Décembre 1637, annonçant au Gouverneur qu'il ne faisait que s'arrêter quelques instants et allait continuer sa route. Le Gouverneur ignorant ce qui s'était passé, à Alger, avec le chevalier de Manty, reçut en toute confiance le Corsaire et tous les siens. Mais ils n'étaient pas plutôt entrés dans la Place qu'ils se saisissaient des personnes et des marchandises et chargeaient le tout sur les Galères, en enlevant aussi les portes et les fenêtrés de l'Établissement, après quoi ils y mirent le feu.
Une lettre datée d'Alger, le 11 Janvier 1638, annonce que tous les Français du Bastion, au nombre de trois cent dix-sept, ont été amenés dans cette ville, desquels les uns furent vendus sans aucune considération, et les autres répartis aux Galères. (Dans la Correspondance de Sourdis, T. II, P. 411. et D'après un Auteur Anglais, le Gouverneur du Bastion parvint seul à se sauver à Tabarque.)
Le Divan, en agissant ainsi ab irato, n'avait pas songé qu'il privait une grande partie des Indigènes de la province de Constantine des bénéfices commerciaux que ceux-ci faisaient avec les Français du Bastion. Or, ces Indigènes frustrés d'un négoce lucratif, déclarèrent qu'ils ne pouvaient plus rien payer aux Turcs, et, en effet, ils refusèrent nettement d'acquitter la lezma ou Impôt annuel.
A cette époque, le Chef des populations nomades sahariennes avait à se venger des Turcs de Constantine qui avaient traîtreusement assassiné son frère. Il exploita habilement les éléments de révolte provoqués par la destruction du Bastion, et tout le Pays prit les armes. Telle était donc la situation en 1638. A l'extérieur, hostilité avec les Français, sinon guerre déclarée ; à l'intérieur, formidable insurrection des Indigènes, née de deux causes différentes dans le Sahara et sur le bord de la mer.
Les révoltés attaquèrent Constantine et finirent par battre, en rase campagne, l'armée Turque envoyée d'Alger pour les réduire à l'obéissance.
Enfin, le Chef des Hanencha, Khaled ben Ali, Suzerain de tout le pays frontière dans lequel étaient situés le Bastion et La Calle, consentit à rétablir la paix avec les Turcs aux conditions suivantes :
1° Les Turcs n'inquiéteront plus les révoltés au sujet de la Lezma ;
2° Ils s'en retourneront droit à Alger sans se détourner ni à droite ni à gauche de la route, sous peine d'être tous taillés en pièces ;
3° Ils rebâtiront le Bastion de France, ainsi que ses dépendances, attendu que c'est là qu'eux, révoltés, allaient échanger leurs denrées contre de bon argent avec lequel ils payaient la lezma ; de sorte que la ruine du dit Bastion les avait empêchés de ne plus rien payer.
Pendant les années 1638 et 1639 on ne tenta rien contre les Algériens, et ce ne fut qu'au commencement de l'année 1640 que l'Archevêque de Bordeaux reçut l'ordre d'ouvrir de nouvelles négociations avec eux, par l'entremise d'un Sieur de Coquiel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, aidé du sieur Thomas Picquet, de Lyon.
Traité de Coquiel en 1640
Les Turcs d'Alger, pour rétablir la paix dans la Province de Constantine avaient intérêt à permettre le rétablissement du Bastion de France. Ils consentirent donc avec de Coquiel les Conventions suivantes :
" Articles du Traité fait pour le Bastion de France, Massacarès, dit La Calle, de Roze, Échelle de Bône et du Cole, fait avec le Pacha et Divan d'Alger, en présence de tous les Juges, Mufti et Cadis; par Jean-Baptiste de Coquiel, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, l'An 1640 et le septième Juillet qui est l'année 1050 et le quinzième jour de la Lune de Rebie El-Ouel, suivant le compte des Musulmans, pour y négocier en laines, cuir s, cires et autres Marchandises et faire la pêche du Corail depuis le Cole jusqu'au Cap Roux, qu'ils ont juré et promis obéir, savoir :
I. " Que les Vaisseaux, Barques et Polacres pourront aller et venir aux dites Échelles sans que personne les puisse troubler, et que défenses seront faites à tous autres marchands d'y négocier en aucune façon.
II. " Moyennant quoi, le dit de Coquiel nous paiera, tant pour la Ferme des terres qu'il possédera que pour les dits négoces du Cole et Bône, la somme de trente-quatre mille doubles chaque année, savoir : vingt-quatre mille doubles dès mains du Pacha pour la paie des soldats et dix mille doubles au Trésor de la Kasba.
III. " Lui sera permis de bâtir aux dites Places de Bastion Massacarès et Cap Roze, pour se défendre des Galères d'Espagne et des Frégates de Sardaigne, Majorque et Minorque, et pour pouvoir défendre les navires des Musulmans se retirant dans les dits Ports pour le mauvais temps ou peur des ennemis, comme aussi pour se défendre contre les Maures rebelles.
IV. " Pourra aussi bâtir à l'embouchure des Ports pour y tenir sentinelles.
V. " Arrivant que nos Galères ou Vaisseaux rencontrent aucun des Vaisseaux du dit de Coquiel, ne pourront rendre aucun déplaisir aux gens, ni moins prendre aucun garçon, ni chercher aucune avarie, sur quelque prétexte que ce soit, ainsi les laisseront aller libres en France à leur voyage.
VI. " Arrivant que les barques qui pêchent le Corail fussent, par le mauvais temps, portées en aucune des Échelles de la côte du Royaume d'Alger; personne ne les y pourra troubler, mais leur sera donné toute aide et faveur.
VII. " De Même, ne sera donné aucun empêchement aux dites Barques qui pêchent le Corail étant rencontrées par nos Vaisseaux allant et venant à Tunis.
VIII. " Lui sera permis de bâtir ou louer aux lieux de Bône et du Cole, maison, magasin, four et moulin, pour loger ses gens, pour y négocier et retirer les Coraux que ses gens pêcheront, et autres choses, les Bateaux desquels auront libre retraite aux dits Ports.
IX. " Ne seront, ses Agents ni ses Mariniers des Barques et Bateaux obligés de prendre du pain de la Noube du Cole ni du Bazar Bachi (magasin du Gouvernement) et le feront eux-mêmes, dans leur four, sans que personne les y puisse empêcher et pourront prendre toutes sortes de vivres et rafraîchissements pour leur nécessité, de même que les habitants de la ville et au même prix, sans que l'on puisse faire monopole sur eux.
X. " Et d'autant que dans les Ports de Bône et du Cole, quelques-uns s'émancipent sous prétexte de porter en Alger, de vendre des Cires, Laines et Cuirs, aux Patrons des Barques et Brigantins de Tunis, ou même audit Alger, où ils les vendent dans le Port aux vaisseaux Livournais, seront faites très expresses défenses à toutes sortes de personnes de faire semblables négoces, et se trouvant telles marchandises dans les dits Vaisseaux, Barques ou Brigantins, seront confisqués et les gens châtiés.
XI. " Ne sera permis à aucune personne de la Noube, de Bône et du Cole, ni autres Marchands, faire aucuns des dits négoces, ni moins le faire sous le nom d'autres.
XII. " Et d'autant que, tant à Bône qu'au Cole, l'on avait du temps de M. Sanson introduit beaucoup de nouvelles coutumes, il est fait expresses défenses de ne prendre autre chose que ce que l'on avait accoutumé donner du temps que les Anglais avaient les Échelles, et ne paiera aussi les droits des marchandises aux Caïds, que comme on faisait audit temps des Anglais.
XIII. " Ne pourra être contraint par le Caïd, ni la Noube de prendre des Truchemans pour faire son négoce, n'en ayant point de besoin.
XIV. " Et pour remédier aux abus qui se font aux dites Échelles par les Maures et les habitants de la ville, de frauder les Cires et les augmenter avec du parasine, huile et graisse et autres choses, seront : telles Cires qui se trouveront ainsi, brûlées, et les Marchands qui s'en trouveront saisis, amendés et châtiés pour donner exemple aux autres.
XV. " Que toutes sortes de personnes, soit Génois, soit Corses, Flamands, qui seront au service du dit Bastion, ou sûr les Vaisseaux ou Barques, seront privilégiés comme des même Français, et étant pris, ne pourront être faits esclaves, attendu que l'on ne peut passer de se servir des dites sortes de Nations, tant pour la Pêche du Corail, qu'autrement.
XVI. " Arrivant la mort de quelqu'un de ces gens dans les dites Échelles, ne pourra personne empêcher de leur donner enterrement, mais y aideront.
XVII. " Quand le Bastion de France aura besoin de prendre, dans lesdites Échelles de Bône et du Cole, des cargaisons, olives, huile, fromage, beurre et autres vivres, ne leur pourra être refusé en le payant ; aussi ayant besoin de biscuits, en nécessité, leur sera donné en payant, jusque que la nécessité sera passée.
XVIII. " Ne seront obligés, les Barques ni Vaisseaux du Bastion, de donner leurs voiles dans les Ports de Bône et du Cole, attendu qu'ils ont des gens en Alger qui répondent de cela. (Nous avons déjà dit que chaque navire Chrétien était forcé de donner en garantie son gouvernail et ses voiles pendant son séjour dans un Port barbaresque.)
XIX. " Ne sera obligé de payer aucuns droits du Corail et argent qu'il enverra en argent pour payer la lisme.
XX. " Tous Navires et Barques du Bastion qui viendront en Alger ne seront obligés de prendre des cuirs ni cires du magasin du Cade des cuirs.
XXI. " Et d'autant que dans la ruine du Bastion ils ont perdu tous les livres et toutes les promesses et quittances des négoces qu'ils faisaient avec ceux de Bône et du Cole, et que, par conséquent, ils ne peuvent justifier des paiements; ils seront déchargés de payer toutes promesses qui pourraient avoir été faites par eux ou leurs gens en faveur des dits de Bône et du Cole.
XXII. " Tous ceux qui résideront en Alger, pour les affaires du Bastion, seront protégés, sans que personne puisse leur donner aucun trouble ni mauvais traitement.
XXIII. " Arrivant différend entre les Français et, nous, et que cela causât rupture de notre part, n'en seront, les dits du Bastion, en aucune façon responsables ; et tous ceux qui parleront de rompre le dit Bastion, seront obligés de payer les trente-quatre mille doubles tous les ans, qui se paient tant au Pacha qu'au Trésor de la Casbah, afin que la paie des soldats n'en reçoive aucune atteinte.
" Ainsi sont les Articles de cette Capitulation, écrite et publiée, et fait deux copies en façon d'Acte, l'une pour garder dans la caisse du Trésor de la Casbah, et l'autre l'avons donnée au dit Jean-Baptiste de Coquiel, pour s'en servir en temps et lieu.
" Fait au milieu de la Lune de Rabi el-Ouel, l'an 1050, suivant le compte des Musulmans (7 Juillet 1640). "
Le Cardinal de Richelieu repoussa énergiquement le Traité de Coquiel, qui n'avait pas, disait-il, suivi ses ordres, et qui était contraire aux Capitulations que le Roi avait avec le Grand Seigneur.
Cependant, ce Traité, quoique non ratifié par le Roi, était en vigueur au Bastion de France, puisque le 19 Août 1641, le Père Archange de l'Isle, Augustin déchaussé, y trouvait le personnel Français rétabli, au moins partiellement.
Rupture de Picquet
L'Établissement commercial du Bastion qui venait d'être rendu à la France, ne se soutint pas longtemps. Picquet de Lyon qui le dirigea dans cette troisième phase de son existence, ayant fait de mauvaises affaires et devant à Alger des sommes considérables qu'il ne pouvait payer, le Bey d'Alger le menaça de le faire maltraiter.
En 1658, Picquet s'embarqua frauduleusement et s'enfuit avec sa garnison et tous les effets du Bastion. Mais non content de faire banqueroute à ses Créanciers, ce misérable, qui déshonorait le nom de la France chez les Algériens, enleva les quatre Chaouchs et les cinquante Maures envoyés pour lui réclamer ses dettes, les chargea de chaînes et alla les vendre à Livourne aux galères de Toscane. De retour en France, Picquet n'eût pas honte d'ajouter à son nom comme titre de Noblesse, celui de La Calle. Il revenait riche et on le laissa faire. Néanmoins le Gouvernement Français s'empressa de le désavouer dès qu'il eût connaissance de cet acte odieux, et les Arabes que Picquet avait vendus en Italie, rachetés par les soins de notre Consul de Livourne, furent renvoyés dans leur pays.
A la suite de l'attentat de Picquet, le père Barreau, Préfet Apostolique, qui remplissait, à Alger, les fonctions de Consul de France avait été jeté en prison et les Esclaves Chrétiens eurent beaucoup à souffrir. St-Vincent de Paul, Supérieur de la mission, s'employa si bien, que les Arabes enlevés furent, disons nous, rachetés, rendus et Barreau remis en liberté. Louis XIV voulant alors réorganiser le Bastion, écrivit à Ibrahim Pacha la lettre suivante qui resta sans réponse.
" Illustre et magnifique Seigneur, ayant pourvu de la charge de Gouverneur et Consul du Bastion de France en Barbarie le Sieur Louis Campon, écuyer de notre ville de Marseille, pour rétablir cette Place dans son négoce, nous avons bien voulu vous écrire la présente pour vous dire que vous ne, nous ferez pas un plaisir peu agréable de le favoriser de votre autorité et protection et de ne souffrir qu'il lui soit fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement quelconque, mais au contraire toute l'aide et protection dont il aura besoin, comme nous ferions en pareil cas, si nous y étions requis ; cependant nous prions Dieu qu'il vous aye, illustre et magnifique Seigneur, en sa Sainte Garde.
" Écrit de Paris, le 14 juin 1659.
" LOUIS. "
Un sieur Rominhac, qui avait payé les dettes de Picquet et ramené les Turcs et les Maures enlevés, se présenta ensuite pour lui succéder; mais cette négociation n'aboutit pas non plus, car le Divan d'Alger, que l'indigne conduite de Picquet avait exaspéré contre les Français, ne voulut pas pendant longtemps entendre parler de leur réinstallation en Afrique.
Cependant, en 1662, lisons-nous dans une lettre du Père Dubourdieu, du 22 Août, il était de nouveau question de la réoccupation du Port de La Calle mais les Négociateurs manquaient de ce qui aurait pu assurer la réalisation de leurs désirs de l'argent nécessaire. Ils bornèrent alors leurs demandes au rétablissement du Bastion de France. (Baude rapporte que vers cette époque, le Duc de Guise ne sachant comment diriger l'Exploitation des Concessions, les cédait à une Compagnie qui se serait formée, moyennant une redevance annuelle de dix chevaux barbes.) Les démarches et les bons offices du Consul Dubourdieu n'ayant pu triompher de l'opposition du Divan, il demanda son congé aux Algériens, qui le lui refusèrent, disant que ses fonctions se trouvaient étrangères à cette affaire du Bastion.
Enfin, les Turcs étaient disposés en 1664, à traiter avec la Compagnie du Bastion ; le Consul en informa le gouvernement dans le mois de Mars et lui recommanda par-dessus tout de n'entretenir que des " Agents d'honneur et de conscience, persuadé qu'il était, que les malheurs qui sont arrivés à ceux qui ont possédé le Bastion ont procédé de la mauvaise conduite de celui qui résidait à Alger. Plaise à Dieu qu'il n'en soit pas ci-après comme il a été ci-devant. " Mais la lutte qui eut lieu cette même année, entre la France et Alger, rompit toute négociation.
La France étant sortie de ses embarras intérieurs et la paix avec l'Espagne étant conclue, Louis XIV s'appliqua à protéger le Commerce contre les entreprises des Corsaires barbaresques Le Duc de Beaufort commença par leur donner la chasse et leur faire éprouver de grands revers ; puis le 26 Juillet 1664, il occupait avec un Corps de débarquement, la petite ville de Gigelli. On connaît l'issue malheureuse de cette, Expédition.
En 1665, Beaufort prenait sa revanche en coulant et incendiant les flottilles de Corsaires Algériens, d'abord devant Tunis, puis devant Cherchell. Cette rude leçon les rendit plus disposés à entrer en accommodement.
Traité d'Arnaud en 1866
Au commencement de 1666, le Roi de France reçut une lettre des principaux de la Milice d'Alger, demandant à traiter de la paix.
Un sieur Jacques Arnaud, de Gap, en Dauphiné, et établi à Marseille, s'étant trouvé dans ce temps-là à Alger, travailla beaucoup à la conclusion de cette grande affaire.
Il fit plusieurs voyages d'Alger en France pour ajuster les différends réciproques entre les deux Nations, et cela lui acquit l'estime de, M. de Colbert, qui lui trouva beaucoup d'esprit, de pénétration et de droiture. Enfin, il négocia si heureusement que la Paix, sur laquelle on n'avait pu s'accorder, fut conclue ainsi qu'il suit à l'avantage de la Navigation et du Commerce et plus favorablement qu'à aucune autre Nation étrangère.
TRAITÉ DE PAIX
Fait entre le Royaume de France et la Ville et Royaume d'Alger.
" L'an 1666, le dix-septième jour de Mars du règne du très chrétien, très puissant, très excellent et invincible Prince Louis X.IV du nom, par la Grâce de Dieu, Empereur de France et de Navarre. Le sieur André François Trubert, gentilhomme ordinaire de la maison de Sa Majesté et Commissaire Général de ses Armées Navales, envoyé par le très haut et très puissant Prince Monseigneur François de Vendôme, Duc de Beaufort, Prince de Martigues, Pair, grand Maître, Chef et Surintendant Général de la Navigation et Commerce de France.
" En conséquences des lettres écrites par le très illustre Pacha, Divan et Milice de la Ville et Royaume d'Alger, par desquelles ils auraient témoigné être en volonté de rétablir l'ancienne amitié et bonne correspondance qui étaient autrefois entre les sujets de sa Majesté et eux, se serait présenté en cette Ville d'Alger or après avoir rendu les Lettres de créance de son Altesse en réponse, les dits très illustres Pacha, Divan et Milice en expliquant les ordres du Grand Seigneur et en exécutant la Capitulation ci-devant faite entre les Empires de deux si grands Monarques, auraient d'un commun consentement résolu de rétablir et même de conserver et maintenir à l'avenir une bonne paix et amitié et pour cet effet sont convenus des articles qui suivent.
" I. Que les Capitulations faites et accordées entre les deux Empereurs et leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau à l'Ambassadeur de France envoyé exprès à la Porte du Grand Seigneur pour la paix et repos de leurs États, seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que de part et d'autre il soit contrevenu directement ou indirectement.
" II. Que toutes courses et actes d'hostilités tant par mer que par terre cesseront sans qu'à l'avenir les Corsaires du Royaume d'Alger rencontrant les navires et autres bâtiments Français, tant de Levant que de Ponant, ensemble tous les Négociants sous la Bannière de France sujets de Sa Majesté, puissent visiter, prendre ni toucher aux personnes, robes, vaisseaux et marchandises, ni autre chose leur appartenant, ayant passeport de l'Amiral de France. Et pour appuyer d'autant plus le présent Traité qui n'a été rompu que par des particuliers Armateurs, les très illustres Pacha, Divan et Milice leur ordonneront de n'y contrevenir en aucune manière que ce soit et seront obligés avant de sortir de leurs Ports, de prendre un Certificat du Consul Français résidant en la dite Ville d'Alger pour être reconnus des navires galères et bâtiments de France, afin que les Corsaires de Tripoli et autres de Barbarie ne puissent se prévaloir de la conformité de la langue et de l'Étendard.
" III. Comme aussi ne sera permis que dans les Ports de France soient armés aucuns vaisseaux pour courir sur ceux d'Alger et en cas que les Sujets de Sa Majesté se missent au Service d'autres Princes et fassent la course sous la Bannière d'iceux, Sa Majesté les désavouera et ne leur donnera aucune retraite dans ses Ports pour y conduire les Turcs des dites ville et Royaume, et si tant est qu'ils y abordent, Sa Majesté les fera mettre en liberté avec leurs navires et facultés. De même s'il était mené par les Corsaires des autres Royaumes et pays de la domination du Grand Seigneur quelque Français par force dans la Ville et Royaume d'Alger, il leur sera donné à l'instant la liberté, avec une entière restitution de leurs facultés.
" IV. Que tous les Esclaves Français qui sont dans l'étendue du Royaume d'Alger, pris sous quelque Bannière que ce soit ou qui pourraient être pris à l'avenir, de quelque qualité et condition qu'ils soient, sans en excepter aucun, seront mis en liberté et rendus de bonne foi, ainsi que les Janissaires qui sont en France, pris sous la bannière, dans les vaisseaux de la Ville et Royaume d'Alger, seront pareillement rendus.
" V. Les navires, galères et autres bâtiments, tant de guerre que de marchandises de part et d'autre, se rencontrant à la mer, après s'être reconnus par les Patentes de l'Amiral de France et par le Certificat du Consul des Français, qu'ils feront voir réciproquement par le moyen de leurs chaloupes et de leurs bateaux, se donneront nouvelles et seront reçus dans tous leurs Ports et Havres comme vrais et bons amis, et leur sera fourni tous les vivres, munitions et marchandises dont ils auront besoin, en payant au prix courant des marchés publics et les droits ordinaires.
" VI. Et pour travailler à l'établissement d'un commerce ferme et stable, les très illustres Pacha, Divan et Milice envoieront, s'il leur plaît, deux personnes de qualité d'entre eux résider en la Ville de Marseille pour entendre, sur tes lieux, les plaintes qui pourraient arriver sur les contraventions au présent Traité, auxquels sera fait en la dite ville toutes sortes de bons traitements. Comme aussi le Consul des Français fera le même office en la Ville et Royaume d'Alger.
" VII. Le dit Consul jouira des mêmes honnêtetés, facultés et pouvoirs dont il doit jouir en conséquence des capitulations qui ont été faites, ou qui le seront ci-après entre les deux Empereurs, et, à cet effet, avec la prééminence sur tous les autres Consuls, il aura chez lui l'exercice libre de la Religion chrétienne, tant pour lui que pour tous les Français qui se trouveront en la dite Ville. Il aura aussi le privilège de changer de Trucheman, quand il le jugera nécessaire.
" VIII. Qu'icelui Consul ni autre sujet de Sa Majesté ne sera contraint de payer les dettes d'aucun Français ou autre, s'il n'y est obligé par écrit et que toutes les autres Nations qui négocieront en la dite Ville et Royaume d'Alger, et qui n'auront point de Consul, reconnaîtront celui de France et lui payeront les droits accoutumés sans difficulté.
" IX. Que les étoffes et vivres que le Consul Français fera venir pour son usage ou pour présent seulement, ne payeront aucuns droits ni impôt, non plus que ce qu'il achètera sur les lieux, pour la provision de sa maison.
" X. Que si un Vaisseau ou autre Bâtiment Français fait naufrage aux Côtes des dites Villes et Royaume d'Alger, il sera secouru par mer et par terre des habitants des Côtes, et les Marchandises et les Bâtiments remis à qui ils appartiendront, ou entre les mains du Consul ; et que tant celles-là que les autres, qui ne seront point conduites dans la dite Ville d'Alger, ne payeront aucuns droits, quoiqu'elles aient été déchargées; non plus que les Vaisseaux et Barques qui reprendront les Marchandises non vendues, ne payeront point d'ancrage pour leur sortie, et, en cas qu'il arrivât le même accident aux Vaisseaux et autres Bâtiments du Royaume d'Alger sur les Côtes de France, ils recevront un traitement pareil.
" XI. Si quelqu'un des Sujets de Sa Majesté frappe ou maltraite un Turc ou un Maure, on pourra le punir après en avoir donné avis au Consul ; mais en cas qu'il se sauve, on ne pourra s'en prendre au dit Consul ni à aucun autre.
On demeure d'accord aussi que nul des Turcs ou Maures qui ont des Esclaves Français, ne pourront les contraindre ni forcer à changer de religion, ni leur faire aucune menace pour les y obliger.
" XII. Que les Marchands Français, négociant dans tous les Ports et Rades du Royaume d'Alger, seront traités pour les levées et impositions autant et plus favorablement qu'aucune autre Nation étrangère.
" Et si, à l'avenir, il arrivait de part et d'autre quelque action qui put être prise pour un sujet de mécontentement, il ne sera pas, pour cela, permis à celui qui s'estimera offensé d'user de force et d'hostilité, jusqu'à ce que l'on ait refusé de faire justice à ceux qui se plaindront. Et, pour le surplus, seront les Capitulations ci-devant faites, ou qui le seront ci-après, entre les deux Empereurs, comme le présent Traité, observées de part et d'autre, de point en point, selon leur forme et teneur.
" Et afin que nul Sujet des deux Empires n'y puisse contrevenir, on les fera publier dans toute leur étendue, incessamment et le plus tôt qu'il se pourra.
" Le tout ayant été accordé dans une Assemblée générale, ainsi arrêté et signé en présence du Divan, et scellé et tapé en l'original de la Marque du Pacha Ali, et signé André-François Trubert. "
Le Dey d'Alger voulut donner en cette occasion des preuves de sa reconnaissance au sieur Arnaud. Il lui permit de rétablir, en son nom, le Commerce du Bastion de France et de ses Dépendances, et de relever les Murailles que les Maures avaient abattues après la fuite du sieur Picquet.
Il fallait donc réparer tous les Bâtiments et les Murailles, il fallait pourvoir le Fort d'Artillerie et de Munitions de guerre et de bouche, y mettre une Garnison convenable et faire un Fond pour rétablir le Commerce dans son ancien état. Arnaud n'était pas assez riche pour entreprendre seul ce grand Établissement. Il obtint la permission du Dey d'aller en France pour former une Compagnie qui fournit les fonds nécessaires. Cette Compagnie était composée des sieurs Jacques le Masson de la Fontaine, Contrôleur Général des Gabelles de France, du Seigneur de Lalo, Conseiller au Parlement de Grenoble, et du sieur de La Font, de Lyon.
Tous ces gens étaient sages et fort riches ; ils passèrent l'Acte de leur Société à Marseille, en réglèrent les fonds et il fut convenu que Arnaud irait au Bastion en qualité de Gouverneur. Le Dey l'agréa et lui donna toutes les expéditions dont il avait besoin pour s'y établir de la manière que la nouvelle Compagnie pouvait le désirer.
De La Font s'établit à Marseille en qualité de Directeur pour la correspondance des affaires qu'Arnaud ferait au Bastion. La Fontaine demeura à Paris aussi en` qualité de Directeur, et de Lalo, également Directeur, allait tantôt à Paris, tantôt à Marseille et même au Bastion, selon l'exigence des affaires.
Arnaud avait emmené avec lui le sieur de St-Jacques, son gendre, autrefois Conseiller au siège de Marseille. Il le fit Capitaine de La Calle, où il mourut quelque temps après. Arnaud voulut donner cet emploi au fils aîné du défunt. Mais de La Font, Directeur à Marseille, avait promis la place à une de ses créatures et l'envoya à La Calle sans avertir Arnaud qui, s'en trouvant choqué, ne voulut pas le recevoir et le renvoya en France. De là, un premier conflit de pouvoirs, bientôt suivi d'une querelle qui alla toujours s'envenimant.
Averti que le Directeur de Marseille, qui avait une grande envie d'être nommé Directeur du Bastion; sollicitait sa destitution des autres associés, Arnaud songea à se maintenir à son poste, malgré la Compagnie. Mais, pendant ce temps, ses associés cherchèrent à trouver des raisons pour colorer le projet qu'ils avaient formé ; ils observèrent ce qui se passait dans la famille d'Arnaud, restée à Marseille, et crurent voir qu'on y faisait grande chère et que les dépenses de sa maison venaient des profits particuliers que leur Gouverneur faisait à leurs dépens.
Madame Arnaud prit feu là dessus et donna à son mari tous les avis qu'elle jugea nécessaires. Ces avis le déterminèrent à ne pas se laisser déposséder sans coup férir, après les peines qu'il s'était données pour la Paix avec le Gouvernement d'Alger et le rétablissement du Commerce du Bastion dont on lui avait toute l'obligation. Il résolut donc de s'y maintenir par la faveur du Dey et de la Milice qui avaient beaucoup de considération pour lui, de sorte que les ordres des trois Directeurs de France étant arrivés au Bastion par la barque du Patron Légier, il répondit qu'il ne quitterait point son poste et leur écrivit toutes les raisons qu'il avait d'en user ainsi. Elles parurent justes aux gens désintéressés, mais la Compagnie n'en jugea pas si favorablement.
L'animosité augmenta beaucoup au retour de la barque de Légier. Les Directeurs eurent recours à M. de Colbert qui leur promit sa protection, et sur l'exposé qu'ils lui firent de la conduite d'Arnaud et de sa prétendue malversation, il leur donna une lettre de cachet et les ordres du Roy, qui furent portés au Bastion par un Vaisseau de guerre aux frais de la Compagnie. Arnaud répondit qu'il ne pouvait quitter ses Places dans l'état où elles étaient, sans préjudicier aux intérêts du Roi et du Gouvernement, qu'il obéirait aux ordres de Sa Majesté dès qu'il le pourrait, et le Vaisseau revint ainsi sans avoir rien avancé.
Cependant, le Commerce avait été interrompu, parce que de La Font, espérant réduire par la famine l'obstiné Gouverneur, avait fait défendre aux Navires Français d'aller au Bastion. Arnaud, sans se laisser émouvoir par cet espèce d'interdit qu'il avait prévu, ouvrit les Ports du Bastion de France et de La Calle aux Négociants de Gênes et de Livourne, et se maintint avec leur aide.
La Compagnie le fit condamner comme rebelle aux ordres du Roi et résolut d'envoyer d'autres Bâtiments à Alger. Le sieur Turpin et M. de Martel allèrent demander au Dey de leur livrer Arnaud qui était alors à Alger ; mais la Milice demandant à être payée et ne recevant point d'argent, refusa absolument de le rendre, disant qu'Arnaud était un honnête homme, que c'était à lui seul qu'elle avait donné l'Établissement du Bastion, et qu'on ne connaissait pas le prétendu Directeur de Marseille ou ses associés.
Le sieur de Lalo alla ensuite à Alger et offrit au Dey une somme pour obtenir la destitution d'Arnaud, De La Font avait été une première fois au Bastion, et pendant ce voyage, on l'accusa d'avoir promis vingt-mille piastres au Bey de Constantine pour faire tuer le Dey d'Alger et son gendre, qui étaient les protecteurs d'Arnaud. Cette accusation s'était ébruitée, de sorte que quand de La Font retourna à Alger, il n'osa mettre pied à terre et resta toujours sur son Vaisseau, craignant qu'on le fit mourir comme on l'en avait menacé si ou pouvait le prendre.
Les offres de Lalo ne furent point écoutées, de sorte qu'il fut obligé de se retirer sans avoir pu rien faire. Arnaud retourna au Bastion sous la protection du Dey et de la Milice, laissant à Alger le sieur Estelle, son beau-frère et son agent qui continua à le soutenir puissamment contre tous ses ennemis qui, les uns après les antres, furent contraints de s'en retourner à Marseille, après avoir fait inutilement de fort grandes dépenses.
Les trois associés de France ne sachant plus que faire pour contraindre Arnaud à se retirer du Bastion, s'avisèrent d'un étrange moyen. Ils demandèrent et obtinrent des ordres du Roi pour se saisir de sa famille. Sa femme et sa fille furent arrêtées et enfermées dans la Citadelle de Marseille, où elles demeurèrent fort longtemps ; les associés espérant que l'état de ces deux malheureuses femmes toucherait le sieur Arnaud et l'obligerait à obéir aux ordres du Roi. " On ferait des volumes entiers, ajoute le Chevalier, d'Arvieux, des procédures qui ont été faites dans cette affaire. " Ce singulier abus de pouvoir n'eût pas le succès qu'on en attendait. Arnaud ne céda pas. Toute sa fortune était engagée dans cette malheureuse spéculation et il savait bien d'ailleurs qu'on ne pouvait pas, sans la plus révoltante injustice, rendre sa famille responsable de son obstination, Au bout de quelques mois, en effet, sa femme et sa fille furent remises en liberté.
A SUIVRE
ALGER, TYP. DE L'ASSOCIATION OUVRIÈRE V. AILLAUD ET Cie
Rue des Trois-Couleurs, 1877
Livre numérisé en mode texte par M. Alain Spenatto.
| |
L'AUMONIER
Par M. Nafaa Boumaiza
Envoyé par Mme Boumaiza (sa fille)
|
Je m'adaptai à peine à l'Internat si triste
Qu'un surveillant m'apprit que notre permanence
Du lundi à onze heures supprimait sa séance
Qu'il fallait de ma classe réintégrer la liste.
C'était le Catéchisme - je ne peux le nier -
On me fit donc asseoir, au fond, supplémentaire
J'entendais l'homme en noir réciter son bréviaire
Mes camarades disaient que c'était l'aumônier.
J'allai dans cette étude malgré ma propre race
J'y ai connu MARIE, LAZARE de BETHANIE
JESUS disant ELI, lama sabacthani
Presque de mon CORAN j'avais perdu la trace.
Un jour il m'appela, et égal à lui-même
Me dit tout à la fin de notre réunion
" Bientôt vous devez faire votre sainte Communion
Apportez-moi bien vite vos papiers de baptême ".
Le lundi qui suivit, je fus par lui mandé
Alors je précisai qu'on fit une grande fête
Pour ma circoncision, que le taleb honnête
N'a pas pu me fournir les papiers demandés.
" Parbleu répondit-il, vous êtes mahométan
Que veniez-vous mon fils charger votre mémoire
De ces cours qui vous sont supplémentaire histoire ?
Amis je ris encore de ces neiges d'antan.
L'aumônier constatait ma race sarrasine
Et ne me força plus à faire d'autres devoirs
Mais avec mes amis je récitais le soir
Les Laudes, les Nones et vêpres, les complies, les mâtines.
Et je dois reconnaître qu'en ce jour, ce moment
J'aime tous mes prochains et avant de partir
Je dois vous assurer que j'ai en souvenir
L'aumônier qui m'apprit les dix Commandements.
BOUMAIZA NAFAA.
- ANNABA -
|
|
DOCUMENT
Exceptionnel
envoyé par M. Marc Spina
|
|
L'INCENDIE DE LA MAIRIE DE BÔNE EN 1962
Ce petit film a été tourné en Super 8 par M. Spina et aujourd'hui il nous en fait profiter.
Merci Marc
Aujourd'hui, à la vue de notre magnifique Mairie en feu, on mesure la bétise de la guerre car ensuite on ne peut rien dire sur la destruction d'autres monuments découlant d'autres bétises.
Cela prouve que la politique de la terre brûlée ne profite à personne et n'est en rien justifiable, car dans ce cas précis, il ne faut pas oublier que sous cette superbe toiture il y avait des archives qui ont été définitivements perdues pour tout le monde dont les principales victimes sont les Pieds-Noirs.
JPB
Je vous rappelle que cette vidéo est protégée par des droits d'auteur et qu'elle n'est pas commerciable, seules les copies privées sont autorisées. Pour télécharger et voir cette vidéo en privé.
INCENDIE de la MAIRIE de BÔNE EN 1962.
CLIQUEZ ICI
|
|
| Sacrée Maladie ..!
Envoyé Par Chantal
| |
4 vieilles grands-mères sont assises à une table dans une maison de retraite.
Soudain un vieux grand-père fait son entrée dans la pièce. Une des vieilles grands-mères l’interpelle :
- Nous parions avec toi que nous sommes capables de te dire ton âge avec exactitude !
Le vieil homme leur réplique :
- Cela m’étonnerait beaucoup que vous sachiez trouver mon âge exact, bande de vieilles poulettes déplumées !
Une des vieilles poulettes lui réplique :
- Pour sûr que nous savons te le dire ! Baisse ton pantalon et ton slip et nous te dirons avec exactitude l’âge que tu as !
Un peu surpris mais fermement décidé à leur prouver qu’elles en sont incapables, il baisse son pantalon et son slip.
Les petites vieilles lui font faire quelques allers et retours et demi-tours devant elles avant de s’écrier en chœur :
- Tu as 89 ans ! Avec le pantalon et le slip toujours baissés, le petit vieux s’énerve :
- Par tous les saints du paradis, comment avez-vous deviné ?
Avec des larmes plein les yeux à force d’avoir rigolé, les 3 vieilles s’écrient à nouveau en chœur :
- Hier nous étions à ton anniversaire !!!!
|
|
|
Pourquoi suis-je devenu Supplétif ?
Par Christian Migliaccio
|
50 ans sont passés et où en est-on ?
J'ai décidé d'écrire pour vous faire partager mon destin ; non pour m'autocélébrer, ou pour m'auto promouvoir, mais pour deux raisons :
Lorsque l'on arrive à la fin de sa vie, le besoin d'expliquer ce que l'on a vécu se fait sentir, Il existe un vieux proverbe arabe qui dit : « Lorsque le vieillard disparaît c'est une bibliothèque qui brûle » On a toujours envie de sauver quelques pages de l'incendie, ou de laisser quelque chose sur le coin de la table avant de quitter la maison.
La première raison est, que je crois à l'importance du passé. Non par nostalgie larmoyante, mais par passion de l'avenir. Le passé éclaire le présent. Je crois au poids des mots, au sang et à la mémoire des hommes. Que serait une nation sans mémoire ? Que serait un homme sans mémoire ? Il marcherait dans la nuit. Pour ma part, je crois à la force du passé.
L'autre raison pour laquelle j'évoque mon destin, c'est que je crois à l'utilité du témoignage. Un témoignage personnel n'apporte pas la vérité avec un grand V. Je ne vais pas vous dire la vérité sur la guerre d'Algérie, mais sur ma jeunesse dans ce pays, je devrai plutôt dire cette belle Province française d’Algérie, française bien avant le comté de Nice ou le comté de Savoie. Je vous apporte ma petite vérité, mon petit éclairage. Ce sont ces différentes petites vérités qui vous permettront d'approcher la Vérité. Cette vérité que tout homme digne de ce nom cherche à appréhender.
Je suis né en Algérie le 17 juin 1938 à Bône, d’un père français d’origine Napolitaine (Ischia) et d’une mère française d’origine Maltaise (La Valette) dans une famille qui comptait 12 enfants.
Père et mère quasiment illettrés, j’ai vécu ma prime jeunesse auprès de ma grand-mère maternelle à Bône. Les Maltais étant des gens très pieux et pratiquants, je fus envoyé au petit séminaire de Constantine où j’ai effectué mes humanités.
Le Premier novembre 1954, jour oh combien funeste ! L’Algérie s’embrase par des attentats simultanés d’Ouest en Est, qui ne se souvient du lâche assassinat des époux Monnerot ?
Modestement à mon niveau, lorsque je jouais avec mes petits camarades musulmans de quartier, j’habitais la Cité Auzas à Bône, quartier que l’on qualifierait de « Zone » aujourd’hui. Je pratiquais sans le savoir une sorte d’action psychologique pacifique en dissuadant mes petits camarades de jeux de s’enrôler dans le FLN 1. Mon action bien que timide s’avérait efficace et j’employais toujours les mêmes arguments : « Ton grand-père est mort ou a été blessé à Verdun, ton père, tes oncles ont été blessés ou sont morts à Monte-Cassino ou à Diên Bien Phu. Ils ont combattu avec gloire et honneur sous les couleurs du drapeau français. Oseriez-vous leur faire honte en combattant contre le drapeau qu’ils ont su si vaillamment défendre ?
Il faut croire que ma pédagogie était convaincante, puisque le commissaire politique, (les cellules FLN étaient calquées de la même manière que les cellules politiques communistes et marxistes, les réunions étaient tenues secrètes par le commissaire) n’arrivait plus à convaincre mes camarades de jeux d’embrasser la politique du FLN, mais surtout d’alimenter en combattants leurs rangs. Je fus donc condamné à Mort par ce même responsable
Le 2 juin 1956, alors que je regagnais mon domicile, accompagné de mes parents, il était 21 heures, lorsque quatre jeunes hommes sortis du couloir d’un immeuble, dans la pénombre, se sont rués sur moi et m’ont solidement maintenu. Mes parents pensant que ce devait être un jeu, ont continué à avancer. L’un des quatre énergumènes m’a dit : « on va te tuer ». A mon tour je pensais qu’il s’agissait d’un jeu. J’ai vite compris quand un second individu s’est baissé au pied d’un poteau électrique, pour en sortir un paquet de chiffon, qu’il déploya et j’ai aperçu … un révolver ! J’ai immédiatement compris que ce n’était plus un jeu, mais une exécution sommaire. Le troisième comparse un morceau de tissus à la main m’a dit : je vais te bander les yeux. Par bravade, sans aucun doute, et non par patriotisme, j’ai répondu qu’il n’en était pas question. Je n’avais aucun sentiment de peur, et je n’ai pas crié, j’étais comme dans un état second, loin d’imaginer que j’allais mourir.
Devant mon attitude, celui qui tenait le révolver s’est posté derrière moi, il a appliqué le canon de l’arme contre mon omoplate et a tiré à bout touchant, J’ai senti une brûlure et une forte odeur de soufre, comme quand on frotte une poignée d’allumettes d’un seul coup. La balle m’a transpercé de part en part détériorant au passage le poumon gauche, le cœur oreillette droite et est allé se loger dans l’œil d’un passant qui marchait en sens inverse, le sieur Chorfi Rabah qui a perdu son œil.
A sang chaud je me suis mis à courir, dépassant mes parents, et je suis tombé en essayant d’ouvrir la porte de notre appartement. Mes parents ont pensé que j’avais eu peur et ne se sont pas inquiétés pour moi, ils se sont portés au secours de Chorfi Rabah, appelant une ambulance pour le diriger vers l’hôpital. Une fois le blessé évacué mon père et ma mère regagnant le domicile ont eu la désagréable surprise de me voir étendu au pied de la porte d’entrée dans le coma et perdant mon sang en abondance. Je n’ai qu’un vague souvenir de ce moment fatal, mais je me souviens des cris de ma mère : Ils ont tué mon fils, ils ont tué mon fils.
Mon état n’inspirait aucune chance de survie, le chirurgien, le Docteur Debrie dit à mon père : votre fils est quasiment mort, mais si vous m’en donner l’autorisation écrite je tenterais l’impossible, n’ayez tout de même pas trop d’espoir.
Mon père apposa une petite croix au bas du document, le pauvre il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait une confiance totale en ce chirurgien qui aurait pu être son fils tellement il était jeune.
Trois semaines de coma, deux longs mois d’hôpital et me voilà de nouveau prêt à affronter le dur combat de la vie. En ce qui me concerne, se serait plutôt de la survie. Les soins ont été beaucoup plus pénibles à endurer : ponction dans le poumon, piqures, brûlures des excroissances de chair au nitrate d’argent, assistance respiratoire, pour ne citer que ceux qui m’ont le plus marqués.
C’est alors que j’ai commencé une convalescence à la maison, oubliant le séminaire, les études, les jeux. J’attendais avec impatience d’être appelé au service militaire de ma classe. Ce jour tant attendu arriva. La sentence raisonne encore dans ma tête, elle ne me quitte plus : Christian Migliaccio « Exempté ».
Cette blessure-là s’est révélée bien plus traumatisante que la blessure par balle. Comment moi, le seul mâle de la famille, inapte au service militaire ? Dans mes rêves d’enfant les plus fous, je me voyais bravant la mitraille et les obus, conquérir un territoire tenu par l’ennemi. Ne pas faire son service militaire en Algérie était ce qui pouvait arriver de pire à un jeune homme.
Désormais je ne serai plus français, puisque l’Etat m’avait désigné comme inapte à le servir. Quand on a un nom comme le mien à consonance italienne pour se sentir français, la meilleure façon était de servir son pays. Je n’ai jamais accepté d’être français par filiation. Mon titre de français je devais le gagner au service de mon pays et non par la transmission paternelle.
Il fallait que je trouve un moyen de porter les armes pour la défense de ma terre de mon pays, de ma nationalité, au service de la paix des hommes. J’ai donc appris que la France recrutait des supplétifs, autochtones, de souche nord-africaine ou européenne. Que ces personnels étaient engagés dans des groupes d’auto défense, de maghzen(2) ou de groupe mobile de police rurale. Qu’il n’y avait aucune exigence médicale, qu’ils étaient engagés comme journaliers et gérés par le Ministère de l’Intérieur. Notre paquetage était squelettique, notre armement archaïque, notre instruction au combat quasi nulle, quand à notre salaire un peu plus d’un euro par jour, c’est dire 7,50 F de l’époque. Si nous étions blessés ou morts, cela était considéré comme un accident du travail. Notre contrat était d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Nous pouvions être renvoyés sans préavis, par le chef qui nous employait.
Je me rends donc à la préfecture de Bône pour m’engager comme Moghazni (2) S.A.S. (3) Je m’engage pour la durée de la guerre. J’ai demandé au Capitaine responsable du recrutement de m’affecter là où personne ne souhaitait aller. Le poste d’interprète m’a été proposé pour la S.A.S. de Bordj-M’raou Sakiet Sidi Youssef. En Zone déshéritée, à la frontière Tunisienne, à l’extérieur de la ligne Morice (Barrage électrifié) dans une sorte de No man’s Land entre le barrage et la frontière Tunisienne.
Sans aucune instruction militaire, le Lieutenant Chef de S.A.S. m’a affecté un paquetage, un fusil, des munitions, une grenade, un cheval et j’ai été incorporé à son maghzen.
Pour toute intimité, j’étais logé dans une sorte de grand hangar où étaient disposé une trentaine de lits métalliques, sur lesquels se trouvaient des sacs de gros drap remplis de paille qui servaient de matelas, ainsi que deux couvertures.
La nourriture était à notre charge, le pain, les tomates, les oignons étaient notre quotidien. L’huile d’olive et la viande un met de luxe, étaient souvent absentes. Par contre les olives, les cacahuètes, le thé à la menthe et le café nous apportaient le tonus nécessaire pour le crapahut. Notre maigre salaire y suffisait tout juste.
Au milieu de ce hangar se trouvait un gros poêle à bois, et trois ou quatre tables et des bancs. Un ancien sergent de tirailleurs était notre mokkadem et nous commandait, supervisé en cela par un adjudant-chef de l’Armée d‘Active. Les seules instructions militaires que j’ai reçues ont été de me mettre au garde à vous, de saluer, et d’aller m’exercer au tir. En prime, j’ai eu droit de porter le poste radio lors des patrouilles de nuit. Dans le cantonnement j’ai été affecté comme tireur à la mitrailleuse «Hotchkiss » et en opérations, je servais la mitrailleuse MG42 (4) avec deux Moghazni pourvoyeurs.
Notre action militaire était conditionnée par le commandant de Secteur, l’unité d’active à laquelle nous étions rattachée, et les taches les plus ingrates nous étaient confiées : embuscades et patrouilles de nuit dans notre secteur. La particularité de notre poste était que nous étions harcelés au moins deux ou trois fois par semaine.
Les fellouzes (5) stationnés en Tunisie ne se gênaient guère de franchir la frontière et de nous canarder à coup de mortier et de lance-roquette, nous répondions par des tirs de mitrailleuses.
En défense de poste j’étais tireur à la mitrailleuse une bonne vieille « hotchkiss » 6 . La SAS n’étant pas doté de moyens lourds. L’Unité de Secteur disposait elle, de mortiers, parfois d’un char et d’un vieux canon de 75.
L’unité de secteur nous prenait souvent avec eux en bouclage, et j’ai vu quelques camarades de combat sauter sur des mines antipersonnelle, jambes arrachées, certains ont été éventrés, déchiquetés lors des explosions. Quelques-uns sont morts d’une balle en pleine tête. Mon lieutenant chef de SAS a été tué en sautant sur une mine antichar avec sa jeep.
En tant qu’interprète il m’arrivait de crapahuter avec les Légionnaires du 1er REP qui balayait le terrain le long de la frontière. C’est là que j’ai vu l’efficacité d’une troupe aguerrie et nous sorte de vieux grognards mal payés, mal formés désordonnés au combat. Notre spécialité était le pistage sur le terrain. Les Moghazni avaient un don d’observation hors du commun. Ils étaient des cavaliers extraordinaires.
Nos patrouilles de police étaient efficaces, nous avions la responsabilité de la protection du camp de regroupement qui abritait un millier de personnes femmes et enfants que nous protégions des atrocités rebelles.
Notre présence, outre l’état-civil, l’assistance médicale gratuite, la scolarisation, nous assurons la sécurité qui leur permettait de cultiver et d’emblaver leurs champs. C‘est ainsi que durant près de quatre ans j’ai servi à la S.A.S. Au combat j’ai obtenu 2 citations : une à l’Ordre de la Brigade, l’autre à l’Ordre de la Division. On m’a décerné la Médaille Militaire, 40 ans après, j’ai été promu chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire (Légion d’Honneur décernée au Péril de sa vie).
Ces décorations sont pour moi la récompense suprême que souhaitent tous les militaires. Ne l’ayant pas été, je suis très fier d’avoir pu les obtenir par ma conduite devant l’ennemi et au péril de ma vie, civil habillé en militaire pour faire la guerre. J’ai payé ma nationalité française au service de notre drapeau national. Mon souhait le plus cher aurait été de mourir au combat, il n’en a rien été. C’est dommage, car après avoir servi fidèlement et courageusement le drapeau, avec mes frères de combat d’origine Nord-Africaine, l’Etat considère lui que cela ne compte pas puisqu’il nous écarte de l’Allocation de Reconnaissance attribué aux Harkis et autres membres des formations supplétives.
Depuis notre rapatriement en France notre sang n’a plus la même couleur que celui versé au combat au service de la France, ni la même valeur que celui de nos camarades d’origine Nord-Africaine, comme si les balles du FLN ne frappaient que les seuls supplétifs de souche Nord-Africaine. Malgré cette ségrégation et cette discrimination républicaine, je suis fier d’avoir payé ma nationalité française par le sang versé. Ma carte nationale d’identité ne devrait pas être bleue, mais rouge.
Pourquoi tant d’ostracisme à notre égard, ne sommes-nous donc plus français ?
Pourquoi cette ségrégation ? Pourquoi ce racisme envers ses plus fidèles serviteurs qu’ont été les supplétifs de souche européenne ?
Pourquoi en 2011 l’Etat s’évertue à maintenir les deux collèges électoraux : les droits locaux et les droits communs ?
Pourquoi l’Etat considère qu’il y a en France deux catégories de citoyens ?
Toutes ces interrogations resteront sans doute sans réponse, la moyenne d’âge des supplétifs dépasse allègrement les 70 ans, encore quelques années, et il n’en restera plus pour réclamer. Ce n’est pas tant l’argent que nous réclamons, mais notre dignité de combattant sans aucune exclusive et sans aucune différence entre les uns et les autres.
Certes, cela a été écrit et prononcé dans un discours du président de la République en décembre 2007, mais sans aucun effet concret. Il est à mettre aux dizaines de promesses non tenues.
Quoi d’étonnant un Président de la République lui-même sans doute le précepteur de l’actuel Président n’a-t-il pas dit que : « Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ! »
Notre génération, sans distinction d’origine est une génération où la parole était sacrée et les promesses tenues. Ce n’est plus le cas. La nouvelle génération est celle de la Rolex, de l’Argent Roi, des valeurs boursières.
Nous n’avons pas combattu pour cela.
Nous avons combattu pour la Paix, la démocratie, la justice pour tous.
Christian Migliaccio
1 - FLN Front de libération nationale
2 - S.A.S. Section Administrative Spécialisée dépendant des Affaires Algériennes. La Préfecture de chaque département la sous-préfecture à l’échelon liaison.
3 - Moghazni personnels des Maghzen - Maghzen unité statique composé de Moghazni
4 - La Maschinengewehr 42 allemande, plus connue sous son code de nomenclature. Les premières armes arrivèrent dans les unités au cours de l’année 1942. Elle fut largement utilisée par l’infanterie de la Wehrmacht pendant la deuxième moitié de la Seconde guerre mondiale et ses dérivés modernes, chambrés en 7,62 OTAN, sont encore en service dans de nombreux pays.
5 - Fellouzes, fellagha, fells rebelles armés.
6 - La mitrailleuse Hotchkiss Modèle 1914 en calibre 8mm Lebel était la principale arme automatique de l’armée française pendant les dernières années de la Grande Guerre. Elle fut également utilisée par le corps expéditionnaire américain (A.E.F) en 1917 et 1918. Fabriquée en France à Saint-Denis et à Lyon par les Établissements Hotchkiss et Cie, elle fut également exportée et fabriquée sous licence à l’étranger.
Quelques Photos

 A la S.A.S. tenue de travail Exercice de tir à la MG42
A la S.A.S. tenue de travail Exercice de tir à la MG42


Tenue de crapahut avec le 1er REP Tenue de défilé
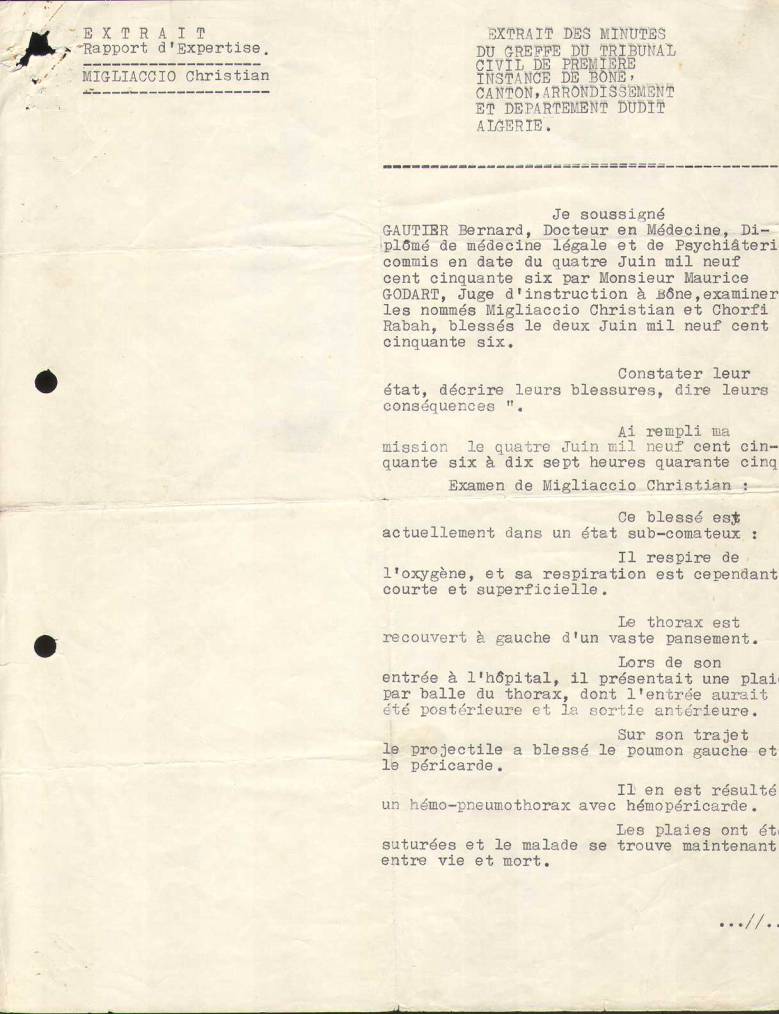
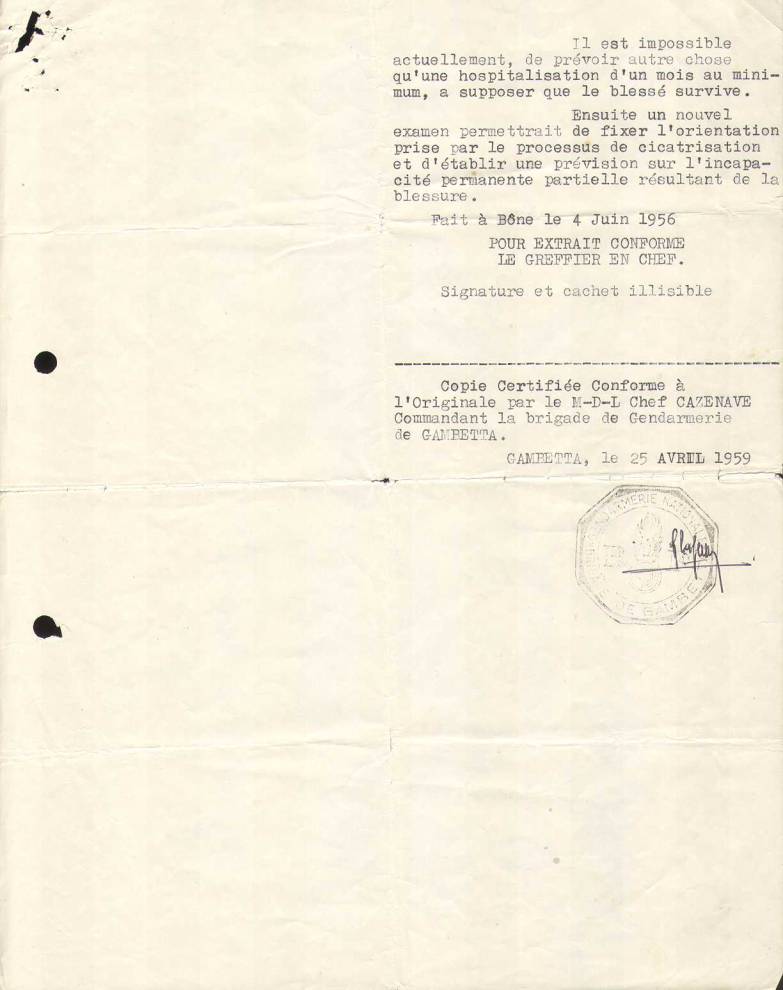
|
|
La Patrie
Envoyé par M. Jean-Claude Elbeze
|
Voici la copie d'un élève de classe de 3ème, classé en 1976 lauréat national dans un concours écrit sur le thème de "la Patrie"
Le sujet exact était : Que signifie pour vous le mot Patrie ?
Voici sa copie :
Etranger, mon ami, tu me demandes ce que signifie le mot " Patrie ". Si tu as une mère et si tu l'honores, c'est avec ton cœur de fils que tu comprendras mes propres sentiments. Ma patrie, c'est la terre de France où mes ancêtres ont vécu. Ma patrie, c'est cet héritage intellectuel qu'ils m'ont laissé pour le transmettre à mon tour.
Viens voir, étranger, la beauté des paysages de France, la splendeur des monuments édifiés par mes aïeux. Va te reposer dans le vert marais poitevin, admire les roches rouges d'Agay qui se baignent dans le bleu de la mer de Provence. Chemine simplement de Paris vers Lyon. Sur la route, près d'Avallon, l'élégance raffinée de la basilique de Vézelay fera surgir pour toi l'épopée de nos croisades. Tu arriveras plus loin au château de la Rochepot qui donne à la région un air médiéval. N'oublie pas de visiter en Bourgogne le ravissant hospice de Beaune. Ne néglige pas le barrage de Génissiat. Continue, regarde, réjouis-toi de tant de beauté.
Mais si la France, ma patrie, n'était que belle et aimable, mon amour pour elle ne serait pas si grand. Elle est mieux encore : intelligente et cultivée. La clarté de sa pensée, la finesse de son esprit, l'excellence de son goût te sont déjà connus. Des idées venues de France ont influencé l'humanité toute entière. Sais-tu par exemple, que la bibliothèque personnelle de Frédéric II de Prusse, conservée à Berlin, ne contient que des livres écrits en français ? Ainsi, bien au-delà de nos frontières, des hommes de France sont célèbres : philosophes, écrivains, poètes, artistes, savants. Pascal, Molière, Vigny, Delacroix, Berlioz, Pasteur : tous ont contribué à la gloire de la France.
Et vous, héros humbles et méritants, qui avez fait la France brave et fidèle, vous guerriers morts pour la patrie, comme je vous suis reconnaissant de m'avoir conservé ce précieux bien de mes ancêtres ! De Bayard à Guynemer, des premiers chevaliers aux soldats des dernières guerres, que de dévouements, que de sacrifices !
Et toi mon ami, qui es aussi comme moi une créature de Dieu, ne vois-tu pas qu'ici en France, tu es en terre chrétienne ? Les oratoires pittoresques, les calvaires aux croisées des chemins, les flèches de nos cathédrales sont les témoins de pierre d'une foi vivante. Ma patrie, bonne et pieuse, a vu naître de grands saints. Le sens missionnaire de Saint Bernard, la vertu de Saint-Louis, la charité de Saint Vincent de Paul, le zèle du Curé d'Ars sont le vrai trésor laissé par nos ancêtres. De la grande Sainte Jeanne d'Arc à la petite Thérèse, de l'épopée de l'une à la vie si simple de l'autre, je retrouve le courage et la bonté des femmes de France. Aux plus humbles d'entre elles, s'est montrée la Vierge Marie. A travers Catherine Labouré, Bernadette de Lourdes, quel honneur pour la France !
Tu comprends maintenant pourquoi, ami étranger, j'aime et je vénère ma patrie comme ma mère ; pourquoi, si riche de tout ce qu'elle me donne, je désire transmettre cet héritage. Ne crois pas que cet amour que j'ai au cœur soit aveugle. Mais devant toi, je ne dirai pas les défauts de ma mère Patrie. Car tu sais bien qu'un fils ne gagne rien à critiquer sa mère. C'est en grandissant lui-même qu'il la fait grandir. Si je veux ma patrie meilleure et plus saine, que je devienne moi-même meilleur et plus sain.
La France, ma patrie a tant de qualités que je ne saurais, ami étranger, te priver de sa douceur ; si tu sais découvrir ses charmes et ses vertus, tu l'aimeras, toi aussi. Je partagerai avec toi ses bontés et, loin de m'appauvrir de ce don, je m'enrichirai de cette tendresse nouvelle que tu lui porteras. Mais ne l'abîme pas, ami étranger, la France, ma douce patrie, ma chère mère ; ne la blâme pas, ne la pervertis pas, ne la démolis pas car je suis là, moi son fils, prêt à la défendre.
Si tous les bacheliers de notre temps étaient capables de rédiger un tel texte, je pense que nous n'aurions pas de soucis à nous faire sur le devenir de la France !!!
|
|
LA REPENTANCE
« En un siècle, à force de bras, les colons ont, d’un marécage infernal, mitonné un paradis lumineux. Seul, l’amour pouvait oser pareil défi… Quarante ans est un temps honnête, ce nous semble, pour reconnaître que ces foutus colons ont plus chéri cette terre que nous, qui sommes ses enfants »(Boualem Sansal – 2002)
Au fil des générations, nos hommes politiques et les médias qui les soutiennent, n’ont eu de cesse de cultiver le mythe de la culpabilité nationale : Colonisation… Repentance… Soumission… ignorant, comme le disait Charles Péguy, « qu’il y a des contritions plus sales que les péchés ». C’est pourquoi, le « remords » aidant, ils s’interdisent (et nos magistrats avec eux) toute action systématique de reconduite à la frontière qui pourrait être interprétée par le lobby pro-immigrationniste comme un acte raciste… Et de cette façon, la misère s’ajoute à la misère… et déjà dans ce pays, la démocratie ipso facto repose sur la cosmopolite reconnaissance du peuple français à disparaître inéluctablement. Ainsi, inexorablement, toutes les traditions historiques qui ont fait la grandeur de la France sont en train de se dissoudre dans un pluralisme qui admet tout et comprend tout et qui n’est que trop voisin de la lâcheté pure et simple. Elle agit, cette France-là, comme si elle n’était plus intéressée à maintenir sa position dans le monde. Elle s’accuse elle-même et se déclare honteuse de son passé guerrier, impérialiste et colonialiste, oubliant toutefois que le passé des autres nations n’est ni plus paisible, ni plus vertueux…
Dénigrer l’histoire de son pays, de son passé, sa grandeur et le sacrifice de ses aînés est un acte criminel. Nous n’avons pas à tronquer notre histoire pour faire plaisir à telle minorité, telle association au « cœur sur la main » ou tel parti politique. « Dans cette rumination morose, les nations européennes oublient qu’elles, et elles seules, ont fait l’effort de surmonter leur barbarie pour la penser et s’en affranchir » écrivait Pascal Bruckner. Que ceux qui s’adonnent à ce type d’autoflagellation jouissive n’oublient pas cette mise en garde de Henri de Montherlant : « Qui a ouvert l’égout périra par l’égout.»
Ce dénigrement perpétuel de la France et de son passé colonial par nos « bien pensants », martyrocrates de profession, faussaires de l’antiracisme, est le pire danger auquel elle est confrontée. L’historien Max Gallo, dans son essai « Fier d’être Français», déclare : « Il faut bien que quelqu’un monte sur le ring et dise : “Je suis fier d’être français”. Qu’il réponde à ceux qui condamnent la France pour ce qu’elle fut, ce qu’elle est, ce qu’elle sera : une criminelle devenue vieillerie décadente. […] Ils exigent que la France reconnaisse qu'elle les opprime, qu'elle les torture, qu'elle les massacre. Seule coupable ! Pas de héros dans ce pays ! Renversons les statues, déchirons les légendes. Célébrons Trafalgar et Waterloo et renions Austerlitz ! Ils veulent que la France s’agenouille, baisse la tête, avoue, fasse repentance, reconnaisse ses crimes et, tondue, en robe de bure, se laisse couvrir d’insultes, de crachats, heureuse qu’on ne la “nique” qu’en chanson et qu’on ne la brûle que symboliquement chaque nuit ! Il est temps de redresser la tête, de hausser la voix, de monter sur le ring… et de boxer à la française ! »
Et Malika Sorel, française d’origine algérienne, de renchérir : «Au Maghreb, les gens sont consternés par ce qui se passe en France. Pour eux, la situation est liée à cette « repentance » et la responsabilité en incombe aux adultes français qui passent leur temps à se prosterner et être à genoux…»
- Repentance !C’est un mot que les Français commencent à connaître tant ils l’entendent ! Celui-ci désigne la manifestation publique du sentiment personnel qu’est le repentir pour une faute que l’on affirme avoir commise et dont on demande le pardon.
- Pardon ! Mais quelle faute a bien pu commettre la France pour demander pardon? Et à qui ? Pardon d’avoir un passé colonial ? Mais, Messieurs les détracteurs, le colonialisme que vous décriez, la main sur le cœur aujourd’hui, n’est rien d’autre que ce phénomène qui a poussé l’Occident à partager l’essentiel de son avance technique avec le reste du monde qui ne l’avait même pas entrevue. L’entreprise s’est accompagnée de souffrances, certes, mais il n’est pas d’aventure humaine qui ne s’accompagne de ce douloureux cortège… Il est le prix de sueur et de sang qu’il faut payer, mais le bilan est positif. J’en appelle à tous ceux qui ont atterri dans une colonie soumise à la loi et aux méthodes de l’Occident. Le changement de tableau est subit. Des récifs, elle a fait des ports ; de la poussière et des marais, elle a édifié des villes ; dans cet air embrasé, elle a fait pousser des feuillages et des jardins. Quand un contraste crie, il faut l’entendre, et ce serait être apocryphe en nature humaine, en morale pure, que de ne pas comprendre la puissance occidentale.
Voyez donc, en exemple, ce qu’est devenue l’Algérie en un siècle seulement de colonisation... Au départ des Européens en 1962, les terres arables et fertiles ont été gagnées sur le désert et sur les marais au prix de tant de tombes qui jalonnent l’Afrique du Nord que le terme même de « colonisation» est aujourd’hui dépassé. Comment oublier que ce sont les premiers Européens (les pères de ces enfants qui ont été chassés) qui ont asséché les marais, ensemencé les maquis, transformé les douars, les casbahs, les repaires de pirates en paisibles villages, en cités prospères, en ports dignes de ce nom, bâti les écoles, les universités et les hôpitaux, tracé les routes et édifié les ponts, chassé la maladie, la famine, fait jaillir des pierres la vigne généreuse et les orangers ? Comment oublier que c’est la France, et elle seule, qui a fait gicler du sable du désert le pétrole et le gaz ? Et c’est pour toutes ces réalisations qu’il faudrait demander pardon ? A cela, qu’ont opposé les révolutionnaires ?... La révolte, le terrorisme, l’abomination et pour finir, la dilapidation de l’héritage « colonial ».
Avant que la France ne vienne dans ce pays, les autochtones jouissaient-ils de toutes ces réalisations ? Les avaient-ils réalisées ? La France les en avait-t-elle privées ? La réponse est NON! Et ce qu’ils n’ont pas su faire eux-mêmes en tant de siècles, voici qu’ils se l’approprient aujourd’hui et qu’ils accusent la France de n’avoir rien fait pour eux en 132 ans… Dès lors, les voix des apparatchiks du FLN, au pouvoir depuis 1962, conscients de leur responsabilité dans la misère qui frappe le peuple, n’ont de cesse de façonner les esprits en utilisant invariablement ce même refrain, vieux d’un demi siècle, qui répète sans cesse que les Français sont des ravisseurs et des bourreaux, qu’ils ont dévasté par le fer et par le feu la patrie algérienne en pillant ses richesses et exigent aujourd’hui réparation et repentance.
Pour preuve : En novembre 2009, à l’occasion du 55ème anniversaire du début des attentats terroristes du FLN (novembre 1954), le secrétaire général du FLN, Abdelaziz Belkhadem qui est également ministre d'Etat et représentant personnel du président Bouteflika, n’a pas manqué d'exiger de la France « des excuses et des réparations pour les crimes barbares et génocidaires commis durant 132 ans par le colonialisme en Algérie...[...] la période de destruction coloniale fut la plus difficile et la plus horrible jamais vécue par notre peuple. L'Algérie ne cessera pas d'exiger la reconnaissance par la France de ses crimes coloniaux à l'endroit du peuple algérien »… déclaration en parfaite contradiction avec celle d’Aït Ahmed, leader historique du FLN, actuellement réfugié en Suisse : « Du temps de la France, l’Algérie c’était le paradis ! » Un paradis dilapidé… En effet, un quart des recettes en hydrocarbures de l’Algérie, découverts et abandonnés par la France dans un Sahara qui n’était même pas algérien, permet aujourd’hui à ce pays d’importer ses produits alimentaires issus notamment de l’agriculture… alors qu’elle les exportait du temps de la « colonisation ».
Dans les livres d’histoire, écoliers et étudiants retiennent de l’armée française, qu’elle ne s’est strictement et uniquement livrée qu’à des exactions envers la population civile algérienne. C’est proprement odieux ! A l’inverse, rien n’apparaît sur les bienfaits de la Pacification et sur le bien-être que cette armée-là a apporté à l’homme du Bled. Sur les réalisations précitées, rien n’est mentionné. L’Histoire de l’Algérie rapportée par les livres est une Histoire tronquée, falsifiée, vide de toute vérité vraie et injurieuse vis-à-vis de ces milliers d’hommes et de femmes, Européens et Musulmans, qui ont œuvré de concert pour sortir ce pays du cadre moyenâgeux qui était le sien en 1830. Et il se trouve des Français pour soutenir les thèses diffamatoires du FLN !... des nigauds de naissance, champions des « droits de l’homme », de «l’antiracisme » et de « l’antifrance qui demandent à grands cris la « révision des livres d’histoire ».
« Rien n’est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse » a écrit Martin Luther King…
Dès lors, que peuvent bien retenir les jeunes enfants dès leur scolarité ? Une histoire de France faite d’intolérance, d’inégalités, de compassion excessive, de récriminations et d’accusations qui ne manqueront pas de marquer à jamais leur esprit et d’entacher durablement l’image qu’ils se feront désormais de leur pays. « Vous tenez en vos mains, l’intelligence et l’âme des enfants. Vous êtes responsables de la Patrie. Les enfants qui vous sont confiés… ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie, son histoire : son corps et son âme », déclarait Jean Jaurès… ce que dénia Jacques Chirac en interdisant les cérémonies en mémoire de l’Empereur Napoléon Bonaparte au nom du complexe des conquêtes des siècles passés… Quant aux immigrés, comment les encourager à s’intégrer à une nation qui n’a de cesse de culpabiliser et de se mépriser elle-même ? Dans le journal « Le Monde » du 21 janvier 1992, Michel Serres suppliait les journalistes : « Si vous pouviez… de temps en temps dire un peu de bien de la France ! » Et en 1947, déjà, Raymond Aron déclarait : « La vanité française consiste à se reprocher toutes les fautes sauf la faute décisive : La paresse de la pensée ». Alors, afin d’éviter toutes critiques par trop virulentes et se prémunir de tout procès d’intention de la part des pseudos associations antiracistes qui n’ont de cesse d’en appeler, d’une part, aux grandes traditions de générosité et d’ouverture du peuple français et, d’autre part, de prêcher pour une société pluriculturelle, nos gouvernants, depuis un demi-siècle, engoncés dans leurs scrupules congénitaux, sont demeurés amorphes et frileux face aux décisions qui devaient être prises et à la fermeté qui s’imposait…
« Je vous laisse deviner ce qui se passe lorsqu’un peuple estime que ses élites ne le représentent plus, ne défendent plus son identité, ne défendent plus ce qu’il est, eh bien l’étape suivante, c’est que le peuple reprend son destin en main » a lancé, en guise d’avertissement, Malika Sorel.
Quant aux adeptes de la «repentance » et de l’anticolonialisme, ils devraient s’inspirer de cette cinglante leçon d’histoire que nous donne Walter Williams, Africain-Américain et professeur d’économie à l’université George Mason de Virginie (Etats-Unis) :« Peut-être que votre professeur d’économie vous a enseigné que la pauvreté du Tiers-Monde est l’héritage de la colonisation. Quel non-sens ! Le Canada a été une colonie, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou Hong-Kong. En fait le pays le plus riche du monde, les Etats-Unis, fut jadis une colonie. Par contraste, l’Ethiopie, le Liberia, le Tibet, le Sikkim, le Népal et le Bhoutan ne furent jamais colonisés et pourtant ils abritent les populations les plus pauvres du monde… » Mortifiant sujet de réflexion…
José CASTANO
- « Je n'ai jamais entendu un musulman présenter ses excuses pour avoir occupé l'Espagne pendant huit siècles » (José-Maria Aznar, ancien chef du gouvernement espagnol – Journal « Jeune Afrique » du 1er octobre 2006)
|
| Lettre ouverte
à tous les parents méchants !!!
Par un Neuropsychologue
Envoyé Par Jacqueline
| |
Un jour, quand mes enfants seront assez vieux, pour comprendre la logique qui motive un parent, je vais leur dire, comme mes parents méchants m'ont dit:
Je t'ai aimé assez pour te demander où tu allais, avec qui, et quand tu serais de retour à la maison...
Je t'ai aimé assez pour être patiente jusqu'à ce que tu découvres que ta nouvelle meilleure amie ou ton grand copain, n'était pas fréquentable....
Je t'ai aimé assez pour me tenir plantée là dans le cadre de porte pendant deux heures tandis que tu nettoyais ta chambre, une affaire de 15 minutes en principe !
Je t'ai aimé assez pour te laisser voir la colère, la déception et les larmes dans mes yeux. Les enfants doivent apprendre que leurs parents ne sont pas parfaits.
Je t'ai aimé assez pour te laisser assumer la responsabilité de tes actions même lorsque les pénalités étaient si dures qu'elles ont presque brisé mon coeur.
Mais surtout, Je t'ai aimé assez pour dire NON même quand je savais que tu me détesterais pour ça. Telles étaient les batailles les plus difficiles de toutes. Je suis heureuse de les avoir gagnées, parce qu'à la fin, tu y as gagné aussi. Et un jour, quand tes enfants seront assez vieux pour comprendre la logique qui motive des parents «méchants», tu leur diras :
Vos parents étaient ils méchants?
Les miens l'étaient
J'ai eu les parents les plus méchants du monde entier ! Pendant que d'autres enfants mangeaient des sucreries pour les repas, j'ai dû manger des céréales, des oeufs, et des légumes. Quand d'autres ont eu du Coca et des hamburgers pour le dîner, j'ai dû manger de la viande, du fromage,des crudités et des fruits... Sans oublier toutes ces crêpes et gâteaux que ma maman nous a faits... Et vous pouvez deviner que ma mère m'a fait des dîners qui étaient différents de celui des autres enfants.
Mes parents ont insisté pour savoir où j'étais en tout temps. On aurait pu croire que j'étais enfermée dans une prison. Ils devaient savoir qui mes amis étaient et ce que je faisais avec eux.. Ils insistaient si je disais que je serais partie pour une heure, pour que ce soit seulement une heure ou moins..
J'avais honte de l'admettre, mais mes parents ont enfreint la loi sur la protection des enfants concernant le travail en me faisant travailler. J'ai dû faire la vaisselle, mon lit (quelle horreur!), apprendre à faire la cuisine, passer l'aspirateur, faire mon lavage, vider les poubelles et toutes sortes d'autres travaux cruels.... Je pense qu'ils se réveillaient la nuit pour imaginer de nouvelles tâches à me faire faire...
Ils ont toujours insisté pour que je dise la vérité, juste la vérité et rien que la vérité. Au moment où je suis devenue adolescente, ils pouvaient lire dans mon esprit et avaient des yeux tout autour de la tête. Puis, la vie est devenue vraiment dure !
Mes parents ne laissaient pas mes amis juste klaxonner quand ils venaient me chercher. Ils devaient venir à la porte pour qu'ils puissent les rencontrer. Pendant que chacun pouvait fréquenter un ou une petit(e) ami(e) quand ils avaient 12 ou 13 ans, j'ai dû attendre d'en avoir 16
À cause de mes parents, j'ai manqué beaucoup de choses que d'autres enfants ont expérimentées. Je n'ai jamais été prise pour vol à l'étalage, vandalisme, alcoolisme, ni même arrêtée pour tout autre crime. C'était «tout de leur faute».
Maintenant que j'ai quitté la maison, je suis instruite et une adulte honnête. Je fais de mon mieux pour être un parent méchant comme mes parents l'étaient.
Je pense que c'est ce qui ne va pas avec le monde aujourd'hui. Il n'y a pas assez de parents méchants!
Merci donc à toutes les parents qui ont été assez méchants dans notre jeunesse pour nous apprendre à être de méchantes bonnes personnes.
Stéphanie CHARIOT-AUCHERE
|
|
|
LES ANNALES ALGERIENNES
De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)
Envoyé par Robert
|
|
LIVRE VIII
Relations avec les Arabes. - Assassinat du caïd de Sbachna. - Excursion dans la plaine. - Reconnaissance de Coléa. - Travaux topographiques. - Expédition de Beni-Salah. - Expédition de Médéa. - Désordres de la retraite. - Combats auprès de la Ferme-Modèle. - El-Hadj-Mahiddin est nommé agha des Arabes. - Expédition malheureuse de Bône. - Mort du commandant Rader. - Le général Boyer à Oran. - Organisation des services publics à Oran. - Description de la province. - Rappel du général Berthezène.
Relations avec les Arabes. - Assassinat du caïd de Sbachna. - Excursion dans la plaine. - Reconnaissance de Coléa. - Travaux topographiques.
Peu de jours après son arrivée à Alger, c'est-à-dire dans le commencement de mars, le général Berthezène fit, avec quelques troupes, une tournée dans la Métidja. Le pays lui parut être tranquille; mais, dans le courant d'avril, quelques assassinats furent commis dans l'intérieur de nos lignes ; des cavaliers de l'agha furent attaqués par les Beni-Salah et les Beni-Misra, qui en tuèrent un ; enfin le raid de Khachna, Ben-el-Amri, fut assassiné dans sa tribu. Le général résolut d'aller châtier les tribus coupables. A cet effet, il partit d'Alger, le 7 mai, avec une colonne de 4000 hommes, et se dirigea d'abord sur Khachna, où il fit arrêter quelques individus que l'on crut être les auteurs du meurtre de Ben-el-Amri; mais leur culpabilité n'ayant pas été établie, ils furent bientôt relâchés et il ne fut plus question de cette affaire. De Kbachna, le général Berthezène se porta vers les Beni-Affra qu'il frappa d'une contribution de quelques bœufs.
Expédition de Beni-Salah.
De là, il alla chez les Beni-Salah, en passant entre la montagne et Blida, qu'il laissa à sa droite; ils les somma de livrer les hommes qui avaient tué le cavalier de l'agha, et qu'on disait appartenir à cette tribu. Ceux-ci demandèrent du temps pour les trouver, mais ils profitèrent du répit qu'on leur accorda pour se retirer de l'autre côté de la montagne, avec tout ce qu'ils purent emporter. Après une nuit d'attente, le général, voyant qu'on se jouait de lui, fit tout saccager dans la tribu. Il pénétra jusqu'à Thiza, un des sommets de l'Atlas, sans rencontrer de résistance; seulement, parvenu sur ce point, il reçut quelques coups de fusil d'un groupe de Kbaïles qui fuyait, et eut un homme tué. Il redescendit ensuite la montagne, sans être poursuivi, et vint camper autour de Blida Les habitants de cette ville, où nous n'entrâmes pas; envoyèrent des vivres à l'armée. Les troupes rentrèrent à Alger le 15.
Cette courte expédition, qui fut absolument sans résultat, puisqu'on ne put saisir les auteurs des divers crimes qu'on voulait punir, rendit cependant. le général Berthezène très satisfait de lui-même. Il fit un ordre du jour pompeux, quoiqu'il eût dit étant à Thiza : " Nous y voilà arrivés sur l'Atlas par un chemin bien plus difficile que celui de Téniah, et cependant nous ne ferons point de bulletins comme le général Clauzel. "
Dans toute cette course, le général en chef ne songea nullement à établir dans les tribus des autorités qui dépendissent de lui, et avec lesquelles il pût s'entendre. Il ne remplaça pas même le malheureux Ben-el-Amri, dont la mort ne fut pas vengée; du reste, il montra de l'humanité, et ce ne fut que malgré lui, et pour prévenir le reproche de faiblesse, qu'il se mit à faire la guerre aux arbres et aux cabanes des Beni-Salah, ne pouvant trouver d'autres ennemis.
Cependant la position de Ben-Omar, notre bey de Titteri, qui était resté à Médéa, après que les troupes françaises eurent évacué cette ville, devenait chaque jour plus critique. La majorité des habitants s'était bien ralliée à lui; mais la famille de l'ancien bey comptait encore de nombreux partisans. Le général Clauzel, par une générosité mal entendue, n'avait pas déporté Oulidhou-Mezrag, fils du bey Mustapha. Ce jeune homme s'était d'abord établi à Blida, où il chercha à détourner l'attention, en affectant des habitudes paisibles et casanières. Il y réussit si bien qu'on finit par le regarder comme un personnage sans importance et nullement dangereux, de sorte qu'on le laissa retourner à Médéa. Il profita de cette condescendance pour travailler les esprits; lorsque le bey s'aperçut de ces menées, il était déjà assez fort pour braver son autorité. Il sortit de la ville sans que Ben-Omar pût ou osât l'arrêter, alla se mettre à la tête des tribus mécontentes, et vint bientôt s'établir avec quelques troupes à la maison de campagne du bey, d'où il bloquait Médéa ; ses partisans s'agitèrent à l'intérieur. Le bey effrayé, écrivit au général Berthezène, pour demander de prompts secours.
Expédition de Médéa.
Le général Berthezène, décidé à ne pas l'abandonner, partit d'Alger, le 25 juin, avec deux brigades commandées par les généraux Buchet et Feuchères; le corps d'armée coucha, ce jour-là, en avant d'Oued-el-Kerma, le 26, en avant de Boufarik, et le 27, à la ferme de Mouzaia; on y laissa un bataillon du 50° de ligne. Le 28, on franchit le Téniah, où l'on établit un bataillon du 20°, et l'on vint coucher à Zéboudj-Azarha, bois d'oliviers dont nous avons déjà parlé. Jusque-là on n'avait point rencontré d'ennemis ; mais, en cet endroit, quelques coups de fusil furent tirés sur nos troupes.
Le 29, le général Berthezène arriva à Médéa. Quelques Arabes, qui faisaient mine de vouloir attaquer nos colonnes au moment où elles se présentaient devant cette ville, furent chargés par les escadrons du 12e de chasseurs. Ces escadrons éloignèrent l'ennemi; mais dans le mouvement qu'ils firent pour rejoindre l'armée, ils furent attaqués à leur tour, et éprouvèrent quelques pertes.
A l'approche des troupes françaises, Oulid-bou-Mezrag avait abandonné la maison de campagne du bey, qui fut occupée par un bataillon du 30e de ligne et par notre cavalerie; le reste du corps d'armée s'établit au nord de la ville, où un seul bataillon pénétra.
Aucun mouvement n'eut lieu dans la journée du 30 juin. Il parait que le général ne savait pas exactement ce qu'il voulait faire; le but de son voyage avait été de secourir le bey de Titteri; mais, quoique sa présence eût éloigné un instant le danger, il était évident que son départ devait le ramener plus imminent et plus terrible. Dans cette conjoncture, le général en chef n'avait que trois partis à prendre : ou laisser une garnison française à Médéa pour soutenir Ben-Omar; ou rester lui-même dans la province pendant quinze jours ou trois semaines, soumettre durant ce temps Ies outhans qui touchent à Médéa, et créer des troupes indigènes à Ben-Omar; ou enfin, tâcher d'être assez heureux pour atteindre Oulidbou-Mezrag, et lui faire éprouver assez de pertes pour lui ôter la possibilité de reprendre les armes.
Le premier parti était contraire aux instructions du général Berthezène, qui avait plutôt mission de se resserrer que de s'étendre dans ce pays; le second, qui était le plus sage, offrait de grandes difficultés à un homme qui ne savait en surmonter aucune; le troisième présentait peu de chances de réussite, mais il n'exigeait pas de grandes combinaisons : ce fut celui auquel s'arrêta le général Berthezène. En conséquence, il partit de Médéa le 1° juillet, au point du jour, et se dirigea sur la montagne d'Aouarah, dans l'outhan de ce nom. Comme on aurait dû le prévoir, les partis ennemies ne nous attendirent pas et s'éloignèrent à notre approche. On se mit alors à brûler les blés et à couper les arbres.
Cependant les tribus qui fuyaient devant nous avaient bien évidemment le dessein de prendre leur revanche, lorsqu'après avoir marché assez longtemps, nous serions obligés de revenir sur nos pas. Elles restaient unies, et aussitôt que nos colonnes s'arrêtaient, elles commençaient la fusillade avec l'avant-garde. Nous allâmes ainsi jusqu'au plateau d'Aouarah, d'où le général Berthezène ordonna la retraite sur Médéa ; l'ennemi reprit alors ses avantages, et poursuivit nos colonnes jusqu'à Médéa, où elles arrivèrent dans la soirée.
Cette journée, dans laquelle la colère impuissante du général en chef avait été réduite à s'exercer sur des arbres et des champs de blé, fut toute à l'avantage des Arabes, qui eurent la satisfaction de voir les Français battre en retraite devant eux. Ils vinrent se poster auprès de Médéa et attendirent ce qu'allait faire le général Berthezène. Celui-ci était très embarrassé de sa position : la consternation régnait dans la ville parmi les partisans de Ben-Omar; tout annonçait à l'extérieur une insurrection générale. La ville était mal approvisionnée en vivres, et ceux que l'armée avait apportés avec elle allaient bientôt être épuisés. Cette circonstance persuada au général français qu'il lui était impossible de rester plus longtemps dans le pays. Il paraît qu'il ne lui vint pas à l'esprit que, puisqu'il avait trouvé des blés à briller, il en aurait trouvé à moissonner, et qu'il y avait des moulins à Médéa. Il n'était qu'à quelques lieues de Blida, qui lui aurait envoyé de la viande, car on obtient tout ce que l'ou veut d'un peuple conquis, tant qu'on prend l'offensive, tandis qu'au moindre mouvement rétrograde, on a toutes les populations sur les bras.
Si M. Berthezène eût fait toutes ces réflexions, il n'aurait pas été réduit à abandonner la province de Titteri, sans avoir rien exécuté de ce qu'il paraissait avoir voulu y faire : car je ne pense pas qu'il n'eût d'autre dessein, en partant d'Alger, que de tirer Ben-Omar de Médéa. Quoi qu'il en soit, il annonça, le 2 juillet. aux habitants de cette ville, que les Français étaient dans la dure nécessité de les abandonner une seconde fois à eux-mêmes ; ils les engagea à se défendre comme ils le pourraient, et leur dit que, à cet effet, il leur laissait les canons et les munitions qu'ils avaient reçus du général Clauzel. A ce discours, le bey de Titteri et quelques personnes qui lui étaient plus particulièrement attachées déclarèrent qu'ils ne pouvaient rester à Médéa dans les circonstances présentes ; le général en chef se décida à les emmener à Alger.
Désordres de la retraite.
Le même jour, à quatre heures du soir, l'armée commença son mouvement de retraite sur Alger; tout aussitôt l'ennemi, qui était toujours en position en vue de Médéa, s'ébranla pour la suivre en tiraillant, suivant son habitude. On arriva ainsi jusqu'à Zeboudj-Azarah, où l'on s'établit comme pour passer la nuit ; mais, peu d'heures après, le général Berthezène, désirant profiter de l'obscurité pour gagner le col, fit remettre la colonne en marche ; elle arriva à Thénia à la pointe du jour, accompagnée de l'ennemi, qui, s'étant aperçu de son départ, s'était mis à sa poursuite. Après une halte de quelques instants, l'armée commença à descendre le versant septentrional de l'Atlas. Le bataillon du 20°, qui était resté au col, s'ébranla le dernier et forma l'arrière-garde.
Le nombre des ennemis avait un peu augmenté ; cependant il ne s'élevait pas à plus de douze à quinze cents hommes au moment où les Français quittèrent le col. Quelque faible qu'il fût, comme on était obligé de se retirer par un chemin difficile, on aurait dû, pour prévenir le désordre, ne négliger aucune de ces vulgaires précautions que l'étude seule des règlements militaires suffit pour enseigner, mène à ceux qui n'ont pu y joindre encore les leçons de l'expérience ; C'est cependant à quoi on ne songea pas : aucune troupe ne fut envoyée sur les crêtes des hauteurs qui dominent la route, de sorte que l'ennemi s'en empara, et se mit à longer dans cette direction le flanc droit de la colonne, en l'incommodant par un feu vertical et meurtrier.
Bientôt le bataillon du 11e de ligne, qui était à l'arrière-garde, assailli par les Kbaïles, commença à mollir. Dans ce moment, un malheureux hasard voulut que son chef fût blessé. Cet officier se retira du champ de bataille, sans avoir remis le commandement à celui qui devait le prendre après lui. Comme la plus grande partie de cette troupe était dispersée en tirailleurs, personne ne s'aperçut à temps de l'absence du commandant, qui, par conséquent, ne fut pas remplacé ; il en résulta que toute direction manquant à ce bataillon, le désordre se mit dans ses rangs, et qu'il se replia avec précipitation sur le gros de la colonne, déjà ébranlée par l'attaque de flanc des Kbaïles.
Alors une terreur panique s'empara de toute l'armée : les rangs se rompirent ; les régiments, les bataillons, les compagnies se confondirent, et chacun, ne songeant qu'à son propre salut, se mit à fuir vers la ferme de Mouzaia. Des blessés furent abandonnés à la fureur des ennemis. Des Kbaïles attaquèrent nos soldats corps à corps, et en précipitèrent plusieurs dans les ravins qui bordaient la route.
Dans ce moment critique, où quatre mille Français allaient peut-être être anéantis par une poignée d'Africains, le chef de bataillon Duvivier, commandant le bataillon de zouaves et quelques Parisiens, se jeta en dehors du flanc droit de la colonne, et, faisant face à l'ennemi, il s'établit perpendiculairement à la route, sa gauche appuyée à la crête des hauteurs, et sa droite à la route même. Ce mouvement habile et hardi, qui réparait en partie la faute commise dès le principe, sauva l'armée. Les Parisiens et les zouaves, combattant à l'envi les uns des autres, arrêtèrent l'ennemi, pendant que le reste de nos troupes continuait à fuir. Mais, lorsqu'ils durent songer à leur propre retraite, la colonne était déjà loin, et ils ne trouvèrent personne pour les soutenir. Le commandant Duvivier était persuadé qu'on aurait disposé un bataillon de manière à ce que le sien pût venir se rallier derrière ; mais il n'en fut pas ainsi. Ce brave commandant fut abandonné. Son bataillon ayant été dispersé sur un grand espace tri-accidenté, il ne put reformer les compagnies ; mais il se retira par groupes, toujours combattant, toujours faisant face à l'ennemi lorsqu'il était poussé de trop près. II trouva sur le chemin une pièce de montagne renversée, et auprès le commandant d'artillerie Camin, qui n'avait pas voulu l'abandonner; il la releva, continua sa retraite et parvint à la ferme de Mouzaïa, où l'armée se ralliait.
Les Kbaïles et les Arabes s'arrêtèrent au pied de la montagne, en face des troupes françaises, qui se reformaient silencieusement, honteuses du moment de faiblesse qu'elles avaient eu. Le général Berthezène paraissait indécis sur le parti qu'il devait prendre. Après quelques heures de repos et d'hésitation de part et d'autre, l'ennemi, auquel étaient venus se joindre les Hadjoutes et les cavaliers du Merdjia, s'ébranla par sa droite pour aller s'emparer du gué de la Chiffa, par lequel l'armée avait passé en venant. Le général, ayant deviné son intention, lui laissa le temps d'effectuer son mouvement, et se mit en marche vers le soir pour aller passer la rivière à deux lieues au-dessous dans la direction de Haouch-Hadj. L'ennemi ne s'aperçut que fort tard de cette contre-marche; il revint néanmoins sur ses pas, et ses cavaliers les mieux mon-tés purent tirailler avec notre arrière-garde. Ce ne fut qu'à dix heures du soir que les Français arrivèrent à la Chiffa; comme depuis le matin ils souffraient de la soif, ils se précipitèrent pèle-mêle dans l'eau; il y eut une confusion telle que, si les Arabes avaient vigoureusement attaqué dans le moment, les événements de la matinée auraient pu se renouveler. Enfin l'ordre se rétablit, et le 4 juillet, à quatre heures du matin, le corps d'armée atteignit Boufarik. La route en cet endroit était bordée à droite et à gauche par des taillis épais, et franchissait plusieurs ruisseaux sur dix ponts étroits situés à peu de distance les uns des autres. Les Arabes de Beni-Khelil et de Beni-Mouça s'étaient emparés de ce passage qu'il cherchèrent à défendre ; mais ils en furent facilement débusqués. L'armée, après avoir traversé le défilé, prit quelques instants de repos, et se dirigea ensuite sur Oued-el-Kerma, où elle bivouaqua. Le lendemain 5 juillet, anniversaire de la prise d'Alger, les troupes rentrèrent dans leurs cantonnements.
Telle fut cette malheureuse expédition de Médéa, plus funeste par l'effet moral qu'elle produisit sur l'esprit des indigènes que par les pertes réelles que nous y éprouvâmes, car nous n'eûmes que 254 hommes mis hors de combat, savoir : 63 morts et 193 blessés. L'armée et son général eurent réciproquement de graves reproches à se faire; mais ce fut principalement sur ce dernier que porta le blâme public. On accusait ouvertement son incapacité et son incurie, et mème on exagérait le mal pour donner libre carrière à la médisance. Les militaires français sont en général trop disposés à accabler un chef malheureux; et cependant ce n'est pas par des récriminations passionnées que l'on doit espérer de réparer un échec. Les fautes d'un général sont du domaine de I'histoire; mais, dans son armée moine. les hommes qui sont en état de le juger devraient plutôt les dissimuler et les taire qu'affaiblir la confiance des troupes en les publiant. Pour nous, placé loin des événements, nous avons pu sans inconvénient user des droits de la critique, et laisser voir le général Berthezène tel que nous le présentent ses actes.
Cependant les Arabes, fiers des avantages incontestables qu'un malheureux concours de circonstances leur avait fait obtenir sur nous, se berçaient de la flatteuse espérance de nous chasser d'Alger. Oulid-Bou-Mezrag d'un côté, Ben-Zamoun de l'autre, excitaient les indigènes à prendre les armes. Sidi-Saadi, d'une famille de marabouts d'Alger, qu'un voyage récent à La Mecque recommandait à l'estime de ses coreligionnaires, et qui ne visait à rien moins qu'à succéder à Hussein-Pacha, contribuait puissamment par ses prédications à ameuter les tribus de l'est, chez lesquelles il s'était retiré. Bientôt deux camps d'insurgés se formèrent, l'un à Boufarik, sous les ordres d'Oulid-Bou-Mezrag, et l'autre sur la rive droite de l'Arach auprès du marabout de Sidi Arzine, sous ceux de Ben - Zamoun et de Sidi - Saadi. Ce dernier n'était qu'à peu de distance de la Ferme-Modèle. Des partis nombreux se répandirent dans le Fhas, attaquèrent des cultivateurs européens, en tuèrent quelques-uns, et forcèrent les autres à se réfugier dans la ville. La consternation fut alors générale dans la population civile européenne. La terreur grossissant le nombre des ennemis, peignait tout sous tes plus noires couleurs : les colons abandonnèrent les campagnes qu'ils commençaient à cultiver; dans la ville, plusieurs négociants fermaient leurs établissements et songeaient déjà à se rembarquer avec leurs marchandises les plus précieuses, tant il leur paraissait difficile de résister à une insurrection générale, avec une armée découragée et malade, et avec un chef déconsidéré; enfin la colonie naissante semblait être arrivée à son dernier jour. Mais que peuvent dans une guerre défensive les efforts désordonnés de la barbarie contre la vigoureuse organisation militaire des nations civilisées ?
Combats auprès de la Ferme-Modèle.
Le 17 juillet, les gens de Ben-Zamoun passèrent l'Arach, vinrent attaquer la Ferme-Modèle, et mirent le feu à la première récolte que des mains européennes eussent fait croître sur le sol algérien. Tous tes postes extérieurs furent obligés de se replier sur la Ferme, excepté celui d'un blockhaus que les Kbaïles ne purent forcer. L'ennemi s'étant emparé des hauteurs qui dominaient ce poste du côté du nord, plongeait dans sou intérieur et commençait à mettre la garnison dans une position assez critique, lorsque des secours arrivèrent, ce qui l'obligea de repasser la rivière et de se retirer dans son camp.
Le lendemain l'attaque recommença; mais, au premier coup de canon, le général Berthezène partit d'Alger avec six bataillons, toute la cavalerie et deux pièces de campagne, et se dirigea par Kouba et la route de Constantine entre la maison Carrée et la Ferme. Arrivé sur la crête des hauteurs en face de Sidi-Arzine, il dirigea le feu de son artillerie sur le camp des Kbaïles. En même temps, le colonel d'Arlanges, du 50e de ligne, qui commandait le poste de la Ferme, fit une sortie contre ceux qu'il avait en face, les rejeta de l'autre côté de la rivière, passa l'Arach après eux, et se dirigea sur le camp. Le général Berthezène s'y porta aussi avec toutes ses troupes, mais l'ennemi n'attendit pas un choc aussi formidable. Il leva le camp avec précipitation, et prit en toute hâte le chemin des montagnes. La cavalerie se mit à sa poursuite, mais elle ne put l'atteindre. Le général en chef rentra le même jour à Alger, croyant en avoir fini avec l'insurrection.
Malgré le succès de cette journée et la dispersion des troupes de Ben-Zamoun, les voitures de l'artillerie, qui rentraient le soir à Alger, sous l'escorte de deux compagnies, furent attaquées près de Birkadem par un parti arabe qui s'était mis en embuscade sur la route. Il y eut un moment de désordre dans l'escorte, mais l'ennemi finit par être repoussé.
Le 19, la Ferme fut de nouveau attaquée; cette fois, ce fut par les Arabes du rassemblement de Boufarik L'ennemi arriva par le pont d'Oued-el-germa, bloqua le blockhaus qui était sur la hauteur en face, et vint investir la Ferme qu'il ne put forcer. Le combat se prolongea jusque dans la nuit.
Le 20, le blockhaus d'Oued-el-germa, toujours entouré d'ennemis, continua à se défendre avec acharnement, quoique privé de toute communication avec la Ferme. L'officier qui le commandait, et dont le nom mérite d'être connu, s'appelait Rouillard ; il était lieutenant au 50° de ligne. Il ménagea ses cartouches en ne faisant tirer qu'à coups sûrs, et parvint ainsi à se maintenir dans ce poste dangereux. Les Arabes essayèrent de démolir le blockhaus en arrachant les planches ou en les coupant à coup de yatagan, mais ils n'eurent pas, fort heureusement, l'idée d'y mettre le feu. Le même jour un convoi fut attaqué près de Birkadem ; un demi-bataillon du 67° de ligne, qui l'escortait, fut mis en complète déroute, et ne dut son salut qu'à un bataillon du 50° qui vint à son secours; la Ferme fut aussi attaquée, mais faiblement.
Le 21, les tirailleurs ennemis s'avancèrent jusqu'à Birkadem; on combattit jusque dans la nuit aux environs de la Ferme et d'Oued-el-germa, sans succès bien prononcé de part ni d'autre. Le général Feuchères s'était porté sur ce point vers le soir avec quelques bataillons.
Enfin, le 22, le général en chef marcha à l'ennemi au point du jour avec des forces imposantes. Le combat se décida alors empiétement en notre faveur. Les Arabes furent rejetés sur la route de Blida ; on les poursuivit jusqu'à Bir-Touta (le Puits des Mûriers), à cinq quarts de lieue au-delà du pont d'Oued-el-germa. La cavalerie s'avança jusqu'en vue de Boufarik, où se trouvaient encore quelques masses ennemies ; ne se sentant pas assez forte pour les attaquer, elle se replia sur le corps d'armée en incendiant et saccageant quelques habitations arabes.
Le général Berthezène rentra le même jour à Alger, comme il l'avait fait le 18, mais cette fois avec plus de raison, car le succès de cette journée avait été décisif. Les bandes qui composaient le rassemblement de Boufarik se dispersèrent comme celles de Ben-Zamoun et de Sidi-Saadi, et il ne resta plus d'ennemis à combattre.
Les Arabes ne mirent ni ordre ni ensemble dans leurs attaques; ils avaient hâte d'en finir, parce qu'ils sentaient bien qu'ils ne pouvaient rester réunis bien longtemps. S'ils avaient pu prolonger leurs efforts, ils nous auraient mis dans une position critique. Les maladies qui régnaient dans nos troupes depuis plus d'un mois prenaient chaque jour plus d'intensité : les hôpitaux étaient encombrés, les cadres de plusieurs compagnies presque vides, de serte qu'un mois ou trois semaines de fatigue et de combats, même heureux, auraient réduit l'armée presque à rien. Au reste, cette insurrection, quoiqu'elle n'eût pas atteint le but que s'en proposaient les auteurs, fit beau-coup de mal à la colonie : elle arrêta le travail et la marche des capitaux sur Alger, découragea les hommes timides qui sont toujours en grand nombre, fournit des arguments aux ennemis de la colonisation, et contribua puissamment à donner à ce qu'il resta d'activité coloniale la fausse et funeste direction que nous avons signalée dans le livre précédent.
El-Hadj-Mahiddin est nommé agha des Arabes.
Quoique les Arabes eussent été repoussés à l'attaque de nos lignes, cet échec ne détruisit pas la bonne opinion qu'ils avaient conçue d'eux-mêmes depuis la retraite de Médéa. Ils n'y virent qu'un avertissement de se borner à se considérer comme nos égaux en force et en puissance, tandis que pendant quelques jours ils s'étaient regardés comme nos supérieurs. Dès ce moment, ils commencèrent à faire une distinction entre la banlieue d'Alger, sur laquelle ils voulurent bien consentir à reconnaître nos droits, et le reste de la province, qui, d'après eux, devait être soustrait à notre autorité. Restez chez vous, et nous resterons chez nous, tel fut le langage de leur politique. La conduite du général Berthezène, pendant les quatre ou cinq mois qu'il resta encore en Afrique, prouva qu'il avait accepté cet ultimatum. Cependant ce général, tout en consentant à traiter de puissance à puissance avec les Arabes de la province d'Alger, désirait qu'ils eussent un chef unique qui pût lui répondre non de leur soumission, il n'en était plus question, mais de leur tranquillité. L'agha lliendiri n'avait jamais été qu'une fiction; sur la recommandation des Maures d'Alger, on le remplaça par El-Hadj-Mahiddin-el-Seghir-ben-Sidi-Ali-ben-Moubarek, chef de l'antique et illustre famille des marabouts de Coléa. Celui-ci s'engagea, moyennant un traitement de 70.000 fr. par an, à retenir les Arabes chez eux, à condition que nous resterions chez nous. C'était un système de complète stagnation ; mais enfin c'était un système : nous nous bornions à occuper les quelques lieues carrées qui paraissaient pouvoir suffire à nos essais de colonisation.
Le nouvel agha, jusqu'au départ du général Berthezène, qui eut lieu dans le mois de janvier 1852, remplit ses engagements en homme consciencieux ; les Arabes ne se permirent aucun acte d'hostilité sur nos terres, mais il était imprudent à un Français de pénétrer sur les leurs. L'agha recommandait bien dans toutes ses lettres de ne laisser aller personne chez les indigènes, et de n'avoir de communications avec eux que par son intermédiaire. En effet, toutes les relations avec les Arabes se réduisirent à la correspondance de l'agha, qui ne vint que très rarement à Alger dans le cours de son administration.
El-Hadj-Mahiddin exerçait une grande influence sur les indigènes, et par la sainteté de son origine, et par ses qualités personnelles, qui étaient très remarquables. Homme d'ordre et d'autorité, il arrêta un moment l'anarchie parmi les Arabes. Il nomma pour kaïd à Khachna, en remplacement de Ben-el-Amri, dont nous avons raconté la fin tragique, El-Hadj-Mohammed-el-Mokhfi; Ahmed-ben-Ourchefoun fut laissé à Beni-Mouça, et Meçaoud-ben-Abdeloued au Sebt, malgré la part qu'ils avaient prise l'un et l'autre à l'insurrection. A Beni-Khelil, Mohammed-ben-Cherguy avait abandonné ses fonctions à la destitution de l'agha Hamdan. L'agha Mendiri ne songea pas à le remplacer ; mais l'outhan, las de cette anarchie, mit à sa tète El-Hadj-Boualouan. M. Mendiri refusa de reconnaître Boualouan, et fit nommer à sa place El-Arbi-ben-Brahim, cheik de Beni-Salab. L'agha Mahiddin, n'ayant pas confiance en cet homme, le destitua, et El-Arbi-ben-Mouça fut reconnu kaid de Beni-Khelil. A Médéa, Oulid-Bou-Mezrag s'était emparé du pouvoir sans titre déterminé, après le départ de Ben-Omar ; mais ce jeune homme, s'étant ensuite abandonné à la débauche et à l'ivrognerie avec un scandale qui indigna toute la population, tomba dans le plus grand discrédit, et ne vit d'autre ressource que de se jeter dans le parti du bey de Constantine, ainsi que nous le verrons dans le second volume.
Comme nous touchons à l'époque où ce dernier commença à être en contact plus immédiat avec nous, il convient de faire connaître au lecteur dans quelle position il se trouvait alors.
Ahmed, bey de Constantine, après la prise d'Alger, se retira dans sa province avec le peu de troupes qu'il avait conduites au secours d'Hussein-Pacha. En approchant de sa capitale, il apprit que les Turcs qu'il y avait laissés s'étaient révoltés contre son autorité, et avaient élu pour bey son lieutenant Hamoud-ben-Chakar. Ne se trouvant pas assez fort pour les soumettre, il les fit prier de permettre à sa famille de venir le rejoindre, promettant de renoncer à tous ses droits et de se retirer dans le Sahara, pays de sa mère. Mais, pendant cette petite négociation, une prompte révolution s'opéra en sa faveur. Les habitants de Constantine, craignant les excès auxquels les révoltés pourraient se livrer, s'ils étaient corn-piétement vainqueurs, envoyèrent un marabout à Ahmed bey, pour l'inviter à entrer en ville avec le peu de forces dont il pouvait disposer, s'engageant à le soutenir contre les Turcs. Ahmed, qui ne renonçait que malgré lui à la puissance, mit à profit ces bonnes dispositions, et pénétra dans Constantine. Les Turcs, voyant qu'ils avaient toute la population contre eux, sortirent de la ville, et allèrent camper à une certaine distance avec le bey qu'ils avaient élu. Le lendemain, Ahmed marcha contre eux avec des forces supérieures prises dans le sein de la population. Les révoltés, n'espérant pas pouvoir lui résister, massacrèrent Hamoud-ben-Chakar, et firent leur sou-mission. Le bey feignit de les recevoir en grâce, mais, plus tard, il les fit presque tous égorger en détail, sous différents prétextes.
Mustapha-ben-Mezrag, bey de Titteri, s'étant mis en état de guerre contre la France, et ayant pris le titre de pacha, envoya, dans l'été de 1830, une députation à Ahmed pour le sommer de le reconnaître comme successeur d'Hussein. Cette ambassade n'arriva pas jusqu'à lui, car, à peine eut-il vent de la démarche de Mustapha, qu'il jura qu'il ne reconnaîtrait jamais son collègue pour son souverain, et prit pour lui-même le titre de pacha.
La chute de Mustapha ne rapprocha pas Ahmed des Français. Le général Clauzel ayant pris alors, comme nous l'avons dit, la résolution de le remplacer par un prince de la famille de Tunis, il ne songea plus qu'à se mettre en état de défense. Se méfiant de Farhat-ben-Said, qui remplissait alors les fonctions de cheik des Arabes du Sahara, il le destitua et nomma à cet emploi son oncle maternel Bou-Zeïd-ben-Gana. Cette mesure intempestive fut pour lui une source intarissable d'embarras de toute espèce, car Farhat n'était pas homme à céder facilement la place; il avait pour lui l'affection de plusieurs tribus puissantes, et par leur moyen il repoussa Ben-Gana, qui s'était présenté avec des forces insuffisantes. Vaincu peu de temps après par Ahmed bey, qui marcha contre lui en personne, il ne perdit pas courage pour cela, et la plupart des tribus continuèrent à le reconnaître pour chef. Sans cesse occupé à susciter des ennemis au bey de Constantine, il étendait ses menées sur tous les points où il pouvait trouver le moindre germe de mécontentement à exploiter.
Expédition malheureuse de Bône.
Cet état de choses menaçant pour Ahmed bey l'empêcha de s'occuper de Bône, après que le général Damrémont l'eut évacué en 1850. Cette ville, soustraite de fait à son autorité et abandonnée par la France, se gouverna elle-même. Les tribus voisines, qui en voulaient beaucoup aux habitants pour avoir reçu les Français dans leurs murs, l'attaquèrent plusieurs fois, mais elles en furent toujours repoussées. Une centaine de Turcs qui s'y trouvaient sous le commandement d'un Koulougli influent, nommé Ahmed, contribuèrent puissamment à sa défense. Cependant, comme les attaques se renouvelaient sans cesse, les Bônois s'adressèrent au général Berthezène dans l'été de 1851 et lui demandèrent des secours en hommes et en munitions. D'après les insinuations de Sidi-Ahmed, qui nécessairement jouissait d'un grand crédit chez eux à cause des services que sa petite troupe leur rendait depuis un an, ils insistèrent beaucoup pour qu'on ne leur envoyât que des troupes indigènes. Cet arrangement convenait à Sidi-Ahmed, qui avait, dit-on, conçu le projet de se créer une position indépendante, et au général Berthezène, qui n'aurait pas cru peut-être pouvoir prendre sur lui d'envoyer des troupes françaises à Bône sans l'autorisation du gouvernement français : en conséquence, on forma un petit détachement de 125 zouaves, tous Musulmans, à l'exception de quelques officiers et sous-officiers, dont on donna le commandement au capitaine Bigot. Le commandant Huder, officier d'ordonnance du général Guilleminot, alors ambassadeur à Constantinople, fut chargé de la direction supérieure de l'expédition ; mais, par une assez bizarre combinaison d'idées, il reçut le titre de consul de France à Bône. M. Rader était venu en Afrique sous le général Clauzel, pensant que la connaissance qu'il croyait avoir des mœurs de l'Orient pourrait y être utilisée. C'était un homme très actif et très zélé, mais d'un jugement peu sûr.
MM. Huder, Bigot et leurs 125 zouaves arrivèrent, à Bône sur la corvette la Créole, le 14 septembre. Ils furent fort bien reçus par les habitants ; mais Sidi-Ahmed, à la vue des officiers français, laissa percer son mécontentement. Ce n'était pas ce qu'il avait demandé : il aurait voulu des soldats musulmans, et rien de plus. Le commandant Huder, qui s'aperçut de ses dispositions, vit bien qu'il allait avoir un ennemi dans cet homme, et se mit tout aussitôt à travailler à l'éloigner des affaires. Sous prétexte de soulager les Turcs, il plaça quelques zouaves à la Casbah et en augmenta progressivement le nombre, de manière à pouvoir y envoyer un officier, ce qui ôta par le fait le commandement de cette citadelle à Sidi-Ahmed. Mais celui-ci resta cependant assez puissant pour faire beaucoup de mal, s'il le voulait, et il le voulut d'autant plus que M. Huder rompait évidemment avec lui. Il est des circonstances difficiles où il faut dissimuler avec un ennemi, lorsqu'on ne se sent pas la force de l'écraser entièrement.
Il y avait alors à Bône un ancien bey de Constantine, nommé Ibrahim, qu'une suite d'événements avait conduit dans cette ville. Ce personnage, qui cachait sous une bonhomie apparente un grand fond de perfidie, parvint à capter la confiance de M. Huder. Il épiait toutes les démarches de Sidi-Ahmed dont il rendait compte au commandant français. Son dessein était de les perdre l'un par l'autre et de s'emparer ensuite du pouvoir.
M. Huder, qui n'avait pas les habitudes très militaires, s'était fort mal installé à Bône; sa petite troupe se gardait mal ; les portes de la Casbah étaient toujours ouvertes, et l'officier qui y commandait venait tous les jours prendre ses repas en ville. Ibrahim, qui observait tout, résolut de profiter de cette négligence pour brusquer le dénouement qu'il préparait. Il avait obtenu du trop confiant Huder quelque argent pour prix des services qu'il était censé lui rendre. Il en employa une partie à soudoyer quelques hommes avec lesquels il se présenta à la Casbah an moment où l'officier en était absent. La garnison étonnée hésita un instant, mais bientôt, séduite par quelques largesses, elle se déclara pour lui, les Turcs d'abord et plusieurs zouaves ensuite. Ceux qui auraient désiré rester fidèles, se voyant ainsi abandonnés, furent contraints de poser les armes.
Ibrahim, maître de la citadelle, en fit fermer les portes et annonça son triomphe par une salve d'artillerie. A ce bruit, le commandant Huder et le capitaine Bigot réunirent à la hâte quelques soldats et marchèrent sur la Casbah, d'où ils furent repoussés par une vive fusillade. Ils rentrèrent alors dans la ville, dont les partisans de Sidi-Ahmed cherchaient déjà à fermer les portes.
Il y avait alors en rade de Bône deux bâtiments de l'Etat, la Créole et l'Adonis. M. Huder résolut de leur demander des hommes de débarquement et d'attaquer la Casbah avec eux et ses zouaves. Mais les habitants de la ville lui ayant promis de ramener les Turcs à leur devoir et de lui livrer Ibrahim, il renonça à son projet.
Mort du commandant Huder
Deux jours se passèrent à attendre l'effet de ces promesses, qui ne devaient pas se réaliser. Les Arabes de la campagne étaient aux portes de la ville ; Ibrahim en avait reçu un grand nombre dans la citadelle, et tout annonçait une attaque prochaine. Le 29, quelques Bônois, disant agir au nom de leurs compatriotes, vinrent déclarer au commandant Huder qu'il ne pouvait plus rester à Bône. Forcé de céder à la nécessité, ce malheureux officier leur annonça qu'il allait partir et fit aussitôt demander des embarcations aux deux navires. Dès que celte nouvelle se fut répandue eu ville et au dehors, les campagnards se précipitèrent sur les portes, forcèrent les gardes et envahirent toutes les rues. Beaucoup de zouaves furent pris ou se réunirent aux insurgés; le capitaine Bigot fut égorgé après s'être vaillamment défendu. Quarante ou cinquante personnes, Français ou zouaves, repoussées vers la porte de la Marine, se précipitèrent vers les embarcations que les deux navires leur envoyaient. Plusieurs périrent dans cette retraite; de ce nombre fut l'infortuné Huder, qui, déjà blessé de deux coups de feu, reçut une balle dans la tète en arrivant dans un canot.
Cette scène sanglante était à peine terminée que les habitants de Bône envoyèrent des parlementaires à bord de la Créole pour protester qu'ils n'étaient pour rien dans tout ce qui venait de se passer. Peu d'instants après, on vit arriver d'Alger deux bricks portant 250 hommes du 2e bataillons de zouaves, commandés par le commandant Duvivier, que le général Berthezène envoyait au secours de la faible garnison de Bône. Les gens de la ville rendirent alors les prisonniers, parmi lesquels se trouvait un officier. M. Duvivier désirait tenter un coup de main sur la Casbah avec ses hommes et une partie des équipages des navires ; mais les commandants des bâtiments ne crurent pas devoir accéder à ce projet. Il fallut donc retourner à Alger, où les débris de l'expédition rentrèrent le 11 octobre.
Cette malheureuse affaire acheva de perdre le général Berthezène, à qui on en reprocha l'issue avec d'autant plus d'amertume, que la pitié commandait le silence sur celui qui aurait pu en partager le blâme avec lui.
Dans la province d'Oran, notre position fut longtemps indécise sous l'administration du général Berthezène. Le Gouvernement resta plusieurs mois sans se prononcer sur l'adoption ou le rejet des arrangements pris par le général Clauzel au sujet de ce beylick ; pendant tout ce temps les choses restèrent dans l'état où nous les avons laissées au 6e livre de cet ouvrage. Le khalifat du prince Ahmed était toujours censé gouverner le pays sous la protection du colonel Lefol et de son régiment; mais son autorité ne s'étendait guère au-delà de la ville, réduite à une très faible population. Il avait pris à son service les Tares qui étaient à celui de l'ancien bey, ce qui éleva à près de 500 hommes le nombre des soldats immédiatement placés sous ses ordres, y compris ceux qu'il avait amenés de Tunis. Dans le mois de juin, il alla attaquer avec ce petit corps une tribu qui l'avait bravé, lui tua beaucoup de monde, et lui enleva un assez riche butin; il avait besoin de cette ressource, car il était presque sans argent et ses troupes étaient dans le plus affreux dénuement. Le 218 de ligne n'était pas dans une position plus brillante. Comme il était désigné depuis longtemps pour rentrer en France, il ne recevait plus rien de son dépôt, de sorte que les soldats étaient presque nus; les officiers eux-mêmes n'avaient que des habits en lambeaux. Le découragement s'était emparé de cette troupe, fatiguée de son isolement, et qui restait souvent un mois sans nouvelles d'Alger ni de France. Le colonel Lefol, qui la commandait, mourut d'une nostalgie dans le courant du mois d'août.
Le général Boyer à Oran.
La nouvelle des succès obtenus par les Kbaïles à l'expédition de Médéa excita quelques mouvements dans les environs d'Oran : les Arabes qui habitaient auprès de cette place s'en éloignèrent avec l'intention avouée d'aller se joindre à leurs compatriotes de l'intérieur, et de revenir ensuite attaquer la garnison. Ces préparatifs hostiles rendirent un peu de vie aux soldats français, à qui l'inaction pèse plus que toute autre chose; mais ils n'amenèrent que quelques vaines démonstrations de la part des Arabes. Il n'y eut aucune attaque sérieuse; tout se borna à quelques insignifiants coups de fusil, tirés de loin sur les avant-postes.
Enfin, le Gouvernement s'étant déterminé à refuser sa ratification aux arrangements du général Clauzel, se décida à occuper Oran pour son propre compte. Le général Fodoas avait d'abord été désigné pour aller commander sur ce point, mais une nouvelle décision confia ce poste au général Boyer. II arriva à Oran dans le milieu de septembre; le 21e de ligne rentra en France, et le 20o le remplaça. Mais l'envoi d'un lieutenant-général à Oran prouvait que l'intention du Gouvernement était d'augmenter les forces de cette partie de la Régence, ce qui eut en effet lieu un peu plus tard.
Le khalifat et ses Tunisiens furent reconduits dans leur pays à leur grande satisfaction, car ils étaient las depuis longtemps de leur position équivoque.
Peu de jours après l'arrivée du général Boyer, Muley-Ali, parent de l'empereur de Maroc et commandant des troupes que ce prince avait envoyées dans la province d'Oran, vint avec quelques centaines de cavaliers tournoyer autour de la place ; après deux ou trois jours de vaines et puériles démonstrations, il disparut; mais les environs de la ville restèrent peu armés. Les Arabes venaient en enfants perdus tirer de loin sur les sentinelles, comme pour protester contre notre présence à Oran par ces actes d'hostilités sans résultats; cela n'empêchait pas d'autres Arabes de fréquenter notre marché. Il arriva plus d'une fois que les indigènes, après avoir vendu leurs denrées à Oran, s'amusaient, en s'en retournant, à décharger leurs fusils contre les remparts. Cet état équivoque, qui n'était ni la paix ni la guerre, dura, avec quelques légères variations, pendant toute l'année 1851.
Le général Boyer était arrivé dans son commandement précédé d'une grande réputation de sévérité, qui lui avait acquis en Espagne le surnom de Cruel, dont il était le seul à s'honorer. C'était, du reste, un homme d'esprit et de capacité, instruit et ami des arts, doux et arable dans son intérieur, et pourvu enfin d'une foule de qualités estimables, qui contrastaient singulièrement avec sa terrible réputation justifiée par ses actes. Il se montra à Oran impitoyable envers des Maures soupçonnés d'entretenir des intelligences avec l'empereur de Maroc. Plusieurs furent exécutés sans jugement, et quelques-uns clandestinement. Un marchand marocain, nommé Balenciano, fut un jour enlevé de chez lui par ses ordres, et cessa bientôt d'exister : toutes ses richesses furent confisquées ; il revint au trésor une somme de 20,000 fr., qui fut restituée aux héritiers en 1840. Rien ne justifiait des mesures aussi acerbes. La population d'Oran n'était pas assez considérable, ni assez hostile, pour qu'il fût nécessaire de la maintenir par de semblables moyens. S'il existait des coupables, c'était à la justice à les trouver et à les punir. Il faut que les circonstances soient bien graves pour qu'un seul homme s'arroge le droit de vie et de mort; malheureusement la cruauté, comme moyen politique, était systématique chez le général Boyer; c'était une affaire de conviction et de raisonnement plus encore qu'une émanation du caractère.
Organisation des services publics à Oran.
Lorsqu'il fut bien décidé qu'Oran ferait définitivement partie de l'occupation, on s'occupa d'y organiser les services administratifs. Comme toujours, la fiscalité fut mise en première ligne; un arrêté du 7 septembre rendit applicables au port et à la ville d'Oran le tarif et le mode de perception des droits de douane et d'octroi en usage à Alger. Le même jour on fixa la composition du personnel du bureau des douanes. M. Baraclein fut nommé sous-intendant civil, et M. Pujal commissaire près de la municipalité qu'on se proposait de créer à l'instar de celle d'Alger. Nous allons donner maintenant une courte description de la province d'Oran, et faire connaître les tribus qui l'habitent.
Description de la province.
La province ou beylick d'Oran avait une partie de son territoire sur la droite du Chélif. Cette rivière, qui est le cours d'eau le plus considérable de l'Algérie, commence au sud du mont Ouenseris, dans un lieu appelé Seboun-Ain, à cause des soixante-dix fontaines dont la réunion en forme la source. Quoique cette source ne soit en ligne directe qu'à cent quarante kilomètres de son embouchure, le cours de la rivière en a plus de quatre cents, par suite des grands détours qu'elle fait. Elle court d'abord vers l'est l'espace d'une centaine de kilomètres, puis elle se dirige vers le nord jusqu'à la hauteur de Médéa, qu'elle laisse sur la droite; de là elle court à l'ouest jusqu'à son embouchure, en suivant une ligne parallèle au littoral, dont elle n'est jamais plus éloignée que de quarante kilomètres. Dans cette dernière partie de son cours, l'espèce de presqu'île qu'elle forme ainsi avec la mer est très montagneuse et d'un accès difficile, mais du reste riche et fort pittoresque; c'est là que se trouve la petite ville maritime de Tenez, qui, avant la domination turque, était la capitale d'un petit royaume indépendant.
La contrée comprise entre Tenez et l'embouchure du Chélif porte le nom de Dahra. On l'appelait jadis, et on l'appelle encore quelquefois aujourd'hui Magraouah. Les principales tribus qui l'habitent sont : les Beni-Zeroual, les Beni-Zantès, les Oulad-Khelouf, les Mediouna, les Oulad-Kiah, les Oulad-Younès et les Beni-Madoun. Sur le versant sud des montagnes du Dahra est la ville, ou plutôt le village de Mazouna, à une dizaine de kilomètres du Chélif.
Il se faisait autrefois sur les côtes du Dahra, par les points appelé Kbelat-el-Chema, Ras-el-Khamise et Ruminel-el-Abiad, un commerce de grains et de cire qui n'était pas sans importance. La population de ce canton est au moins de 25,000 âmes; elle est presque toute de race kbaïle, laborieuse, brave, et a toujours joui d'une assez grande indépendance.
A l'est de Tenez, entre cette ville et les Beni-Menasser, on trouve de l'ouest à l'est les Beni-Hidja, les Haoua, la forte tribu de Zatima, qui compte neuf subdivisions, et les Beni-Ferah. Ces diverses tribus présentent une population de plus de 50,000 âmes.
Maintenant, si nous descendons le Chélif depuis sa source jusqu'à son embouchure, nous rencontrerons successivement les Beni-Lent, les Beni-Meida, les Oulad-Aiad, les Oulad-Aziz, les Oulad-Helal, les Matmata, les Beni-Ahmed, les Djendel, les Hacheur du Chélif. C'est au nord de cette tribu que se trouve la ville de Miliana, sur les pentes du Djebel-Zaccar, dans une position ravissante. Non loin de cette ville, sur le territoire des Hachem, on traverse le Chélif, sur un fort beau pont en pierre, construit en 1816, avec les restes d'un ancien pont romain. Au-dessous de ce ponton trouve les Beni-Zoug-Zoug, les Ataf, les Braz, les Sendjès, les Oulad-Kosseir, les Beni-Rached, les Oulad-Fers, le village ou petite ville de Medjadja, la position d'El-Senam, ancienne ville romaine, les Sbiah, tribu en tout temps indocile et remuante, et les Oulad-Sidi-el-Aribi, réunion d'un grand nombre de petites tribus soumises héréditairement à la famille EI-Aribi, une des plus nobles de la province. Viennent ensuite les Mahdjer et les Hachem-Daro, auprès desquels est la ville de Mostaganem. Cette ville est bâtie à 12 kilomètres de l'embouchure du Chélif et à 2 de la mer, sur une colline assez élevée. Elle est divisée en deux parties par un profond ravin, la ville proprement dite, et le quartier de Matmora qui la domine. Il y avait de plus autrefois deux faubourgs, Tisdid et Diar-el-Djedid, mais ils sont maintenant en ruines. Mostaganem est fermée d'un faible mur. Il existe hors de son enceinte un petit fort détaché qu'on appelle fort des Turcs ou de l'Est. Dans l'intérieur on voit un vieux château bâti par Yousoufben-Tachfin, au XIIe siècle de notre ère. Il y a eu jadis à Mostaganem une population de plus de 12,000 âmes et une grande quantité d'ateliers de broderie d'or.
Mazagran, petite ville située à 4 kilomètres de Mostaganem, a beaucoup souffert depuis 1830. La campagne autour de ces deux villes était couverte de maisons et de jardins.
La vallée du Chélif, qui est une des plus fertiles contrées de l'Algérie, a une population d'au moins 80,000 âmes. De nombreux vestiges de l'antiquité attestent que la colonisation romaine y fut très florissante.
Les affluents du Chélif sont nombreux. Les principaux sont la Mina, l'Oued-Djediouia, l'Oued-Riou, l'Oued-Fodda, l'Oued-Rouina et l'Oued-Derder. Tous se jettent dans le Chélif par la gauche.
La Mina prend sa source au plateau de Sersou, non loin de celte du Chélif. Elle passe près des anciennes cités de Takdemt et de Tiaret, laissant à droite les Beni-Medjan et les Oulad-Messaoud, à gauche la grande tribu des Sdama, traverse le territoire de la puissante et difficile tribu des Flitta et se réunit au Chélif, à l'est du territoire des Mahdjer, après un cours de 140 kilomètres.
L'Oued-Djediouia prend sa source chez les Flitta, coule entre cette tribu et celle des Beni-Ouragh, et se jette dans le Chélif chez les Oulad-Sidi-el-Aribi.
L'Oued-Riou commence chez les Oulad-Messaoud, traverse les territoires des Oulad-Chérif, de Halouya, des Beni-Ouragh, des Oulad-Mobammed, et se perd dans le Chélif, un peu au-dessus de l'Oued-Djediouia.
L'Oued-Fodda descend du Djebel-Ouenseris, un des points les plus élevés de la première chaîne atlantique, traverse les territoires des Beni-Lassem, des Oulad-Bessam, des Beni-Indel, des Beni-Chaïl, des Beni-Bou-Kannous, des Beni-Bou-Attab, des Chouchaoua, et arrive au Chélif chez les Attaf.
L'Oued-Rouina a sa source chez les Oulad-Mariem à l'est de l'Ouenseris, et traverse le pays des Beni-Zoug-Zoug où il se perd dans le Chélif.
L'Oued-Derdeur descend de chez les Matmata, sépare les Beni-Zoug-Zoug des Beni-Ahmed et des Hacheur, et se réunit au Chélif un peu au-dessus du pont dont nous avons parlé.
Oran, capitale de la province, est à 78 kilomètres de Mostaganem. Cette ville est bâtie au bord de la mer, dans une position fort pittoresque. Elle s'élève sur deux collines séparées par un ravin, dans lequel coule un ruisseau qui arrose de beaux jardins et fait tourner quelques moulins. Les deux principaux quartiers de la ville sont situés l'un à droite et l'autre à gauche de ce ravin, qui débouche sur la plage où se trouve un troisième quartier appelé la Marine, moins considérable que les deux premiers. L'enceinte d'Oran a été fortifiée avec beaucoup d'art et de soin par les Espagnols, qui l'ont longtemps occupé. Une montagne assez élevée domine la ville à l'ouest. Le sommet en est défendu par le fort Santa-Cruz; à mi-côte se trouve le fort Saint-Grégoire, et dans le bas, auprès de la mer, celui de la Mouna. Vers la partie sud du quartier qui est à droite du ravin, s'élèvent les forts Saint-André et Saint-Philippe, qui éclairent ce même ravin, défendu en outre par quelques tours. La partie nord de ce même quartier est défendue par la nouvelle Casbah, ou Chàteau-Neuf, et par la pointe fortifiée de Sainte-Thérèse, qui commande la mer. Le quartier à gauche du ravin est dominé par la vieille Casbah, qui a été presque entièrement détruite par le tremblement de terre de 1790. Oran avait jadis deux faubourgs considérables, Ras-el-Ain et Kairkenta; mais ils ont été sacrifiés aux besoins de la défense. Quoique cette ville offre un développement très étendu, il ne parait pas qu'elle ait jamais eu plus de 7 à 8,000 âmes de population sous les Turcs.
A 6 kilomètres au nord-ouest d'Oran, on trouve le port et le fort de Mers-el-Kebir, qui est une bonne position maritime: c'est là que vont mouiller les navires destinés pour Oran, dont le petit port ne peut recevoir que des barques.
En suivant le littoral depuis Mazagran jusqu'à Oran, on trouve d'abord les Abid-Cheraga, puis l'Oued-Hahra, cours d'eau assez considérable, qui reçoit par sa gauche une autre petite rivière appelée le Sig, et qui au-dessous de cette jonction jusqu'à son embouchure, laquelle en est peu éloignée, porte le nom de Macta. Il existe à cette embouchure un petit mouillage qu'on appelle Mersel-Djadje (le port aux Poules).
A l'ouest de la Macta commence une chaîne de collines qui se prolonge jusqu'à Oran. Elle est habitée par les Hamian. On y trouve la petite ville d'Arzew, qui était encore habitée lorsque nous nous établîmes à Oran. Les Français l'appellent le vieil Arzew, pour la distinguer de la position maritime à laquelle ils ont donné ce nom, et que les Arabes appellent la Marsa, qui est plus à l'ouest. Notre Arzew est un assez bon mouillage, couvert à l'ouest par le cap Carbon. Entre ce cap et Oran, on trouve le petit village maritime de Keristel.
Il existe auprès d'Arzew une sebkah qui forme de très belles salines. Au sud de cette sebkah habitent les Garraba, partie sur les collines, partie dans la plaine du Sig. Les Bordjia sont à l'est des Garraba, dans la plaine de l'Habra, qu'on appelle aussi plaine de Ceirat. Les Bordjia se prolongent sur les montagnes qui bornent au sud cette plaine et qui font partie de la première chaîne atlantique. L'ouest des Bordjia de la montagne sont les Sedjenara, les Beni-Chougran, et, un peu plus loin, les Beni-Amer, dont le vaste territoire, plus étendu que peuplé, arrive jusqu'auprès de Tlemcen. Les Beni-Amer, subdivisés en treize fractions, ne présentent pas une population de plus de 20.000 âmes. Au nord de la partie de leur territoire la plus rapprochée d'Oran règne une grande sebkah sur les bords de laquelle les beys d'Oran avaient une maison de plaisance appelée Miserghine. Entre cette sebkah et la mer sont les Ghomra et les Douer et Zemela, tribu du Makhzen, comme l'indiquent leurs noms.
Tlemcen est à 102 kilomètres au sud-ouest d'Oran, et à 50 à l'est des frontières du Maroc. Cette ville, capitale jadis d'un assez puissant royaume, ne comptait pas six mille âmes de population à la chute de la domination turque. Nous aurons occasion d'en parler avec plus de détails dans le cours de cet ouvrage.
Au sud de Tlemcen est la tribu des Ghocel, dont le territoire est traversé par l'Oued-Isser, qui se jette dans la Tafna, et va se perdre avec elle dans la mer en face de la petite île de Rachgoun, après avoir traversé le pays des Oulaça, situé entre celui des Ghocel et la mer.
Entre les Oulaça et les frontières du Maroc sont les Trara et les Souhalia. Toutes ces tribus sont Kbaïles et habitent une contrée très montagneuse. Au nord du territoire des Souhalia est la petite ville de Nedrouma, et au sud, la position maritime de Djemma-Ghazouat. A l'ouest de Tlemcen sont quelques fractions de la grande tribu des Angad, et au nord, dans les montagnes, les Beni-Ournid, les Beni-Snous, et quelques autres petites tribus.
Au sud de la première chaîne atlantique, à peu près sous le méridien de Mostaganem, on trouve la ville de Mascara, où les beys de la province faisaient leur résidence pendant que les Espagnols occupaient Oran. Elle est dans une fort belle position, entourée de frais jardins et de cinq faubourgs. Elle est bâtie à l'entrée de la plaine d'Eghrès, qui fait partie du territoire des Hachem, que, par cette raison, on appelle Hacheur-Eghrès. Cette tribu, forte de plus de 20.000 âmes, se partage en deux grandes divisions, les Hachem-Garraba et les Hachem-Cheraga. Au nord de ces derniers, on trouve la petite ville de Kala, renommée pour la fabrication des tapis.
Au sud des Hachem sont les Djafra et le pays d'Yacobia, habité par plusieurs tribus qu'il est inutile de nommer. Cette contrée est à l'ouest des Sedama, dont il a été parlé plus haut.
A l'ouest des Djafra, on retrouve encore les Beni-Amer, puis les Angad jusqu'au Maroc.
Au sud de l'Yacobia, des Djafra et des Angad, s'étendent, de l'est à l'ouest, deux longues sebkah ; la première s'appelle Chot-el-Chergui et la seconde Chot-el-Gharbi. Au sud de ces Chot erre la grande tribu des Hamian, et, à l'est, celle non moins considérable des Harar. Les petites villes de Frenda, de Taourzout et de Godjilah, sont au nord des Harar.
Au sud des Chot, on rencontre la chaîne atlantique méridionale, puis le Sahara, dont la partie que l'on peut considérer comme appartenant à la province d'Oran comprend la tribu des Ouled-Sidi-Chirk, la petite ville de Berizina, et quelques autres lieux habités de peu d'importance. La population totale de la province d'Oran a été évaluée à près de 500.000 âmes.
Cette province était, à l'époque où le général Boyer en prit le commandement, livrée à la plus horrible anarchie. Un vague désir d'indépendance nationale fermentait dans toutes les tètes, mais il y avait encore absence d'unité dans la volonté et le commandement. La ville de Mascara s'était révoltée contre les Turcs, qui avaient cru pouvoir s'y maintenir après la chute du dey, et, après les avoir chassés, égorgés, s'était constituée de fait en république. Celle de Tlemcen était partagée entre les indépendants, qui occupaient la ville, et les Turcs et les Koulouglis, qui étaient maîtres de la citadelle. Mostaganem avait reconnu notre autorité, grâce à un officier turc fort habile, le kaïd Ibrahim, que nous avions pris â notre service, et que le colonel Lefol y avait envoyé à la tète de quelques centaines de soldats de sa nation. Arzew était également assez bien disposée pour nous, et le cadi, qui s'y était emparé de toute l'autorité, était en bonnes relations avec Oran. Tout le reste de la province nous était plus ou moins hostile, mais manquait de centre d'action. Les chefs les plus influents étaient : Ali-el-Galati, de Millas, El-Bagdadi, kaïd d'Ataf, Mustapha et El-Mezary, chefs des Douer et de Zemela, Miloud-ben-Arach, de la tribu des Garraba, et, enfin, le marabout Mahiddin et son jeune fils Abd-el-Kader, appelé à jouer plus tard un si grand rôle.
Rappel du général Berthezène.
M. le général Berthezène ne s'occupa jamais que fort indirectement de la province d'Oran. Il voulut cependant y envoyer Mustapha-ben-Omar, dont il ne savait que faire après l'avoir retiré de Médéa, mais le général Boyer refusa de l'employer. Peu de temps après, M. Berthezène fut remplacé par M. le duc de Rovigo.
A SUIVRE
|
|
PHOTOS
Anciennes de BÔNE
Envoyé par M. Charles Ciantar
|
Vue de Bône en 1847

Vue du Port de Bône après 1850
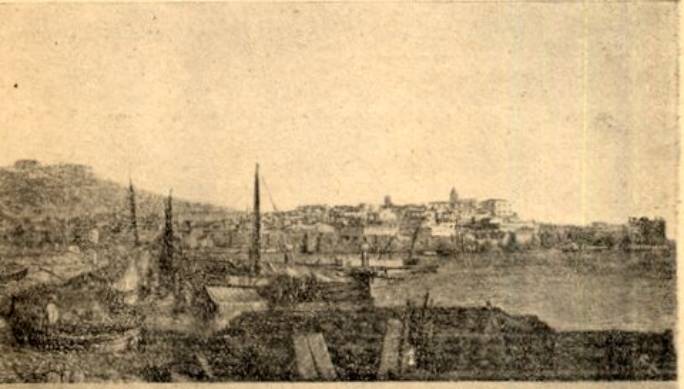
L'Equipe d'Aumale en 1929

|
|
| Ainsi va la vie!!!
Envoyé Par Jean Claude
| |
Gardien de la Paix : 1 600 euros pour risquer sa vie
Pompier professionnel : 1 800 euros pour sauver une vie
Instituteur : 1 600 euros pour préparer à la vie
Médecin : 5 000 euros pour nous maintenir en vie
Sénateur : 19 000 euros pour profiter de la vie
Ministre : 30 000 euros pour nous pourrir la vie !!!
|
|
|
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793) (N°12)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
TROISIÈME PARTIE
LA PAIX AVEC LES BARBARESQUES
ET SES PREMIERS RÉSULTATS (1690-1740)
CHAPITRE X
LES PREMIÈRES COMPAGNIES D'AFRIQUE (1706-41)
(1690-1706)
Malgré les difficultés et les inquiétudes du moment, une compagnie finit par se former, en 1706, sous le nom nouveau de Compagnie d'Afrique ; il ne devait plus y avoir désormais de compagnies du Bastion, ni du cap Nègre. Toutes les Concessions d'Afrique devaient être groupées dans les mains.
La première compagnie d'Afrique fut reconnue par un arrêt du Conseil du 9 octobre 1706 ; elle était constituée pour six ans seulement. Elle devait racheter, dans le délai d'un an, moyennant 150.000 livres, prix conventionnel qui devait toujours être stipulé dans la suite, les établissements du cap Nègre, Bastion, de France et leurs dépendances. Il était, en outre, stipulé que tous les bâtiments, propriétés, armes et munitions de guerre desdites places, lui appartiendraient, sans qu'elle pût être inquiétée, ni évincée, pour aucune raison, par les créanciers des anciennes compagnies et que ceux-ci ne pourraient, sous aucun prétexte, agir contre elle, en raison de leurs créances. Le roi lui accordait des privilèges exceptionnels : l'entière exemption pour les marchandises venant de Barbarie, du droit de cottimo, dont les anciennes compagnies payaient la moitié, ainsi que des droits de convoi, table de mer, poids et casse, et autres, qui étaient payés à Marseille. En outre, les intéressés étaient déchargés de toutes les fonctions publiques. Son capital, divisé suivant l'ordinaire, en 20 sols, était de 400.000 livres, chaque sol revenant à 20.000 livres. La Compagnie entra en possession des Concessions, le 1er janvier 1707 ; elle avait pour directeur, à Marseille, le sieur Chavignot et pour gouverneur à la Calle J.-B. Fénix. Il semble que, comme les années précédentes, l'exploitation du cap Nègre fut la plus importante. Comme sa devancière, la Compagnie d'Afrique eut, à diverses reprises, des difficultés avec le bey. Elle ne put l'empêcher, en 1707, de concéder à des pécheurs napolitains et siciliens, la pêche du corail à l'île de la Galite, située au nord de Tabarque, sous prétexte que la Compagnie n'y avait pas d'établissements. Pour faire cesser cette concurrence, Pontchartrain proposa d'envoyer dans les parages de l'île quelques patrons corailleurs.
Il est à remarquer, en effet, que, depuis l'échec du premier essai fait par la Compagnie Gautier, en 1686-87, les Français semblaient avoir renoncé à l'exploitation du monopole de la pêche qui leur avait été concédé par le traité de 1685, et laissaient le champ libre aux corailleurs de Tabarque dans les eaux tunisiennes.
Après un an d'efforts, le consul Sorhainde finit par obtenir du bey sa parole de ne plus écouter aucune proposition au sujet de la pêche du corail. Les corailleurs italiens profitaient de la connivence du gouverneur de Tabarque, qui donnait asile aux felouques siciliennes. En cette occasion, le bey soutint la Compagnie parce qu'il y était intéressé. " Il a témoigné de ces faits un vif déplaisir, écrivait Sorhainde et un grand ressentiment contre Tabarque, dont il a juré la ruine. " Cet échec n'empêcha pas les Siciliens de renouveler maintes fois, dans le courant du XVIIIe siècle, leurs tentatives pour obtenir la concession de la pêche qu'ils pratiquèrent toujours clandestinement.
A deux reprises, la cour de France ne put obtenir satisfaction du bey. En 1706, M. de Gastines, intendant de la marine, envoyé en inspection dans les Echelles du levant, passa à Tunis pour y faire différentes réclamations, pour demander le paiement des dettes de l'ancien bey à la Compagnie du cap Nègre en liquidation, et, en attendant, la suspension des lismes. La négociation échoua et, à son retour des échelles, de Gastines essaya en vain de la renouer. Le bey s'obstina à ne vouloir lui donner audience au Bardo qu'à la condition qu'il retirât ses chaussures, et l'envoyé du roi partit, laissant au consul le mémoire de ses réclamations; le bey finit par déclarer qu'il n'entendait pas répondre des dettes de ses prédécesseurs.
L'année suivante, surgit un conflit plus grave : le bey prétendit obliger la Compagnie à lui acheter 1000 kaffis de blé. Le sieur La Pérouze, directeur du cap Nègre, fut révoqué par la Compagnie pour avoir consenti à ce marché, mais le bey s'étant mis fort en colère, on jugea prudent de maintenir le directeur. Les désastres de la guerre de succession obligeaient le gouvernement royal à bien des ménagements. Pontchartrain écrivait à Lebret, en 1709, qu'il approuverait tout ce qu'il se déterminerait à ordonner pour " parer aux nouvelles difficultés, suscitées par l'avarice du bey ", mais il devait se souvenir que S. M. ne voulait pas recourir à la violence pour amener ce prince à composition. C'était l'année du grand hiver et de la famine ; un mémoire rappelait plus tard, en 1730, que Lyon et le Dauphiné se " ressentirent " des envois de blé faits par le cap Nègre et " que la Provence aurait été réduite à la famine sans le secours de cette colonie. "
Cependant, à la fin de 1710, les affaires du roi étaient en meilleur état ; on put envoyer à Tunis trois vaisseaux de guerre, commandés par le capitaine de frégate Laigle ; l'un d'eux avait été armé par la Compagnie d'Afrique elle-même. " S. M., écrivait Pontchartrain au consul, a résolu de déclarer la guerre aux Tunisiens s'ils ne font immédiatement réparation de tant d'injustices ". Celles-ci étaient énumérées dans un mémoire adressé à Sorhainde, en date du 15 octobre 1710.
Michel, l'ambassadeur qui venait de signer le premier traité de commerce avec la Perse, s'embarqua sur les vaisseaux du roi pour aller négocier avec le consul. Le bey ne tenait pas à se brouiller avec la France ; il fit bon accueil à Michel, s'excusa publiquement des violences exercées et renouvela pour cent ans, le 16 décembre 1710, le traité de 1685. Mais, au sujet des griefs de la Compagnie d'Afrique, les pourparlers durèrent plus longtemps ; ce n'est que le 3 juin 1711 que fut signée une nouvelle convention, relative au cap Nègre. Le bey n'y abandonnait pas toutes ses prétentions puisqu'il en confirmait la possession à la Compagnie, moyennant qu'elle s'obligeât, outre le paiement des lismes accoutumées, à lui prendre annuellement 1,000 kaffis de blé à 10 piastres le kaffi. Dans tous ces démêlés, le consul Sorhainde avait paru manquer de fermeté à cause de son grand âge ; il fut remplacé par Michel lui-même, en 1711, sur la demande de la Compagnie d'Afrique. Si le bey avait pu montrer ces exigences, c'est qu'il connaissait les besoins en blé des puissances chrétiennes en guerre. En 1709, les Anglais et les Français s'étaient disputé l'achat de toute la récolte avant même qu'elle fût faite.
Pendant les famines de 1708 et de 1709, la pénurie croissante des grains, malgré les apports de la Barbarie et du Levant, fit de nouveau accuser la Compagnie de songer plus à ses intérêts qu'à soulager la misère du royaume. Desmaretz, hostile à la Compagnie comme Chamillard, écrivait à Pontchartrain, le 31 octobre 1708, que, malgré la parole qu'il lui avait donnée, le directeur Chavignot avait vendu une quantité considérable de blé en Espagne, ainsi que le sieur Roze, l'un de ses associés : " La conduite de cette Compagnie, ajoutait-il, semble obliger à prendre le parti de lui défendre de vendre ses blés ailleurs qu'a Marseille. Ce sera un moyen pour la rendre utile dans les temps qu'elle le peut être, puisqu'on souffre tant de son commerce en d'autres temps. " Pontchartrain, bien disposé au contraire, comme son père, excusa la Compagnie : c'était lui qui n'avait pas cru pouvoir refuser un faible secours en blé aux sujets du roi d'Espagne, privés de toute ressource par la perte de la Sardaigne. Il affirmait que, depuis 1691, les opérations de la Compagnie avaient été " d'une utilité infinie " à la Provence. L'intendant, Lebret le fils, qui renseignait les deux ministres, jouait à cette occasion un double jeu ; c'était lui qui donnait au contrôleur général des avis hostiles, à l'insu du ministre de la marine. Desmaretz écrivait, en effet, à Lebret, le 9 novembre, après avoir reçu les explications de Pontchartrain : " Comme j'ai observé de ne vous point nommer... à M. de Pontchartrain, vous pouvez continuer à me marquer avec confiance ce que vous penserez sur cette matière. " Lebret répondait, le 26, qu'il ignorait en quoi la Compagnie avait rendu des services, ayant, de 1693 à 1703, fait sortir 9.000.000 de livres du royaume pour des marchandises qu'on se serait procurées en Levant, par voie d'échange. Quant au blé, elle n'en avait jamais fourni que peu à la fois, pour le maintenir ai un haut prix et ce peu aurait pu être apporté sans qu'elle s'en mêlât. "
En décembre 1708, la pénurie de blé était devenue telle que les Marseillais s'opposèrent fortement à la sortie de 12 à 15.000 quintaux, que le prévôt des marchands de Lyon avait achetés à la Compagnie d'Afrique. Celui-ci n'osa pas demander des ordres pour les contraindre, de peur de causer quelques troubles(1). Aussi, l'année suivante, pour assurer l'approvisionnement de Lyon, le contrôleur général songea à former une société de négociants de Lyon et de Marseille pour faire venir des blés de Barbarie, du Levant et des autres pays étrangers. Lebret, redoutant l'opposition de tous les négociants marseillais à un tel projet, conseilla au ministre de les laisser maures de la traite des blés et de donner tout pouvoir à un bureau d'abondance qu'il formait à Marseille. " Je doute fort, lui disait-il, qu'une Société de Lyonnais et de Marseillais puisse réussir. Les Marseillais, entre eux, ne peuvent presque jamais s'accorder et ils sentent si bien que leur humeur ne s'accommode pas aisément avec celle des autres qu'ils fuient autant qu'ils peuvent les sociétés. Je ne trouve pas qu'ils aient tort, car il n'y a pas d'exemple qu'aucune Compagnie ait bien réussi à Marseille(2). En effet, l'association projetée ne réussit pas.
Cependant, les difficultés créées par la guerre et les perles qu'elle avait faites ne permettaient guère à la Compagnie d'Afrique de donner à la traite des blés toute l'activité qui eût été nécessaire. Pontchartrain l'encourageait de tout son appui. Il écrivait à Lebret " d'employer toute son influence pour lui fournir du crédit et des fonds. "
Par suite du désarroi de notre marine marchande et de la navigation, il était difficile de trouver des bâtiments en temps utile. En 1709, le roi accorda ü la Compagnie 10 frégates pour transporter ses blés. L'année suivante, Pontchartrain invitait la Chambre de Commerce à lui procurer le plus possible de navires pour aller charger les blés dont ses magasins des Concessions étaient encombrés.
Le ministre alla même jusqu'à vouloir obliger tous les bâtiments du port de Marseille d'effectuer un voyage pour le compte de la Compagnie, avant de pouvoir être affrétés par des particuliers, mais cette mesure singulière souleva une protestation unanime des négociants marseillais :
" Il est extrêmement nécessaire, écrivaient-ils dans leur mémoire de 1711, de représenter à la Cour la nécessité qu'il y a de révoquer l'ordre qu'elle a donné.... puisqu'il culmine nécessairement avec soi une suspension de tout le commerce... C'est une société en commandite de quelques négociants avec un fonds de 400.000 livres, somme assez modique avec laquelle cette Compagnie n'aurait pas seulement été en état de commencer son commerce sans les ressources.... les autres négociants desquels elle emprunte journellement....
La disette dont ce royaume fut affligé, il y a deux ans, fut une occasion en laquelle on a pu voir combien les moyens de cette Compagnie sont limités, puisque tous les efforts quelle a pu faire n'ont jamais pu arriver à donner la sixième ni, peut-être, la dixième partie des blés que le reste des négociants de cette place ont eu moyen de tirer de tous les ports du levant, à quoi l'on peut ajouter encore, sans faire aucune violence à la vérité, que la plupart des blés que cette Compagnie fit venir dans cette occasion étaient si mauvais, qui ils étaient plus propres à causer des maladies au peuple, qu'a lui servir de nourriture, et, en effet, elle charria tous les vieux reliquats de ses magasins dont elle ne pouvait raisonnablement espérer ne faire jamais un sol... Ainsi cette Compagnie a très mauvaise grâce et on peut même dire qu'elle est bien ingrate et bien injuste de vouloir s'attribuer tout le négoce des blés, en prenant de force les bâtiments des particuliers pour son service. "
Cette vive diatribe, un des nombreux documents qui prouvent l'ardeur de la persistante rivalité entre les négociants particuliers et les Compagnies privilégiées, était appuyée de nombreux autres arguments. Le conseiller d'État, de Harlay, à qui on la remit pour l'examiner, écrivait au contrôleur général Desmaretz, le 31 octobre 1711 :
On ne m'a point écrit par qui ces ordres avaient été donnés, si c'était par vous, monsieur, ou par M. de Pontchartrain, mais, de quelque part qu'ils viennent, il est certain que l'affaire mérite beaucoup d'attention.... j'aurai seulement l'honneur de vous dire, en général, que les privilèges exclusifs paraissent bien peu favorables et bien contraires à l'utilité et à la liberté publique, qu'il me semble que c'est ce dernier point, c'est-à-dire la liberté, qui produit ordinairement l'abondance si désirable à toutes choses, particulièrement en fait de blés, enfin qu'il semblerait que l'intérêt de quelques particuliers et d'une compagnie qu'on prétend peu utile.... ne devrait point prévaloir à celui de toute une ville aussi importante que Marseille(3). "
C'est déjà le langage des économistes du XVIIIe siècle qu'on commençait à parler et à lire lors du règne de Louis XIV.
Dans ce conflit, rendu plus vif par la disette de 1709 et la triste situation du commerce, il n'est que juste de reproduire, à côté des accusations portées contre la Compagnie, les justifications qui elle adressait au ministre, en réponse aux plaintes des échevins de Marseille en 1710 :
" Il est surprenant que MM. les échevins de cette ville vous mandent que nous les laissons manquer de blé, presque dans le temps qu'il nous en est venu trente mille charges dans l'espace d'un mois. Il est vrai, Monseigneur, qu'ils n'ont pas voulu le laisser vendre dans la ville, parce que leur bureau d'abondance voulait débiter celui qui lui restait des provisions faites pendant l'hiver, de façon que nous avons été dans la nécessité d'en envoyer la plus grosse partie du côté d'Arles et en Languedoc... L'empêchement que MM les échevins ont apporté à la vente de nos blés en celte ville a été très favorable et d'un grand secours nu Languedoc, car, si nous n'en avions pas fait passer 20,000 charges an mois de juin dernier, les villes de Montpellier, Lunel, Nîmes, Béziers et bonne partie des Cévennes auraient été réduites, quoique touchant à la récolte, à de grandes extrémités...
Cependant, pour rassurer MM. les échevins sur la prétendue crainte où ils étaient de manquer de blé, si nous faisons passer tout le nôtre dehors, nous nous engageâmes d'en laisser 8,000 charges pour être vendues dans la ville après qu'ils auraient débité le leur ; cela a été ponctuellement exécuté de notre part.
Mais comme les blés de Barbarie ne sauraient absolument se conserver dans les chaleurs de l'été, il sen est trouvé dans nos magasins une partie d'échauffé, ce qui a sans doute donné occasion à MM. les échevins de mander à V. G. que le peu que nous en avions était de mauvaise qualité ; il devaient du moins ajouter cette circonstance que cela provenait de les avoir trop longtemps gardés en magasin, faute par eux de nous avoir permis de les débiter ; en effet, Monseigneur, ces blés d'Afrique que les Maures serrent dans des matamores et où ils les conservent pendant 30 ans, s'échauffent dès qu'on les enterre en été et ils ne sauraient ensuite se conserver dans les chaleurs ; cependant nous devons ajouter que, depuis qu'on tire des blés de Barbarie, il n'en est jamais venu de si beau ni de meilleur que celui de la récolte dernière et, si MM. les échevins en avaient voulu faire la provision de la ville, au lieu de se charger de mauvais blés du Levant comme ils ont fait, le peuple aurait mangé de meilleur pain et a beaucoup meilleur marché, car nos blés font une production beaucoup plus forte que ceux du Levant, cela est de notoriété publique en ce pays. "
Les échevins, ajoutait la Compagnie, feraient mieux de leur payer 100.000 écus qu'il lui devaient. Voulaient-ils la mettre dans l'impossibilité de continuer son commerce. Pourtant jamais l'utilité de ses établissements n'avait paru plus grande que depuis un an, car elle avait tiré près de 120,000 charges de grains dans 14 ou 15 mois, ce qui ne s'était jamais fait. Jamais les colonies ne seraient régies par des gens qui se prévalaient moins qu'elle de la disette, avant vendu les blés à moindre prix que ceux du Levant, quoique infiniment meilleurs(4).
On calculait que les bénéfices du cap Nègre sur les blés étaient de 326.000 livres. En outre, la Compagnie pouvait faire des profits importants sur la pêche du corail. Elle possédait, en 1707, 40 bateaux corailleurs pêchant chaque année 160 caisses de corail, pesant 150 livres chacune(5). Mais c'étaient là des comptes supposés dressés dans l'hypothèse d'un commerce normal. En réalité la durée de la guerre, malgré les famines de 1708 et 1709 et l'importance de la traite des blés, avait rendu les opérations de la Compagnie très désavantageuses.
Arrivée au terme des six années de sa concession, en 1712, elle ne songea pas à la renouveler. Le roi avait chargé l'intendant Arnoul de recevoir les propositions de ceux qui se présenteraient pour prendre sa succession. On songea alors à former de nouveau deux sociétés, " mais quelques-uns uns des plus riches négociants de Marseille se chargèrent de faire valoir, sans les diviser, les établissements de Tunis et autres lieux de Barbarie aux mêmes clauses et conditions que celles de la Compagnie d'Afrique(6). " La nouvelle compagnie, constituée aussi pour six ans, dut payer comme la précédente 150.000 livres pour les places des Concessions ; son fonds social était de 720.000 livres; il était composé de 24 sols revenant à 30.000 livres par sol. L'arrêt du 15 août 1712, qui reconnaissait son privilège, fixa au 1er janvier 1713 le commencement de ses opérations(7). La seconde compagnie d'Afrique débuta heureusement en signant avec le bey de Constantine, le 15 juillet 1714, une convention dont on n'a pas encore compris l'importance. Jusque là, la traite des blés avait été passée sous silence dates toutes les conventions relatives au Bastion ; les Français n'avaient le droit d'en acheter que pour l'approvisionnement de leurs comptoirs. Le traité de 1679 et celui de 1694 avaient permis, en outre, d'en envoyer deux barques en France, pour la nourriture des femmes et des enfants des employés de la Compagne: Pour la première fois, la convention de 1714 autorisait formellement le commerce des blés et fixait les conditions auxquelles il pourrait être fait à la Calle et dans ses dépendances. Voici les principales clauses de ce traité conclu par Assen bey(8) et le sieur Demarle, gouverneur de la Calle :
En considération des services que notre ami Demarle a rendus au divan et milice d'Alger, il lui est permis de faire mesurer du blé, orge et fèves dans notre ville de Bonne, Tarcut et autres échelles de notre dépendance, sans qu'il puisse être troublé par gens du pays, habitués et non habitués aux dits lieux, ou autres marchands, sous quelque prétexte que ce puisse être (Art. 1).
Sera payé pour tous droits au seigneur bey une piastre pour chaque kaffis de blé et demi piastre pour chaque kaffi d'orge ou de fèves (Art. 2).
Sera payé au caïd de Bonne 50 piastres pour chaque vaisseau qui chargera du blé et 25 piastres par barque (art. 3).
Sera payé encore aux Turcs de la Cassabe de lionne 25 piastres par vaisseau et 12 1/2 par barque (art. 4).
Il est permis au sieur Demarle de payer le prix du blé sur le pied de la rabe, même d'y mesurer si bon lui semble, et de prendre sur le même pied, celui des habitants de Bonne et gens du pays, sans que personne puisse en prétendre un plus haut prix (art. 6).
Il n'aura rien à payer pour le blé qu'il mesurera à la rabe attendu que ce droit est dû par le vendeur (art. 7).
Ne pourra aucun bâtiment étranger, de quelque nation que ce puisse être, même aux musulmans, faire aucun chargement de blé, orge, fèves, dans ladite ville de Bonne, Tarcut, et autres endroits ci-dessus désignés, sous quelque prétexte que ce soit (art. 8).
Et attendu que ledit commerce est un gros avantage pour la maison du roi et pour nous, enjoignons à l'aga de Bonne et à notre caïd, de tenir la main pour que ledit Demarle ne soit inquiété par qui que ce soit dans son commerce (art. 10).
Sur la plainte que ledit sieur Demarle nous a faite que tous les sandals qui vont de Bonne à Tabarque y portent des marchandises à lui concédées par son ottoman d'Alger, voulons que ceux de Bonne touchent en passant à la Calle pour y être visités et qu'ils en rapportent un certificat au commis de Bonne, et ceux étrangers qui chargeront audit Bonne ne puissent le faire qu'en présence des chaoux et des Turcs du calife et du truchement des chrétiens et partent ensuite de jour et non de nuit et, en cas de contravention, que les sandals à leur retour soient faits beylicks et les raïs châtiés(9) (art. 11).
Malgré les redevances stipulées, ce traité était très avantageux : le monopole de la traite des blés, accordé aux Français, était encore solennellement affirmé dans un article additionnel :
" C'est ici notre ordre et notre traité donné au sieur Demarle avec lequel nous avons convenu qu'il mesurera le blé de la ville de Bonne au prix courant des habitants et comme il se vend au marché public sans qu'aucun puisse le lui faire augmenter, en nous payant les droits suivant l'usage accoutumé, et que personne des autres nations en puisse prendre, soit Grecs, Hollandais, Génois, et autres, qui ne pourront faire mesurer du blé au port dudit Bonne, ni autres ports qui sont dans notre pays, mais seulement les Français, bien entendu que, suivant l'ancien usage, personne ne pourra acheter qu'eux la cire, la laine, les cuirs et autres choses à eux affectées, sans que personne puisse les traverser en rien et, si quelqu'un les traverse, ce sera tant pis pour lui, leur ayant donné cet écrit auquel on doit faire attention. Moyennant ce que dessus nous avons convenu avec ledit Demarle et accordé qu'il prendra de nous 200 kaffis de blé toutes les années, au prix de 10 piastres chaque kaffi.
Cette convention allait rendre le premier rôle aux établissements d'Algérie, sacrifiés depuis 20 ans au cap Nègre, à cause de l'importance nouvelle attachée au commerce des blés(10).
En même temps, Duquesne Monnier, chef d'escadre, était venu renouveler à Tunis, en 1713, le traité centenaire de 1710. Grâce au rétablissement de la paix européenne, l'influence française chancelante était de nouveau bien établie chez les Barbaresques. Cependant, en dépit des traités et des conjonctures meilleures, la Compagnie eut fort à se plaindre à la fois des Algériens et des Tunisiens.
En 1713, les indigènes des montagnes voisines de la frontière d'Alger et de Tunis vinrent attaquer la Calle ; il y eut cinq pêcheurs de corail tués, trois blessés et trois prisonniers. On avait assez souvent à déplorer des incidents de ce genre ; ni le bey, ni le dey, ne pouvaient être rendus responsables de la conduite de tribus indisciplinées et on ne pouvait songer à " châtier ces Maures qui habitaient des montagnes inaccessibles. " Le seul moyen de s'en garantir était de faire bonne garde à la Calle pour éviter les surprises.
Mais le bey de Tunis ne cessa de mettre des entraves à la traite des blés. En 1713, il l'interdit même complètement, afin de " pouvoir le vendre plus cher aux Catalans et autres étrangers. " " Depuis l'avènement d'Hossein ben Ali, écrivait le consul Michel, le 16 juillet 1714, la liberté du commerce a cessé avec la bonne foi ; le bey est le seul marchand de cet État, il achète tout de ses sujets et nul autre que lui ne peut vendre aux chrétiens. " La paix permettait à la cour de France d'agir énergiquement ; l'interdiction du commerce avec Tunis n'ayant pas produit d'effet, Pontchartrain se décida à une démonstration navale. Duquesne Monnier se rendit à Tunis avec un délégué de la Compagnie d'Afrique et parla avec hauteur ; le bey, craignant une rupture, montra de meilleures dispositions.
Mais la connivence des marchands français établis à Tunis, rivaux de la Compagnie et toujours jaloux de son monopole, permettait au dey " de ruiner entièrement son commerce, en lui fournissant les moyens d'acheter de la première main, en société avec eux, les blés de ses sujets, et de les revendre ensuite à de hauts prix aux commis de la Compagnie, ce qui la mettait hors d'état de soutenir ses engagements et de faire venir, en Provence et dans les provinces voisines, la sixième partie des grains que l'on avait tirés jusqu'à présent de ses Concessions. " Pour couper court à cette concurrence déloyale, une ordonnance du roi, du 31 octobre 1714, défendit à " tous capitaines, patrons ou négociants français de commercer, directement ou' indirectement, dans l'étendue du gouvernement de Tunis pendant six mois, à peine de confiscation des bâtiments et chargements, au profit de la Compagnie. "
L'interdiction du commerce, destinée à alarmer le bey et à lui faire craindre une rupture, fut prolongée pendant toute l'année 1715 et le printemps de 1716. Une visite des vaisseaux du roi, en décembre 1715, et la mission de Duquesne Monnier accompagné du sieur de Maillet, chargé de demander le redressement des griefs du commerce français, continrent un moment les Tunisiens dans le devoir(11). L'envoi de cette escadre avait un moment donné des inquiétudes à notre consul au sujet du cap Nègre.
" Il serait à craindre, écrivait-il au conseil de marine, que les Puissances, qui souhaitent depuis longtemps de faire valoir elles-s le commerce de cette colonie, ordonnassent secrètement aux Maures des environs de saccager la place, quitte à s'en excuser ensuite, en arguant que les Maures savaient qu'il y avait des bombardes françaises à la Goulette et n'avaient pu douter de la rupture entre la France et Tunis. "
Duquesne Monnier et de Maillet avaient été chargés, en même temps, d'une mission analogue à Alger. Tout en obtenant le redressement de divers griefs dont se plaignaient la Compagnie et les marchands, Duquesne pionnier échoua en partie dans sa mission par son trop de raideur, car il ne put renouveler les traités de paix, comme il en était chargé, en y faisant insérer de nouveaux articles, pour assurer au commerce des garanties plus solides.
Outre les diverses vexations dont elle s'était plainte, la Compagnie n'avait pu faire respecter son monopole, ni pour la pêche du corail, ni pour la traite des blés. En 1713, le bey de Tunis, qui avait accordé en 1709, aux Siciliens, l'île de la Galite pour la pêche du corail, fit avec eux un nouveau traité. Il permettait aux coralines de Sicile d'aborder à Bizerte et de faire la pêche du corail, de là jusqu'au cap Blanc, à la condition que tout le corail serait mis en magasin à Bizerte. En 1714, en vertu d'un nouveau contrat, les Siciliens s'établirent au cap Roux, tout près du cap Nègre et de Tabarque. Dans le mémoire de ses griefs, remis en 1717, la Compagnie accusait aussi le dey d'Alger de laisser les Siciliens se livrer à la pêche du corail, malgré le traité de 104. Contrairement à l'accord conclu en 1714, il faisait de grandes difficultés pour la sortie tics grains et la Compagnie était obligée, comme auparavant, de " prétexter la nourriture des pêcheurs de corail " pour emmagasiner de grandes provisions de grains.
En même temps, la Compagnie était violemment attaquée en France. En 1716 fut porté devant le Conseil de commerce un grand débat, au sujet de l'utilité des compagnies d'Afrique et de l'introduction des blés de Barbarie dans le royaume, en dehors des cas de disette. La question fut soulevée par un article d'un cahier présenté par les États de Languedoc, sur lequel M. de Machault, le père du futur ministre, lut un rapport intéressant, favorable à la Compagnie, à la séance du 15 octobre 1716 :
Par le 5e article, les États de Languedoc demandent qu'il soit défendu à la Compagnie d'Afrique d'apporter à Marseille des blés de Barbarie et que, dans les temps de disette, il soit permis, tant aux sujets du roi qu'aux étrangers, d'introduire dans le royaume des blés, sur des permissions générales ou particulières qui leur seront accordées. Sur quoi, il a été observé que la province de Languedoc prétend que la mortalité des oliviers arrivée en 1709, la cessation de ses manufactures et le peu de profit qu'elle peut tirer de la vente de ses vins et eaux-de-vie, ne lui laissent actuellement aucune autre ressource que la vente de ses blés, pour payer les impositions qui sont presque aussi fortes que pendant la guerre.
Que, depuis la paix, les années de Catalogne et d'Italie ne faisant plus la consommation de ses grains, il faut nécessairement qu'elle se fasse dans les provinces voisines… afin que la culture des terres… qui n'est déjà que trop négligée dans plusieurs cantons du Languedoc n'y soit pas abandonnée ; que le Languedoc, qui recueille année commune le double de ce qu'il faut de grains pour la nourriture de ses habitants, offre d'en laisser perpétuellement le commerce libre avec la Provence, de façon que, s'il survenait quelque disette, qui est un cas fort rare, et par conséquent qui ne doit pas faire de règle, les deux provinces auraient égal intérêt de pourvoir à leurs besoins communs.
Qu'on ne peut révoquer en doute que le commerce de la Compagnie d'Afrique, qui fournit des blés de Barbarie à Marseille, est ruineux pour l'État, puisqu'il ne se fait qu'avec de l'argent, qu'il fait tort aux autres provinces quand elles ont des blés superflus et qu'il n'est point utile à Marseille, quand les blés manquent dans le royaume ainsi qu'il arriva en 1709, auquel temps plusieurs négociants particuliers du Languedoc et de la Provence entreprirent d'aller chercher dans l'Archipel et dans les échelles du Levant des blés… Et puisqu'on ne leur en refusa pas alors, quoiqu'ils n'eussent jamais fait ce commerce, c'est une preuve certaine que, dans des temps de disette, cette ressource ne manquera pas, qu'enfin cette demande n'est pas nouvelle puisque, sur la requête des habitants de Languedoc et mène ceux de Provence, intervint, le 12 août 1634, un arrêt et un commandement qui Interdit aux sujets du roi de faire aucun commerce de blés étrangers, soit dedans, soit hors du royaume.
Que MM. les intendants de Dauphin et de Lyon et même la ville d'Arles adhèrent à la demande des États de Languedoc et ajoutent que la Bourgogne et le Dauphiné sont aussi à portée de fournir des blés en la Provence, où il est surprenant qu'on souffre que la Compagnie d'Afrique introduise des blés étrangers, pendant que tous les ports du royaume sont ouverts pour la sortie des nôtres, avec exemption de droits, parce qu'on est persuadé qu'ils font la première richesse de l'État et qu'il est à désirer que le prix n'en soit point trop bas.
Que M. Lebret, les maire et échevins de la ville de Marseille et la Compagnie d'Afrique ont représenté, au contraire, que chez aucune nation on n'avait exercé de contrainte pour l'aliment le plus nécessaire à la vie. Que, depuis 300 ans, il y a une compagnie de négociants français pour la pêche du corail sur les côtes de l'Afrique, que, sur la fin du seizième siècle, ce commerce fut étendu en celui des cires, cuirs, laines et grains, mais que les Turcs, ne permettant jamais ouvertement la sortie de leurs grains pour les chrétiens.... la Compagnie bâtit des forts pour y faire des magasins de grains sous prétexte de la nourriture de ceux qui pêchent le corail. Que cette Compagnie a été perpétuellement soutenue et favorisée parce qu'on a reconnu, dans tous les temps, qu'il était avantageux de conserver les postes dont elle est en possession; que, si elle les abandonnait, les Anglais s'en rendraient les maîtres dès le lendemain, aussi bien que du commerce des blés, ce qui les mettrait en état d'en faire des magasins au port Mahon, où nous avons tout sujet de craindre qu'ils n'augmentent leurs établissements, et la ville de Marseille dans ses besoins n'en pourrait plus avoir qu'en passant par leurs mains, de sorte que, quand nous serions en guerre avec l'Angleterre, la Provence se trouverait dénuée d'un secours qui, seul, la fait subsister depuis très longtemps, parce qu'elle ne recueille jamais des blés pour nourrir ses habitants pendant le tiers de l'année.
Que l'abondance des récoltes dans les provinces de Languedoc et autres provinces est très incertaine... Que les blés du Languedoc et autres étant de meilleure qualité que ceux d'Afrique sont toujours préférés dans Marseille ; que la Compagnie d'Afrique, à cause des frais qu'elle est obligée de faire et des redevances qu'elle paie au bey de Tunis et au divan d'Alger, ne pouvant sans perte vendre ses blés moins de 17 à 18 livres, les habitants du Languedoc sont toujours en état d'y vendre leurs blés ce même prix dont ils doivent être satisfaits.... Qu'il n'est pas aisé de concevoir qu'il soit praticable de retrancher à la Provence, qui recueille le moins de blés, une liberté dont ont toujours joui celles qui en produisent le plus, telles que la Bretagne, Normandie, Saintonge et Picardie, dans les ports desquelles on n'a jamais défendu l'entrée des blés étrangers, afin d'empêcher que quelques particuliers, en faisant des amas de blé, ne se rendent les maîtres du prix et que la concurrence des blés étrangers, lorsqu'elle est nécessaire, les force à se relâcher....
" Par ces considérations, il a paru qu'on devait absolument laisser à la Provence la faculté perpétuelle de faire venir des blés étrangers ; mais, comme on a appris que le blé de l'Afrique coûte actuellement dans Marseille 17 à 18 livres le setier de 240 livres pesant, pendant que celui de blé de Languedoc ne vaut sur le lieu que 8 livres, il convient de tâcher de pénétrer ce qui peut produire une différence aussi énorme du prit des blés dans deux provinces limitrophes et de faire cesser les abus qui se commettent à cet égard, comme aussi de faciliter le commerce des blés, tant de Languedoc que du Dauphiné et de Bourgogne, avec la Provence, par la diminution des droits dus aux fermes et des péages qui, avec les frais de transport, en augmentent trop considérablement le prix. "
Au milieu de ces tribulations et de cette insécurité, le commerce de la Compagnie avait passé par une série de fluctuations. Au début de 1714, elle se plaignait amèrement de l'état peu satisfaisant de ses affaires ; elle demandait au ministre la permission d'abandonner les comptoirs de Tunisie. A la fin de la même année, elle déclarait que ses magasins du cap Nègre étaient pleins et que les choses allaient à souhait. " Si la Compagnie avait été prise au mot, écrivait le consul de Tunis à Pontchartrain, lorsqu'elle a demandé à résilier son traité avec le cap Nègre, il est certain qu'elle le regretterait aujourd'hui, car cette colonie donnera à elle seule, cette année-ci, des bénéfices considérables. " Cependant l'ensemble de ses opérations fut très désavantageux, comme le montre le bilan du 31 décembre 1717, reproduit par Bonnassieux : elle avait perdu 429.500 livres et elle comptait 335.000 livres de fonds accrochés, c'est-à-dire immobilisés ; il ne lui restait donc absolument rien de son capital pour continuer son commerce(12). Elle prévoyait des pertes encore plus considérables à la fin de son bail, c'est-à-dire pour l'année 1718. Aussi ne montra-t-elle aucun désir de le renouveler. Elle proposa au Conseil de marine, comme elle l'avait fait déjà en 1714, d'abandonner le cap Nègre pour se consacrer aux Concessions des états d'Alger. Mais on lui répondit que le bien du service s'opposait à cette solution. Alors les marchands de Marseille demandèrent la permission de renoncer à leur privilège. Le duc d'Orléans " voulant empêcher les établissements de tomber aux mains des étrangers, " pria l'intendant Lebret de pourvoir à la formation d'une nouvelle Société. C'est tout au plus si la Compagnie consentit, sur les représentations du Conseil de marine, à conserver jusqu'au début de 1719 l'entretien des comptoirs d'Afrique.
Elle avait eu à s'occuper, les années précédentes, de l'éternelle question de Tabarque. Le bey de Tunis s'était brouillé en 1713 avec les Tabarquins et avait interdit tout commerce avec l'île. Les Lomellini, dégoûtés de ces mauvais procédés, paraissaient disposés à la vendre. Pontchartrain insista vivement auprès de la Compagnie d'Afrique pour la décider à faire cet achat " afin de réunir dans ses mains toutes les concessions de la côte barbaresque. " Pour la décider, il lui assura même qu'elle serait remboursée du prix de cet établissement à la fin de son traité, comme des magasins et du matériel qu'elle avait achetés à ceux qui l'avaient précédé, mais la Compagnie hésita " par peur de provoquer la jalousie du bey " et l'affaire n'eut pas de suite.
Personne n'était disposé, à Marseille, à recueillir la succession de la seconde compagnie d'Afrique, puisque celle-ci, composée des plus riches négociants de la ville, avait échoué. Aussi tremblait-elle, au début de 1719, de crainte d'être obligée de continuer son exploitation. Le Conseil de marine lui offrait divers avantages pour l'engager à ne pas abandonner ses comptoirs et faisait intervenir la Chambre de commerce de Marseille pour la décider à se reconstituer. Les instances du gouvernement finirent par décider la plupart des anciens intéressés à fournir un nouveau fonds pour l'exploitation des Concessions, à condition que le trésor royal leur vint en aide(13).
(1) Ibid., n° 237. Ravat, prévôt des marchands de Lyon, au contrôleur général, 4 décembre 1708.
(2) Lebret au contrôleur général, 1, 2, 6 mai 1709. Ibid., n° 389. - En même temps, le maréchal de Villeroy annonçait au contrôleur général qu'un ex consul de Lyon avait été envoyé à Marseille, pour essayer de faire un achat auprès de la Compagnie d'Afrique. Il sollicitait des ordres formels du roi, et craignait que l'emploi de la force ne fût nécessaire pour faire arriver ces blés jusqu'à Lyon. 28 avril 1740. Ibid., n° 383.
(3) Arch. nat. G7, 1695 : " Mémoire présenté par les principaux négociants de la ville de Marseille, inclus dans la lettre de de Harlay. - Cf. le rapport envoyé par le conseiller d'État Amelot, au sujet d'un cas analogue, au nom du Conseil de commerce : " Sur la lettre des maires et échevins de Marseille, au sujet des permissions que le commissaire de la marine refuse à leurs négociants pour aller faire la traite des blés.
Cette lettre contient des plaintes sur trois chefs qui sont plus extraordinaires les uns que les autres.... Le Conseil de commerce estime par toutes ces raisons qu'il n'y a point de temps à perdre à faire cesser par de bons ordres les trois sujets de plaintes expliqués dans la lettre. " Arch. nat. marine B7, 1696. Amelot à Desmaretz, 24 octobre 1717. Le copiste a fait une erreur de date; la pièce est antérieure à 1715.
(4) Les intéressés en la Compagnie d'Afrique à Monseigneur, 6 août 1710. Arch. nat. marine. B7. 1695. Ils protestaient contre l'obligation prétendue qu'on voulait leur imposer d'avoir toujours au moins 6,000 charges de blé dans leurs magasins de Marseille. Un arrêt du Conseil de 1692 avait obligé à cela la Compagnie du cap Nègre, en retour de la permission de sortir des blés de Marseille, ce qui n'avait pas été permis jusqu'alors. Mais leur compagnie n'avait jamais cherché à sortir des blés. Leur arrêt de formation ne faisait pas mention de la susdite obligation et aucune Compagnie ne se formerait avec une condition aussi onéreuse. Signé Montanier, Chover, Chavignot, Saradet (?).
(5) Plantet. Tunis, t. II, p. 59, note 2. Bénéfices comptés sur 54,000 charges, achetées 450,000 livres, vendues 972,000, en déduisant 162,000 livres de frais et 34,000 de lismes. - La Compagnie avait au cap Nègre 1 agent, 1 aumônier, 1 caissier, 1 teneur de livres, 1 garde magasin, 2 commis aux mesures, 1 Chirurgien, 1 garçon chirurgien, 1 truchement, 1 commis aux vivres, 1 cuisinier, 4 domestiques, 1 menuisier, 1 charpentier, 1 maçon, 2 boulangers, 1 palefrenier, 1 forgeron. 1 boucher, 1 blanchisseur, 2 mesureurs, 1 capitaine d'armes et 15 soldats.
(6) Ibid., nos 161, 164, 213. Arch. nat. B7, 89, fol. 30 ; B7, 534 : Arrêt qui homologue la proposition de plusieurs particuliers faite en forme de société pour une nouvelle compagnie d'Afrique. - " La dernière compagnie est une société composée de dix ou douze des plus forts négociants de Marseille, lesquels ont fait un fonds, en 1713, de la somme de 720.000 livres. " Arch. des aff. étrang. Mém. et doc. Alger, t. XII, fol. 349. - On trouve sur diverses lettres adressées par les intéressés de la Compagnie au régent, en 1719, les signatures suivantes Pierre Remuzat et fils, Magy, Compian, Guilhet et fils, Michel, Aillaud, Coustan et Piquet, Vincent, Varade, Begron, Roux, Catelin. Arch. Colon. Compagnie d'Afrique 1681-1731.
(7) Pour la constitution de cette compagnie, V. Propositions de la nouvelle compagnie d'Afrique pour être, au premier janvier 1713, subrogée aux droits de celle dont le traité expire au dernier décembre 1712. Arch. des colon. Carton, Compagnie d'Afrique 1681-1731. V. Ibid. l'arrêt du Conseil et Arch. nation. mar. B7, 84.), fol. 77.
(8) Kilian Hosseïn bey (1713-36), pacificateur du pays, bon administrateur et brillant homme de guerre (Vayssettes, p. 281-302, année 1868). - Peyssonnel dans son voyage fut très bien reçu par ce bey. Dureau de la Malle, p. 363.
(9) Arch. de la Chambre de Commerce de Marseille. Compagnie royale d Afrique. Recueil des traités. Ce traité se trouve aussi aux Arch. des Af. étrang., Mém. et doc. Alger, t. XII. fol. 329-331. - D'après Devoulx, ottoman serait une déformation de Ahed aman, qui signifie pacte de sécurité. - La rabe était le marché public. - Tarcut (Takouch ? ), aujourd'hui Herbillon, à l'ouest de Bône.
(10) Le commerce de la Calle était peu considérable vers 1715, ainsi qu'il résulte d'un Mémoire de 1718, conservé aux archives des affaires étrangères : Pêche du corail, année commune, 120 caisses produisant 144.000 livres. Traite du blé, environ 12.000 charges vendues à Marseille 14 à 15 livres, ci 180.000 livres. Traite des cuirs, 35.000 pièces vendues 105.000 livres ; cinq cents quintaux de cire valant 54.000 livres ; mille quintaux de laine valant 21.000 livres. Soit un total de 504.000 livres. D'après le même mémoire les bénéfices, en déduisant 55.000 livres de tributs et lismes aux puissances d'Alger et 52.500 livres pour les dépenses des comptoirs, devaient s'élever à 80.000 livres. Mém. et doc. Alger, t. XII, nos. 349-352.
(11) Ibid., nos 207, 212, 217, 219, 224, 268, 269. - Mémoire contenant les sujets de plaintes de la Compagnie d'Afrique contre le bey de Tunis, 29 septembre 1717. Arch. colon. Compagnie d'Afrique 1681-1731. - Un des associés de la Compagnie, Taxil, avait été admis à faire partie de la suite de Duquesne (Plantet. n° 275). - Mémoire des plaintes du commerce de France touchant les contraventions aux traités commises par les Barbaresques, 9 mai 1716. Aff. étrang. Mém. et doc. Alger, t. XII, fol. 332-33. Il y est question aussi de Tunis et de Tripoli.
(12) Bonnassieux, p. 192-193. - Il parle à tort plus loin, p. 221, des pertes de la Compagnie du cap Nègre en 1713-1715, comme s'il y avait eu alors une Compagnie spéciale pour ce comptoir. Bonnassieux dit que le 13 janv. 1713, la Compagnie devait au roi 158.001 livres ; la Compagnie venait à peine d'être constituée, peut-être cette dette n'est-elle autre chose que la somme de 150.000 livres due pour l'achat des comptoirs ; elle figure comme acquittée dans le bilan de 1717. - L'auteur d'un mémoire attribue les pertes de la Compagnie à une mauvaise spéculation sur les blés " dont elle tint une fort grande quantité resserrée pendant longtemps... Le blé étant venu à diminuer tout d'un coup, elle y perdit plus qu'elle n'avait compté d'y gagner. " - Arch. des Aff. étrang., Mém. et doc. Alger, t. XII, fol. 352. - V. État des dépenses et profits de la Compagnie d'Afrique du 1er janv.1713 au 31 Juillet 1717, par Taxil. La perte totale, qui est de 736.674 liv., excède de 16.674 liv. le fonds capital de la Compagnie. Arch. des colon., Compagnie d'Afrique, 1681-1731.
(13) V. le projet de constitution de la nouvelle compagnie, Arch. des colonies (Carton Compagnie d'Afrique 1681-1731), mars 1719. On y trouve déjà en germe la combinaison qui devait être définitivement adoptée en 1741, pour la Compagnie royale.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
LA VALISE OU LE CERCUEIL
Un film Documentaire de Charly CASSAN
Envoyé par plusieurs internautes
Ce film documentaire, où des vérités sont dites sans polémique ou esprit de revanche, est un film à voir et à montrer dans toutes les écoles et aussi dans les familles Françaises et pas seulement Pieds-Noirs qui pour la plupart n'ignorent pas ces vérités.
Un très beau cadeau à Offrir ou à montrer à ceux qui ne savent pas !!!
- Pour tout savoir sur cette œuvre exceptionnelle et commander le DVD, cliquez sur : Film la valise ou le cercueil
|
|
|
DISTINCTION
Envoyé par M. Tenneroni
|
 "Un Bônois à l’honneur ! "Un Bônois à l’honneur !
Le 28 septembre 2011 a été promu officier de la légion d’honneur Daniel Bonocori, contrôleur général des armées, né à Bône le 27 juin 1954.
Son père Henri Bonocori, sa mère Yvette Pagano, ses grands-parents paternels (Vincent Bonocori et Madeleine Gallo) et maternels (Angelo Pagano et Elisabeth Gilli) sont aussi Bônois."
La Seybouse et le groupe « des Amis des voyages » félicitent notre Ami Daniel.
|
|
DISTINCTION
envoyé par Mme Mas Jocelyne
|
La Presse : Nice-Matin édition Cannes.
Cannes : 9 septembre 2011
Jocelyne Mas médaillée dans l’Ordre National du Mérite.

Distinguée par la plus haute autorité de l'État, tous les Pieds-Noirs le sont avec elle. Car son œuvre est un hommage à tous ceux qui ont construit ce magnifique pays à force de travail acharné, de courage et de ténacité.
Et aussi une reconnaissance envers son pays d'adoption : la Côte d'Azur, vous retrouverez dans ses ouvrages : Courmes, Plascassier, Magagnosc, Grasse ….. et tous les Prix Littéraires et Médailles que ses livres ont obtenus, elle les dédie à tout son peuple.

- Jocelyne Mas au centre, à sa gauche Bernard Brochand...
Le député-maire Bernard Brochand rejoint un peu plus tard par son premier adjoint David Lisnard, avait accueilli dans son bureau Jocelyne Mas, entourée de son mari, Alain, de ses enfants Véronique et Christophe et de ses 5 petits-enfants ainsi que de ses amis. Il dressa comme c’est la coutume, le parcours du nouveau récipiendaire, dans lequel se trouvent les raisons mêmes qui l’ont conduit à recevoir cette médaille. Puis ce fut au tour de Jocelyne Mas de mettre en exergue les faits les plus frappants et les plus essentiels de sa vie. À commencer par un hommage à sa parenté, à son arrière grand-père Jean Adam Kullmayeur parti d'Alsace en 1870, parce qu'il ne voulait pas devenir allemand. Il créera en Algérie le village de Lavarande, luttant contre les pillards, la malaria, la typhoïde pour faire sortir de ce marécage, une terre rouge et fertile. Son grand-père Charles-Antoine Bertrand gazé à Verdun. Il faisait partie de la 4° compagnie des Zouaves de la célèbre Armée d'Afrique. Son père André Fougère, à 20 ans, s'embarquera pour Londres à l'appel du Général de Gaulle, quittant sa Normandie natale, pour participer plus tard aux campagnes de Libye, de Syrie, d'El-Alamein et Bir-Hakeim. Il sera d'autant plus déçu et trahi quand le Général de Gaulle abandonnera l'Algérie et tout son peuple. Et il s'est battu pour ramener en France ses amis Harkis.
Jocelyne n’oubliera pas d’évoquer les femmes de sa famille : Louise Mosser, Catherine Lanzac, Madeleine Pujo, sa grand-mère Virginie Solarino, sa mère Yolande Bertrand épouse Fougère qui ont montré à maintes occasions leur courage, leur amour pour cette terre, et pour ses habitants en créant écoles et dispensaires. Toutes ces personnes ont inspiré son œuvre littéraire et poétique et témoignent de cette Algérie que Jocelyne Mas quittera en 1962, le cœur défait. Elle n’oubliera jamais, comme beaucoup de ses compatriotes, ses souvenirs d'une enfance heureuse. Arrivée à Cannes, sa famille galère mais Jocelyne apprécie cette nouvelle liberté. Elle écrit ainsi : « égoïstement je me sentais libre, libre de rester tard le soir sur la plage, libre d'aller au cinéma sans redouter une bombe placée sous les sièges, libre, sans couvre-feu, sans bruit d'explosion, sans cette peur qui nous prenait au ventre et qui ne nous lâchait plus. » Jocelyne était au lycée Bristol et son frère au lycée Carnot.
L’avenir devient le présent, les années passent qui construisent un passé. Jocelyne revient à « Cannes la Blanche », comme s’est plu à qualifier la ville Bernard Brochand dans sa présentation. « Cannes, cette ville ressemble tant à Alger, le Boulevard du front de mer se superpose sur la célèbre Croisette dans mes souvenirs qui pâlissent de jour en jour... », reprendra la nouvelle Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. Elle s’y sent bien. Regardant les palmes des palmiers se découper sur l'azur du ciel, son esprit vagabonde tandis qu’une brise de vent chaud la ramène de l’autre côté de la Méditerranée... en naîtront une pluie d’étoiles filantes, petits cailloux sur les chemins du souvenir, poèmes et textes pour enchanter ses lecteurs.
Vous retrouverez tous ses ouvrages sur l'Algérie et sur la Provence Côte d'Azur sur son site Internet : http:www.jocelynemas.com
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Novembre 2011.
Son adresse: http://www.piednoir.net/guelma
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
Le Guelmois
| |
| JE TE SOUHAITE ASSEZ !
Envoyé par Thérèse
Auteur Inconnu
| |
|
Récemment, j'ai surpris un père et sa fille dans leurs derniers moments ensemble à l'aéroport. On avait annoncé le départ.
Debout près de la porte de sécurité, ils se sont serrés et le père a dit « Je t'aime et je te souhaite assez. »
La fille a répondu « Papa, notre vie ensemble a été plus qu'assez. Ton amour a été tout ce dont j’avais besoin. Je te souhaite assez, aussi, papa. »
Ils se sont embrassés et la fille est partie. Le père a marché vers la fenêtre où j'étais assis. Je pouvais voir qu’il avait besoin et qu’il voulait pleurer. J'ai essayé de ne pas m'imposer et de respecter son intimité, mais il m'a demandé « Vous est-il déjà arrivé de dire au revoir à quelqu'un en sachant que vous ne vous reverriez jamais ? »
« Oui. » j'ai répondu.
« Me permettez-vous de vous demander pourquoi vous croyez que vous ne vous reverrez jamais ? ».
« Je suis vieux et elle vit si loin. J'ai de gros défis devant moi et la réalité est que son prochain voyage sera pour mon enterrement» a-t-il dit.
« Quand vous vous disiez au revoir, je vous ai entendu dire « Je te souhaite assez. » Est-ce que je peux vous demander ce que cela signifie ? »
Il a commencé à sourire. « C’est un souhait qui nous vient de plusieurs générations qui nous ont précédé. Mes parents avaient l'habitude de le dire à chacun. » Il a fait une pause un moment et regarda au plafond, comme s’il essayait de se rappeler en détail, et il a souri encore plus. « Quand nous disons « Je te souhaite assez » nous souhaitons que l'autre personne ait une vie remplie de juste assez de bonnes choses pour les garder heureux. » Alors, se tournant vers moi, il a partagé ce qui suit comme s’il récitait un texte mémorisé.
Je te souhaite assez de soleil pour maintenir ton attitude lumineuse peu importe que la journée soit grise et moche.
Je te souhaite assez de pluie pour apprécier le soleil encore plus.
Je te souhaite assez de bonheur pour maintenir ton esprit vivant et éternel.
Je te souhaite assez de douleur de sorte que même la plus petite des joies dans la vie puisse te sembler grande.
Je te souhaite assez de gain pour satisfaire tes besoins.
Je te souhaite assez de perte pour apprécier tout ce que tu possèdes.
Je te souhaite assez d’au revoir pour te permettre de bien te rendre à l’Au revoir final.
Il a alors commencé à pleurer et il s’est éloigné...
On dit que ça prend une minute pour trouver une personne spéciale, une heure pour l’apprécier, un jour pour l’aimer, mais que ça prend une vie entière pour l’oublier.
Seulement si tu le souhaites, envoie ceci aux personnes que tu n’oublieras jamais incluant celle qui te l'a envoyé. Si tu ne l'envoies à personne, ça peut signifier que tu es pressé et que tu as oublié tes amis.
PRENDS LE TEMPS DE VIVRE…
JE TE SOUHAITE ASSEZ !
|
|