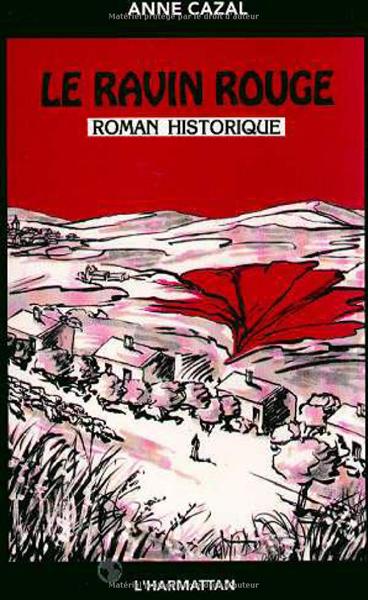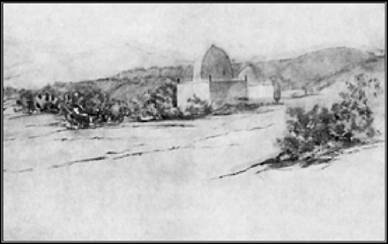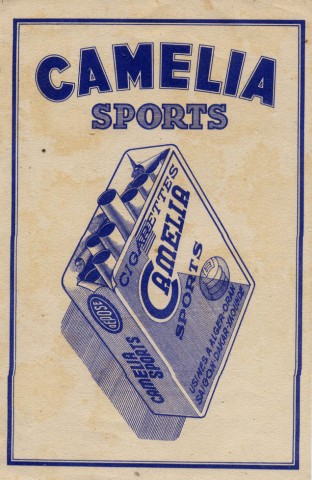|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint |
|
|
|
EDITO
Excités comme des puces Pieds-Noirs
Chers Amis,
La communauté Pieds-Noirs marche sur la tête, du moins une certaine partie de la communauté toute excitée par les puces qu'elle a dans la tête. Et c'est cette fange là qui tente de faire croire qu'elle en est la représentante exclusive de tous les Pieds-Noirs.
Ce n'est pas le bouclage de ce 103ème N° de la Seybouse qui a jeté un sort sur la tête des P.N., mais bien l'annonce à Nice de l'élévation d'une stèle en l'honneur du bourreau des P.N., " Charlot Machiavel le Fourbe ", avec le soutien d'associations P.N. Et, cerise sur le gâteau, pour la célébration du cinquantième anniversaire de notre exode.
Mais on a vu pire, encore, circuler sur le net !
" Pour le 50ème anniversaire de notre douloureux exode, certains présidents d'associations pieds noirs, sur une idée de l'une d'entre elle (Union pour la défense des intérêts de rapatriés), envisagent même, pour faire un peu plus couleur locale, de " déguiser " les pieds noirs et de simuler un nouvel exode en invitant les Français d'Algérie à reprendre le bateau depuis les côtes algériennes pour accoster dans les ports de France ! "
Certains, avec raison, diront : Oh mon dieu !
- Quelle horreur !
- Des P.N. gaullistes qui nous tapent dessus !
- Des P.N. habités par l'âme d'un traître, d'un félon, d'un assassin.
- Pourquoi faire une telle infidélité à tous nos morts ?
- Pourquoi salir notre mémoire ?
- Pourquoi renier nos souffrances ?
- Pourquoi fêter d'une telle sordidité le malheur de notre communauté ?
Eh bien, le gaullisme veut tout simplement pouvoir bénéficier encore une fois des voix de P.N. pour la prochaine élection présidentielle et une fois le suffrage passé, pouvoir cracher sur les promesses faites comme l'a fait hier son " géniteur ". Ce courant de pensées malfaisantes, sait que ça marche, qu'il ne sera pas poings et pieds liés face à des lavettes pour qui le déshonneur n'a pas de valeur morale mais simplement une valeur nutritive en avantages personnels. Et à ces prébendiers là, la honte ne les étouffe même pas, quel dommage, mais on souhaite que la " gratelle " causée par leurs puces leur fasse les bras trop courts...
A l'heure où la communauté devrait faire bloc autour d'un grand projet de mémoire comme le propose le Film " Le Ravin Rouge ", ces " associations et P.N." ne pensent qu'à leur pré carré où se battent leurs puces excitées pour avoir la meilleur part du sang. Du sang encore chaud des dépouilles de nos compatriotes. Quand est-ce que la communauté P.N. aura compris que la politique ne fait pas bon ménage avec la mémoire et la véritable histoire de notre peuple.
Ce que nous voyons et constatons à l'heure actuelle, sur les agissements de certains P.N. ou associations, traduit bien ce qui s'est passé pendant la " présence française " en Algérie.
Il y avait le petit peuple hétéroclite, fait de travailleurs, des pionniers :
- qui ne demandait qu'à travailler, à vivre en paix avec tout le monde ;
- qui voulait prospérer honnêtement dans un pays où tout était à faire ou refaire ;
- qui ne connaissait rien à la politique française dont elle subissait aussi les effets pervers.
Ce petit peuple a fait les frais macabres d'une indépendance mal négociée et inéluctable au vu de ce que nous voyons et constatons. Car à coté, et non pas aux cotés, de ce petit peuple il y avait déjà des groupes, associations, clans de gauche comme de droite manipulés par la politique parisienne qui tiraient toutes les ficelles sans se soucier de la misère du petit peuple, de tout le petit peuple sans distinction de race ou de religion. Seul le profit comptait pour cette minorité.
Depuis l'exode, malheureusement, les agissements des malfaisants ont continués sous diverses formes et à chaque fois la majorité du petit peuple P.N. a marché car on lui faisait croire à des indemnisations, qu'il ne verra jamais dans sa globalité, et cela passait avant la sauvegarde essentielle de sa mémoire.
Pendant prés de 50 ans, la majorité silencieuse de ce petit peuple a démontré, avec le courage de ses ancêtres pionniers, qu'elle était capable de survivre sans indemnisations. Les 50 ans de notre exode sont tout proche ; pour nos ancêtres, pour leur modeste œuvre, soutenons et défendons tout ce qui concerne la conservation et la diffusion de notre mémoire à la manière de ce que nous ont montré les Juifs et les Arméniens.
Chassons les porteurs de puces qui veulent encore une fois sucer notre sang.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
| Ma Mère d'Algérie
Auteur : Inconnu
Envoyé Par Georges
| |
En hommage à toutes les MAMANS pieds-noirs
qui ont vu le jour sur le sol de notre pays perdu.
Elle a le cœur dans sa cuisine,
Toujours les mains dans la farine.
Le regard baigne de tendresse
Pour ses souvenirs de jeunesse.
Elle est la base de sa famille,
Comme toutes les mères d’Algérie.
Elle a, dans le cœur et la voix,
Des comportements d’autrefois.
Elle soigne les rhumes à l’anisette,
Dans les oreilles et sur la tête.
Elle suit l’exemple de sa mère
Qui le tenait de sa grand-mère.
Chez elle, l’odeur de la lavande
Vous saute au cœur comme une offrande.
Le linge respire la propreté :
Esprit de sel, planche à laver.
Sa cuisine sent bon les épices,
Sa table est un petit délice.
Elle fait chanter la nostalgie
En cuisant des plats d’Algérie.
Elle aime ses fils à l’infini.
Pour elle, ils sont restés petits.
Elle distribue avec largesse
Tout son Amour et sa Tendresse.
Derrière les carreaux de l’hiver,
Elle songe aux souvenirs d’hier
Qui ont marqué son existence,
De l’autre côté de la France.
Loin de la terre où elle naquit,
Loin des voisins et des Amis,
Elle vit, solitaire, ses journées,
Emmitouflée dans son passé.
Dans sa cité de solitude,
Elle veut garder ses habitudes,
Mais ses voisines ne viendront plus
Chercher de l’ail, de la laitue.
Sa porte, ouverte sur l’amitié,
Reste inutile sur le palier :
Ici ne vient jamais personne,
L’affection parle au téléphone.
L’exode a dispersé sa Vie
Et disloqué toute sa famille.
Sa maison est comme un hôtel
Depuis qu’elle n’a plus son « chez elle ».
Mais elle conserve au long des jours
L’esprit Pied-Noir et, pour toujours,
Son cœur respire en ALGERIE
Près de la tombe de son mari.
|
|
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LA CIGALE Y LA FORMI
[FABLE IMITÉE DE LA FONTAINE]

J'y conni one cigale qui tojor y rigole
Y chante, y fir la noce,
y rire comme one folle,
Y s'amouse comme y faut
Tot l'temps y fi chaud.
Ma, voilà qui li froid !
Bor blorer t'y en a le droit -
Ma, t'a riann por bouffer,
Bar force ti va criver.
Y rnarchi bor la rote
Y trovi one forrni
Qui porti bon caserolr.
Y loui di : "Mon zami,
Fir blizir bor priter
One p'tit po di couscousse
Bor qui ji soui manger.
Josqu'à c'qui. l'hirb' y pousse.
J'y paye, barol d'honnor,
L'arjan y l'antiri, pas bizoann d'avoir por.
La formi, kif (i) youdi,
L'argeann y prite pas.
- " Quis ti fir y loui di,
Quand di froid y ana pas
Le jour, ji chanti bor blizir,
La noui j'y soui dormir.
- Ti chanti ? Bor moi ji pense
Qui millor qui ti danse. "
MORALE
La jouif y couni pas quisqui cit la mousique
Millor di bons douros, afic bon magasin
Qu'one tam-tamm manific
qui l'embite li voisin
| |
|
LE MUTILE N° 192, 8 mai 1921
|
LE CAPITAINE SUDRY
Secrétaire Général des Anciens Zouaves
 Nous avons la bonne fortune de pouvoir publier aujourd'hui la photographie du Capitaine Sudry, secrétaire général de la Société des « Anciens Zouaves », qui est une des plus Sympathiques figures algéroises. Nous avons la bonne fortune de pouvoir publier aujourd'hui la photographie du Capitaine Sudry, secrétaire général de la Société des « Anciens Zouaves », qui est une des plus Sympathiques figures algéroises.
Né le 28 février 1876, à Saint Etienne - aux - Clos (Corrèze), Louis-François Sudry contracte en 1895, un engagement volontaire à: Alger, pour le régiment: de zouaves.
Pendant 15 années, il sert successivement au 1er Zouaves, au 63° et, au 92° d'Infanterie. Il devint caporal, sergent, sergent-major et adjudant, puis démissionne en 1910.
Mobilisé, le 9 août 1914 comme sous-lieutenant de territoriale il est versé au 4° bataillon à Fort-National; mais il ne peul se résoudre à l'inaction en Kabylie. Volontaire pour le front, il est versé au 9° Tirailleurs, à Miliana et s'embarque pour la France, le 13 juin 1915, avec un détachement de six cents indigènes.
Affecté au 5° Tirailleurs, puis au 2° mixte de Zouaves et tirailleurs, il fait avec ces unités les secteurs et attaques de l'Aisne, de Confrécourt et de Soisson. Son attitude au feu lui vaut, ç ce moment la citation suivante :
" Le colonel Vrenière, commandant la 96° brigade, cite à l'Ordre de la brigade le lieutenant Sudry (Louis-François), 3° bataillon du 5° Tirailleurs :
" Commandant depuis trois mois sa compagnie au .front avec une activité, une énergie et une autorité remarquables. Vient de donner, du 2 au .3 août 1915, dans le secteur de l'Aisne, l'exempte personnel du plus grand courage et du plus grand dévouement sous un bombardement souvent intense et presque continuel, a su organiser dans son unité le tir le plus efficace contre les mines et les bombes, déconcertant l'ennemi par les résultats obtenus "
Son bataillon épuisé est désigné ensuite pour une relève au Maroc. Ce n'est .plus le même front, mais c'est toujours la guerre. Le lieutenant Sudry " baroude " à Kasba-Tadla, à Kenitra, prend part à la prise de Béni-Hellal, où il est nommé capitaine le 13 novembre 1916.
On le retrouve dans les opérations de la colonne du Sous, en 1917 : Taroudant, Tizmit, Ifnia. Il fait l'objet d'une deuxième citation, à la date du 3 juillet 1917.
" Au combat du 17 avril, le capitaine Sudry (Louis-François), commandant la 5° compagnie du 5° tirailleurs, placé au point de la ligne 1e plus délicat et assailli à 200 mètres par de nombreux contingents, a pu, grâce à. son sang-froid et à ses habiles dispositions, replier son unité avec des pertes minimes. "
Gravement atteint de paludisme et d'anémie, il est évacué sur Vichy, où des soins prolongés lui sont nécessaires pour recouvrer la santé.
A peine de retour au Maroc, par suite de compression des cadres d'officiers, il est de nouveau dirigé sur le front français et versé au 4° Zouaves où il sert jusqu'à l'armistice. Puis, en attendant la date de sa démobilisation, il est envoyé à Aix-en-Provence pour l'instruction des jeunes recrues.
Rendu à la vie civile, le 1er décembre 1918, le capitaine Sudry revient, alors à Alger, où ses nombreux amis et anciens camarades de combat, ont vu avec plaisir s'aligner sur sa poitrine les témoignages de sa belle conduite au feu : croix de chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, médaille coloniale et Ouissan Alaouite.
Nous sommes heureux de la circonstance qui s'offre aujourd'hui pour nous de renouveler à notre ami Sudry l'expression de notre sympathie profonde et de notre vive amitié.
" LE MUTILE ".
©§©§©§©§©§©§©
|
|
FILM « LE RAVIN ROUGE »
Tiré du livre d’ANNE CAZAL
|
NOTE DU WEBMASTER
A l'attention surtout des coupeurs de cheveux en quatre : SVP. Ne me faites aucun procès d'intention car je ne fais que de l'information et donne un petit avis personnel. Je n'ai aucun intérêt personnel dans cette opération. Je ne suis pas impliqué et je ne fais parti d'aucun comité de contrôle ou d'organisation. Un groupe bénévole sérieux s’est lancé dans cette opération.
Je souscris et soutiens à titre personnel car je pense que c'est une idée qui aurait déjà dû être mise en route il y a bien longtemps. Il serait temps que la communauté pieds-noirs prenne en charge sa mémoire et qu'au moins une union et une solidarité s'établissent pour mener à bien un projet qui nous concerne tous.
Même, si je devais me tromper en soutenant personnellement ce projet, je préfère faire :
- le pari de la réussite face à celui de l'échec ;
- le pari de la Mémoire face à celui de l’Oubli ;
- le pari de l'action face à celui de l'inaction et de l'attentisme ;
- le pari de l’enseignement de la connaissance face à celui de la désinformation ;
- le pari du cri de la vérité face à la rouspétance inutile.
Tout cela dans l'espoir qu'il y aura d'autres projets qui pourront se concrétiser avec au bout la paix des mémoires, des esprits et des âmes.
Chacun doit être face à sa conscience et choisir d'amener librement sa modeste obole selon ses moyens financiers ou peut-être d'aller manger un couscous merguez ou une paella. (C'est pour rire).
Plus nous serons nombreux à apporter « des grains de riz ou de couscous », plus la réalisation pourra se mettre en batterie pour nous concocter un menu où déjà l’impatience se fait jour. C’est mon cas, comme tout bon convive, je veux déguster ce film qui doit être à la hauteur du livre « Le Ravin Rouge ».
En attendant, je vous invite à lire
attentivement ce qui suit.
Jean-Pierre Bartolini,
Webmaster

DROIT DE MEMOIRE
« Ligue du Droit des Français à disposer de leur Mémoire »
OPERATION FILM « LE RAVIN ROUGE»
Par Le Président, de Droit de Mémoire
Pierre Barisain Monrose
En 2012, cela fera 51 ans que nous avons quitté notre Algérie.
Nous avons tous la nostalgie de notre terre natale et nos souvenirs sont encore vifs. Beaucoup d'associations tentent de mener une bataille mémorielle difficile. Mais aujourd'hui nos cheveux blanchissent et notre devoir est de nous battre encore afin que notre belle oeuvre accomplie là bas ne tombe pas dans l'oubli et que certaines vérités ne soient pas enterrées avec nous.
C'est en fait un devoir pour nous, un devoir envers nos morts qui se sont battus pour une Algérie aimée, un devoir envers nos enfants et nos petits enfants.
L'association « DROIT de MEMOIRE » - Président Pierre Barisain -, soutient le projet de lancement d'un film tiré d'un très beau livre de la journaliste Anne Cazal « LE RAVIN ROUGE ». Tout est dit dans ce livre. Une histoire vécue, de l'arrivée des premiers pionniers jusqu'aux tragédies que nous avons connues sans oublier la vérité souvent cachée des relations entre les diverses communautés.
En participant à la promotion de ce film,
vous accomplirez un geste de générosité naturelle.
Selon vos moyens, vous pouvez adresser un chèque de 10 euros (minimum) ou plus à l'ordre de l'association « DROIT de MEMOIRE » - Le Ravin Rouge.
– Une association, (ou une entreprise), peut grouper des fonds et remplir un seul bulletin de participation. Elle sera citée dans le générique du film, « avec le soutien et les encouragements de,,,. ».
Autre possibilité :
En participant à la production de ce Film, vous pourrez aussi réaliser une économie d'impôt, I.R. (impôt sur les Revenus), voire supprimer votre I.S.F. (impôt sur la fortune), en plus d’un geste de générosité naturelle.
Tout participant, aura la possibilité de demander à faire partie de la figuration du film et recevra également une invitation pour sa projection en avant première.
Le Président, de Droit de Mémoire
Pierre Barisain Monrose

FAISONS UN FILM
Par Michel XIMENES
http://realifilmpn.com.over-blog.fr 06 08 67 61 61
« Faites un film, c’est par l’image que vous arriverez à vous faire entendre.
Les livres ne suffisent pas car les gens lisent peu, et, je vous donne un exemple, le choc qu’a produit le film «Indigènes» de Rachid Bouchareb, voilà le seul moyen. »
Ces paroles sont de Raphaël Delpard auteur de plusieurs ouvrages comme : Les oubliés de la Guerre d’ Algérie, Les persécutions des Chrétiens dans le monde, les convois de la honte, et aussi Souffrances secrètes des Français d’Algérie (Histoire d’un scandale).
Chers amis de toutes origines et de toutes confessions.
A quelques encablures de mes 71 ans et avec un collectif d’amis nous avons pensé qu’il était temps de faire un film un vrai film non pas des documentaires. Ce projet vise à rétablir la Vérité Historique sur l'Algérie Française face aux mensonges qui nous stigmatisent, c’est avec une étonnante convergence de vue, que la plupart (journaux, revues, radios, télé, cinéma) ont révélé, sur cette période « Française » en Algérie une vision singulièrement sinistre, travestie ou défigurée.
Pour ce film beaucoup nous ont dit ce n’est pas une mince affaire, nous en convenons, sa réalisation sera très difficile, mais comme nous sommes têtus et que nous avons foi en vous, nous devons essayer.
Nous, nous adressons à tous ceux qui ont eu cette idée, nous devons ensemble mettre notre foi, notre force, notre volonté, notre savoir pour réaliser ce film. Nous n’avons plus beaucoup de temps devant nous et nous devons laisser la vérité à nos petits enfants, au monde entier et avant tout au peuple de France avant notre disparition.
Que savent ils de nous ? Principalement ce que les médias et l’enseignement en disent, à savoir entre autres désinformations:
- Ils savent que la présence Française en Algérie fut de tout temps illégitime
- Les Français d’Algérie ont exploité les arabes et ont volé leurs terres.
Pour réaliser un tel film je ne vous cacherai rien, il faut pour cela :
Un scénario, un producteur, un metteur en scène, des acteurs, des costumes, du matériel technique, de la pellicule, le tirage des copies, la publicité et enfin des salles pour le projeter.<
Tout cela coûte très cher, donc le problème est simple. Il faut trouver un producteur assez courageux pour se risquer dans un projet à contre-courant de l’idéologie dominante. Nous n’en connaissons pas, mais ça peut se trouver à condition de lui apporter un scénario qui tienne la route (Madame Anne Cazal nous offre ses droits d’auteur sur son livre le « Ravin Rouge», puisse en être de même pour d’autres…), et un début de financement sûr. Si nous arrivons à convaincre qu’il y a un public pour ce genre de film, il peut prendre les choses en mains, compléter le budget et mener le projet à son terme. Comme vous l’avez bien compris le point crucial c’est l’argent. Nous ne voyons qu’une souscription ouverte auprès de tous ceux (Pieds Noirs et autres) encore assez motivés pour vouloir défendre notre mémoire. Nous tenons à préciser que tout sera fait devant avocat, huissiers et tout ce que vous voudrez pour qu’il n’y ait pas d’arnaque!!!.
Nous avons donc décidé de vous solliciter par Internet et vous inviter à réfléchir sur le questionnement suivant :
- Etes-vous conscients que les Français d’Algérie et leur œuvre en Algérie sont victimes d’une désinformation odieuse et systématique de la part des Médias ?
- Savez-vous qu’il est quasiment impossible d’accéder aux grands moyens d’informations pour rétablir la Vérité Historique et faire entendre notre voix ?
- Pensez-vous que nous devons nous résigner à subir ces campagnes de calomnies sans riposter ?
- Que pensez- vous de l’idée d’un film retraçant l’Epopée « Française » dans la plus grande objectivité et qui rendrait justice à l’Œuvre de la présence en Algérie des Pieds Noirs ?
- Que pensez-vous de l’idée de financer ce film, d’un coût qui n’est pas encore fixé, par une souscription ouverte auprès de tous ceux qui ont à cœur de défendre la mémoire de ce que fut notre pays natal. ?
Nous avons parmi la communauté des gens avec de gros moyens, des artistes, des écrivains, des compositeurs, des producteurs, des réalisateurs…. qui peuvent participer à ce projet, et sinon nous irions, s’il le fallait voir les étrangers. Nous tenons à dire que les caricaturistes s‘abstiennent !!!. Pour la petite histoire sachez qu’en 1936 sous le Front Populaire, le film de Jean Renoir, "la Marseillaise"fût réalisé par une souscription populaire lancée par la CGT.
Sachant que pour atteindre la somme finale qui sera nécessaire pour la réalisation de ce film, toutes les idées seront les bienvenues, il faudrait un très grand nombre de souscripteurs.
- VOUS, pour quelle sommes seriez-vous prêt à souscrire ?
Aujourd'hui nous pouvons vous dire que le film, d'après l'oeuvre littéraire de Anne Cazal "le Ravin Rouge" qui prouve que toutes les communautés pouvaient vivre ensemble, qui rectifie les mensonges à notre encontre et qui met en évidence la Vérité Historique sur l'Algérie Française, va se faire.
Ce livre a été transmis à Mme Evelyne Colle (Responsable de la Commission du Film Alpes-Maritimes - Côte-d'Azur. Cette dernière nous a confirmé que seul un producteur pouvait développer notre projet. Nous avons ensuite été dirigés vers une société de production et un producteur. Cette société nous a confirmé son intérêt pour développer ce projet et passer ainsi de l'écrit à l'écran.
1) Nous avons donc maintenant une Association : Droit de Mémoire, dont le Président est le Docteur Pierre Barisain-Monrose qui se charge de récolter les dons qui serviront à financer le Scénariste qui nous coûte environ 35 000 euros. Tous les dons doivent être envoyés à DDM - Ravin Rouge à Mme Maryse Gillmann - 21 quai Louis Gillet - 69004 Lyon le plus rapidement possible. Le moindre don sera le bienvenu.
2) Le Producteur trouve le scénariste, celui-ci fait le scénario, ensuite il est proposé à un Comité de Lecture composé de l'écrivain Anne Cazal et de quelques amis et qui pourra modifier le scénario afin qu'il reste bien dans les idées et dans la trame du livre !
Les délais étant courts pour réunir la somme de 35 000 Euros, tous les dons seront remboursés à la fin de ces délais si nous ne pouvons pas payer le scénariste. Cela voudra dire que n'avons pas été capables de nous réunir autour d'une idée qui aurait pu changer le regard des autres sur notre histoire.
3) Ceux qui ont le bonheur de payer l'ISF (impôt sur la fortune) et qui peuvent donner au-delà de 5000 euros, doivent envoyer leurs dons à la Société de Production A.C.A.P., 1830 Avenue des Templiers, l'Horizon, 0640 Vence- contact@action-prod.com, N° de téléphone à composer pour laisser un message et être rappeler : 04 93 58 78 93. Vous serez informés de vos possibilités et vous pourrez bénéficier d'un accompagnement complet sur les démarches à suivre. (réduction importante d'impôts).
Nous comptons sur vous, le moindre petit don est important. Nous devons montrer que nous sommes capables de faire bloc face à nos adversaires et à nos délateurs.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOLIDARITE
- · Imprimez des bons de participation au format PDF
- · Remettez-les à vos amis, votre famille, vos voisins, votre boucher ou votre boulanger. Vous pouvez également recueillir les sommes qui vous seront données et les regrouper dans un seul bon de souscription à envoyer.
Droit de mémoire - le film (Format PDF)
Bon de participation (Format PDF)
Nous sommes tenus par le temps. Nous comptons sur votre diligence.
TOUS POUR UN – UN POUR TOUS
Michel XIMENES
06 08 67 61 61

LE RAVIN ROUGE
Par ANNE CAZAL
Roman historique
Quel beau roman que le Ravin Rouge ! On sent qu’il a été écrit avec le cœur ! Ses lecteurs se sont attachés aux personnages qui traversent le récit car ils sont profondément authentiques : ils ont vécu, ils ont existé, ils ont connu la joie, et aussi le malheur. Nombreux sont les lecteurs, qui ont écrit à l’auteur, croyant les avoir rencontrés, aux quatre coins de la province française d’Algérie.
« Même si l’on a une certaine pudeur à les évoquer, on ne peut s’empêcher d’avoir pour eux de l’attention et même de l’amitié » a écrit Jeannine de la Hogue, préfacière de l’ouvrage.
Adrien de Courtenay, le héros de ce roman, est un être de chair et de sang, mais il est aussi un mythe, un exemple, une sorte de prototype de ceux qui sont venus en Algérie par nécessité, et qui se sont attachés au pays au point de s’identifier à lui, d’en devenir le symbole, d’en devenir, comme dans le récit d’Anne Cazal, la mémoire.
La démarche de ce récit, de ce témoignage, écrit avec passion, mais aussi avec respect pour les acteurs, races, religions, milieux sociaux, confondus dans la plus grande tourmente de leur vie, est une arme pacifique mais absolument efficace, et le Ravin Rouge le prouve à ses lecteurs, depuis bientôt seize ans...
Les Pieds Noirs sont orphelins de leur terre. Ils l’ont pleurée avec désespoir. Certains l’ont fait avec violence, d’autres ont transformé leur désespoir en nostalgie, l’auteur a essayé de le faire ressentir par l’écriture car rien n’est pire que de se sentir incompris, parfois injustement jugé, et, bien souvent mal aimé.
Anne Cazal a simplement écrit la vie là-bas, et sous sa ferveur et sa plume, se sont fait soudain comprendre des lecteurs les peines, les difficultés et les drames humains vécus.
Le héros de ce récit, venu en Algérie à la suite d’un deuil, d’un désarroi, y trouva, grâce à son travail et à sa ténacité une certaine réussite matérielle. Il y fut aidé par un camarade de guerre, Kader Kouïder habitant la mechta voisine, puis par la femme dont il tomba amoureux, institutrice dans le bled, Elise Cortès. Puis vint le temps des turbulences où tous furent emportés par le vent dit … de l’Histoire
A travers les peines et les drames dont la vie du héros et de sa famille seront accablés, Les lecteurs ressentent, qu’ils fassent partie des exilés de l’Algérie Française ou qu’ils ne l’aient pas connue, le fil conducteur qui anime ce roman : ferveur, foi et espoir.
Personne ne ressort intact de cette lecture !
Boualem SANSAL et Anne CAZAL, d’une seule et même main
ANNE CAZAL COMMUNIQUE :
Le Ravin Rouge, paru en 1994 et de nombreuses fois réédité (la 9ème et dernière édition datant de fin décembre 2010), est un long cri du cœur, un cri qui commence dans l’allégresse et dans l’extase pour s’achever dans la douleur et la révolte. C’est aussi l’histoire mêlée, mais authentique, de plusieurs de nos compatriotes… Et c’est, de plus, le reflet fidèle, sans haine et sans crainte d’une fraternité brisée par l’infâme collision d’un Etat de droit avec un terrorisme naissant qui devait s’en trouver renforcé au point de devenir international.
Tous ceux qui lisent ce livre (pour lequel, à l’époque, j’avais refusé le prix algérianiste estimant qu’un roman, fut-il historique, ne pouvait pas entrer en concurrence avec l’œuvre immense du professeur Yacono) en sont bouleversés… Combien de fois m’a-t-on écrit : « On ne peut pas ressortir intact de cette lecture… ». On m’a aussi écrit : « il faut en faire un film… ». ou « Je prie pour qu’on en fasse un film… » Vœu pieux qui dépassait mes limites… Il semblerait, aujourd’hui, que ceux qui prient aient été entendus.
Il a fallu que plusieurs de nos compatriotes, révoltés par les films antifrançais et chargés de contrevérités historiques que l’Etat subventionne largement, rencontrent un producteur, lui proposent de faire un film tiré du Ravin Rouge, ouvrage qui, après lecture, a sensibilisé ce dernier au point que nos amis ont obtenu de lui la volonté de concrétiser ce projet. Depuis, m’ont-ils écrit, ils rêvent d’avoir bientôt leur « AUTANT EN EMPORTE LE VENT … DE L’HISTOIRE ! »
Et je me suis mise à rêver avec eux… Je n’ai posé qu’une seule condition : avoir un droit de vérification et de modification éventuelle sur le film, ceci dans le cadre du respect scrupuleux de la vérité historique, et je m’y tiendrai. Boualem Sansal, écrivain algérien opposant au régime en place dont la réputation n’est plus à faire, me soutiendra dans cette action.
J’ai cru comprendre que, pour la mise en marche du projet et la réalisation du scénario, les producteurs avaient besoin d’une première mise de fond à laquelle tous ceux qui le désirent peuvent contribuer. Je n’ai pas à m’en mêler – et, je le précise, VERITAS non plus – mais je donnerai mon obole comme les autres, en fonctions de mes moyens, simplement parce que je suis certaine que le Ravin Rouge témoignera encore de notre drame à tous, et qu’il serait bénéfique pour tous qu’il soit mis en image.
Vous pourrez donc, si vous le souhaitez, participer à cette première mise de fond, auprès de l’association chargée de recueillir les fonds : DROIT DE MEMOIRE - Maryse GILMAN, 21 Quai Louis Gillet - 69004 Lyon . Bien préciser sur l'envoi : à l'ordre de « Droit de Mémoire-Ravin Rouge ».
Le combat continue, bonne année à tous ! Anne Cazal
N.B. Je vous informe, en outre, que mon éditeur vient de m’envoyer un stock de livres sur la dernière édition et que je suis à la disposition de ceux qui souhaiteraient l’acquérir au prix de 28 € par chèque à mon nom, étant précisé que j’offre le port et la dédicace éventuelle.
PRÉFACE du livre ‘LE RAVIN ROUGE »
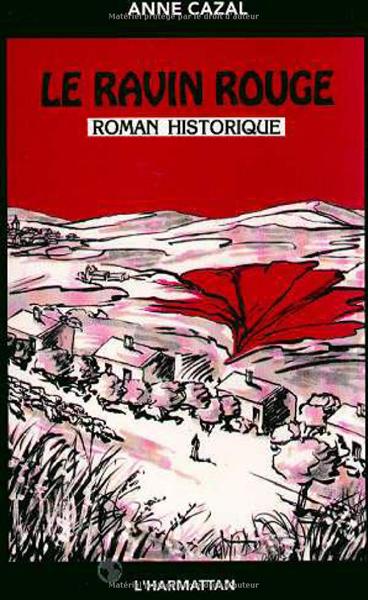 Il est toujours difficile de présenter un livre. Ce n'est pas un acte innocent. Il reste parfois un doute : a t-on bien compris la pensée de l'auteur, ne va t-on pas trahir ses intentions ? Il est toujours difficile de présenter un livre. Ce n'est pas un acte innocent. Il reste parfois un doute : a t-on bien compris la pensée de l'auteur, ne va t-on pas trahir ses intentions ?
Pour le Ravin rouge, il me semble pourtant pouvoir évoquer sans difficulté les personnages qui traversent le récit car ils sont profondément authentiques.
Ils ont existé, ont vécu, ont connu le malheur, les difficultés et les joies. Et si l'on a une certaine pudeur à les évoquer, on ne peut s'empêcher d'avoir pour eux de l'attention et même de l'amitié.
Adrien de Courtenay, le héros de cette histoire, est un être de chair et de sang mais il est aussi un mythe, un exemple, une sorte de prototype de tous ceux qui sont venus en Algérie, certains par hasard, beaucoup par nécessité, et qui se sont attachés au pays au point de s'identifier à lui, d'en devenir le symbole. D'en devenir, comme dans le récit d'Anne Cazal, la mémoire.
Sous une forme romancée, c'est la somme de plusieurs tragédies, authentiques témoignages du destin douloureux de ceux qui avaient cru bâtir en Algérie pour l'éternité. II est bon de leur rendre hommage, de faire connaître la réalité de leur vie.
Et pour cela, il faut écrire, écrire pour vaincre l'oubli. Il est une formule que j'aime beaucoup employer car elle me paraît essentielle : la mémoire passe par l'écriture. C'est la démarche de ce récit, de ce témoignage écrit avec passion, avec respect aussi pour les acteurs, races, religions, milieux sociaux, confondus dans la plus grande tourmente de leur vie.
Les Pieds-Noirs sont orphelins de leur terre. Ils l'ont pleurée avec désespoir. Certains l'ont fait avec violence, d'autres ont transformé leur désespoir en nostalgie, d'autres encore ont tenté de se faire entendre à travers l'écriture.
Et quand on dit entendre, c'est plutôt comprendre qu'il faudrait dire. Rien n'est pire que de se sentir incompris, parfois même injustement jugé et, dans tous les cas, mal aimé.
Il est important d'écrire des récits comme celui-ci. Ils portent témoignage, ils ajoutent leur pierre à la maison Histoire qui, depuis quelques années, se construit patiemment, avec amour, avec maladresse parfois, mais toujours avec une sincérité évidente. L'écriture est la seule arme qui reste aux Pieds-Noirs, une arme pacifique, jamais neutre, bien souvent efficace. Il faut écrire, écrire beaucoup, écrire toujours pour vaincre l'oubli de ceux qui ont construit une oeuvre injustement décriée, qu'il faut défendre et faire connaître, avec lucidité, avec objectivité et sans omettre les erreurs.
Il n'est pas souhaitable d'être polémique, il faut seulement raconter. Dire tout simplement la vie, et à la lecture se feront comprendre les peines, les difficultés, les drames. Le héros de ce récit, venu en Algérie à la suite d'un deuil, d'un désarroi, y trouvera, grâce à son travail, à sa ténacité, une certaine réussite matérielle. II y sera aidé par un camarade de guerre, Kader Kouïder, qui habite la mechta voisine, par la femme qu'il aimera et qu'il épousera, Elise Cortès. On notera, à travers les peines et les drames dont sa vie et celle de sa famille seront accablées, un fil conducteur, foi et espoir. La personnalité de cet homme exceptionnel marque fortement tout le récit. Et si les derniers chapitres sont tragiques, c'est qu'ils sont, malheureusement, la réalité des derniers mois vécus en Algérie avant l'exil douloureux.
Anne Cazal, dans ce livre-mémoire, ouvre son cœur, délivre un message où se devinent d’inguérissables blessures.
Jeanine de la Hogue
Journaliste et écrivain

Pour trouver et imprimer ce communiqué au format PDF

Et les autres documents ci-dessous, cliquez sur les lignes
Droit de mémoire - le film (Format PDF)
Bon de participation (Format PDF)
|
AVENIR DE L'EST
Extraits des chroniques
du Journal de Bône, Constantine, Guelma
Source BNF
|
|
Bône, du 1 au 13 Janvier 1934
CHRONIQUE LOCALE
LE "PALACE"
Présente sur scène la Tournée Charles BEAL
dans LE PAYS DU SOURIRE
L’opérette la plus en vogue ;
le plus beau spectacle du moment
avec M. Bernardo GALLOUR de l’opéra comique
Mme Adélia TROJANI du Capitole de Toulouse.
M. JOSSE du Trianon Lyrique.
M. RANTE du Théâtre des variétés.
Mlle Valy Winck de l’Opéra.
Mlle MARGERAT de la Gaîté Lyrique.
M. DESART du théâtre Royal de Bruxelles.
Et Mlles Thony NELLY, MARCHAND, Solange BARRE, Josette MYN-THO, YOU-KI, FOU-LY, YAKOMA, MYRTHO, SAM-LY, etc…
Orchestre sous la direction de Mlle Yvonne PERROT.
Grand Ballet Chinois, réglé par M. FEDOROFF,
maître de ballet de l’Opéra de Moscou.
Lever de rideau : Soirées, 20 h. 45
Matinées, Samedi et Dimanche, 15 heures.
Prix des places pour ce spectacle : Loges. 20 fr. ;
Premières balcons, 18 fr. ; demi, 9fr. ;
Orchestre, 12 fr. ; demi, 6 fr.
Deuxièmes balcons, 8 fr. ; demi, 4 fr.
Circulation, 6 francs.
NOTA. — Après le Pays du Sourire, le Palace reprendra la série de ses magnifiques projections avec deux grands films à son programme...
12 - 13 - 14 - 15 janvier 1934, LE PAYS DU SOURIRE.
Louez vos places 2, rue Perrégaux
UN EVENEMENT ARTISTIQUE
LE PAYS DU SOURIRE
Ce soir et jours suivants continuation dans le coquet établissement de la rue Thiers, la grande première du Pays du Sourire. Elle constitue sans aucun doute, l'événement artistique de la saison.
Comme nous l'avons déjà annoncé celle opérette est interprétée par la troupe officielle de l'Afrique du Nord, organisée par M. Charles Beal, « producer » de tant de belles pièces dans notre ville.
La composition de cette troupe aura à sa tète le brillant ténor péruvien Bernardo Gaillour, de l'Opéra comique, qui a fait une composition remarquable du prince Son Chong. Le rôle de la princesse Lisa sera joué et chanté par la jolie divette Adélia Trojani, du Capitole de Toulouse.
A côté de ces deux artistes de tout premier plan, M. Josse, le jeune premier trial de la Gaîté Lyrique de Paris; M. Rante, premier comique du Théâtre des Variétés; Mlle Valy Winck, la gracieuse fantaisiste du Trianon Lyrique, dans le rôle de My, la petite Chinoise.
Comme Paris, comme toutes les grandes capitales qui tiennent à perpétuer l'art du la musique, Bône aura « Le Pays du Sourire » c'est à dire une oeuvre grandiose, prodigieuse, éblouissante, autant de superlatifs qui ne reflètent qu'imparfaitement l'invraisemblable succès de cette opérette magique qui a fait courir tout le monde entier.
Le grand air de cet ouvrage : « Je t’ai donné mon cœur », sera chanté en italien et en espagnol par M. Bernardo Gaillour, et nul doute que le brillant ténor ne soit « bissé », voire « trissé », comme en France.
On ne pouvait choisir un meilleur spectacle: .en ce début de ce nouvel an, car c'est bien un spectacle sans précédent que peuvent voir toutes les jeunes filles. Aussi, convient-il de complimenter avec chaleur M. H. Lagardère, dont l'heureuse initiative trouvera sa juste récompense dans l'enthousiasme avec lequel on a accueilli « Le Pays du Sourire »
La partition de Franz Lehar est ardente, colorée, remarquablement orchestrée, et sa valeur musicale ne saurait se contester. Nombre de motifs, d'un joli dessin, en seront tôt détachés. Le livret ne cède en rien à la partition ; il prouve une rare tenue, séduit, amuse, son entrain est communicatif. Cette opérette, qui tient plutôt de l'Opéra comique; est le spectacle le plus en vogue à l'heure actuelle.
Nous ne pouvons donc que conseiller à nos concitoyens de ne pas manquer ces belles représentations qui demeureront dans leurs souvenirs.
L'orchestre, conduit par la « maestro » Yvonne Perrot, comprendra les meilleurs éléments de notre ville, parmi lesquels nous avons noté : MM. Kisseleff, violon solo ; Sagnol, premier violon ; Odnoralow, pianiste; Galéa, clarinette ; Spiteri J., flûte; Chamboissier, contrebasse; Loukastchouk, violoncelle; L. Porou (de l'Opéra d'Alger), hautbois ; Gauthier, alto ; Primout, batterie.
Piano Gaveau de la Maison Colin.
P.S. NOTE du Webmaster : Est-ce que quelqu’un peut m’envoyer une ou des photos du PALACE de la rue Thiers à Bône.
?o?-?o?-?o?-?o?
|
|
LA CAROUBE, LES GENS
par M. Charles Ciantar
|
|

Familles BORELLI, CIANTAR, DI BATISTA, HILLI, ZAMMIT

LES FAMILLES BORELLI, CIANTAR, DI BATISTA, HELLUL, ZAMMIT….

LES FAMILLES BARBATO, CANE, CIANTAR, DESIO, DI BATISTA, LUPINO….

FAMILLES DESIO, DI BATISTA………..

Mesdames BARBATO, CIANTAR, DI BATISTA, CANE

Photo J C PANE
FAMILLE PANE

Photo J C PANE
FAMILLE PANE

Photo JC STELLA
Les familles COLANDREA, PETRONI , STELLA………

Familles CANE, CIANTAR, DI BATISTA, NOMAY, VALLEE, ZAMMIT
Ciantar.charles@wanadoo.fr
Charles Ciantar
| |
TIMBRES D'ALGERIE
Envoyé par M. Daniel Bonocori et J.P. Bartolini
|
 Alger
Alger |
 Bône
Bône |
 Constantine
Constantine |
 Mostaganem
Mostaganem |
 Oran
Oran |
 Orléansville
Orléansville |
 Sétif
Sétif |
 Tizi-Ouzou
Tizi-Ouzou |
 Tlemcen
Tlemcen |
|
|
|
ECOLE DE SAINT-CLOUD
CE1 - 1A - 1961 envoyé par M. Beghdadi Ammar
Monsieur BARTOLONI, je vous envoie une photo d'école. Il s'agit de l'école de Saint Cloud à bône aujourd'hui Annaba, la photo -- dans laquelle je figure en sixième position de droite à gauche ou vice versa dans la rangée du milieu --date de 1961 pour la classe Cours Elémentaire 1; je voudrais que ceux qui se reconnaissent enrichissent la photo en y apportant leur nom. Merci.
Salutations Bônoises. Beghdadi Ammar

|
|
La petite Histoire de famille
de Monique Sammut
Envoyé par M. et Mme Robert et Monique Léon
|

Monique Sammut est née le 08 Octobre 1945 à Bône elle épouse Michel DURANTIN, puis Robert LEON.
Elle vit actuellement à Binic, charmant petit port des Côtes d’Armor et à Gruissan, autre port…. de l’Aude…
Elle est la fille de Sammut Antoine et de Louise Maniero.
Elle est la petite fille de Michel-Ange Maniero et de Anna Païno coté maternel ainsi que de Carmelo Sammut et de Thérèse Dimech coté paternel.
Sa grand-mère maternelle était remariée avec Raphaël Veneruso qui possédait le salon de coiffure « Idéal Salon » rue derrière les Galeries de France.
Elle nous transmet quelques photos de famille qui montrent leur implantation dans notre ville de Bône.
Son parcours scolaire commença à l’école maternelle Garibaldi.

Ecole Maternelle, rue Garibaldi 1949 ou 1950..
On retrouve dessus Gaëtan TABONI et sa sœur au premier rang, 1er et 2ème à gauche.

Ecole maternelle de la rue Garibaldi 1951 ; ??? Zarmia, Bédagoin, Diméglio, Jil, Léonti, Abédicha, Adouessa, ????, Bosco, Farrugia, Régine, Dégouille, ???, Biblia, Arissabas, Tafami, Nelly, Pace et Bussola……….. Monique est assise au 1er rang la 4ème à partir de la droite Gaêtan Taboni est au premier rang le 4ème à gauche.……..
Se continua tout naturellement à l’école Sadi Carnot.

Ecole Sadi Carnot année 1956 ; ??? Greck, Virgo, Léonti, Mota, Génardi, Bouguessa, Ben Amor, Hadi, Lupino, Zemouri, Moro, Hamadi, Salvati, Benyouness, Guittard, Dockan, Pouch, Lencioni, Esmin, ???, Robaglia, Lagréga, Taormina, Sammut, Lencioni Mireille, Ali Rachezdi, Mascor, Elbeze, Chelali….., Monique est au premier rang, la deuxième à gauche…..

Ecole Sadi Carnot année 1957 ?
Monique est au premier rang assise la 3ème à gauche
Les colonies de vacances

Colonie de vacances à Luz la Croix Haute en 1957….

Colonie de vacances à Luz la Croix Haute en 1958 organisée par la paroisse Sainte Anne et les sœurs Saint Vincent de Paul.
Puis le Collège Technique

Lendit scolaire 1959
Au premier rang 2ème à gauche assise Françoise Briand, Monique est au second rang la 7ème à gauche en comptant les instits.

Collège technique 1959 ou 1960
On reconnaît Robert Marigni, Sorlin et Lorquin, au premier rang de gauche à droite 3ème Frédérique ? 5ème Geneviève Betro, 7ème Jeanine Zammit, 8ème Josiane Chessa, et Monique Sammut dernière à droite
La famille au Cabanon de la Caroube

Sur cette photo, il s’agit de la Famille MANIERO qui possédait un « cabanon » à la Caroube, où la famille se retrouvait dès que possible, sur cette photo on retrouve : Tata Rosine MANIERO, Mémé Anne PAÏNO, Pépé Raphaël VENERUSO, Maman Louise MANIERO, Papa Antoine SAMMUT, Tonton Antoine MANIERO, Marraine Anne Marie MANIERO et Michel MANIERO ;
Tout ce monde habitait la Colonne, et plus spécialement la rue du 14 juillet pour la famille SAMMUT. Nous avons eu le plaisir de retrouver la maison intacte lors de notre visite en avril dernier. Le Père de Monique Antoine SAMMUT travaillait aux Galeries de France.

Même famille Anna PAÏNO, Raphaël VENERUSO, Rosine MANIERO, Michel et Anne Marie MANIERO ;

Anna PAÏNO, Antoine SAMMUT, Louise MANIERO et Christian SAMMUT

Rosine MANIERO, Anna PAÏNO, Louise MANIERO, Raphaël VENERUSO, Antoine SAMMUT, Mémé Thérèse DIMECH *, Anne Marie et Michel MANIERO et Christian SAMMUT.
*Thérèse DIMECH, grand-mère de Monique, était très connue dans le quartier de la colonne, veuve deux fois à 20 ans, elle était très pieuse et d’un courage à toute épreuve. Elle a élevé seule ses 5 enfants, Un peu médecin elle faisait les piqûres, soignait les gens avec des remèdes de « Bonne femme ». Elle soignait souvent gratuitement les pauvres, bien qu’étant elle-même peu riche. En outre elle servait d’interprète et d’écrivain public (elle parlait couramment l’Anglais, l’Italien, le Maltais, le Français et un peu d’Arabe…)
Sa petite fille Jeanne DIMECH (épouse MORGAT) doit fêter ses 100 ans prochainement. Nous la remercions pour les éléments qu’elle a pu nous apporter.
Actuellement on retrouve en France la descendance de Thérèse DIMECH : famille DIMECH à AUCH, Famille CAUCHI à Toulon, CAUCHI-PAYAN et CAUCHI à Voiron, Famille DIMECH-MORGAT à Angers, Famille DIMECH-RIBOUD à Metz et la région parisienne, Famille SAMMUT Christian à Lorient et Nantes, Famille SAMMUT-LEON (Monique) à Binic (22) et enfin famille DIMECH-POYER à Angoulême.
Quelques photos d'hier et d'aujourd'hui
  
Louise MANIERO, Antoine SAMMUT Monique SAMMUT
Maman de Monique Père de Monique
 
La Tante de Monique Religieuse de la Monique quelques temps
Doctrine Chrétienne, Sœur Anne Marie, avant le départ de Bône, 16 ans.
Née Rosinne Maniéro

Mounir HANECHE , son fils, Monique et Suzy à l’Ours Polaire, devant le Créponnet

Retrouvailles à la maison où habitait Monique, 5 bis rue du 14 Juillet.

Le caveau familial restauré et entretenu par Mounir.
Il manque quelques renseignements concernant la branche SAMMUT, originaire de Malte, suite au mariage de Thérèse DIMECH avec Carmelo SAMMUT, si parmi les lecteurs, quelqu’un a des renseignements, merci de les faire parvenir à M. Robert Léon : robert.leon@free.fr
|
SOUVENIRS DE LA GUERRE 39-45
Envoyé par Pierre Latkowski
|
Je ne peux m'empêcher de publier le message que m'a adressé Pierre Latkowski qui de ses "plus de 90 ans" est toujours sur Internet. Fidèle parmi les fidèles, depuis le début de la Seybouse, il est un exemple pour tous ceux qui disent qu'Internet n'est pas de leur âge. Il nous fait revivre un de ses souvenirs de guerre.
Merci Pierre.
Message de Pierre.
Bonjour Jean-Pierre et merci pour ce nouveau numéro de La Seybouse, le premier d'une année 2011 qui, comme il est de coutume à cette époque, nous donne l'occasion de partager notre aspiration à des temps meilleurs.
Oui, les années se succèdent, sur nos épaules de plus en plus fragiles mais toujours là, prêtes à supporter une fois de plus le poids d'une nouvelle tranche de vie, avec ses joies et ses peines. Et ces échanges annuels nous apportent à chacun les encouragements de nos amis à continuer ce que seuls nous aurions du mal à assumer. Au-delà des mots, toujours aussi sincères mais toujours les mêmes, santé, bonheur, réussite, c'est l'Espérance qui habite en nous que l'on offre ainsi à ceux qu'on aime.
La Seybouse me donne chaque mois l'occasion de retourner dans ce monde qui m'est cher, ce passé où je me réfugie de plus en plus, où je retrouve des marques que je perds dès que la vie actuelle m'accapare. C'est un moment d'évasion bienheureux vers ce qui fut mon univers pendant 38 ans.
Des images, des paroles, des attitudes me reviennent et me semblent plus vivantes, plus vraies que celles que m'offre le présent.
Il y a quelques jours, pendant mes rêveries, un air m'est revenu, une chanson que tu n'as sans doute pas entendue car elle date de 1942-43, et je ne pense pas qu'elle ait été chantée après la guerre, car elle s'est répandue parmi les 150.000 pieds-noirs mobilisés après le débarquement anglo-américain. Avant la réception des uniformes USA sous lesquels nous avons combattu, nous étions affublés des anciennes tenues de l'armée française, bourgerons, croquenots et bandes molletières auxquels le sex-appeal des plus élégants d'entre nous ne pouvait résister. Et ceux qui ont voulu tenter leur chance auprès de la gent féminine ont dû en éprouver les conséquences puisque, sur l'air de "un mauvais garçon" que chantait Henri Garrat à l'époque, on avait mis les paroles suivantes :
(texte ci-dessous)
Je ne garantis pas l'exactitude du texte. Peut-être quelqu'un pourra compléter, corriger et éventuellement glisser dans les souvenirs pieds-noirs ce témoignage d'un état d'esprit qui a régné un temps dans notre armée, moins glorieux que "le chant des africains", mais tout aussi authentique.
Voilà, Jean-Pierre, ce que "La Seybouse" m'a donné aujourd'hui envie de te dire.
Bonne année 2011, Pierre
****************
LES FEMMES DE CHEZ NOUS
Nous les Français
Nous ne sommes pas aimés
Les femmes chez nous,
Nous laissent toutes tomber
Il faut avoir pour être à leur goût
Du cheuouine-gomme, des dollars, de tout.
La chéchia ça fait moche,
On n'a pas d'pèze dans la poche,
Et c'est pour ça quand les p'tites femmes nous voient,
Elles disent en nous montrant du doigt…
REFRAIN
C'est un soldat français,
Y a rien à gratter,
Vaut mieux qu'on l'évite.
Allons voir Johnny,
Qui fait les délices de nos nuits.
C'est un gentil garçon,
Qui lâche son pognon
Sitôt qui s'explique
Avec l'Amérique et les Américains
Nous ne manquons de rien.
****************
|
|
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793) (N°4)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
PREMIÈRE PARTIE
LES ORIGINES (1560-1635)
CHAPITRE III
L'ÉTABLISSEMENT DES CONSULS
ET DES MARCHANDS FRANÇAIS
DANS LES ÉCHELLES DE BARBARIE
L'origine des Consulats et des échelles barbaresques n'est pas entourée de moins d'obscurité que celle des Concessions d'Afrique. L'établissement des Turcs en Barbarie, l'activité plus grande qu'ils donnèrent à la course et leur mépris pour le commerce avaient encore restreint le trafic fait par les chrétiens sur les côtes du Maghreb dont l'importance, depuis plusieurs siècles, était déjà bien réduite. Il semblait, au début, que les nouveaux maîtres de la Barbarie devaient entretenir avec les Français des relations aussi hostiles qu'avec les autres riverains du Nord de la Méditerranée : en 1532, Barberousse fit une croisière sur les côtes de Provence et les îles d'Hyères furent menacées. Les Marseillais, malgré les conjonctures difficiles, ne durent jamais, cependant, cesser d'aller faire sur ces côtes leurs chargements habituels. La signature des capitulations et les relations particulières d'amitié nouées à partir de 1535, avec Barberousse et ses successeurs les Beglierbeys ou vice-rois d'Alger, jusqu'à la mort du dernier d'entre eux. Euldj-Ali, en 1587, leur permirent, malgré la turbulence croissante des corsaires, de reprendre leur commerce avec plus de sécurité et de chercher à établir, dans les principaux ports barbaresques, des résidents protégés et surveillés par des consuls, comme dans les pays du Levant. Mais, pour la fondation, de ces consulats de Barbarie, on devait se heurter à des difficultés qu'on n'avait pas rencontrées pour ceux du Levant, et même on allait aboutir en partie à des échecs.
La mort d'Euldj-Ali marque une des époques de l'histoire de la Régence : elle est suivie de l'abandon de la protection effective de la Porte pour Alger et réciproquement, de la rupture des liens d'obéissance qui rattachent cette ville au chef de l'Islam. La France, notamment, vit changer du tout au tout des relations jusqu'alors excessivement cordiales et que Euldj-Ali, pour sa part, avait entretenues avec la plus grande affection.
Il semble bien que c'est sur l'initiative de l'ambassadeur de Charles, IX, à Constantinople, Pétremol de Norvoie, que fut créé le Premier consulat en Barbarie. Dans une lettre au roi, du 15 Juillet 1565, Pétremol proposait cet établissement comme le meilleur moyen de contenir les Algériens, dont les pirateries commençaient à susciter des plaintes (1). " Pour obvier dorénavant, disait-il, aux courses et des larcins corsaires, il ne serait impertinent que V. M. donnât licence a ceux de Marseille de tenir en Barbarie un Consul comme en Egypte et en Syrie. Car, outre que, pour le trafic de leurs marchandises ils en ont un besoin, lesdits corsaires se garderont bien d'aller vendre leur proie ni mener navires et butin là où ils sauront qu'il y aura quelqu'un pour V.M. qui, avec les commandements du G. S., les pourra faire châtier ". L'ambassadeur attachait tant d'importance à son idée que, le même jour, il écrivait au baron de la Garde pour la lui exposer et lui demander de l'appuyer de tout son crédit. Il la recommandait aussi aux Marseillais, dans une lettre du 4 août, où il leur annonçait l'arrivée prochaine d'un négociant de leur ville qui leur rapportait des commandements du Sultan pour le vice-roi d'Alger ; il en reparlait de nouveau au roi le même jour et dans une autre lettre du 17 septembre. Cependant l'idée première du consulat n'appartient peut-être pas à l'ambassadeur puisque, l'année précédente, le marseillais Bertolle avait été pourvu de l'office de Consulat d'Alger par lettres-patentes de Charles IX, du 15 septembre 1564 (2). Dans ses lettres de 1565, l'ambassadeur ne fait aucune allusion à des propositions analogues qu'il aurait pu faire auparavant, ni à Bertolle.
Quoi qu'il en soit, les Marseillais n'avaient pas sollicité la création de ce poste ; ils essayèrent même de la faire révoquer, Pour comprendre cette opposition, il faut se souvenir que les consulats d'alors étaient des offices vénaux dont le titulaire ne recevait pas d'émoluments et percevait pour sa subsistance des droits sur le commerce. Le Conseil de ville considérant que " tel office se trouverait grandement dommageable à la chose publique de Marseille pour raison que, de la langue française, nul trafique audit Argiers que ceux de la présente ville, pour raison des droits que ledit consul pourrait lever audit lieu des marchandises y allant", délibéra, le 2 septembre 1565, de poursuivre par tous les moyens, par devant le conseil privé du roi, le procès engagé contre Bertolle. Thomas Lenche, le fondateur du Bastion, était alors 2ème consul de Marseille ; peut-être vit-il dans l'établissement d'un consul à Alger une menace pour l'importance de sa compagnie et pour son propre crédit auprès des Puissances. Si cette délibération fut inspirée par lui, elle montrerait à ses débuts la naissance de la longue rivalité entre les compagnies d'Afrique et les résidents français à Alger.
D'un autre côté, les Algériens ne voulaient pas recevoir de consul ; l'arrivée de Bertolle y excita une grande indignation et le nouveau venu ne reçut pas la permission de débarquer. Pour triompher de leur répugnance on eut recours, plus de dix ans après, à l'autorité de la Porte ainsi que nous l'apprend une lettre de l'ambassadeur d'Henri III, Gilles de Noailles abbé de Lisle : " Et m'a été encore accordé plusieurs bons et avantageux commandements ... et fait établir le capitaine Maurice Sauron, pour consul en Alger ainsi que V.
M. m'en avait aussi écrit ci-devant et envoyé des lettres à cet effet. Lesquelles ce néanmoins je n'ai présentées, n'estimant que l'affaire le méritât, encore que par ci devant l'on eût toujours remis au vice-roi dudit lieu de pourvoir à cela et comme chose dépendante de sa charge ; qui toutefois ne les y veulent comporter afin qu'ils n'éclairent et observent les grands larcins qui se font en ces côtes de delà ". En dépit des commandements du G. S. Maurice Sauron ne put faire accepter le nommé Guighigotto qu'il envoya à Alger pour faire gérer son consulat. Le pacha d'Alger s'excusait auprès des consuls de
Marseille en leur écrivant le 28 avril 1578: " Nous ne trouvons aucun moyen pour le mettre en place, la chose répugnant à l'esprit des marchands, du peuple et de tous. Ils ne veulent point admettre la nouvelle autorité que vous leur imposeriez... Nous serions bien surpris que vous l'ayez permis, vos prédécesseurs n'ayant jamais eu la hardiesse de le faire... Lorsque vous nous demanderez des choses qui seront dans nos habitudes et conformes à nos devoirs nous ne manquerons pas de vous montrer la bonne volonté que nous avons de vous faire plaisir ". De nouveaux commandements plus catégoriques furent obtenus à la Porte en 1580 et Sauron put prendre possession de son consulat ainsi qu'il résulte d'un document perdu mais analysé dans un ancien inventaire des archives de la Chambre de Commerce de Marseille, Dès lors, la France ne devait plus cesser d'être représentée à Alger ; mais le temps de l'alliance franco-algérienne était passé ; les efforts d'Henri IV ne purent empêcher sa ruine définitive. Aussi l'établissement de nos consuls, loin de marquer le commencement d'une ère de prospérité pour notre commerce, coïncida plutôt avec le commencement d'une longue décadence. L'état de guerre avec Alger étant devenu presque la règle, nos consuls restèrent exposés sans cesse aux insultes, aux mauvais traitements, au bagne et même à la mort ; il fallut attendre encore plus d'un siècle avant qu'ils pussent vivre à Alger avec quelque tranquillité (3). Les Anglais qui venaient d'obtenir des capitulations à la Porte et de fonder la Turkey Compagny s'empressèrent de profiter du succès des Français. Quelques années après, leur ambassadeur à la Porte. William Hareborne, nomma John Tipton, l'agent de la Compagnie à Alger, consul d'Angleterre à Alger. Tunis et Tripoli.
Mais ce n'était pas là un véritable consul de Sa Majesté britannique et les Algériens ne le considéraient pas comme tel. S'il faut en croire une relation du temps, utilisée par Playfair. Il n'y avait pas encore de consul anglais en 1620, et le premier fut alors installé de bizarre façon. Cette année-là, écrit Playfair, sir Robert Mansel conduisit à Alger la première force navale britannique qui fût entrée dans la Méditerranée depuis les Croisades. " Le dey, bien qu'il nous eût donné des otages comme gages de la sécurité de notre messager, le capitaine John Roper, porteur des lettres royales, fit connaître sa résolution de ne le renvoyer qu'autant qu'il serait remplacé près de lui par un consul " ... Afin de répondre à cette exigence du dey, l'amiral fit immédiatement vêtir convenablement un homme de son équipage et le fit débarquer comme consul. Les Turcs le reçurent avec déférence, rendant à ce fonctionnaire improvisé tous les honneurs dus à la dignité dont il portait les insignes ... L'amiral ne put obtenir que 40 captifs ; il partit le 7 décembre au matin, laissant ses dernières instructions à son consul et adressa au dey une lettre sévère sur sa conduite déloyale. La flotte sortit du port après avoir infructueusement tenté de brider les vaisseaux turcs qui s'y trouvaient. Playfair ne dit pas ce qu'il advint de ce consul ainsi improvisé et installé.
La même année qu'Henri III avait pourvu Maurice Sauron du consulat d'Alger, il avait créé un consulat à Tunis par lettres patentes du 28 mai 1577 et en avait pourvu le capitaine marseillais Louis de la Motte Dariès (4). Les Turcs venaient à peine de chasser les Espagnols de Tunis (1573) et devaient sentir, plus qu'à Alger, la nécessité de ménager les Français ; d'ailleurs, la situation politique et économique à Tunis était tout autre. Dariès put entrer paisiblement en possession de sa charge et une lettre du Pacha à Henri III, du 16 juin 1579, témoigne des égards que les Tunisiens avaient pour le consul (5). Il transmit sa charge, en 1581, à Thomas Martin, capitaine marseillais, qui la remplit paisiblement et dignement, et obtint, en 1618, avec l'appui des consuls de Marseille, la permission de résigner son office en faveur de son fils, Pierre Martin (6). Le consulat de Tunis fut ainsi établi définitivement sans avoir donné lieu à des difficultés. Ni l'importance du trafic, ni la puissance des Tripolitains ne firent juger nécessaire, pendant un certain temps, l'établissement d'un consul dans leur ville (7). Ils affectaient d'être irrités des égards que la France avait pour leurs voisins de Tunis et d'Alger, et ce fut le prétexte qu'ils invoquèrent souvent pour courir sus à nos navires et faire nos marins esclaves en dépit des commandements de la Porte. Mais, en réalité, ils regrettaient surtout de ne pas recevoir les présents que nos consuls distribuaient aux Algériens et aux Tunisiens, et ils voyaient, en outre, dans l'établissement d'un consul, l'occasion de fructueuses avanies. Il semble que la Cour de France ait jugé utile, à diverses reprises, de leur donner satisfaction ; nais, bientôt, la situation du consul paraissait intenable au milieu de cette population, la plus hostile aux chrétiens de toute la Barbarie, et dont le commerce n'offrait aucune ressource ; le poste était de nouveau abandonné. C'est ainsi qu'un premier consul établi par Henri IV s'en alla vers 1610 ; un sieur Nicolas Brun fut pourvu de l'office en 1613 par la résignation de François du Mas et se trouvait encore en charge en 1619(5).
Mais il dut bientôt quitter Tripoli ; en 1620, les Tripolitains étaient en guerre ouverte avec la France. D'après une Histoire de Tripoli, " en 1630, Louis VIII ayant fait délivrer les esclaves, Berenguier qui fit le voyage y laissa du Moulin en qualité de consul de l'agrément de Mustafa dey. Ce consul ne fut que deux ans à Tripoli, parce que les Corsaires recommencèrent les hostilités (8). " Deux ans après, en 1634, le pacha promettait son amitié au capitaine marseillais Jean Beau, envoyé pour négocier, si les Français voulaient établir un consul. Il parait qu'en 1617, un certain Noël Jourdan reçut des lettres de provision de consul à Tripoli, en date du 29 juillet, mais le pacha ne voulut pas le recevoir : ce consulat, qu'on ne pouvait parvenir à établir, était alors, comme celui d'Alger, la propriété des pères de la Mission (9). Les Tripolitains devaient attendre jusqu'après 1680 pour entrer en relations régulières et pacifiques avec la France. Cependant, " en 1640, dit l'auteur de l'Histoire de Tripoli, Bayon, marchand français, s'y établit pour trafiquer et s'y acquit une telle considération qu'il y fit toutes les fonctions de consul bien qu'il n'eût aucune commission du roi. Estienne, grand marchand de Marseille, demeura aussi longtemps à Tripoli, il fut considéré comme consul quoiqu'il n'eût non plus aucun pouvoir du roi." C'est seulement aussi dans la seconde moitié du XVIIème siècle que les Anglais devaient avoir un consul à Tripoli ; cette ville resta jusques-là nominalement dans la juridiction de leur consul d'Alger.
L'Empire du Maroc (10), qui ne reconnaissait ni la suprématie politique, ni l'autorité religieuse du Sultan de Constantinople, avait une situation à part parmi les États barbaresques. Mais la même politique, qui avait poussé les rois de France à contracter alliance avec les Turcs, devait les engager à entrer en relations avec ce pays. Tandis que François 1er luttait en Europe contre la formidable puissance de Charles-Quint, il songeait aussi à prendre sa part des richesses fabuleuses de ces terres lointaines que les Espagnols et les Portugais prétendaient s'être partagées. En attendant, les corsaires français, normands ou bretons, guettaient au passage les galions ou les caraques qui revenaient chargés de l'or, des riches marchandises ou des dépouilles des Indes. Mais, s'il leur arrivait de faire de riches prises, ils s'exposaient aussi aux plus grands périls. Croisant dans les parages du sud de l'Espagne et du Portugal, des Açores, des côtes du Maroc, là où se rencontraient les routes du Mexique, du Brésil et des Indes-Orientales, dans une mer sillonnée de navires espagnols et portugais ; ils couraient le risque de se voir donner la chasse par un ennemi supérieur, sans avoir dans ces parages un seul port ami où ils pussent se réfugier. N'était-il pas naturel de songer à trouver au Maroc ces ports de refuge ? M. de La Roncière, qui a raconté récemment la première mission française au Maroc, remarque avec raison qu'elle fut envoyée peu de temps après que le grand armateur Ange eût obtenu des lettres de marque contre les Portugais en 1530 ou 1531.
Il parait cependant que François 1er fut décidé à l'envoi d'une ambassade par le rapport enthousiaste que lui fit un marchand Hémond ou Hamon de Molon, de retour d'un voyage au Maroc, sur les richesses de ce pays. C'est en 1533 que partit de Honfleur, sur une galéasse, l'envoyé du roi, le colonel Pierre de Piton, vieux routier des guerres d'Italie, et qu'il débarqua à Larache, après avoir échappé aux croisières portugaises. Appelé par le roi de Fez, Piton, malgré son inexpérience, malgré l'insuffisance des présents qu'il avait apportés, réussit dans sa mission et obtint d'Ahmed el Oates des promesses avantageuses pour les Français. Tout bâtiment français " soit marchand, soit navire de guerre, soit corsaire, et tous manyères de navires, pourveu qu'ilz soient voué du roy, soit en guerre et en quelque temps du monde", écrivait Piton dans son rapport, pourra se ravitailler dans les ports du roi de Fez ; il lui suffira d'exhiber des lettres du roi ou de l'amiral de France.
Mais l'expédition finit mal. Piton, brouillé avec le capitaine de son navire, fut abandonné et trahi par lui au retour. Il eut le bonheur d'échapper aux Portugais auxquels il avait été dénoncé par le traître. Mais, malade et découragé, il mourut sur les côtes de Galice où la tempête l'avait jeté. Les gentilshommes qui l'avaient accompagné étaient morts de la peste à Fez. Cependant, le navire revint en France et le roi reçut les présents du roi de Fez avec le rapport de l'ambassadeur (11).
Cette première tentative fut-elle poursuivie ? L'absence de documents n'autorise pas il affirmer que les relations avec le Maroc aient été abandonnées. Ce n'est que plus de quarante ans après, en 1577, l'année où des consuls furent envoyés à Alger et à Tunis, que Henri III nomma consul au Maroc le marseillais Guillaume Bérard " à cause des grands services rendus à notre commerce et à l'affranchissement des Français esclaves chez les Maures ". Mais les lettres patentes qui instituaient ce consulat affirmaient à la fois l'existence antérieure de notre commerce et l'amitié du souverain marocain pour la France : " Considérant qu'il est nécessaire pour le bien de nos sujets trafiquant ès royaumes de Maroc et de Fez qu'il y ait ès dites parties un consul de la nation française créé et autorisé de nous savoir faisons que nous inclinant libéralement à la prière et requête que fait nous a été par le roi desdits royaumes de Maroc et de Fez, notre très cher et parfait ami, ès faveur de notre très cher et très allié Guillaume Bérard de notre ville de Marseille….. les constituons par ces présentes consul de la nation française ès dits royaumes " (12)
Outre les termes de ces lettres patentes, un autre document relatif à Bérard, établit nettement qu'il y avait déjà des relations suivies et des traditions de bons rapports entre la France et le Maroc. A peine rendu à son poste, ce consul fut renvoyé en France par le Sultan avec des lettres pour Henri III et une mission " tendant à la confirmation et à l'entretien de l'amitié qui était entre S. M. et le feu roi (de Maroc)... Désirant faire connaître audit sieur roi combien lui avait été agréable cette démonstration de sa bonne volonté, " Henri III chargea Bérard de lui remettre une lettre où il exprimait ses regrets de la perte " d'un bon ami ", et la joie que sa succession fût tombée entre les mains d'un prince " rempli de vertus ". En outre, Bérard devait " remontrer la promesse que ledit feu roi avait faite à S. M. de permettre l'accès en tous ses ports aux sujets de ce royaume tant pour le trafic et commerce qu'ils pourraient faire en ces pays que pour y avoir sûreté contre leurs ennemis et de faire mettre en pleine liberté tous les Français et autres de ses sujets qui se trouveraient esclaves en ce royaume, avec défenses à tous ses corsaires de n'entreprendre de là en avant à l'encontre de ses sujets en leurs personnes ni en leurs biens et marchandises (13) ".
En outre, les Français faisaient un commerce régulier avec le Maroc. Bérard se plaignit au roi de ce que, malgré tout le mal qu'il s'était donné pour le favoriser, les capitaines partaient sans lui payer les droits ordinaires de consulat. Avant de retourner à son poste, il put obtenir un arrêt du Conseil, en date du 19 juillet 1579, spécifiant qu'il percevrait ces droits de la même manière que les consuls établis " ès parties d'Alexandrie et Tripoli de Surie, Tripoli de Barbarie, Gelby, Thunis, Bonne et Argiers ". Ainsi, dès l'origine, nos relations officielles avec le Maroc apparaissent toutes différentes de ce qu'elles devaient être avec Alger ou Tunis. Le sultan était souverain d'un état pour lequel la course était bien loin de constituer le principal moyen d'existence. Aux époques où leur pays n'était pas désolé par l'anarchie, malheureusement trop fréquente, les Marocains sentaient l'utilité de nouer des relations commerciales régulières avec l'Europe.
Déjà, les Français n'étaient pas les seuls à avoir traité avec eux. Les Anglais les avaient suivis au Maroc au moment où ils cherchaient aussi à pénétrer dans la Méditerranée et dans le Levant. C'est en 1551 que, sur un gros navire, le Lion, de Londres, un capitaine anglais Thomas Windham alla, pour la première fois, trafiquer au Maroc, où Il revint en 1552. Mais c'est en 1577, l'année même de la mission de Guillaume Bérard, qu'on vit au Maroc le premier ambassadeur anglais, Edmond Hogan, écuyer de la reine Elisabeth, envoyé par elle à Muley Abd-el-Melek, empereur du Maroc, roi de Fez et de Sous. C'était le moment où le marchand William Hareborn négociait au nom de la reine à Constantinople et obtenait les capitulations de 1579.
En 1585, un autre ambassadeur, Henry Roberts était envoyé près du nouveau sultan Muley Hamet, obtenait de lui la défense d'inquiéter les Anglais dans ses états et de les faire esclaves, et demeurait trois ans dans le pays. Les bonnes dispositions du souverain du Maroc décidaient même un certain nombre de gentilshommes et de marchands de Londres à constituer une compagnie à laquelle Elisabeth accordait une charte et des privilèges, en 1585. A la tête de la liste des gentilshommes qui en faisaient partie, on voyait les noms des comtes de Warwick et de Leicester. Les Anglais cherchaient à se renseigner sur les ressources du pays et, en 1594, un certain Madoc Laurence envoyait du Maroc à un marchand de Londres Anthony Dassel une relation sur l'état des villes et des provinces de Tombuto et de Gago que les Marocains venaient de conquérir. Les corsaires et pirates anglais, à ce qu'il semble, fréquentaient, plus que les marchands, les côtes du Maroc. Henry IV se plaignit souvent du refuge qu'ils y trouvaient et de la facilité qu'ils avaient d'y conduire leurs prises. Davity affirme que, quand la flotte espagnole s'empara de Mamora en 1614, " elle délogea de la rivière certains Anglais auxquels elle servait de retraite et de dépôt pour leur butin, avec grand profit pour eux et les marchands maures ".
Comme dans le Levant, les Hollandais n'apparurent que les derniers, après que la trêve de douze ans leur eût permis d'établir leur navigation dans les parages de la Méditerranée. En 1610, le sultan Muley Zeidan envoya en Hollande le caïd Hamed ben Abdullah qui conclut avec les États Généraux un traité renouvelé, en 1622, par une ambassade hollandaise au Maroc.
Français, Anglais et Hollandais, étaient bien accueillis ou même recevaient des avances des souverains du Maroc parce que ceux-ci ne pouvaient et ne voulaient pas nouer des relations commerciales avec leurs voisins, Espagnols et Portugais, leurs ennemis traditionnels, qui ne manquaient aucune occasion de faire de nouvelles conquêtes à leurs dépens, en profitant de la décadence de la puissance des sultans mérinides, au XVIème siècle, et des guerres civiles qui désolèrent le Maroc. Les Portugais avaient pris Ceuta en 1413, Tanger en 1471, ainsi qu'Arzilla ; celle-ci, rendue en 1553, avait été réoccupée de 1577 à 1588. En 1507, ce fut le tour de Safi, puis de Sainte-Croix, près du cap d'Aguer; cette dernière fut perdue en 1536 et Safi, qui avait résisté à plusieurs sièges, fut démantelée et évacuée en 1539, parce qu'elle coûtait trop cher à défendre à la cour portugaise. Les Portugais furent plus heureux avec Mazagan que le roi Emmanuel fonda en 1506 et qu'ils gardèrent jusqu'au XVIIIème siècle ; enfin, en 1513, ils s'emparèrent d'Azemmor : Mamora, prise en 1515, n'avait pu être conservée. Les Espagnols avaient Mélilla depuis 1496: le Peñon de Velez, occupé par eux de 1508 à 1522, leur restait définitivement en 1564 ; Larache tombait entre leurs mains en 1610, Mamora en 1614 (14). La haine entre les Espagnols et les Marocains avait encore été accrue par l'expulsion des Morisques en 1610.
Espagnols et Portugais ne songeaient qu'à la lutte contre les Infidèles et leur commerce ne profitait pas de leurs conquêtes. Au début du XVIème siècle, les Portugais, outre leurs nombreuses possessions de la côte, exerçaient une sorte de suzeraineté assez loin dans l'intérieur ; ils imposaient aux indigènes des contributions considérables et l'obligation de leur fournir des auxiliaires armés. Mais cette situation n'avait pas duré longtemps. Les premiers chérifs avaient établi leur autorité sur les populations côtières et réduit les Portugais à la possession de leurs places avant 1550. Dès lors, celles-ci ne furent plus que des garnisons en lutte continuelle avec les Marocains, obligées de recevoir même tous leurs ravitaillements du dehors et réduits à une situation très précaire. Mocquet raconte comment, en 1602, il passa au Maroc sur un navire de Saint-Malo qui fut affrété à Lisbonne pour porter en diligence du blé et du biscuit aux soldats portugais en garnison à Mazagan. On avait bien envoyé d'autres navires chargés de vivres, mais ils avaient été pris par les pirates. " C'était une grande pitié, remarque-t-il, de voir ces pauvres gens comme ils étaient affamés et si ces vivres ne fussent arrivés à propos, je crois qu'ils fussent tous morts ou ils eussent été contraints de se rendre esclaves aux Mores ". Tout port du Maroc occupé par les Espagnols ou les Portugais pouvait être désormais considéré comme perdu pour le commerce (15).
Si les Marocains avaient intérêt à attirer chez eux les Français, les Anglais et les Hollandais, les Espagnols et les Portugais voyaient de fort mauvais oeil le trafic de ceux-ci. Ils les soupçonnaient, non sans raison souvent, de porter des munitions à leurs ennemis. C'est l'accusation qui fut portée contre l'envoyé de François 1er, Pierre de Piton, quand il fut dénoncé aux Portugais par le capitaine de son navire. Vincent Leblanc raconte comment le navire sur lequel il était, ayant échoué près de la côte espagnole, fut pris par les galères royales et emmené à Gibraltar. Le capitaine eut beau faire jeter précipitamment à la mer " plus de 2,000 balles de canon et grande quantité de poudre ", il ne put éviter l'accusation de porter de la contrebande de guerre aux Marocains, et la condamnation à mort ou aux galères pour les passagers et l'équipage. Heureusement, on eut le temps d'intervenir à Madrid d'où vint l'ordre de relâcher les prisonniers. Pareille aventure faillit arriver à Mocquet qui revenait en 1602 sur un navire de Saint-Malo, chargé de poisson à Arguiti. Les Espagnols voulurent retenir le bâtiment à San-Lucar de Barrameda, sous prétexte que, dans des voyages précédents, il avait vendu du blé et des armes aux Maures.
Les relations créées par François 1er, et Henri III ne furent plus interrompues et l'on petit considérer le consulat du Maroc comme définitivement établi, bien que la pénurie des documents ne permette pas d'en suivre complètement l'histoire. Guillaume Bérard étant mort au moment où la France ne reconnaissait pas encore l'autorité d'Henri IV, c'est au nom de Charles. X, roi de la Ligue, que le Parlement d'Aix enregistra des lettres patentes donnant commission à Georges Fournier pour exercer le consulat de Fez et Maroc. Des Français étaient certainement établis dès lors au Maroc. L'un d'eux, Pierre Treillault, était même officier de la maison du sultan, en 1596, et adressait l'année suivante de Rouen, au connétable de Montmorency, une relation des derniers évènements du Maroc (16).
Henri IV, si préoccupé de former des alliances contre l'Espagne et de développer notre commerce, ne pouvait négliger nos relations avec le Maroc. Il eut auprès du sultan un agent, le médecin de Lisle, dont les documents ne permettent pas de caractériser nettement la mission. De Lisle fit un premier et long séjour au Maroc, antérieurement à l'année 1600. Rien n'indiquerait qu'il y jouât alors un rôle politique, sans l'affirmation du voyageur Mocquet, " garde du cabinet des singularités du roy ", au courant des choses de la Cour, qui, parlant de son passage à Maroc en 1606, écrit : " Le sieur de l'Isle était de longtemps près la personne du roi du Maroc comme en qualité d'agent pour notre roi Henri le Grand et y avait été encore depuis envoyé le sieur Hubert médecin du roi, pour relever le sieur de l'Isle, puis tous deux étaient revenus en France, mais depuis ledit sieur de l'Isle y était retourné (17) ".
C'est en 1606 que de Lisle revint au Maroc avec une mission mieux définie ; on le voit dès lors en correspondance avec le roi et avec le secrétaire d'État Villeroy (18). En janvier 1606, au moment de s'embarquer, De Lisle écrivait à Villeroy : " Il serait besoin que S. M. m'honorât du titre d'ambassadeur, d'autant que ce prince m'a fait dire qu'il ne traitera qu'avec ceux de cette qualité ". Cette lettre semble bien Indiquer que de Lisle partait avec mission de négocier un traité formel, traité d'alliance peut-être, traité de commerce aussi sans doute, analogue aux Capitulations. De Lisle reçut-il le titre qu'il sollicitait ? on ne sait, mais Mocquet, qui le vit quelques mois après à Maroc, ne le lui donne pas. Quoi qu'il en soit, il en joua effectivement le rôle comme le montre cette lettre de Henri IV au chérif Muley Cheikh : " Nous nous remettons à ce que vous en dira de notre part le sieur de Lisle auquel nous vous prions sur l'un et l'autre sujet et dorénavant en ce qu'il aura à traiter avec vous pour notre service vouloir ajouter pareille foi et créance qu'à nous-mêmes " (19). De Lisle, encore au Maroc en avril 1808, était de retour en France au mois d'août de la même année ; son séjour n'avait donc pas été de longue durée. On ne sait rien du résultat de ses négociations. On pourrait penser que c'est leur succès qui décida Henri IV, à nommer un consul en résidence au Maroc. C'est en effet le 16 septembre 1607 que furent expédiées les lettres patentes contenant " provisions pour Guillaume Curol, marchand, citoyen de la ville de Marseille avec survivance en faveur de Philippe aussi citoyen de Marseille ". Comme Henri IV ne reconnaissait pas la validité de la nomination de Georges Fournier faite au nom du roi de la Ligue, il était dit dans ces lettres que " l'état et office de consul était vacant, puis quelque temps déjà, par la mort de feu Guillaume Bérard, dernier paisible possesseur d'icelui."
Quelles qu'aient été les négociations entamées par Henri IV, les lettres échangées avec de Lisle ou avec les différents chérifs attestent qu'au début du XVIIème siècle, malgré des réclamations inévitables au sujet des corsaires, la bonne intelligence était bien établie entre la France et le Maroc. Les sultans ne demandaient qu'à l'entretenir : " Maintenant que Dieu nous a bénis, écrivait Muley Zeidan à Henri IV en 1607, nous souhaitons que nos Majestés entretiennent l'amitié qui s'est conservée entre nos prédécesseurs ; il ne tiendra à nous que cela n'arrive ; si votre Majesté nous mande des nouvelles de sa prospérité, ce sera nous obliger de croire qu'elle désire nous faire part de son amitié " (20). Ni les guerres civiles qui désolaient alors le Maroc, ni l'abandon de la politique de Henri IV par Marie de Médicis n'altérèrent les bonnes relations ; mais, en 1616, une fâcheuse affaire vint les rompre pour plusieurs années et porter un coup funeste au commerce français. Peu après son arrivée, un nouveau consul français, Jean Philippe de Castellane (21), abusa de la confiance que lui témoignait Muley Zeïdan pour lui dérober la valeur de plusieurs millions de pierreries et de livres, aussi précieux par leur reliure que par leur rareté. Chargé de mettre ce trésor en lieu sûr dans un des ports du sud du Maroc, alors que Zeïdan croyait sa situation menacée, il chercha à l'expédier en France sur un navire qui fut capturé par les Espagnols. Le Sultan, furieux, fit mettre tous les Français à la chaîne et même l'acte infâme du consul coûta " la vie de plusieurs ". Heureusement, Muley Zeïdan négociait alors avec la Porte ; son envoyé, qui se trouvait quelque temps après à Constantinople, affirma à notre ambassadeur, Achille de Harlay, baron de Sancy, que son maître serait disposé à recevoir avec honneur un nouveau consul.
Sancy lui avait fait croire que " le sieur de Castellane était un effronteur qui avait supposé des lettres du roi de France (22) ". Il obtint l'envoi d'un chaouch du Grand Seigneur avec des lettres où celui-ci demandait la délivrance des Français; un agent de l'ambassadeur l'accompagna " pour ne rien omettre qui put faciliter la délivrance de ces pauvres gens. " Sancy pensait recueillir les fruits de ce zèle pour lui-même. " Je supplie donc M. de Villeroy, disait-il en terminant la lettre où il exposait sa conduite, de me vouloir, s'il lui plait, faire expédier lettres du consulat pour la nation française à Marrok et à Fess et terres en dépendantes avec les mêmes droits des consulats du Levant, savoir deux pour cent sur tout ce qui s'y porte ou bien sur ce qui s'en enlève et je lui en donnerai quatre mille francs, espérant que peut-être ci après y ayant un peu raccommodé les affaires, car j'espère qu'elles le seront un peu par l'allée au delà dudit chaouch, il s'y pourra commencer quelque négoce. J'en écris à M. de Villeroy.... Ce qui me fait encore plus désirer cette grâce de lui est quelque curiosité que j'ai de savoir par ce moyen et être averti de plusieurs particularités de ces lieux éloignés de ce qui s'y passera (23) ".
APPENDICE :
(1) M. Heinrich remarque que les plaintes faites dans une lettre de M. de la Vigne à Henri II, contre la " canaille d'Alger" sont presque les seules que l'on rencontre dans la correspondance de Constantinople à la fin du règne de Henri II.
(2) V. aux Arch. Nat. (Marine) B7. 49, fol. I : Provisions de consul d'Alger pour Vincent Bertolle de Marseille.
(3) La liste des premiers consuls d'Alger est fort mal établie et on trouvera à ce sujet une série de contradictions dans Devoulx, Féraud et Plantet. - Sauron mourut en 1585, le conseil de ville proposa au roi pour le remplacer Louis de la Motte Dariès qui probablement ne fut pas agréé. La charge fut donnée à Jacques de Vias, Marseillais, docteur en droit, conseiller d'État et maître des requêtes de Catherine de Médicis (Arch. nat. (Marine) B7, 49, fol. 4 : Provisions du consul à Alger pour Jacques Vins, à la place du capitaine Maurice Sauron, 16 avril 1585). Ainsi Sander Rang se trompe en disant que de Vias obtint sa charge en 1597 pour le dédommager de ce qu'il avait souffert pour la cause du roi pendant la Ligue. Des lettres patentes de 1586, 1595, 1610, confirmèrent Vias dans la possession de sa charge (Arch. nat. Ibid.). Cependant il en avait été un moment dépossédé. On lit en effet dans un manuscrit de la Biblioth. Nat. (fr. 16738, fol. 110-113) Intitulé, Mémoire des consulats auxquels il a été pourvu : Alger, Pierre Pascal au lieu de Vias, suivant les arrêts du conseil du 31 juillet 1596 et 15 décembre 1599, et à la recommandation de M. le connétable. Le roi, sur la requête de Vias, cassa les provisions accordées à Pascal par ses lettres patentes du 2 janvier 1601 (Arch. nat. Ibid.). Vias eut d'abord pour vice-consul le P. Bionneau, religieux de la Trinité, emprisonné en 1586 Charrière, Négociations. t. IV. p. 499, puis le capitaine Jean Ollivier (Arch. munic. de Marseille. Registres des Délibér ; 17 mars 1585 et 28 mars 1588, et plus tard, parait-il, de nouveau le P. Bionneau, emprisonné une seconde fois en 1595 Féraud. p. 100 Jacques de Vias alla lui-même exercer son consulat et résida à Alger jusqu'en 1618, puis il le fit gérer par le sieur Chaix (1618-21). Pendant la période troublée qui suit son fils Balthazard qui hérita son office en 1623 (Arch. nat. Marine. B7. 49 : Provisions de consul pour Balthazard Vias, 3 octobre 1623) et non en 1627, ne se fit pas représenter Alger. Pour défendre les intérêts du commerce, la ville de Marseille donnait une gratification annuelle de 500 écus à un marchand qui prenait le nom de député de la ville. On ne sait exactement quand cette situation prit fin. En 1630, Nicoullin Ricou, consul pour le roi, et député de la ville de Marseille, devait être le délégué du consul Vias. Aff. étrang. mêm. et doc. Alger. t. XII. fol. 64. En 1616, Balthazar de Vias vendit son office de consul à l'ordre des Lazaristes fondé par saint Vincent de Paul. Vias était un poète latin très connu de son temps. L'ami de Peirese et de l'historien Ruffi.
(4) V. Plantet. Tunis, t. I, n° 1. Dariès y est nommé consul De la nation française au royaume de Tunis, La Goulette et Tripoli. - Cf. Charrière. Négoc. du Levant. T. III, p. 767. Dans une lettre du chargé d'affaires à Constantinople, de 1578, il est question de commandements obtenus à la Porte en faveur des nouveaux consulats érigés par S. M. en Tripoli, Tunis et Bizerte. E. Watbled a reproduit une grosse erreur de A. de Miltilz (Manuel des Consuls, Londres, 1898. T. II, p. 414), quand il a écrit : " Les comptoirs de Tunis, de la Goulette et de Tripoli furent établis par les soins du capitaine Lourdarsès, qui fut nommé consul dans la première de ces échelles le 28 mai 1518. " Revue Africaine, 1872, p. 29.
(5) Plantet. Tunis. Introduct., p. VII.
(6) Lettre des consuls de Marseille à Villeroy, 4 décembre 1617: " Le capitaine Thomas Martin, consul de Tunis, mérite cette grâce de vous d'admettre la résignation de son office en faveur de ses enfants... tant pour n'avoir appris aucune plainte de lui que de ce qu'il a dignement servi le roi et le public en plusieurs et diverses occasions, même que ses enfants, qui ont jà pratiqué le pays, sont bien nés et bien nourris, ayant eu un oncle, le consul Martin, si digne et capable personnage et qui a tant mérité de son service envers nos feus rois, lequel vous pouvez avoir connu" (Bibl. nat. mss fr. 16738, fol. 96. Les lettres patentes en faveur de Pierre Martin furent expédiées le 20 janvier 1618. (Ibid. fol. 101-102). Cependant, le 14 juin 1591, des Provisions de consul à Tunis, La Goulette et Tripoli, avaient été expédiées en faveur de Balthazard Seguler par l'absence de Thomas Martin, accusé et prouvé hérétique. (Arch. nat. marine, B7, 49, fol 8). Les Martin, comme les de Vias, eurent des vice-consuls qui les représentèrent à Tunis.
(7) Dans les lettres de provision accordées à Louis de la Motte Dariès, Tripoli est nommée comme une dépendance du consulat de Tunis ; c'est ainsi qu'il faut comprendre les termes de la nomination du premier consul de France au Maroc, qui est de la même année 1577 ; elle lui attribue les mêmes privilèges qu'aux " consuls établis ès parties d'Alexandrie, Tripoli de Syrie. Tripoli de Barbarie. Gelby (Djerba), Thunis Bonne et Argier.
(5) État des consuls de Levant, baillé à M. de Césy au mois d'août 1619. - Cf. Mémoire des consulats auxquels il a été pourvu. Tripoli en Barbarie. Nicolas Brun, pourvu dudit office en novembre 1615 par la résignation de François du Mas. Biblioth. nat. Mss. fr. 16738, fol. 101-102 et 110-113.
(8) Bibl. nat. mss fr. 12219, 12220 (2 vol. pet. in-4°). Histoire chronologique du royaume de Tripoly de Barbarie. - L'auteur déclare qu'il n'a pu trouver s'il y avait des consuls de France à Tripoli au début du siècle. - L'ambassadeur, de Césy, en envoyant à Marseille des commandements du G. S., pour le pacha et la milice de Tripoli, en 1627, écrivait que les Tripolitains désiraient un consul et se tiendraient plus tranquilles, s'ils avaient espoir de faire du commerce avec les Français. 13 avril 1627. Bibl. nat. mss. fr. 16164. fol. 95. - Cf. mon Histoire du Commerce du Levant, p. 41-43.
(9) Bib1. nat. mss. fr. 18595, p. 105-106. - Cf. Aff. étrang. Tripoli, 1642-1698 : Propositions du P. Cauto, récollet, missionnaire apostolique, de la part du roi de Tripoli, 1642. Le pacha offre de délivrer 130 esclaves français pour la moitié du prix ordinaire. Cauto demande au cardinal 4000 piastres qui lui manquent et un vaisseau pour aller chercher les esclaves.
(10) L'histoire du Maroc est si embrouillée au XVIème siècle qu'il est indispensable pour l'intelligence de ce qui va suivre de rappeler quelques faits et quelques dates essentielles. Au début du XVIème siècle, les derniers Mérinides, incapables, n'ont presque plus d'autorité ; ils résident à Fez. La famille des chérifs saadiens, descendants du prophète, grandit dans le Sud ; le fondateur de leur puissance mourut en 1517. En 1550, son fils Mohamed et Medhi, chassa de Fez le dernier des Mérinides après trente ans de luttes. En 1557, son fils Moulai Abou Mohammed Abd Allah lui succéda et mourut en 1573. Deux de ses frères, Abd el Malek et Abou l'Abbas, menacés de mort par son fils Moulaï Mohammed, le chassèrent avec l'appui des Turcs d'Alger (1575-76). Mohammed, ramené par don Sébastien de Portugal, mourut avec celui-ci et son oncle Abd-el-Malek dans la fameuse bataille d'Al Kazar-el-Kebir (4 août 1578). Abou l'Abbas Ahmed, resté seul maître du Maroc, est connu sous le nom d'El Mansour, le victorieux. Il régna paisiblement jusqu'en 1603 et porta à son apogée à la fois la puissance des chérifs et la prospérité du Maroc. Ses généraux avaient conquis le Touat et le Gourara en 1581, Tombouctou, Gago et tout le Soudan, jusqu'au Bornou, en 1591. Les richesses du Soudan enrichirent alors les Marocains : l'or y devint si abondant qu'El Mansour reçut aussi le surnom de Debhi adoré. A sa mort les guerres civiles recommencèrent de plus belle entre ses fils. El Mamoun Cheikh, Zidane et Abou Farés ; il y a alors au moins deux rois, l'un à Fez, l'autre au Maroc. Moulaï Abou Farés est étranglé en 1609. Moulai Cheikh assassiné en 1612. Zidane est alors en lutte avec bon neveu, fils de ce dernier, Abd Allah et tous deux sont aux prises avec l'anarchie, à Maroc et à Fez. Abd-el-Malek remplace son frère Abd-Allah à Fez en 1624, sans que la situation change. L'empire des Chérifs saadiens est en pleine décomposition. Abd-el-Malek et Zidane meurent en 1627. Trois fils de Zidane, Abd-el-Malek (1627-31). El Oualid (1631-36) et
-Mohammed Cheikh (163654) se succèdent à Maroc. Mais divers marabouts sont maîtres de la plus grande partie du pays, l'un d'eux domine à Fez, d'autres à Tafilala et dans le Sous.
-V. Mercier. T. III, passim. - Il y avait eu des traités de commerce au moyen-âge entre les républiques commerçantes de la Méditerranée traité de Marseille avec le roi de Maroc de 1138 et les Almoravides, les Almohades, les Mérinides. L'influence des puissances chrétiennes avait grandi, grâce à la faiblesse des derniers Mérinides. Les dynasties chérifiennes furent, au contraire, soutenues par un puissant mouvement de réaction de l'islam. Cependant, c'est surtout par ses relations avec l'Europe que 1'histoire du Maroc devient intéressante à partir du XVIème siècle. V. Edm. Doutté. Les Marocains et la société marocaine. Rev. génér. des sc. 28 fév. 1903.
(11) M. de la Roncière a fait le curieux récit de cette ambassade d'après le rapport de Pierre de Piton, conservé parmi les manuscrits de la Bibliothèque nationale V. Correspondant, 25 juin 1911, p. 1136-1146 : La Première mission française au Maroc.
- Cf. aff. étrang. Mém. et doc. Maroc, t. I : Réponse du roi de Maroc à François 1er, roi de France, 2 août 1533. (Inventaire de Laffilard). - Ahmed el oates, dernier représentant de lu célèbre dynastie des Mérinides, qui n'était que roi de Fez, fut bientôt renversé.
(12) Aff. étrang. Maroc, 1577-1693. Voir ibid., Provisions de facteur pour la nation des royaumes de Maroc et Fez, en faveur de François Vertia, 13 juin 1577 : " Comme outre le consul de la nation française que nous avons crée pour résider es royaumes de Maroc et de Fez et y avoir ….. surintendance au fait de trafic et commerce qu'y exercent nos sujets. Il soit besoin y commettre aussi pour le taturage dépendant dudit commerce quelque personnage…." Cet office de facteur n'est cité que dans un très petit nombre de documents. - On lit dans la Relation de voyage du marseillais Vincent Leblanc, qu'il partit en 1578 pour le Maroc avec dom Guillerm, envoyé par Henri III comme ambassadeur vers le roi de Fez et Maroc. C'était un barbier de Nice qui étant allé voyager au Maroc, guérit le roi Muley Maluco ou Abd-el-Melech de la peste dont il avait été atteint à Constantinople, ce qui le mit en grande estime auprès de ce prince, p. 135. - Est-ce de Guillaume Bérard que Leblanc veut parler ? Dans le courant de son récit il oublie complètement l'ambassadeur qu'il accompagnait au début. Ce Leblanc a d'ailleurs, la réputation justifiée d'un voyageur peu digne de foi.
- Thomassy (p. 116-117) a publié les deux pièces de 1577.
(13) Instruction au sieur Bérard s'en allant vers le roi de Fez et de Majorque (sic), du 16 juillet 1579. Aff. étrang. Maroc. 1577-1693.
(14) Quand Philippe II devint roi de Portugal, les places portugaises devinrent espagnoles. En 1643, Tanger et Mazagan chassèrent les Espagnols et redevinrent portugaises.
- Larache resta aux Espagnols jusqu'en 1689, Mamora jusqu'en 1681. V. La Primaudaie Les villes maritimes du Maroc. Mercier. Hist. de l'Af. sept. T. III, passim. Dans les guerres civiles du commencement et de la fin du XVIème siècle, il arriva fréquemment que l'un des princes marocains rivaux vint solliciter l'appui des Espagnols et des Portugais. Ceux-ci y mirent toujours pour condition la cession de quelque place de la côte, moine la reconnaissance de leur suzeraineté, mais ne stipulèrent jamais rien pour leur commerce. Ainsi, lors de la fameuse expédition de 1578 où il périt, don Sébastien avait exigé de Muley Mohammed, qu'il soutenait, la promesse de la cession de tout le littoral. C'est en ramenant El Mamoun Cheikh chassé du Maroc, que Philippe III lui imposa la cession de Larache en 1610. V. Mercier. Ibid. passim.
(15) Ainsi, au XVIème siècle, avant l'occupation espagnole, les Européens venaient trafiquer à Mamora. D'Avity raconte que les " habitants de Mamora et des pays voisins avaient de tout en merveilleuse abondance et que les bestiaux y étaient à vil prix. Le capitaine d'un vaisseau florentin qui se trouvait là en 1611, lui dit qu'il avait eu un boeuf pour trente réales et que la seule peau en valait douze. La récolte des olives y était très considérable. La Primaudaie. Rev. Afric. 1873. p. 69.
(16) discours véritable de la seconde et dernière bataille donnée à Taquate... le 12 mai 1596... Signé de Pierre Treillault officier domestique de Moulé Hamed Chérif (El Mamoun) roy de Mauritanie, qui estoit à sa court lorsque la dicte bataille se donna ". Biblioth. nat. mss. fr. 3603. fol. 93-97. - Il y a à la bibliothèque nationale une relation imprimée (O3j. 52) de la bataille donnée près de Fez le 30 août 1585. Écrite de Maroc par un facteur qui y réside. M. Jacqueton qui a publié ces documents (Documents marocains dans Rev. Afric. 1894, p. 5-64) pense avec raison que ce facteur doit être Treillault. En effet, le titre de la Relation de Treillault semble indiquer qu'il a raconté aussi la première bataille.
(17) Mocquet, p. 175. Mocquet ajoute que Hubert resta un an à Maroc exerçant la médecine auprès du roi, mais que son principal dessein était d'apprendre à fond l'arabe " Il se contenta de sortir de ces pays plus chargé de science et de livres arabiques que de richesses et autres commodités, esquelles le sieur de l'Isle fut plus heureux que lui. "
- M Jacqueton croit pouvoir placer entre 1588 et 1598 environ, le premier séjour de de Lisle Rev. Afric. 1894, p. 7, note 2 et p. 34, note 1.
(18) V Lettres missives de Henri IV. T. VII et Biblioth. nat. mss. fr. 16141, 16145, et 16146. Cette dernière correspondance a été publiée par M. Jacqueton. Documents marocains Rev. afr. 1894, p. 5-64. Une des lettres du roi à M. de Lisle, de 1607, porte comme inscription : à M de Liste, mon conseiller et médecin ordinaire résidant pour mon service à Marocq.
(19) Avril (?) 1607. Lettres missives, T. VII, p. 213. - Le début de la lettre nous apprend sur quels sujets Henri IV s'en remettait à de Lisle : " Très haut et très excellent prince notre bon ami. Ayant entendu du sieur de Lisle notre médecin ordinaire résidant près de vous le bon succès qu'il a plu à Dieu vous donner dans la bataille nous avons bien voulu nous en conjouir avec vous par cette lettre.... pour l'estime que nous faisons de votre bonne et parfaite amitié, suivant laquelle ayant commandé audit sieur de Lisle de vous requérir en notre nom, comme nous faisons très affectueusement, de tenir la main qu'a l'avenir nos sujets et autres qui trafiquent sous notre bannière es terres de votre obéissance y jouissent des mêmes privilèges et franchises qu'ils ont accoutumé, sans permettre que les pirates ou corsaires flamands ou anglais puissent, après les déprédations qu'ils pourraient avoir commises sur eux, trouver aucun sûr accès ni retraite en vos ports et havres.... Cf., ibid. p. 212, la lettre envoyée en même temps à de Liste.
- Dans d'autres lettres le roi charge de Lisle de s'occuper de la délivrance des Français esclaves (ibid. p. 442), de réclamer la restitution d'une prise faite par un Anglais et conduite à Salé (p. 443), de soutenir les réclamations de deux marchands français (p. 443).
- Mocquet parle de sa visite à de Lisle " qui était logé en un beau logis en la juderie ou juiverie " à Maroc en septembre 1606. " Cette Juderie est à plus d'une grande lieue de la douane où logent les chrétiens et proche du palais du roi et est comme une ville à part entourée de bonnes murailles et n'ayant qu'une porte gardée par les Mores : cela peut être grand comme Meaux ; là demeurent les juifs au nombre de plus de 4.000 et paient tribut. Il y a aussi quelques chrétiens et là demeurent aussi les agents et ambassadeurs des princes étrangers. Pour le gros des chrétiens, trafiquants et autres, ils demeurent à la douane". P. 175-176.
(20) Jacqueton, p. 50-51. On voit que Henri IV était en correspondance, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre des deux frères alors en lutte, Muley Cheikh et Muley Zeïdan, suivant que l'un ou l'autre semblait l'emporter. D'ailleurs, les quelques lettres du roi à de Lisle, qui ont été conservées, sembleraient montrer que celui-ci, quoique résidant à Maroc, était chargé de négocier aussi, suivant les occasions, avec le roi de Fez. V. lettres de 1607. Lettres missives, t. VII, p. 442 : " Parlez, si besoin est, au roi de Fez, même avec l'entremise de mon nom et autorité " ; p. 443: négociation à propos d'un certain Vincent de Marlens, qui réside près le roi de Fez. Cf. Lettre du sieur de l'Isle au Roi sur ses affaires avec le roi de Fez, de Madrid, 16 avril 1608. Bibl. Nat Mss. V Colbert. 183, fol. 450-51.
(21) L'aventure de ce Castellane est assez obscure. Elle a été très inexactement rapportée par Thomassy, qui a cru à tort à l'existence de deux Castellane. M. Fagniez n'y fait qu'une allusion d'après un mémoire d'Isaac de Razilly. D'abord, il faut remarquer que le Castellane, consul à Maroc, n'est autre que le Philippe, qui, en 1607, avait obtenu la survivance du consulat, comme l'indiquent les deux pièces suivantes : Confirmation des provisions du consulat de Maroc et de Fez à Guillaume Curiol, à condition de survivance en faveur de Jean Phelip, 22 septembre 1610. (Aff. étrang. Maroc, 15771693) Mémoire des consulats auquel il a été pourvu, 1616 : Maroques et Fez. Guillaume Curel à la survivance de Jean Philippe de Castellane au mois de septembre 1607 (Bibl. Nat. Mss. fr. 16738, fol 110-113). D'après ce dernier document et la lettre du baron de Sancy, citée ci-dessous, Guillaume Curiol dut mourir en 1616 et Castellane le remplaça cette année-là. Suivant Thomassy (source non citée). Castellane aurait cherché à s'approprier 4.000 volumes précieux que Muley Zeïdan lui avait confiés ; suivant Razilly " Cathelane et autres... emportèrent plus de trois millions en pierreries et livres. " D'après le P François d'Angers (Histoire de la Mission, etc., 1644) " le roi de Maroc s'était vu assiéger d'une armée si puissante qu'il avait sujet de craindre d'être chassé de ses États Dans cette appréhension, il avait confié à ce Français un million en or et en pierreries et grand nombre de volumes d'une rare bibliothèque pour les apporter en France, afin d'y conserver le tout Ce pauvre homme, faisant sa route fut rencontré par un vaisseau d'Espagne qui se rendit maître du trésor après l'avoir été du navire " (p. 18). Dans un Mémoire de 1733, le consul de Cadix, Partyet, très au courant des choses du Maroc, dit qu'un " renégat français avait volé dans la bibliothèque du roi de Maroc et emporté en Espagne tous les ouvrages de saint Augustin qu il tenait être l'original de la main même de ce Père et dans la couverture desquels ce prince prétendait qu'il y avait pour 4 millions d'or, de pierreries. " Arch. nat. Marine B7. 321. L'un des Français qui résidaient au Maroc en 1624 donne encore une version différente: Muley Zeïdan avait confié ses meubles et sa bibliothèque à un capitaine provençal qui s'appelait Charles, pour les transporter de Safi à Agader ou Sainte-Croix, où il était obligé de se retirer. Ce capitaine, au lieu d'aller à Sainte-Croix, fit voile pour la France, mais fut pris par Don Juan Faxardo, commandant un galion d'Espagne ; les meubles furent envoyés à Madrid et la bibliothèque à l'Escurial. Celle-ci renfermait des manuscrits de saint Augustin que les Marocains appelaient Sidi Belabech et qu'ils prétendaient être mort au Maroc et avoir sa sépulture " à Goncet, entre les montagnes d'Atlas et Maroc ". Lettre escritte... 1670, p 173-177. Ce patron provençal pouvait être un des complices de Castellane, dont parle Razilly. A propos de ces pierreries, on peut faire un curieux rapprochement : en 1617, un Anglais, William Ligthgow, alla à Fez par Alger et Tlemcen avec un certain nombre de marchands d'Alger et un joaillier d'Aix en Provence, qu'il appelle Chatteline (Playfair, n° l42), nom qui se rapproche beaucoup du Cathelane de Razilly. Ce Chatteline put négocier quelque affaire de pierreries avec le sultan de Maroc, son nom a pu être confondu avec celui de Castellane. Celui-ci mourut peu après ; en effet, dans l'État des consuls de Levant, baillé à M. de Césy au mois d'août 1619, on trouve la mention Maroc. ques, vacant par la mort de Castelanne. (Bibl. Nat. Mss. fr. 16738, fol. 101).
- Partyet, dans le Mémoire cité plus haut, parle d'une trêve de quinze ans faite par Louis XIII avec le roi de Maroc et rompue lors de l'incident Castellane ; aucun autre document ne mentionne cette trêve.
(22) C'était la version officielle qui avait été adoptée. On retrouve presque les mêmes termes dans le mémoire de Razilly de 1626. Il parle de Cathelane et autres " lesquels ont affronté l'empereur de Marocque par le moyen des lettres du roi qu'ils obtinrent par faveur des secrétaires d'Etat. " La version du P. François d'Angers (page précédente, note 3) est favorable à Castellane ; mais, pour lui aussi, celui-ci " s'était dit envoyé du roi. "
(23) A M. Fourreau, conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France, de Pera, 14 mai 1617. Bibl. nat. mss. fr. 16738, fol. 120.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
| Dur d'oreille...
Envoyé Par Marie
| |
L'instituteur :
- Thomas, dis-moi un peu qui d'entre vous est venu hier voler des pommes dans mon pommier?
Thomas :
- Je ne vous entends pas bien monsieur, vu que je suis sur le dernier banc de la rangée.
L'instituteur :
- C'est ce qu'on va voir ! Viens ici t'asseoir à ma place.
Ils échangent leur place et Thomas fait ce que l'instituteur lui a demandé.
- Maître, qui est venu dormir avec maman alors que papa était de service de nuit?
L'instituteur :
- Tu as raison Thomas, on ne comprend rien ici dans le fond!
|
|
|
| CAHIERS DU CENTENAIRE DE L'ALGÉRIE N° 4
PAR M. J.- M. BOURGET
|
|
L'ALGÉRIE
TROISIÈME PARTIE
L'ALGÉRIE ET LA FRANCE
IV
La Lutte contre Abd et Kader
Provisoire dans l'esprit d'Abd el Kader, le traité de la Tafna devait l'être dans les faits. En dehors même de toute contestation sur le texte du traité, notre extension dans la province de Constantine devait tôt ou tard amener la reprise des hostilités. Et, avec un adversaire de la valeur et de l'énergie d'Abd el Kader, elles ne pouvaient se terminer que par un succès décisif ou une défaite complète.
Abd el Kader en eut le premier le sentiment très net. Il agit vigoureusement. Le commandement français le laissa faire.
Dès le mois de juillet 1837, Abd el Kader, après avoir châtié une fraction des Angad révoltée, prit possession de Tlemcen avec une grande solennité. Le mois suivant, il opéra contre les populations nomades du Sud et soumit les gens du Djebel-Amour à qui il imposa une lourde contribution de guerre. Il se fit reconnaître des Oulad-Chaïb, des Oulad-Mokhtar. Préparant son extension vers l'est, et l'amorçant, il soumit des tribus jusqu'aux Bibans. Puis il se tourna contre les Zouatna de l'Oued Zeitoun en Kabylie ; après un combat meurtrier, il massacra leurs chefs et les contraignit à la soumission (janvier 1838).
Les limites de la Tafna étaient largement dépassées. Le général Bernelle, envoyé par le maréchal Valée au camp du Fondouk avec une brigade, demanda dans une lettre énergique des explications à Abd el Kader. Il fut désavoué par Valée et remplacé par le général Rullière. Mais la lettre avait produit son effet : Abd el Kader se retourna contre le Sud.
Il commença par établir son autorité à Biskra (mai 1838), puis il entreprit des opérations contre Laghouat et Aïn Mahdi, où Sidi Tedjini, chef de la puissante confrérie des Tidjanyia, ne paraissait pas disposé à le reconnaître. L'émir installa un khalifat à Laghouat, puis mit le siège devant Aïn Mahdi : après six mois d'efforts, de juin à décembre 1838, il dut se contenter d'une capitulation laissant Tedjini en liberté. Quoiqu'il n'eût pu prendre la ville, il tira de cette expédition un renforcement de puissance : le " Sultan de Touggourt ", les Larbaa, les Oulad Khélif, les Oulad Naïls, lui envoyèrent des présents ou des délégués.
Au milieu de 1839, Abd el Kader fit un voyage en Kabylie, mais il n'obtint chez les montagnards qu'un succès incomplet. Cependant son autorité était établie en principe sur les deux tiers de l'Algérie. Les Français étaient confinés dans Oran, dans Alger, dans une partie du beylik de Constantine, sans avoir, aux termes du traité de la Tafna, le droit de communiquer par terre entre leurs possessions.
Abd el Kader, alors âgé de 32 ans, de taille moyenne mais vigoureux, était dans toute la force de son merveilleux tempérament. Dur à lui-même, sobre, d'une résistance extrême, il mangeait peu, était vêtu simplement, et se distinguait surtout par sa piété, qui, tout en étant un de ses moyens de gouvernement, était restée sincère. Lancé dans une redoutable aventure, au bout de laquelle il entrevoyait la liberté des musulmans algériens, il employa souvent des moyens énergiques, dictés par une politique faite de justice et de sévérité. Sa cruauté même, qu'on lui a reprochée, n'est pas foncièrement établie, et en tous cas, s'il fut parfois impitoyable, ce fut seulement à cause de l'idée qu'il se faisait de sa mission.
Pour remplir celle-ci, il, s'efforça d'établir une administration régulière. Il étendit à ses domaines agrandis l'organisation qu'il avait instaurée dans la province d'Oran après le traité Desmichels. Il les divisa en huit khalifaliks (Tlemcen, Mascara, Miliana, Médéa, le Hamza, la Medjana, le Sahara occidental, le Sahara oriental). Son trésor était alimenté par deux impôts principaux : la zecca, sur les troupeaux, perçue au printemps ; l'achour, sur les moissons, perçue à l'automne. Il fonda une organisation de la justice, de la police, de l'instruction publique (écoles et bibliothèques), des finances (monnaies).
Les circonstances l'obligèrent à donner des soins particuliers à l'organisation militaire. Il eut une armée régulière de 8.000 fantassins, 2.000 cavaliers, 240 artilleurs (servant 20 pièces d'artillerie de campagne), répartie entre les khalifaliks et complétée par les guerriers des tribus. Les règlements, les décorations, l'avancement, la discipline, la comptabilité, le service de santé, étaient à la mode européenne; il avait eu des collaborateurs européens.
Il avait adopté un dispositif stratégique fondé sur les conditions géographiques. Vers la côte, d'abord, des tribus en avant-garde : les Gharaba devant Oran, les Hadjoutes devant Alger, les Kabyles ralliés devant Bône. Dans le Tell, une ligne de places : Tlemcen, Mascara, Miliana, Médéa ; un chaînon manquait, Constantine, mais l'Emir espérait bien le conquérir. En arrière, et formant autant de réduits, Sebdou, Saïda, Tagdempt, Taza, Boghar, la Zaouïa de Bel-Kheroub, Biskra. Ce système de places lui fournissait des bases nombreuses, comprenant des moyens de ravitaillement (céréales enfermés dans les silos), grâce auxquelles il pouvait se rendre insaisissable, ce qui était le moyen de sa stratégie. Il employait tactiquement un procédé analogue en évitant la bataille rangée, et en harcelant les colonnes.
La faiblesse de cette organisation était son manque d'unité réelle. De très anciens souvenirs de rivalités entre familles et entre tribus s'opposaient à l'unification. Jamais, d'ailleurs, rappelons-le, avant la pacification française, l'Algérie n'a formé une unité dans les limites qu'elle a atteintes et qu'a tracées la tentative même d'Abd el Kader. On doit plutôt considérer l'Etat d'apparence unitaire créé par l'émir comme une confédération dans laquelle chaque khalifat était presque indépendant de fait, la liaison résultant de la reconnaissance d'un chef commun.
Les difficultés avec la France commencèrent à propos du Consul d'Abd el Kader à Alger. Ben Duran décidément reconnu indésirable, l'émir voulut le remplacer par le nommé Garavini, qui fut écarté par Valée parce qu'il était déjà consul des Etats-Unis. Abd el Kader se plaignit de ce refus. Mais l'affaire la plus grave était la délimitation de la Mitidja vers l'est. Le traité disait : jusqu'à l'Oued Kaddara et au delà. Rédaction contradictoire, d'où chacun s'efforçait de tirer des conclusions favorables à sa thèse, les Français pour maintenir les communications par terre entre Alger et Constantine, Abd el Kader pour s'étendre vers l'Est. Le Maréchal Valée prépara un projet de traité additionnel réglant le litige ; Abd el Kader refusa de le ratifier ; mais le gouvernement français le déclara valable, parce que signé du représentant de l'émir.
Celui-ci sentait venir la reprise des hostilités, à laquelle il se préparait. Ses empiètements dans la province de Constantine étaient autant de provocations contre les Français qui se décidèrent à réagir. Le Maréchal Valée, confiant dans son système de camps successifs pour tenir le pays, crut qu'un coup d'audace pourrait intimider l'émir. Ce fut une simple démonstration.
Le Maréchal quitta Mila, le 18 octobre 1839, à la tête d'une colonne de 4.000 hommes et accompagné du duc d'Orléans. Il traversa le défilé des Bibans (Portes de fer) le 28 (moyennant paiement aux tribus d'un " droit de passage ") et rentra à Alger le 2 novembre.
Abd el Kader, qui était décidé depuis le mois de juillet à proclamer la guerre sainte à la première " violation " du traité par les Français, trouva dans cette expédition le prétexte souhaité. Il quitta Tagdempt le 1et novembre, écrivit à Valée deux lettres, dont la seconde reçut une réponse conciliante, et lança l'appel à la guerre sainte le 19.
Dès le 10, un officier supérieur français avait été tué dans une embuscade tendue par les Hadjoutes ; les 13 et 14 novembre, des coups de feu avaient été tirés contre Blida. Le 20, la Mitidja fut envahie et ravagée par les contingents de l'émir. Le lendemain, 158 Français furent surpris et tués au camp de l'Oued el Alleug.
L'effort de l'émir paraissait devoir se concentrer d'abord dans la province d'Alger où 20.000 Français étaient disséminés dans les postes et les camps sur lesquels Valée fondait sa sécurité. Le système ne résista pas à l'épreuve, Valée évacua la plupart des points occupés, ne maintenant de garnisons qu'au Fondouk, à Kara Mustapha, à l'Arba, et à Blida. Mais il fallait organiser des colonnes mobiles pour les ravitailler, procédé que le Maréchal dû adopter, après s'être violemment élevé contre lui auparavant.
Dans la province d'Oran, des attaques furent exécutées par les partisans d'Abd el Kader contre Mazagran (13 décembre), contre Arzew (17 décembre), et des razzias des Gharaba contre les Douairs et les Smela. Le 2 février 1840, eut lieu l'attaque de Ben Thami, khalifat à d'Abd el Kader, contre la redoute de Mazagran, défendue par le capitaine Lelièvre et 123 hommes de la 10e compagnie du premier bataillon d'infanterie légère d'Afrique ; la résistance dura 5 jours, les assaillants durent se retirer. L'héroïsme des défenseurs fut célébré peut-être avec quelque exagération ; mais l'opinion française surexcitée exigea une action énergique.
Valée, renforcé, disposant de 58.000 hommes, dont 33.000 dans la province d'Alger, se disposa à agir au printemps. Il résolut d'occuper Médéa et Miliana, puis de se maintenir en liaison permanente avec Mostaganem et Oran. Il occupa les deux premières villes ainsi que Cherchell, mais le ravitaillement amena toujours de nouveaux combats. L'état sanitaire des garnisons était des plus défectueux, Des révoltes se produisirent chez les indigènes dans les provinces d'Oran et de Constantine.
Cette fois, le gouvernement français, poussé par Bugeaud, qui avait un plan tout prêt, décida une action d'envergure : l'occupation " restreinte, progressive, pacifique ", avait échoué. Il fallait aussi compenser la reculade à quoi avait abouti le soutien donné à Méhémet Ali : au lieu d'aider celui-ci, au prix d'une guerre européenne, à consolider sa situation en Egypte, mieux valait pacifier l'Algérie. Le Ministère Guizot rappela Valée et le remplaça par Bugeaud (29 décembre).
Avec celui-ci, qui avait renoncé aux illusions politiques de 1837, le système des camps fut abandonné pour celui des colonnes mobiles. A l'activité d'Abd el Kader, il fallait opposer une activité supérieure. Le camp du Fondouk et la plupart de ceux de la province d'Alger furent évacués. Grâce à la confiance que Paris avait en Bugeaud, les effectifs atteignirent un chiffre élevé, jusqu'à 110.000 hommes, et permirent de former un grand nombre de colonnes. Les hommes furent pourvus d'un équipement approprié. Les convois sur bêtes de somme devinrent la règle. La colonne comprenait 3 ou 4 bataillons d'infanterie, 2 escadrons de cavalerie, 2 obusiers de campagne, des auxiliaires indigènes. Bugeaud, qui resta longtemps en fonction, trouva des subordonnés remarquables, parmi des officiers qui s'étaient formés en Algérie même, les Changarnier, les Lamoricière, les Duvivier, les Morris, les Cavaignac, les Bedeau, les Baraguey d'Hilliers.
Le système trouvé, restait encore à en arrêter le mode d'application à la fois politique et stratégique. Certaines servitudes étaient imposées par l'impossibilité d'évacuer des points comme Médéa et Miliana. Il fallut donc encore avoir recours aux colonnes de ravitaillement. Mais, en même temps, Bugeaud comprit la nécessité de s'attaquer aux places de l'Emir : il commença dès le printemps de 1841.
Abd el Kader comprend le danger : il s'adresse au sultan du Maroc, et à l'Angleterre, mais sans succès. Du 30 mars au 6 avril, Médéa est ravitaillée. Puis c'est le tour de Miliana (combats du 2 au 5 mai). A la fin du mois, Tagdempt, Boghar, Taza, Mascara, sont prises. La première ligne des places de l'émir est enlevée tout entière, sauf Tlemcen ; la seconde est entamée. En juin, Mascara est ravitaillée et les troupes de Bugeaud font la récolte dans la plaine d'Eghris, qui a vu naître la puissance d'Abd el Kader.
Après un temps d'arrêt, employé à la réorganisation de la direction des affaires arabes, la campagne est reprise à l'automne. Bugeaud bat Abd el Kader à Sidi Yahia, détruit la Guetna de Sidi Mahi ed Din, arrive à Saïda (octobre 1841). Il établit des bases d'opérations à Mascara, Mostaganem et Oran, d'où pourront rayonner et agir en liaison des colonnes de pacification. En janvier 1842, Bugeaud, partant d'Oran, rentre à Tlemcen et dévaste Sebdou. En mars, Bedeau soumet Nedroma.
En décembre 1841, Abd el Kader a fait de nouveau appel à l'Angleterre. Il a adressé des lettres au sultan de Constantinople, à son grand vizir, au capitan-pacha. Toujours sans succès. Il va chercher des Beni Snassen pour les mener au combat : ils s'enfuient sur la Sikkak (21 mars 1842). Au début d'avril l'émir a rassemblé de nouveaux contingents : il est battu le 11 sur la Tafna par Bedeau. Infatigable, Abd el Kader, qui a entraîné cette fois les Kabyles, vient assiéger Nedroma. Bedeau le bat à nouveau le 29 à Bab-Taza.
Le mois suivant, une opération combinée, conduite par Bugeaud avec Changarnier et Lamoricière, ouvre les communications par terre entre Oran et Alger, et contraint la smala d'Abd el Kader à fuir vers le Sahara. Lamoricière manque de peu l'émir lui-même, mais s'empare de Goudjilah, où Abd el Kader a rassemblé toutes les armes et les munitions qu'il a pu sauver de Tagdempt.
Les tribus hésitent encore à se rallier à la France, à la fois par sentiment religieux et par crainte des représailles d'Abd el Kader. Il faut déterminer et pratiquer une politique indigène. Il s'agit d'abord de lever le malentendu fondamental. C'est à quoi s'emploie Léon Roches, qui, entre 1837 et 1839, a séjourné auprès d'Abd el Kader, et lui a même servi en plusieurs occasions de secrétaire pour ses relations avec l'extérieur. Il y est aidé par Sidi Tedjini, le vaincu d'Aïn Mahdi.
Les mokkadems, réunis à la Zaouïa de Tedjini, à Kairouan, ont donné une fettoua, permettant aux Algériens de faire leur soumission aux Français (août 1841). Roches fait approuver cette fettoua par les oulémas du Caire, puis par un medjelès, réuni à Taïf par le grand Chérif de la Mecque. Revenu à Alger en juin 1842, Roches recrute, grâce à Tedjini, des émissaires sûrs et dévoués qui vont répandre la fettoua dans les tribus ; en même temps, il les fait rassurer matériellement en promettant qu'il n'y aura plus de traités comme ceux de Desmichels et de la Tafna abandonnant les tribus ralliées à la vengeance de l'émir.
Abd el Kader a perdu ses places, ses lieutenants sont battus, sa Smala, qui, outre sa famille et ses familiers, comprend d'immenses approvisionnements et toutes ses richesses, est contrainte de se déplacer sans cesse. Lui-même, à l'automne de 1842, ne tient plus la campagne que grâce à sa mobilité et en harcelant les troupes françaises. Lamoricière l'a vainement pourchassé sans l'atteindre. C'est dans le sud et au Maroc qu'il peut retrouver des forces. Il faut lui barrer la route.
Au début de 1843, l'émir reparaît dans l'Ouarsenis : la saison encore peu favorable empêche Bugeaud d'agir. Mais, au printemps, il se remet en campagne avec ses lieutenants et commence par occuper les grandes avenues du pays : camps d'El Asnam (Orléansville), de Tiaret, de Teniet el Had, de Boghar.
Le duc d'Aumale, qui commande à Boghar, sait que la Smala ne peut être loin et il se jure de l'atteindre. Avec ses 60 à 70.000 âmes, elle se meut difficilement. Le duc d'Aumale apprend qu'elle a hiverné à Goudjilah ; il occupe ce point le 14 mai. La smala, lui dit-on, est du côté de Taguin. Trompé par un faux renseignement, il se trouve brusquement en présence du vaste campement avec sa seule cavalerie, le 16 vers 11 heures du matin. L'occasion est propice : attendre l'infanterie, c'est risquer de la laisser passer. Le duc d'Aumale se précipite, s'empare de la smala : les prises sont considérables, l'effet produit prodigieux.
L'émir lui-même se sent atteint par ce coup de fortune où les musulmans voient la volonté de Dieu : un moment découragé, il songe à se retirer en Orient. La dépression ne dure pas. Mais Abd el Kader est traqué : à plusieurs reprises, il est sur le point d'être pris par le colonel Géry
(21 juin, début d'août, 12 septembre), par Lamoricière
(22 septembre). Il se réfugie au Maroc.
Alors, se produit dans le drame une péripétie : après de longues hésitations, les Marocains interviennent dans la lutte. La guerre est inévitable, du fait qu'ils donnent asile à l'émir, qui en profite pour organiser sur leur territoire ses coups de main et ses razzias contre l'Algérie, qui ose même y envoyer ses prisonniers. Mais les hostilités prennent bientôt un caractère plus net. L'occupation de l'Algérie par les Français s'étend : au printemps 1844, le duc d'Aumale occupe Biskra, Bugeaud occupe Dellys, un camp français est établi à Laghouat et, comme il était inéluctable, Lamoricière occupe Lalla-Maghrnia. Région toujours contestée à laquelle le sultan du Maroc n'a jamais renoncé.
Il y a des troupes marocaines à Oujda. Leur chef somme Lamoricière d'évacuer Lalla-Maghrnia : Lamoricière refuse. On essaie de négocier, mais les palabres dégénèrent en bataille. En juin, Bugeaud occupe Oujda temporairement sans rien obtenir : le sultan compte sur l'appui britannique. L'affaire se règle au mois d'août. Tanger est bombardé par l'escadre du prince de Joinville le 6, Mogador le 15 ; le 14, Bugeaud bat complètement sur l'Isly l'armée marocaine commandée par un fils du sultan. Le 10 septembre est signé le traité de Tanger, dont la clause principale met Abd el Kader hors la loi. Le traité est complété par la convention de Lalla-Maghrnia, sur les limites entre le Maroc et l'Algérie (18 mars 1845) : il est bien dit qu'Abd el Kader sera extradé s'il se réfugie au Maroc, mais la frontière est tracée de façon imprécise et inopportune.
Bugeaud, rentré en France en novembre 1844, croit la question réglée. Tout va cependant être remis en question. Au début de 1845, le pays est agité par le marabout Bou Maza (l'homme à la chèvre), qui profite du mécontentement causé par les maladresses de l'administration française. Au mois de janvier, Sidi Bel Abbès a été surpris. Orléansville est menacée, la révolte gronde dans la vallée du Chélif, dans l'Ouarsenis, dans le Dahra. Une action vigoureuse est nécessaire. Bugeaud, rentré en mars, travaille dans l'Ouarsenis, Pélissier dans le Dahra ; Bou Maza est battu par Saint-Arnaud (21 mai) et s'enfuit. Mais la situation reste obscure : de faux Bou Maza apparaissent çà et là. L'agitation est entretenue par Abd el Kader. Cependant Bugeaud rentre en France au début de septembre, laissant l'intérim à Lamoricière.
Tandis que celui-ci se garde surtout au sud, l'initiative désordonnée d'un sous-ordre, le lieutenant-colonel Montagnac, qui brûle de se mesurer avec Abd el Kader, vient troubler l'application de son plan. Montagnac quitte Djemmaa-Ghezaouet avec 346 hommes du 8e bataillon de chasseurs d'Orléans et le 2e escadron du 2e hussards (Commandant Courby de Cognord) ; le 23 septembre, il se porte vers le Djebel Kerkour, engage la lutte sans que ses forces soient réunies et dès le début est mortellement blessé. La plupart des hommes sont massacrés, Courby de Cognord, blessé, est fait prisonnier ; 82 hommes s'enferment dans le marabout de Sidi-Brahim et tiennent contre tous les assauts : le 26, ils se font jour vers Djemmaa-Ghezaouet, mais se désunissent pour boire dans un ruisseau ; quatorze d'entre eux rejoignent le poste ; un seul, le caporal Lavayssière, a encore son fusil.
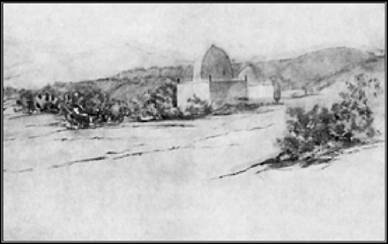 Le marabout de Sidi-Brahim, d'après Genêt.
Le marabout de Sidi-Brahim, d'après Genêt.
L'effet produit dans toute l'Algérie fut immense : l'insurrection se généralisa. L'armée française semblait traverser une crise : un convoi de cartouches envoyé par Cavaignac qui commandait à Tlemcen capitula en rase campagne avec son escorte non loin d'Aïn Temouchent le 27 septembre, devant Abd el Kader.
L'énergie de Lamoricière et de Cavaignac sauva l'Oranie et l'Algérie tout entière. Bugeaud débarqua à Alger le 15 octobre et agit immédiatement. Il mit sur pied jusqu'à 18 colonnes à la fois, opérant les unes sur le pourtour, les autres au centre. Devant cet effort, les insurgés ne tiennent pas : plusieurs Bou Maza sont défaits. En novembre, Abd el Kader, qui s'est porté vers le plateau du Sersou, doit s'enfuir vers le sud. Il tâche de se maintenir successivement dans les massifs montagneux qui ont toujours permis une résistance opiniâtre : il est chassé de l'Ouarsenis ; puis il s'élance du Djurdjura sur la Mitidja où il est arrêté de justesse ; rejeté dans le Djurdjura, il n'est pas suivi par les Kabyles. Il se réfugie au Djebel-Amour, mais les Oulad-Naïls et les Harrar demandent l'aman au Français. En mai 1846, il se porte chez les Oulad Sidi Cheïkh : le colonel Renaud arrive à El-Abiod au début de juin. Abd el Kader s'enfuit à Figuig.
Pendant cette dure campagne, les prisonniers français de Sidi-Brahim et d'Aïn Temouchent, gardés à la Deïra (smala très réduite) sur les bords de Moulouya, ont été presque tous massacrés en l'absence de l'émir. Les survivants, avec Courby de Cognord, sont mis en liberté contre rançon en novembre ; quelques-uns dont le clairon de Roland avaient réussi à s'évader.
L'émir, coupé des révoltes algériens, s'entend avec Bou Maza, qui tente d'opérer dans Tittery. L'homme à la chèvre est à son tour pourchassé chez les Oulad Naïls, en janvier - février 1847, et, après un nouvel échec dans le Dahra, se rend à Saint-Arnaud le 13 avril. La pacification de l'Algérie est en bonne voie quand Bugeaud, las des attaques dont il est l'objet au Parlement, rentre en France (5 juin 1847) après une courte campagne en Kabylie.
Son successeur, le duc d'Aumale, allait avoir l'honneur de recevoir la reddition d'Abd el Kader.
Celui-ci ne peut plus rien obtenir des Marocains qui entrent même en lutte avec lui et empêchent des contingents algériens de le rejoindre : le sultan craint l'ambition de l'émir. Celui-ci est hors d'état d'agir : le Maroc est hostile. L'Algérie est maintenant bien gardée. Les deux frères de l'émir demandent l'aman. Lui-même tente de rentrer en Algérie, il passe la Moulouya en subissant des pertes élevées, mais tous les passages sont gardés. Après des tractations dans lesquelles on lui a promis qu'il pourrait se rendre en Orient, Abd el Kader fait sa soumission le 23 décembre 1847.
On sait que la monarchie de juillet et la Seconde République ne purent se décider à lui permettre de quitter le territoire français. C'est Napoléon III qui tint la parole donnée. Le 21 décembre 1852, l'émir arrivait à Brousse. Il acceptait pleinement la situation et employa toute son énergie à sauver les Français lors des émeutes de Damas en juillet 1860. Au reste, n'a-t-il pas écrit : " Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, je ferais cesser leur divergence, et ils deviendraient frères à l'extérieur et à l'intérieur
***
V
L'Achèvement de la Pacification
La fin de la lutte contre Abd el Kader marquait la principale étape de la pacification en Algérie. Elle ne sauva pas plus la monarchie de juillet que la prise d'Alger n'avait sauvé Charles X. Du moins était-ce un magnifique héritage que le Roi des Français laissait sur la terre d'Afrique à la Seconde République. Il s'étendait du Maroc à la Tunisie, de la Méditerranée au Sahara. Aucun homme, aucun chef n'était capable de reprendre à son compte l'impossible rêve d'Abd el Kader. A la poursuite de celui-ci les colonnes françaises avaient montré leurs drapeaux et pacifié les populations, même dans les vieux môles de résistance comme l'Ouarsenis, l'Aurès, le Djebel-Amour. Elles étaient allées jusqu'à Laghouat et jusqu'à Biskra. La mise en valeur, la colonisation, avaient commencé, grâce aux efforts des autorités joints à ceux des particuliers, au premier rang desquels il faut citer le baron de Vialar.
Il restait cependant une lourde tâche à remplir. La Kabylie n'avait pas cédé aux sollicitations d'Abd el Kader. La soumission de celui-ci ne l'affectait pas ; et les Kabyles n'étaient pas disposés à reconnaître les autorités françaises. Dans le sud, le contact avec les grands nomades était à peine pris, il fallait établir la sécurité de la rive septentrionale de la mer saharienne.
 Un des premiers colons algériens : A. de Vialar.
Un des premiers colons algériens : A. de Vialar.
Une première solution fut obtenue des deux côtés moins de dix ans après la soumission d'Abd el Kader. Elle fut remise en question, d'abord dans le sud (1864), puis en Kabylie (1871). Sur ce dernier point un effort intense permit une pacification rapide. Dans le sud il fallut guerroyer jusque dans les premières années du XXe siècle.
La question se posa des deux côtés simultanément et dans des conditions analogues : soulèvements locaux provoqués par des agitateurs qui couvraient d'un prétexte religieux leur désir de pillage. En 1849, Bou Zian, dans le Sud, Bou Baghla, en Kabylie, forcent les Français soit à agir, soit à envisager une action sérieuse.
Dans le sud ce fut l'affaire de Zaatcha, pénible et coûteuse. Après un premier assaut infructueux le 20 octobre 1849, des renforts furent envoyés et permirent de prendre le Ksar. Les pertes françaises s'élevaient à 1.500 tués et blessés. Affaire purement épisodique d'ailleurs, malgré son caractère meurtrier, et qui n'empêcha pas l'agitation de se poursuivre. Elle atteignit un certain développement en 1852.
Un chérif, qui avait fait parler de lui dans les dernières années de la lutte contre Abd el Kader, Mohammed ben Abdallah s'était mis à prêcher la guerre sainte parmi les populations sahariennes rassemblées autour de lui. Ses partisans mirent la main sur Laghouat. De ce point, où il vint lui-même s'installer, il tenta d'entraîner les tribus de l'Atlas et des Hauts-Plateaux. Il fallut, pour le réduire, l'action combinée des deux colonnes Pélissier et Yusuf, qui s'emparèrent de Laghouat le 4 décembre 1852, tandis que leur mouvement était couvert à distance par Mac-Mahon dans la région de Biskra.
Mohammed ne s'avoua pas battu et reparut quelques mois plus tard dans le Mzab. Le général Randon, gouverneur général, mettant en oeuvre, une politique qui a toujours donné des résultats, s'entendit pour le réduire avec les Oulad-Sidi-Cheïkh, et avec leur chef Si Hamza. Les forces indigènes de celui-ci appuyées en profondeur par les colonnes françaises se mirent à la poursuite du Chérif, qui fut battu à Ngouça, et s'emparèrent d'Ouargla. En 1854 l'intervention d'un allié de Mohammed amena une campagne sur l'Oued Rhir et l'entrée des troupes françaises à Touggourt (29 novembre) et dans le Souf. La pénétration vers le sud fut momentanément arrêtée : Si Hamza exerçait le commandement dans la région de Géryville et Ouargla et resta fidèle à l'amitié française.
En Kabylie, à la suite des troubles de 1849, le gouverneur-général d'Hautpoul avait demandé à Paris l'autorisation d'occuper le massif. Le gouvernement s'en tint aux demi-mesures et n'admit qu'une campagne en Petite Kabylie. De mai à juillet 1851, Saint-Arnaud promena ses troupes entre Mila et Djidjelli : le résultat final ne pouvait être atteint de cette façon.
Nommé gouverneur général, Randon, dont on a vu l'heureuse action dans le Sud, résolut de régler la question suivant un plan méthodique. Il porta d'abord son effort sur les communications, procédé toujours fécond : construction des deux routes Bougie-Alger-Dellys, et Aumale-Sétif-Bougie. Mais il entra en rivalité avec Saint-Arnaud et ce dissentiment empêcha de régler d'un coup le problème ; encore une fois Paris n'admit qu'une opération partielle, une nouvelle campagne en Petite Kabylie. Menée par Randon lui-même avec les divisions Mac-Mahon et Bosquet, elle aboutit du moins à la pacification de la région située entre Djidjelli, Collo, Constantine et Sétif.
Ce premier succès eût permis à Randon d'achever son oeuvre, si les circonstances n'étaient venues encore se mettre à la traverse. Cette fois, il fut arrêté par les prélèvements opérés sur les troupes d'Algérie pour l'expédition de Crimée. Il ne resta pas inactif, mais il ne put donner à ses opérations l'envergure nécessaire. A la suite d'un soulèvement contre l'Agha du Sébaou (1854) Randon exécuta une reconnaissance en force qui mena les troupes françaises jusqu'au territoire des Beni Yahia : les tribus durent payer une contribution de guerre. Mais l'action de présence ne put être exercée ; nos troupes se retirèrent ; l'agitation reprit. Le poste de Tizi Ouzou fut attaqué. Une opération vers Dra el Mizan (1856) fut, naturellement, encore insuffisante pour amener la solution.
 Le général Randon en Kabylie (1857), d'après Devilly.
Le général Randon en Kabylie (1857), d'après Devilly.
Enfin, en 1857, Randon put exécuter la campagne qu'il préparait depuis si longtemps. Laissant un détachement à la surveillance du Djurdjura, Randon lança trois colonnes dans les montagnes Kabyles. L'opération commença le 24 mai. Elle atteignit d'abord les Beni Raten : partant de Tizi Ouzou, les troupes françaises occupèrent le plateau de Soukh el Arba : les Beni Raten entrèrent en pourparlers. Fidèle à sa méthode, Randon fit construire une route assurant les communications avec Tizi Ouzou. Et dès le 14 juin avait lieu la pose de la première pierre du Fort Napoléon (Fort National).
La campagne fut reprise quelques jours plus tard : prise d'Icheriden par Mac-Mahon (24 juin) mettant hors de cause les Beni Menguellet, combats d'Aït Hassen et de Taourirt Mimoun, qui amenèrent la soumission des Beni Yenni. La campagne s'acheva le 11 juillet dans le Djurdjura par la capture de la maraboute Lalla Fatma. Randon, parfaitement au courant du caractère et des moeurs des Kabyles, leur laissa leurs institutions particulières et une large autonomie municipale.
La pacification semblait complète.
Une première crise se produisit cependant dans le sud en 1864.
L'accord avec Si Hamza avait permis de prendre contact avec les Sahariens (voyage de Duveyrier chez les Touareg, accord avec les Adjer en 1862). En mars 1864, Si Sliman, deuxième successeur de Si Hamza, rejeta la fidélité à la France à la suite de blessures d'amour-propre (il n'avait reçu que le titre de bachagha, au lieu de celui de khalifat qu'avait eu Si Hamza). Le 8 avril, le commandant supérieur de Tiaret, le colonel Beauprêtre, qui marchait contre les insurgés, fut surpris et massacré avec sa colonne. Si Sliman resta lui-même sur le terrain du combat.
Son frère, Si Mohammed, qui le remplaça, profita de l'émotion causée par la catastrophe de la colonne Beauprêtre et réussit en quelques jours, à déclancher un vaste mouvement du Djebel Amour au Tittery. Les troupes françaises parvinrent à empêcher les insurgés de prendre pied dans les Hauts-Plateaux. Mais l'importante tribu des Flitta entre le Cheliff et Tiaret, se souleva à la voix du marabout Sidi-Lazreg ; les tribus du Dahra s'agitèrent. En dépit de l'affaiblissement des effectifs (expédition du Mexique), le général Martimprey, gouverneur général par intérim, à la suite du décès du maréchal Pélissier, prit la direction des opérations avec énergie. A la suite d'un combat où leur chef fut tué, les Flitta se soumirent à la fin de juin, et le calme se rétablit dans le Djebel-Amour et le Tittery.
La situation resta longtemps troublée en Oranie. De ce côté, Si Mohammed tint la campagne jusqu'à sa mort (4 février 1865). Il aurait fallu atteindre la région de Figuig, le Maroc, où les rebelles trouvaient un refuge. Le gouvernement français s'opposa à ce mouvement. Pendant plusieurs années on dut rester sur le qui-vive, en s'opposant aux razzias des pillards sans pouvoir trancher dans le vif. Cependant, en juillet 1870, une attaque contre les Hamyan fit autoriser le général Wimpfen à agir contre les Zegdou (Oulad Djerir, Beni Guil, Doui Menia) : son succès fut complet. Il fut malheureusement temporaire, et l'agitation continua. Elle ne devait cesser que lorsque la pénétration saharienne eut porté ses fruits : c'est un sujet qui vaut d'être étudié pour lui-même.
Plus brève, mais aussi plus grave et plus meurtrière, fut, en 1871, l'insurrection de la Kabylie. La guerre franco-allemande avait amené une nouvelle et très profonde baisse des effectifs, et nos défaites un redoutable affaiblissement du prestige français. Avec une extraordinaire légèreté le gouvernement de la Défense Nationale choisit ce moment pour introduire des modifications sérieuses dans le système administratif de l'Algérie : substitution du régime civil au régime militaire, naturalisation en bloc des israélites en vertu du décret Crémieux. On inquiétait à la fois les chefs indigènes jaloux de leur autorité, et la masse des musulmans.
L'agitation alla s'amplifiant, et, à cause du manque de troupes, aboutit à une véritable insurrection. Elle fut menée par un descendant d'une famille illustre, Moqrani, Bachagha de la Medjana, et prit un caractère religieux du fait de l'alliance qu'il conclut avec le cheikh Haddad, chef de la confrérie des Rahmanyia. Moqrani commença par adresser une déclaration de guerre en forme au général commandant la subdivision de Sétif (14 mars 1871) et par mettre le siège devant le poste de Bou Arreridj. Peu après, les Rahmanyia étaient appelés à la guerre sainte par le cheikh Haddad (8 avril).
La guerre sainte prit la forme du pillage : les villages et les fermes isolés furent dévastés, les villes bloquées. C'est-à-dire (car le mot blocus évoquerait des visions militaires inexactes) que les communications furent interceptées. Dellys, Bougie ne purent plus trafiquer avec les environs ; des postes même, comme Fort-National, se trouvèrent coupés du reste du pays. Souvenir des années de naguère : la Mitidja fut envahie. En quelques jours, 150.000 Kabyles avaient pris les armes.
Ils furent arrêtés dans leur marche sur Alger au village de l'Alma (22 avril). Mais l'insurrection gagnait. Tandis que Moqrani était vers Aumale, toute la Grande Kabylie était soulevée ; le mouvement s'étendait aux tribus du Hodna, puis aux Beni Menacer, entre Cherchell et Miliana.
Le gouvernement français, qui avait pourtant à faire face en même temps à la Commune de Paris, put envoyer des troupes en Algérie avec un gouverneur général clairvoyant et décidé, l'amiral de Gueydon. Dès le 5 mai, Moqrani fut tué dans un combat sur l'Oued Soufflat, et son frère Bou Mezrag vit bientôt le plus grand nombre de ses partisans le quitter. La contre-offensive s'organisa en mai et juin, Tizi Ouzou, Dellys, Dra el Mizan furent délivrés. Les derniers champions de la résistance furent battus à Icheriden. Haddad et ses fils se soumirent le 13 juillet. Bou Mezrag se réfugia dans le sud et ne fut capturé qu'en janvier 1872.
L'insurrection avait trouvé à son début des circonstances favorables, mais l'oeuvre accomplie depuis quarante ans avait déjà porté ses fruits : le mouvement resta presque entièrement localisé dans la province de Constantine. Dans celle d'Alger, il n'eut que peu de succès et n'en eut pas du tout dans celle d'Oran.
***
CONCLUSION
On a souvent abusé de la comparaison entre l'oeuvre de Rome et celle de la France en Algérie. Le rapprochement peut cependant être fait, à condition de n'être pas poussé trop loin.
Comme la paix romaine, la paix française assure la sécurité et la prospérité du pays. Elle, a mis un terme, dans ce qu'elles avaient de dévastateur, aux querelles de tribus, de clans et de familles ; elle permet à chacun de profiter sans trouble des fruits de son travail. Ceux-ci se développent de plus en plus ; il y a encore beaucoup à faire, et notre " politique de l'eau " n'est guère qu'à ses débuts, mais les statistiques du commerce extérieur sont probantes (1), et rendent éloquemment témoignage de l'oeuvre accomplie. Depuis cent ans, il y a eu des combats en Algérie, mais il y a eu aussi création de richesses.
Il y a cependant, entre l'Algérie française et l'Algérie romaine, des différences dont la principale est due à la politique de colonisation. Celle-ci a amené en Algérie des éléments européens d'origine très diverse, et le problème a été d'abord d'en faire un ensemble unitaire (ce qui a assez bien réussi), puis de faire vivre cet ensemble en bonne harmonie avec les indigènes.
Les Romains eux aussi, comme les Carthaginois, ont bien dû avoir une politique indigène. Mais ses bases n'étaient pas celles de la nôtre. Le considérable apport ethnique qu'ils n'ont pas réalisé, et que nous avons suscité, a posé un problème spécial et requis des solutions nouvelles. Problème d'autant plus complexe, solutions d'autant plus difficiles, que la mise en valeur progressive des ressources du pays par la colonisation a provoqué un accroissement sensible de la population indigène. Cet accroissement, qui évoque le souvenir de l'Algérie romaine très peuplée, provoque un conflit entre la politique indigène et la politique de colonisation : conflit pacifique, d'ailleurs, et qui, est loin d'être insoluble.
A la condition toutefois qu'on sache comprendre et interpréter les exemples fournis par l'écroulement de la domination romaine et de la domination turque. L'une et l'autre sont tombées parce qu'elles avaient abouti à une politique purement fiscale, tendant à négliger les intérêts du pays. Il n'est pas question de contester les droits des Européens venus en Algérie à l'appel des autorités françaises. Mais il est indispensable, par une politique éclatante de justice, de toucher le coeur des indigènes. Le mot de collaboration, dont on fait un usage si fréquent doit inspirer autre chose que des discours d'apparat : adaptation de la politique indigène à des nécessités nouvelles.
Il y a une autre différence entre l'Algérie française et l'Algérie romaine, et c'est un avantage certain pour la première. L'Algérie française fait partie du vaste ensemble de l'Afrique du Nord, tout entier soumis à la direction de la France, comme jadis à celle de Rome. Le système est, dans l'application, souple et variable : l'impulsion de la puissance directrice ne se fait pas sentir de la même façon en Algérie qu'au Maroc et en Tunisie. Et l'histoire, surtout depuis la conquête arabe, explique et justifie les différences présentes. Mais l'ensemble harmonieux que constitue l'Afrique du Nord n'est lui-même qu'une partie de l'ensemble plus vaste qui s'étend d'un seul tenant de la Méditerranée au golfe de Guinée.
La France a rempli là une tâche gigantesque, où l'effort militaire n'a été que le prélude de l'effort civilisateur. Celui-ci tend à faire entrer dans la communauté des peuples de l'univers, dans l'humanité à la recherche du mieux-être, des populations qui jusque-là, repliées sur elles-mêmes, arrivaient péniblement à trouver le moyen de ne pas disparaître. Ces populations, la France les a appelées, les appelle encore, à améliorer leur existence en adoptant un rythme de vie nouveau, sans rien détruire de ce qui est respectable dans les traditions reçues des ancêtres. L'Algérie a été l'une des bases, peut-être même la base principale, de cette oeuvre grandiose, et ses enfants y ont collaboré avec ceux de la France.
L'Algérie a déjà témoigné sa reconnaissance à ceux qui l'ont ainsi grandie et enrichie. Le souvenir des turcos de 1870 n'était pas aboli dans les coeurs français, quand leurs descendants sont venus à leur tour verser leur sang pour la défense de la Métropole au cours de la guerre mondiale. Côte à côte avec nos ouvriers, avec nos paysans, avec nos intellectuels, avec nos bourgeois, ils ont lutté, ils ont souffert ; trop d'entre eux, comme aussi trop des nôtres, sont morts, glorieusement, de la mort des héros. De telles choses ne sortent pas de la mémoire : elles resserrent les liens anciens, elles en créent de nouveaux. La fraternité des armes n'est pas un vain mot : elle unit dans la paix, comme elle les a unies dans la guerre, la France et l'Algérie.

(1) La moyenne annuelle des transactions de l'Algérie avec l'extérieur est passée de 25 millions dans la décade 1831-1840, à 1.724 millions dans la décade 1911-1920 ; le chiffre de l'année 1928 atteint 1.750 millions (ramené comme celui de la décade 1911-1920 à la parité de l'or).
| |
NOS BUVARDS D'ANTAN
Envoyé par M. Jean Pierre PEYRAT
|
|
MESSAGE de M. AXISA
Bonjour monsieur BARTOLINI Jean-Pierre,
Bône a toujours été considérée comme la seconde capitale de Malte au vu du nombre d'habitants venus, venant et repartant et cela longtemps avant l'arrivée de la France en Algérie.... Bon, je ne vais pas vous ré-écrire l'histoire.
Je me présente comme un habitant de Bône, de la Colonne en plus, pas loin de la statue de Diane Chasseresse où se tenait le marchand de brochettes, vous savez avenue Garibaldi. Ma mère y était sage-femme... etc...
Mais là n'est pas le propos de ce message.
Vous serait-il possible de passer une petite annonce pour tous les pied-noirs qui s'intéressent à leur passé généalogique et fidèles lecteurs comme moi de "La Seybouse" ?
GENEALOGIE
Nous avons le plaisir de vous informer que le "Groupe ADAMI" à mis en ligne ce jour un grand nombre de relevés BMS de Malte, sur la période 1500-1800 :
12.300 Baptêmes
113.000 Mariages
2.300 Sépultures
Il y a aussi beaucoup de relevés concernant la Tunisie.
Ces relevés sont accessibles à partir de :
http://www.geneanum.com/
Ils ont été effectués par une équipe de 90 bénévoles, hors structure associative, entre 2006 et 2010.
Les sources suivantes ont été, en particulier, utilisées : relevés ADAMI, Certificats délivrés par les Paroisses, photos de Registres Paroissiaux.
Le Comité de Pilotage du Projet ADAMI
Bernard AXISA
Christiane CHARREL
Georges GANDER
Josyanne MASSA
Thierry PALUD
Nicolas VELIN
Avec votre assentiment, l'adresse de votre Site sera donnée sur la page :
http://www.geneanum.com/malte1/liens.html
Vous serait-il possible, à titre de reciprocité, de mentionner en référence l'adresse de notre Site sur vos pages ? Merci par avance.
Et surtout merci pour La Seybouse, continuez comme ça, nous vous en sommes tous reconnaissants, vous apportez dans beaucoup de coeurs un coup de soleil.
Bien cordialement et amicalement,
Bernard
| |
| Comment avoir des vacances ?
Envoyé Par Marie
| |
Deux fonctionnaires ont envie d'un peu de repos : or comme ils reviennent de vacances, ils cherchent à trouver un moyen de se reposer gratuitement (ayant épuisé leur quota de congés maladie).
L'un des deux dit : Je sais comment faire. Il monte sur son bureau, soulève une dalle du faux plafond, se hisse dans le faux plafond et ne laisse dépasser que sa tête, puis attend.
Le chef de service arrive, le voit et s'exclame : Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes devenu fou?
Le premier employé répond : Je ne suis pas fou, je suis une ampoule électrique!
Le chef de service : Mon pauvre vieux, vous êtes vraiment surmené;
Rentrez chez vous, reposez vous pendant 2 semaines, j'en prends la responsabilité.
Content de lui, l'employé s'en va.
Le second employé prend alors son sac et sa veste et commence à partir.
Le chef de service le retient et lui demande ce qu'il fait.
Le second employé répond : Et alors, comment voulez-vous que je travaille dans le noir?
|
|
|
NOTES
Bulletin de l'Algérie
N° 7, Mai 1856
|
|
LE SORGHO A SUCRE,
(Holcus saccharatus.)
SA CULTURE. - SON EMPLOI.
Il est un produit, d'importation récente en Algérie, qui, depuis quelque temps, attire l'attention et excite la curiosité des agriculteurs de France : c'est le sorgho à sucre, originaire de la Chine, apporté chez nous par notre consul à Sang-Haï, M. de Montigny, et dont la culture, essayée avec un succès complet sur plusieurs points de notre colonie africaine, paraît appelée à enrichir l'industrie nationale d'un nouvel élément de fabrication. L'habile directeur de la pépinière centrale du gouvernement à Alger, M. Hardy, a tenté sur ce produit de curieuses expériences pendant la campagne de 1855.
Le 18 mai, il en fit semer trois parcelles, d'une contenance réunie de 17 acres, et d'une qualité de terrain à peu près identique. Le sol, bien découvert, avait été labouré profondément et fumé. Le semis eut lieu en lignes espacées de 80 centimètres.
Quand les jeunes plants se furent suffisamment développés, il les fit distancer de 30 à 35 centimètres, en arrachant à la main ceux qui lui paraissaient parasites ou superflus. Il soumit ensuite successivement les autres à trois binages et à trois légères irrigations au moyen d'un peu d'eau versée dans une rigole ouverte au pied de chaque ligne, arrosage qu'il n'estime pas devoir consommer plus de 400 mètres cubes de liquide par hectare.
Puis, il ramena la terre au pied des plants, de manière à faire un petit billon, dont la ligne occupait le centre. Son but était, en leur offrant un, point d'appui contre le vent, de favoriser la pousse des racines qui naissent à la base, comme dans le maïs.
Or, la plupart des tiges atteignirent à une hauteur de 4 à 5 mètres; un grand nombre ne mesurait pas moins de 10 à 11 centimètres à la base.
C'est vers la mi-septembre que les graines parvinrent à maturité: malgré les déprédations des moineaux, les 37 ares en donnèrent 425 kilogrammes, soit 2,500 l'hectare, résultat dû principalement à la culture. Pour opérer industriellement, il eût fallu à M. Hardy une installation et des appareils qui lui manquaient.
Néanmoins, il coupa les tiges pour, en faire des pesées sur des surfaces dont il tenait compte dans diverses parties des trois parcelles, et il remarqua que chaque plant avait, en général, de 3 à 7 tiges, soit 5 en moyenne. Les ayant débarrassées de leurs feuilles et des pétioles engainant chaque mérithalle, les ayant ensuite privées de leur partie supérieure, ne contenant que peu ou point de parties saccharines, il les ramena à une longueur moyenne de 2 m. 50. Ces pesées lui donnèrent par hectare 83,250 kilogrammes de tiges saccharines.
L'année précédente, M. Hardy avait semé le sorgho par petites touffes espacées de 45 centimètres, et les tiges s'étaient élevées à peu près comme celles de cette année; mais, gênées par leur entourage, elles n'en avaient eu, tant s'en faut, ni le volume, ni le diamètre; le rendement ne dépassa guère par hectare 40 à 45,000 kilogrammes.
L'espacement et la disposition adoptés en 1855 semblèrent donc à l'habile praticien tout à fait applicables aux bons terrains fertiles, les seuls, du reste, qui conviennent au sorgho. Ces conditions se prêtent d'ailleurs merveilleusement à l'emploi des instruments attelés, la houe à cheval pour les binages, la charrue légère ou le buttoir, pour les raies d'arrosement.
Pilées dans un mortier, après avoir été coupées par tronçons, puis soumises à une pression énergique, les tiges donnèrent 67 p. 100 de jus. Ce jus, au moment de la récolte des graines, sur la fin de septembre, avait une densité de 80 3/4 à l'aréomètre de Baumé, soit approximativement 13 p. 100 de sucre, autant qu'on peut s'en rapporter à un calcul dressé sans saccharimètre. Il peut se faire aussi que celui qu'on recueillit renfermât une portion de sucre incristallisable, ou sucre de raisin.
Mais, en supposant que tout le sucre fût cristallisable, l'hectare aurait donné les résultats ci-après :
(83250/100) X 67 = (55,777/100) X 13 = 7,251 kilogramme de sucre, ou l'équivalent pour une partie de sucre, incristallisable.
Le jus contenant du sucre incristallisable, ou sucre de raisin, n'est pas moins susceptible d'alcoolisation que s'il contenait en entier du sucre cristallisable.
Les tiges dont on avait coupé les panicules de graines, étant restées sur pied, M. Hardy eut la satisfaction de les voir, deux mois après la récolte de la graine, conserver leur saveur sucrée, ayant résisté aux vents et aux vers, d'où il résulte qu'en Algérie, on peut utiliser les graines de sorgho en les laissant venir à maturité, sans diminuer la récolte du principe saccharin.
Ces graines, fort rares en ce moment, ont une assez grande valeur commerciale, mais elle descendra rapidement au niveau des mercuriales des céréales communes, la quantité produite par les récoltes devant alors dépasser de beaucoup les besoins des ensemencements; toutefois, elles pourront avoir une certaine valeur industrielle et servir à autre chose qu'à l'alimentation de la volaille et des porcs, comme celles du sorgho à balais.
Le docteur Sicart, de Marseille, a trouvé, l'an dernier, qu'elles contenaient dans leur épiderme une très belle couleur rouge avec des nuances dans toute la gamme jusqu'au violet; et M. Chevreul a découvert que cette couleur teignait admirablement la soie. M. Hardy, de son côté, a extrait des tiges du sorgho un produit qui pourra ne pas être sans importance, comme on va le voir.
Le sorgho à sucre est vivace : ses plants, à la fin de leur seconde année d'existence, commencent à faire une troisième pousse et se disposent à accomplir leur végétation dans une troisième année; mais il ne faudrait pas en conclure qu'il y ait utilité à conserver une plantation pendant plusieurs saisons. M. Hardy pense que ce serait plus onéreux que productif : la seconde année les tiges atteignent à peine la hauteur de 1 mètre 50 centimètres, 2 mètres tout au plus; elles sont grêles, chétives, beaucoup moins grosses d'ordinaire que le petit doigt, si on les compare à ce qu'elles étaient au bout de la première année. A la troisième, il est plus que probable que leur développement sera moindre encore. En outre, il en résulterait un grand épuisement pour la terre, et mieux vaut cent fois se hâter de retourner le sol par un labour de charrue dès la fin de la première saison.
Malgré l'opinion contraire, M. Hardy ne pense pas que le sorgho à sucre puisse donner deux bonnes récoltes de tiges dans une même année. Pour favoriser le développement de la seconde pousse, on serait toujours tenté de couper les tiges de la première avant la formation des graines ; il en résulterait infailliblement un sucre n'ayant pas encore acquis tout son principe sucré, et l'on perdrait, en outre, le produit de la graine.
Les tiges, succédant à la première coupe ayant porté des graines, demeurent herbacées et donnent un jus trop pauvre pour couvrir les frais de fabrication. Il sera toujours préférable de faire de cette seconde pousse la pâture du bétail, qui manque précisément d'herbages à cette époque, fin d'octobre et commencement de novembre. Un des bons côtés de la culture de cette plante, c'est qu'on peut utiliser une notable portion de ses dépouilles à l'alimentation du bétail, et contribuer ainsi puissamment à la production des engrais, large compensation à l'épuisement du sol qu'elle occasionne.
M. Hardy, poursuivant activement ses expériences, a conservé sur pied jusqu'au mois de février dernier les tiges écimées par suite de la récolte des panicules de graines. Voici les résultats de ses extractions de jus à diverses époques :
Fin septembre, au moment de la récolte des graines, 67 de jus sur 100 parties de tiges, jus d'une densité de 8° 3/4 ;
28 novembre, 52 % de jus; densité 9° 1/2 ;
31 janvier, 51 % de jus; densité 8° 1/2 ;
16 février, dernière épreuve, 49,50 % de jus ; densité 8°.
Ainsi, de la fin de septembre à la fin de novembre, les tiges restées sur pied n'ont rien perdu de la proportion de leur propriété saccharine. En effet, si la quantité de jus a diminué de 15 %, représentant 0,66 % d'alcool, en revanche, ce jus a gagné 0,75 % en richesse, représentant à peu près l'équivalent en alcool ; donc, la richesse saccharine ou alcoolique a, au contraire, augmenté.
De la fin de novembre à la mi-février, la diminution au poids et en titre de jus n'a pas été sensible au point qu'il n'y ait pas économie à conserver les tiges sur pied pour alimenter la fabrication durant ce long espace de temps. Dans le midi de la France, les gelées les ont détruites dès la fin d'octobre ; en Algérie, elles résistent sans altération, pour ainsi dire, et sans frais, pendant la majeure partie de l'hiver, pour entretenir les distilleries.
Les essais d'alcoolisation ont été faits par M. Hardy sur le jus extrait le 31 janvier. Il a mis dans deux ballons de verre deux litres de jus avec une addition de levure de bière un peu vieille, un peu acidulée, et deux litres sans ferment; il a fait bouillir des tronçons de sorgho sucré, les a fait peler et en a extrait le jus à la presse. Ce jus a été introduit dans un troisième ballon ; et les trois ont été placés dans la serre aux boutures de la pépinière centrale, à une température oscillant de 22 à 30° centigrades. Dès le lendemain, le jus pur et simple commençait à fermenter ; il s'en dégageait de nombreuses bulles de gaz acide carbonique, tandis que le jus avec addition de levure, ainsi que le jus bouilli, ne donnait aucun signe de fermentation.
Le 3 février, M. Hardy fit un essai avec l'appareil Salleron :
Le jus simple donna 2 1/2 % d'alcool;
Le jus avec addition de levure, 0;
Le jus bouilli, 0.
Le 6 février, un deuxième essai eut lieu :
Le jus simple donna 6,20 % d'alcool;
Le jus avec addition de levure, 0;
Le jus bouilli, 0.
Le 8 février, troisième essai :
Le jus simple donna 10,30 % d'alcool
Le jus avec addition de levure, 0;
Le jus bouilli, 1 %.
Le 10 février, quatrième essai :
Le jus simple donna 9,90 % d'alcool;
Le jus avec addition de levure, 0;
Le jus bouilli, 3,20 %.
Le 12 février, cinquième essai :
Le jus simple donna 9,30 % d'alcool ;
Le jus avec levure, 1 %;
Le jus bouilli, 5,40 %.
Le 14 février, sixième essai :
Le jus simple donna 8,60 % d'alcool;
Le jus avec levure, 0;
Le jus bouilli, 2,40 %.
Le 16 février, septième et dernier essai :
Le jus simple donna 7,90 % d'alcool;
Le jus avec levure, 0;
Le jus bouilli, 1,90 %.
Cette série d'expériences est concluante : le jus du sorgho sucré a en lui-même son principe fermentescible ; il n'est nécessaire d'y ajouter aucun levain pour en obtenir la fermentation alcoolique, pourvu qu'on ait soin de le soumettre à une température convenable. C'est au bout de huit jours de fermentation qu'il atteint son maximum d'alcoolisation et qu'il peut être distillé. Deux jours après, sa richesse alcoolique diminue, il passe à l'acidification.
La graine est également susceptible de donner une notable quantité d'alcool, comme les autres céréales. Selon M. Basset, on retire de la graine du sorgho ordinaire 24,75 % de son poids d'alcool; la production du sorgho sucré ne doit pas être moindre. 2,500 kg de cette graine, récoltés sur un hectare, rendraient donc 618 kg 75 grammes d'alcool.
Quand les tiges sont parvenues à maturité parfaite, il se développe, à leur surface, une efflorescence cireuse, comme dans certaines variétés de cannes à sucre. C'est de la cérosie, ou cire végétale, sèche, dure, susceptible de se pulvériser, fusible à 900. On en fait, mêlée à un peu de suif épuré, des bougies, dont la lumière a un bel éclat.
M. Hardy, avant dépouillé un certain nombre de tiges de leur cérosie, a pu se convaincre qu'on en récolterait aisément dans un hectare 108 kg 400 c., moyennant une dépense de 252 fr. de main-d'oeuvre. La cire d'abeille valant en moyenne 4 fr. le kg, la cérosie du sorgho sucré ne coûterait pas plus de 3 fr. 50; ce serait une recette de 330 fr. 62, donnant un bénéfice de 88 fr. 62 à porter au produit net de la culture de la plante, sans compter les améliorations économiques à apporter aux procédés d'extraction.
Les expériences d'alcoolisation auxquelles M. Hardy s'est livré, lui ont donné les résultats suivants : les 83,250 kg de tiges mondées et prêtes à être employées que donne un hectare, contiennent, au moment de la maturité de la graine, 67 % de jus, lequel renferme 10,30 % d'alcool absolu ; donc :
83,250 X (67/100) = 55,777 X (10,30/100) = 5,745 k. d'alcool.
L'emploi industriel de la graine sera très certainement sa transformation en alcool, et il en résultera :
2,500 X (24/75) = 618 k, 75.
Le rendement en alcool d'un hectare de sorgho sucré cultivé en Algérie sera donc finalement de 5,745 + 618,65 = 6,368 k 75, ou 7,964 litres 68; en nombre rond, 79 hectolitres et demi.
Le fourrage pour la nourriture du bétail que peut donner un hectare, tant de l'effeuillaison des tiges que du regain, ne doit pas être estimé à moins de 200 quintaux métriques, ramené à l'état sec. A 4 fr. le quintal, c'est encore un produit de 800 fr.
L
e revenu d'un hectare bien cultivé en sorgho à sucre se résume donc comme il suit :
7,954 lit. 68 d'alcool, à 140 fr. l'hectolitre, valeur actuelle sur les principales places de France, dont il faut déduire 10 fr. par hectolitre pour le transport, le coulage et les frais de tout genre, soit 130 fr. l'hectolitre, ci: 10,341
108 kil. 400 gr. de cérosie, à 3 fr. 50 c. le kil. . 330 62
20,000 kil. de fourrage, le quintal à 4 fr 800
TOTAL 11,471 62
Frais approximatifs par hectare, à déduire :
Labour, 80 fr.; hersage, 40 fr., ensemble 120
Ensemencement 30
Binages, sarclages, éclaircies 90
Irrigations 40
Valeur du fumier consommé 60
Frais de récolte 80
Loyer de la terre 100
Frais d'extraction de la cérosie 252
TOTAL 772
Frais de distillation à 30 fr. l'hectolitre, comprenant la main-d'oeuvre, le combustible, les fûts, les frais généraux, l'intérêt du capital engagé, l'entretien du matériel, etc 2,386 40
TOTAL 3,158 10
Bénéfice net 8,313 22
Ce bénéfice énorme est dû, il est vrai, en grande partie, à la cherté actuelle des alcools ; mais supposons-les tombés à 70 fr. l'hectolitre, chiffre le plus bas où ils puissent descendre, il n'en restera pas moins un bénéfice net de 3,340 fr. 49 c. par hectare, ce qui est encore fort beau. Ce serait donc là pour l'Algérie une industrie viable, à l'abri des crises, et méritant d'être encouragée.
Pour parcourir toutes les phases de sa végétation jusqu'à la maturité de ses graines, le sorgho à sucre a besoin de 2,760 degrés de chaleur. La mi-mai est la saison la plus favorable au semis ; la plante est mûre alors vers le 15 septembre. On peut la semer cependant encore avec succès à une température plus basse, de 12, à 15 degrés environ, vers les premiers jours d'avril. Dans ces conditions-là, la maturité a lieu vers le 13 août, après 135 jours de végétation. Il serait possible de la confier aussi à la terre vers la mi-juillet, pour voir la graine mûrir après 143 jours, sur la fin de novembre. Mais M. Hardy regarde ce terme comme le point extrême, qu'il serait dangereux de dépasser. Ainsi, les tiges pouvant se conserver pendant plusieurs mois, on doit être en position d'en alimenter les distilleries durant six mois au moins.
Une crainte s'est répandue dans le midi de la France, c'est que le sorgho à sucre, exclusivement multiplié par la graine, ne vînt à dégénérer, et l'on a conseillé de recourir aux boutures. Oui, cet abâtardissement serait possible si l'on cultivait cette plante sans prévoyance, dans le voisinage des congénères, du sorgho à balais par exemple, mais, isolée, elle ne risque rien. En outre, la multiplication par boutures ou drageons ne serait guère praticable en grand; elle aurait aussi l'inconvénient de débiliter et d'énerver la descendance.
Tel est, en abrégé, le beau travail de M. Hardy. Nous avons cru de notre devoir d'en reproduire au moins la substance dans un recueil principalement consacré à l'Algérie.
EUGÈNE DE MONGLAVE.
|
|
Les Souvenirs militaires
de M. le Colonel Henri Fabre-Massias
|
|
VOYAGE AUX ZIBANS (1848)
CHAPITRE IV
LE SAHARA. (suite)
Le matin, nous recommençâmes à descendre vers le point où les montagnes semblaient s'ouvrir et où je pensais retrouver la grande coupure des Ksours. Nos guides nous joignirent à la première vallée, et, après douze kilomètres environ, nous débouchâmes, en effet, en laissant le Touggourt à gauche, dans la vallée de Batna, nous dirigeant droit sur le camp, dont on pouvait de temps en temps apercevoir les principaux édifices. Nous y étions à dix heures et demie du matin. J'employai le reste de la journée à voir M. le colonel Carbuccia, pour le remercier, ainsi que le capitaine Marmier, de l'aide qu'ils avaient donnée à notre voyage, et à leur en rendre compte ; puis à revoir, avec un vrai plaisir, nos camarades de l'artillerie et du génie.
La soirée fut occupée des préparatifs de départ de ma section, que je devais ramener avec moi. Un de mes hommes, très malade de la fièvre, voulut absolument partir, malgré l'avis du médecin, qui craignait qu'il ne pu supporter la fatigue de la route et le froid des bivouacs. Cependant, ce malheureux témoignait une telle horreur pour le séjour de l'hôpital de Batna, une telle conviction qu'il y mourrait promptement, que je me décidai à l'emmener. Il voyagea dans mon manteau de toile cirée, supporta la route avec un bonheur inattendu, et j'eus le plaisir, deux mois après, de lui remettre un congé de libération à Philippeville. Il était à peu près rétabli, et protestait encore qu'il devait la vie à son départ de Batna.
Je mis en route mon convoi le matin. Puis, à dix heures, après déjeuner, nous montâmes à cheval avec le capitaine de Larminat, et, laissant à gauche la route ordinaire, nous passâmes par le haut de la plaine de Chemora que ferme Lamboesis et qui mène jusqu'à Ghrenchela et aux sources de la Medjerda, l'ancien Bagradas. Nous avions pour guide an spahi irrégulier, tout occupé de son chien de la race des grands lévriers du Sahara: celui-ci était, da reste, très inférieur aux lévriers da lieutenant Bonnemain, ces redoutables adversaires des chacals et, au besoin, des hyènes de Smendou ou de Constantine.
Après deux heures de marche, nous entrâmes dans un étroit ravin. Jusque-là nous avions marché sur le revers en pente douce des montagnes qui ferment du côté de l'est le grand chemin de l'Oumel-Esnam à Batna. Seulement, ces montagnes, si faciles à l'est, sont, de l'autre côté de- leur étroite crête, horriblement abruptes et difficiles. Elles opposent donc, pendant dix kilomètres environ, une barrière presque insurmontable entre les deux routes. Le ravin que nous prîmes ensuite est parallèle à l'ancienne route romaine qui menait à Lambaesis. II est étroit, gracieux, boisé de myrtes, de lentisques, de vigne vierge. Nous y remarquâmes surtout des pistachiers de l'Atlas, aux feuilles rougeâtres et plus dégagées que celles des lentisques ordinaires, dont ils semblent n'être qu'une variété.
Enfin, nous arrivâmes dans de grandes plaines d'une constitution assez étrange. Elles semblent appartenir à la même formation que celle de Lambaesis et avoir été le produit d'ondulations moins puissantes. Elles s'élèvent doucement du sud au nord et retombent brusquement de l'autre côté. Celle dans laquelle on débouche d'abord est surtout remarquable parce qu'elle est appuyée à une montagne assez importante, au pied de laquelle est une grande zaouïa. Ce commencement de la plaine semble être fréquemment inondé : le sol en est meuble et crevassé, mêlé de sable et d'argile et soulevé presque partout comme par une multitude de petites ravines.
Enfin, dans un point où la plaine du Mâder-Haracta (terrain de pacage des Haractas) se resserre et se relève de façon à déverser ses eaux entre deux lacs différents, nous aperçûmes le Madrassen. Nous y courûmes, et j'y passai une heure à le mesurer, à l'étudier partout, sans y comprendre autre chose qu'une construction analogue à celle des pyramides d'Égypte. Seulement l'Égypte a pris pour base le carré, tandis que la base du Madrassen est circulaire. Celui-ci est d'une construction très élégante : il est formé d'un cylindre de 4 mètres de hauteur environ sur 61°,50 de diamètre, soutenu par des colonnes engagées dans tout son pourtour et surmonté par une corniche très saillante. A partir de cette corniche, on s'élève par vingt-quatre marches colossales jusqu'à la petite plate-forme qui termine le monument à 18°,60 de hauteur. Chaque marche a 1 mètre de largeur et 0,60 de hauteur. Le revêtement est tout en pierre de taille. L'intérieur, qu'on voit par une large brèche faite au sud, est en moellons faillés avec soin. Aucune ouverture n'apparaît, et l'on conte que la grande brèche fut faite par l'artillerie d'un bey de Tunis, jaloux de pénétrer jusqu'aux trésors que, suivant la tradition, recèle ce monument. Cette oeuvre de destruction s'est étendue depuis la base jusqu'à la quatorzième marche : elle a respecté les dix marches supérieures.
Dans l'armée d'Afrique, on appelle ce monument " le tombeau de Syphax ". Il est bien à croire que c'est le monument funéraire d'une race de rois aborigènes. Les indications qu'il pourra donner nous seront bientôt connues, j'espère. M. le capitaine Viennot, chargé de l'étudier par le colonel Carbuccia, y a découvert une pierre mobile qui fermait l'entrée d'un escalier obstrué de décombres. Quel que soit au reste le sens du monument, il est d'un effet grandiose, et quand le soir, en le quittant à l'appel du guide, nous le revîmes, de la montagne voisine, éclairé par le soleil couchant, il produisit chez tous trois une impression extrêmement vive de grandeur, d'élégance et de triste majesté. Il anime et intéresse singulièrement cette solitude.
La nuit était faite quand nous rejoignîmes la section à la " fontaine du Rubis " ; elle fut très froide et nous trouvâmes de la glace le matin. Cela n'empêcha pas, bien entendu, l'étape du lendemain de se faire lestement et avec gaieté. Qu'on me permette encore de m'arrêter sur un seul détail du retour.
Je ne m'étais pas regardé comme ayant charge d'étudier le produit des lacs qui s'étendent au pied du Nif-el-Nser. Toutefois un phénomène singulier me détermina à rapporter des échantillons des sels qu'ils déposent. Quand nous passâmes l'isthme dont j'ai parlé, je trouvai que le lac du Nord s'était assez retiré pour permettre de gagner par la ligne la plus courte le pied du rocher qui sépare les deux lacs. Je m'engageai sur la surface abandonnée par l'eau, et qui me semblait couverte d'efflorescences blanches. Elle se trouva être un peu vaseuse, mais suffisamment solide pour porter mon cheval. Mais ce que j'avais pris pour des efflorescences était formé de dépôts épais de plusieurs millimètres, dont le plâtre, je pense, forme la base, et qui ont lié ensemble une sorte de fucus apporté par le lac et tous les menus objets que rejettent ses eaux. L'ensemble de ces fucus, des plumes les plis légères des flamands et des poules d'eau qui fréquentent ces lacs, et des sels de leurs eaux, constitue une sorte d'étoffe assez solide pour qu'on la soulève par larges lambeaux. Mon canonnier les prenait pour des toisons. J'en joignis des échantillons à ceux que je rapportai à Constantine avec quelques cristaux, des terres salpêtrées et du sable blanc et fin que Ban-Meïoub avait envoyé recueillir pour nous au fond d'un des puits de Farfar.
Le 14 novembre je rentrai à Constantine.
En achevant ce récit, je dirai quelques mots de ce qu'était le Sahara il y a huit ans ; il change tous les jours, et il n'est pas sans intérêt de garder la mémoire de ce qu'il était sous le gouvernement de son premier commandant français.
Chaque jour le sud de nos possessions d'Afrique est mieux connu, et l'impénétrable Sahara avec ses déserts de sable, l'effrayant mystère de ses vents de flamme et de ses infinis espaces vides, recule devant les conquêtes de nos armes et de notre politique. Mais un intérêt considérable restera attaché à ce pays des Zibans et grandira à mesure que nous le connaîtrons mieux. Climat, moeurs, histoire, tout y est spécial et digne de l'intérêt de l'homme d'État, de l'ethnographe, du philosophe, de l'économiste.
Ainsi, on remarque, en réalité, peu de différence entre le climat de l'Afrique du nord et celui du midi de l'Europe. Tout le bassin de la Méditerranée a, pour ainsi dire, les mêmes productions, les mêmes conditions de climat. Le rivage algérien a, sur ceux de la Provence et du Languedoc, cet avantage que la brise de mer y vient du nord, et rafraîchit singulièrement tout le milieu des jours d'été. Le palmier croit mieux en Espagne ou en Sicile que dans le nord de la province de Constantine. Si l'olivier y atteint des proportions magnifiques, l'oranger y réussit peu : c'est surtout une terre à céréales.
On ne trouve réellement un climat nouveau qu'au delà des deux Atlas, et la transition parait subite : on a traversé deux chaînes de montagnes et trois degrés de latitude. Mais les vallées de la première chaîne sont rafraîchies par le vent du nord et le voisinage de la mer. Le plateau, très élevé, se couvre de neige chaque hiver et est balayé en toute saison par des vents violents venus de tous les points de l'horizon. La chaîne du sud n'a que de rares et abrupts sillons ouverts au sud, et participant de la nature du Sahara. Mais au delà de cette chaîne se trouve une plaine déprimée jusqu'au niveau de la mer, et même, au-dessous de ce niveau, garantie des vents du nord par la haute muraille de l'Atlas, et dont le sol léger et perméable aux rayons du soleil se dessèche aisément et s'échauffe à une grande profondeur. La température moyenne y est très élevée : on n'y connaît plus la neige, et la pluie même y est très rare. Le vent y est habituellement d'une sécheresse extraordinaire et chargé de poussière impalpable qui obscurcit l'atmosphère comme un brouillard. Les circonstances du développement de la marche et de la nature du siroco sont, au reste, caractéristiques de la météorologie du Sahara, et méritent tonte l'attention des physiciens et des géologues. Les effets s'en font sentir sur tous les rivages de la Méditerranée, et sur l'Océan, jusqu'aux îles du Cap-Vert. M. Hardy pense même que des causes contraires établissent un courant régulier entre le Sahara et le Groenland. Je regarde comme certaine l'existence d'une corrélation entre les vents venus du Sahara et les grandes effusions de neiges fondues qui déterminent les inondations dans les vallées dont la tète est aux Alpes, aux Pyrénées, aux Cévennes. Quant aux effets du siroco dans les contrées mêmes où il prend naissance, ils sont extrêmement redoutés des indigènes, et c'est vraiment à bon droit. Les terribles récits que font les voyageurs des effets du simoun n'ont point exagéré la démoralisation ni les souffrances qu'il inflige à tous les êtres soumis à son influence. Heureusement elle parait être assez limitée, et ces terribles courants d'air chargé de poudre brûlante ne s'étendent pas sur de grandes largeurs; M. le duc de Montpensier nous racontait avoir vu, dans l'expédition d'avril 1844, ce courant se diviser en rencontrant les palmiers de l'oasis d'où le prince les observait. Une autre fois l'armée ayant été surprise en plaine par le vent du désert, le duc de Montpensier, après avoir marché en coupant le courant, avait trouvé un air plus libre et avait envoyé prévenir le duc d'Aumale, qui commandait en chef, qu'un déplacement de quelques centaines de pas ferait échapper nos soldats à l'affreux supplice que le siroco leur infligeait.
Avant de se décider à chercher les moyens d'échapper au vent, le prince avait passé un certain temps sous une tente double, couvert de deux bernous à ouvertures opposées et ayant sous la main une éponge et de l'eau dont il humectait sans cesse ses yeux et ses narines. Il était, nous disait-il, dans un état de prostration absolue, et comprenait parfaitement la terreur que le siroco inspire aux indigènes.
Le sol est léger, friable, et le vent semble l'écorcher. Il emporte avec la poussière les sels des lacs et des étangs desséchés, en sorte que derrière chaque touffe d'herbes s'allonge un petit amas de sable couvert d'une trace de sels blancs déposés après lui. Ces sels sont tantôt des sels marins comme autour de Biskra, tantôt des salpêtres ou des gypses. Dans certaines localités, où des chaînes de hauteurs opposent au vent des obstacles plus sérieux, il délaisse, sur de larges espaces, ces vagues mouvantes que nous avons désignées sous le nom d'Arag. Elles couvrent plusieurs lieues carrées à l'approche de l'Atlas, au Mâder-Rhamra.
Habituellement le sol est élastique et commode à la marche. Partout où il n'est pas fécondé par la savante irrigation des oasis, il ne produit que quelques arbustes épineux, tronqués par la dent des chameaux, ou, çà et là, quelque jujubier sauvage dont les branches sont chargées d'innombrables chiffons, ex-voto de la misère superstitieuse.
La culture des oasis est savante, en effet ; elle veut et prouve un esprit de suite et de discipline qui fait contraste avec tout ce que l'on voit ailleurs de l'esprit économique des indigènes. - J'ai beaucoup songé à cette anomalie, j'en ai cherché l'explication dans l'histoire et dans les légendes du pays. L'histoire est incomplète, et ce qu'il y aurait de plus vrai serait peut-être un roman dont les détails seraient d'accord avec les données historiques et les données du climat.
Je me figure que les colons romains, venus en conquérants sur cette terre et qui n'ont guère été, pendant les temps que racontent leurs annales, que publicains et soldats, ont dû réapprendre le travail et les vertus civiques quand ils ont été délaissés par la mère patrie et condamnés à se défendre seuls contre les indigènes auxquels ils ne s'étaient jamais mêlés et qui reprenaient leur indépendance à la faiblesse de leurs gouvernants. L'invasion des Vandales n'est qu'un accident dans cette longue déchéance de la société africaine. Après Genséric, l'anarchie recommence et gagne peu à peu, comme une marée montante, tout ce qui environne les cités romaines. Vainement les Bélisaire et les Salomon essayent de faire renaître les villes mortes. Au milieu des ruines, la faible colonie militaire qu'ils ont envoyée a bâti un monument, temple ou forteresse, avec les pierres des tombeaux et les débris des colonnes brisées. Ainsi en est-il pour beaucoup de villes du plateau ; mais aucune, excepté Tébessa, n'a vécu au delà de ce premier jour. Le monument restauré, devenu ruine à son tour, reste seul de son âge. La société romaine ne s'est pas relevée dans le nord et s'est de plus en plus concentrée autour de Carthage. - Mais je crois qu'elle a vécu dans le sud; que les oasis ont été, sinon romaines, du moins habitées par des clients des Romains, et qu'elles ont pu se maintenir jusqu'au milieu du septième siècle. En effet, chacune d'elles est une forteresse et se suffit presque entièrement à elle-même. Il est vrai qu'elles durent être en butte à des hostilités incessantes des montagnards de l'Atlas et renoncer peu à peu au commerce et aux relations extérieures. Les cultures qu'elles étendaient hors de l'enceinte des palmiers furent ravagées, et l'insouciance des Maures permit seule à l'eau des Seguias d'aller encore alimenter les palmiers.
Mais à mesure qu'avance le septième siècle, le mal devient intolérable. Les Maures des montagnes se réunissent sous une reine que la tradition nomme Kahina. D'une autre part, les Arabes débarquent au sud de Carthage et se jettent à travers l'Afrique avec toute l'ardeur de leur prosélytisme, avec tout l'élan de cet indomptable courage qui réalisa la plus rapide, la plus vaste et la plus solide des conquêtes. Kahina les a repoussés une fois, et Sidi-Okba a laissé son nom à son dernier champ de bataille. - Mais la reine barbare redoute leur retour et veut leur opposer le désert. La ruine des vallées du sud devient systématique. Les cultures s'effacent, l'eau des fleuves se répand en torrents ou s'évapore sous le soleil. Les eaux, dit la légende arabe, s'enfoncent sous le sol, et la surface devient aride.
Les oasis comprirent que le dernier coup allait leur être porté; les Arabes revenaient, offrant la paix à qui adopterait le Coran, la paix avec l'éclat des sciences, des lettres et de la victoire ; la paix avec les bienfaits de, la civilisation la plus avancée qu'eût alors le monde. Les chrétiens des oasis acceptèrent la religion de Mahomet et purent ainsi sauver des ravages des barbares leurs palmiers et leurs vies. Les Maures subirent un nouveau joug, mais les Arabes dominateurs du Nord furent au Midi alliés et compagnons.
Fatale alliance d'ailleurs et dégradante comme tous les protectorats! Le Romain habita l'oasis et la cultiva; l'Arabe, campant en dehors des canaux et des palmiers, se réserva l'action extérieure, le commerce et surtout la défense contre tout ennemi. Il resta guerrier, le Romain devenant surtout agriculteur. Nul maître n'a été plus tolérant et plus doux que l'Arabe; cependant, quelques siècles s'étant écoulés, il se trouva que le Romain, après avoir sacrifié sa religion et son existence politique, avait perdu sans cesse de sa valeur sociale et reculé devant son brillant compagnon. Aujourd'hui, la plupart des jardiniers des oasis tiennent leurs terres à ferme de quelque grand de la tribu voisine. Bel-Hadj, par exemple, possédait des centaines de jardins dans les Zibans. Dans les délibérations communes, la voix de l'Arabe est prépondérante : à lui sont les plus belles maisons, les meilleurs emplacements, le gouvernement de l'oasis. Cet abaissement des travailleurs parait avoir eu lieu peu à peu, sans secousse, et par la seule force des choses. C'est une preuve de plus que tout se tient dans la vie politique et économique des peuples, les âpres et périlleux devoirs, la richesse et la grandeur. On a vu, dans ce que j'ai dit d'El-Outaïa, les caractères physiques des deux races.
Combien je voudrais retrouver dans l'histoire les traces de ces péripéties étranges et si nombreuses par lesquelles passa la société romaine ! ces colons, abandonnés par la mère patrie, renonçant d'abord à la souveraineté sur les tribus indigènes, transigeant avec elles, reculant sans cesse, survivant, en petit nombre, aux explosions de la haine et de l'avidité de leurs voisins ; passionnés, aux IV° et V° siècles, par les hérésies de Donat et d'Arius ou par la puissante voix d'Augustin, subissant les Vandales et obéissant sans trop de peine à Genséric, la plus grande figure peut-être du monde barbare ; puis délaissés encore par ces rudes tuteurs, et se retrouvant, affaiblis et isolés, en face de l'anarchie qui grandit et s'organise; réduits à se faire petits et à se renfermer dans leurs oasis, bientôt menacées elles-mêmes par un ennemi ivre de barbarie, sujets d'hier, oppresseurs aujourd'hui, marchant avec une joie féroce à la destruction du maître orgueilleux qui n'avait réclamé jamais, aux jours de sa puissance, que l'abaissement et les tributs du vaincu. Comprenez-vous ce qui du se passer dans les oasis quand on y vint conter que les sectateurs de Mahomet étaient arrivés d'Égypte jusqu'à Carthage? Songez que leur renommée devait être plus terrible que celle de ces anciens Perses qui, pendant le cours de leurs longues luttes contre l'empire, s'étaient fait un marchepied du corps d'un empereur prisonnier. Songez que depuis cinquante ans chacun des rares voyageurs qui étaient revenus aux oasis après avoir prêté l'oreille aux bruits du monde extérieur y avait rapporté les récits de ces conquêtes si rapides qu'un siècle vit commencer et s'étendre jusqu'à la Loire d'une part, jusqu'à la Chine de l'autre. Le règne d'Héraclius, si. grand contre l'ancien monde, si misérable devant ces inconnus d'hier, portés d'un seul bond à la tète des nations, semblait raconter en abrégé l'histoire du monde romain lui-même, destiné à périr sous les coups des califes après avoir dominé les autres nations. Une telle renommée ne va pas sans une immense terreur, et les Romains durent la ressentir bien plus vivement que les Maures eux-mêmes Un roman, avons-nous dit; eh! Toutes les conditions ne s'en trouveraient-elles pas réunies dans celte agonie d'un peuple qui n'a plus, à côté de ses intérêts matériels, qu'un sentiment qui vive en lui, le sentiment chrétien, et que fascine, en le terrifiant, cette bande si brillante, malgré son petit nombre, que l'enthousiasme d'une autre religion élève si haut au-dessus de tout ce qu'ont vu ces Romains, et jette à la conquête du monde ! Si nous nous représentons Biskra avec sa curie, sa garde civique perpétuellement assiégée, ses souvenirs d'orgueil vivant dans quelques coeurs, mais outragés tous les jours, depuis longues années, par ces montagnards que les Romains méprisent, pouvons-nous bien deviner quels sentiments s'agitèrent quand Okba traversa l'Afrique, foulant aux pieds de ses chevaux les vainqueurs et les vaincus des luttes quotidiennes du Sahara? C'est presque à l'ombre des palmiers de Biskra qu'Okba succomba, et, près lui, les Kabyles reviennent à la destruction universelle, non plus d'instinct, mais systématiquement
Les Romains se débattent avec désespoir contre la ruine qui se multiplie et les presse; ils en viennent à se dire que leurs ennemis tant redoutés d'hier ne pouvaient pas leur faire plus de mal qu'ils n'en éprouvent aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs la pitié d'une femme ou d'un prêtre a recueilli quelque soldat de Mahomet, et l'on s'étonne de sa tolérance et de ses lumières : vienne le moment, le musulman délivré accompagnera, au camp des vengeurs d'Okba, un Romain envoyé par les têtes politiques de la curie ; là, il lui servira d'interprète pour annoncer aux musulmans surpris et charmés qu'au prix de la tolérance qu'ils ont partout accordée aux chrétiens, ils trouveront au Sahara des citadelles et des alliés. Alors le torrent reprendra son cours désormais irrésistible. Kahina et ses hordes s'effaceront devant lui. Le Maure connaîtra des maîtres comme au temps de Carthage et comme au temps de Rome, et subira leur religion sans la comprendre et sans l'aimer. Quelques Romains, peut-être, fuiront en Italie le triomphe du Croissant; quelques autres se donneront, corps et âme, au vainqueur, partageront sa gloire et oublieront leurs autels; le reste, chaque jour plus attaché à la glèbe, remerciant les vainqueurs qui le dispensent de gloire et de politique, s'effacera peu à peu dans le rôle utile et obscur des travailleurs prolétaires d'une grande nation.
HENRI FABRE.
FIN
| |
| BIEN DIT !
Envoyé Par Rémy
| |
Un présumé étudiant dans un autobus plein à craquer prit le temps d’expliquer à un monsieur âgé assis à ses côtés pourquoi la vieille génération ne peut pas comprendre celle des jeunes.
« -Vous êtes nés et avez grandi dans un monde différent, presque primitif » dit-il d’une voix assez forte pour être entendue par tous. « Les jeunes d’aujourd’hui nous avons grandi avec internet, la télévision, les avions, les jets, les voyages dans l’espace, l’homme marchant sur la lune. Nos sondes spatiales ont visité Mars. Nous avons des bateaux à énergie nucléaire et des voitures électriques et à hydrogène, des ordinateurs qui calculent quasiment à la vitesse de la lumière. Et encore plus. »
Après un bref silence, l’homme âgé lui répondit :
« Tu as raison jeune homme, nous n’avions pas toutes ces choses quand nous étions jeunes … par conséquent nous les avons inventées ! . . . Et maintenant jeune petit con arrogant, dis-moi ce que TOI tu prépares pour la génération suivante. »
Les applaudissements furent logiquement tonitruants.
|
|
|
LES ANNALES ALGERIENNES
De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)
Envoyé par Robert
|
|
LIVRE PREMIER.
Historique et politique sur la régence d'Alger.
Cause de la guerre de la France contre Alger - Blocus -
Préparatifs de l'expédition - Départ de l'armée d'expédition.
Aperçu géographique,
La partie de la Barbarie qui formait l'ancienne régence d'Alger occupe, au nord de l'Afrique, une longueur de côte d'environ deux cents lieues, depuis les frontières du Maroc jusqu'à celles de Tunis. La largeur du nord au midi en est assez indéterminée ; les géographes la poussent jusqu'au grand désert, quoique toute cette étendue de pays ne reconnût pas la domination des deys d'Alger. Cette contrée est sillonnée longitudinalement de l'ouest à l'est par deux chaînes de montagnes bordant, au nord et au sud, une série de plateaux élevés qui en forme la zone centrale. Ces chaînes se détachent du mythologique Atlas, que l'inhospitalière terre du Maroc, où il est situé, soustrait aux études européennes. Nos géographes paraissent avoir voulu se consoler de la pénurie de données positives sur ce mont mystérieux, en décorant de son nota ses deux ramifications algériennes ; ils ont appelé petit Atlas celle du nord, et grand Atlas celle du sud : dénominations défectueuses, car c'est précisément ce qu'ils appellent le petit Atlas qui présente les pentes les plus abruptes et les sommets les plus élevés.
Quelques chaînons transversaux vont çà et là d'une chaîne à l'autre, en coupant les plateaux du centre qu'ils partagent en diverses régions, tantôt ridées par des ondulations de terrain, tantôt planes et en partie couvertes par de vastes amas d'eau salée, connus sous le nom de sebkas, et qui ne méritent celui de lac que dans la saison des pluies; car, aux autres époques de l'année, l'eau s'évaporant ne laisse sur le sol qu'une nappe de sel cristallisé. Ces sebkas sont les récipients des torrents qui n'ont pu s'ouvrir une issue à travers les chaînes, soit que leur peu de puissance ne leur ait pas permis de s'y creuser des vallées d'érosion, soit que les combinaisons du soulèvement des masses rocheuses aient opposé à leurs efforts d'invincibles obstacles.
Les plaines qui se déroulent aux pieds de la chaîne septentrionale, vers les points où elle est le moins éloignée du littoral, sont généralement séparées de la mer par des collines terreuses dont les pentes fécondes couronnent le rivage d'un feston de verdure et réjouissent les regards du navigateur. Ces collines forment ce que l'on appelle généralement le sahel (rivage), en le subdivisant par localités, comme le sahel d'Alger, le sahel de Cherchell, le sahel de Bône, etc. Le pays qui vient après, jusqu'à la chaîne méridionale, est assez souvent désigné, dans l'ouest surtout, sous la dénomination générique de Tell. Quelques personnes ont cru voir dans ce mot un dérivé du mot latin tellus, comme si l'on avait voulu indiquer par là la terre par excellence, la terre à céréales, par opposition au Sahara qui n'en produit point ; mais c'est une erreur: cette expression est purement arabe, et signifie haut pays, pays élevé.
Le Sahara, que nous venons de nommer, s'étend au-delà de la chaîne méridionale. C'est une vaste zone de plaines sablonneuses, du sein desquelles s'élèvent de loin en loin, comme des îles, de belles oasis de palmiers. Au delà règnent le désert et ses mystères.
L'Algérie est arrosée par beaucoup de petits cours d'eau, mais il n'y a pas de rivières considérables, la constitution géologique du pays ne le comportant point. Le climat est assez généralement sain et tempéré ; le sol est presque partout fertile et se prêté à une grande variété de culture; il est, sur plusieurs points, d'une admirable beauté. Cette féconde contrée produit ou est susceptible de produire tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins matériels et sociaux de l'homme. Il n'est pas de pays peut-être qui eût moins à demander à ses voisins s'il était bien exploité par les peuples qui l'habitent.
Ces peuples appartiennent à des races diverses d'origine et de langage. La plus répandue est la race arabe qui, dans le 7e siècle de notre ère, fit la conquête de ce beau pays sur les faibles empereurs d'Orient. Elle occupe les plaines, et plus les lieux qu'elle habite sont éloignés de la mer, plus elle conserve avec pureté son type originel. Les Arabes que l'on rencontre entre la mer et la première chaîne ont des demeures fixes, ou pour le moins un territoire déterminé. Ceux des plaines sont plus enclins à la vie nomade, qui est l'existence ordinaire des Arabes du sud. Ces derniers, libres et fiers, n'ont jamais complètement courbé la tête sous le joug étranger ; ils ont été quelquefois les alliés, mais jamais véritablement les sujets des Turcs. Les autres, au contraire, étaient soumis au gouvernement du dey d'Alger, et reconnaissaient l'autorité de caïds turcs qui leur étaient imposés. Mais il ne faut pas croire cependant que le despotisme oriental pesât sur eux de tout son poids ; les Turcs avaient de grands ménagements pour ces peuples. Il est vrai que de temps à autres, lorsque le Gouvernement avait trop à se plaindre d'une tribu, une expédition de guerre était dirigée contre elle, et que le châtiment était alors prompt et terrible ; mais, dans les rapports ordinaires et journaliers, le joug se faisait peu sentir. Cependant les peuplades les plus rapprochées des villes, qui étaient naturellement les centres d'action des Turcs, avaient bien quelques avanies à supporter.
Après les Arabes, viennent les Kbaïles que l'on regarde, en général, comme les descendants des anciens Numides. Pour moi, je ne pense pas qu'on doive leur donner cette seule origine. Je suis disposé à les considérer comme le résidu et le mélange de toutes les races qui ont successivement résisté aux invasions punique, romaine, vandale, grecque et arabe. Leur organisation physique se prête à cette supposition, car ils n'ont pas de type bien déterminé; les traits caractéristiques des races du midi s'y trouvent à côté de ceux des races du nord. Il existe même une tribu kbaïle qui, par tradition, a conservé le souvenir d'une origine européenne.
Le nom de Berbères, que dans plusieurs ouvrages ont donné aux Kbailes, n'est point connu dans la régence d'Alger. Il n'est employé que dans la partie de la Barbarie qui touche à l'Egypte.
Les Khaïles habitent les montagnes, où ils jouissent de la plus grande somme de liberté qu'il soit donné à l'homme de posséder. Ils sont laborieux et adroits, braves et indomptables, mais point envahissants. Ce que je dis ici des Kbaïles s'applique plus particulièrement à ceux de Bougie, où les montagnes, plus rapprochées et plus épaisses, ont offert un asile plus sûr aux restes des anciennes populations. C'est là qu'ils forment véritablement une nation que ni les Arabes ni les Turcs n'ont pu entamer. Ailleurs ils ne présentent que des agglomérations d'individus, tantôt soumis tantôt rebelles à la race dominante.
On donne en général la dénomination de Maures aux habitants des villes. Les Maures ont été les premiers habitants connus de la partie occidentale de la Barbarie. Quelques auteurs croient que leur origine, qui se perd du reste dans la nuit des temps, remonte aux Arabes. On sait que, dans les siècles les plus reculés, ceux-ci envahirent l'Égypte, et l'occupèrent en maîtres fort longtemps. Il est possible que de là de nombreux émigrants de cette nation soient venus s'établir dans cette contrée que les Romains ont appelée Mauritanie. Cette supposition est même donnée comme un fait par plusieurs écrivains de l'Orient. Lorsque les Arabes de la génération du grand Mohammed vinrent, deux ou trois mille ans après, conquérir ce même pays, ils s'établirent peu dans les villes, d'où leurs moeurs les éloignaient ; les Maures, au contraire, ainsi que les Gréco-romains qui n'émigrèrent pas, s'y concentrèrent, par cela même qu'ils ne devaient pas y trouver les Arabes; et de là, sans doute, l'habitude de donner le nom de Maures à tous les habitants des villes, quoiqu'à la longue bien des familles arabes se soient mêlées à eux. Malgré ces fusions partielles, les purs Arabes regardent encore avec dédain les Maures habitants des villes, et les mettent dans leur estime très peu au-dessus des Juifs.
Ces derniers sont très répandus dans l'Algérie, mais dans les villes seulement. Leur existence est là ce qu'elle est partout.
Les Turcs s'établirent à Alger dans le seizième siècle ; voici à quelle occasion: lorsque le vaste empire des Califes commença à se désorganiser, l'Espagne et l'Afrique s'en séparèrent successivement. Dans cette dernière contrée, la domination arabe se fractionnant encore, deux nouveaux empires se formèrent l'un à Fez et l'autre en Égypte, laissant entre eux un vaste espace où surgirent de petits États indépendants. Alger forma un de ces petits États, où il parait que quelques princes sages firent fleurir l'industrie et l'agriculture, en ouvrant un asile aux Musulmans que les conquêtes des Chrétiens chassaient d'Espagne. Mais après l'entière destruction de la puissance arabe en Espagne, les Espagnols poursuivirent jusqu'en Afrique les restes de leurs anciens conquérants. Ils s'emparèrent d'Oran, de Bougie et d'autres places, et vinrent s'établir sur un rocher situé en mer en face d'Alger. L'émir de cette ville, fatigué de cet importun voisinage, appela à son secours le fameux renégat Haroudj Barberousse. Mais un allié trop puissant est souvent pire qu'un ennemi déclaré; l'émir mourut assassiné, et Barberousse s'empara du pouvoir. Après sa mort, son frère Khair-Eddine fut nommé pacha d'Alger par la Porte Ottomane, et ce pays fit dès lors partie du vaste empire des Turcs ; mais Khair-Eddine, quoique satrape du Sultan de Constantinople, fut de fait le fondateur d'un État qui ne tarda pas à devenir indépendant.
Cet État était une république militaire, dont le chef était électif, et dont les membres devaient être Turcs. Les indigènes étaient sujets ou alliés, selon le plus où le moins d'action que les Turcs avaient sur eux; mais ils ne pouvaient exercer aucune fonction politique en dehors de la race à laquelle ils appartenaient. Les fils de Turcs ou Koulouglis étaient considérés, à cet égard, comme indigènes, et ne pouvaient, en conséquence, prétendre à aucun emploi gouvernemental. La république, qui n'était qu'un corps de troupe, se perpétuait par le recrutement qui se faisait à Constantinople, et surtout à Smyrne. Tout individu turc transporté de cette manière à Alger devenait membre de l'État, et pouvait parvenir à la position la plus élevée.
La milice turque était divisée en compagnies ou odas commandées par des officiers supérieurs appelés boulcabachys, ayant sous leurs ordres un certain nombre d'officiers subalternes. Les règles de l'avancement étaient établies de manière à assurer les droits de l'ancienneté, sans nuire à ceux du mérite. Les membres de la milice recevaient par jour deux livres de pain, et une modique solde qui variait selon l'ancienneté, mais dont le maximum ne dépassait pas 30 cent. par jour. C'étaient là de faibles moyens d'existence; mais comme ils pouvaient disposer de leur temps et de leurs actions, lorsqu'ils n'étaient pas de service, il leur était facile de s'en créer d'autres en se livrant à divers genres d'industrie. Les jeunes Turcs étaient casernés et soumis à une discipline très sévère. Ils ne sortaient que le jeudi, sous la surveillance d'un officier; mais après cette sorte de noviciat, rien n'était moins assujettissant que les règlements de la milice turque. Un membre de cette milice pouvait vivre tranquillement au sein de sa famille, se livrer au commerce, ou occuper quelque emploi civil, sans que les exigences de la discipline s'y opposassent. On ne lui demandait autre chose que d'être toujours prêt à marcher lorsqu'il en recevait l'ordre.
L'administration avait beaucoup de condescendance pour les soldats mariés: on les laissait, autant que possible, dans les mêmes garnisons, s'ils le désiraient, et l'on cherchait en tout à améliorer leur position. Beaucoup de Turcs faisaient des fortunes considérables, soit dans les emplois publics, soit par leur industrie, soit par des mariages avec de riches héritières indigènes.
L'obligation du service cessait à l'âge de cinquante ans.
Les Koulouglis étaient admis dans la milice, mais ils ne pouvaient parvenir aux grades élevés. Ils furent traités sur le même pied que les Turcs, jusqu'en 1650. A cette époque une conspiration qu'ils firent pour expulser les Turcs du pays, et qui fut découverte, les fit exclure eux-mêmes de tous les emplois de quelque importance. Ils furent dès lors soumis à une surveillance qui pesait assez durement sur eux; cependant quelques Koulouglis sont parvenus, par exception, aux plus grands emplois : le dernier bey de Constantine était Koulougli.
Le dey et les beys avaient auprès d'eux des soldats tous Turcs qui formaient leur garde. C'était ce qu'on appelait les janissaires. Ils jouissaient de plusieurs avantages et d'une très grande considération.
Les forces militaires du Gouvernement algérien ne se bornaient pas à la milice turque : il existait dans les tribus arabes qui lui étaient soumises un certain nombre de cavaliers toujours à sa disposition. Il avait aussi établi sur plusieurs points des espèces de colonies militaires, composées d'aventuriers de toutes les races, dont il tirait un bon service. Nous entrerons plus loin dans des détails assez curieux à ce sujet.
Telle était l'organisation militaire des Turcs. Voici maintenant leur constitution politique.
La haute direction gouvernementale et le pouvoir législatif appartenaient à un conseil supérieur ou Divan, composé de soixante boulcabachys et des grands fonctionnaires. Ce divan nommait et déposait les deys. La déposition d'un dey était presque toujours suivie de sa mise à mort. La nomination d'un nouveau dey était annoncée par une ambassade à la Porte Ottomane, qui ne manquait jamais de la confirmer, en envoyant à l'élu du divan un firman et un kaftan d'honneur. Dans ces occasions, l'État algérien faisait quelques présents au Sultan, qui les rendait ordinairement en armes et en munitions de guerre. Le titre officiel du dey était celui de pacha; le mot dey était à peine connu à Alger, dans ces derniers temps.
Le dey ou pacha avait le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude ; il l'exerçait au moyen de ses ministres qui étaient:
Le Khasnadji ou ministre des finances et de l'intérieur;
Khair-Eddine ou ministre de la guerre;
Le Khodja-et-Tiril ou ministre des domaines nationaux;
L'Oukil-eI-Hardj ou ministre de la marine et des affaires étrangères ;
Le Makatadji ou chef des secrétaires;
Le Beit-el-Maldji ou procureur aux successions;
Le Cheikh-el-Islam ou Muphti-el-Hanephi, ministre du culte et de la justice.
Le lecteur comprendra facilement qu'en assimilant ces fonctionnaires à ceux qui, parmi nous, sont à la tète des grandes divisions administratives, je n'ai en vue que de lui donner une idée approximative de leurs attributions, et non d'en indiquer les limites d'une manière positive et absolue. Ainsi il ne faudrait pas croire que le kbasnadji, par exemple, fût exactement ce qu'est chez nous le ministre des finances ; la comptabilité générale de l'Etat n'était pas entre ses mains: elle appartenait au makatadji.
L'administration de la justice criminelle n'appartenait qu'au dey, qui l'exerçait ou par lui-même ou par ses ministres; les peines étaient la mort, la mutilation, les travaux publics, la bastonnade et l'amende.
La justice civile était administrée dans chaque grand centre d'administration par deux cadis, l'un dit el-Hanephi pour les Turcs, et l'autre dit el-Haleki pour les indigènes. Les hanephis et les malekis forment deux sectes musulmanes qui diffèrent sur quelques pratiques assez insignifiantes du culte, et sur quelques points de jurisprudence. Du reste, elles vivent en bonne intelligence, et sont loin de s'anathématiser l'une l'autre, comme le font les catholiques et les protestants. Les Turcs sont de la secte des hanephis; les naturels de l'Afrique sont au contraire malekis. Au-dessus des cadis existaient deux muphtis, l'un hanephi et l'autre maleki. Le premier, qui, comme nous l'avons dit, portait le titre de Cheikh-el-Islam (chef de l'islamisme), était un fort grand personnage; il recevait les appels des jugements rendus par les cadis, dans une Cour appelée le Midjelés qu'il présidait, et qui se composait des deux muphtis, et des deux cadis. Une affaire civile pouvait être portée par les parties, soit à Tunis, soit à Fez, où se trouvent les plus célèbres légistes de l'Afrique.
Le beit-el-maldji, ou procureur aux successions, était chargé de l'ouverture des testaments et de tous les litiges que pouvait en entraîner l'exécution. Il était le représentant né de tous les héritiers absents. Il devait faire rentrer au domaine, après les prélèvements faits pour les pauvres et pour quelques autres dépenses spéciales, les successions vacantes, et la partie des biens qui revenaient à l'Etat dans toutes celles où il n'y avait pas d'héritier mâle direct, partie qui était quelquefois fort considérable. Il était aussi chargé de la police des inhumations. Il avait sous lui un cadi et plusieurs agents.
C'était au moyen de ces divers fonctionnaires que le dey dirigeait les rouages de son gouvernement; mais comme son action ne pouvait s'étendre directement sur les points éloignés, il avait établi dans les provinces des gouverneurs qui, sous le titre de Beys, y exerçaient la souveraineté en son nom. Ces gouverneurs étaient obligés de venir tous les trois ans à Alger rendre compte de leur administration. Les beyliks ou provinces étaient au nombre de trois, Constantine à l'est, Oran à l'ouest, et Titteri au midi. Nous en parlerons successivement, à mesure que notre narration nous y conduira. L'arrondissement d'Alger était directement administré par le dey et ses ministres.
Tel était le gouvernement turc d'Alger dans sa pureté constitutionnelle; mais les formes en furent plus d'une fois altérées par la licence de la milice. L'élection du Dey, au lieu d'être le résultat paisible d'une délibération du divan, n'était le plus souvent que le produit d'une émeute soldatesque. Ce conseil lui-même n'existait plus que de nom, lorsque nous nous emparâmes d'Alger. Hussein pacha, qui ne l'a pas appelé une seule fois dans toute la durée de son règne, ne lui avait laissé que des attributions tout à fait insignifiantes; de sorte que les principes fondamentaux de ce gouvernement étaient en pleine dissolution, lorsque la domination turque s'écroula sous les coups des Français.
La facilité avec laquelle elle s'établit dans le nord de l'Afrique n'a rien qui doive étonner, si l'on se reporte à l'époque où elle prit naissance; c'était dans un temps où les malheurs des Maures d'Espagne avaient porté à son comble la haine du nom chrétien. Les Turcs se présentèrent comme les vengeurs de l'Islamisme, ce qui, joint à la gloire dont brillait alors l'empire des Osmanlis, dû les faire accueillir plutôt comme des protecteurs que comme des maîtres incommodes. Leurs premiers succès contre les Chrétiens, le système de piraterie qu'ils organisèrent avec autant d'audace que de bonheur, justifièrent la bonne opinion que les indigènes avaient conçue d'eux, et leur domination s'établit sur la double base de la reconnaissance et de l'estime. La dignité de leurs manières, la régularité de leur conduite, imprimèrent à tous les esprits un sentiment si profond de leur supériorité, que chacun les considérait comme nés pour commander. Aussi, avec sept ou huit mille hommes répandus sur plusieurs points, contenaient-ils dans le devoir de vastes contrées. Lorsque, dans un des livres suivants, nous étudierons leur politique envers les Arabes, nous verrons qu'elle était très habile pour le maintien de leur autorité, mais déplorable pour la prospérité du pays qu'elle tendait sans cesse à étouffer. Il en sera toujours de même de celle d'un peuple conquérant qui ne cherchera pas à se mêler complètement au peuple conquis. Nous avons vu qu'à Alger, cet esprit d'isolement, qui est dans le caractère des Turcs, était poussé si loin, qu'ils regardaient leurs propres enfants tomme étrangers, parce qu'ils naissaient de mères indigènes. Au reste, ils avaient su ménager à toutes les ambitions un peu actives un débouché qui, tout en les éloignant des hautes fonctions politiques, pouvait, jusqu'à un certain point, les satisfaire, car il était en même temps le chemin de la fortune; je veux parler de ces bâtiments armés en course, qui furent pendant si longtemps la terreur de la Chrétienté, et au commandement desquels chacun pouvait prétendre selon sa valeur, son habileté, et la confiance qu'il inspirait aux armateurs. La marine offrait à tous les indigènes, sans exception, des chances d'avancement que leur refusait la milice. Raïs-Hamida, qui commandait la flotte algérienne en 1815, était kbaïle.
Quoique les corsaires algériens fussent en général peu scrupuleux, les instructions qu'ils recevaient de leur Gouvernement étaient ordinairement basées sur les principes du droit des gens. Ils ne pouvaient capturer légalement que les bâtiments des nations avec lesquelles la Régence était en guerre. Il est vrai qu'il ne fallait que de bien faibles prétextes pour que le dey d'Alger se déclarât en état de guerre contre les puissances chrétiennes. Il est même arrivé plus d'une fois que, sans en chercher, il commençait les hostilités en avouant qu'il n'avait d'autre motif d'en agir ainsi que le besoin de faire des prises. C'est ainsi que la Régence était parvenue à rendre tributaires plusieurs puissances maritimes, qui, pour se soustraire à ses déprédations, lui payaient des subsides annuels; ce qui n'empêchait pas qu'au moindre sujet de mécontentement, soit réel, soit imaginaire, la guerre ne leur fût déclarée par les Algériens. En principe, le Gouvernement d'Alger regardait la guerre avec les Chrétiens comme son état normal. Il se croyait le droit de les réduire en servitude partout où il les trouvait, et il fallait, pour qu'il s'abstint d'en user, qu'un traité positif lui fit un devoir de respecter ceux de telle ou telle nation. Ainsi, aussitôt après que l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique eut été reconnue, les Algériens attaquèrent leur pavillon, parce qu'aucun traité ne les liait encore à cette nouvelle puissance. Les Américains, tout froissés de la longue et sanglante lutte qu'ils venaient de soutenir contre l'Angleterre, furent obligés d'acheter la paix à prix d'argent ; ils s'engagèrent à payer à la Régence un tribut annuel de 24,000 dollars, et ne s'en affranchirent qu'en 1815.
Les deys d'Alger reçurent, plusieurs fois, d'assez vigoureuses corrections des grandes puissances. Louis XIV, comme tout le monde le sait, fit bombarder trois fois leur capitale, ce qui, joint à l'influence que nous exercions depuis longtemps en Barbarie par nos établissements de La Galle, nous mit dans une fort bonne position à l'égard de la régence d'Alger. En 1815, les Américains envoyèrent contre elle une flotte, qui, chemin faisant, captura plusieurs bâtiments algériens, et qui, s'étant présentée devant Alger dans un moment où rien n'était disposé pour repousser une attaque, arracha au dey Omar pacha, qui régnait alors, un traité avantageux. Enfin, en 1816, une flotte anglaise commandée par lord Exmouth, après un bombardement de neuf heures, força le même Omar pacha à souscrire à la délivrance de tous les esclaves chrétiens qui étaient dans ses États, et à renoncer pour l'avenir au droit abusif de mettre en vente les prisonniers européens. On a dit qu'il aurait été facile à la France et à l'Angleterre de détruire de fond en comble la puissance algérienne; mais qu'elles se bornèrent, dans les deux circonstances que nous venons de citer, à assurer la suprématie de leurs pavillons, voulant d'ailleurs laisser subsister la piraterie algérienne comme un obstacle à la prospérité commerciale des petits États. Je ne sais si ce reproche a jamais été fondé; dans tous les cas, depuis 1830, la France a cessé de le mériter.
A SUIVRE
|
|
BULLETIN N°13
DE L'ACADÉMIE D'HIPPONE
SOCIÉTÉ DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ET D'ACCLIMATATION
|
NOTE SUR LA BELIMA
Par M PAPIER, vice-président de l'Académie d'Hippone.
MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,
Des renseignements que M. le Dr Reboud bien voulu communiquer à l'Académie d'Hippone par une note adressée à M. le président, et qu'après lecture de celle-ci vous vous êtes empressés de faire insérer au procès-verbal de notre séance du 13 août dernier (1876), j'ai tiré les conclusions suivantes que je vous prie de vouloir bien me permettre de vous exposer aujourd'hui.
1° Pour les auteurs de médecine arabe des dixième, treizième, seizième et dix-huitième siècles, les noms de moumia, de belima et koufr el-Iahoudi étaient, à tort, synonymes. Tous ces auteurs ne me paraissent pas, en effet, avoir été très soucieux de la véritable synonymie des mots. Ils appliquaient souvent le même mot à des substances minérales d'espèces différentes. C'est ainsi qu'ils avaient deux moumia très distinctes l'une de l'autre. La première correspondait au malthe ou pissasphalte de Dioscoride. " C'est un liquide noir comme de la poix, qui découle d'une caverne dans des environs d'Astakhar, en Perse, " dit le cheikh Daôud el-Antaki.
La seconde se rapportait â la momie des tombeaux. " Cette dernière, dit Ebn-Beithar, est une préparation que les Grecs mélangeaient autrefois avec leurs morts pour les conserver et les empêcher de s'altérer. " Elle provenait, suivant le cheikh Daôud, du goudron, de I'aloès, préparés avec du miel et du vinaigre.
Pourquoi n'y aurait-il pas alors deux sortes aussi de belima, l'une à odeur fétide et correspondant au malthe ou pissasphalte du célèbre pharmacograghe grec, et l'autre à la préparation très odorante que j'ai rapprochée par ses caractères physiques de la variété d'ambre gris la plus noire, non sans soulever, il est vrai, de la part de quelques-uns d'entre vous, Messieurs, de très vives objections? Quoique ces auteurs ne disent rien de cette dernière, elle n'est pas moins très connue, en effet, et très recherchée sous le nom de belima. Du reste, n'ont-ils pas aussi deux sortes de sassor'int au séso'ina, I'une qui est la plante elle même, et qui le cheikh Daôud appelle bakhour el berber, l'autre qui est une préparation â laquelle Ebn-Batouta conne le nom de bakhour es-soudan, et qui se vend encore de nos jours sous forme de tablettes noires comme étant un parfum très usité par les nègres du Soudan ?
2° Daôud l'Algérien confond tous les bitumes sous les noms de koufr el-Iahoudi ou de belima, quoiqu'il y ait entre tous ces produits naturels des caractères physiques toujours assez tranchés pour pouvoir les distinguer nettement les uns des autres. C'est ainsi que le malthe ou pissasphalte est constamment mou et glutineux, tandis que I'asphalte ou bitume de Judée devient solide et ressemble extérieurement beaucoup plus à de la houille qu'à de la poix. C'est donc la première espèce que doit se rapporter exclusivement la belima, et non la dernière, qui est, en effet, très peu propre à la mastication.
3° II est très étonnant qu'une substance aussi commune que le malthe ou goudron, minéral ne se soit pas trouvée sans cesse entre les mains des marchands mozabites ou juifs de Bône, si, comme on le prétend, les indigènes en étaient si friands. II est vrai que plusieurs d'entre vous, Messieurs, m'ont fait observer à ce propos que l'administration française avait interdit, depuis un certain temps déjà, aux droguistes indigènes, de vendre certaines substances pharmaceutiques parmi lesquelles pouvait fort bien s'être trouvée la belima ; mais je doute qu'il en ait été ainsi, car cette substance n'a absolument rien par elle-même ce qui caractérise les matières toxiques proprement dites, telle que la noix vomique, la poudre de cantharides, les onguents mercuriels, les pommades arsenicales, etc., dont la vente a été, en effet et avec juste raison, interdite aux droguistes indigènes depuis une quarantaine d'années. Bône n'a été définitivement occupé qu'en juin 1832 par le général d'Uzer.
4° II est non moins étonnant que, n'étant rien de plus que du malthe ou goudron minéral, les marins, pécheurs, ingénieurs des mines, industriels, etc., etc., interrogés par M. le Dr Reboud, n'aient su lui dire; même à première vue, ce que c'était que la substance qu'il leur montrait.
5° Rien ne prouve que la petite masse bitumineuse vendue par un Mozabite de Bône à M. le. Dr Reboud pour de la belima ait été trouvée près du Fort Génois.
6° Lors même qu'elle aurait été recueillie en cet endroit, rien ne nous dit qu'elle était naturelle. A cette station, quoique je ne prétende pas néanmoins contester la possibilité de rencontrer du bitume liquide ou solide au Cap de Garde.
Je n'ignore pas, en effet, qu'on observe des bitumes, en plus ou moins grande quantité, à tous les degrés de l'échelle géologique, dans les terrains les plus anciens comme dans les plus modernes, dans ceux d'origine volcanique comme dans ceux d'origine sédimentaire ; mais je ne pense pas qu'on en ait rencontré jusqu'à aujourd'hui dans la grande formation cristallophyllienne à laquelle se rattache le massif de l'Edough, avec le Gap de Garde pour éperon. L'existence du bitume dans les gneiss et les micaschistes de ce massif montagneux serait une exception à la règle générale, une exception digne de remarque, à. mon avis.
7° Les carapaces siliceuses de diatomées observées par M. Brun dans les fragments de belima qu'il a recueillis dans le voisinage du Fort Génois ne démontrent pas non plus d'une manière irréfutable que cette substance est une production naturelle de la mer. Toute matière molle et visqueuse, comme le malthe ou goudron minéral, peut, en effet, se pénétrer à la longue de ces carapaces siliceuses en tombant à la mer et en flottant sans cesse à la surface des roches qu'elle baigne de ses eaux, et que recouvrent presque toujours, dans ce dernier cas, des myriades de ces petites plantes cuirassés dont la vie est, soit dit en passant, aussi animale que végétale.
8° Enfin, les copeaux, feuilles de chêne-vert et menus flocons de laine fixés aux parties inférieures et supérieures de ]a petite masse de bitume vendue à M. le Dr Reboud comme provenant du Fort Génois, prouveraient plutôt qu'elle a été apportée et abandonnée là, sur la plage, par quelque petit bateau pécheur en réparation, ou tombée à la mer d'un bateau quelconque sortant du port de Bône, puisqu'on se sert dans la marine aussi bien, on le sait, du goudron minéral que du goudron végétal pour enduire les cordages et tous les agrès des navires.
M. le Dr Reboud avait donc raison, en principe, de la regarder comme une épave et de la signaler comme telle à son ami M. le Dr Leclerc, si par épave il entendait du moins parier, comme tout le monde, d'un objet naufragé que la mer a rejeté sur ses bords.
Or, si erronées que soient mes conclusions, je n'en sollicite pas moins leur insertion au bulletin de l'Académie ; elles peuvent, en tombant sous leurs yeux, amener les savants naturalistes à qui des fragments de belima ont été remis dans le temps par M. le Dr Reboud, à nous communiquer bientôt le résultat de leurs études sur cette substance.
==============
NOTE
SUR LA SUBSTANCE APPELÉE BELIMA
PAR LES INDIGENES DE BÔNE
Par M. MALTERRE, ingénieur civile membre titulaire
C'est dans la séance du 14 juin 1876 que fut agitée pour la Première fois, au sein de l'Académie d Hippone, la question de l'existence, de l'origine et de la nature de la substance indigène appelée belima. Absent de cette séance, nous regrettâmes, lorsque le compte rendu nous en fut parvenu, de n'avoir pu y assister, et d'avoir ainsi perdu l'occasion de faire remarquer à l'Académie combien de faits certainement risqués pouvait renfermer la Note, probablement un peu hâtive, qui y fut lue par M. Papier à l'occasion de la belima. Nos regrets ne manquèrent pas de se produire peu de jours après, lors de la réunion du 16 juillet, ainsi que le relate le procès-verbal de la séance ; mais ils ne pouvaient qu'être impuissants â combattre l'effet déjà produit par l'insertion acquise sous réserve la Note précitée, et nous les produisîmes bien plus en vue de prendre vis-à-vis de l'Académie l'engagement d'étudier à notre tour la question. Nous l'avons fait, en laissant tout fait de côté le point de vue exclusivement spéculatif auquel il a plu M. Papier de se placer ; nous sommes entrés dans le domaine des faits, et nous venons avec confiance faire connaître à la Société le résultat de nos modestes recherches.
Nous ne donnerons point notre travail comme complet, et nous nous garderons de prétendre que l'origine et la nature de la belima soient par nous définitivement fixées. Au contraire, nous n'établirons que les présomptions, irrésistibles, la vérité, auxquelles nous avons été conduit, laissant à. d'autres plus autorisés que nous le soin de faire le dernier pas et conclure. Nous serions heureux que le dernier mot fût dit par notre honorable vice-président, M. Papier, qui, en proclamant la vérité, aurait du même coup le bien doux avantage de détruire la préjudiciable illusion qu'il a propagée.
Nous avons cherché pendant longtemps, et sans succès, la belima chez les Arabes de Bône. Des indigènes actifs et intelligents ont fouillé tous les magasins où se débitait jadis cette substance, ont visité plusieurs maisons mauresques de la ville, sans en rapporter autre chose que la certitude de l'existence de la substance et de son usage à une époque éloignée d'à peine dix années du temps actuel. Cette certitude nous était déjà acquise par les indigènes qui nous assistaient dans nos recherches, lesquels connaissaient parfaitement la belima pour en avoir autrefois eux-mêmes fait usage.
Cependant nous fûmes un jour mis en possession de prétendus fragments de belima apportés par un Arabe. Au premier examen nous reconnûmes que ces fragments n'étaient autre chose que du bitume de Judée, et ignorant à cette époque les indications du Kachef-er-Roumouz, nous éprouvâmes, en dépit des affirmations et des serments réitérés de l'Arabe, des doutes sur l'identité de sa substance.
Fort heureusement, le souvenir si net et si vivace qu'avaient de la belima les indigènes par nous visités antérieurement, nous permettait de lever facilement tous nos doutes. Nous nous empressâmes de soumettre la substance en question à l'examen de toutes ces personnes et d'en recueillir aussitôt le témoignage. L'avis fut unanime, toutes affirmèrent que ce qui leur était présenté était la belima; quelques-unes observant toutefois que, d'ordinaire plus molle, celle qui leur était présentement soumise devait être fort ancienne pour avoir perdu sa plasticité, mais qu'il était facile de la lui rendre en l'humectant avec de l'huile. Une partie de nos échantillons resta entre les mains d'indigènes qu'une sorte d'avidité toute particulière pour cette substance poussait à en distraire de nombreuses parcelles. Nous ajouterons que nous avons recueilli un nombre considérable de témoignages dont I'expression, nous le répétons, a été unanime.
Plus récemment, nous avons encore reçu source indigène un autre échantillon de belima; mais, cette fois, l'échantillon avait été recueilli tout récemment, et expressément pour nous, dans le voisinage du Fort Génois. Nous avons tenu à vérifier par nous même la provenance, et nous avons acquis la certitude que la substance que nous avions reçue, quoique fort difficile à rencontrer par raison de rareté, existait effectivement dans les environs du lieu signalé. On la rencontre en masses peu importantes, extrêmement minces, agglutinées aux galets qui bordent le pied des falaises. Elle doit certainement exister aussi dans le sable des plages, mais il ne nous a pas été donné de l'y rencontrer, et il y a lieu de croire que le littoral des environs de Bône, autrefois renommé comme parages à belima, en est actuellement assez dépourvu. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on ne trouve plus de belima chez les Mozabites de Bône. Nous disons une des raisons, car la défense qui interdit à ces marchands la vente des remèdes indigènes et la défaveur certainement croissante des Arabes des villes pour leurs anciennes drogues doivent aussi puissamment contribuer à en proscrire l'usage.
Notre nouvel échantillon a été goûté par nombre d'indigènes de distinction, en dépit de l'odeur de bitume, - odeur fétide, il est vrai, mais non infecte, comme la qualifie M. Papier, - qu'il possédait. Nous ne l'avons point goûté nous-même, jugeant inutile de renouveler l'expérience : le Dr Reboud. Nous ne saurions donc en dire ni le goût, ni la valeur; mais vous pouvons affirmer que ce dernier échantillon nous a été garanti bonne qualité par tous les connaisseurs, qu'il nous importait avant tout d'établir; en sorte qu'il est prouvé que la substance désignée sous le nom de belima par les Arabes a réellement existé sur le littoral, aux environs de Bône, et qu'elle existe encore aujourd'hui.
Quelle est maintenant la nature et I'origine de cette substance ?
C'est ici que nous sortirons du champ de l'affirmation pour exposer simplement ce que nos connaissances nous autorisent à croire à ce sujet. Nous ne doutons pas, cependant, qu'une analyse minéralogique ultérieure, qui seule peut définitivement trancher la question, ne vienne sanctionner entièrement notre manière de voir ; et, tout en attendant le résultat promis à M. le Dr Reboud par M. Brun., de Genève, il nous serait particulièrement agréable de voir M. Papier, ainsi que nous l'y conviions en commençant, remettre la main aux investigations et prononcer sur le point décisif.
Pour nous, les échantillons de belima recueillis au Fort Génois nous paraissent n'être autre chose que la variété de bitume connue des minéralogistes sous les noms de malthe, bitume glutineux, pissasphalte ou poix marine, exsudée par les roches submergées et rejetée en tout ou partie hors de l'eau par l'effet incessant des vagues et des courants. Tous les caractères qui déterminent ces espèces minérales se retrouvent dans la belima, et nous ne connaissons pas d'autres substances appartenant au règne minéral auxquelles on puisse plus ou moins judicieusement les rapporter. En faisant appel à l'analyse chimique, ainsi que nous le disions plus haut, on arrivera à prononcer en dernier ressort.
Quant à l'origine minérale que nous attribuons à la belima, nous tenons à rappeler en passant que nombre de gisements rencontrent ailleurs que dans les terrains cristallins (les calcaires jurassiques, qui alimentent seuls l'industrie des dallages, sont loin de comprendre la majorité des gisements connus), et qu'il n'est presque pas de terrain volcanique qui n'en renferme. Qui n'a pas entendu parler de la célèbre fontaine poix des environs de Clermont-Ferrand?
C'est précisément l'espèce minérale de gisement que nous assimilons la belima du Fort Génois. Devons-nous maintenant identifier les deux genres d'échantillons dont nous avons parlé, et admettre, comme certains indigènes, qu'avec le temps, le malthe ou bitume glutineux perd sa viscosité et atteint le degré de dureté du bitume Judée ? Sur point nous ne nous prononcerons pas. Nombre de minéralogistes admettent, en effet, que cette modification a lieu avec le temps; d'autres et, parmi les plus autorisés, Dufrenoy, affirment le contraire, et basent sur ce fait la principale sinon l'unique distinction entre le bitume de Judée et le pissasphalte. Nous n'insisterons donc pas, n*ayant aucun élément sérieux pour faire prévaloir l'une où l'autre opinion, et la chose ne présentant au fond qu'un intérêt tout au plus secondaire.
Pour compléter ce qui précède, nous ferons remarquer que le bitume de la fontaine des noix des environs de Clermont, auquel nous rapportons la belima, occupe, par le fait de sa composition la place la plus rapprochée du pétrole de Gabian dans la série naturelle des bitumes, qui comprend tous les mélanges, en proportions diverses, d'hydrocarbures purs ou accompagnés d'hydrocarbures oxygénés. Or, chacun sait la vogue et la faveur méritée dont jouit, sous le nom d'huile de Gabian, le pétrole de cette localité employé comme vermifuge dans tout le midi de la France. Que saurait-il donc y avoir d'étonnant dans l'usage et la faveur marquée des Arabes pour leur belima, cette substance congénère, à n'en pas douter, de la célèbre huile de Gabian? Cette faveur était certainement justifiée, et nous inclinons volontiers à croire que la belima, en raison même de sa nature, devait être l'une des drogues de la médecine arabe devant le mieux réussir â l'empirisme qui les préconisait.
Nous pourrions clore ici ce travail. Cependant, en commençant, nous avons été conduit à critiquer celui produit antérieurement par M. Papier, et il est devenu pour nous un devoir de justifier la critique que nous avons portée: Nous le ferons brièvement, dans I'unique but d'aider à dégager la vérité et avec l'espoir ou tout au moins le désir de ne causer aucun mécontentement à notre antagoniste dans ce débat, l'honorable vice-président de l'Académie, dont l'amitié nous est particulièrement chère.
Dans la première partie de sa Note, M. Papier a porté immédiatement conclusion, d'après des témoignages recueillis, sur la nature la belima. Je crois pouvoir conclure, y est-il dit, que la belima n'est autre chose que de l'ambre gris, ou une espèce d'ambre gris, et on a hâte d'en expliquer la production. Cette affirmation nous a toujours choqué, parce que, à notre avis, il était dangereux prononcer en l'absence de l'objet et sans l'étude préalable indispensable pour asseoir un jugement, et qu'en outre l'affirmation donnée était contradiction manifeste avec l'un des points des témoignages invoqués pour la produire. En effet, ces témoignages portent que la belima est une substance d'un noir assez foncé et brillant, caractère qu'il est impossible de reconnaître à l'ambre gris, quelque diversité d'aspect qu'on lui connaisse. D'autre part, en voulant attribuer la formation de I'ambre belima à la décomposition du poulpe musqué, même dans les conditions inexactes de milieu spécifiées, on s'impose l'obligation d'en admettre l'existence sur n'importe quel point du littoral, tant africain que métropolitain, ce qui n'est pas soutenable. Il est établi, en effet, que quelques points seulement de la côte algérienne sont reconnus pour fournir de la belima, et ces points ne présentent d'autre particularité que celle d'être en relation intime avec des terrains renfermant des gisements bitumineux, comme Djidjelli, simplement susceptibles d'en renfermer, particularité qui est exclusivement en faveur de notre manière de voir. Il est donc tout à fait impossible de soutenir l'idée d'un rapprochement entre la belima et l'ambre gris ou toute substance similaire.
Il ne nous suffit pas d'avoir signalé cette première confusion; nous devons encore mettre I'attention publique en garde contre celle à l'aide de laquelle M. Papier a cru pouvoir formuler une nouvelle hypothèse expliquant la formation de l'ambre gris.
Établissant d'abord entre l'ambréine et la cholestérine un premier rapprochement dent il est difficile d'apercevoir les raisons et le but véritable, M. Papier arrive ensuite à présenter, à I'encontre des faits établis, l'ambréine comme ne différant de l'adipocire que par du charbon auquel il faut attribuer la coloration de ce dernier corps. De la sorte, la distance séparant l'adipocire de l'ambréine et de l'ambre gris est prévisionnellement réduite : c'est le premier bond dans l'espace à franchir. Le second, qui doit achever le rapprochement, ne saurait être plus laborieux. On fait intervenir l'artifice d'une réaction chimique complexe et inexplicable, et l'on se trouve soudain en possession du talisman qui détruit la dissemblance : l'adipocire ou gras de cadavre est devenu ambre gris !
Évidemment, une nouvelle hypothèse n'a de chances de se faire accepter qu'autant qu'elle explique mieux les faits que les autres qui l'ont précédée, et tel n'est pas le cas de celle que nous venons d'examiner. L'hypothèse de M. Papier, tendant à expliquer à nouveau l'origine de l'ambre gris, est donc certainement condamnée à représenter exclusivement l'opinion personnelle de son auteur.
Nous signalerons enfin que l'odeur de l'ambre gris a été, par erreur, attribuée à l'acide benzoïque, et, pour terminer, nous nous permettrons d'émettre une réflexion au sujet du Behim-el-bahar.
Quoique mentionnée dans les ouvrages médecine arabe, cette version est tenue, et à bon droit, pour une fable par un grand nombre d'indigènes. Cependant, M. Papier lui a fait plus d'honneur. Supputant avec tact les probabilités, que comporte la nature du fait, mis à l'actif du BEHIL EL BAHAR, il conclut à sa vraisemblance et ne désespère pas d'être bientôt fixé par les échantillons qu'on a promis de lui procurer.
N.B. Désirant ne pas élargir le cadre de la discussion, nous signalerons que pour mémoire des produits à base de résine et de cire renfermant de l'ambre et d'autres matières odorantes, qui se fabriquent à Tunis et dans tout l'Orient, et portent également le nom de belima. Ces produits sont inconnus aux Arabes de l'arrondissement de Bône. Ils ont une teinte sombre, sont beaucoup moins mous que la cire et dégagent, lorsqu'on les égrène sous les doigts, une odeur forte et pénétrante. Ils ne paraissent pas avoir d'autre usage que celui de flatter l'odorat, et, sont de composition variable et, de prix toujours élevé.
==============
RÉPONSE
AUX OBSERVATIONS CRITIQUES DE M. MALTERRE
RELATIVEMENT AUX CONJECTURES
FAITES PAR MOI SUR LA BELIMA
Par M. PAPIER, vice-président
Si grands que soient les regrets de M. Malterre de n'avoir pu faire remarquer à l'Académie combien de faits certainement risqués renfermait ma Note sur la belima et combien elle eût agi sagement en retardant I'insertion au procès-verbal de sa séance du 14 juin 1876, ils ne sauraient égaler ceux que j'éprouve en le voyant donner à cette Note beaucoup plus d'importance qu'elle n'en a réellement. S'il n'est interdit à personne de faire des conjectures sur un sujet qui s'y prête, il ne lui appartenait pas d'incriminer celles que j'ai jugé à propos de faire sur une substance qui m'avait été signalée de nature bitumineuse, il est vrai, mais d'origine animale.
Si M. Malterre a vu dans ma Note autre chose que de simples conjectures, il s'est évidemment trompé. M. Malterre ne saurait me contester que l'un de ces échantillons de belima avait une odeur si repoussante que les indigènes appelés à l'examiner en parurent très désagréablement impressionnés et le regardèrent comme n'étant très probablement pas de la belima. II avait été néanmoins recueilli au Fort Génois pour de la véritable belima, et ne différait guère, en effet, de l'autre échantillon présenté à la séance que par une odeur plus fétide et une consistance plus fluide. J'ai qualifié son odeur d'infecte, mais je ne crois pas m'être trompé en l'appelant ainsi, car c'était bien là l'odeur d'une matière corrompue.
Je n'ai jamais, que je sache, nié la présence de la belima au Fort Génois ; tout ce que je crois avoir dit, c'est qu'elle ne s'y rencontre qu'accidentellement, soit comme matière minérale, soit comme matière animale rejetée par la mer.
J'ai peut-être été trop loin en disant, d'après les témoignages recueillis autour de moi, que la belima n'était autre chose qu'une espèce d'ambre gris, ou de l'ambre gris même ; mais je ferai remarquer que je n'ai pas été aussi affirmatif que le prétend M. Malterre. Il y avait dans ma conclusion une légère nuance de doute qu'il a eu soin de détruire en en éliminant la première partie et en intervertissant les termes de la seconde.
Quant à l'existence d'une variété noire d'ambre gris, M. Malterre a tort de la nier : cette variété existe. Elle était bien connue des auteurs de médecine arabe. " Le meilleur (ambre) est le gris, dit Abd er-Rezzaq, le noir est le plus mauvais. "
Du reste, si l'ambre gris présente, en général, cette teinte grise et mate qu'on lui connaît, il ne tarde pas à en prendre une noir foncé et assez brillanté quand on le roule et le ramollit entre ses doigts. J'en ai fait I'expérience, et j'engage mon confrère en faire autant pour s'en assurer.
Malterre m'objecte que si l'on attribuait avec moi la formation de la belima, à la décomposition du poulpe odorant dans l'eau et à l'abri complet ou presque complet de l'air, on s'imposerait l'obligation d'en admettre l'existence sur n'importe quel point du littoral algérien, ce qui n'est pas soutenable, puisqu'il est établi, ajoute-t-il, que quelques points seulement de la .côte algérienne, Bône, Djidjelli et Collo, sont reconnus pour en fournir.
Pas si bien établi cependant qu'au ne puisse en douter, cher confrère, car quelques indigènes m'ont affirmé en avoir recueilli également â La Calle et à Takouch.
Les points Bône, Djidjelli et Collo ne présentent d'autre particularité, dites-vous, que celle d'être en relation intime avec des terrains renfermant des gisements bitumineux ou simplement susceptibles d'en renfermer, ce qui militerait exclusivement en faveur de notre manière de voir.
Erreur! Profonde erreur ! car si pour Djidjelli, où, sur le rivage, on observe, à 1'est, des calcaires marneux gris veinés d'asphalte qui s'étendent, au sud, assez loin dans la contrée, et sans doute aussi, au nord, sous la mer, cette particularité est toute en faveur, je l'avoue, de votre opinion, elle ne saurait l'être pour Bône et Collo, où jamais personne n'a découvert, que je sache, la moindre trace de bitume à dix lieues à la ronde.
D'un autre côté, s'il suffit qu'un de ces pointe soit en rapport avec des terrains simplement susceptibles de renfermer des gîtes bitumineux pour y expliquer la présence de la belima, pourquoi n'en serait-il pas de même pour n'Importe quel autre point du littoral de la Méditerranée, de la Baltique, de la Manche, etc. ?
Non ! En voulant trop prouver, M. Malterre, vous ne prouvez rien ! Vous prouvez tout juste le contraire de ce que vous aviez vous-même établi en principe, à savoir : que quelques points seulement de la côte algérienne, Bône, Djidjelli et Collo, fournissaient de la belima !
M. Malterre ne voit pas trop sur quoi j'ai pu m'étayer pour établir un rapprochement sérieux entre
L'ambréine et la cholestérine. Il m'étonne, vraiment!
Comment ! Voilà deux substances présentant absolument les mêmes éléments de composition, en proportions presque égales, et il n'admettrait pas qu'on puisse établir entre elles une certaine analogie ! Elles sont toutes deux cristallisables, inodores, insipides, fusibles, volatiles, insolubles dans l'eau, mais solubles dans l'alcool et l'éther, les essences et les huiles grasses, inattaquables par les alcalis, enfin, et il leur refuserait tout lien de parenté !
Traitées par l'acide azotique, toutes deux se convertissent en des acides jaunes, solubles dans l'alcool et l'éther ; donnent avec les alcalis et les terres alcalines des sels jaunâtres, très soluble et incristallisables; les bases métalliques, des sels jaunes peu solubles, au contraire, et, il leur dénierait toute communauté d'origine ! Allons, avouez, cher confrère, que vous êtes bien difficile, ou que vous aviez un parti pris de ne rien accepter de mes considérations.
Vous ne voyez pas trop pourquoi non plus j'ai fait ce rapprochement, quoique je m'en sois expliqué assez clairement, je crois. En effet, du moment que j'arrivais à prouver que la cholestérine, qui rencontre en abondance dans le foie et la bile des animaux, avait la plus grande analogie avec la matière constituante de l'ambre gris, c'est-à-dire I'ambréine, n'amenais-je pas mes confrères à considérer I'ambre gris lui-même comme étant très vraisemblablement un calcul biliaire du cachalot?
En m'attribuant, d'un autre côte l'hypothèse qui tend à rapprocher l'ambréine de l'adipocire ou gras de cadavre, M. Malterre me fait beaucoup trop d'honneur. Elle appartient à Bouillon-Lagrange, qui le premier l'a émise en .donnant la composition chimique de l'ambre gris. J'en ai conclu, il est vrai, que cette matière odorante pourrait bien être le produit de I'action simultanée de la fermentation putride et de la combustion lente sur une matière animale, puisque I'adipocire ne se forme jamais qu'en des endroits humides où l'air atmosphérique n'a point ou presque point d'accès ; mais je lui ferai remarquer que je n'ai encore rien affirmé, ici pas plus qu'ailleurs. En fait d'hypothèses, on ne saurait, je le répète, en interdire l'usage à qui que soit, surtout quand il s'agit, comme ici, d'une substance sur laquelle on est encore à deviser, et qu'en fin de compte aussi les hypothèses émises n'ont absolument rien d invraisemblable.
Sans m'en dire la raison, M. Malterre me reproche aussi d'avoir attribué l'odeur douce et pénétrante de I'ambre gris à l'acide benzoïque; Serait-ce parce que ce parfum n'en contient pas ? Il serait, dans ce cas, en contradiction avec Bouillon-Lagrange, qui en a retiré jusqu'à 4,25 %. Serait-ce encore parce que cet acide n'a par lui-même aucune odeur? Mais les acides oxalique, malique, racémique, sorbique, quinique, oenanthique, etc., etc*, eux aussi sont dénués d'odeur; seulement, comme pendant la fermentation des substances qui les renferment à l'état de combinaisons, ils donnent lieu à des produits volatils carbonés à odeur plus ou moins aromatique, et des produits fixes où le charbon domine, pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'acide benzoïque de l'ambre gris ? J'incline d'autant plus à croire à une combinaison et un phénomène semblables, que, retiré du benjoin où il existe en assez grande abondance, cet acide conserve pendant un certain temps une odeur balsamique, alors que, obtenu par d'autres procédés, il est toujours parfaitement inodore, témoin celui qu'on extrait de l'essence d'amendes amères soumises à des influences oxydantes ou exposée pendant longtemps à l'air.
Et j'incline aussi d'autant plus à considérer l'ambre gris lui-même comme une matière organique en voie de décomposition lente et progressive, qu'il est bien peu d'échantillons qui ne présentent dans leur masse des veines plus ou moins charbonneuses, suivant que cette décomposition est plus ou moins avancée, sans doute. Il en est de même des variétés presque toutes noires qui ont d'autant moins d'odeur et prix que leur degré d'oxydation est, dans ce cas, plus prononcé, que la matière grasse (adipocire dont elles sont constituées est, en d'autres termes, passée presque toute entière à l'état goudronneux ou bitumeux. J'ai rappelé plus haut Fort Génois l'Algérien connaissait deux sortes d'ambre gris : le gris et le noir, et que, suivant cet auteur, le noir était beaucoup moins bon que le premier. Si mon confrère en doute, qu'il veuille bien relire le traité de matière médicale de cet auteur, la page 263 (traduction du Dr L. Leclerc, Paris, 1874) ; il aura la preuve que j'avance.
Mais j'en finis ici avec une question qui menace de s'éterniser, en déclarant ouvertement que j'admets très volontiers, avec mon confrère et contradicteur, ou plutôt avec Fort Génois l'Algérien, dont il a eu l'heureuse occasion de consulter bien avant moi le Kachef er-Roumouz, que la belima des auteurs de médecine arabe et des indigènes de Bône soit de la poix marine ou goudron minéral, mais que j'admets aussi qu'il peut s'en rencontrer d'origine animale, puisqu'il est acquis à la science que les principes gras des animaux (graisses), comme ceux des végétaux (huiles), placés hors contact de l'air et sous l'influence de l'eau, passent à l'état goudronneux ou bitumeux en subissant les effets ultimes de la pourriture humide.
|
|
GRAVURES et PHOTOS Anciennes
De BÔNE
Envoi de M. Cinobatti
|
 BÔNE 1830
BÔNE 1830
 Tableau représentant les funérailles du Général de Damremont tué devant la brèche de constantine, au moment de l'élévation
Tableau représentant les funérailles du Général de Damremont tué devant la brèche de constantine, au moment de l'élévation
|
|
|
CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS
DE BARBARIE (1857)
PAR M. L'ABBE LÉON GODARD
ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE
AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES
Dominare in medio inimicorum tuorum.
Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.
SOIREES ALGERIENNES
DEUXIÈME SOIRÉEE
Les villes de bagnes. - La marine des corsaires.
- La prise.
Le père Gervais achevait à l'écart la récitation de son bréviaire. Le clair de lune était si limpide, qu'il permettait aux yeux du vieillard de suivre encore sur les pages du respectable in-quarto les prières accoutumées. Cependant, ce demi-jour laissait briller des milliers de lumières aux fenêtres des maisons en amphithéâtre dont se compose Alger. Chaque soir la cité s'illumine ainsi, et l'on croirait qu'elle veut rivaliser avec le ciel profond qui la couronne, tout scintillant d'étoiles.
Mme Morelli indiquait de la main les murs de la Casbah, posée comme une aire d'aigle au sommet de la ville. " C'est là, disait-elle, que le dernier dey d'Alger, Hussein, donna au consul de France, M. Duval, le fameux coup d'éventail qui détermina l'expédition de 1830.
- De cette hauteur, à quatre cents pieds au-dessus du niveau de la mer, dit M. Morelli, les rois corsaires, ces oiseaux de proie, découvraient au loin, sur les flots, leurs navires triomphants et traînant à la remorque de riches captures.
- Oui, dit le trinitaire, qui intervint alors dans la conversation; les deux derniers deys ont fixé leur résidence à la Casbah. J'étais ici, en 1816, lorsque Megheur-Ali, souverain d'Alger, abandonna l'ancienne demeure des pachas pour cette forteresse. La peste, cette année-là, ravageait la ville basse. Megheur saisit ce prétexte pour transférer sur la hauteur plus saine le siège du gouvernement. Le motif réel, c'est qu'il avait moins à craindre, à l'abri de la citadelle, les complots qui renversaient l'un sur l'autre les deys assassinés.
Car, que pouvait-on attendre d'un État qui avait à sa tête une horde de brigands ? La tyrannie des pachas que nous avons vue s'établir, au XVIème siècle, ne respectait que les Turcs. Elle opprimait Arabes et Maures; elle écartait des emplois les Coulouglis eux-mêmes, et pourtant c'étaient les fils de Turcs et de Mauresques. Ils se révoltèrent en 1631, et furent massacrés. L'orgueil des Turcs en devint plus intraitable, et les jeni-tchéri, ou janissaires, qui formaient la garde des pachas, commencèrent à les destituer, sans se mettre en peine du Grand Seigneur. La Porte ratifiait forcément les caprices de cette milice rebelle, et envoyait presque tous les ans un nouveau pacha. En 1660, l'autorité de ces vice-rois fut bien réduite. Les janissaires opposèrent au représentant de la Porte le conseil des agas, officiers du divan, qui tenaient en main l'administration. En 1661, ils donnèrent au président de ce conseil le titre de protecteur ou de dey. En 1710, le dey Ali-Chaouch renvoyait à Constantinople le pacha du sultan. La Porte du se résigner à reconnaître désormais la double dignité de pacha et de dey dans la personne de l'élu des janissaires.
Le gouvernement ne fut pas moins orageux sous les deys qu'au temps des pachas. Le 23 août 1712, sept deys furent élus et massacrés dans la même matinée ! Si un dey meurt dans son lit, c'est par exception. Le yatagan ou le lacet, voilà la règle. En 1817, Omar fut étranglé. Megheur Ali-Khodja, mis à sa place, se sauva, la nuit, de la Djenina à la Casbah.
La Djenina, ce sombre bâtiment aux fenêtres rares, étroites et grillées, qui regardent le port, était le palais des rois corsaires. Bâti en 1552, par salah-Raïs, il est maintenant si délabré, qu'à l'intérieur même, sauf ses colonnettes de marbre, rien ne révèle sa splendeur passée.
Sachons-le bien, les villes mauresques, et Alger en particulier, ont été fort appauvries par la destruction des pirates. Elles ont souffert autrefois de la peste et de la famine; elles ont laissé tarir, si on le veut, les sources de la vraie richesse, en préférant au développement de l'agriculture et de l'industrie les entreprises aléatoires des raïs ; mais elles ont vu des jours de bonne fortune, où elles regorgeaient de trésors, de marchandises précieuses, dé munitions de guerre et d'esclaves. Les captures des Algériens atteignirent en certaines années la valeur d'un à deux millions. En 1616, le commerce de Marseille déplorait une perte de deux millions, ravis par les corsaires.
Aussi les considérait-on comme les pourvoyeurs et les soutiens de l'État. Si la soif du butin, si la pensée que la meilleure couvre d'un bon musulman est d'affaiblir les infidèles, n'avaient pas invinciblement poussé les Turcs à la piraterie, malgré les traités et les serments, ils s'y seraient livrés par besoin et pour ne pas mourir de faim et de misère. C'était une conséquence inévitable, du moment qu'on négligeait les autres moyens qui font vivre les nations.
Tous les gouvernements de la côte ont perdu à cette abolition de la course ; ils n'ont pas mémo en dédommagement les avantages matériels que l'activité industrielle ou commerciale et la justice des Français ont apportés aux Algériens. Je crois au contraire que le pillage et les exactions des grands sur les petits, des puissants sur les faibles, ont redoublé à l'intérieur, de manière à réparer pour les chefs les pertes qu'ils éprouvaient au dehors.
- Révérend père, demanda Carlotta, quelles sont donc les villes, outre Alger, qui autrefois profitaient le plus de la course et de l'esclavage des chrétiens ?
- Ce sont les villes de bagnes et celles où la piraterie était organisée : Tripoli, Tunis, Tétouan, Salé, Fez et Maroc tiennent le premier rang.
- Tripoli, dit Alfred, était merveilleusement placée pour les forbans. Les navires qui fréquentent les parages de l'Égypte et du Levant se trouvent à sa portée. Son éloignement vers l'est la protégent contre les forces des Latins.
- Heureusement, nous avions Malte en sentinelle avancée, dit le moine. Lorsque les chevaliers eurent abandonné Tripoli, qu'ils tenaient de Charles-Quint, et quand les Turcs l'occupèrent définitivement, l'ordre ne réussit plus à prendre pied sur la côte ; mais il combattit les corsaires tripolitains. En 1619, le renégat Mami-Raïs ranima leur courage, et leur apprit à faire la course avec des vaisseaux ronds. En 1638, les galères de la religion leur enlevèrent deux petits navires et trois vaisseaux, après une lutte acharnée. Les chevaliers ramenèrent deux cents corsaires. Une jeune femme de vingt-deux ans reconnaît, parmi les prisonniers, son mari, qui depuis peu était allé renier la foi chez les Turcs. Elle se jette sur lui, le frappe, le saisit à la gorge. Elle faillit l'étrangler, tant elle avait d'horreur de son crime.
Il y a deux bazars à Tripoli ; le plus petit était destiné à la vente des esclaves. Le bagne des chrétiens est voisin du château où réside le bey. Il renferme une chapelle, où les prêtres captifs, lorsqu'il s'en trouvait, pouvaient célébrer la messe. Cette chapelle a été bâtie et dédiée en l'honneur de saint Antoine, au XVIIème siècle, avec la permission du pacha Mohammed, renégat; grec, de la famille des Justiniens de Chio. La bénédiction fut célébrée par un évêque fait prisonnier dans la traversée de Gènes à Majorque. Ce prélat était de la parenté du pacha ; mais au bagne il ne se fi t connaître qu'en qualité de prêtre, et après avoir servi longtemps les maçons comme un captif vulgaire. Il fut racheté par le consul de Venise ; et quand le pacha su quel il était, il lui écrivit pour lui demander pardon, et lui renvoya le prix de sa rançon avec de riches présents. Vers 1630, il y avait à Tripoli de cinq à six cents esclaves chrétiens : c'est peu relativement aux autres villes de bagnes.
On en comptait sept mille, à Tunis, à la même époque. Ils étaient entassés dans des fondouks, bâtiments disposés en forme de tour carrée. On y disait la messe dans des chapelles. La principale était dédiée à saint Antoine.
En 1720, les pères trinitaires espagnols fondèrent en cette ville un hôpital pour les esclaves malades. Ils y sont restés jusqu'à l'abolition de l'esclavage, en mai 1816. C'est actuellement l'hospice habité par les capucins. Le réfectoire était l'ancienne chapelle des trinitaires. Les deux ordres ont travaillé concurremment au rachat des esclaves. Il y avait quatre bagnes ayant chacun une chapelle et un missionnaire capucin. Les esclaves étaient divisés par nation dans ces fondouks, désignés par les noms des patrons : Sainte-Lucie, Saint-Léonard, Saint-Roch et Sainte-Croix. Il y avait en outre cinq bagnes à Bizerte et d'autres à Porto Farina, où l'on construisait les navires. Des hôpitaux y furent établis en 1720. Enfin les esclaves employés au Bardo, palais du bey, à quelque distance de Tunis, avaient pour chapelle un souterrain humide et obscur, où l'on a célébré la messe jusqu'en 1848. Il s'est écroulé alors, et n'a pas été rebâti.
Tétouan possédait quelquefois trois à quatre mille esclaves chrétiens. Sous Louis XIII, elle n'armait qu'un petit nombre de frégates, qui allaient en course vers les côtes d'Espagne. Les trinitaires y firent beaucoup de rachats. En 1641, le père Martin Agudo de la Rosa et les frères Michel Diaz et Diégo Vallezo, donnèrent soixante mille francs pour la rançon de cent seize esclaves espagnols, où l'on comptait un dominicain, deux capucins, onze capitaines, dix-huit enfants au-dessous de seize ans, et deux femmes. Les autres étaient marchands et matelots. A peine ces rédempteurs furent-ils revenus à Madrid, dit le père Dan, qu'ils y moururent d'un poison que les infidèles leur avaient fait boire avant le départ. Ces barbares croyaient que les religieux en mourraient sur le territoire du Maroc, et ils espéraient reprendre les esclaves et garder l'argent.
A Fez, qui fut longtemps capitale d'un royaume florissant, les chrétiens captifs ont été souvent jusqu'à cinq à six mille, et le roi en avait un millier pour lui seul. Ils logeaient dans des matamores, caves souterraines où ils avaient beaucoup à souffrir. Les voûtes étaient basses. L'air ne pénétrait que par des soupiraux.
Ceux de Maroc étaient dans les mêmes conditions. Cette ville en renfermait environ six mille à l'époque où M. de Rasilly négocia un traité entre l'empire et la France. Cette convention, signée en 1631, stipulait la liberté de commerce et de navigation, la reddition des esclaves français, alors au nombre de quatre-vingts, et le libre exercice de la religion chrétienne. " Qu'aucun de nos sujets ne les trouble en leur religion, disait l'émir, et que, pour en faire exercice, ils puissent avoir des prêtres en quelque lieu que soient les consuls; pourvu néanmoins que ce ne soit que pour lesdits Français, et que ceux des autres nations n'y soient point mêlés. " Les Français prenaient d'ailleurs l'engagement de ne pas venir en aide aux Espagnols contre le Maroc.
Salé fut aussi un repaire de pirates. Refuge, d'un grand nombre de Morisques, elle avait acquis de l'importance au commencement du XVIIème siècle. Ses corsaires étaient avantageusement placés à l'entrée du détroit; ils nourrissaient dans leur cœur une haine implacable contre les chrétiens, qui les avaient bannis de l'Espagne. Ils connaissaient la fabrication des armes, et parlaient l'espagnol; on conçoit donc qu'ils étaient fort à craindre, ils se soulevèrent contre l'empereur du Maroc, qui les avait accueillis, s'emparèrent de la citadelle de Salé et se proclamèrent indépendants. L'empereur, dans l'impuissance de les réduire, se contenta du titre de suzerain et de quelques offrandes annuelles.
Anglais, Français, Espagnols, avaient à se plaindre de leur insolence. En 1630, le cardinal de Richelieu envoie l'amiral de Rasilly avec trois vaisseaux de guerre pour réprimer ces forbans. L'amiral capture deux navires près de Salé, tient enfermés dans le port dix-sept bâtiments qui n'osent engager le combat, et signe un traité sur les bases de celui de Maroc, que j'ai mentionné tout à l'heure. Vers ce temps, il y avait environ quatre cents Français parmi les quinze cents esclaves de Salé. Malgré ces conventions, la piraterie continuait. Le père Jean Escoffier rachetait, en 1641, à Salé même ; quarante et un Français. Il apprit d'eux la mort de Nicolas, marin du Havre-de-Grâce.
Nicolas avait été captif à Alger. Après une longue résistance, il s'était fait renégat, non point de cour, mais pour obtenir plus de liberté et de plus sûrs moyens d'évasion. Il réussit à rentrer en France. Deux ans de séjour dans sa patrie lui firent oublier les périls de la mer. Il quitta son pays, qu'il avait édifié par ses vertus, et se rembarqua, espérant que s'il avait le malheur d'être pris par les corsaires, il ne serait pas reconnu des Algériens. Son navire fut capturé par des pirates de Salé, après une héroïque défense. Pour se rendre compte de la valeur de Nicolas, ils l'examinèrent de prés, et plusieurs crurent reconnaître un renégat qu'ils avaient vu à Alger. Une marque indélébile acheva de le trahir. Il fut mené devant le juge à Salé, et arraché du tribunal par la populace. On le lia, et on le tua à coups de couteaux, de bâtons et de pierres. Le martyr priait durant ce supplice. On était au 26 septembre 1634.
Les Anglais, en 1637, demandèrent satisfaction à leur tour. L'amiral Rainsborough parut à la tête d'une flotte devant le nid de pirates, alors divisé en vieux et nouveau Salé. Il mit à profit ces discordes, détruisit quelques navires, et se fit rendre trois cent trente-neuf esclaves anglais. Ce fut là tout son succès.
Mais le plus important repaire des corsaires barbaresques, c'était Alger. Le père Dan, appréciant au commencement du XVIIème siècle les forces dont ils disposent, compte cent vingt-deux vaisseaux ronds. Alger en a soixante-dix armés de vingt-cinq à quarante canons ; Tunis en a quatorze ; Tripoli en avait vingt-cinq, mais les chevaliers de Malte en ont réduit le nombre a une huitaine. Salé possède trente navires, d'une construction légère, parce que son port est peu profond. Cette énumération néglige des galères et des frégates de moindre importance.
A cette époque, dans un intervalle d'environ trente ans, les Algériens avaient capturé environ six cents navires et une valeur de vingt millions. Et pourtant la France était protégée par le traité de 1534, conclu entre la Porte et François 1er. La ville et son territoire possédaient trente mille esclaves de toutes nations. On y distinguait quinze cents Français. Il y avait deux cents femmes, enlevées sur mer ou sur les côtes ; mais les Françaises étaient peu nombreuses.
Le même religieux trace ainsi l'état des prises faites par les Algériens sur la France du mois d'octobre 1628 à 1631 Quatre-vingts vaisseaux, dont cinquante-deux venus de l'océan et vingt-huit naviguant dans la Méditerranée;
Quatre millions sept cent cinquante-deux mille livres, valeur totale des prises ;
Treize cent trente et un esclaves, dont trois cent quarante-deux non vendus;
Quatre cent cinquante-neuf vendus ;
Cent quarante-neuf renégats ;
Deux cent soixante-deux rachetés ;
Cent dix-neuf morts.
Les pertes des autres nations étaient proportionnelles, mais celles de la Hollande relativement plus fortes, parce que les corsaires recherchaient ses navires, bâtis plus solidement et montés de peu d'hommes.
A une époque plus rapprochée de nous, et où j'ai pu observer par moi-même la marine algérienne, elle avait d'ordinaire une vingtaine de vaisseaux de diverses grandeurs, sans parler des petites galères ou chaloupes à rames. Les bois de construction, les agrès provenaient des navires pris sur les chrétiens. Les pièces de bois neuf se tiraient généralement du pays de Bougie et de Cherchell. Il y avait des pièces d'artillerie de six, de huit et de douze. Les chrétiens faisaient encore les frais de cet armement. Du reste, les corsaires étaient restés, je crois, fort inférieurs aux Européens dans l'art de la marine, et je ne remarquais pas à bord de leurs navires cet ordre et ces proportions qui distinguaient nos vaisseaux.
- Il règne beaucoup de préjugés sur la marine du moyen âge, dit M. Morelli ; et quand nous entendons parler de galères à rames, nous nous imaginons de frêles coquilles de noix, incapables de soutenir les assauts de la mer ou de faire de longs voyages.
- Je me figure en effet, ajouta Mme Morelli, qu'il n'y eut pas de marine vraiment digne de ce nom avant les Barberousse ou les Doria, et que les grands vaisseaux datent de Duquesne. N'en est-il pas de la sorte, Alfred ?
- Non, ma mère. Le moyen âge en toute chose fut plus grand qu'on ne le pense. Ma sœur était en extase dans les nefs gothiques des vastes cathédrales, lorsque nous voyagions en France, Pour moi, je ne m'étonne pas que les siècles capables de construire de tels édifices aient pu bâtir de bons et beaux vaisseaux.
Le moyen âge à connu, comme l'antiquité, deux genres de navires, les vaisseaux longs à la voile ou à la rame, ou mus par l'une et par l'autre à la fois, et les vaisseaux ronds, qui manœuvrent à la voile seule.
Les vaisseaux longs, ou les galères, se subdivisent en nombreuses familles, depuis le dromon, qui a quelquefois plus de cent rames sur deux étages, et maniées chacune par plusieurs hommes, jusqu'à la galiote, qui en est le dernier diminutif.
La galère commune, qui joue un si grand rôle dans l'histoire des corsaires, est un petit dromon à deux rangs de rames, long, ras d'eau, de peu de calaison, à deux mâts courts, et dépourvu de tillac ou de pont. C'est le bâtiment de guerre par excellence au moyen âge. Il file avec la vitesse du poisson, dont il a la forme.
Le brigantin était aussi un bâtiment à voiles et à rames, à un pont et à un ou deux mâts. Il pouvait, mieux que la galère commune, braver le mauvais temps. Les corsaires lui ont donné quelquefois le nom de frégate.
Leurs galères avaient pour la plupart de dix-huit à vingt-quatre bancs. Presque toutes appartenaient à des renégats.
La nef ou vaisseau rond, qui généralement ne marche qu'à la voile, fut adoptée par les corsaires algériens vers 1620, date bénie des esclaves qui expiraient souvent de fatigue sur l'aviron. Le galion était une nef allongée, une fusion du vaisseau rond et de la grosse galère. Il y en avait d'énormes à deux et trois ponts, armés de, plusieurs centaines de pièces d'artillerie. La mahonne et la caravelle aux quatre mâts verticaux, à voiles carrées et triangulaires, sont de la famille des vaisseaux ronds.
- D'après Haedo, les galiotes, au XVIème siècle, étaient souvent commandées à Alger par des Morisques de Cherchell, dit le père Gervais. Elles pouvaient porter jusqu'à quatre-vingt-seize rameurs et quarante-huit levantins ou soldats de marine. Elles étaient construites à Alger sur l'emplacement de la place actuelle du Gouvernement. Il y avait encore un chantier dans l'île réunie depuis à la ville par la jetée Kheir-ed-Din. On tirait alors les bois de Cherchell L'exploitation de ces bois était tout entière entre les mains de captifs chrétiens, organisés en une corporation nommée El-Macen, et travaillant sous la garde des janissaires. C'est donc aux chrétiens que les corsaires devaient leur marine.
Pour activer le travail, on fêtait le jour où un bâtiment était lancé à la mer. L'El-Macen et les chrétiens, qui mettaient la main à l'œuvre dans cette opération, prenaient part aux réjouissances.
- De tout temps, reprit Alfred, nous avons été supérieurs aux musulmans dans tout ce qui se rapporte à la navigation. En 1248, saint Louis traversait la Méditerranée avec dix-huit cents galères et vaisseaux, dont quelques-uns portaient plus de mille passagers, et d'autres cent chevaux.
Les corsaires s'armaient du cimeterre, de croissants emmanchés pour couper les cordages, de piques, de flèches et d'arbalètes, de lances à croix, d'artillerie et d'armes à feu.
Il y eut parmi eux de hardis navigateurs, très habiles à se diriger d'après les vents périodiques, le mouvement des astres, l'étoile polaire, ou, comme on disait, la tramontane. Puis ils connurent l'aiguille frottée d'aimant qui, enfermée dans un brin de paille, nageait sur l'eau d'un vase en montrant le nord. La Méditerranée devenait trop étroite. Les pirates croisèrent devant Cadix, les caps Saint-Vincent, la Roque et Finistère, dans les parages des Açores et des Canaries. Quelques-uns poussèrent jusqu'à Terre-Neuve.
- En 1707, dit le père Gervais, on vit arriver à Alger douze cents captifs. Ils venaient de Madère, que les corsaires avaient pillée. Le mobilier, les cloches des églises, faisaient partie du butin.
- Ces aventuriers se hasardèrent dans les mers du Nord, reprit Alfred ; ils capturèrent des vaisseaux l'île de Texel, sur les côtes de Hollande.
- En 1631, ajouta le trinitaire, le renégat flamand Morat-Raïs, fi t une descente en Irlande, enleva deux cent trente-sept personnes, et même des enfants au berceau. Quand on les mit en vente séparément à Alger, ce fut un spectacle déchirant.
On rapporte, et j'ai vraiment peine à le croire, qu'en 1727 le renégat allemand Cure-Morat partit d'Alger avec trois navires, se rendit en Danemark, à l'île d'Islande, et ramena quatre cents esclaves.
- Est-ce que les capitaines étaient libres de sortir du port à leur gré ? demanda M. Morelli. Y avait-il quelque ordre dans les expéditions des corsaires ?
- Le gouvernement n'avait qu'un ou deux navires en propriété. Il devait donc se ménager le droit de régler les mouvements du port. Les raïs étaient libres de se mettre en mer et de choisir leurs croisières, mais à la condition de prévenir le dey de leur départ. Il ne s'y opposait que dans le cas où les besoins de l'État l'exigeaient : par exemple, pour le transport d'approvisionnements, pour la garde du pays en temps de guerre, ou pour le service du sultan. Les propriétaires des navires étaient tenus, en pareils cas, de sacrifier leurs intérêts à la volonté du pacha ou du dey.
Le raïs n'était pas toujours propriétaire de son bâtiment ; il en possédait quelquefois une partie seulement, et les avances de fonds étaient complétées par des associés, qui avaient leur dividende au moment du partage. De mon temps, pour entretenir sur un pied toujours égal les forces de la marine, les propriétaires d'un navire perdu par le naufrage ou autrement, étaient obligés de le remplacer par un autre semblable.
Nos esclaves travaillaient au chargement du navire en partance, et prenaient place parmi les hommes du bord. Au XVIème siècle, le patron d'un esclave le louait pour une course à raison de douze écus d'or. Les provisions sont faites pour un ou deux mois : voilà l'eau, le biscuit, le couscous et le riz. Ni lit, ni coffre. Le Turc dormira, dans son haïk de laine; l'esclave sur la planche. Mais on n'entreprend pas la course au hasard. Il faut sonder l'avenir et s'assurer de puissants protecteurs.
Les femmes offrent des sacrifices aux Djenouns sur le bord de la mer ; elles égorgent des coqs, livrent la plume au vent qui l'emporte sur les flots, et font fumer l'encens. Elles mettent deux doigts en croix et crachent dessus, pour maudire le chrétien. On ne part pas un jeudi ; le fal ou présage serait funeste. Les marabouts ont bon espoir. Au signal on lève l'ancre, et le navire en s'éloignant salue d'un coup de canon le grand Sidi-Sebka.
- Qui est-ce donc, père, Sidi-Sebka ? demanda Carlotta.
- C'est un fameux marabout dont la kouba, ou chapelle funéraire couverte d'une coupole, était à Bab-Azoun. Les nouvelles constructions françaises l'ont fait disparaître. Au départ et à l'arrivée, tout bâtiment saluait ce santon. C'est à lui, à ses jeunes et à ses prières, aux coups de bâton dont il avait frappé la mer, que les Algériens doivent, disent-ils, la destruction de la flotte de Charles-Quint par une tempête de nuit, dans la baie d'Alger. C'est à lui et au sortilège du nègre Youcef, que la ville doit son salut. N'est-il pas vrai, Fatma ? "
La négresse écoutait le cou tendu. Elle était fort instruite des légendes algériennes, surtout de celles qui étaient relatives aux gens de sa race.
" Oui, c'est Sidi-Youcef et l'autre nègre Sidi-Ouali Dada, qui ont sauvé Alger. Que la bénédiction d'Allah soit avec eux !
- Qu'a donc fait ton Ouali-Dada !
- Ouali-Dada, el-Saleh, le pieux, le protecteur des marins, arrivait. Il venait de Stambol, non pas dans un bateau, mais en naviguant sur sa natte. Il débarque avec la natte, son fusil et sa masse de fer... ".
Alfred laissa partir un éclat de rire qu'il comprimait.
" Oui, oui, dit la négresse ; dans sa kouba; rue du Divan, vous pouvez voir la natte, le fusil et la massue...
- Va, va, dit Alfred.
- Ouali entre dans un café maure. Le kaouadji et les hommes sont pâles, ils tremblent. Les Roumis avancent.
Les voilà au Coudiat-el-Sabroun, au tombeau de Sidi Yacoub. Ouali-Dada descend sur la plage, entre dans l'eau et la frappe... La tempête s'élève, et les vaisseaux des Roumis se brisent. Que la malédiction d'Allah...
- Voulez-vous vous taire, Fatma ! cria subitement Alfred.
- Oh ! ne la grondez pas, dit le père Gervais; ce n'est point elle qui parle ainsi : voyez comme elle est confuse. Elle achevait de répéter la formule de la légende qu'elle récite par cœur. N'est-ce pas, Fatma ?
- Ia, sidi marabout ; je n'avais pas mon esprit. Tu es bon; rien ne t'est caché, ton regard pénètre tout. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous !
- Suivons nos corsaires sortis du port, continua le vieillard. Ils arborent par ruse un pavillon chrétien. Le vent enfle la voile, les esclaves rament avec vigueur. La sueur tombe à grosses gouttes de leur front. Le raïs sonde l'espace de sa lunette, ou de son regard, qui voit où le nôtre ne voit rien.
" Un brigantin ! s'écrie-t-il; un brigantin à l'horizon ! "
L'aga-bachi prononce une parole; le bâton active les bras des esclaves haletants, et le corsaire en furie donne la chasse au navire chrétien. Bientôt celui-ci s'aperçoit qu'il est poursuivi ; il ne se trompe pas ; à la vue du pavillon démenti par les formes du navire, il fuit son redoutable adversaire ; mais, malgré de suprêmes efforts, il perd peu à peu l'avantage. Heureusement un petit nuage blanc se lève de la mer et monte rapidement sur le ciel : c'est un grain. La bourrasque se déchaîne. Le brigantin est armé contre elle.
Mais la galère des pirates est en perdition. La peur les saisit. Ils offrent aux génies des cruches d'huile. Ils allument des chandelles pour conjurer l'orage, et l'orage redouble. Ils font des ablutions pour se purifier des crimes dont ils sont souillés, la vague menace toujours de les engloutir. Dans leur désespoir, ils commandent aux esclaves chrétiens de faire des vœux à la sainte Vierge ou à, saint Nicolas. Peu leur importe à qui l'on s'adresse, pourvu qu'ils échappent à cette mort devant laquelle ils sont si lâches, eux qui la donnent aux autres si facilement. Le vent et la vague s'apaisent enfin ; le navire chrétien est hors d'atteinte.
De quel côté maintenant chercher la fortune ! On ouvre au hasard un livre magique, et il indique le levant. On fait tourner une aiguille en murmurant des formules magiques, et elle marque aussi l'orient. Les corsaires prennent cette direction, et consultent les présages. Un d'eux tient une flèche de chaque main et rapproche leurs pointes l'une de l'autre, sans d'ailleurs gêner le mouvement. Puis le khodja, ou secrétaire du bâtiment, lit des formules magiques et dessine des caractères cabalistiques ; les flèches aussitôt se rapprochent d'elles-mêmes et s'entrechoquent. L'une d'elles, celle qui signifie les chrétiens, tombe de la main du pirate, et l'autre, qui marque les musulmans, se soutient en signe de victoire. On marche donc avec confiance ; et pour que Mahomet soit encore plus favorable, le khodja fait rougir au feu un grand clou, et le passe en forme de croix, sans pourtant les brûler, sous les pieds des Turcs et des chrétiens.
- Révérend père, dit Alfred, ces superstitions sont fort étranges. Mais s'il y a, grâce à Dieu, parmi nous beaucoup d'officiers très éclairés et d'une foi à toute épreuve, il règne encore parmi les matelots quelques-unes des superstitions répandues autrefois chez les hommes de mer : ils ne se coupaient pas les ongles pendant le calme; ils éloignaient la trombe en faisant dans l'air, avec un couteau, des signes de croix; ils fouettaient saint Antoine au grand mât ; ils jetaient à la vague bondissante les pains de saint Nicolas. " Malheur à nous ! " disait le matelot, si on levait l'ancre un vendredi, ou si au moment du départ on entendait à gauche un éternuement.
- Le khodja finissait à peine la cérémonie. Un petit bâtiment, une tartane à la voile latine se montre au loin. On le poursuit, il ne fait pas mine de fuir. Est-ce que par hasard les braves qui le montent sont disposés à la lutte ? Nos corsaires hésitent ; le raïs se prononce pour l'attaque. Mais l'aga-bachi s'y oppose, et la galère elle-même s'éloigne de l'ennemi.
- Quelles étaient, révérend père, les fonctions de ce dernier officier ? demanda M, Morelli.
- A vrai dire, c'est à lui qu'appartenait le haut commandement du navire. Le capitaine présidait à la manœuvre ; mais il lui fallait l'assentiment de l'aga-bachi pour engager le combat ou pour retourner à Alger. L'aga rendait compte au dey de la conduite du capitaine en toute circonstance, et sa plainte entraînait d'ordinaire un châtiment.
On aurait tort de croire que les corsaires étaient plus braves que les matelots chrétiens. Ils n'attaquaient pas, généralement, s'ils ne se sentaient supérieurs en forces. Aussi voyons-nous notre navre, sur l'avis de l'aga, décliner une rencontre.
La galère rentrera-t-elle donc à Alger avec la honte et sans butin? Non : les corsaires sont patients comme toutes les bêtes ale proie. D'ailleurs les soldats turcs n'ont pas de solde. Pour exciter leur courage à combattre, en ne leur assure que les vivres en dehors de leur part des captures. Quelquefois, surpris par les vents contraires, ils ne peuvent atteindre la Barbarie avec les provisions qui leur restent ; alors les esclaves jeûnent ; plusieurs, en pareils cas, sont morts de soif et de faim.
Mais où vas-tu, frêle goélette ? Ne vois-tu pas le vautour ? Il te guettait dans l'ombre du soir. Il vient sur toi ; fuir est impossible. Le raïs commande l'abordage ; les glaives étincellent. Les cris s'élèvent, puis se taisent. La mêlée est chaude, et le sang coule. Les hommes tombent. La goélette se remplit de Turcs. Je les distingue au turban, à l'éclair des lames courbes. Le combat se concentre à la retenus de poupe : là est la bannière. Enfin l'assaillant l'emporte ; les Maures, lâchement confinés sur la galère, arrivent maintenant, rivent des fers aux blessés et jettent à la mer les cadavres.
Le lendemain la galère entrait au port d'Alger ; elle tirait le canon en signe de victoire, et la foule accueillait les corsaires en triomphe. On conduisait les prisonniers dans les bagnes pour y attendre le partage des prises et la vente à l'enchère.
Les rameurs et d'autres esclaves déchargeaient le navire, et disposaient dans les magasins de marine les agrès et les avirons.
- Révérend père, dit Mme Morelli, nous avons l'idée d'une course de pirates ; mais nous voudrions savoir comment se faisait ce partage des prises.
- Il y a eu, Madame, des variations dans les règles qui présidaient au partage. Au XVIème siècle, le Turc qui sautait le premier à l'abordage avait droit de choisir l'esclave qui lui convenait le mieux. Le roi prélevait le septième des esclaves et des marchandises, le raïs recevait le quinzième ; on adjugeait les vêtements aux soldats turcs. Le roi gardait aussi la carcasse du navire. Plus tard, les pachas percevaient dix pour cent, après l'inventaire. Le dey d'Alger a même reçu onze. On imposait aussi toutes les prises en faveur des marabouts des mosquées et pour l'entretien du port.
De mon temps, le dey prenait le huitième des marchandises et des hommes. Aussitôt que le navire était arrivé, on conduisait les esclaves, au palais. Le dey choisissait ceux qui paraissaient de meilleure condition, ou dont le métier lui serait le plus utile.
Dans le lot de l'équipage, l'aga-bachi, commandant des soldats, avait trois parts. Le capitaine n'avait que sa part de propriétaire. Le lieutenant, le khodja, le maître-canonnier recevaient trois parts. Les contremaîtres, les aides canonniers, les quartiers-maîtres en avaient deux. Les esclaves chrétiens employés à bord étaient récompensés selon leur conduite.
Quelquefois les corsaires, pour ne pas remorquer un mauvais bateau dans une course longue, le brûlaient en mer. S'ils le jugeaient assez bon pour être ramené, les gardiens du bagne s'emparaient des agrès du grand mât. Mais le raïs avait eu soin de le dépouiller avant eux, et d'y mettre de méchantes voiles et de vieux cordages.
Les corsaires accordaient une part des prises à chaque passager qui pouvait être à leur bord, quelle que fût sa religion ; ils voulaient ainsi se rendre le Ciel favorable : c'est superstition, non générosité.
Vous voyez, d'après le partage des esclaves, que les uns appartenaient au beylik ou au gouvernement, les autres à des propriétaires. Ceux des grandes maisons étaient souvent logés dans de petites chambres basses et voûtées, qui pouvaient en contenir une quinzaine. Ils y couchaient sur la dure ou sur une natte de palmier. Les haillons qui les couvraient ne les protégeaient guère contre l'humidité. La vermine rongeait ces malheureux, et il ne leur était pas toujours facile d'éviter, dans ces antres, les reptiles et les scorpions.
Quelques esclaves obtenaient l'autorisation de tenir cabaret ; ils y réalisaient de beaux bénéfices sur les Turcs et les renégats. Mais ce gain s'en allait en débauches ; car, j'ai le regret de le dire, les esclaves n'étaient pas tous des saints ; un trop grand nombre ne profitaient nullement de la Situation méritoire où la Providence les avait placés. C'est surtout dans les derniers temps qu'ils ont donné le scandale de l'impiété et de l'immoralité. Tirons le voile de l'oubli sur cette partie gangrenée, pour rappeler les admirables exemples de foi, de piété, de patience et de dévouement, dont j'étais chaque jour le témoin.
Je visitais les captifs principalement dans les bagnes.
Ces bâtiments ou ces prisons doivent leur nom à la plus importante des maisons destinées aux esclaves à Constantinople. Elle avait des bains et des réservoirs qui l'ont fait appeler bagno, en langue italienne ou franque, et les Turcs ont désigné de la même manière tous ces lieux où l'on enfermait les esclaves après le travail. Il y en avait autrefois à Alger six principaux: ceux du roi ou du dey, de Sidi-Hassan, des Coulouglis, d'Ali-Mami, de Rapagy ou Aripagy, fameux pirates au XVIème siècle, et celui de Sainte Catherine.
Les Français ont renversé ce que j'ai pu voir encore des anciennes prisons des esclaves, à la caserne du Lion et aux bains du Beylik, dans le quartier Bab-Azoun.
- Les esclaves étaient-ils nombreux à Alger, tandis que vous exerciez auprès d'eux votre saint ministère ? demanda Mme. Morelli.
- Le nombre des esclaves variait beaucoup, selon les circonstances politiques. De 1807 à 1817, pour ne parler que des esclaves du beylik, le maximum a été de mille six cent soixante-cinq, en 1813, et le minimum de mille seize, en 1816. En dernier lieu, ils étaient de quatre à cinq cents, et la plupart italiens.
Nous recevions les malades dans un hôpital attenant à la caserne du Lion, et dont il ne reste pas de vestiges. C'était une fondation des trinitaires espagnols, due surtout au père Sébastien Duport, du couvent de Burgos. En 1546, il racheta deux cents esclaves, jeta les fondements de l'hôpital à un second voyage, et mourut en 1556, après avoir accompagné l'expédition de Charles-Quint.
En 1593, un évêque, Louis Figuerra, assura un revenu suffisant pour entretenir constamment à Alger deux trinitaires, qui se voueraient au soin des esclaves. Quand les musulmans virent le bien qui résultait de leur zèle, ils les chassèrent, avec défense de paraître dans la ville, si ce n'est pour le rachat. Mais rien ne décourageait les trinitaires, et ils s'efforçaient avec persévérance de soulager par tous les moyens les pauvres esclaves.
L'hôpital du père Sébastien Duport était bien étroit. Il fut agrandi, en 1611, par les pères trinitaires Bernard de Montroy, Jean d'Aquila et Jean de Palaccio. Les circonstances de ce fait méritent d'être rapportées.
En 1609, .noire province de Castille députe à Alger ces trois religieux; ils y rachètent cent trente-six chrétiens. A l'époque où ils allaient partir, des galères génoises capturent un navire algérien on se trouvaient beaucoup de jeunes gens, filles et garçons, qui accompagnaient dans ce voyage la fille de l'aga de Bône. Les parents des jeunes gens traitèrent de leur rachat avec les Génois; mais, au moment de s'embarquer, les captifs algériens ne se trouvèrent pas au complet ; il manquait une jeune fille de dix ans, qu'on ne pu retrouver, et qui était d'une famille riche. Ses parents, irrités, obtinrent qu'on empêchât le départ des trois religieux et des esclaves dont ils avaient conclu la rançon. Des janissaires jettent les trinitaires en prison, et remettent aux fers les esclaves; on les accable de travail, et l'on profère des menaces de mort, si la jeune fille n'est pas rendue. En vain ces chrétiens objectent qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire ; on le sait ; mais on espère, en les persécutant, recouvrer la Mauresque.
Depuis trois ans les religieux souffraient dans une horrible prison, lorsqu'on apprit que la jeune fille était en Sicile. Les parents députèrent quelqu'un muni d'un sauf conduit pour payer sa rançon. Mais Fatma, s'était faite chrétienne, et avait pris au baptême le nom de Marie-Eugénie.
- Marie-Eugénie déclare qu'elle est chrétienne et non musulmane, qu'elle rentrera en Afrique, mais à la condition que ses parents deviendront chrétiens comme elle. Et en attendant, elle les conjure de relâcher les religieux et les autres innocents qu'on persécute à cause d'elle.
La famille ne voulut rien entendre, et refusa l'argent qu'on offrait pour la rançon des religieux. On obtint seulement qu'ils passeraient de leur cachot au bagne du roi, où il y a une salle pour chapelle. Quelle joie ce fut pour eux d'y célébrer le saint sacrifice ! Les esclaves y viennent en traînant des fers qui ne leur permettent pas de fléchir le genou. Les pères annoncent la parole de Dieu. On chante avec larmes le Miserere. Le samedi, au soleil levant, on dit la messe en l'honneur de la sainte Vierge, et le soir, après la fermeture du bagne, on donne la bénédiction du saint sacrement, au chant des litanies. Les pères récitent l'office entier, administrent les sacrements, préparent les esclaves à la communion. On ne perd pas les occasions de gagner les indulgences. Le premier dimanche de chaque mois, on récite le rosaire et l'office de Notre-Dame. Le jour de l'Annonciation, il y eut cinq cents communions. Enfin, le pacha et le chef des gardiens du bagne autorisèrent les religieux à établir un hôpital de huit lits.
Une lettre du père Bernard de Montroy, adressée le 20 juin 1612 au provincial de Castille, nous révèle ces précieux détails. Frère Bernard continue :
" En ce petit hôpital, nous avons huit lits, à savoir, quatre de chaque côté, tous scellés dans la muraille à la hauteur d'un pied et demi. Les parois y sont nattées de joncs, les matelas de feuillage et de jonc encore, les couvertures et les mantes de pareille étoffe; et le reste de la garniture est fait de haillons qu'apportent avec eux les pauvres malades, à savoir, de vieilles jupes de drap et de serge toutes rapiécées, et de quelques caleçons. Au milieu de cet hôpital nous avons dressé un autel et des croix de notre ordre ; rouges et bleues.
" Un chirurgien espagnol prodigue ses soins aux malades. Les Turcs et les Maures s'étonnent à ce spectacle d'une charité inconnue chez eux, et l'admiration fait tomber de leurs mains des aumônes. On recueille les vieux esclaves abandonnés par leurs maîtres.
" Le jour des Rameaux et toute la semaine sainte sont dignement célébrés au bagne. Les marchands chrétiens se réunissent aux esclaves. Plusieurs, afin d'assister aux ténèbres, laissent le bagne se fermer sur eux, et ils y passent la nuit. Des captifs ajoutent une rude discipline volontaire à leurs souffrances forcées. Le jeudi saint, on expose le saint sacrement dans un oratoire orné de tapisseries prêtées par des Turcs et des renégats, et resplendissant des feux de plus de cent cinquante lampes ou flambeaux. Des Juifs et des Turcs assistent en silence au sermon. Le jour de Pâques, beaucoup d'esclaves viennent des campagnes. Les confessions et les communions sont nombreuses. Voilà, dit le père de Montroy, comment nous avons célébré la pâque en cette horrible prison d'Alger, dans laquelle, favorisés de l'assistance divine, nous prendrons en patience toutes sortes de travaux, jusqu'à perdre la vie pour la gloire de notre Dieu. "
Cette année fut affligée d'une grande sécheresse. Partout éclataient les lamentations. Le 28 avril, on rase la tête aux esclaves et on les charge de fer plus lourds : le ciel reste d'airain. Le 30, on bannit les Morisques, avec ordre de partir sous trois jours ; beaucoup ne s'en allèrent pas et furent massacrés : pas de pluie. Le 1er et le 2 mai, Turcs, Maures, marabouts invoquent le prophète, en criant et en faisant leurs ablutions dans les rues : peine inutile. On commande aux Juifs, une procession publique avec accompagnement de cris et la Bible en main : même résultat. On commence alors à demander que les babas soient privés de leurs chapelles. Les religieux se hâtent d'en mettre à l'abri les ornements. Le père de Montroy prie M. Viatz, consul de France, d'empêcher le pillage, et d'obtenir plutôt pour les chrétiens la permission de faire une procession comme les Maures et les Juifs. Le divan y consent. Les religieux font cette cérémonie avec les chrétiens esclaves et libres ; ils offrent le saint sacrifice et commencent une neuvaine. La pluie tombe dès le troisième jour, et le neuvième elle est plus abondante qu'il ne le fallait pour remédier au mal.
Néanmoins on ne délivra pas les trinitaires. Les parents de la Mauresque étaient d'autant plus aigris, qu'elle avait pris le voile dans un couvent de Sicile. Les trois pères moururent en captivité. Bernard de Montroy succomba le dernier, le 10 août 1622, à l'âge de soixante ans. Après la mort de ses compagnons, il avait été retiré du bagne et transféré dans une tour du château de l'Empereur, ainsi nommé parce qu'il fut bâti là même où Charles-Quint avait planté sa tente au déplorable siège de 1541. Le corps du moine fut jeté à la voirie ; mais les chrétiens l'ensevelirent, et dans la suite, ses os recueillis avec soin furent envoyés en Espagne par M. Viatz, du consulat de France.
Vers 1630, outre la chapelle de la Trinité, au bagne du roi, il y avait la chapelle de Saint-Roch, au bagne d'Ali Pichini, et celle de Sainte-Catherine au bagne de ce nom, Cette tolérance du culte chrétien de la part des musulmans était moins l'effet de leur bonne volonté pour les esclaves que de la crainte d'éloigner les marchands ; ceux-ci venaient acheter les produits du pays ou même les prises des corsaires ; disons toutefois que le roi de France interdisait aux négociants français ce dernier commerce. Les ornements des chapelles étaient assez beaux. Le sceau de celle de la Trinité, que l'on apposait aux actes de l'état religieux, représentait la croix de l'ordre des Trinitaires.
A Tunis, il y eut aussi plusieurs chapelles. La principale était celle de Saint-Antoine, où le consul français entretenait des chapelains. On avait là plus de liberté qu'ailleurs. Tripoli avait aussi une petite chapelle ; mais elle ne possédait pas toujours de prêtre pour y célébrer. Salé était dépourvue de local consacré au culte. Dans les matamores, on dressait des autels en forme de tables. Quelques images de papier formaient la décoration des murailles. Soir et matin les esclaves faisaient la prière et chantaient les litanies de la sainte Vierge.
A Alger, les chapelles payaient, de l'aumône des marchands et des esclaves, une redevance au messouar, officier de police et bourreau. Elles n'étaient pas suffisamment préservées des profanations sacrilèges des Turcs. Le 11 septembre 1634, le père Infantine disait la messe en celle du bagne du roi. Le messouar entre et jette le trouble dans l'assemblée. Le père se hâte de consommer l'hostie. Mais le messouar saisit le calice, le verse, abat la croix, bouleverse les ornements et se retire. Il prétendit qu'on ne le payait pas. C'était faux ; mais il fallut payer de nouveau sans se plaindre.
Outre les chapelles des bagnes, il y en avait d'autres dans la maison des consuls. Elles étaient comme la paroisse des chrétiens libres. Celle d'Alger était sous le titre de saint Cyprien, évêque de Carthage, et celle de Tunis, sous l'invocation de saint Louis, roi de France. On y célébrait le culte avec toute la solennité possible, et sans craindre là d'offenser les musulmans.
- Comment pouviez-vous, révérend père, demanda Carlotta, porter le viatique aux mourants hors des bagnes et du consulat ?
Nous suspendions à notre cou une petite boite d'argent doré qui renfermait l'hostie, nous mettions sur la robe une petite étole, et nous avions soin de tout cacher sous notre manteau. Un chrétien marchait devant avec le rituel et de l'eau bénite aussi cachés. A Alger, nous défendions aux esclaves de nous suivre.
Mais il n'y avait pas le même péril à Tunis, et les prêtres qui allaient donner le viatique ne saluaient personne ; les chrétiens qu'ils rencontraient comprenaient ce signal et faisaient escorte à notre Seigneur.
A l'hôpital du Beylik d'Alger se rattache le souvenir du père Pierre de la Conception. Il quitta le monde afin d'embrasser la pénitence et de prendre l'habit des trinitaires. Il mendia au Pérou pour le soulagement des esclaves, et du produit de ses aumônes il racheta des captifs et répara l'hôpital d'Alger. Emporté par un saint zèle, il entra un jour dans une mosquée et se mit à prêcher le crucifix à la main. Ses amis essayèrent en vain de le faire passer pour fou. Les Turcs le brûlèrent à petit feu. Pendant le supplice, qui dura six heures, il annonçait l'Évangile et chantait les hymnes de l'Église. Ses ossements furent jetés à la mer. Les chrétiens ne purent dérober aux flots qu'un os de la jambe. On le gardait à l'hôpital du Beylik.
Les femmes n'étaient pas reçues à cet hôpital. On les soignait chez elles. Les esclaves n'y entraient et n'y recevaient de remède violent qu'avec la permission de leurs maîtres. Trois religieux y remplissaient les charges d'administrateur, de médecin et d'apothicaire. En 1700 ses revenus n'étaient que de dix mille francs. Pour les augmenter, on soumit à un droit de trois piastres les bâtiments chrétiens qui entraient au port d'Alger. Chaque soir, à la chapelle, la prière se faisait en commun.
Dans les autres bagnes, il y eut aussi quelque coin réservé pour les malades ; car l'hôpital du Beylik était insuffisant. Peu à peu des autels furent dressés dans chacun des bagnes principaux, et les prêtres esclaves obtenaient de leurs maîtres, à prix d'argent, la faculté d'y célébrer la messe. Cet argent leur venait communément des esclaves eux-mêmes. Ceux-ci prenaient sur leur petit pécule et sur les aumônes qu'ils recevaient des marchands chrétiens, auxquels ils présentaient une petite croix à baiser. Vous pourriez voir à Lyon, dans la salle du conseil de la Propagation de la Foi, un crucifix qui, pendant longues années, servit à administrer les esclaves mourants.
Sans doute, nous ne déployions pas une pompe magnifique dans nos cérémonies; mais aux jours des grandes fêtes de l'Église, la ferveur des esclaves, les saints cantiques chantés d'une voix où respirait la joie intérieure, que le chrétien ne perd pas dans l'infortune, nous donnaient les plus douces consolations, et sous la voûte pesante de la prison je me trouvais aussi heureux, je sentais notre divine religion aussi grande que sous la coupole de Saint-Pierre de Rome.
Une autre consolation fut accordée aux chrétiens depuis la fin du XVIème, siècle, ils obtinrent du pacha le droit d'acquérir un cimetière. Il était au pied de la colline, à Bâb El-Oued, et comme la mer, empiétant sur les grèves, menaçait de le détruire, on en transporta les ossements, en 1845, au nouveau cimetière établi plus loin vers le couchant. Que de restes sacrés furent réunis alors ! Car c'était là que les chrétiens ensevelissaient autrefois les martyrs, lorsqu'ils pouvaient enlever les corps aux bourreaux.
L'origine de ce vieux cimetière nous faisait regretter aussi cet abandon selon la tradition, un capucin, confesseur de don Juan d'Autriche, est fait prisonnier par un des navires algériens qui échappent en 1571 à la défaite de Lépante. Il reçoit bientôt de ce prince une somme considérable pour son propre rachat. Mais gémissant sur le sort des chrétiens abandonnés sans sépulture, comme des animaux immondes, le moine renonce à la liberté, et il offre au pacha cet or en échange d'un terrain où pourront, après leur mort, dormir à l'abri de la profanation ses compagnons d'infortune. Il eut donc sa place dans cette terre trois fois bénie, et que l'on a nommée le cimetière des Consuls. La solide muraille dont elle était ceinte avait été bâtie par les représentants des nations chrétiennes, qui y contribuèrent chacun pour deux cents douros ou mille francs. La tradition que je rapporte a été modifiée en ce qu'on a aussi attribué l'œuvre héroïque du capucin au dévouement d'un évêque espagnol. A Tunis, dés 1630, il y avait également un cimetière chrétien, près de la chapelle Saint-Antoine. Il en était de même à Salé, hors la porte de la Mamoure. A Tripoli, on enterrait les esclaves çà et là.
Les funérailles étaient bien modestes, vous pouvez le croire. Deux esclaves portaient le corps sans drap ni suaire et mis avec ses haillons dans une bière commune ; qui ne descendait pas dans la fosse avec le cadavre. Les renégats, les Turcs, les enfants jetaient au convoi des injures, des pierres et de la boue. Quelques esclaves suivaient de loin. Il n'y avait ni croix ni eau bénite. Parfois un prêtre attendait au cimetière pour y réciter les dernières prières. Mais que de fois aussi les Turcs, irrités sur un simple bruit, ne prenaient-ils pas le corps pour le tramer par la ville, où chacun l'insultait et le mettait en lambeaux !
- Révérend père, reprit Mme Morelli, en donnant le signal de se retirer, les regrets que vous manifestez sur la translation de l'ancien cimetière sont bien naturels, et nous les partageons. Mais pour les adoucir, nous irons prochainement prier sur cette terre sacrée, dans la nouvelle enceinte qui la renferme. Le cimetière d'Alger doit être à nos yeux doublement béni : c'est un campo santo que les pays les plus anciennement catholiques pourraient nous envier. "
A SUIVRE
|
| "Li courbou et li chacaille"
| |
Voici une fable en sabir enregistrée par M. Robert Vaillant.
Il est Philippevillois, il recherche Robert PAPALARDI fils de cheminot comme lui, ils se sont connus aux colonies de vacance des Chemin de Fer Algérien et ils ont passé trois ans à Bouzharéa orphelinat des C F A;
Si quelqu'un peut l'aider, par avance merci.
Pour écouter cette fable, cliquez ICI
|
|
|
|
| Pour nos chers Amis Disparus
Nos Sincères condoléances à leur Familles et Amis
|
Par J.P. Bartolini
Décès de M. SAKRAOUI
"Chers(es) amis (es),
C'est avec tristesse que je vous fais part du décés d'un ami, M. SAKRAOUI.
Il est parti pour un monde dit meilleur le 26 novembre 2010 où j'espère il regardera son sport favori, le Foot, avec la passion dont il a fait preuve pendant des années jusqu'à son jubilé il y a trois ans.
Joueur à l'ASB, où je l'ai connu quand j'étais minime, puis je l'ai retrouvé à Perpignan quelques années plus tard.
A chacun de mes voyages à bône, je l'ai revu avec plaisir et dernièrement encore où nous avons fait un bout de chemin ensemble du Cours bertagna au Majestic où il demeurait à coté.
Paix à toi, mon Ami
Jean Pierre
Mon Adresse : Jean Pierre Bartolini
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
De Mme Nicole Marquet
Bonjour
Dans le bulletin joint à l'"Algérianiste", il y a des notices nécrologiques, dont celle de Yves Pleven, rédigée par Pierre Dimech.
Il raconte un voyage en Californie, où Yves Pleven l'a amené sur la plage de Sante Monica, pour lui montrer une statue à "celle qui a donné son nom à cette plage : Sainte Monique, mère de Saint-Augustin".
J'ignore s'il existe une photo, mais cela montre que, même au bout du Monde, on trouve des "Bônois"..
Amicalement, NIcole.
P.S. : Si quelqu'un possède une photo de cette statue sur la plage de Santa-Monica, nous serions heureux d'en avoir un exemplaire. Merci d'avance
Mon adresse : jean-pierre.bartolini@wanadoo.fr
De M. B. Rigoutat
Bonjour
Internaute depuis peu j'ai eu le plaisir de "voyager" sur le site de Böne qui fut ma ville ou ma famille est née je recherchais des vues de l'Orangerie où mes grands-parents résidaient, de la rue Maillot c'est vrai que l'on ne peut pas tout avoir et ce qu'il y a est déjà bien celà nous permet de nous "souvenir".
Si par hasard quelqu'un en avait, je ferai voir ces images à ma maman qui à 87 ans, cela lui fera plaisir.
Merci infiniment,
Mon adresse : B. Rigoutat
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
| |
| La pauvre dame et l'intrus !
Envoyé par Chantal
| |
Un beau matin une petite vieille dame va voir lorsqu'on frappe à sa porte.
Elle y découvre un jeune homme, bien habillé avec un aspirateur à la main.
"Bonjour madame, dit le jeune homme. Si vous avez une minute je vais vous montrer ce nouvel aspirateur, haute technologie, qui aspire sans comparaison"!
Allez-vous en, lui dit-elle, je suis fauchée. Et elle tente de refermer la porte.
Aussi rapide qu'un éclair, le jeune homme met son pied pour coincer la porte ouverte.
Il rouvre la porte et s'exclame: "pas si rapidement, madame, pas avant que je vous ai fait ma démonstration".
Sur ce, il vide un sac plein de fumier de cheval sur le tapis.
"Maintenant, madame, si mon aspirateur ne nettoie pas la totalité de ce tas de fumier, je m'engage à manger ce qui en restera!"
La vieille dame recule et lui dit: " Je vais vous chercher une fourchette, monsieur. Ils ont coupé mon électricité ce matin parce que je n'ai pas payé ma facture".
|
|