|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Cet Ecusson de Bône a été généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint |
|
|
|
EDITO
LA SEYBOUSE, une aventure Humaine

Chers Amis,
C'est vrai la Seybouse est au départ une véritable aventure humaine partie d'une petite idée toute bête qui consistait en une brochure Internet de 4 pages pour annoncer les nouveautés du site de Bône.
Au fur et à mesure que les mois passaient, cette idée a fait son chemin et a grandi avec l'appui des premiers lecteurs et supporters. Depuis son origine, la Seybouse a diversifié les rubriques pour répondre aux besoins et désirs de ses lecteurs.
Pour la Seybouse, l'avenir se confond avec celui de ses lecteurs et amis. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis. La disponibilité de ses collaborateurs, leur liberté de ton, leur caractère humain, le respect et l'attachement aux valeurs de nos communautés et de leurs mémoires, le libre échange des données, documents ou photos ; constituent des atouts indéniables au succès de la Seybouse.
Plus de 9 ans de vie et d'expérience sur Internet, ont fait de la Seybouse un partenaire Historique des Pieds-Noirs ; des écoles et universités qui y puisent du savoir ; des journaux et magazines papier qui y trouvent de la matière ; des milliers de gens à travers la France et du Monde qui arrivent par curiosité et suivent par intérêt et fidélité notre Gazette.
Chaque mois, la réception d'un volumineux courrier auquel je ne peux faire face en totalité ; des photos et documents ; contribuent à la vie et à la pérennité de la Seybouse.
Depuis toutes ces années, la Seybouse a une vision de service public dont le principal but est la sauvegarde de notre trésor patrimonial qui est la mémoire afin de la faire connaître par la diffusion sans aucune retenue.
La Seybouse est une Gazette mensuelle totalement gratuite et libre, sans attaches politique, associative ou publicitaire commerciale. Elle ne vit qu'avec ses propres moyens financiers et sans en tirer aucun bénéfice pécuniaire.
Cette totale indépendance, la Seybouse la revendique et elle en a payé le prix. Elle est la garantie indispensable dans la mission qu'elle s'est imposée vis-à-vis de la mémoire et de la vérité. En effet, seule l'indépendance gage la liberté des opinions par le parler, le penser et l'objectivité des articles. Elle permet toute transparence et impartialité.
Plus que jamais, la Gazette continuera à jouer le rôle de trait d'union entre les communautés et les générations, et tentera de communiquer au plus prés avec le courrier des lecteurs.
La Seybouse fera en sorte que 2011 soit un grand cru. La plupart des analystes sont d'accords pour dire que les journaux papiers arrivent à leur terme, donc à fortiori ceux des associations. Même, si j'ai de plus en plus de demande pour faire de la Seybouse une revue papier, je ne pourrai pas le faire car cela demande des moyens financiers que je n'ai pas et une organisation commerciale dont il serait hors de question à mon age de retraité.
La Seybouse a été très heureuse de vous accompagner au cours de l'année 2010 et espère vous avoir été utile.
Se fait-on trop vieux pour apprécier ces occasions spéciales du temps des fêtes? Le jour de l'An annonce le changement de chiffre comme un changement de chiffre sur notre âge.
Alors, ça change quoi, à vrai dire? Personnellement, j'aimerais festoyer, même humblement entre amis (es) et où la famille a aussi son importance.
Au seuil de 2011, beaucoup d'entre vous ferons la fête, d'autres seront dans la peine, certains ne sauront pas quoi faire et j'en profite pour vous citer un passage de l'Evangile par LUC: "Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste".
En vous laissant méditer sur la sagesse de cette parole, je vous souhaite les meilleures fêtes possibles, les meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité, et j'aurais grand plaisir à vous retrouver dès le prochain Numéro pour de nouvelles lectures.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
P.S. Comme je le dis plus haut, il m'est actuellement impossible de faire face au volumineux courrier et je prie tous les lecteurs, qui m'envoient des messages, de m'en excuser. J'essaie de répondre aux messages urgents et importants. Certains lecteurs pensent que j'ai la science infuse sur l'Algérie, non, je suis un jeune retraité qui est parti à l'age de 15 ans ; qui ne détient pas toutes les archives que les associations gardent jalousement dans des armoires ou placards (tout cela serait mieux utilisé sur nos sites Internet P.N. si elles étaient mises à notre disposition gratuitement) ; je ne connais pas tous les habitants de Bône et encore moins ceux de toute l'Algérie ; je ne détiens pas les registres des cimetières ou de l'état-civil de chaque ville ou village ; je n'ai pas fait la guerre ou les guerres pour ceux qui pensent que j'aurai 150 ans et qui me demandent si j'ai connu leur aïeul qui a fait la guerre de 1870. Et oui, ça arrive !!!!
Je ne suis qu'un simple bénévole qui fait, par ses seuls moyens, ce qu'il peut avec ce qu'il a ou ce qu'il reçoit. Et croyez-moi, cela demande énormément de temps.
La Seybouse est à la disposition de chacun pour passer des messages. Bien sur, la Gazette ne veut pas être un mouchoir de papier que l'on jette sans ménagement après utilisation comme le font certains qui me demandent de passer un message avec leurs coordonnées et qui après avoir obtenu satisfaction exigent le retrait de celles-ci en me menaçant de poursuites ou en m'insultant parce qu'ils reçoivent des spams.
Les spams sont générés par la navigation sur Internet sur des sites qui sont pourvus, truffés de fichiers espions et de publicités visibles ou cachées et qui, par des robots, trouvent sur vos P.C. vos adresses IP, toutes vos coordonnées, vos carnets d'adresses et parfois même plus.
Les spams sont aussi alimentés en adresses par tous les inconscients qui font parvenir à leurs correspondants des dizaines de messages journaliers avec des PPS (qui ont fait cent fois le tour du monde) et en laissant visibles les adresses de tous leurs correspondants.
Les sites de Bône et de la Seybouse sont totalement dépourvus de fichiers espions et de publicités visibles ou cachées. De plus mon carnet d'adresses n'est pas visible dans mes messages.
C'est pour cette raison qu'à partir du 1er janvier 2011, tout message qui sera passé sur la Seybouse devra être accompagné de coordonnées d'identification et de localisation de la personne qui en fait la demande et qui seront obligatoirement insérées dans la Gazette sans avoir la possibilité de les faire retirer. Toute demande devra être suivie de confirmation et en accepter cette règle.
Je vous remercie d'avoir lu cette petite mise au point dans ce post-scriptum.
J.P. B.
|
|
| Noël : Une étoile
Auteur : Danielle Sciaky
Envoyé Par Adine
| |
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard
pour un peu de lumière
dans le cœur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d'écoute
pour un peu de chaleur
dans le cœur de ceux
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée
par quelques mots
d'encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s'unissent.
Une étoile de parfum
pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu'à toi.

Aprés avoir écouté ou écourté la chanson d'Allibert, vous pouvez cliquer ci-dessus sur la Crêche de Saint-Augustin et regarder une vidéo "des Noëls d'autrefois par Georges Blanés".
ou sur :Noëls d'autrefois
|
|
|
| Ahè! toi,
De : Rachid Habbachi
|
Que t'y es en Patosie,
En Andalousie et même en Papouasie,
Què c'est ça qu'aujourd'hui, je peux t'le dire,
Ça qu'au moins tu peux t'le lire,
C'est que, toujours aux mêmes dates,
Impossibe, tu t'les rates,
T'y as deux évènements
Qui te reviennent tout l'temps
Et tout l'temps, c'est la même chose,
Je t'les enveloppe en dedans du rose
Pour te dire à toi et à tous les tiens
De ma part à moi et aussi des miens
"Que joyeuse, elle vient ta Noëlle,
Que ton année elle te vient belle
Et pleine de cette douceur
Qu'on s'l'appelle aussi le bonheur
Avec, la sané et à la pelle, beaucoup d'l'argent
Comme ça, à Bône tu viens tout l'temps.

|
|
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LA LION Y LA PITITE MOCHE
[FABLE IMITÉE DE LA FONTAINE]
Vatan, in al oualdik (1), bogri di salopri.
Ci comme ça qui barli, afic one pitite moche
La lion di désert. - " Ji ti touille si t'abroche,
Ispice di gran salti, qui bout li chiane pori."
La pitite moche y riste, y loui di : " Quisqui-ci,
Ji crois qui j'en a I'droit por passir par ici.
Barc' qui vos ites lion, li fir tone malin,
Ji ni bas por di toi, ji marche dans cit chimin,
Y si bor fir blisir, ti vo fir one bataille
Ji ti casse ton figour, bogre di gran canaille.
Moi ji mi fot di toi barc' qui ji ni bas por,
Y qui pit être one bof est blous qui toi millor.
Ji fi quisqui ji vo, tojor il y contan,
Mi toi ti fir mariol, moi ji di fot moi l'camp."
La lion y s'mittra tot à fit en colère,
Ma la pitit moch y vol bor piquer son darrière,
Y bossi sor son tit', y lui piqué son nez.
La lion y corir, pas moyen l'attraper,
Alors blous en colère y si mit à crier.
To li monde il a por ; li moton son caché,
Li chian y son trembli, li chacail son faché,
Li zoizeaux son voli et li pol y si coche.
Y quisqui fir to ça ? cit one petite moche,
Qui son fir la bataille, afic la lion noir.
Ci loui là son ragi, barc' qui po pas la voir,
Qui cour, qui soute bar tout, y po pas l'attrapi
Y qu'afic son queue, loui mime y sa frapi
Bar tir il y cochi, afic son zio farmi
Enfin ji crois la lion, tot à fit esquinti.
La moche y son contan, y rire comme one folle
Y por fir fantasia, to di souite y s'envole ;
Ma y son attrapi bar on p'tit' zoizeau noir,
Qui li mange bian contan ; son fini cit histoir.
MORALE
Si divan li cadi, ti gagni ton broci,
Afic one Bachagha, ou bian on zraélite,
Pas bizoan mon zami, di chanti vot' socci,
Barc' qu'Allah il y gran, Mohamed ji brofite..
1) Maudits soient ceux qui t'ont mis au monde.
| |
|
LE MUTILE N° 192, 8 mai 1921
|
Les Veuves du Conseil de Guerrec
COMMENT ON RÉPARE
Nous reproduisons l'article ci-dessous, parce qu'il explique d'une manière magistrale l'injustice dont sont victimes les veuves des condamnés à mort, par les Conseils de guerre. Nous avons toujours demandé pour elles le droit à pension. Notre voeu n'a jamais été pris en considération. Au moment du vote de la loi du 31 mars 1919 la question avait été discutée sur un amendement de M. Aristide Jobert et rejetée par 346 voix contre 154.
Avec les trop nombreuses erreurs judiciaires qui se découvrent chaque jour, il est de toute urgence que 1a législation se modifie sur ce point. D'ailleurs les tribunaux de révision commencent à compenser la sévérité incompréhensible de la loi : témoin ce jugement que nous reproduisons ci-dessous et qui a servi de thème à l'article du Radical, paru sous la signature de M. Ch. Fromentin.
La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, a rendu son arrêt dans l'instance en révision introduite au nom des six soldats condamnés à mort, et Fusillés en décembre 1914 à Vingré, pour abandon de poste devant l'ennemi. Conformément aux conclusions, de M. Depeiges, avocat général, la Cour a cassé et annulé le jugement rendu en décembre 1914 et déchargé la mémoire des condamnés de la condamnation prononcée contre eux. Elle accorde, en outre, une pension annuelle de 2000 francs à chacune de leurs veuves, pension qui trouve son point de départ en décembre 1914, et une pension annuelle de 1.000 francs, jusqu'à leur majorité, à chacun des trois enfants de l'un des condamnés, réversibles, en cas de décès de l'un des enfants,'sur la tête des deux autres.
Un héro anonyme, dort sous l'Arc de Triomphe ! Il dort dans les plis du drapeau, dans la gloire, dans 1'Eternité. La foule s'est inclinée pieusement devant son cercueil, et l'armée française, conduite par trois maréchaux a salué celui qui n'aura pas de nom dans l'Histoire, mais rappellera la fidélité au devoir et à l'honneur.
Je sais six autres héros - un caporal et cinq soldats - qui n'eurent jamais cette apothéose ; leurs noms ne sont pas inconnus ; ils figurent au greffe d'un Conseil de guerre, et quand les troupes passèrent, devant eux, ce ne fut pas pour leur rendre hommage, mais pour les fusiller. Ils n'ont pas, pour abriter leur dernier sommeil, une voûte de pierre glorieuse, mais ils gisent en tas dans le coin d'un cimetière abandonné ; s'il y a quelques fleurs sur le tertre qui les recouvre, ce sont celles que la nature, moins oublieuse que les hommes, fait pousser au printemps.
Ce sont les victimes de la justice militaire, toujours prompte à punir, toujours lente à réparer. C'es six poilus furent accusés, le 3 décembre 1914, d'avoir été des tâches devant l'ennemi et condamnés à mort. Le 29 janvier 1921, la Cour de cassation a été d'un avis contraire : ces tâches étaient des héros qui avaient obéi à une consigne. Seulement, ils ne sont plus là pour assister à leur réhabilitation : depuis plus de six ans, ils sont tombés unis les balles françaises, le déshonneur et la honte se sont injustement accumulés sur leur tombe parce qu'un, colonel et quelques officiers pressés n'ont pas eu le temps d'écouter leur conscience. Ce fut une erreur, dit-on, et là s'arrête l'oraison funèbre !
Pendant ce temps, il y a des veuves et des orphelins qui pleurent, martyrs d'une iniquité qui fut longue à découvrir et ne sera jamais punie. Pendant six ans, le nom qu'ils portent a été Sali par l'injure et la calomnie. L'arrêt odieux du Conseil de guerre les avait pour ainsi dire mis en quarantaine. Certes au village de Vingré, on savait que les six condamnés étaient innocents, la preuve en avait été faite, mais la Justice civile qui, elle, ne juge pas au débotté comme l'autre, était lente à peser le mensonge et la vérité. Et dans la région, il y avait des gens qui croyaient encore à la lâcheté du caporal et de son escouade.
Aujourd'hui, c'est fini : les soupçons sont dissipés ; c'est la réhabilitation et la revanche ! L'honneur des six fusillés est intact il n'y à plus qu'à honorer et à fleurir le 'coin de terre où dorment des innocents. Mais la Cour de cassation, généreuse sur la question, d'honneur, l'a été beaucoup moins quand il s'est agi de réparer le mal matériel et moral. A la demande d'indemnité formée par les veuves, elle a répondu par 'un geste d'aumône. On lui demandait un capital qui aurait assuré un peu de bien-être aux orphelins ; elle a parcimonieusement accordé de quoi ne pas mourir de faim. Avec une pension de deux mille francs sur chaque tête et une Médaille sur chaque tombe, l'état sera, quitte de toute responsabilité.
Une erreur épouvantable aura apporté la misère, le deui1 et la honte à d'humbles foyers ; pendant six ans, des femmes, des enfants auront connu les pires angoisses et subi les plus humiliants affronts. Six pères de famille auront été conduits au poteau d'exécution et fusillés comme des déserteurs, alors qu'en bons poilus ils avaient fait leur devoir. Or, tant de douleur, de tristesse et d'injustice sera soldé au rabais, à peine ce que représente dans un ministère le traitement d'un sous-chef de bureau,
L'erreur d'un Conseil de guerre qui fait des orphelins et des veuves coûte moins cher qu'un accident d'auto qui fait un boiteux.
C. FROMENTIN.
©§©§©§©§©§©§©
|
|
AVENIR DE L'EST
Extraits des chroniques
du Journal de Bône, Constantine, Guelma
Source BNF
|
|
Bône, du 1 au 9 Janvier 1891
CHRONIQUE LOCALE
QUERELLE DES BRUNES ET DES BLONDES
Voici l'épître que nous adresse Melle Georgette en réponse à celle de Melle Lucia établissant la prééminence des brunes sur les blondes :
" La beauté prise dans son ensemble peut aussi bien être attribuée aux brunes qu'aux blondes. Ces dernières aiment avec abandon, trop d'abandon même. Les brunes ne se prodiguent pas, elles se ménagent et, par conséquent, s'usent moins vite. Sous leurs grâces félines se cache beaucoup de prudence et d'adresse, parfois même de l'astuce.
" Il y a beaucoup plus de naïveté chez les blondes.
" Les qualités du coeur sont variables.
Les beautés mythologiques, que l'on prend souvent pour types, en donnent de nombreux exemples
" Vénus, la blonde, très jalouse, accordait ses faveurs à tous les dieux. Minerve, qui était blonde, personnifiait la sagesse, la vertu et le courage.
" Junon, blonde aussi, obligeait Jupiter, lorsque, entouré de ses foudres, il montait sur sou trône, à porter une couronne fermée par le haut pour qu'on ne vit pas les deux cornes de taureau qui ornaient son front.
" C'est en ce moment que, sur le doux Olympe, Junon et Mercure échangeaient un coup d'oeil d'intelligence avec un sourire ironique.
" Pénélope, la blonde Pénélope, ne voulut pas se remarier, malgré l'absence prolongée d'Ulysse et le grand nombre de poursuivants qui aspiraient à sa main.
" Mais je pense qu'une trop longue énumération pourrait bien vous ennuyer. Je remets donc à lundi prochain !a suite du parallèle. Georgette.
AVIS.
- Un examen pour l'emploi de géomètre eu chef du cadastre du département de la Haute-Savoie, aura lieu à Annecy, le 21 février 1891.
Les candidats trouveront auprès de M. le Directeur des contributions directes du département de Constantine tous les renseignements relatifs aux conditions de l'examen et aux pièces à fournir à l'appui de leur demande d'admission.
LA NEIGE SUR L'EDOUGH.
- Après les deux journées de pluie battante que nous venons de traverser, la température, quoique très supportable en ville, s'est sensiblement abaissée.
L'Edough a recouvert son manteau d'hermine qui descend jusque sur collines très rapprochées de la ville.
Ce matin, à la première heure, l'aspect de la montagne toute couverte de neige était des plus imposants.
?o?-?o?-?o?-?o?
|
|
PHOTOS DE VIE BÔNOISE
Envoyé par M. divers donateurs
|
Envoi de M. Robert Léon
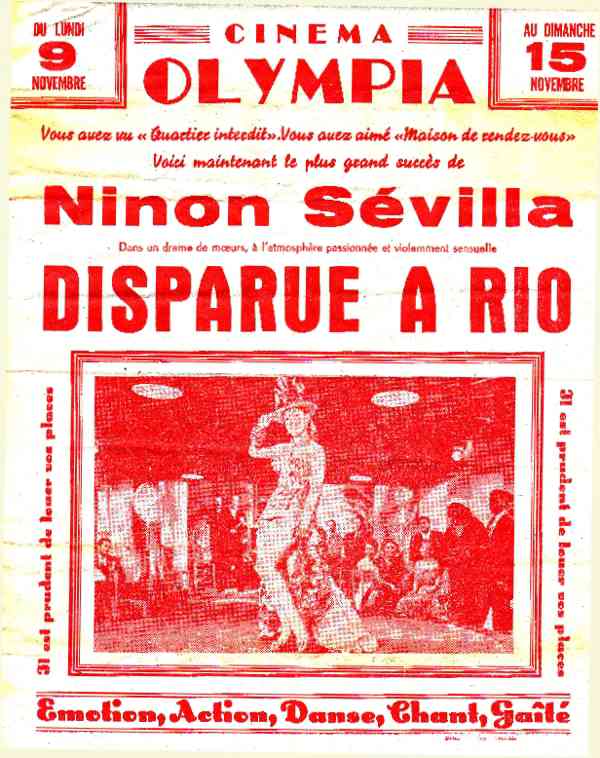 Une affiche de cinéma de l'Olympia à Bône
Une affiche de cinéma de l'Olympia à Bône
Envoi de M. Marius Longo
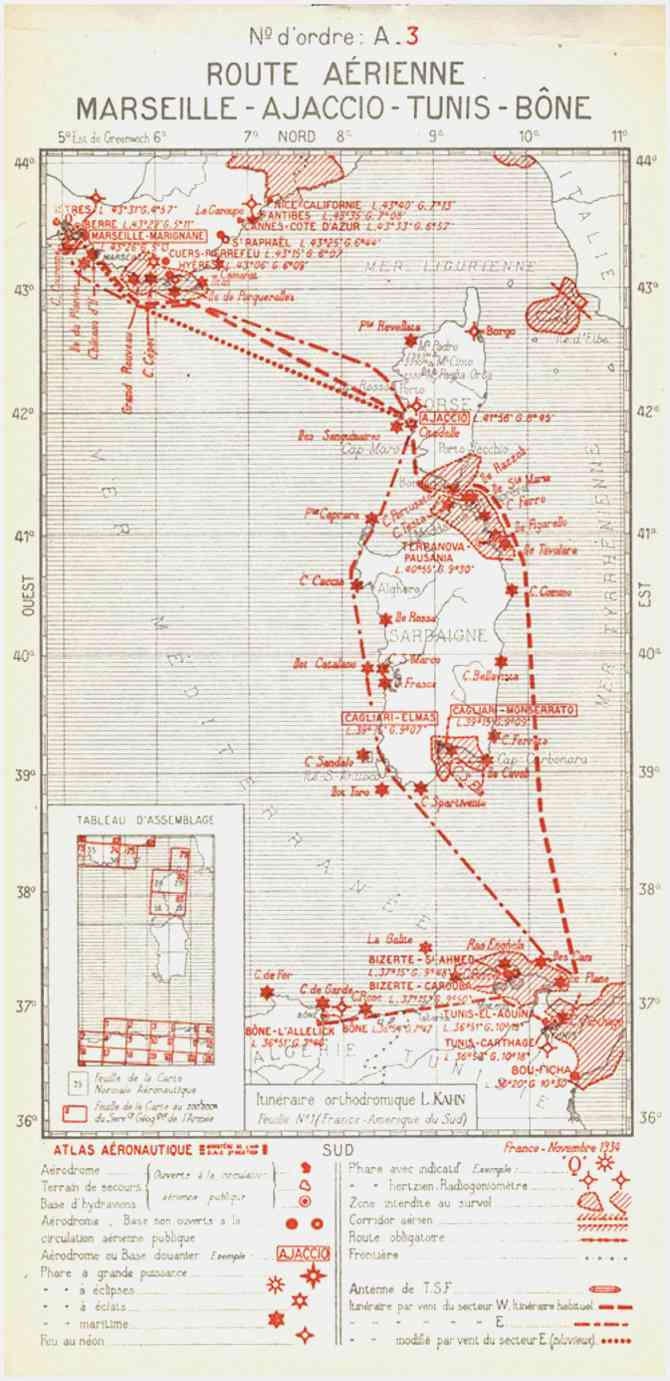 Carte trajet aérien Marseille - Bône
Carte trajet aérien Marseille - Bône
Si quelqu'un peut nous dire d'où elle vient
et s'il en existe d'autres
Envoi de M. Christian Camilleri
 Les inondations de janvier 1962
Les inondations de janvier 1962
Envoi de M. Georges Bailly
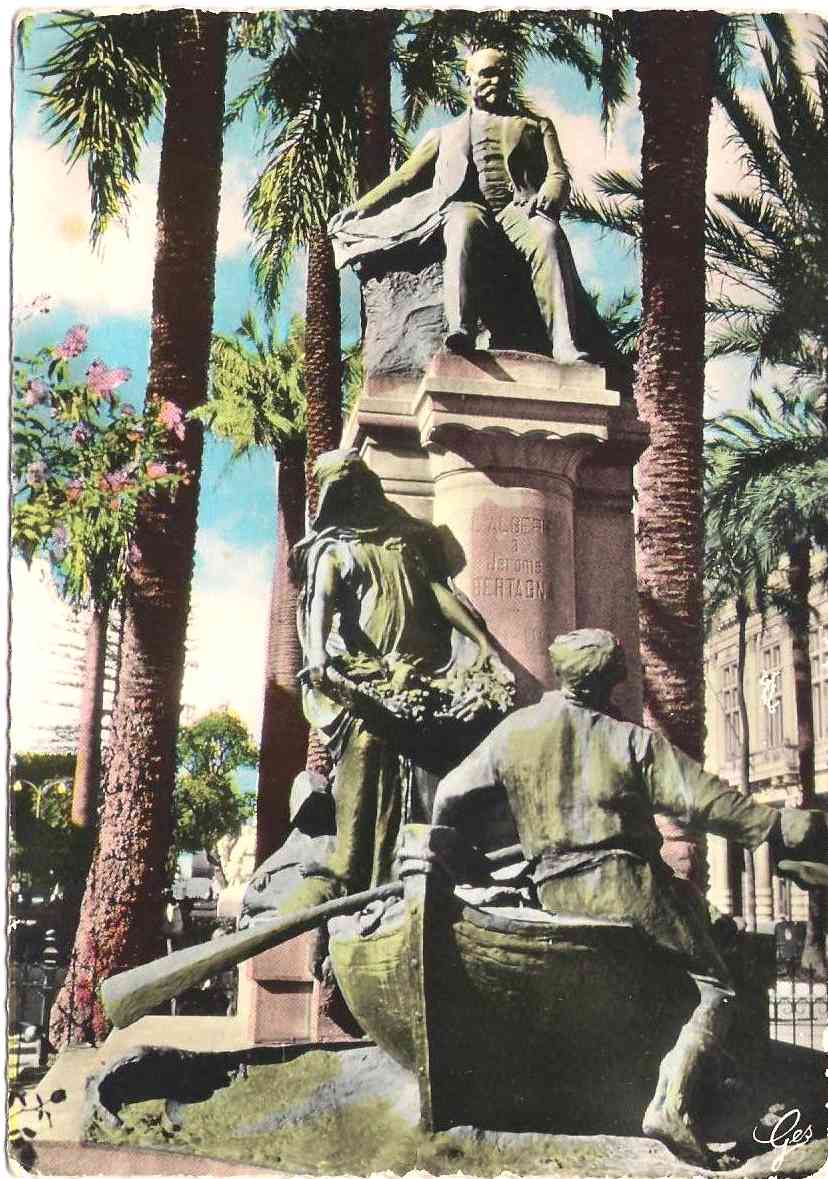
 Statues de J. Bertagna et de la Diane Chasseresse
Statues de J. Bertagna et de la Diane Chasseresse
dans le Jardin de la Liberté à Bone
|
|
PHOTOS D'ECOLE
Envoyé par M. Charles CIANTAR
|
|
LYCEE SAINT-AUGUSTIN
1ère 1955/1960 (Modifications/photo de M. André Gabard)

1 J. Floirat - 2 Mattéï - 3 Beugnot - 4 J.P. Manzo - 5 G. Lecoy - 6 J. Gaches - 7 M. Gau - 8 E. Blasi
9 Stella - 10 Dron - 11 D. Ruggiu - 12 A. Ferry - 13 Ranfraing - 14 A. Gabard - 15 B. Gauchi - 16 R. Vento - 17 Frulio
18 A. Bruntz - 19 G. Pisani - 20 Doulé - 21 Strini - 22 G. Sauvaire - 23 Schembri - 24 Ciantar B.- 25 P. Casimir - 26 J.C. Lastes
27 Calamia J.B.- 28 Battista - 29 Tellier - 30 M. Schneider - 31 Zanca - 32 Morin - 33 Faïn
Photo envoyée par M. André GABARD
ECOLE de l'ORANGERIE
Cours Moyen 1ère année 1950/1951
 Instituteur Mr Oberdoff
Instituteur Mr Oberdoff
1- Belkala, 2- Chaker, 3- ?, 4- Jardino, 5- Bouatit, 6- ?, 7- ?, 8- Orlando,
9- Toro, 10- Portelli, 11- ?, 12- Migliasso, 13- Toro ?, 14- ?, 15- Monti,
16- Maisonneuve, 17- Sorbara, 18- Farrugia, 19- Onorato, 20 Del Gado, 21 ?, 22- Albaneze, 23- Aïello, 24- Rubini
25- Sant, 26- Ciantar, 27- Schmid, 28- Sudre, 29- Portelli
|
|
LA CAROUBE
par M. Charles Ciantar
|
La Caroube ou Plage Fabre est située au nord de Bône. C’était une petite plage abritée des vents dominants, dans la baie des corailleurs, qui en faisait un port naturel.
Elle était presque enfouie dans la verdure. De la route, on ne voyait que très peu du sable de la plage, tout près d’une ancienne batterie édifiée là, à grand frais, par le génie militaire et pourvue de toutes les caractéristiques moyenâgeuses des anciens châteaux fort : fossé, pont-levis, redans et créneaux.
Elle se nommait aussi la plage « Fabre » parce que Mr Florian Fabre, industriel et Conseiller Général, qui possédait les terres environnantes avait fait construire une maison agréable et des bâtiments de ferme, sur le bord de la mer, à l’ombre des grands pins parasols.
Les macaronades des lendemains d’élections d’autrefois qui, avaient inéluctablement la Plage Fabre pour cadre ne sont plus qu’un souvenir pour les vieux Bônois.

La plage était un centre important de pêcheurs typiquement. Bônois peu soucieux de la précarité de leur installation et qui dormaient dans des barques ou sur des filets mis en tas. Le poisson de la caroube avait une très bonne renommée auprès de la population de la ville.
La plage leur servait à étendre les filets sur le sable pour les faire sécher et par la même occasion de les remailler quand la maille était déchirée.
Et bien sûr, il y avait de gros chaudrons sous lesquels on allumait un grand feu pour faire bouillir de l’eau avec du tanin. Les cordeaux, filets, palangres étaient trempés dans cette préparation afin de le rendre moins perméables à l’eau de mer et par conséquent plus résistants.

La plage vers

LE FORTIN

La caroube au début sans la tonnelle de St Michel et avec quelques cabanons

Chapelle de St Michel Patron de la plage.
Chaque dimanche il y avait un office sous la tonnelle



Plage du côté du fortin
L’équipe de l’OCB - Olympique Caroube de Bône

Charles Ciantar
| |
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793) (N°3)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
PREMIÈRE PARTIE
LES ORIGINES (1560-1635)
CHAPITRE II
LA FONDATION DÉFINITIVE DES CONCESSIONS:
RICHELIEU, LE DUC DE GUISE
ET SANSON NAPOLLON
(1626-1633)
L'arrivée de Richelieu au pouvoir allait changer la face des affaires, et c'est en grande partie à sa puissante intervention et à son initiative, partout en éveil, que les Marseillais allaient devoir la fondation définitive des Concessions d'Afrique. Il trouva un agent habile et énergique dans la personne de Sanson Napollon, Corse d'origine comme les Lenche et Libertat, devenu Marseillais d'adoption ; il s'était signalé comme consul à Alep et le roi l'avait nominé gentilhomme de sa chambre. En 1623, il fut chargé d'une mission de confiance à Constantinople pour obtenir du sultan des ordres rigoureux contre les Barbaresques (1). De retour en 1626, il fut chargé d'aller traiter une dernière fois la paix à Alger.
Les historiens ont laissé jusqu'ici dans l'ombre la personne du duc de Guise, mais il ne faut pas oublier que c'est lui qui avait inspiré et dirigé les négociations des années précédentes. C'est lui aussi qui fut chargé de traiter avec les Barbaresques, avec pouvoir de déléguer Sanson Napollon pour la négociation (2) ; c'est en son nom que Napollon devait relever le Bastion : celui-ci n'y fut jamais que le délégué du duc ; et enfin, c'est Guise qui fournit l'argent nécessaire pour les négociations, pour rétablir ensuite le Bastion et le munir de tout ce qui était nécessaire (3).
Napollon arrivé à Alger, le 21 juin 1626, avec les commandements de la Porte destinés aux Algériens, se heurta à mille difficultés et, comprenant qu'il n'en triompherait qu'au prix de beaucoup d'argent, revint à Marseille pour en chercher (4).
Pendant ce temps, l'ambassadeur, de Césy, agissait activement à Constantinople, et, sur la demande du duc de Guise, âme de la négociation, obtenait, en 1627, de nouveaux commandements du G. S. adressés à tous les Barbaresques (5). Après avoir réuni à grand peine les sommes nécessaires, Sanson, revenu à Alger, finit par réussir dans ses négociations (6) malgré les efforts des Anglais qui, dès le début du XVIIe siècle, devenaient, auprès des Barbaresques comme dans le Levant, nos rivaux les plus redoutables. Les agents de leur grande Compagnie des vingt vaisseaux demandaient la concession de Collo et de Bône et prodiguaient les présents pour arriver à leurs fins, comme ils l'avaient déjà fait en 1610 (7). Dans le traité de paix signé le 19 septembre 1628, il n'était pas nominalement question du Bastion (8) ; l'article 10 contenait seulement l'engagement réciproque d'observer " tous et chacun des articles des capitulations de paix faites et conclues entre nos deux empereurs ".
Mais, dix jours après, Sanson avait signé avec les puissances un contrat spécial relatif aux concessions d'Afrique. Dans une sorte de préambule, mis en tête du texte conservé à la Bibliothèque nationale, Napollon expose lui-même dans quelles conditions il sollicita le relèvement du Bastion : " considérant le sieur Napollon, qu'il fallait accomplir la volonté du roi pour l'établissement du Bastion, ainsi qu'il est contenu dans un article exprès de son Instruction que S. M. lui a fait expédier, et par la recommandation que le duc de Guise lui a faite, lui recommandant de rechercher la permission de rétablir ledit Bastion ". Ainsi, Sanson avait agi à la fois au nom du roi et au nom du dur de Guise qui se considérait comme le propriétaire légitime des Concessions.
Le contrat du 29 septembre 1628 est à publier intégralement parce que c'est le premier texte précis relatif aux Concessions d'Afrique qui permette de se rendre compte de leur nature. De plus, tous les traités ultérieurs jusqu'au XVIIIe siècle se réfèrent aux coutumes établies du temps de Sanson. Après les formules du début, on y lit les clauses suivantes :
Ainsi que par ci devant les François avoient commandé le Bastion avec l'échelle de Bône, les avons accordés moyennant 26,000 doubles, savoir : Seize mille doubles pour la paye des soldats et dix mille doubles pour le glorieux trésor de la Casbah, ainsi qu'il a été promis par le capitaine Sanson.
Et moyennant ces dites sommes avons déclaré, promis donner Bastion et échelles de Bône au Roy de France, avec pêches ; que, pour récompense des services rendus par le capitaine Sanson, il en sera le chef et commandera les dictes places sans que l'on en puisse mettre un autre. Néanmoins, après son décès, le Roy y pourra pourvoir d'autres personnes.
Les vaisseaux dudit capitaine Sanson pourront aller et venir auxdits lieux pour y vendre, négocier et acheter, enlever cuirs, cire, laine et toute autre chose comme était anciennement, sans qu'un autre vaisseau, de qui que ce boit, y puisse aborder, vendre, négocier, ni acheter, cire, laine et autres marchandises, sans qu'il eut ordre par écrit du capitaine Sanson.
Permettons et entendons que les vaisseaux dudit capitaine Sanson puissent partir de France pour aller, venir et retourner aux dites échelles en droiture sans aucune permission.
Etant les dits vaisseaux rencontrés par nos corsaires ne leur sera fait aucun déplaisir, ni reproche, allant ou venant à droiture.
Et d'autant que ladite place du Bastion et ses dépendances ont été démolies, permettons de les pouvoir redresser et fabriquer comme elles étaient anciennement pour pouvoir se garantir contre les Maures, vaisseaux et brigantins de Majorque et Minorque ensemble.
Ils pourront redresser les autres lieux et places qui avoient accoutumés être tenus pour se défendre, comme étaient anciennement.
Etant les bateaux de la pêche du corail entraînés par vents contraires, d'aborder aux lieux de la cote comme Djidjelli, Collo et Bône ne leur sera fait aucun déplaisir, faits esclaves ni vendu aux Mores.
Toutes sortes de navires, galères et frégates qui passent par ladite côte, soit en négociation ou autrement, allant et venant au royaume de Tunis, ne pourront nuire ni faire aucun déplaisir aux bateaux qui pêchent le corail en façon quelconque ni feront aucun mal.
Cette promesse foi et parole l'avons écrite et remise entre les mains de Nappolon (9).
Ce contrat avait été habilement dressé ; en stipulant le paiement d'une redevance de seize mille livres (10), dont une partie était spécialement affectée à la paie des janissaires, Napollon avait intéressé les Algériens et la milice elle-même à la conservation du Bastion. Cette clause, au moins sous cette forme, parait avoir été introduite par lui ; quant aux autres, elles n'étaient que la reproduction d'accords anciens et les privilèges des Français ne reçurent aucun accroissement en 1628 ; ils furent seulement établis plus solidement. Il faut remarquer que les Algériens leur reconnaissaient expressément le monopole, non seulement de la pêche du corail, mais de tout le commerce dans l'étendue des Concessions, qui n'était malheureusement pas nettement délimitée. Parmi les marchandises dont le trafic leur était permis, le blé et les autres grains n'étaient pas désignés ; l'exportation en restait en effet interdite comme dans toits les États du G. S. et comme elle l'était, d'ailleurs, à la même époque, dans presque tous les pays chrétiens. Enfin, on peut observer que, malgré la cession au Roi du Bastion, le contrat était fait surtout avec un particulier. Les Algériens accordaient des privilèges au capitaine Sanson, comme autrefois aux frères Lenche, parce qu'il était leur ami. Pendant longtemps, les traités signés à Alger, relatifs aux concessions, et, par conséquent, les concessions elles-mêmes, devaient conserver un caractère ambigu. Il semble que le gouvernement royal ne tenait pas trop à en faire de véritables possessions de la couronne, car, tant qu'elles pouvaient passer pour des comptoirs d'une Compagnie de marchands, le prestige royal n'était pas en péril lorsque le Bastion était insulté ou détruit, et il n'y avait pas nécessité de déclarer pour cela la guerre aux Algériens.
Cependant. Richelieu tenait beaucoup à ce que les nouveaux établissements fussent sous la dépendance exclusive du Roi. Quelque temps après, le duc de Guise rappelait la part qu'il avait eue au rétablissement de la paix et " suppliait très humblement S. M. de lui vouloir confirmer le don " qui lui avait été fait autrefois des Concessions.
Les Algériens avaient voulu lui accorder le Bastion, mais il n'avait pas accepté " ne le voulant tenir que du Roi " (11). Malgré cette attitude soumise, le duc n'obtint pas satisfaction et, bientôt, le cardinal devait faire tous ses efforts pour soustraire de plus en plus les Concessions d'Afrique et Napollon à son influence.
Sanson Napollon déploya une remarquable activité pour tirer parti de la convention qui il avait signée. Non seulement les anciens établissements marseillais furent relevés, mais il semble bien qu'il en construisit de nouveaux ; en tout cas, il leur donna certainement une importance qu'ils n'avaient jamais eue. Le Bastion, transformé complètement, devint pour la première fois une véritable petite forteresse avec un ensemble imposant de constructions. Le Père Dan, qui le visita en 1634, en fait la description suivante (12) :
Il regarde directement le Nord, du côté duquel il a pour borne la mer qui bat ses murailles, et une petite plage où abordent d'ordinaire les barques de ceux qui vont pêcher le corail, ce qu'ils font de cette sorte. Ils ont un grand lest attaché à de longues cordes parce qu'il y a quelquefois jusques à 50 brasses d'eau dans les endroits où ils font leur pêche. En ce lest, ils mettent de grosses pierres pour le faire aller au fond, si bien que par la violence de l'eau et du courant, il entre sous des rochers en certaines grottes entièrement creuses et faites en forme de voûtes où croit le corail, et où il s'attache, ayant ses branches qui pendent en bas. Comme ils jugent donc à peu près que leurs filets sont engagés dans ces grottes qu'ils appellent baumes en provençal, ils se mettent à les retirer et, par ce moyen, ce côté du lest qui touche la voûte en arrache le corail qui tombe dedans.
Il y a deux grandes cours en ce bastion, la première desquelles est vers le Nord où sont les magasins à mettre les blés et les autres marchandises, avec plusieurs autres chambres basses où logent quelques officiers du Bastion, et cette cour est assez grande. L'autre, qui est beaucoup plus spacieuse, se joint à la plage dont nous avons parlé ci-dessus où l'on retire les bateaux et les frégates.
Au bout de celle-ci, se voit une belle et grande chapelle toute voûtée que l'on nomme Sainte-Catherine, au-dessus de laquelle il y a plusieurs chambres, où logent les chapelains et les prêtres du Bastion. Le cimetière est au-devant ; et, un peu à côté, entre la chapelle et le jardin, se remarque l'hôpital, où l'on traite les soldats, les officiers et les autres personnes malades. Entre ces deux cours, du côté du Midi, il y a un grand bâtiment tout de pierre et de figure carrée ; c'est la forteresse qui est couverte en plateforme, munie de deux pierriers et de trois moyennes pièces de canon de fonte. Là même est le corps de garde et le logement des soldats de la garnison, divisé en plusieurs chambres. A dix pas de la porte du Bastion qui regarde la terre ferme, il y a quelque vingt familles d'Arabes qui se tiennent là pour le service de la forteresse. Ils demeurent sous des tentes avec tout leur ménage, poules, chevaux, boeufs et autre bétail, ce qu'ils appellent en leur langue une baraque.
On trouve d'autres détails sur le personnel qui occupait le Bastion, sur les autres établissements créés par Sanson et sur le commerce de la Compagnie, dans un très intéressant manuscrit de la Bibliothèque nationale (13) :
" Le Bastion est la principale place et la plus forte dans laquelle se tient toute la munition de guerre et de bouche nécessaire pour toutes les autres places, dans laquelle y demeurent ordinairement le capitaine et son lieutenant, un homme qui a l'intendance et l'administration du négoce, un écrivain qui tient compte de toutes les affaires...
" Dans le corps de garde y demeurent un capitaine et deux caporaux et vingt-huit soldats et un tambour. Ledit capitaine a trente six livres le mois…
De plus, dans la forteresse, il y demeure toujours quinze personnes qui servent dans les occasions et pour accompagner le capitaine lorsqu'il va en compagnie et en tout autre occasion d'importance.
" Il y a d'ordinaire quatre soldats qui font sentinelle, hors de la forteresse, dans la basse-cour. Un capitaine, qui commande la frégate du Bastion et quarante matelots, pour servir aux frégates et caïques et aller aux lieux et places lorsque besoin est. "
" Le Bastion avait en outre trois truchements pour interpréter les langues turquesque et moresque, un médecin aux appointements de 450 livres par an, un chirurgien, un apothicaire, deux barbiers.
On y trouvait comme ouvriers ou artisans deux charpentiers, deux calfats, deux menuisiers, un maréchal ferrant, un serrurier, un cordonnier, un tailleur d'habits, cinq boulangers, deux meuniers pour le moulin à vent avec deux aides et quatre valets d'étable, deux charretiers, deux hommes pour cribler le blé deux maîtres maçons avec douze hommes pour les servir, un boucher, deux jardiniers, deux hospitaliers, trois hommes pour le service des magasins, deux autres pour garder le bétail, un valet pour les chiens, un porteur d'eau, vingt paysans pour travailler la terre. Dans l'église Sainte-Catherine il y avait deux religieux franciscains auxquels on donnait l'habillement et la nourriture et, suivant la volonté du commandant, quelques charges de blé tous les ans au couvent de Marseille.
Vingt et un bateaux, montés chacun par sept hommes, étaient employés à la pêche du corail sous le commandement d'un capitaine. La Compagnie leur achetait 20 sols la livre le corail qui ils péchaient, mais elle leur fournissait le bateau tout équipé et la nourriture qui était réglée comme il suit : à chacun des bateaux, par semaine, trois cents pains, une millerole (14) de vin, vingt-cinq livres de chair, une bouteille d'huile, une autre de vinaigre, une livre de suif, dix livres de sel, vingt livres de légumes et, de plus, trente livres de fromage et un baril de sardines.
La Compagnie possédait ou employait trois tartanes pour son service et occupait aux transports trente chevaux et trois mulets.
Enfin, l'arsenal était largement approvisionné de munitions, mousquets, sables, plomb, poudre, et l'artillerie se composait de cinq canons de bronze et deux espingards, l'un de bronze, l'autre de fer.
Deux forteresses moins importantes furent élevées à la Calle et au cap de Roze qui ferme à l'est le golfe de Bône. " Le lieu dit, La Calle, nous apprend le même document, est le port où les navires qui abordent les bastions demeurent en tout temps assurés et sans aucun danger : il y a une forteresse et deux grands magasins ; il y demeure un capitaine et quatorze soldats en garnison d'ordinaire, et, suivant l'occasion, on la renforce ". Un commis, qui faisait le commerce avec les tribus voisines et qui s'occupait surtout d'acheter des blés, résidait aussi à la Calle avec six hommes sous ses ordres pour faire les chargements. Ses appointements étaient de 600 livres par an.
" La forteresse du cap de Roze (15) est la plus proche place de Bône ; il y demeure un caporal dont le salaire est de trente livres par mois et huit soldats qui reçoivent neuf livres chacun par mois ".
Un truchement y était aussi établi à demeure. Elle était bâtie sur un rocher escarpé, au sud d'une petite anse connue sous le nom de Calle du prisonnier, situé sur la face ouest du cap. L'endroit, pas plus que le Bastion, n'était d'un commerce considérable, mais c'était une des meilleures stations pour la pêche du corail. Aujourd'hui encore, les pêcheurs assurent que ses bancs de rochers donnent toujours le corail le plus beau et le plus riche de la côte d'Afrique et qu'on n'est pas obligé d'aller le chercher à une trop grande distance ; on le trouve à une profondeur de quarante à cinquante brasses. De plus, l'isolement de ce lieu, comme celui du Bastion, était favorable à la sécurité des pécheurs. Le pays qui avoisine le cap, entièrement inculte et inhabité, leur donnait la facilité de faire de l'eau et du bois sans crainte d'être surpris par les Arabes.
Quant à Bône, la seule place commerçante de cette côte, la Compagnie n'y avait qu'une simple " maison " c'est-à-dire un comptoir.
Dans cette ville, gardée par une garnison turque, elle était en effet à la fois sous la protection et dans la main de la milice, tandis que les forteresses des autres postes étaient faites pour la protéger, non contre une attaque des Algériens, mais contre un coup de main des tribus turbulentes du voisinage ou contre une descente de corsaires.
La maison de Bône, achetée des deniers du Bastion, était très grande et logeable et son personnel se composait de cinq agents pour faire le négoce. La dépense annuelle de son entretien et des cinq employés était évaluée à 5,000 livres par an. De plus, une somme de 800 livres était comptée tous les ans aux chefs et officiers principaux de la garnison turque, afin de les avoir pour amis. Lorsque des navires de guerre abordaient au port de Bône, l'agent de la Compagnie était tenu d'offrir des rafraîchissements et quelque présent aux capitaines jusqu'à concurrence de 300 livres. Il fallait en outre payer à la ville de Bône pour ses droits et prétentions et pour les taxes d'entrée et de sortie des marchandises la somme de 7.000 livres a moyennant laquelle celui qui tenait la ferme de Bône était obligé de fournir annuellement aux marchands du Bastion 2.000 cuirs des plus grands à 25 sols la pièce ".
Enfin, la Compagnie avait pour la représenter un agent à Alger et une maison, spacieuse et belle, louée 500 livres par an, dont les meubles et ustensiles appartenaient au Bastion. Le salaire de l'agent et l'entretien de la maison revenaient à 800 livres par an.
Les dépenses totales de la Compagnie, pour l'entretien des établissements des Concessions, s'élevaient annuellement à 119,680 livres en y comprenant 5.000 livres de pensions aux principaux chefs du voisinage, " au moyen de quoi les chemins n'étaient pas violés et la paix assurée avec les hommes des tribus. " Il faut y ajouter les 16.000 livres de redevances stipulées en faveur des algériens et les cadeaux d'usage. La Compagnie avait besoin de faire de gros bénéfices pour balancer d'aussi lourdes charges.
Un mémoire de Sanson Napollon donne aussi d'intéressants détails sur la vie des Français au Bastion et sur son importance :
" Pour la pêche du corail il y a 24 bateaux fabriqués exprès, à chacun desquels il y a 7 hommes, une frégate avec 20 hommes, deux autres frégates à chacune 10 hommes, deux tartanes à chacune 9 hommes... En ces quatre places il s'y peut occuper ordinairement 800 hommes et, en Provence, 400... à polir le corail, faire donner ordre aux provisions nécessaires pour ledit Bastion... Dudit Bastion se retire corail, grains, cuirs, cire, laines, chevaux. Le grain sert pour les pauvres, d'autant qu'il est à bon marché n'étant pas si bon que celui qui croit en Provence, étant néanmoins net et sans aucun mélange.
En les dites places se dit et célèbre tous les jours la sainte Messe et au Bastion s'y établit un couvent de religieux dédiés à Sainte... où il se dit tous les jours trois messes... Les quatre principales fêtes de l'année un chacun se confessant et communiant... L'office et procession se faisant publiquement où vont ordinairement assister tous les Mores qui admirent la bonne vie des chrétiens, l'ordre et magnificence du service de Dieu et de la religion de France, y ayant un exact règlement pour toutes choses concernant le fait de la religion et particulièrement tous les blasphémateurs de façon que si aucun venait à jurer le nom de Dieu ou autrement en quelque sorte que se soit, il se trouverait puni sans aucune grâce.
Tous les esclaves qui s'en peuvent fuir des villes et lieux de Barbarie se viennent sauver au Bastion qui est un asile assuré et soudainement nous les envoyons en chrétienté.
Les fêtes légères, la pêche qui se fait du corail est destinée à s'employer à faire un fond pour aider à racheter les pauvres esclaves et pour marier de pauvres filles et pour autres oeuvres pies.
En tous ces lieux les Turcs ni les Maures ne peuvent avoir aucune sorte de juridiction ni lever aucun droit... Le gouverneur du dit Bastion exerce la justice civile envers tous les Mores qui trafiquent et vont en ces lieux et places et si aucun More a commis quelque crime se sauvant au dit Bastion il est en franchise sans que le dit gouverneur soit obligé de le rendre si bon lui semble. Il ne se paie aucune sorte de droits en toutes lesdites places et peuvent et peut un chacun y négocier sans payer aucune chose et la justice y est exercée par forme de prud'hommes. Tous ceux qui vont au Bastion ne paient aucune chose pour le pain, la viande et autres choses nécessaires pour vivre et on pratique cette charité envers toutes nations qui y viennent tellement que de compte fait, il se mange tous les jours cinq mille pains ".
La correspondance de Sanson Napollon atteste qu'il ne fut pas moins heureux pour ranimer le commerce des Concessions que pour les relever. En dépit des défenses d'exporter les grains, c'est au commerce du blé qu'il s'attacha particulièrement, car l'approvisionnement de la Provence était toujours mal assuré. Dès le mois de janvier 1629, Sanson pouvait écrire aux consuls de Marseille : " Je vous prie de me commander et vous verrez avec quelle promptitude et affection je vous servirai.... Si vous avez présentement besoin de blé, vous pouvez attendre d'ici toute la quantité que vous désirez. (16). " Et, trois ans après, il leur écrivait encore avec satisfaction : " J'ai toujours rendu tous les services que j'ai pu pour le bien de ladite ville.... Je ferai encore davantage.... Il y a trois ans que j'ai toujours mandé tout le blé que j'ai pu pour secourir ladite ville et continuer toujours de très bon coeur.... MM. les consuls de la ville d'Aix ont demandé mille charges, je serais bien votre obligé de faire queux en ayant besoin de vous vouloir contenter.... et ne tarderai pas de vous en envoyer d'autre. " (17). Le duc de Guise avait associé Sanson pour un tiers au commerce du Bastion (18) et les profits que celui-ci avait retirés du négoce étaient considérables puisque sa fortune lui permit de marier sa fille au marquis de Regusse, président au Parlement de Provence (19).
Cependant la paix de 1628 était mal observée ; des infractions graves y avaient été commises des deux côtés depuis la fin de 1629 (20). Sanson, malgré la mésintelligence croissante entre les Algériens et la France, maintenait son crédit si bien que ses ennemis prétendirent qu'il était de connivence avec les Barbaresques. En effet, le rétablissement du Bastion et du monopole de la Compagnie était loin de réjouir les marchands Marseillais en relations avec la côte d'Alger, car les opérations les plus fructueuses se faisaient alors à Bône ou dans les ports environnants de la côte Orientale, tandis qu'Alger offrait peu de ressources au commerce. Les consuls de France à Alger eux-mêmes ne pouvaient voir d'un bon oeil la faveur du commandant du Bastion qui éclipsait leur autorité et ne leur laissait qu'un rôle secondaire ; leurs intérêts étaient aussi lésés, car leurs droits de consulat étaient diminués de tout le trafic que la Compagnie enlevait aux Français résidant à Alger; de plus, l'existence du Bastion n'avait été jusqu'ici pour eux qu'une source de dangers de plus.
On comprend donc, sans les excuser, les intrigues auxquelles se laissèrent entraîner les résidents d'Alger, d'abord pour faire échouer les négociations de Sanson Napollon , puis, quand le traité de 1628 eut été conclu, pour amener la perte du capitaine et de sa compagnie.
A la tête de cette coalition on remarquait Thomas Fréjus, négociant qui avait rempli, en 1628, les fonctions de consul intérimaire et dont les deux neveux, Michel et Roland (21) devaient jouer plus tard un rôle considérable en Barbarie. Deux autres marseillais, Nicolas Ricou et Blanchard, envoyés aussi, de 1630 à 1633, à Alger, pour y remplir les fonctions de consuls, ne cessèrent dans leur correspondance avec les consuls de Marseille, d'accumuler les plaintes contre Sanson et contre ses agents ; certaines de ces lettres témoignent d'une exaspération extraordinaire (22).
La faveur du capitaine du Bastion était trop assurée à Alger, pour que ses ennemis pussent rien y entreprendre contre lui (23) ; c'était à Marseille ou à la Cour qu'on pouvait essayer de le perdre. Le frère de Thomas Fréjus suscita à Marseille un mouvement populaire qui faillit amener le pillage de la maison de Napollon. On l'accusait d'avoir détourné une partie des fonds qui lui avaient été remis pour le rachat des esclaves, mais il n'eut pas de peine à prouver, qu'au contraire il avait dépensé " tout ce qu'il avait au monde " pour l'accomplissement de sa mission (24).
A la Cour, on sut inspirer des inquiétudes au Cardinal, au sujet de la fidélité du Gouverneur du Bastion. Tantôt on faisait entendre qu'il achetait, par toutes sortes de complaisances coupables, la faveur des Algériens ; tantôt on envoyait des avis sur ses intelligences avec les Espagnols (25), surtout on fit craindre au Cardinal que Sanson ne voulût se rendre indépendant. N'avait-il pas fait stipuler, dans le contrat de 1628, que le roi ne pourrait mettre un autre à sa place à la tête du Bastion. Pour éclaircir la situation et s'assurer de l'obéissance de Sanson, Richelieu envoya en mission spéciale M. de l'Isle Antry, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, commissaire de S. M. pour les affaires de Barbarie.
Cependant, le Cardinal était en correspondance régulière avec le Gouverneur qui le tenait au courant de tous ses projets et lui envoyait les plans des fortifications qu'il construisait (26). Sanson, qui avait été jusque là surtout l'homme du duc de Guise, avait senti la nécessité de devenir l'homme du Cardinal, et avait fait, au début de 1631, le voyage de la Cour, laissant le commandement du Bastion à Lazare de Servian, pour dissiper les soupçons qu'on cherchait à accumuler sur lui et régulariser définitivement sa situation vis-à-vis du roi. Le 27 mai 1631, en même temps qu'il avait remis un mémoire justificatif des recettes et des dépenses qu'il avait faites pour la signature de la paix, il avait rédigé, à Fontainebleau, une attestation où il disait " qu'il avait traité avec ceux d'Alger, au nom du roi, pour établir le Bastion, l'échelle de Bonne, le cap de Rose et la Calle dite Massacharette, desquelles places il avait été fait capitaine pendant sa vie, et que le sieur duc et dame de Guise lui avaient fourni 12,000 écus, desquels ils retiraient les deux tiers du profit qui se faisait au Bastions.
Le 29 août, Sanson avait reçu des lettres-patentes du roi lui donnant la charge de capitaine et gouverneur du Bastion. Il avait été en relations suivies avec l'évêque de Saint-Malo, l'un des confidents du Cardinal, et l'avait chargé d'obtenir de celui-ci l'évocation au conseil de toutes les affaires qui le concernaient, à cause a de la continuation des troubles qu'on lui donnait en haine de l'établissement qu'il avait fait ". Il semble donc que, quand la mort de son lieutenant Servian rappela Sanson au Bastion, à la fin de septembre 1631, sa situation dût être bien nette vis-à-vis de la Cour. Pourtant, les défiances du Cardinal ne peuvent être mises en doute, et les instructions qu'il remit à De l'Isle, le 8 octobre 1631, indiquent clairement quel était le but de la mission de celui-ci.
" Ceux de la ville de Marseille ont envoyé faire de grandes plaintes à S. M. par leurs députés, en premier lieu de la paix, mal observée par les algériens… Pour ce qui touche le Bastion, ils ont représenté que la subsistance pouvait être fort dommageable au pays de Provence et qu'il valait mieux le quitter de tous points que l'entretenir. " De l'Isle devra " reconnaître l'état des affaires et en faire un rapport à S. M. à son retour... faire réformer au traité certains articles qui peuvent faire préjudice à s dignité et piété et à la sûreté du commerce de ses sujets… Pour le regard du Bastion… ledit sieur de l'Isle s'y transportera, verra les forteresses, en lèvera les plans pour les rapporter à S. M., considérera si les fortifications sont bonnes… ce qui peut rester à faire pour les rendre plus assurées… et s'il serait nécessaire de garder les trois forts ou seulement le Bastion… de quel nombre est composée la garnison… s'il y a quelque cheik outre ledit Sanson Napollon… et si les soldats dépendent immédiatement de lui ou de quelque autre… Il sera bien à propos qu'il sache ce que le sieur Sanson Napollon en a tiré depuis son établissement et les dépenses auxquelles il a employé ce revenu... ce que le sieur de l'Isle fera avec grande discrétion et adresse sans donner jalousie audit Napollon...
Il s'informera aussi de ce que Mr de Guise a mis et contribué pour ledit établissement, ce qu'il en a retiré par le moyen de la vente des blés ou autrement, jusqu'à quel point va la dépendance qu'a ledit Sanson avec lui et par quels moyens et adresses ledit Sanson s'est établi en les dits lieux, s'il a provisions du Grand Seigneur ou du Divan (ce que le roi ne croit pas)… Et d'autant qu'il importe au service de S. M. attendant le rapport qui lui sera fait par le sieur de l'Isle que les choses se maintiennent en Barbarie en l'état qu'elles sont… S. M. a voulu faire expédier une commission scellée du grand sceau audit sieur Sanson Napollon pour y commander immédiatement sous son autorité jusqu'à ce qu'autrement il en soit par elle ordonné et outre ce elle donne ordre et pouvoir exprès au sieur de l'Isle de déclarer audit Sanson que S. M. entend qu'il tienne ladite place immédiatement d'elle et lui en réponde de sa vie " (27).
Il ressort nettement de ces instructions que Richelieu voulait être exactement renseigné par un homme de confiance sur des établissements encore mal connus à la Cour et qu'il tenait à les rattacher directement à l'autorité royale.
En réalité, la mission de De l'Isle fut bien plus dirigée contre le duc de Guise, brouillé avec Richelieu, que contre Napollon comme le montre ce curieux mémoire qui dut inspirer au cardinal l'envoi de ce commissaire, à moins qu'il n'ait été dicté par le cardinal lui-même.
" Pour éviter un second accident semblable à celui de 1604, il est expédient que la place appartienne à S. M., non à aucun particulier et que celui qui y mandera y soit mis de temps en temps de la part de S. M. Mais étant nécessaire de faire beaucoup de dépense pour la sûreté de la place il est juste que les finances de S. M. n'en soient chargées, que le revenu de ladite place appartienne à S. M. et, pour ce que ce revenu consiste en négoce et en pêche de corail, il semble qu'il serait convenable que le capitaine qui y est mis de la part de S. M. fasse faire la pêche et négoce et en rende compte à S. M. qui pour son entretien et récompense lui en accordera telle part qu'il lui plaira, fera payer sur le reste les dépenses nécessaires pour la conservation de la place et des deniers revenants bon s'il y en a. En sera fait ce qu'il lui plaira d'ordonner.
Par ce moyen la place et tout son revenu sera avec apparente et juste raison tiré de la puissance de… (28) qui s'il s'y oppose et dit avoir dépendu quelque chose ne saurait au plus prétendre que 12,000 écus lesquels lui payant Il n'a plus rien à dire et lesquels 12,000 écus se peuvent tirer du Bastion sans que S. M. en débourse rien de son épargne.
Il y a deux voies pour exécuter cela. L'une prompte, qui est que le roi dans son Conseil l'ordonne et fasse expédier commission au sieur Sanson, ou autre quelle enverra… de lui rendre désormais compte de tout le revenu lequel elle entend devoir lui appartenir sans qu'aucun y puisse prétendre part.
L'autre, que sur le prétexte des plaintes que MM. de Marseille font contre ledit Bastion et du préjudice qu'ils proposent qu'il apporte aux sujets de S. M., S. M. envoie un commissaire de delà pour s'en informer, auquel elle donnera pouvoir, après avoir vu et examiné toutes choses, d'ordonner au nom de S.
M. au sieur Sanson Napollon ou ses lieutenants ce qu'il jugera être convenable pour le service de S. M. audit lieu. Et ledit commissaire aura un ordre secret qu'après avoir vu et examiné toutes choses, il prenne le prétexte de la sûreté de la place, le fortifiant encore de l'entreprise qui y a été faite nouvellement par un vaisseau armé à Villefranche et faire au nom de S. M. commandement exprès et par écrit au sieur Napollon de ce que nous avons dit ci-dessus " (29).
Il est d'ailleurs curieux de remarquer que, si de l'Isle fut envoyé pour faire une enquête sur les actes de Sanson, celui-ci eut tout le temps de se préparer à le recevoir car le cardinal lui avait annoncé six mois d'avance qu'il le lui envoyait (30). L'inspection du commissaire royal ne fit qu'affermir la situation du gouverneur et le confirmer dans la faveur du cardinal. Quant au duc de Guise, il conserva tout au moins ses droits aux revenus du Bastion ; les instructions remises à de l'Isle étaient en effet beaucoup moins catégoriques que le mémoire cité ci-dessus.
De l'Isle, arrivé au Bastion le 11 avril 1632, visita en détail les constructions, se fit rendre compte des dépenses et se déclara " entièrement satisfait en tout ce qui peut regarder le service du roi. " Puis, le 28 avril, il assembla solennellement tous les officiers et soldats, remit solennellement à Sanson sa commission de gouverneur royal, scellée du grand sceau, en date du 29 août 1631, et lui lit prêter serment de fidélité ainsi qu'à tous les chefs et soldats " tant de ceux qui sont de la garnison du Bastion et du dehors, que des forts de la Calle, de cap de Rose " (31). Quelques jours après de l'Isle mandait à l'évêque de Saint-Malo " qu'il n'avait rien vu de si beau que l'établissement du Bastion qui donnait espérance d'un grand bien. "
Cependant les ennemis de Sanson ne désarmèrent pas et les relations devinrent de plus en plus aigres entre lui et les Marseillais ainsi qu'en témoigne cette violente réponse des consuls à une lettre qu'il leur avait écrite le 1er juin :
M. Sanson, la lettre que vous nous avez écrite du Bastion le 1er de ce mois est si insolente qu'elle n'était pas digne ni d'être lue de nous ni de notre réponse ; vous l'aurez toutefois ici non pour vous faire honneur nais seulement pour vous y faire reconnaître vos impostures et votre erreur.... Vous vous êtes oublié jusques là d'en faire courir des copies avant que nous l'ayons reçue, ce qui nous a d'autant plus incités à cette réponse pour en découvrir la turpitude aux yeux de tout le monde.... Nous avons en main de quoi faire voir que pour vos particuliers desseins vous bandez tous vos efforts pour l'avantage et la liberté des Turcs et opprimer celle des Français… On n'a point vu la liberté des nôtres, vous étant seulement contenté d'attraper les deniers qui leur étaient destinés.... Tous ceux qui viennent ou écrivent d'Alger confirment tout cela; ils ont donc dû en faire leurs s plaintes à la cour.... Si vous osez nous donner des instructions et des conseils du renard aux poules et parler dans votre lettre en censeur, en seigneur et en maître avec cette outrecuidance et cette témérité qui vous est naturelle à faute d'avoir bien considéré votre condition et la nôtre et que vous devez à nôtre ville tout ce que vous avez d'honneur et de fortune. Pour en apparence.... assurer la paix et le commerce vous fîtes faire cette reprochable et infâme restitution des Turcs et des canons et soumettre les Français à toutes conditions honteuses et vilaines pour parvenir à ce fatal Bastion. Et vous trompez grandement de penser que soit d'aversion volontaire qu'on vous haïsse pour respect du Bastion... Vous en avez justement encouru et mérité l'indignation et la haine publique, mais en telle sorte toutefois qu'on n'en veut qu'à vos mauvais déportements et non au Bastion comme industrieusement et à dessein vous tachez de le persuader quand pour vous sauver vous vous jetez à l'abri et sous l'ombre du roi, mais nous osons espérer de sa bonté que lorsque S. M. vous aura mieux connu, elle exaucera nos justes clameurs " (32).
Sur ces entrefaites, un Marseillais nommé Bettandier, mêlé auparavant aux affaires de Barbarie, écrivait un libelle diffamatoire contre Sanson. Celui-ci, soutenu par son gendre le président de Regusse, eut pour lui le Parlement d'Aix qui décréta Bettandier de prise de corps, le condamna par contumace à 1500 livres d'amende et ordonna que son libelle fût brûlé par le bourreau (33). Mais Bettandier, bâtard de la puissante maison de Valbelle, fut défendu par son chef, lieutenant de l'amirauté à Marseille, qui entraîna le maréchal de Vitry, gouverneur de Provence. Vitry, sans doute par hostilité pour les Guise qui jouissaient du Bastion, fit réformer l'arrêt du Parlement et ordonner au contraire qu'il serait informé contre Sanson. C'était au tour du secrétaire du duc de Guise de s'adresser à la protection de l'évêque de Saint-Malo pour demander que l'affaire fût évoquée par le cardinal (34).
En même temps, les consuls de Marseille, s'il faut en croire Sanson, avaient envoyé à Alger le patron d'une barque pour donner avis au pacha et au divan que le Bastion n'avait été fait que pour préparer la ruine de la Barbarie et pour donner des airs au cardinal, ce qui avait décidé les Puissances à dépêcher le général de la milice au Bastion pour faire une enquête. En janvier 1633, le secrétaire du duc de Guise mandait à l'évêque de Saint-Malo que les Marseillais faisaient une députation à Constantinople sous prétexte de leurs démêlés avec l'ambassadeur, de Césy, mais en réalité pour ruiner le Bastion (35). Ces haines terribles ne devaient peut-être pas être étrangères à la mort tragique qui frappa Napollon quatre mois après.
Le cardinal profita du déchaînement des attaques contre le Bastion pour porter un nouveau coup aux Guise à la fin de 1632, s'il faut en croire les instructions données par lui au capitaine de vaisseau Rigault, envoyé à Alger pour faire rectifier le traité de paix et obtenir des restitutions de vaisseau. " S. M. fait commandement audit Rigault, disaient ces instructions, de déclarer au sieur Sanson qu'elle veut qu'il tienne le Bastion de France immédiatement d'elle, et de lui en répondre sous peine de la vie, qu'elle veut aussi qu'il prenne la charge de la pêche du corail et négoce de Barbarie, que sur les profits et revenus qui en pourront provenir, il prenne le fond nécessaire pour la défense de l'entretien de lui et de la garnison et que du surplus il en rendra compte à celui que nommera Sa Majesté " (36). Ces instructions reproduisaient presque textuellement les termes du mémoire cité plus haut qui demandait que le Bastion et ses revenus appartinssent entièrement au roi. Cependant, jusqu'à la mort de Sanson Napollon, le duc de Guise ne cessa pas de s'occuper des établissements qui il avait tant contribué à fonder et sans doute d'avoir part aux revenus du commerce.
Au moment même où le commissaire de l'Isle arrivait au Bastion, Sanson était en correspondance avec le cardinal au sujet d'un dernier établissement par lequel il devait compléter utilement son oeuvre. Il s'agissait de rétablir les Français au cap Nègre, en Tunisie. Les Génois, parait-il, en avalent été chassés, on ne sait à quel moment, par des corsaires de Tripoli et, depuis, avaient fait de vaines tentatives auprès du bey de Tunis pour en obtenir la concession. Les indigènes se plaignaient de ce que les Génois les renvoyaient souvent sans acheter leurs marchandises, sous prétexte qui ils n'en avaient pas besoin, et le bey ne voulut pas traiter avec eux parce qu'ils se refusaient à établir un commerce régulier avec les gens du pays (37).
Parmi les commandements du G. S. envoyés par le comte de Césy en 1627, il y en avait un au pacha de Tunis, lui donnant ordre d'empêcher ses corsaires de molester les vaisseaux français, de rendre les esclaves et de " laisser faire aux Français une retraite à la Fumaire Sallade, Cap Nègre et Cap Roux, pour y faire la pêche du corail ". Était-ce aussi le duc de Guise qui avait fait engager cette négociation ? Ce qui est certain, c'est qu'en 1631, Napollon agissait à Tunis pour le compte personnel du cardinal et non du duc. Le 27 mai 1631, il envoyait à Richelieu une promesse " de traiter avec Issufo, dey de Tunis, pour avoir permission d'établir les Français dans quelque lieu ou port, ou île du royaume de Tunis ", en reconnaissant " que tout le revenu qui viendrait dudit trafic appartiendrait audit cardinal. "
Au même moment, un simple marchand marseillais, Jean Estelle, dont la famille devait pendant longtemps jouer un rôle important en Barbarie, négociait à Tunis dans le même but pour son propre compte, en se servant de l'influence de Ragop bey, renégat provençal très riche et très puissant, qui, pendant douze ans, avait été général de l'armée tunisienne, et dont il avait épousé la nièce.
Ragop bey, lit-on dans un Mémoire adressé à Richelieu, en 1632, a obtenu permission... d'établir un trafic et négoce à Cap Nègre... et pour cet effet d'y bâtir une forteresse et tous les logements nécessaires... L'étendue qu'on lui a donnée tout à l'entour de Cap Nègre sen va du côté de Levant jusqu'à la Fumaire salée, qui est une rivière d'eau salée qui se jette dans la mer soixante milles près de Bizerte... et du côté du Couchant elle va jusques à la Fumaire d'Abeillo (?) qui est une rivière d'eau douce qui se décharge dans la mer un peu au-dessous l'endroit où est l'île de Tabarque. Le dessin de ce négoce et de l'établissement d'icelui a été donné par Jehan Estelle, marchand de Marseille, mari d'une nièce dudit bey, duquel il est grandement aimé, qui s'en alla exprès à Tunis pour ce susdit là où il sut si bien ménager les esprits des principaux du divan d'Issout dey et du bey, son onde, que la forteresse se trouve aujourd'hui achevée, où il y a trente Turcs de garnison et quantité de logements faits ainsi que se peut voir particulièrement dans le plan. De sorte qu'il ne reste plus maintenant que de donner commencement au trafic duquel le bey a laissé l'entière direction audit sieur Estelle, qui est venu à Marseille pour y dresser une Société et Compagnie avec quelques-uns de ses amis, afin d'attirer tous les profits et commodités d'icelui dans sa patrie. L'établissement de ce négoce n'est pas de petite considération car, en premier lieu, on peut tirer du pays une grande quantité de grains pour le secours de le France et de toute la chrétienté y ayant une seule ville à deux journées et demie du Cap Nègre, dans la terre ferme appelée Bege, qui fournira toute seule vingt mille charges de blé revenant à plus de cinquante mille sentiers de Paris. Et si une fois le lieu et le négoce sont reconnus des Arabes, ils viendront de tout le voisinage de Tunis et des déserts de l'Arabie y porter leurs grains, consistant en blé, orge, seigle, fèves, pois chiches, lentilles les plus belles et toutes autres sortes de légumes.
En second lieu, on peut tirer quantité de cuirs, tant grands que petits, qui n'apportent pas une petite commodité à la France, comme encore de grandes quantités de laines et de cires... (38).
Estelle s'étant adressé, à Marseille, au baron de Viens, gentilhomme de ses amis, celui-ci jugea l'affaire assez importante pour la faire connaître à Richelieu et lui conseilla de ne rien faire sans avoir informe le cardinal.
Dans la lettre qu'il adressait à celui-ci, le 21 novembre 1632, de Viens lui faisait valoir la grandeur de ce dessein : " L'établissement de ce négoce, disait-il, a été jugé de telle importance que le duc de Florence a essayé autrefois d'y parvenir et aujourd'hui même, le duc de Savoie en fait traiter sous main, car, par le moyen d'icelui, on attirera à soi tout le trafic du royaume de Tunis, qui est la meilleure partie de la Barbarie (39) ". Au moment où cette lettre était adressée au cardinal, celui-ci avait déjà reçu de Sanson Napollon un projet de constructions pour le cap Nègre. En effet, il lui écrivait, le 19 avril 1632 : " J'estime qu'il est a propos que vous donniez le nom de Saint-Louis ou de la Fleur de lys à la fortification du cap Nègre " (40). Il serait piquant de savoir quel effet produisit sur le tout puissant cardinal l'entreprise de ce Marseillais dont l'initiative imprévue venait contrecarrer ses projets. Il n'y eu pas entente entre Estelle et Napollon puisque, le 3 janvier 1633, celui-ci écrivait à l'évêque de Saint-Malo, qu'un " Marseillais nommé Istella avait fait tout ce qu'il avait pu pour lui faire perdre le cap Nègre. " Pourtant, le capitaine du Bastion dut conclure un accord avec la famille de Ragop bey, car, à peine était-il mort, que le Marseillais Franchiscou, neveu du renégat, " qui avait l'administration du négoce du cap Nègre ", fit des offres au duc de Guise pour le " lui faire donner aux mêmes conditions que l'avait M. de Napollon " (41). L'accord fait avec les Tunisiens au sujet du cap Nègre reste très obscur. Quoi qu'il en soit, le comptoir était fondé et resta occupé par les Français, puisque le commissaire du roi, Sanson Lepage, en fit la visite en 1634.
L'emplacement de ce nouveau comptoir, situé en face de Tabarque, n'offrait rien de particulièrement favorable. Un agent d'une des compagnies d'Afrique le décrit ainsi : " Le cap Nègre est situé sur une langue de terre qui avance dans la mer un demi quart de lieue courant à l'Ouest-Nord-Ouest ; le commencement de cette langue ou de ce cap est un pays plat et qui va ensuite en se levant et forme une colline qui a environ 400 pas de large environnée de trois côtés de la mer. Le mouillage se trouve du côté de l'Ouest, le fond en est mauvais et coupe les câbles des bâtiments qui s'y trouvent dans les mauvais temps; c'est ce qui fait que ce port est toujours dangereux et qu'il arrive de fréquents naufrages. Cette anse ou ce port fi nit à une plage ou rivage de sable " (42). En réalité, il n'y avait pas là d'abri, même pour les barques de corailleurs, et, plus tard, quand les vaisseaux de la Compagnie d'Afrique visitaient le cap Nègre, il leur était interdit de s y arrêter plus de trois jours pour faire leurs chargements (43). Mais le cap Nègre avait toujours été le seul point de la côte nord de la Tunisie où l'on faisait un grand commerce et c'était un grand succès pour les Français d'être parvenus à s'y établir à la place des Génois.
Pour que leur prépondérance fût absolue sur toutes les côtes orientales de la Barbarie, il leur aurait fallu enlever aussi au; Génois l'île de Tabarque. Guise et Napollon ne reculèrent pas devant un pareil dessein dont le succès eût été le digne couronnement de leur oeuvre. L'expulsion des Génois avait été l'objet de négociations à Constantinople et dans le commandement du G. S. envoyé au pacha de Tunis en 1627 pour lui ordonner de laisser les Français s'établir au cap Nègre, il était dit : " D'autant que nous entendons que ceux qui sont logés en l'île de Tabarque sont Génois et nos ennemis jurés nous voulons que leur soit interdit toute sorte de commerce tant par terre que par mer et que vous appliquiez vos forces joint avec celles d'Alger pour les faire déloger (44).
Les instructions données à Sanson avant son départ pour Tunis et Alger l'autorisaient à s'occuper de ce projet : " Ledit sieur Napollon assurera ledit sieur duc de Guise que S. M. lui a recommandé de voir par quel moyen il pouvait, sur ledit lieu de Tabarque être faite entreprise pour la faire exécuter par la milice du lieu, en cas qu'il soit jugé qu'il puisse réussir et non autrement, et en cas d'un bon et favorable succès il en donnerait avis à ladite Majesté et retirerait d'eux ledit lieu de Tabarque pour se fortifier en icelui le mieux qu'il lui serait possible, lui donnant ladite Majesté assurance de l'établir chef et gouverneur pour son service, et en attendant qu'il puisse sur cela recevoir ses commandements elle lui permet de faire levée de soldats pour garder ledit lieu de Tabarque, remettant à la suffisance et conduite dudit sieur Napollon toute cette entreprise, ne désirant pas sa dite Majesté qu'il y soit rien hasardé que bien à propos." (45)
Richelieu ne voulait pas que le nom du roi fût mêlé à cette entreprise, il espérait décider les Tunisiens à reprendre Tabarque, et il recommandait à son agent la plus grande prudence. En réponse à de nouvelles propositions faites par Sanson, il lui donnait pour instruction en 1629 de chercher seulement à pousser les Algériens à prendre Tabarque et à raser les fortifications (46). Sanson dut attendre quatre ans encore avant de pouvoir réaliser un projet qui lui était cher ; il et fut question sans doute lors de la visite de M. de l'Isle au Bastion puisque, pendant le séjour de celui-ci, le gouverneur écrivait au cardinal pour solliciter l'ordre d'agir contre les Génois (47). L'année suivante, il crut pouvoir s'emparer de l'île par surprise et noua des intelligences avec un génois employé dans le fort ; mais celui-ci le trahit et Sanson fut tué d'une mousquetade en dirigeant l'assaut à la tête d'une petite troupe composée des garnisons du Bastion et de la Calle. Telle est, du moins, la version adoptée par M. de Grammont dans sa biographie de Sanson Napollon. Mais l'écrivain du Bastion, Gatien, envoyait, le lendemain même de la mort tragique du gouverneur, un tout autre récit à du Gay, secrétaire du duc de Guise. D'après lui, Sanson avait été assassiné la nuit du 10 au 11 mai, " retournant de Cap Nègre ", par 6 frégates tabarquines armées pour cet effet. Les Tabarquins, disait-il, " ont mis sa tête sur le portail de leur forteresse et fait jeter son corps à la mer ; encore nous menacent-ils de nous venir attaquer lorsque leurs vaisseaux qu'ils attendent seront arrivés. Ils prennent le prétexte de cet assassinat sur ce qu'ils disent qu'ils avaient eu des nouvelles que ledit sieur Sanson voulait aller surprendre leur place, néanmoins ils ne l'ont rencontré ni dans leur île, ni avec des forces suffisantes pour cela, ainsi à la mer, accompagné de 7 ou 8 de ses domestiques et le reste mariniers, ce qui fait voir que c'est un faible prétexte et qu'ils n'ont été poussés à rechercher sa mort que par l'envie qu'ils portent à sa vertu et prospérité... Le caïd de Bonna est aujourd'hui arrivé qui nous fait offre de tout ce qui est en sa puissance et même de nous envoyer des soldats pour nous garder, ce que nous avons refusé " (48).
Ainsi périt prématurément l'homme qui contribua le plus à établir l'influence du nom Français en Algérie et en Tunisie au début du XVIIe siècle : son souvenir, vivant chez les Barbaresques, devait nous servir bien longtemps après sa mort. Son misérable échec à Tabarque était le prélude d'une série d'autres ; deux siècles de diplomatie ne devaient pas nous donner cette île toujours convoitée par nos marchands et par nos hommes d'État.
Sanson mourait laissant les Concessions d'Afrique solidement établies, garanties par des contrats en règle passés avec les Barbaresques et surtout, par les redevances stipulées en retour de leur jouissance. Pendant longtemps elles devaient passer par une série de vicissitudes mais elles ne devaient plus rester abandonnées. Dues à l'initiative de simples marchands Marseillais elles avaient vite attiré l'attention puisque, dès leur origine, les ambassadeurs du roi à Constantinople intervinrent pour en faire consacrer l'existence par les traités avec la Porte. Elles paraissaient assez importantes au début du XVII siècle pour que le duc de Guise tint à s'en réserver pour lui-même les bénéfices et pour que Richelieu s'en occupât tout particulièrement.
Ce n'était pas l'importance seulement de la pêche du corail ou du commerce qui valut aux Concessions cette attention du cardinal. Mais, sous couleur de pêche et de négoce, les Français étaient parvenus à prendre pied sur cette côte d'Afrique où les Espagnols n'avaient pu se maintenir et, dès lors, ils songeaient à reprendre pour leur propre compte ces projets de destruction des Barbaresques les successeurs de Charles-Quint et de Philippe il avaient dû abandonner Comme l'expliquait Napollon lui-même, leurs établissements permettaient aux Français de nouer des intelligences avec les indigènes, qui supportaient impatiemment le joug des Turcs, et de se tenir au courant de leurs mouvements. Le moment venu, ils faciliteraient singulièrement un débarquement des troupes royales.
Tous les Mores de l'Afrique, écrivait Sanson, ont fait ligue contre les Turcs et fait dessein de ruiner Alger et Tunis à cause des ravages et cruelles tyrannies qu'ils exercent contre lesdits Mores.... Lequel dessein ledit Sanson fait savoir en même temps à S. M. laquelle lui donna commandement de continuer soigneusement à tenir la main pour savoir la suite des desseins... Il y a environ trois ans que lesdits Mores se soulevèrent contre ceux d'Alger et ont défait et bataillé par quatre fois…… et ont tant d'intelligences dans lesdites villes qu'il se peut espérer que Dieu permettra qu'ils se déferont eux-mêmes (Ils espèrent) chasser les Turcs desdites villes, et, pour ce que lesdits Mores ne les pourraient et voudraient garder, Ils font offre de les remettre aux Français et m'ont prié que, quand Dieu voudra faire réussir leur dessein, d'en donner promptement avis au roi, afin que S. M. y envoie des personnes de sa part, auxquels ils remettront les villes sans mettre la main aux armes.
Du Bastion et par la grande confédération qu'on a avec le peuple il se peut toujours savoir ce qui se passe en Barbarie et cette côte se trouve acquise et assurée à S. M. sans qu'il lui coûte aucune chose pour l'entretien de ces places et, quand le temps sera favorable, S. M. peut faire débarquer tant de gens de guerre qu'il lui plaira, sans aucun danger, ni difficulté, et se trouvera en les dites places toute la quantité de vivres et victuailles qui seront nécessaires pour la nourriture desdites gens de guerre.
Il est nécessaire de conserver lesdites places sous couleur de négoce et pêche de corail afin que le dessein de faire les dites conquêtes ne soit pas connu.".
Un mémoire de décembre 1629, sur le Bastion et les commodités qu'on en peut retirer, exprimait non moins nettement la même pensée : " Cette place est de très grande considération.... soit pour retraites aux galères du roi en plusieurs occasions qui se pourraient présenter, soit pour servir un jour de degré à la conquête d'Alger, et la place peut-être, par un homme adroit, petit à petit et insensiblement si bien fortifiée qu'il ne soit pas facile ou possible aux Turcs de nous en chasser". Deux siècles après, les prévisions des conseillers de Richelieu allaient devenir des réalités.
APPENDICE :
(1) C'est sans doute à ce séjour que fait allusion le passage suivant d'un mémoire de Sanson Napollon lui-même : " Il y a environ dix ans que le sieur Sanson Napollon se trouvant à Constantinople, les principaux ministres du Grand Seigneur lui dirent que, sil voulait redresser ledit Bastion, qui ils lui en feraient bailler la permission du dit G. S. Ledit Sanson, sachant bien que ceux d'Argers n'obéissent nullement aux commandements du G. S. quand il y va tant soit peu de leur intérêt, rejeta son avis et ses offres... Deux ans après, certains des principaux dudit Argers, intimes amis dudit Sanson, lui donnèrent avis que s'il voulait entreprendre de rétablir ledit Bastion, qu'ils lui en rendraient faciles les moyens, lui faisant offre de l'assister outre leur crédit jusques à la somme de 300.000 livres, à quoi néanmoins ledit Sanson n'aurait voulu entendre, attendu le dessein qu'il avait vu que ledit seigneur duc de Guise avait de rétablir ledit bastion et sans l'assistance et faveur duquel ledit rétablissement ne se pouvait faire, en effet. " Bibl. nat. Mss. fr. 16161. fol 7-12. D'après un mémoire de 1685, Sanson étant consul avait fait un riche chargement sur le vaisseau du capitaine Gazille, son parent, qui fut pris par les Algériens. Il ne put obtenir la restitution élu bâtiment et Gazille, ayant noué des intelligences à Alger, lui persuada qu'on pourrait en échange obtenir le Bastion. Mém sur l'entrée du Bastion, 2 avril 1685. Arch. Des colonies Cie du Bastion, 1639-1751. - Ce Gazille fut plus tard employé au Bastion.
(2) Aff. étrang. Mém. et Doc. Alger, Tunis. fol. 18-19: Commission baillée à M. de Guise pour traiter la paix de Barbarie, du 28 janv. 1636. - Cf. Lettres patentes du 29 janvier 1626 donnant commission au duc de Guise pour traiter la pais avec les divans de Tunis et d'Alger et l'autorisant à déléguer Sanson Napollon en Barbarie. Arch. Nat. marine. B7. 49. fol. 60-64. Ibid. fol. 64-76
Instructions à Sanson Napollon envoyé en Alger... comme subdélégué pour ce faire par M. le duc de Guise, le 14 févr. 1626. Publié en partie par Plantet. Tanis. T. I. n° 98. - Cf. Aff. étrang. Mém. et doc. Afrique. T. VIII. fol. 16-20.
(3) C'est ce qui est rappelé dans un mémoire rédigé pour faire valoir les droits de la famille de Guise et dans l'arrêt du Conseil du 28 juillet 1639 qui reconnut ces droits. Les Guise produisirent une lettre du roi à l'ambassadeur de Césy, de 1621, montrant que les négociations pour la réédification du Bastion avaient été entreprises à l'instigation du duc de Guise : " plusieurs traités et lettres originales des bacha, divan et officiers d'Alger au sieur duc de Guise et entre autres la lettre du chérif datée du Bastion de France du 10 mars 1629 portant l'établissement dudit Sanson Napollon comme procureur dudit sieur de Guise dans ledit Bastion : cinq lettres originales dudit Sanson Napollon audit sieur de Guise des années 1628 et 1629 touchant sa négociation, par lesquelles il se justifie que ledit sieur de Guise fournissait toutes les sommes d'argent nécessaires tant pour obtenir la permission de réédifier ledit Bastion que pour le munir de toutes sortes de provisions ".Aff. Étrang. Mém. et doc. Alger. T. XI. Fol. 122. Cf. fol. 108.
(4) D'après La Primaudaie. p. 18-19, et Féraud. p. 121. Il y avait eu pendant les négociations une nouvelle tentative à main armée pour prendre le Bastion par d'Argencourt, envoyé du duc de Guise. D'Argencourt, après avoir commencé les travaux depuis quelques jours, aurait été attaqué par la milice de Bône et obligé de se rembarquer après avoir essayé vainement de parlementer, puis de résister. Féraud cite comme références Ruffi. Hist. de Mars, et les Mss. de Brienne à la Bibl. nat. Je n'ai rien trouvé concernant cette expédition de 1626. Pareille équipée au milieu des négociations semble d'ailleurs bien invraisemblable. Les deux auteurs ont dû confondre avec l'expédition de 1629. D'Argencourt mourut en 1635 gouverneur de Narbonne et surintendant des fortifications de France. - Cette expédition de d'Argencourt est mentionnée à la date de 1628, dans un mémoire de l'archivaire de la Cambre de Commerce. Isnard. de 1775. Arch. des Bouches-du-Rhône (C. 2460). Mais les mémoires du XVIIIe siècle fourmillent d'erreurs au sujet de 1'histoire des Concessions d'Afrique.
(5) Mémoires du duc de Guise au sieur Lempereur, pour traiter avec M. l'ambassadeur de Const. pour obtenir trois commandements du G. S. aux bassas d'Alger, Tunis, Tripoli, de laisser rétablir le Bastion, 1627. Bibl. nat. mss. fr. 16164, fol. 89.
- Voir les commandements envoyés par Césy, fol. 90 et 92.
(6) Pour ces négociations embrouillées de 1626-28 voir surtout : Bibl. nat. mss. fr. 16164 (série de pièces) ; ibid. mss. fr. 16167 (foi. 337-79) ; ibid. mss. fr. Nouv. acq. 7049. - Aff. étrang. Mém. et doc. Alger, T. XII, fol. 20-52 (série de pièces).
- Arch. nat. marine, B7, 49 (série de pièces), p. 52-107. On y trouve entre autres, une lettre de Savary de Brèves, ambassadeur du roi à Alger, à M. d'Herbault, secrétaire d'État, 29 déc. 1627, p. 93.97. De Brèves, quelque temps avant sa mort (1628) aurait donc été mêlé à la négociation. - Cf. de Grammont. La mission de Sanson Napollon. Léon Bourguès, Sanson Napollon ; Plantet, Corresp. des deys d'Alger, T. I, p. 25-41.
Les documents des archives n'ont pas encore été suffisamment utilisés. Voici, d'après Sanson lui-même, quel avait été le prix de la paix : " La ville de Marseille a fourni 24,000 écus ; le duc de Guise 10,000, les capitaines des galères 8,000 ; on a perdu en la recette dudit argent 2,000, Napollon en a retiré 3,400, on a dépendu pour avoir conduit trois vaisseaux de Turcs en Alger 7,000, pour finir le traité de paix 70,000, et pour le rachat de 321 esclaves 60,000 ". Bibl. nat. mss. fr. 16164 : Mém. du sieur Sanson de ce qu'il a dépensé et reçu pour les affaires du roi en Alger, 27 mai 1631, fol. 117.
(7) V. de Grammont. La mission de Sanson et Napollon.
(8) Voir le texte dans la Collect. de Doc. inéd. Correspondance de Sourdis. T. II, fol. 383-88. Il y a de nombreuses copies du même traité : Aff. étrang. Mém. et doc. Turquie, T. II, fol. 238-43 (cf. fol. 222-35). Bibi. Nat. mss. Ve Colbert, 483, fol. 467. mss. fr. 7161. fol. 173-184 ; mss. fr. 23386, fol. 269-74 ; mss. (r. 16164, fol. 103-106: (Cf. mss. fr. 4140 : Traité de paix avec ceux d'Alger, 1626, fol. 3-8). Arch. Nat. marine. B7, 49, p. 108.120. - M. Boutin ignore l'existence de ce traité.
(9) Teneur du contrat passé avec le Divan et Conseil d'Argers pour le rétablissement du Bastion et ses dépendances. Biblioth. Nat. Mss. Fr Nouv. Acq. 7049, fol. 246-47. - Publié déjà par Charles de Rotalier, Histoire d'Alger. Pièces justificatives, n°1.
(10) Plusieurs historiens ont évalué faussement les 26,000 doubles de la redevance stipulée. Le préambule dit expressément : " Lesdites deux parties (10,000 + 16,000 doubles) réduites en monnaie de France montent seize mil livres. " Bibl. nation. Mss. fr. Nouv acq. 7049, fol. 215. (Pourtant Plantet, p. 40, note 1, et de Grammont disent 18.000 livres).
(11) Arch. nat. marine. B7, 49, p. 48-49.
(12) Dan. Hist. de Barbarie. p. 54-55. - Davity. Afrique. p. 215, a copié le P. Dan. - Sanson Napollon, dans son voyage à la Cour. en 1631, rapporta les premiers plans des établissements. V. mss. fr. 16164 en tête : Plans du bastion de la Calle Mascarez, du cap de Rose et un peu de la coste. Il y a là quatre plans curieux : 1° Un croquis de la côte, depuis Bône jusqu'au-delà du Cap Nègre. La frontière tunisienne est marquée par un trait. Du côté algérien, il y a : La Costa che guardano li Franciessy in Barbiria. - 2° Plan du Bastion. - 3° Plan de la Calle (le port nommé La Calle Masagueles) : sur une presqu'île à l'ouest du port, il y a : Montaigne où le baron d'Allemaigne et Argencour c'étaient fortifié. - 4° Capo di Rosa.
(13) État de ce qui est nécessaire pour l'entretien du Bastion, la Calle, cap de Roze, la maison de Bône et celle d'Alger, construites par Sanson Napollon... par commandement de S. M. comme il appert par l'instruction que S. M. lui fit expédier par M, de la Villeauderts secrétaire de ses commandements, en l'année 1626. - Biblioth. Nat. Mss. fr. Nouv. Acq. N° 7049, fol. 237-43.
Féraud a publié ce document in extenso, p. 129-142 et de Rotalier en partie. Pièces justificatives, n° 2. - La Primaudaie (p. 21-24).
(14) Mesure vaut 120 livres, poids de marc.
(15) D'après Davity (Afrique. p. 214-215), Sanson Napollon aurait rebâti le Bastion à l'est de l'ancien qui aurait été au cap de Roze : " A 20 milles de Bône tirant toujours au Levant l'on voyait autrefois près du cap de Mascara ou Massacaresse, comme les Italiens l'appellent, la Cale et petit réduit, où se tenaient les vaisseaux qui venaient charger au Bastion de France, et au cap de la Roze on voit les ruines de ce bastion démoli depuis quelques années par la milice d'Alger... Mais le nouveau Bastion français a depuis été fait à quelque douze mille ou du moins plus de trois lieu du vieil, tirant toujours au Levant. Le port de la Calle qui est à 7 milles plus haut vers le Levant, qui est le port du Bastion... ".
(16) 17 janvier 1629. Arch. de la Chambre. AA. 462.
(17) 13 février 1632. - Des lettres émanant de personnes employées à divers titres au Bastion et à la Calle. Lazarin de Servian, Lorenzo d'Angelo. Jacques Massey, et autres, confirment les allégations du capitaine. Arch. de la Chambre AA. 508. - Lazarin de Servian avait été capitaine de quartier puis deuxième consul à Marseille (Bourguès).
(18) Aff. étrang. Mém. et doc. Alger. T. 12. fol. 122.
(19) Arch. des colonies. Cie du Bastion. 1639-1731. Mém. sur l'entrée du Bastion... - Le P. Dan écrivait en 1634 : " On fait ordinairement au Bastion un trafic avantageux et riche qui est de quantité de corail, blé, cire, cuirs et de chevaux barbes que les Maures et Arabes voisins y viennent vendre à très bon prix. " - " Cette place est de très grande considération.... qui peut servir.... soit pour transport de blés en France en cas de famine, soit en Italie et en Espagne en tout temps, ce qui est d'un revenu infini. " Mém. de décembre 1629. Mss. fr. 16164.
(20) Des lettres de 1629 témoignent des bonnes intentions des Algériens. Bibl. nat. Mss. fr. 7161. fol. 187-190: - " La milice résolue de brûler tous ceux qui nuiront et molesteront les Français. " - A la fin de 1631 il y avait presque rupture complète. Les Marseillais demandaient que le roi déclarât la guerre à ceux d'Alger. Sanson écrivait à l'évêque de Saint-Malo au début de 1632 que l'agent qu il avait envoyé à Alger n'avait rapporté d'autre réponse sinon que les Français avaient rompu les premiers et avaient retiré leur consul sans dire adieu. Mss. fr. 16164. fol. 154-155.
(21) Leur père, Louis Morenc, dit Fréjus, baptisé aux Accoules le 22 février 1585, avait épousé Henrique de Servian, et devint 3ème consul de Marseille en 1642 Bourguès).
(22) De Grammont (La Mission de Sanson Napollon) a fort bien expliqué les causes de l'opposition contre Sanson (p. 230-233) ; il a publié une série de lettres de Ricou et de Blanchard (p. 310-330, 383 et seq.). - Cf. Plantet. Corresp. des deys d'Alger, p41-42. - V. Arch. de la Chambre de Comm. AA, 462-463, quelques lettres de Ricou et Blanchard. - Aff. étrang. Mém. et doc. Alger, T.XII, fol. 59-63 : Procès-verbal du Consul d'Argers... ; fol. 61-77 Déclaration de ce qui s'est passé à Alger entre le Consul de France et Sanson Napollon, 20 août 1630. Ricou prend le titre de " Consul pour le Roi et député de la ville de Marseille " ; en réalité, il n'avait pas le titre de consul. V ci-dessous, chap. 3. - Même document aux Arch. nat. marine, B7, 49, p. 324-31. Les historiens de Sanson Napollon se sont peut-être montrés trop exclusivement favorables à leur héros. On prouverait peut-être sans peine, en examinant de près les récriminations acerbes échangées des deux côtés, que Sanson et les agents de sa Compagnie cherchèrent à profiter de la faveur dont ils jouissaient pour rendre la situation intenable à Alger aux autres résidents français, tous marseillais comme eux.
(23) V. la curieuse lettre de Sidi Amonda, premier secrétaire du divan, à Sanson, de février 1629: Le consul d'ici nous a dit que le peuple de Marseille vous en voulait à cause que vous aviez relevé votre Bastion et qu'il n'était pas content de vous. Par le Dieu Très-Haut et par le Saint Prophète, si nous entendons qu'ils en veulent à d'autres que vous par envie, nous romprons la paix à tout jamais... Toute la milice vous aime et prie Dieu qu'il accroisse votre amitié en leurs âmes… Ne vous contristez de rien, et si vous êtes aucunement troublé par ceux de votre pays, faites le-nous savoir et nous romprons la paix ". Plantet, p. 41-42.
(24) V. Arch. de la Chambre. AA. 462, les lettres de Sanson.
(25) Bibl. nat., mss. fr. 7161 , fol. 190-202.
(26) Copies de lettres écrites par le Roi et par Mgr le Cardinal au sieur Sanson (1631-32). Mss. fr. 16164, fol. 133-149
(27) Fait à Fontainebleau le 8 octobre 1631. Aff. étrang. Mém. et doc. Alger, t. XII, fol. 84-88. - Cf. Arch. nat. marine, B7, 49. p. 355-66.
(28) Le nom du duc de Guise est laissé en blanc, mais les 12.000 écus dont il est question ensuite montrent évidemment qu'il s'agit de lui.
(29) Mss. fr.16164, fol. 13-16. Minute avec ratures, sans date. - Ce dernier passage montre que le duc de Savoie convoitait les établissements français. Cf. ci-dessous, au sujet du cap Nègre - Cf. Ibidem, fol. 24. Mémoire touchant l'établissement du Bastion : " Il est très important au service du roi de soigneusement considérer celui en la puissance duquel doit être cette place… car il faut se donner de garde que celui qui en aura en France la disposition ne soit tel que, dès qu'il l'aura fait fortifier, il ne sen qualifie prince souverain et qu'il soit aussi de tel jugement et prudence, qu'il sache si bien choisir celui qu'il enverra pour garder la place qu'il ne la perde par avarice, par imprudence, par infidélité… Par avarice et imprudence, elle a déjà été perdue une fois... Par infidélité, car elle serait à la bienséance des Génois... et plus encore des Espagnols qui, depuis 100 ans, tentent tous les moyens qu'ils peuvent d'avoir un port en cette cote est, et joignant les montagnes où commande un petit roi nommé le roi de Conque sans lequel en l'an 1606 le roi d'Espagne avait intelligence et lui envoyait des armes… Sanson Napollon qui y est maintenant est homme habile. Je pense qu'il soit homme de bien, mais il est homme de fortune. Corse de nation et qui n'a point ou comme point de bien en France. Semble que cela doit être considéré. " Décembre 1629.
(30) Coll. de doc. inéd. Lettres de Richelieu, t. IV, p. 205. - Au moment où de l'Isle arrivait seulement au Bastion, le cardinal écrivait à Sanson comme s'il n'avait pas besoin d'être assuré sur son compte : " Quant à ce qui est de la fortification du Bastion, du trafic et de la pêche du corail, je m'en remets à ce que monsieur l'évêque de Saint-Malo en a arrêté de ma part avec vous, à ce que de temps en temps il vous écrira. Lettre du 19 avril 1632. Ibid., p.282.
(31) Procès-verbal de la visite de M de l'Isle. par Charles Gatien, écrivain du Bastion. bibl. nat. Mss. fr. nouv. acq, 7049, fol. 243-63. Les documents relatifs à cette mission ont été publiés d'après ce manuscrit par Féraud. La Calle, p. 143-150. - Cf. Mss. fr. 161614, fol. 152-153: Mém. du sieur de Lisle, de ce qu'il a fait avec les Marseillais. 15 janv. 1631. - Arch. nat. marine, B7, 49, p. 368-75 : Lettre de De Lisle sur ce que lui ont dit les consuls de Marseille, 11 décembre 1631.
(32) Réponse des consuls de Marseille à une lettre qui leur a été écrite par le corse Sanson, 15 juin 1632 (Imprimé, 21 pages in-18). Mss. fr. 16164, fol. 165-175.
(33) Arrêt du Parlement d'Aix contre Honoré Bettandier de Marseille et Roize, imprimeur à Aix. 22 octobre 1632. Ibid. fol. 46-47.
(34) Lettre du 8 décembre 1632. ibid. fol. 182-183.
(35) Sanson à l'évêque de Saint-Malo, au cardinal, 15 octobre 1632, de l'Isle Antry à Gaston d'Orléans, 1er décembre 1632 : du Gay à l'évoque de Saint-Malo. 29 janv. 1633. Mss. fr. 16164. fol. 176-182, 194.
(36) Ibid. fol. 185-191.
(37) Rapporté par La Primaudaie (p. 42-43), mais d'après quelle source ?
(38) Arch. des Aff. étrang. Mém. et doc Afrique. T. VIII. fol. 21. Ce Mémoire porte à tort la date de 1629 : i1 est de 1612, comme la lettre de M. de Viens citée plus loin
(39) Aff. étrang. Ibid. fol. 22. - Cf. Plantet. Tunis, t. II, p. 131 et 175. - Lettre d'Estelle à Richelieu, nov. 1632. Aff. étrang. Mém. et doc Afrique. t. VIII, fol. 40. - Sanson Napollon se plaint aussi dans une lettre du 13 octobre 1633 que les affaires du cap Nègre sont traversées par quelques Français, " à la faveur du duc de Savoie " Mss. fr. 16164 fol 176-177.
(40) collect. de doc. inéd. Lettres de Richelieu. t. IV. p 282. Le cardinal répond à Sanson qui lui a fait part de ses projets de constructions au Bastion et autres places. J'ai reçu les plans que vous m'avez envoyés par le sieur Dugué qui m a promis de m'en bailler d'autres plus exacts quand lesdites places seront achevées.
(41) Gatien à du Gay, conseiller et secrétaire de M. le duc de Guise, 12 mai 1633. Mss. fr. 16164, fol. 200. - Lettre du 3 janv. ibid. fol. 191. - Cf ibid. fol. 219 État des officiers qui commandent... : au cap. Nègre, neveu de Ragel bey.
(42) Taxil, agent de la Compagnie des Indes à Marseille, à l'abbé Raguet, directeur à Paris, 19 avril 1726. Plantet, Tunis. T. II, n. 392. - Cf. Peyssonnel, p. 255.
(43) La Primandaie, p. 45-46.
(44) " Il faut marquer que les plus grands ennemis du Bastion sont les Espagnols qui ne voudraient pas que les Français fussent si proches voisin de Tabarque." Discours au vrai, etc. Mss. fr. 16164. - Cf., au sujet des craintes qu'inspiraient les Espagnols, ci-dessus, p 41 note.
(45) Instruction à Sanson Napollon, du 14 févier 1626. Plantet. Tunis, t. I, pièce 98
(46) Quant à la proposition que fait ledit Napollon de saisir du fort de Tabarque qui est tenu par ladite République S. M. consent et aurait bien agréable que ledit Napollon portât ceux d'Alger à le prendre et le faire raser à l'instant sans y mêler le nom du roi, ni des Français, estimant plus à propos d'en user de cette sorte que d`accepter ledit fort au nom de S. M., présupposé que les trois forteresses que tient ledit Napollon soient suffisantes pour tenir et conserver aux Français tout le commerce de Barbarie." Aff. Étrang. Mém ; et doc. Alger T. XII fol. 57. Ces instructions du 29 décembre 1829 se tiennent aussi aux Arch. nat. Marine, B7, 49, p. 279-83.
(48) Lettre du 25 avril 1637; citée par de Grammont. Voir celui-ci p. 374-76 pour le récit de l'expédition de Tabarque.
(48) Mss. fr. 16164, fol. 200-201. - Fol. 205 du même mss. est Insérée la simple note suivante, griffonnée : " Le marchand Bettandier a donné avis que Napollon avait dessein sur Tabarque, l'a dit à Floracio Tridi qui l'a écrit à Burgos à Tholon" Serait-ce une indiscrétion voulue de ses ennemis qui causa la mort du capitaine du Bastion ? - De Grammont n'indique pas le source de son récit. En note, il cite une information publiée par la Gazette de France, datée de Marseille. 26 mai 1633. Cette information ne concorde pas très bien avec les détails qu'il donne. " La garnison du château de Tabarque, s'étant imaginée que le capitaine Sanson, gouverneur du Bastion, avait quelque entreprise sur cette place, le tuèrent d'une mousquetade en la tête. Bourguès a copié purement et simplement de Grammont.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
| On nous appelle "Pieds Noirs"
Décembre 1962 Camille Bender
Envoyé Par Georges
| |
On nous appelle "Pieds Noirs" et ces deux mots jetés
Péjorativement, souvent comme une insulte,
sont devenus pour nous bien plus qu'un sobriquet.
On nous appelle "Pieds Noirs" avec cette nuance
De dédain, de mépris attachée à ces mots
Qui pour nous, ont un sens de plus grande importance
On nous appelle "Pieds Noirs", nous acceptons l'injure,
Et ces mots dédaigneux sont comme un ralliement
Comme un drapeau nouveau, comme un emblème pur
On nous appelle "Pieds Noirs", il y a sur nos visages
Le regret nostalgique des horizons perdus,
Et dans nos yeux noyés, d'éblouissants mirages.
On nous appelle "Pieds Noirs" il y a dans nos mémoires
Le souvenir joyeux des belles heures d'autrefois,
De la douceur de vivre, et des grands jours de gloire.
On nous appelle "Pieds Noirs", ami, te souviens-tu
De nos champs d'orangers, de nos coteaux de vigne,
Et de nos palmeraies, longues à perte de vue ?
On nous appelle "Pieds Noirs", mon frère, te souvient-il
Du bruyant Bab-el-Oued, d'El Biar sur sa colline,
Des plages d'Oranie, du glas d'Orléansville ?
On nous appelle "Pieds Noirs", là-bas dans nos villages,
Qu'une croix au sommet d'un clocher dominait,
Il y a un monument dédié au grand courage.
Les nommait-on "Pieds Noirs" les morts des deux carnages
De 14 et 39, les martyrs, les héros
Qui les honorera maintenant tous ces braves ?
On nous appelle "Pieds Noirs", mais ceux qui sont restés,
Ceux de nos cimetières perdus de solitude,
Qui fleurira leurs tombes, leurs tombes abandonnées ?
On nous appelle "Pieds Noirs" nous avions deux patries,
Harmonieusement si mêlées dans nos coeurs,
Que nous disions "ma France", en pensant "Algérie"
On nous appelle "Pieds Noirs" mais nous sommes fiers de l'être
Qui donc en rougirait ? Nous ne nous renions pas
Et nous le crions fort, pour bien nous reconnaître
On nous appelle "Pieds Noirs", nous nous vantons de l'être
Car nous sommes héritiers d'un peuple généreux
Dont l'idéal humain venait des grands ancêtres
On nous appelle "Pieds Noirs" qu'importe l'étiquette
Qu'on nous a apposée sur nos fronts d'exilés,
Nous n'avons pas de honte, et nous levons la tête.
Ô mes amis "Pieds Noirs" ne pleurez plus la terre
Et le sol tant chéris qui vous ont rejetés,
Laissez les vains regrets et les larmes amères
CE PAYS N'A PLUS D'ÂME, VOUS L'AVEZ EMPORTEE.
|
|
|
| CAHIERS DU CENTENAIRE DE L'ALGÉRIE N° 3
PAR M. J.- M. BOURGET
|
|
L'ALGÉRIE
TROISIÈME PARTIE
L'ALGÉRIE ET LA FRANCE
I
L'expédition de 1830
La cause profonde de l'expédition française contre Alger en 1830 est l'impossibilité, dans l'Europe moderne, de tolérer longtemps la situation extravagante créée en Méditerranée par les agissements de la Régence. La menace perpétuelle qu'ils faisaient peser sur le trafic était insupportable. La flotte anglaise, envoyée en 1816 devant Alger, sous le commandement de lord Exmouth, n'avait pas obtenu un résultat durable. En dépit de la suppression officiellement promise de l'esclavage, le Dey maintenait en fait ses prétentions : au début de 1824, trois vaisseaux espagnols avaient été capturés par les Algériens et les équipages condamnés aux travaux publics. Au mois, de mars, le capitaine de vaisseau français du Buisson obtint leur libération, mais la question n'était pas réglée pour cela. Elle devait l'être fatalement, par une puissance ou par l'autre, dans un avenir prochain.
L'occasion est bien connue. Les Bacri et les Busnach, juifs algériens qui avaient le monopole des grandes affaires dans la Régence, avaient fait à la Première République des fournitures de grains qui n'étaient pas encore réglées en 1815. Le gouvernement de la Restauration comprit cette créance dans la liquidation générale qu'il avait entreprise : un accord de 1819 en fixa le montant à 7 millions de francs.
En 1827, la somme n'était pas encore recouvrée. Des créanciers de Bacri s'étaient révélés et mettaient opposition aux paiements. Les tribunaux étaient saisis, à charge d'examiner le bien fondé de leurs réclamations. D'où la lenteur extrême. Mais, de son côté, le Dey d'Alger était aussi créancier de Bacri, et il insistait avec la plus grande véhémence pour que son débiteur fût enfin payé. C'était au Consul de France à Alger, Deval, à lui faire prendre patience. L'affaire finit mal. Après une lettre à notre Ministre, des Affaires étrangères, le Dey Hussein passa de la menace aux actes. Le domicile de notre agent consulaire à Bône fut violé, des bâtiments français furent visités par des Algériens dans les eaux de la Corse, et des bâtiments sous pavillon pontifical capturés. Enfin, le 30 avril 1827, au cours d'une audience, le Dey, hors de lui, frappa trois fois Deval de son chasse-mouches et le congédia.
 Hussein PACHA, d'après Fernel.
Hussein PACHA, d'après Fernel.
Réaction française immédiate et conforme à la tradition : une escadre se présenta devant Alger et son chef exigea excuses et réparations. Hussein refusa tout : Notre Consul et nos résidents s'embarquèrent. Les côtes furent déclarées par la France en état de blocus. Hussein répliqua en ordonnant la destruction du comptoir français établi à la Calle. Le résultat était, lui aussi, conforme à la tradition.
Il devint évident que la flotte à elle seule ne pourrait amener la décision.
Le ministre de la Guerre, Clermont-Tonnerre, se rendit à l'évidence et proposa au Conseil des Ministres une expédition militaire, un débarquement (Il octobre 1827) : il se heurta à l'opposition du Président du Conseil Villèle, et celle du Dauphin. Le Cabinet suivant (Martignac) se contenta de maintenir le blocus et chercha à reprendre les tractations. C'était encourager la résistance du Dey, déjà poussé dans cette voie par le Consul d'Angleterre.
Un peu plus de deux ans après le " coup d'éventail ", en juillet 1829, le Dey poussa l'audace jusqu'à faire canonner, malgré le pavillon parlementaire, la Provence bord de laquelle se trouvait le capitaine de vaisseau de la Bretonnière, reçu la veille en l'audience sans résultat. Hussein rejeta bien la responsabilité de la canonnade sur son ministre de la Marine. Mais la destitution de ce haut fonctionnaire n'était pas une satisfaction suffisante pour la France.
Polignac, qui venait de succéder à Martignac, ne parut pas, d'abord, plus décidé que son prédécesseur à entamer une guerre en Afrique. Sur la proposition de notre Consul au Caire, Drovetti, il pensa à une alliance avec Méhémet-Ali, le vice-roi d'Egypte, qui se présentait comme le plus entreprenant des héritiers éventuels de la Porte. Cette idée rentrait dans le plan général de liquidation de l'Empire ottoman que caressait Polignac. Celui-ci était sur le point d'admettre les conditions singulièrement décevantes posées par Méhémet-Ali : il trouva une vive résistance chez ses collègues, notamment chez le ministre de la Marine, le baron d'Haussez, qui convainquit le roi Charles X de l'impossibilité, entre autres choses, de céder au vice-roi d'Egypte, comme il le demandait, quatre bâtiments de la flotte de guerre française. Au reste, l'attitude de la Russie et de la Prusse rendit bientôt caduc le grand projet du ministre des Maires étrangères.
Les circonstances ne laissaient plus d'autre issue que l'action militaire, le débarquement. Il fut décidé, en conseil des Ministres, le 31 janvier 1830 et publiquement annoncé le 3 mars suivant.
L'objet essentiel de l'expédition était de venger l'insulte faite au pavillon français. Certaines réserves contenues dans les instructions données au général de Bourmont, commandant en chef, portaient que celui-ci devait s'abstenir, dans ses relations avec la population et les chefs, de quoi que ce fût qui pût engager l'avenir. Mais, en dehors de la soumission complète, d'ailleurs improbable, ou de l'éviction définitive du Dey d'Alger et de l'administration turque, rien n'était expressément prévu : l'idée directrice semble avoir été de prendre pied à Alger et sur certains points de la côte; il n'y a pas trace d'intentions "colonisatrices "
Au reste, dans ses circulaires aux puissances, Polignac affirmait au nom du Roi de France que, si le gouvernement du Dey venait à disparaître, une conférence internationale réglerait le sort de là Régence. L'intérêt général de l'Europe était évidemment que le nid de pirates fût détruit, et les grandes puissances se contentèrent des assurances données.
Toutes, sauf une, l'Angleterre. Le Cabinet de Saint-James, à plusieurs reprises, demanda des explications supplémentaires et avant tout l'engagement formel que nous ne resterions pas à Alger. C'était là évidemment sa crainte, car il voyait dans notre installation éventuelle sur la côte nord de l'Afrique une menace grave pour sa prépondérance maritime, affirmée jusqu'en Méditerranée.
Son Consul à Alger prodiguait les encouragements au Dey Hussein. Déjà, en 1824, Du Buisson, en arrivant devant Alger, avait essuyé un coup de canon d'un navire britannique. Le sang-froid et la fermeté du commandant de l'Hermione avaient évité un incident grave.
Le gouvernement français ne se laissa pas intimider. Le baron d'Haussez eut, à la fin d'avril, avec lord Stuart, ambassadeur de la Cour de Londres à Paris, une conversation parfaitement nette. Le prince de Polignac affirmait une énergie et une décision égales.
***
La situation politique intérieure en France était infiniment moins favorable.
Le ministère Polignac (" Coblence, Waterloo, 1815 ") était considéré, dès ses débuts, comme un ministère de coup d'Etat. La personnalité du ministre de la Guerre, le général-comte de Bourmont, était particulièrement discutée. A la première nouvelle d'une expédition contre Alger, l'opposition se déchaîna dans la presse, dans des brochures ; perdant de vue, comme il arrive souvent, l'intérêt national, pour s'en tenir à l'intérêt de parti, elle divulgua des renseignements relatifs à l'opération, et ce fut un grief que releva Polignac dans son rapport précédant les ordonnances de Juillet.
Ces divulgations ne furent pas nuisibles. Remarquons-le cependant : première entreprise africaine de la France au XIXe siècle, l'expédition d'Alger connut, comme toutes celles qui l'ont suivie, l'hostilité peu éclairée d'une partie de l'opinion dans la Métropole. Il n'est pas certain, d'ailleurs, que le gouvernement n'ait pas espéré trouver dans la victoire un moyen de faire admettre plus facilement sa politique intérieure.
La préparation de l'entreprise fut assurée par le général de Bourmont, d'abord comme ministre de la Guerre, puis, après le 11 avril, comme commandant en chef. Le souvenir de 1815 ne le gêna pas plus en 1830 qu'il ne l'avait gêné pendant la campagne d'Espagne (1824) dans l'exercice de son commandement. L'expédition provoqua un grand enthousiasme dans l'armée.
Le rappel de 11.000 hommes en congé d'un an se fit sans difficulté. Il fut formé un corps expéditionnaire fort de 37.612 hommes. L'infanterie était répartie en trois divisions : la 1ère division Berthezène (brigades Poret de Morvan, Achard et Clouet), la 2e, division Loverdo (brigades Damrémont, Monck d'Uzer et Colomb d'Arcine), la 3e, division du duc des Cars (brigades Berthier, Hurel et de Montlivault). La cavalerie était constituée par un régiment de chasseurs d'Afrique formé de deux escadrons du 17e et d'un du 13e chasseurs. L'artillerie, commandée par Lahitte, comprenait 5 batteries de campagne et 10 batteries de siège, avec 2.300 artilleurs. Le génie (Valazé), fort de 1.300 hommes, comprenait deux compagnies de mineurs, six de sapeurs et un demi train du génie. Les fonctions de chef d'état-major étaient remplies par le lieutenant-général Desprez, celles de sous-chef par le maréchal de camp Tholozé. L'intendance, dirigée par l'intendant-général Denniée, opéra par voie d'achats à la commission, dont fut chargée la maison Sieillière de Marseille.
Aussi bien en ce qui concerne la concentration des troupes que les services, la préparation fut très minutieusement menée. Des effets spéciaux furent distribués, le service de santé organisé d'une façon remarquable pour époque. Les 25 jours de vivre de débarquement, que Bourmont avaient jugés nécessaires, furent l'objet de soins particuliers et toutes les précautions firent prises pour qu'ils parvinssent aux troupes en parfait état.
La flotte chargée du transport était constituée par 103 bâtiments de guerre (1.872 canons) et 347 navires de commerce. La flotte de guerre était répartie en trois escadres : escadre de bataille transportant la 2e division et comprenant le bâtiment amiral, La Provence ; escadre de débarquement, transportant la 1ère division et l'artillerie de campagne ; escadre de réserve, transportant la 1ère brigade de la 2e division. Le reste de l'armée était transporté par le convoi (bâtiments de commerce). Une flottille de 195 embarcations (escadrille de débarquement) devait amener les troupes à terre ; un dispositif spécial permettait, en cas de besoin, de se servir de l'artillerie embarquée sur les chaloupes ou chalands.
Il n'y avait, dans l'organisation, qu'un point faible. C'était malheureusement un point important. La flotte, commandée par l'amiral Duperré, devait, en vertu des instructions du gouvernement, coopérer avec l'armée pour la réussite de l'oeuvre commune. Les instructions remises à Duperré établissaient en fait sa subordination par rapport à Bourmont, mais non d'une façon explicite. Seule une instruction spéciale et secrète, remise à Bourmont, avec ordre de ne s'en servir qu'en cas de nécessité absolue, lui donnait le commandement de l'ensemble.
Cette situation n'étant pas officiellement proclamée, un certain nombre de difficultés se produisirent dans le voyage. Les navires français étaient encore des navires à voile, moins aisés à manier que des bateaux à vapeur ; de ce chef, les " nécessités techniques " prenaient une valeur particulière. Les marins semblaient professer une méfiance spéciale à l'endroit des opérations de débarquement. Tradition, peut-être, comme le montrent les opérations de la guerre d'Amérique. En tout cas, l'amiral Roussin, à qui l'on avait songé d'abord pour prendre le commandement, avait déclaré qu'on ne trouverait pas un officier pour l'exercer, et l'amiral Duperré avait demandé l'ajournement à 1831. Les jeunes, officiers de marine, notamment Dupetit-Thouars, étaient d'un avis différent. Mais il y avait là une cause de difficultés et de malentendus.
***
Le Dey d'Alger était réduit à ses seules forces. Il n'avait rien à attendre de la Turquie, dont la suzeraineté était purement nominale. Et même, quand le général Guilleminot, notre ambassadeur à Constantinople, avait demandé à la Porte d'intervenir pour mettre Hussein à la raison, on lui avait laissé clairement entendre qu'on ne pouvait rien. A la dernière minute, cependant, un envoyé de la Porte, Mohammed Taher, se présenta en "pacificateur et conciliateur " à Toulon : c'était la veille du départ de l'expédition; il ne put rien obtenir ; l'impuissance de Constantinople était démontrée.
De quelles ressources disposait le Dey ?
Pratiquement la flotte algérienne n'existait plus. Mais la ville était bien défendue sur le front de mer par une artillerie puissante. La situation était moins brillante sur le front de terre où un seul ouvrage était la clé de la position (le Fort l'Empereur, Sultan-Khalessi).
Les forces de terre paraissaient plus sérieuses. Elles, comprenaient la milice turque (15 à 20.000 hommes au total), les Coulouglis (descendants de Turcs et de femmes indigènes), un certain nombre de tribus maghzen dévouées aux Turcs. En fait, lors du débarquement, les troupes françaises eurent à faire à 5.000 janissaires, 5.000 Coulouglis, 10.000 Maures algériens, 30.000 Arabes des beyliks du Tittery, d'Oran et de Constantine, commandés par l'Agha Ibrahim.
La principale défense d'Alger était encore, dans l'opinion générale, bien plus que dans celle des militaires et des marins français, le renom d'invincibilité que lui avaient valu les retentissants échecs des Européens dans le passé, celui de Charles-Quint au XVIe siècle, celui d'O'Reilly au XVIIe.
Ce renom bien établi semble avoir été la raison qui amena les Anglais à se contenter de protester sans agir. Le duc de Wellington, déclarait à la Princesse de Lieven : " Les Français sont fous, un revers effroyable les attend sur la côte d'Algérie. "
***
Le plan d'opération définitif du général de Bourmont était fondé sur une appréciation exacte de la situation et des possibilités stratégiques, due aux reconnaissances déjà faites, entre autres celles du commandant Boutin sous le Premier Empire. Attaquer directement Alger par mer, tenter de débarquer à proximité immédiate, eût été une folie. Il fallait débarquer à quelque distance, de façon à attaquer par terre : c'est ce qui eut lieu en effet.
Les embarquements de l'armée avaient commencé à Toulon le 11 mai : ils étaient achevés le 17. L'escadrille de débarquement partit pour Palma. Mais, attendant des vents favorables, l'amiral Duperré laissa la flotte au mouillage une longue semaine, ce qui imposa aux troupes des fatigues sérieuses.
Le 25 mai, enfin, la flotte mit à la voile. Elle arriva en vue d'Alger le 31. Bien qu'il eût, deux jours plus tôt, envoyé l'ordre à l'escadrille de quitter Palma et de rallier l'armée navale, Duperré estima que les éléments étaient contraires. La houle lui parut de nature à empêcher les opérations de débarquement. Bourmont ne jugea pas le moment venu de faire état de son instruction spéciale et admit que la flotte se dirigeât sur Palma.
Elle séjourna sur rade jusqu'au 10 juin, tandis que les Turcs cherchaient à accroître leurs forces en appelant aux armes toute la population de la Régence, en essayant d'entraîner le bey de Tunis, qui ne se prononça pas contre nous, et le bey de Tripoli, qui parla de faire prêcher la guerre sainte dans les mosquées.
Enfin, le 10 juin, la flotte quitta Palma. En vue d'Alger quelque hésitation se marqua à nouveau. Cette fois Bourmont fut énergique et insista pour débarquer.
Le point choisi était la baie de Sidi-Ferruch, à 25 kilomètres à l'Ouest d'Alger. Cette baie présentait une plage de sable d'abord facile, bordée de batteries de défense et flanquée au Nord-Est par la péninsule de Torretta Chica, portant une tour carrée et un fortin.
Le 14 juin, à 4 heures du matin, l'opération, qui avait été plusieurs fois répétée à Toulon avant le départ, commença. En une heure, toute la 1ère division eut débarqué et fut suivie de la seconde. Bourmont prit terre à 6 heures 1/2 et ordonna d'enlever les batteries. Celles-ci, prises sous le feu de l'artillerie navale dès le début de l'opération, tombèrent aux mains de la brigade Poret de Morvan (3e de ligne 2e et 4e légers) à 11 heures.
En fin de Journée, les troupes françaises, qui avaient pris 13 canons et 2 mortiers, occupaient une position en arc de cercle englobant la plage et la presqu'île. L'ennemi n'avait réagi que tardivement par d'infructueuses charges de cavalerie. Le génie commença la construction d'un camp retranché.
Bien qu'il eût hâte d'arriver au but, Bourmont était obligé d'être prudent. Le moindre échec pouvait être fatal et il fallait attendre le convoi laissé à Palma et transportant le matériel de siège. Il n'arriva que le 28 (Bourmont s'était plaint de cette lenteur dans une lettre au ministre de la Marine). Aussi les premiers bonds en avant eurent-ils lieu sous forme de contre-attaques.
La première fut effectuée le 19 juin et nous mena au plateau de Staouêli.
Les troupes de l'Agha Ibrahim avaient exécuté le 15 quelques attaques du genre de celles de la veille, mais sans plus de succès. Le 19, à la pointe du jour, elles attaquèrent sur tout le front. A l'extrême gauche de notre ligne, les assaillants marquèrent quelques progrès et mirent un moment en péril la brigade Clouet. Les combattants étant mêlés, les canons de la flotte ne pouvaient intervenir.
 Fort l'Empereur.
Fort l'Empereur.
C'est alors qu'une brillante contre-attaque de la brigade Cobomb d'Arcine (23e et 29e de ligne), général en tête, rétablit la situation et chasse l'assaillant. Une contre-offensive d'ensemble, assez mal menée, finit par entraîner toute la ligne : les gens d'Ibrahim sont ramenés, la baïonnette aux reins, à leur camp de Staouêli, qu'ils évacuent en hâte pour se reformer plus loin.
L'avance était de quatre kilomètres. Nos pertes se montaient à 44 tués et 473 blessés. Si le corps expéditionnaire avait été en possession de son matériel, il aurait pu poursuivre sans désemparer jusque sous Alger.
Le retard du convoi obligeait toujours à la prudence, dont l'inconvénient était d'encourager l'ennemi qui y voyait de la timidité, sinon de la peur. Le 24 juin, il attaqua de nouveau : nos troupes le refoulèrent et, progressant de huit kilomètres vers l'est, s'arrêtèrent à Sidi Khalef. Un seul officier fut blessé mortellement : c'était un des quatre fils de Bourmont qui prenaient part à l'expédition.
Ce nouvel arrêt, survenu pour la même cause que le premier, encouragea encore l'ennemi. L'Agha Ibrahim avait été remplacé à la tête des troupes par le bey du Tittery, Mustapha Bou Mezrag, qui passait pour plus énergique. Les 25, 26, 27 et 28 juin se passèrent en attaques incessantes contre nos nouvelles positions encore insuffisamment assises sur le terrain. Il devenait urgent d'en finir.
Le 28, le général de Lahitte annonça que son matériel était débarqué et disponible. Bourmont fixa au lendemain l'attaque décisive.
L'exécution fut rendue difficile et pénible par suite d'une erreur de direction due au brouillard. Cependant nos troupes occupèrent les hauteurs de la Bouzaréa ; en fin de journée, elles étaient à portée de canon de la Casbah et devant le Fort l'Empereur, que le troupier, plein de souvenirs récents, appelait déjà le Fort Napoléon.
La mise en place des batteries commença aussitôt et fut achevée le 3 juillet au soir. Ce même jour, comme déjà l'avant-veille, la flotte bombarda la ville, sans grand succès, semble-t-il.
Avant la fin de la nuit du 3 au 4, les Turcs exécutèrent une attaque sur une de nos batteries. Ils furent aisément repoussés, et à 4 heures, le bombardement commença. A 700 mètres, il fut rapidement efficace, bien que la garnison (800 Turcs, 1.200 Maures et Coulouglis) entretînt son feu pendant trois heures. A 8 heures, la forteresse cessa de répondre. Le bombardement continua. A 10 heures, au moment où l'ordre allait être donné de battre en brèche, une formidable explosion se produisit, détruisant la tour centrale et crevant le front nord-ouest. Les occupants s'étaient repliés sur la ville et avaient fait sauter le magasin à poudre. Trois compagnies du 25e de ligne se précipitèrent dans le fort.
Les batteries turques furent immédiatement retournées contre la ville, et les travaux d'approche vers la Casbah entamés. Au début de l'après-midi, un secrétaire du Dey se présentait au Fort l'Empereur pour entrer en négociation. Celle-ci fut menée rapidement, deux essais d'intervention du Consul britannique étant écartés. Le lendemain 5 juillet, le Dey acceptait la capitulation, stipulant : 1° la remise aux Français des forts et de la Casbah ; 2° le respect des richesses personnelles du Dey et la faculté pour lui et les siens de se retirer où bon lui semblerait ; 3° les mêmes avantages pour les miliciens turcs ; 4° le libre exercice de la religion musulmane pour les indigènes, ainsi que le " respect de leur liberté, de leurs propriétés, de leur commerce, de leur industrie, de leurs femmes ".
Le jour même, les troupes françaises occupaient les forts et la Casbah.
Le nombre total des tués du corps expéditionnaire depuis le débarquement s'élevait à 415. Le 15 juillet, le Dey Hussein s'embarquait pour Naples. Les Janissaires furent transportés en Asie Mineure. Le régime turc avait cessé d'exister à Alger.
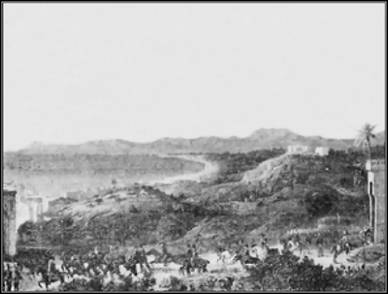 Entrée de l'armée française à Alger, 3 juillet 1830.
Entrée de l'armée française à Alger, 3 juillet 1830.
(D'après une estampe de l'époque.)II
Jusqu'à l'établissement
du Gouverneur Général
(Août 1830 - Juillet 1834)
Les premiers temps de l'occupation française furent marqués par le manque de continuité de vues que traduit matériellement la succession rapide d'un grand nombre de commandants en chef.
Les conditions de la capitulation imposée au Dey ont été souvent considérées comme une preuve de faiblesse de la part de Bourmont. Il s'était cependant conformé à ses instructions et, jusqu'au moment où les événements survenus dans la Métropole l'obligèrent à quitter son commandement, il en poursuivit l'exécution.
Le premier point était d'assurer l'administration de la ville d'Alger. Le général Tholozé fut nommé commandant de la place et l'interprète d'Aubignosc, lieutenant-général de police. Il fut formé une commission administrative comprenant l'intendant-général Denniée, le payeur-général Firino, le consul Deval (neveu de celui de 1827)
Bourmont s'occupa ensuite de prendre pied sur d'autres points du littoral. Une première reconnaissance était effectuée dans la Mitidja, jusqu'au Cap Matifou, le 6 juillet. Le 26, Bône fit sa soumission, puis Bougie, et un nouveau caïd fut proclamé au nom de la France. Le 27, les troupes françaises débarquèrent à Mers-el-Kébir, et des négociations étaient entamées avec le bey d'Oran.
Qu'aurait pu obtenir Bourmont ? Il est difficile de le dire.
Ses instructions spécifiaient que la population " ne supportait qu'avec impatience la domination violente et arbitraire de quelques milliers de Turcs ". Il devait chercher à " attirer à lui " les chefs de tribus et les gens de l'intérieur et promettre " à tous les habitants de les délivrer de l'oppression ". Lui-même, dans son ordre du jour du 10 mai, à la veille de l'embarquement, traduisait le même état d'esprit en disant :
" Terribles dans le combat, soyez justes et humains après la victoire : votre intérêt le commande autant que le devoir. Trop longtemps opprimé par une milice cruelle et avide, l'Arabe verra en nous des libérateurs. Il implorera notre alliance. Rassuré par votre bonne foi, il apportera dans nos camps les produits de son sol. "
Il y avait là les principes d'une politique qui ne fut pas exécutée systématiquement, mais suivie sans vues d'ensemble sous la pression des circonstances.
Avant la fin de juillet 1830, celles-ci avaient montré à Bourmont que l'application était quelque peu hasardeuse. Au lendemain de la prise d'Alger, il crut aux bonnes dispositions du bey du Tittery, Mustapha Bou Mezrag, et lui donna l'investiture de la France. Le 23 juillet, Bourmont se rendit à Blida, mais le lendemain, il fut attaqué sur la route du retour. Et dès lors Mustapha prit une attitude hostile et menaçante.
Bourmont, nommé Maréchal de France le 24 juillet, apprit les nouvelles de la capitale officieusement le 10 août et officiellement peu après. Il jugea nécessaire de concentrer ses forces sous Alger, ce qui amena, entre autres choses, l'arrêt des négociations avec le bey d'Oran. Sur l'ordre du nouveau ministre de la Guerre, le général Gérard, il fit prendre, sans incident, le drapeau tricolore par ses troupes (17 août).
Le général Clauzel fut désigné le 12 août pour le remplacer. Bourmont lui passa le commandement et s'embarqua le 3 septembre pour Mahon où il attendrait la suite des événements : l'amiral Duperré lui avait refusé un bâtiment de l'Etat (alors qu'il en avait accordé un au Dey Hussein) ; du moins le général Clauzel fit-il rendre les honneurs au brick autrichien qui l'emporta.
***
Le nouveau commandant en chef se trouvait dans une situation délicate. Pour des raisons de politique intérieure et extérieure, le gouvernement de Louis-Philippe n'était rien moins que décidé à une politique de conquête. Dans ces conditions, le général Clauzel arrêta la ligne de conduite suivante : occupation effective des points importants de la côte, occupation de toute la Régence d'Alger en confiant l'administration du pays à des chefs musulmans vassaux.
La liquidation de l'autorité turque fut poursuivie. Mais il fallait se hâter. Car, si, comme on le verra plus loin, Clauzel pensait à utiliser les Tunisiens, avec qui la France entretenait de bonnes relations, l'autre prétendant à la domination de l'Algérie, le Sultan du Maroc cherchait aussi à reprendre la traditionnelle politique d'extension vers l'est. Sa première tentative fut l'occasion de l'entrée en scène de Mahi-ed-Din et de son fils Abd el Kader.
On a vu l'importance grandissante prise dans l'Algérie turque par le mouvement maraboutique. Un de ses représentants les plus vénérés dans la province d'Oran au moment du débarquement des troupes françaises à Alger était Mahi-ed-Din. Celui-ci avait eu de sa seconde femme, Zohra, un fils, Abd el Kader, en qui certaines prophéties faisaient voir le futur Mahdi qui délivrerait les musulmans. Né en 1808, Abd el Kader était venu en 1822 poursuivre ses études à Oran. Là, il avait senti grandir sa haine du Turc dont le peu de respect pour les préceptes coraniques l'avait choqué, en même temps que les exactions de la milice. Les prophéties relatives à Abd el Kader inquiétèrent le bey d'Oran, Hassan. Peu après son retour à la Zaouïa paternelle et son mariage, Abd el Kader fut impliqué avec son père dans des poursuites consécutives à une attaque contre Mascara. Détenus quelque temps à Oran, le père et le fils purent enfin aller en pèlerinage à La Mecque. Ils en revinrent au début de 1829.
Après le débarquement des Français, le sultan du Maroc, Abd el Rahman envoya un gouverneur à Tlemcen. Le bey Hassan protesta et chercha du secours auprès des populations indigènes : il demanda notamment l'appui de Mahi-ed-Din, dont l'influence était considérable. Sur le conseil d'Abd el Kader, Mahi-ed-Din refusa.
A ce moment, le général Clauzel renforça la garnison de Mers-el-Kébir par la brigade Damrémont, dont une fraction occupa Oran le 4 janvier 1831. Hassan se retira à Alexandrie, puis à La Mecque. Le commandant en chef français négociait avec Tunis. Notre consul dans la Régence, Mathieu de Lesseps, avait entretenu les bonnes dispositions du bey pour la France. Clauzel résolut d'en profiter. Le 4 février, il installait le prince Achmet comme bey d'Oran. Il songeait à établir un autre prince tunisien à Constantine.
En même temps, il agissait dans le Tittery, occupait Médéa, où il installait un bey dévoué à la France et une garnison française.
Mais Paris hésitait. Les effectifs furent réduits, Clauzel fut rappelé et remplacé par le général Berthezène (que Bourmont avait désigné pour son successeur éventuel au gouvernement de la Restauration). Celui-ci resta en fonction jusqu'en décembre 1831. Il fut remplacé à son tour par le duc de Rovigo (Savary), qui lui-même, en avril 1833, céda la place au général Voirol. Ces changements continuels empêchèrent l'action méthodique et à larges vues qui eût été nécessaire.
Dans la province d'Oran, le Tunisien Achmet n'avait pu se maintenir : il évacua Oran à la fin d'avril 1831. Le sultan du Maroc en profita immédiatement. Avec l'aide de deux chefs des tribus Douairs et Smela, qui, après avoir développé une savante propagande, lancèrent leurs cavaliers en avant, des représentants d'Abd el Rahman furent installés à Médéa (que les Français avaient dû abandonner) et à Miliana. Un Marocain, Bel Amri occupa Mascara. A Tlemcen, le premier gouverneur marocain avait échoué complètement. Mahi-ed-Din, appelé en médiateur, prit le titre de Khalifa du Sultan du Maroc, la garnison turque se maintenant toujours au Méchouar comme dans la citadelle de Mostaganem.
Il importait de mettre un terme à l'action du Maroc. Un bataillon de renfort débarqua à Oran le 17 août. Le mois suivant, un chef énergique, le général Pierre Boyer, fit rentrer dans leurs tribus les cavaliers Douairs et Smela. Une démonstration navale devant Tanger (novembre 1831), l'envoi d'une ambassade à Mekhnès (mars 1832) amenèrent Abd er Rahman à renoncer à ses prétentions. Ses représentants, y compris Mahi-ed-Din, abandonnèrent les pouvoirs qu'ils s'étaient arrogés. Par la suite, les Français occupèrent Arzew et Mostaganem.
Dans les autres parties de l'Algérie, il n'y avait pas d'amélioration sensible. Sous Savary, et après un échec en 1831, Bône fut prise par Yusuf et d'Armandy en mars 1832, et Bougie en octobre 1833. Mais l'intérieur du pays était livré à une complète anarchie, les rivalités entre les tribus, entre les descendants des Marabouts et les chefs de guerre, entretenant le désordre.
Il restait encore en fonction un bey turc, Ahmed, à Constantine. En juillet 1830, Bourmont avait songé un moment à lui donner l'investiture de la France. Mais Ahmed pensait pouvoir s'assurer l'indépendance et restait maître de la plus grande partie de son beylik, où il croyait difficile, sinon impossible, une campagne des troupes françaises. Il songeait même à s'étendre vers l'ouest et jetait ses regards vers le Tittery.
C'est cependant encore dans la province d'Oran que les événements retenaient le plus l'attention. Les villes où nous tenions garnison étaient en fait bloquées. Mahi-ed-Din avait groupé autour de lui, cette fois en son nom et non pas comme Khalifa d'Abd-er-Rahman, tous ceux des indigènes qui voulaient lutter contre nous.
Au mois d'avril 1832, il avait été proclamé chef de la guerre sainte au cours d'une réunion tenue par les principaux chefs de la région de Mascara. Dès le 17, il avait attaqué une reconnaissance française, à peu de distance d'Oran, et, le 1er mai, sommé la garnison de se rendre. Il lança alors l'appel à la guerre sainte et attaqua Oran le 3 mai. Dans ce combat, Abd el Kader fut sur le point d'être pris. Mahi-ed-Din renouvela l'attaque le 4 Le 6, douze mille guerriers des tribus étaient réunis, mais ils se dispersèrent pour la fête de l'Aïd-el-kébir (11 mai).
Le blocus d'Oran était maintenu. Cependant les premiers essais de politique indigène s'ébauchaient dans la région. Les Français étaient entrés en conversation avec les Douairs et les Sméla ; mais une grave erreur avait été commise par le général Boyer qui avait répondu négativement à une démarche des cheikhs des anciennes tribus maghzen demandant qu'un bey fût choisi parmi les principaux Turcs restés au Méchouar de Tlemcen.
De son côté, Mahi-ed-Din ne réussissait pas à faire l'unité autour de lui. Ses échecs devant Oran, renouvelés les 31 août, 19 septembre, 23 octobre, 10 novembre, lassaient ses partisans. Il dispersa ses contingents en leur donnant rendez-vous au mois de mai 1833.
L'étoile d'Abd el Kader, qui s'était distingué dans tous les combats, se levait à l'horizon. Le 21 novembre, il était proclamé sultan dans la plaine d'Eghris, et le 25 il faisait son entrée dans Mascara. Il n'accepta d'ailleurs que le titre d'émir, qu'il transforma par la suite en celui d'Emir el Mouminin (commandeur des croyants).
Le général Boyer à Oran ne s'émut pas : le nouvel émir n'était reconnu, en dehors de sa propre tribu, les Hachem, que par les Beni Amer et les Gharaba ; il lui fallait chercher à consolider ses pouvoirs, à organiser une sorte de gouvernement, de façon à se procurer les ressources nécessaires pour la guerre sainte. La France allait lui en fournir les moyens, partie sans le vouloir, partie de propos délibéré
En avril 1833, la suite d'un dissentiment avec le duc de Rovigo, commandant en chef, le général Boyer, qui venait d'enlever Arzew, quitta Oran, où il fut remplacé par le général Desmichels. Celui-ci déploya d'abord de l'énergie et occupa Mostaganem. La ville, attaquée par Abd el Kader, pendant que Desmichels était allé razzier les Smela passés à l'Emir, tint bon. Les Smela abandonnèrent Abd el Kader qui dut rentrer à Mascara.
Les garnisons françaises pouvaient vivre grâce aux relations qu'elles entretenaient avec les tribus du voisinage. Mais, moyennant une active propagande, et à la suite de quelques actes de violence Abd el Kader réussit à les isoler. Le moment semblait venu d'essayer d'entrer en conversation : Abd el Kader sentait la nécessité d'organiser ses forces avant de reprendre la lutte ; Desmichels, s'inspirant des conceptions de Clauzel, croyait discerner en Abd el Kader des qualités capables de faire de lui le chef indigène qui pacifierait l'intérieur, et des sentiments qui lui permettraient d'accepter la suprématie de la France.
Abd el Kader, chef de la guerre sainte, ne pouvait faire le premier pas pour entrer en conversation avec les infidèles. Desmichels accepta de le faire : il demanda la libération de quatre soldats faits prisonniers dans une embuscade par des hommes de l'émir. La négociation se noua par l'intermédiaire d'un Busnach d'Oran. Elle aboutit au traité du 26 février 1834, dit traité Desmichels, après avoir été marquée par des incidents militaires qui, brillants pour les Français, leur étaient en fait nuisibles dans l'esprit des indigènes, parce qu'ils regagnaient leurs bases après chaque engagement.
Ce premier accord avec Abd el Kader ouvrait la porte à de nouvelles contestations. Les textes arabe et français ne concordaient pas. En outre, le traité du 26 février avait été précédé, le 4 du même mois, d'un échange de notes qui, aux yeux de Desmichels, étaient de simples préliminaires révisés par le traité lui-même, tandis qu'Abd el Kader les considérait comme des parties constitutives du traité ayant même valeur que le texte du 26.
Les stipulations du traité tendaient à représenter Abd el Kader comme un souverain indépendant traitant d'égal à égal avec les Français. C'était lui donner, aux yeux des indigènes, une autorité et un prestige qu'il n'avait pu acquérir lui-même. Cet avantage était complété par d'autres, matériels ceux-là : existence de représentants de l'émir (appelés dans le texte arabe " consuls ") à Oran, Mostaganem et Arzew ; liberté du commerce, mais, en fait, monopole du commerce des grains en faveur d'Abd el Kader (imitation évidente du procédé employé par Méhémet-Ali pour enrichir son trésor).
La conclusion du traité Desmichels constitue une faute incontestable. Et la responsabilité en retombe tout entière sur son auteur. En effet, le général Desmichels rendit compte correctement des premiers pourparlers ; mais il signa le traité du 26 février sans attendre les instructions qu'il avait cependant demandées. Ces instructions, datées du 29, étaient infiniment plus raisonnables : elles comportaient la reconnaissance par Abd el Kader de la souveraineté française avec serment de foi et hommage, et tribut annuel. Conditions évidemment moins dangereuses mais encore peu réalistes... car Abd el Kader ne les eût jamais acceptées. C'est ce que montreront le traité de la Tafna et ses suites.
Quelques Français commençaient cependant à comprendre. C'est ainsi que le commandant en chef, le général Voirol, repoussa les avances d'Abd el Kader qui s'offrait à ramener l'ordre et le calme dans la province d'Alger. C'est ainsi que le gouvernement de Paris lui-même tenait bon dans l'entreprise commencée, sans d'ailleurs en mesurer toute l'étendue.
L'opinion s'était émue en France des difficultés rencontrées. Certains, en s'hypnotisant sur ces difficultés, d'autres en invoquant des principes se prononçaient contre le maintien de l'occupation d'Alger : les deux tendances se retrouveront par la suite dans toute notre histoire coloniale au XIXe siècle. Heureusement, d'autres hommes, les La Rochefoucauld, les Pelet de la Lozère, les de Laborde, les Clauzel, faisaient valoir les avantages d'ordre économique et militaire que nous assurerait la persévérance.
Le gouvernement accepta l'idée d'une vaste enquête menée sur place, mise en avant par un adversaire de l'occupation, Hippolyte Passy. Une " commission d'Afrique ", composée de parlementaires et d'officiers, se rendit en Algérie et y séjourna de septembre à novembre 1833. Elle conclut à la nécessité de rester à Alger, non qu'elle fût bien profondément convaincue des avantages d'avenir que l'occupation assurerait au pays, mais pour la sauvegarde de l'honneur national : la question n'était plus entière, nous étions engagés ; l'entreprise n'aurait peut-être pas été à recommander ; mais on ne pouvait pas reculer.
Une commission supérieure, chargée de réviser les travaux de la commission d'Afrique, conclut dans le même sens, et d'une façon plus catégorique : l'intérêt de la France concordait avec son honneur pour imposer le maintien de l'occupation. Celui-ci fut décidé. Une ordonnance royale cru 22 Juillet 1834 créa le gouvernement général de l'Algérie, désignée sous le nom de " possessions françaises dans le nord de l'Afrique ". Le premier gouverneur général fut Drouet d'Erlon, qui prit possession de son poste en septembre 1834.
III
Les débuts du Gouvernement général
La Macta - La Sikkak -
Le traité de la Tafna
La Prise de Constantine
L'institution du gouvernement général était une preuve de volonté. Mais cette volonté était encore peu éclairée. On tenait par-dessus tout à éviter des dépenses et on en restait aux illusions du début : occupation de quelques points de la côte avec une banlieue suffisante pour permettre aux garnisons et aux citadins de se ravitailler tout en assurant leur sécurité. Pour le reste, on se flattait d'entretenir des relations acceptables avec les chefs du pays, on espérait même les amener à reconnaître la souveraineté de la France. Mais c'était tout. Programme évidemment inspiré par des souvenirs historiques, mais qui négligeait le fait important survenu depuis le temps des Romains : l'islamisation de l'Afrique du Nord. Qui négligeait aussi l'étendue et la vigueur des ambitions personnelles des deux principaux chefs de l'intérieur : le bey Ahmed à Constantine, l'Emir Abd el Kader en Oranie.
Le pouvoir du second paraissait singulièrement précaire, mais l'énergie de l'homme devait suffire à le consolider.
Sa tâche n'était pas facile. Ses ascendances maraboutiques, qui l'avaient d'abord servi, suscitaient contre lui les jalousies des familles qui fournissaient traditionnellement des chefs, et des chefs militaires. Abd el Kader avait comme rivaux et comme ennemis : El Ghomari, Cheikh des Angad ; Mustapha ben Ismaël, des Douairs et Smela ; Kaddour ben Mokhfi, des Bordjia ; Sidi Larbi, des tribus du Chélif. Il était facile d'exploiter contre l'émir le fait qu'il avait traité avec les infidèles : les conditions importaient peu.
Moins de deux mois après la signature du traité Desmichels, les Douairs et les Smela, renforcés des Angad, se jetaient sur le camp de l'émir à Hennaya, près de Tlemcen : Abd el Kader s'échappait presque seul et rentrait à Mascara (12 avril 1834). La révolte s'étendit.
Le général Desmichels resta fidèle à la politique qui l'avait amené à traiter. Il refusa l'aide que lui demandaient les Douairs et les Smela. Il fournit des armes et de la poudre à Abd el Kader et lui donna des conseils d'ordre stratégique. L'Emir marcha contre ses adversaires : il battit Sidi Larbi à El Bordj, Mustapha ben Ismaël près de Tlemcen (1er juillet 1834). Il occupa cette dernière ville, mais ne put rien contre le Méchouar où les Turcs tenaient toujours et où les rejoignit Mustapha. Cet échec ne l'empêcha pas de rentrer à Mascara en vainqueur, maître du pays depuis les frontières du Maroc jusqu'au Chélif. Avant la fin de l'année, il réussissait à s'emparer de Sidi Larbi et d'El Ghomari qui n'avaient pas voulu se soumettre : il les fit exécuter.
Son plan se précisa. Il organisa d'abord son domaine, qu'il partagea en deux khalifaliks, Tlemcen et Mascara, subdivisés en aghaliks, desquels relevaient les tribus commandées par des caïds. Le but de cet effort administratif était la reprise de la lutte contre les Français, comportant : 1° l'installation du pouvoir de l'émir dans le Tittery (Médéa, Miliana); 2° l'éviction d'Ahmed, le bey de Constantine, avec l'aide des chefs kabyles de la région de Bougie; 3° enfin, l'expulsion des Français avec l'aide du sultan du Maroc.
Le nouveau gouverneur général s'opposa d'abord à l'effort d'Abd el Kader. A une proposition de l'émir tendant à rétablir l'ordre dans le Tittery et dans la province de Constantine, Drouet d'Erlon répondit de façon négative. Mais, sous l'influence du Consul d'Abd el Kader à Alger, Judas Ben Duran, ses conceptions subirent la même évolution que celle de Desmichels (qui avait été rappelé en janvier 1835 et remplacé par le général Trézel) : il ne réagit pas contre les entreprises de l'Emir.
Après avoir mis à la raison de nouveaux adversaires qui, cette fois, appartenaient à sa propre famille et étaient soutenus par la confrérie des Derkaoua, Abd el Kader occupa Miliana et Médéa (mars-avril 1835). Cette dernière ville, après avoir défait Hadj Moussa (Bou Hamar, l'homme à l'âne).
Drouet d'Erlon était retenu par les instructions venues de Paris, qui lui annonçaient qu'il n'aurait pas de crédits supplémentaires pour 1835 et que les crédits de 1836 ne seraient pas plus élevés. Mais le nouveau commandant à Oran se rendit compte des ambitions d'Abd el Kader, et il voulut y mettre des limites. Au moment de son arrivée, il avait été expliqué à l'émir que les notes du 4 février n'avaient pas de valeur officielle pour le gouvernement français : source de difficultés certaines puisqu'Abd el Kader les considérait comme partie intégrante du traité.
Trézel, obligé de se soumettre aux ordres du gouverneur général, avait dû, au mois de mars 1835, refuser aux Turcs du Méchouar de Tlemcen l'aide qu'ils lui demandaient contre Abd el Kader. La manière dont celui-ci réalisait son monopole du commerce des grains, en empêchant le ravitaillement d'Oran, allait obliger Trézel à l'action, tandis que Drouet d'Erlon s'empêtrait dans une négociation, qui, si elle avait abouti, aurait étendu au Tittery les stipulations du traité Desmichels telles que les interprétait l'émir.
Les Douairs et les Smela continuaient à venir sur les marchés d'Oran. Ils offrirent à Trézel de jouer le rôle de tribu maghzen auprès des Français. L'arrestation de l'un d'eux sur l'ordre de l'émir les conduisit à la révolte ouverte contre lui. En dépit des instructions dilatoires de Drouet d'Erlon, Trézel jugea nécessaire de les soutenir : une convention fut signée le 16 juin au camp du Figuier, aux termes de laquelle les Douairs et les Smela reconnaissaient la souveraineté du roi des Français (chefs nommés par celui-ci, tribut annuel). La reprise des hostilités était inévitable. A une lettre de Trézel, Abd el Kader répondit par un ultimatum.
Le 19 juin 1835, Trézel s'était porté au camp du Tlélat avec 2.500 hommes de la garnison, peu entraînés et encombrés d'un lourd convoi. Le 26, il battit cependant Abd el Kader qui, avec 1.500 fantassins et 3.000 cavaliers, lui avait tendu une embuscade au bois de Moulay Ismaël, et s'établit sur la rive gauche du Sig. Après un essai de négociation, Trézel décida de rentrer à Oran.
Suivant l'usage qui fit longtemps le succès d'Abd el Kader, la route du retour fut funeste à la colonne française, Les contingents de l'émir avaient grossi. Ils atteignaient 1.000 hommes à pied seulement, mais 14.000 cavaliers. Au défilé de la Macta, Trézel, attaqué de tous les côtés, fut submergé sous le nombre ; sa colonne fut disloquée, son convoi pillé, ses blessés massacrés ; il réussit cependant à rentrer à Arzew. Il avait perdu 254 hommes, son convoi, son matériel, des armes, un obusier de campagne; il ramenait 150 blessés (28 juin).
Cependant Lamoricière, arrivé d'Alger, ayant pu revenir d'Oran à Arzew par terre à la tête de cavaliers Douairs et Smela, Trézel, avec les débris de sa colonne, rentre à Oran sans être inquiété. Il revendiqua la responsabilité de l'événement qu'on appela en France un désastre. Il fut rappelé.
***
Un prompt redressement était nécessaire. Le Maréchal Clauzel, premier successeur de Bourmont, et partisan déterminé de l'entreprise, remplaça Drouet d'Erlon, qui avait, dès le 27 juin, désavoué l'entrée en campagne de Trézel. Des renforts furent envoyés en Algérie, et avec eux un des fils du roi Louis-Philippe, le duc d'Orléans. Cependant il fallut attendre : le choléra s'était déclaré à Alger et les forces expéditionnaires ne se montaient qu'à 21.000 disponibles.
Les opérations commencèrent au mois de septembre par des travaux au camp du Figuier. En octobre, l'îlot de Rachgoun, à l'embouchure de la Tafna, fut occupé, et un régiment de renfort jeté dans Oran. Abd el Kader, inquiet, écrivit au Roi d'Angleterre pour lui demander son appui, et se livra à une intense propagande parmi les tribus. En même temps, il retira ses richesses de Mascara, et envoya sa famille dans le Sud.
Le corps expéditionnaire rassemblé par Clauzel à Oran avait un effectif de 10.000 hommes (brigades Oudinot, Perrégaux, d'Arlanges et Combe), renforcés de cavaliers Douairs et Smela, de fantassins turcs et des zouaves de Lamoricière. Il quitte le camp du Tlélat le 29 novembre. Le 1er décembre, l'envoi d'une reconnaissance contre Abd el Kader donne lieu à un vif engagement ; les Français restent maîtres de la situation, mais ils rentrent à leur camp. Le 3, Abd el Kader attaque sans succès la colonne ; il ne réussit pas mieux dans une embuscade auprès des marabouts de Sidi Embarek. Il ne put empêcher Clauzel de prendre pied dans la montagne et de déboucher sur le plateau d'Aïn Kebira (5 décembre), Ce fut le signal de la défection parmi les contingents d'Abd el Kader. Le pillage de Mascara commença. A cette nouvelle, Clauzel précipita sa marche, et entra dans la capitale de l'émir le 8 décembre,
Mais on ne discernait pas encore à cette époque la nécessité de la " présence ". Dès le 9, Clauzel quittait Mascara pour rentrer à Oran, en passant par Mostaganem. Abd el Kader, qui avait été complètement abandonné, retrouva des partisans. Il résolut de s'emparer du Méchouar de Tlemcen. Il échoua de nouveau et ne défendit pas la ville contre un second corps expéditionnaire qui, parti d'Oran le 8 janvier 1836, entra dans la vieille cité le 13. Deux jours plus tard, Yusuf et Richepance avec 50 cavaliers Smela manquaient de peu Abd el Kader au cours d'une poursuite acharnée terminant une surprise du camp de l'émir bien menée par la brigade Perrégaux.
Clauzel pense alors à quitter Tlemcen. Il se dirige d'abord sur Rachgoun. Mais, après un violent combat avec Abd el Kader à Sebaa Chioukh (entre le confluent de Pisser et de la Tafna, et la mer), il rentre à Tlemcen, poursuivi à coups de fusil jusque dans la ville : ce qui donne aux indigènes l'impression qu'ils ont remporté la victoire C'est un nouvel événement favorable à la prédication de la guerre sainte qui s'étend jusque dans les ksours de Figuig.
Clauzel, de son côté, a la même impression de victoire. Il laisse à Tlemcen une garnison française, le bataillon de 500 volontaires commandé par Cavaignac, et rentre à Oran le 12 février; il croyait "la guerre terminée " de ce côté. Il lui faut encore s'occuper des affaires du Tittery et du beylik de Constantine.
Le 30 mars, Clauzel partait de Boufarik en direction de Médéa. Il entrait dans cette ville le 4 avril et en chassait le représentant d'Abd el Kader. Puis, estimant la question réglée, il rentrait le 8 à Boufarik. Partisan des solutions énergiques, il décida d'en finir avec Ahmed, bey de Constantine. Il proclama sa destitution, nomma bey le commandant Yusuf. Celui-ci s'installa à Bône pour travailler politiquement avec les indigènes de la région. Clauzel, paralysé par les ordres extrêmement prudents venus de Paris, à la suite des discussions parlementaires, manquant de moyens, se résolut à faire un voyage en France pour exposer là situation et obtenir les renforts nécessaires. Il s'embarqua le 14 avril. Son dessein était de convaincre le gouvernement de la nécessité de prendre Constantine.
Du côté d'Abd el Kader, les choses étaient bien moins avancées qu'il ne le supposait. Dans la seconde quinzaine de mars, Perrégaux avait exécuté une brillante campagne parmi les tribus du Chélif. Il avait à peine tourné les talons pour regagner Mostaganem et Oran, que l'émir punissait sauvagement une de ces tribus, les Bordjia. De son côté, le bey de Médéa, n'étant pas soutenu, fut impuissant contre les partisans de l'émir qui lui reprirent la ville et l'envoyèrent à Abd el Kader. Dans la région d'Oran, le général d'Arlanges, investi de la mission de maintenir la liaison avec Rachgoun et Tlemcen, avait établi un camp à l'embouchure de la Tafna : il y fut immédiatement bloqué, et blessé au retour d'une reconnaissance (combat de Sidi Yakoub, 25 avril 1836).
La situation de l'émir se trouvait une nouvelle fois consolidée. Il recueillait de nombreuses soumissions jusque dans le Tittery. D'Arlanges, toujours bloqué au camp de la Tafna, demandait 2.000 hommes de renfort. Le ministre de la Guerre décida d'envoyer trois régiments sous le commandement du général Bugeaud ; en même temps l'escadre devait faire des démonstrations sur les côtes du Maroc.
Il ne s'agissait encore, pour le futur héros de la pacification de l'Algérie, que d'une mission temporaire : mettre en état de défense le camp de la Tafna, fortifier Tlemcen, puis rentrer à Oran. Bugeaud était alors âgé de 52 ans. Il avait pris part à la guerre d'Espagne de 1808 à 1814. En demi-solde en 1815, il s'adonna à l'agriculture. Le gouvernement de juillet le nomma maréchal de camp, et il fut élu député de la Dordogne (1832). Il avait su gagner la confiance du Roi et avait l'oreille de la Chambre. Exécutant énergique et heureux, il allait, comme les autres, commencer par faire ses écoles en politique.
Les renforts débarqués au camp de la Tafna (4-6 juin), Bugeaud comprit la nécessité d'alléger les convois en remplaçant les voitures par des animaux de bât. De la Tafna, il gagna Oran par la côte. Le 19 juin, il se porta sur Tlemcen, qu'il atteignit le 24. Puis il rejoignit le camp de la Tafna, dont il jugea dès ce moment le maintien inutile. Il constitua un convoi pour ravitailler Tlemcen et se remit en marche le 4 Juillet. Cette fois Abd el Kader était résolu à lui barrer la route. Bugeaud 'écrasa ses contingents à la Sikkak (6 juillet) et remporta un succès complet moyennant des pertes minimes (32 tués, 70 blessés).
Bugeaud ravitailla Tlemcen et rentra à Oran (19 juillet) Sa mission était remplie. Il se rembarqua peu après. S'il n'avait pas encore distingué clairement la politique à suivre, du moins était-il presque arrivé déjà à déterminer la tactique efficace; il était partisan d'un " système de colonnes agissantes ", seul capable de pacifier le pays. Au reste, des indigènes lui avaient dit : "Nous ne nous soumettrons que si les Français continuent à se montrer plus forts que l'émir. "
En rentrant en Algérie, Clauzel trouva la situation momentanément stabilisée dans l'Ouest. Mais, au centre et à l'Est, les difficultés étaient grandes et manifestes : la Mitidja continuellement ravagée par les incursions des Hadjoutes; la région de Bône troublée par le contrecoup de la politique brutale de Yusuf qui déchaînait l'hostilité de tribus jusque là fidèles à la France.
Sans doute en souvenir des premiers principes adoptés à la fin de 1830, le gouverneur général persistait dans son dessein d'en finir avec Ahmed, de liquider le dernier vestige de la domination ottomane. Pour agir, il lui fallait des renforts. Il avait gagné à sa cause le président du Conseil Thiers. Mais la chute de celui-ci (25 août 1836) arrêta les choses. Molé, le successeur de Thiers, revint sur la promesse faite. Clauzel avait conçu un vaste plan comportant l'occupation de toutes les villes du Tell, la création dans chaque province d'un camp retranché autour duquel pourraient rayonner des colonnes mobiles. Ce plan, bientôt connu, amena Abd el Kader, en présence de la vulnérabilité de places comme Mascara et Tlemcen, à reporter ses bases plus au sud, et notamment sa capitale dans les ruines de Tagdempt.
L'expédition contre Constantine fut exécutée au mois de novembre. Désespérant d'obtenir des renforts, Clauzel avait offert sa démission. Puis, probablement dans l'idée de s'imposer par un succès et d'obtenir ainsi les forces nécessaires pour achever ensuite la pacification, il constitua avec les minces ressources dont il disposait un corps expéditionnaire de 7.000 hommes. Il était impossible d'entreprendre un siège régulier. Clauzel ne pouvait compter que sur un coup de force. Le coup échoua. Il fallut battre en retraite (23 novembre 1836) dans de mauvaises conditions. Clauzel rentra à Bône le 1er décembre, ayant perdu un septième de son effectif.
***
Son échec allait avoir de redoutables conséquences. On y vit en France une condamnation de l'action militaire en général, alors que seule avait succombé l'action militaire menée par des forces insuffisantes. On admit bien la nécessité de réparer l'échec de Constantine ; mais, pour y arriver, on considéra qu'il fallait en finir n'importe comment avec Abd el Kader : celui-ci avait de nouveau fait ravager la Mitidja par les Hadjoutes, enlevé le troupeau de la garnison d'Oran, et interdit aux indigènes d'entrer dans cette ville.
Comme il arrive en pareilles circonstances, on eut recours à des mesures mal coordonnées et favorables au désordre. A la fin de 1836, le général Damrémont fut envoyé en mission en Algérie, d'où il rapporta une condamnation formelle du système de Clauzel. Celui-ci fut rappelé, et son sévère censeur nommé à sa place (février 1837). Puis Bugeaud demanda à être chargé personnellement de régler la question Abd el Kader. Grâce à la confiance qu'il inspirait au roi, il obtint cette mission. Il devait la remplir comme il l'entendrait, par les armes ou en négociant, mais à deux conditions essentielles : l'émir reconnaîtrait la souveraineté du roi de France, son domaine serait limité à la seule province d'Oran.
Damrémont débarqua à Alger le 3 avril 1837. Il ne connaissait rien des pouvoirs conférés à Bugeaud, qui arriva à Oran le 5 avril. Il y avait division du commandement et des responsabilités, situation bien peu favorable au succès.
Bugeaud ne jugea pas nécessaire d'abord de combattre. Au mois de janvier, le général de Brossard, qui, commandait à Oran, était entré en relations avec Abd el Kader, par l'intermédiaire de l'inévitable Ben Duran. Le général avait accepté de rendre 130 réguliers de l'émir capturés par nos troupes à la Sikkak (on sait que les marchandages qui eurent lieu à ce sujet amenèrent le général devant un tribunal). Bugeaud reçut à son arrivée la visite de Ben Duran présenté par de Brossard. Il crut la négociation bien engagée, et pensa que l'émir était la personnalité qualifiée pour faire régner l'ordre à l'intérieur au nom de la France.
Bugeaud fit connaître les conditions auxquelles il pouvait traiter. Abd el Kader les repoussa. D'ailleurs, comprenant mal le partage des attributions entre Bugeaud et Damrémont, il craignait un piège. Il crut même que ce dernier seul avait qualité pour s'occuper du Tittery, et il lui écrivit pour entrer en négociations. Il y avait des possibilités qu'il tenait à exploiter comme il l'avait fait auparavant avec le duc de Rovigo et le général Desmichels. Ce fut Ben Duran lui-même, inquiet pour ses avantages personnels, qui y mit un terme en prévenant Bugeaud : l'accord se fit entre les deux chefs français, et Damrémont signifia à l'émir d'avoir à traiter avec Bugeaud seul.
La différence entre les instructions de celui-ci et les intentions de l'émir était trop accentuée. Abd el Kader réclamait en somme toute l'Algérie sauf Alger et Oran. Bugeaud voulut recourir à l'action militaire ; il se porta sur Tlemcen, puis sur le camp de la Tafna. Mais là, il s'aperçut qu'il n'était pas en situation de poursuivre immédiatement. De plus, il lui faudrait bientôt céder une partie de ses forces destinées à l'expédition de Constantine. De son côté Abd el Kader n'était pas prêt. Les négociations furent menées activement entre les deux camps, à partir du 24 mai. Elles aboutirent le 30 au traité de la Tafna.
D'après le texte français, Abd el Kader reconnaissait " la souveraineté de la France en Afrique ". Les Français conservaient dans la province d'Oran : Oran, Mostaganem, Mazagran, Arzew ; dans celle d'Alger ; Alger, le Sahel, la Mitidja, Blida, Koléa. L'administration de l'émir s'étendait à la province d'Oran, au Tittery, à la partie non française de la province d'Alger : interdiction lui était faite de pénétrer dans les autres parties de la Régence. La France cédait Rachgoun, Tlemcen, avec le Méchouar (qu'Abd el Kader n'avait pas pu prendre).
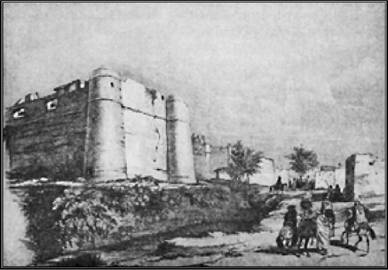 Le Méchouar de Tlemcen, d'après Genêt.
Le Méchouar de Tlemcen, d'après Genêt.
Le commerce était libre entre Français et Algériens, mais, avec l'extérieur, il devait se faire par les ports français. Aucun point du littoral ne devait être concédé à d'autres puissances sans l'assentiment de la France. L'émir achèterait à la France les armes et la poudre dont il aurait besoin. Il donnerait aux Français une quantité déterminée de blé, d'orge et de bêtes à corne.
D'après ce résumé du texte français, on voit que Bugeaud avait transgressé ses instructions sur un point : il cédait le Tittery. Selon le texte arabe, il n'avait pas mieux réussi sur l'autre point, la reconnaissance de la souveraineté de la France. A la phrase française qui l'établissait, correspondait le très lointain équivalent arabe : " Le commandeur des Croyants reconnaît que le Sultan est grand " Quant au tribut constitué par le " don " de blé, d'orge et de boeufs, aucune garantie n'était fournie, et, pour Abd el Kader, il ne s'agissait que d'une fourniture faite une fois pour toutes. Enfin, la délimitation de la frontière orientale de la Mitidja était par trop imprécise et laissait la porte ouverte aux contestations.
Bugeaud, cependant, était fier de son oeuvre. Le 31 mai, il eut une entrevue avec l'émir, la seule qu'ait jamais eue un grand chef français avec lui avant sa soumission : il en remporta une impression excellente et une foi absolue dans les bonnes dispositions d'Abd el Kader.
Tout le monde n'était pas de cet avis. Damrémont tout le premier, qui dénonçait les inconvénients du traité au ministre de la Guerre. Une partie de l'opinion, sans doute impressionnée par le peu glorieux abandon de Tlemcen, le condamnait aussi. Le gouvernement du Roi Louis-Philippe le ratifia cependant le 15 juin. Pour la seconde fois, la France consolidait la puissance d'Abd el Kader. Quant à l'opinion indigène, elle était prête à condamner l'émir qui avait traité au lieu de combattre. Mais Abd el Kader pouvait citer des textes du Coran qui permettaient semblables tractations au musulman momentanément trop faible, qui ne renonçait à la lutte que de façon provisoire, et seulement pour se préparer à la reprendre.
***
On constata immédiatement les inconvénients du traité de la Tafna. Damrémont dut renoncer à l'oeuvre de pacification de la province d'Alger qu'il avait entreprise non sans succès. Mais, si le traité donnait les mains libres à Abd el Kader, il les donnait aussi au gouverneur général qui put se consacrer au règlement de la question de Constantine. L'émir n'avait aucun intérêt à s'y opposer. Il considérait que, en chassant le dernier bey turc de la Régence, les Français allaient travailler pour lui : l'éviction d'Ahmed était le second point de son programme, après la soumission du Tittery, avant l'expulsion de l'envahisseur européen.
Au mois de mai, Damrémont avait tenté d'entrer en négociations avec Ahmed sur les mêmes bases que Bugeaud avec Abd el Kader. Les hésitations du bey préservèrent la France de cette solution. Damrémont se rendit à Bône, le 23 juillet, pour prendre la direction des pourparlers. Ceux-ci n'aboutirent pas ; et le 19 août, un ultimatum du gouverneur général fut rejeté. Il fallut se préparer à la lutte. Damrémont qui, au début de l'année, était l'homme de l'occupation " restreinte, progressive et pacifique " (la formule, on le voit, date de loin), Damrémont se mit à l'oeuvre.
Il reçut les renforts qui avaient été refuses à Clauzel. Il préleva des forces dans les provinces d'Alger et d'Oran, et réunit ainsi un corps expéditionnaire de 10.000 hommes pourvu d'un très puissant matériel de siège. Il en prit lui-même le commandement, voyant un des fils du roi, le duc de Nemours, parmi ses quatre commandants de brigade d'infanterie. L'expédition quitta Mediez-Amar, le 1er octobre Le 6, elle était devant Constantine, abandonnée par Ahmed et défendue par son Khalifa Ben Aïssa.
 Vue de Constantine.
Vue de Constantine.
Sans prévoir un investissement régulier, Damrémont prescrivit des travaux qui, vu la nature du terrain, prirent quelques jours. Lui-même fut tué le 12 octobre, au moment où il inspectait une batterie. Il fut remplacé par le général Valée qui était le plus ancien. Dès le lendemain, Valée ordonnait l'assaut, l'artillerie ayant pratiqué une brèche. Les zouaves se précipitèrent en avant, conduits par Lamoricière qui fut blessé par l'explosion d'un magasin à poudre. Les autres colonnes durent engager un vif combat de rues qui se termina victorieusement. Ahmed gagna l'Aurès. Une garnison française fut installée dans la ville.
Ce succès plaça le gouvernement français devant une situation nouvelle. Bien qu'il eût réprouvé toute politique de conquête, il estimait nécessaire de conserver Constantine. Cette exigence empêcha toute entente avec Ahmed qui n'aurait accepté d'administrer le pays au nom de la France que si on lui avait rendu sa capitale. Aucun chef indigène ne parut capable de tenir sa place. Ce fut encore une circonstance heureuse : dans le cas contraire, nous aurions suscité nous-même à l'est la création d'un Etat qui aurait fait pendant à celui d'Abd el Kader dans l'Ouest. Nous n'avons pas eu que de la malchance dans la pacification de l'Algérie.
Valée, gouverneur général en remplacement de Damrémont, nomma un commandant supérieur de la province. Cet officier général était chargé, outre le commandement des troupes, de l'administration, et résidait à Constantine La province était divisée en quatre khalifaliks (Sahel, Ferdjioua, Medjana, Sahara) administrés chacun par un Khalifa indigène. C'était en somme une imitation du système établi par Abd el Kader dans la province d'Oran.
Cette organisation ne resta pas théorique. Elle fut accompagnée d'une extension effective de l'occupation : prise de Stora, fondation de Philippeville, envoi de colonnes mobiles s'installant successivement à Filfila, Sétif, Djidjelli Les circonstances imposaient par leur seul enchaînement ce à quoi n'avaient pu se décider les dirigeants retenus par une partie de l'opinion française.
Au bout de sept années, la domination turque était complètement liquidée. Une méthode d'administration commençait à se faire jour. Mais cette première étape sérieuse vers la pacification était payée cher par l'installation dans la partie occidentale du pays, la plus dangereuse, puisque limitrophe du Maroc hostile, d'un pouvoir indigène étendu, fort, énergique, et que les concessions qu'on lui avait faites n'avaient rendu que plus intransigeant.
A SUIVRE
| |
NOS BUVARDS D'ANTAN
Envoyé par M. Jean Pierre PEYRAT
|
|
Source : collection personnelle de M. Paul Rost de Constantine.
|
|
| L'ALGERIE EXPLIQUEE AUX ENFANTS
J.C Ober
Envoyé Par Marie
| |
C'est à vous mes enfants qui n'avez pas connu ce paradis
Qu'aujourd'hui je m'adresse et à tous je vous dis
Beaucoup trop de gens sur ce sujet vous ont menti
Alors laissez-moi vous expliquer ce qu'était l'Algérie.
Vos Aïeux venaient de France, d'Espagne ou d'ailleurs
Tous des pauvres gens ni plus mauvais, ni meilleurs
Durs au travail et c'est vrai exubérants et ripailleurs
Mais c'était toujours et avant tout des gens de cœur.
Puisqu'on leur fit croire que ce pays était le leur
Pendant un siècle ils mirent cette terre en valeur
Ni l'insalubrité, ni le travail ne leur faisaient peur
Ils étaient certains d'avoir trouvé le bonheur.
En vérité, il y avait bien un Blachette et un Borgeaud
D'autres de cette terre ne possédaient qu'un morceau
La majorité, elle, n'avait que ses bras pour tout joyau
Mais jamais aucun d'eux ne fit payer un verre d'eau.
Quand la guerre fut déclarée et la Patrie en danger,
Antoine, Jean, Ali, qu'ils soient français ou étrangers,
Tous furent volontaires et prêts à se faire tuer
Les cimetières et les monuments peuvent en témoigner.
Français, Espagnols, Maltais, Portugais ou Italiens
Notre communauté s'appelait déjà les Européens
Par nos origines nous étions tous des chrétiens
C'est tout ce qui nous séparait de nos amis algériens.
Nous pensions avoir été compris un jour du mois de mai
Dans l'euphorie nous n'avions pas saisi le faux du vrai
Il nous a fallu laisser notre maison à défaut de palais
Et quitter ce pays et cette terre dans le plus bref délai.
C'est alors que l'exode nous a fait changer de rivages
Connaître d'autres cieux et d'autres visages
Mais nous garderons toujours en mémoire nos paysages
Rien ne remplacera nos villes et nos villages.
Et puisque " Pieds-Noirs " on a voulu nous appeler
Ce nom il nous a fallu d'abord le valoriser
Et nous battre pour le faire respecter
A vous, mes enfants, il vous reste à le faire aimer.
Maintenant me voila au crépuscule de ma vie
Avant de vous quitter, mes enfants, je vous le confie
Défendez l'œuvre de vos Aïeux de toute votre énergie
Pour que soit connue, enfin, la Vérité sur l'Algérie.
|
|
|
NOTES
Bulletin de l'Algérie
N° 7, Mai 1856
|
|
L'ALGÉRIE
SON PASSÉ, SON PRÉSENT, SON AVENIR.
Depuis 1830, l'Algérie est posée devant la France comme un nouveau sphinx aux scabreuses et décevantes énigmes.
De ces énigmes, il a fallu dix ans pour débrouiller la première, savoir :
Si nous devions ou non conquérir l'Algérie;
Si nous devions l'occuper;
Si l'occupation serait restreinte ou illimitée, partielle ou complète ;
Si nous fonderions en Afrique un poste militaire et un comptoir, ou bien une colonie et une cité;
Si l'Algérie demeurerait musulmane et arabe, ou si elle deviendrait chrétienne et française.
Après d'orageux débats, où le temps consommé, l'argent dépensé, le sang versé, les sacrifices accomplis et les succès obtenus ont tour à tour servi d'arguments pour et contre, le voeu du gouvernement s'est enfin trouvé d'accord avec le voeu de la nation sur ce point capital : l'Algérie sera française.
La question de conquête une fois résolue, l'attention s'est portée sur la question de colonisation.
Dès l'année 1844, le maréchal duc d'Isly signalait cette nouvelle phase de l'évolution algérienne :
" La colonisation européenne de l'Algérie, écrivait-il, est aujourd'hui la grande question à l'ordre du jour, puisque la conquête de toute l'Algérie est faite, moins la grande chaîne du Djurdjura, et que nous avons fondé un gouvernement régulier pour les Arabes. "
Depuis lors, la grande chaîne du Djurdjura a été entaillée, fouillée, percée de part en part; la conquête s'est complétée.
Et pendant que cette grande oeuvre se parachevait, la discussion continuait, moins orageuse, mais aussi vive.
Durant ces dix dernières années, la presse a enfanté une prodigieuse quantité de publications; toutes sortes de renseignements ont été recueillis, toutes sortes de projets et de plans soumis au gouvernement et à l'opinion publique, toutes sortes d'appels adressés au capital et au travail ; l'administration a déployé toutes ses ressources ; le budget s'est déversé sur l'Algérie en larges effluves ; la législation a été maniée et remaniée ; mieux que tout cela, le colon a pris possession définitive du sol et s'est mis à l'oeuvre, sérieux, résolu, ardent, infatigable.
Cependant la grande question est encore à l'ordre du jour. Tout récemment la discussion se ranimait au sein du Corps législatif, et on a vu des conseillers du gouvernement se demander avec anxiété ce qu'on a fait en Algérie et ce que l'on se propose d'y faire.
Le moment est venu pour la colonie de prendre la parole elle-même, au lieu et place de ses tuteurs et de ses avocats ; de donner une réponse catégorique, de convaincre les incrédules, d'enhardir les timides, de rassurer les inquiets, de tenir ses promesses, de satisfaire à ses dettes. II y a urgence.
Où trouver une contrée mieux placée, mieux conformée sous tous les rapports pour combler tous les déficits, satisfaire à tous les intérêts lésés ou menacés, pourvoir à toutes les éventualités?
La mission de l'Algérie n'est plus une mystérieuse affaire de pressentiment, de prévision, de supputation; c'est chose claire, patente, actuelle.
L'an 1854, l'Algérie a versé sur les marchés de la France un million d'hectolitres de froment; en 1855, elle a fait mieux : elle s'est chargée de l'approvisionnement de l'armée d'Orient un fourrages, en céréales, en bétail, en chevaux.
L'Algérie fournissant à l'Orient des chevaux, du bétail, des fourrages, des céréales... le fait est remarquable, il est décisif.
Et cependant, quel est aujourd'hui encore l'état de l'Algérie?
Jugée à un point de vue relatif, l'œuvre accomplie est immense, le progrès est palpable, saisissant, nous ne trouvons rien de téméraire, rien d'exagéré dans cette affirmation articulée tout récemment par M. le général Daumas devant le Corps législatif :
" Les Romains en deux cents ans ont moins fait en Afrique que les Français depuis la conquête. "
Mais, si l'on apprécie la situation actuelle à un point de vue absolu, si on l'envisage, non pas sous le rapport de ce qui est, mais sous le rapport de ce qui doit être, on arrive, et cela abstraction faite de toute velléité de critique et de récriminations, à un résultat peu satisfaisant, qui autorise, en quelque sorte, les doutes et les hésitations des uns, les craintes et les inquiétudes des autres.
Les chiffres et les faits sont de terribles instruments qui, dans la discussion des affaires modernes, jouent un rôle bien autrement puissant que celui de l'art oratoire dans les débats antiques. Malheureusement les chiffres et les faits sont presque aussi élastiques que l'art oratoire, et, comme lui, se prêtent à toutes les combinaisons.
Voici comment calculent les adversaires de l'Algérie, voici ce qu'ils disent:
" La surface cultivable, le Tell algérien, est de 18.000.000 hectares; - la surface cultivée aujourd'hui par les Européens est de 100.000 hectares.
" La population de l'Algérie dans l'ordre normal pourrait être de 10.000.000 d'habitants; - la population totale actuelle, y compris même celle du désert, n'atteint pas le chiffre de 3.000.000 d'individus.
" Sur ce nombre, l'armée compte 65.000 hommes, la population européenne 100.000, dont un quart seulement est adonné à l'agriculture.
" Quelle différence, sous le rapport du peuplement, entre la force d'attraction exercée par les Etats-Unis d'Amérique et celle de l'Algérie!
"En fait de routes, qu'avons-nous? Cinq cents kilomètres au plus, réellement achevés.
" En fait de chemins de fer? - Rien.
" En fait de ports? - Un seul, celui d'Alger, qui s'achève. " En fait de canaux de navigation? - Rien.
"En fait de canaux d'irrigation? Rien, ou presque rien. " En fait d'établissements d'entrepôts, de docks? - Rien.
" Les trois provinces dont se compose l'Algérie, sont, les unes à l'égard des autres, au point de vue des communications, dans un état qui se rapproche plus de l'isolement que de la communauté; et cette circonstance suffit à elle seule pour produire et alimenter cet esprit de décentralisation qui, pour n'avoir pas d'autre raison d'être en Algérie, n'en est pas moins funeste à son développement. La même difficulté de communication existe, à des degrés divers, dans chaque province, d'un centre de population à l'autre.
" D'immenses richesses minérales et végétales, mines, bois et forêts, sont éparses çà et là sur le sol, caressées de l'oeil, mais délaissées encore par l'industrie impuissante à se les approprier, à les exploiter.
" De magnifiques cours d'eau s'échappent irréguliers et inutiles à travers des terres qu'ils pourraient féconder et qui demeurent stériles. Sur un point, c'est la stérilité par défaut d'irrigation ; sur un autre, la stérilité par inondation et défaut d'écoulement. "
Ces faits sont frappants... Nous savons bien, nous, Algériens, par quelles considérations on peut les expliquer, en atténuer la portée ; toutefois, on comprend qu'en France l'esprit de critique et de dénigrement s'en soit fait une arme, et contre l'Algérie, et contre son administration, et contre sa population elle-même.
On comprend aussi que, dans une sphère plus élevée, ces mêmes faits aient servi de stimulant aux réclamations, aux théories et aux projets de toute espèce.
S'il fallait enregistrer tous les systèmes suscités par ce stimulant, nous aboutirions à un programme singulièrement complexe, hérissé de contradictions et d'impossibilités.
Les uns imputent le mal à l'absence des capitaux ; ils s'imaginent que les capitaux constituent une force coërcible que l'on peut, par un simple effet de volonté, diriger et transporter d'un point sur un autre; ils s'imaginent aussi que l'arrivée en Algérie d'une cargaison d'or et d'argent suffirait pour transformer subitement le pays.
Les antres, s'en prenant à la rareté de la population, sont persuadés qu'une expédition de quelques centaines de mille bras débarquée sur nos plages amènerait une amélioration instantanée.
Ceux-ci prétendent que l'administration se mêle trop à toutes les affaires.
Ceux-là affirment qu'elle ne s'y mêle pas assez; ils ne comprennent pas que quelque chose soit réalisable sans elle.
Ici on réclame le droit commun et l'assimilation complète de l'Algérie à la France.
Là on sollicite un régime plus exceptionnel encore que le régime actuel.
Plus loin, on voudrait voir l'Algérie transformée en un vaste marché où le monde entier serait appelé à introduire ses produits en franchise de tous droits.
Ailleurs on soupire après les institutions de crédit.
Chacun a son rêve, et de son rêve fait un projet.
Loin de nous la pensée de blâmer et de repousser ce travail de l'intelligence, qui, en général, est inspiré par un sentiment respectable ; loin de nous surtout la prétention de substituer nos idées à celles des autres, comme une panacée à une autre panacée.
Notre tâche, dans cette grande question à l'ordre du jour, se résume en ces termes :
Il y a beaucoup à faire en Algérie, tout le inonde le reconnaît; mais, en toutes choses, il importe de commencer par le commencement, vérité banale, mais trop souvent méconnue et dédaignée.
Or, quel est le commencement nécessaire de tout ce qui est à faire?
Nous répondons. C'est :
1° L'établissement de voies de communications régulières ;
2° L'aménagement des cours d'eau ;
3° L'amélioration des ports, des rades.
Vérifions d'abord cette première proposition.
La colonisation européenne en Algérie est représentée par deux agents : la force qui conquiert et gouverne; la force qui exploite et produit.
A quelle condition le premier de ces agents a-t-il pu accomplir son oeuvre? - A la condition de circuler librement.
Quel est le préliminaire obligatoire de toutes les opérations? -Se frayer des routes, assurer la circulation.
A quel signe reconnaît-on ses progrès? A quelle mesure les évalue-t-on? - A ses moyens de circulation.
Supposons le moment où, d'un bout du territoire à l'autre sur tous les points et jusque dans les plus intimes replis du terrain, la force qui conquiert et gouverne, pourra alter et venir sans obstacle, sans retard ; à ce moment-là, la conquête sera achevée, la pacification définitive, l'action du gouvernement absolue, incontestée.
Pour la force qui exploite et produit, mêmes procédés, mêmes conditions, même loi.
Ici encore c'est par le rayonnement, la facilité et la sécurité des communications que l'oeuvre s'accomplit, se développe et s'évalue.
Voyez comment les choses se sont passées :
A la suite de nos armées, le travail, poussé par cette expansivité qui lui est propre, se précipite en Algérie avant même d'y avoir été provoqué ; ne pouvant se frayer la route lui-même, il s'attache aux flancs et à la queue de l'armée, il la suit partout où elle va. Le travail, dans ces conditions, est restreint aux plus simples proportions du négoce.
Dès que la circulation de l'armée est suspendue, il s'arrête lui-même, et, renfermé dans l'enceinte des villes et des camps, il se concentre dans l'industrie urbaine.
Les issues lui sont-elles ouvertes, il s'y jette aussitôt, il se répand, il s'avance , et de l'industrie urbaine passe à l'industrie agricole.
D'abord l'agriculture s'installe et se retranche autour des places fortes, des grands centres de population ; peu à peu elle se hasarde, pousse en avant, s'étend et se développe.
Dans cette marche continue, de quoi dépend le progrès? D'où proviennent les obstacles? D'où dérive l'accélération ou le ralentissement du mouvement? Des conditions de la circulation. Si le passage est possible, le travail le franchit et poursuit ; si l'issue est fermée, il s'arrête ou rebrousse ; quand les communications sont faciles, rapides, économiques, il prospère et grandit; quand elles sont difficiles, lentes, dispendieuses, il languit et meurt.
D'où cette conclusion :
Le progrès de la colonisation est proportionnel au développement et à la facilité des communications.
Ceci est élémentaire, et tellement élémentaire, que la démonstration serait superflue tant l'évidence est frappante.
A quoi bon alors aller chercher bien loin l'explication de ce que l'expérience journalière nous fait toucher du doigt? Pourquoi se creuser l'esprit pour découvrir quel est le meilleur système d'administration applicable au pays, quel est le meilleur moyen d'attirer en Algérie les bras et les capitaux, par quel procédé on pourra lutter contre la force qui pousse l'émigration européenne vers l'Amérique ?
Ces diverses questions ont leur importance, sans doute, mais elles viennent toutes à la suite d'une question première plus essentielle, plus urgente, celle de décider comment ouvrir à la colonisation les voies et les communications qui lui sont nécessaires pour rayonner sur le pays et pour s'avancer au-delà des centres de population au bout desquels elle est encore aujourd'hui retranchée, et pour ainsi dire enchaînée.
C'est là le premier problème à résoudre, le premier pas à faire, le commencement de tout : les faits confirment de toutes parts cette vérité.
L'Algérie possède des richesses minéralogiques immenses; le fer, le cuivre, le plomb y abondent; et cependant, ces gisements, pour la plupart d'une exploitation facile et peu coûteuse, restent inexploités; ou bien le minerai des mines en exploitation est expédié en France, à l'étranger, pour y être traité, tandis que l'Algérie possède de vastes et belles forêts, plus considérables même que celles de toute la France, des forêts riches en essences précieuses, et qui, elles aussi, au grand détriment des arts et de l'industrie, demeurent inexploitées.
Ailleurs, comme ici, le minerai et le combustible se rencontrent rarement tout auprès l'un de l'autre ; mais ailleurs l'un va chercher l'autre, grâce à la facilité des communications, à l'économie des transports.
Ainsi, dans un autre genre de faits, le pain, qui se paie 35 c. à Sétif, coûte 70 c. à Constantine; et la distance entre ces deux points n'est que de 130 kilomètres.
Ainsi la mesure d'orge, qui a coûté de 3 à 4 fr. à Teniet-el-Haad, vaut de 13 à 15 fr. à Alger; l'orge, qui a été payée 3 fr. 75 c. à M'Mila, vaut déjà 11 fr. 50 c. à Aumale, et se vend 18 fr. à Alger.
Et cela, toujours grâce à l'absence de viabilité, à la difficulté, à la cherté des transports.
Nous pourrions multiplier les citations ; mais à quoi bon s'obstiner à démontrer ce que personne ne conteste? Bornons-nous à résumer les résultats de cet état de choses.
Ce résumé, le voici :
Non seulement les trois provinces, non seulement, dans chaque province, les principaux centres de population se trouvent ainsi, par la difficulté des communications, isolés les uns des autres, mais encore, par suite de cette difficulté même, le prix des denrées éprouve d'un point à l'autre, et suivant les saisons, des variations brusques, irrégulières et excessives qui déroutent tous les calculs et même toutes les transactions aléatoires.
D'autre part, la colonisation se trouve entravée dans son essor ; et enfin, c'est à l'indigène que reviennent, comme une sorte de monopole, tous les bénéfices, tous les profits de l'industrie des transports, industrie vitale dont dépend, en tout temps, le sort du commerce.
Encore si cette intervention forcée de l'Arabe amenait une amélioration des prix, mais non ! Les chameaux et les mulets pouvant seuls franchir les sentiers tortueux et abruptes par lesquels la circulation cherche à se faire jour, et l'indigène étant le seul conducteur que comportent et la nature du véhicule et la nature des routes, il en résulte que l'indigène dispose et profite seul, à peu près en maître, des moyens de transport par terre. Or, par un phénomène tout particulier et caractéristique de cette race, l'indigène produit et ne consomme pas : après avoir transformé ses produits en numéraire, il enfouit ce numéraire, et le dérobe à jamais à la circulation, de telle sorte que, par l'absorption de la monnaie aussi bien que par l'exploitation des routes, c'est de l'indigène que dépend, pour une grosse part au moins, le mouvement des échanges, c'est-à-dire la vie commerciale.
Assurément ce n'est pas là un état de choses normal.
Que faire pour modifier, transformer cette situation ; pour donner à l'élément européen la supériorité qu'il doit avoir, l'appeler à l'initiative qu'il doit exercer?
Qu'on nous permette d'appliquer à la solution du problème économique et politique qui nous occupe, le procédé usité en géométrie ! Supposons le problème résolu !
Les trois provinces de l'Algérie sont sillonnées par un système de routes, toujours viables et carrossables, dont l'artère principale met en communication directe Alger avec Oran et Bône, et dont les embranchements relient, dans chaque province, les villes du littoral aux villes de l'intérieur.
Sur ces routes est établi un service de messageries à grande vitesse, de roulage accéléré et de roulage ordinaire ; ce service est régulier, quotidien, organisé sur le même pied qu'en France ; les voyageurs peuvent, en Toutes saisons, se rendre d'Alger à Oran en quarante heures, d'Alger à Constantine en quarante-cinq heures, et les marchandises en huit jours ; l'échange de la correspondance, dépêches, lettres et paquets, est journalier d'un bout à l'autre du territoire; sur tout le parcours sont édifiées, de distance en distance, de vastes hôtelleries servant à la fois de pied-à-terre aux voyageurs, de gîte aux voituriers, d'entrepôt pour les marchandises.
Conséquences immédiates de l'hypothèse : l'agriculture et l'industrie ont pris un essor illimité; des terres qui, jusqu'alors inaccessibles au travail, étaient restées improductives, ont acquis une valeur réelle et ont été livrées à la production ; les relations commerciales sont régularisées ; les transactions et les échanges se sont multipliées ; l'isolement a cessé entre les groupes dont se compose la population; les liens se sont établis, se sont resserrés ; les intérêts se sont confondus.
Le gouvernement a pu établir une correspondance plus active, plus régulière, plus facile, moins dispendieuse, entre les diverses administrations dont il se compose ; la centralisation des pouvoirs existe réellement,
Les mouvements et les opérations stratégiques sont devenus plus faciles, plus rapides ; le rayonnement continu de l'armée, que le maréchal duc d'lsly considérait avec raison comme le moyen le plus efficace de pacification et la meilleure garantie de sécurité à l'égard des indigènes, le rayonnement de l'armée s'opère par de simples changements de garnison.
La sécurité existe partout : sur les routes et dans tout le pays. Comme conséquences médiates :
Les capitaux qui demandent, non pas une impulsion extérieure, non pas des encouragements extra commerciaux, non pas une direction étrangère, mais tout simplement un aliment et des débouchés, avec la faculté d'en disposer librement, les capitaux arrivent d'eux-mêmes en Algérie, parce qu'ils y trouvent l'aliment et les débouchés qu'ils recherchent.
Alors le flot de l'émigration grossit en raison des issues qui lui sont ouvertes; et il avance, non plus sur la foi d'une espérance vague et incertaine, mais sur la foi d'une demande positive et formelle.
Alors l'élément européen prédominera, non pas encore numériquement peut-être, mais moralement, par son activité, ses arts et son industrie, surtout par l'influence légitime acquise par les travaux exécutés, par les améliorations faites, par le bien-être répandu, par la prospérité générale ; et l'élément indigène, déshérité désormais du rôle d'intermédiaire, se renfermera dans sa mission de produire à bas prix et d'approvisionner les marchés des produits pour lesquels nous devons renoncer à lui faire concurrence, d'où l'activité européenne se chargera de les diriger sur les centres de consommation, sur les points d'embarquement.
Eh bien, que faut-il pour que l'hypothèse se vérifie, pour que la fiction devienne réalité?
Il faut ouvrir des routes; il faut surtout les achever et les exploiter ; il faut créer la viabilité.
SAINT-LAGER et E. ROBERT.
1) Ce travail, remarquable sous tous les rapports, mérite d'être répandu, et nous croyons être utile en lui donnant une place dans notre Bulletin. MM. Saint-Lager et E. Robert sont déjà connus ; ils ont rendu de très grands services à la colonie par la création de la caisse du commerce algérien, ils ont droit à la reconnaissance du pays. (Note de la rédaction.)
|
|
PHOTOS de Souk-Ahras
Envoyé par M. Charles Ciantar
|


Olivier de ST-Augustin - Ex Mairie


Cimetière - Ex Mairie
|
|
Les Souvenirs militaires
de M. le Colonel Henri Fabre-Massias
|
|
VOYAGE AUX ZIBANS (1848)
CHAPITRE IV
LE SAHARA.
Le lendemain, 3 novembre, nous étions à Doucen dès le matin ; nous n'avions fait que 11 kilomètres. Doucen est une position importante et qui mérite qu'on en parle avec quelque détail.
C'est une oasis ruinée, c'est-à-dire la trace d'un affreux sacrilège. L'histoire de ce pays a dû reproduire, on le comprend, des guerres nombreuses, des conquêtes sanglantes, d'héroïques résistances, et les héros, et les tyrans, et les oppressions que font naître une grande division des territoires, des habitudes guerrières très répandues, des prétentions aristocratiques très orgueilleuses, une grande facilité de parcours. Les surprises à la suite desquelles on emmène les troupeaux, les femmes, les enfants, sont dans la bouche de tous les conteurs. Mais en général les oasis résistent, et Doucen en particulier devait être susceptible d'une grande résistance.
Là les collines du Kef-el-Khredim se sont encore élevées, et à leur pied même naît l'abondante source qui alimentait l'oasis. La colline a 1 kilomètre environ de crête sans interruption, les mosquées de Djaroub en occupent l'extrémité est, et toute son étendue est semée de ruines romaines. On reconnaît encore les traces d'un ouvrage romain sur le monticule qui domine la source, et les ruines antiques se prolongent assez loin de l'autre côté du bassin, dans la plaine sans accidents qui s'étend sur la rive gauche. Ainsi, les gens de l'oasis pouvaient donner aux points principaux des remparts plus de solidité que n'en ont les constructions habituelles au pays; l'eau ne pouvait être interceptée. Jamais les palmiers ne peuvent être brûlés, leur bois brûle aussi mal que celui du figuier, mais le palmier que la hache a frappé ne repousse pas du tronc ; il ne peut venir que de semis ou de drageons : et quand tous ceux d'une oasis ont été abattus, il faut bien que la population émigre. Alors les jeunes pousses ne sont ni soignées ni surtout arrosées.
Elles ne peuvent donc reproduire l'indispensable couvert qui sauvait la fécondité de ce coin du désert et y maintenait la population. Désormais, au lieu de l'abri qui s'offrait nu voyageur, du marché où le commerçant déchargeait ses chameaux, du délicieux ombrage qui charmait les yeux de l'artiste, ce coin de terre n'a retenu que son nom et des ruines que respecte longtemps l'action peu destructive de ce climat. A Doucen, bien des palmiers semblaient coupés depuis quelques jours seulement. Une douzaine vivent encore et étendent leurs gracieux parasols au-dessus du bassin de la source; mais ils ne portent plus de dattes, mais l'eau ne circule plus dans des canaux entretenus par la main des hommes et protégés par l'ombrage des dattiers. Elle forme deux bassins communiquant par une petite chute que l'on franchit sur un pont grossier de troncs de palmier fait par le génie; puis elle descend vers le lit que nous remontons depuis Lioua et disparaît avant d'avoir atteint le maader.
Les seuls habitants permanents de Doucen sont aujourd'hui les fabricants de salpêtre. Ils y trouvent une terre excellente à laquelle des réactions naturelles rendent rapidement le salpêtre enlevé par les lavages. Ils nous accompagnaient sur la colline et se jetèrent avidement sur la terre mise à découvert par une pierre romaine que nous fîmes retourner. Nous lûmes ainsi ce fragment d'inscription :
VVS PIVS
VCOS IIPR cS
TUTE SVA VS
T LEG.v AV PR
Le taf, l'alfa, le tamarix, toute la végétation da Sahara sauvage remplace les produits cultivés de l'oasis et alimente, mieux que ne le feraient les palmiers, le foyer des salpêtriers. Nous sommes à six lieues au nord des O. Djellal, oasis guerrière qui ne récolte pas le salpêtre, mais fabrique la poudre et a vigoureusement résisté, le 10 janvier 1847, au général Herbillon. Toutefois, l'énergie de l'attaque dirigée par les Français a vivement impressionné les populations sahariennes, et Urbi en invoque le souvenir quand il veut déterminer à l'obéissance quelque oasis récalcitrante. Cet esprit de révolte qui devait, dans le cours de l'année suivante, produire 'la lutte acharnée de Zatcha, ne semblait pas né encore ou ne se révélait pas. Il est vrai que l'opération du recensement des palmiers commençait à peine dans les oasis voisines de Biskra ; et c'est cette opération, je pense, qui fournit de nombreux adhérents aux conseils du fanatisme religieux. Mais lors de notre voyage, nos relations, même les plus passagères, avec les indigènes, eurent un caractère de cordialité que je n'avais point connu dans le Tell ; partout les chefs insistèrent pour obtenir les témoignages de notre satisfaction, afin de les représenter au bureau arabe de Biskra. Nous eûmes à Doucen même la visite d'Issa-ed-Daïn, cheik des Ouled-Arkad (fraction des O. Naïls). Il nous apportait un mouton en diffa et demandait une sorte de procès-verbal de son hommage aux Français.
J'admirai en lui un remarquable type de cavalier du Sahara. Il semblait avoir une soixantaine d'années : sa tète était celle d'un chef habitué à commander, à combattre, à être craint et respecté. Sa physionomie était grave et digne, avec quelque rudesse. Il avait cinq pieds sept à huit pouces, et son corps était mince, étroit, nerveux, comme est, assure-t-on, celui des Touaregs. A ce propos Lârbi me rapportait un dicton du désert qui compare à des planches les mangeurs de dattes.
Dans la journée, Sliman nous devança à El-Amri, limite nord de son territoire, pour y réunir à notre passage les Kebar ou grands de sa tribu des Bou-Azid. Pour nous, nous consacrâmes vingt-quatre heures à l'étude des procédés arabes de fabrication du salpêtre. La nuit fut encore très agréable. Nous avions eu le temps de visiter les restes romains qui survivent aux vestiges de l'oasis sur les deux rives du ruisseau. Le commandant Saint-Germain devait faire revivre l'oasis de Doucen, dont il appréciait la position comme l'avaient fait les Romains. Il faut une volonté énergique et une grande puissance pour accomplir un pareil dessein. M. de Saint-Germain possédait l'une et l'autre, et, tant qu'il a vécu, son nom inspirait crainte et respect dans les Zibans. Si j'en juge par la manière dont Urbi surtout parlait de lui et de Ben-Gannah, et aussi par la sollicitude avec laquelle les cheiks s'informaient de lui, son influence s'était tout à fait substituée à celle du chef arabe. Il relevait les Ben-Ferrath et dominait les deux familles rivales du Sahara.
Malheureusement le respect héréditaire des Arabes pour leurs anciens chefs ne se déplace ainsi au profit d'un étranger que sous l'influence incessante de la crainte ou de la reconnaissance pour sa personne. M. de Saint-Germain inspirait alors l'une et l'autre. Mais la colère et le fanatisme les firent oublier, quand il resta quelques mois éloigné de son commandement : la révolte triompha de sa mort, si glorieuse et si chèrement payée qu'elle eût été; et nul ne le remplaça au profit de la France. La conquête morale opérée pendant ces quatre années fut presque perdue.
Le 5 novembre, à six heures et demie du matin, nous nous mimes en route, emportant de la terre de Doucen et accompagnés par les salpêtriers, qui profitaient de notre escorte pour se rendre à El-Amri ; de mon côté, je comptais tirer profit, pour nos recherches, de leur conversation. Après trois quarts d'heure de marche, nous trouvâmes un terrain plus accidenté. Quatre gazelles se sauvèrent devant nous et prirent chasse en se suivant sur une seule ligne ; elles courent si vite, que les poils blancs de l'arrière-train figurent des oiseaux qui raseraient les herbes. Un chien, qui voyageait avec nous et qui se lança à leur poursuite, fut distancé en un instant, et nos Arabes n'essayèrent même pas de les poursuivre.
Une demi-heure après, je lançai mon cheval à fond de train vers le sommet d'un monticule où paraissait un troupeau de soixante à quatre-vingts de ces gracieuses hôtesses du Sahara. Quand j'arrivai, elles avaient disparu et étaient hors de vue; on parvient cependant à les atteindre en les fatiguant au moyen de relais de lévriers, ou bien en les chassant au faucon.
Cependant un ravin boisé paraissait à une demi-lieue vers notre gauche, et un gros animal noir parut sortir des herbes qui le couvraient et trotter vers Doucen. C'était un sanglier. A peine fut-il reconnu que tous les Arabes de l'escorte partirent de toute la vitesse de leurs chevaux, les uns se dirigeant vers l'animal pour le suivre, tandis que d'autres couraient en avant pour le couper. Caby, le seul des canonniers qui n'eût pas de mulets à conduire, courut au soutien des Arabes. Mais la chasse ne lui revint pas. Deux ou trois coups de fusil se firent entendre à une lieue à gauche, et nous continuâmes à marcher en suivant le chemin assez frayé qui mène à El-Amri.
Mais tandis que nous étions occupés de la chasse, et que je marchais à pied en tête de mon petit convoi, quelques cavaliers armés de fusils parurent à notre gauche, courant au bruit des coups de feu. Quand ils nous aperçurent, ils tournèrent vers nous, faisant signe qu'ils étaient amis, et, d'ailleurs, laissant leurs fusils au repos. Une vingtaine d'entre eux m'entourèrent. Le plus apparent mit pied à terre, en me demandant si je n'étais pas le capitaine Fabre, et, sur ma réponse, me remit la lettre suivante :
" Biskra, le 3 novembre. - Mon capitaine, une nouvelle inattendue me donne de l'inquiétude pour vous. Des cavaliers, serviteurs de Bel-Hadj, viennent de tenter une razzia dans le sud de l'Oued-Djedi. Ils ne sont probablement pas seuls, et le succès qu'ils ont obtenu contre les O. Mouleit doit leur donner de l'audace. Je crains qu'à cette nouvelle les O. Sassi, qui n'ont pas encore fait leur soumission, ne recommencent leurs entreprises, et vous ne seriez pas en sûreté à Doucen.
Je vous engage fort à retourner le plus vite possible dans les Zibans. Veuillez bien dire à Lârbi que je compte sur son intelligence, dont il m'a souvent donné des preuves. Dès que vous serez de retour dans les Zibans, vous serez en sûreté, et il vous suffira d'un ou deux cavaliers pour rejoindre Biskra. Lârbi s'établira alors avec les cavaliers que je lui envoie à Lioua, et aura soin de me faire prévenir de tout ce qui se passera. - Si ma lettre vous trouvait en route pour le Hodna, vous pourriez continuer sans crainte. Lârbi, dans le cas où il vous serait indispensable, continuerait à vous suivre, et il enverrait à Lioua un brigadier avec quinze cavaliers. " Cette lettre était signée de M. Dubosquet.
Je n'admettais pas que mon petit convoi fût tout à fait pourvu de défense, quoique mes, canonniers fussent fort mal armés (ils avaient des carabines à tige, mais les balles appropriées à ces carabines n'étaient pas encore parvenues à Constantine). Aussi, dès que Lârbi me rejoignit avec son cheval couvert de sueur à la suite d'une course forcée de plusieurs lieues, je lui fis part de la lettre, et lui dis qu'il aurait à retourner à Lioua, en me laissant seulement deux guides. Il m'accompagna jusqu'à El-Amri, où nos routes se séparaient. C'est à El-Amri que finit le territoire des Bou-Azid.
Nous y retrouvions Sliman, qui pourvut encore splendidement à notre déjeuner. Comme j'allais remonter à cheval, je le vis arriver avec une douzaine d'indigènes en costume assez propre. C'étaient, me dit Urbi, les kebar, les grands de la tribu. Ils m'entourèrent et commencèrent à débiter des discours que l'interprète me traduisait, chacun enchérissant sur les protestations de reconnaissance pour la France qu'avait exprimées son voisin. " La France, me disaient-ils, nous a donné la richesse ; mais, de ce qui nous appartient, bien peu est à nous, juste ce qui nous est nécessaire pour vivre : le reste est tout à son service! " J'écoutais gravement, trouvant assez étrange, à part moi, ce rôle de prince en voyage que les circonstances m'appelaient à jouer. " La France, leur répondis-je, ne veut pas diminuer vos richesses, loin de là. Accroître sans cesse la prospérité de ce pays, y faire régner la justice et, par elle, l'abondance pour tous, c'est notre voeu ; ce sera le but et la récompense de tous nos efforts. Recommandez à tous la confiance en elle et l'esprit de paix. Plantez de nouveaux palmiers : autour de vos oasis étendez la culture des céréales, jusqu'à ce que vos champs couvrent tout le pays. Si vous vous serrez autour du gouvernement des Français, les maraudeurs respecteront vos champs, et vos greniers n'auront plus rien à demander à ceux du Tell. Chacun d'eux vint à son tour me serrer la main en s'inclinant, sans faire pourtant le geste de la baiser. Leurs manières étaient à la fois plus cordiales et moins serviles que celles des habitants du Nord.
A peine étais-je à deux kilomètres d'El-Amri, que j'en vis sortir des cavaliers courant après moi. L'un d'eux était Lârbi lui-même ; il m'apportait une seconde lettre de M. Dubosquet. La razzia n'avait pas eu de suite : les moutons étaient repris, les maraudeurs en fuite ; nous pouvions continuer notre course dans les mêmes conditions que les jours précédents. Je vis avec grand plaisir revenir Lârbi, dont les manières me plaisaient et dont l'intelligence m'était fort utile.
A six kilomètres d'El-Amri, nous trouvâmes El-Bordj, oasis considérable que nous traversâmes sans nous arrêter, pour aller, à 2,500 mètres plus loin, à Tolga, l'une des plus puissantes entre ces riches communes. A droite, nous avions laissé Lichana, Farfar, Zaatcha. Nous approchions des montagnes, et les quelques lieues qui s'étendent à leurs pieds sont semées de riches et nombreuses oasis.
Je dérogeai, ce jour-là, à mon habitude de coucher en pleine campagne : j'étais bien aise de vivre un jour dans une oasis, au moment de quitter la région qui contient ces petites républiques. Le chef de celle-ci, Ben-Meïoub, d'une très noble et très sainte famille, nous dit Urbi, nous fit l'honneur de passer toute la soirée avec nous. Il nous dit qu'il avait été confirmé ou placé même dans le cheikat de Tolga par le duc d'Aumale, et nous raconta longuement ses relations avec le prince. Il dîna avec nous et mangea, avec un plaisir évident, tout un plat de pommes de terre frites, préparées pour nous trois. Les plaisirs de la table paraissent être, au reste, généralement appréciés par ces grands feudataires, moins guerriers qu'autrefois et presque toujours, d'ailleurs, habitués à résider dans l'intérieur de leurs murailles et à faire, derrière leurs fossés, la seule guerre à laquelle ils soient ordinairement appelés. Ben-Meïoub est jeune et sa tête est belle ; il a une tendance à l'obésité, et Issa-ed-Daïn m'avait semblé bien plus beau.
Le soir, un véritable orchestre d'une vingtaine de musiciens vint nous donner une sérénade. Ben-Meïoub avait réuni la musique de sa chapelle, et c'était un grand honneur qu'il faisait à ses hôtes. La mélodie était bizarre, mais elle était réelle, et l'on en venait à l'entendre avec plaisir, quoique Félicien David ait encore bien modifié l'art arabe pour en faire supporter à notre oreille les phrases écourtées et l'harmonie inaccoutumée. La principale flûte manquait, nous dit-on, mais non pas les trompettes au son nasal, les tambourins et les petites liâtes faites de je ne sais quel bois blanc. La musique de Tolga jouit d'une grande réputation dans les oasis.
Le lendemain matin, Ben-Meïoub était à cheval pour nous guider lui-même hors de l'oasis. Il nous fit passer près d'un édifice assez grand, avec créneaux et mâchicoulis, qu défend l'entrée de Tolga du côté des montagnes. Il nous raconta la résistance vigoureuse que son frère, aidé des hommes de sa maison, avait opposée à Ben-Azzous, quand cet allié d'Abd-el-Kader essaya, à l'aide d'un bataillon prêté par l'émir, de pénétrer dans les Zibans. Le château montrait encore les trous faits par les boulets de Ben-Azzous. Celui-ci n'avait pu forcer l'entrée de Tolga. Le fossé d'enceinte est, du reste, large et profond.
Ben-Meïoub nous fit ses adieux à deux kilomètres de Tolga, à un petit col au pied de la mosquée de Sidi-Rouar. Déjà le sol commence à présenter quelques accidents. A six kilomètres de là, nous nous trouvâmes dans un défilé qui traverse une petite chaîne assez élevée, celle sans doute à laquelle touche Biskra Le sol était devenu pierreux ; les broussailles y étaient assez abondantes, et j'y remarquai une sorte de melon sauvage. La halte se fit à seize kilomètres de Tolga, dans un lieu assez sévère et dépourvu d'eau. Le soleil s'était caché, et son absence ajoutait à la tristesse du lieu.
La seconde moitié de cette étape fut vraiment pénible. Pendant quinze kilomètres environ, nous voyageâmes dans les Areg. Cette mer de sable est tellement uniforme que nous nous y perdîmes deux ou trois fois. Je fus, du reste, surpris de la facilité avec laquelle s'en tiraient nos mulets et nos chevaux. Quant à moi, j'en parcourus la plus grande partie à pied, trouvant les Areg encore moins désagréables ainsi qu'en restant â cheval.
Enfin, nous débouchâmes dans une plaine qui s'étendait jusqu'an pied des vraies montagnes. C'est celle de l'Oued-Sersous, et elle s'appelle le Mâder-Rhamra. On y voyait çà et Ià des bergers, des laboureurs et des troupeaux de moutons, mais point de tentes. J'en demandai la raison à Lârbi, qui m'expliqua que les Rhamras n'habitaient cette plaine que pendant les semailles. Celles-ci duraient seulement quelques jours, et ils n'avaient pas besoin de faire dans le Mâder un établissement sérieux.
Le soir, quand nous eûmes, non sans quelque peine, traversé le lit assez fangeux de la rivière, et que notre camp fut établi sur la rive gauche, un certain nombre de Rhamras se rapprochèrent de nos tentes, et ils complétèrent les renseignements de Lârbi.
Depuis très longtemps, me dirent-ils, les O. Derradj (habitants du Hodna), qui peuvent mettre sur pied deux mille cavaliers, empêchaient toute culture jusqu'à Lichana, dans la région des oasis et jusqu'à El-Outaia, hors des palmiers. Si une oasis essayait de semer des céréales hors de ses murs, les 0. Derradj accouraient et mettaient leurs chevaux au vert dans les champs d'orge ou de blé. Eux-mêmes se partageaient en fractions, dont les razzias réciproques arrêtaient aussi tout travail intérieur. Les Français les ont soumis en 1845, et, depuis ce temps, eux et leurs voisins travaillent et recueillent d'admirables moissons. La plaine où nous sommes n'est ensemencée que depuis deux ans. Mais, chaque année, Dieu, qui favorise les Français, a envoyé pendant l'hiver des pluies abondantes dans la montagne. La rivière s'est gonflée et a couvert tout le Mâder ; la semence, fécondée par elle, a rapporté 90 pour 1. , il est vrai que, si ce Nil au petit pied manque à fertiliser ses rivages, toutes les semences sont perdues. Mais le travail de l'agriculteur est si peu de chose dans cette terre facile entre toutes à la charrue! L'étroit binoir du Tell est une machine compliquée auprès de la charrue du Sahara. Et celle-ci ne sillonne le sol qu'une seule fois pour couvrir d'un peu de ce sable fertile le grain jeté sur la terre.
Nous dîmes adieu, le 6 novembre, à cette plaine et au Sahara. Nous allions nous élever au premier étage des montagnes, au plateau du Hodna, intermédiaire entre le Sahara et la région des lacs. Au moment où nous arrivions au pied des hauteurs, à sept kilomètres du bivouac, Urbi me montra le revers des collines où s'était livrée la grande bataille à la suite de laquelle Ben-Gannah envoya tant d'oreilles à Constantine. Son récit dura longtemps, et je voudrais pouvoir le reproduire ici.
C'était, je crois, en 1839, et la France, intervenant dans les querelles du désert, avait remplacé par Ben-Gannah le cheik El-Arab du bey, Ben-Ferrath. Quand Abd-el-Kader essaya de soulever contre nous toute la régence, il envoya dans l'est Ben-Azzous, en l'appuyant d'un bataillon régulier. En outre, Ben-Azzous faisait valoir sa qualité de marabout et ravivait toutes les haines héréditaires des diverses tribus contre les Ben-Gannah. Les Bou-Azid et, je crois, les Saharis se joignirent à lui, et il marcha à la conquête des oasis.
Repoussé de Tolga, il atteignit au Foum-oued-Sersous (foum, embouchure, se dit du point où le fleuve sort d'une gorge pour couler en plaine) Ben-Gannah et toute sa smala. Notre cheik El-Arab avait demandé du secours à Constantine ; mais à peine y connaissait-on le nom de Biskra : on n'y avait aucune notion du pays où il eût fallu risquer une colonne-, sur la foi d'alliés douteux, et à quarante lieues de ses renforts. Ben-Gannah ne reçut donc du général Galbois que des encouragements à bien faire et à défendre seul son pays et le pouvoir de sa famille. Il s'y décida en brave soldat. Dans une ravine que Lârbi nous montrait, et qui ouvre dans la montagne un difficile accès, il plaça ses femmes, sa famille, ses chameaux. En avant, du côté de l'ennemi, il rangea quelques centaines d'hommes, égalant à peine, en nombre, la moitié des troupes de Ben-Azzous.
Mais, pendant la nuit, quelques-uns de ses anciens vassaux vinrent le trouver de la part des cheiks des tribus rebelles. L'orgueil de Ben-Azzous, ses manières hautaines de prêtre et d'étranger avaient choqué ces hommes habitués aux moeurs faciles de leur aristocratie laïque et surtout de Ben-Gannah, qui joint un bon coeur et des habitudes très affables à l'avidité ordinaire aux chefs arabes. " Attaque sans crainte, lui dirent-ils, cet orgueilleux prêtre du Maghreb : les fusils des trois tribus qui l'ont joint ne tireront pas sur toi. Nous marcherons à sa suite, mais tu connaîtras que nos coeurs sont avec toi, quand tu l'aborderas." Le matin venu, Ben-Gannah rangea ses hommes en bataille, leur fit part du secours qu'il attendait, et, donnant le signal du combat, courut le fusil haut contre Ben-Azzous, ordonnant de tirer sur les réguliers venus de l'Ouest. Les cavaliers de l'armée opposée tirèrent à leur tour, mais leurs fusils n'étaient pas tournés vers les Ben-Gannah. Un cri de victoire accueillit ce signe de leur défection. Ben-Azzous comprit qu'il était perdu, et s'enfuit avec ses serviteurs. Les malheureux fantassins réguliers se virent trahis, et, connaissant trop bien les moeurs arabes pour espérer merci, s'acculèrent à la montagne et y furent massacrés tant par les Ben-Gannah que par leurs alliés de la veille. Leurs oreilles furent salées, enfilées en chapelet et envoyées au général Galbois. La joie fut extrême à Constantine, et c'était à bon droit: les Zibans et le Hodna avaient, ce jour-là, rompu pour toujours avec l'émir. Les bataillons réguliers refuseraient désormais de s'y risquer, et la domination d'Abd-el-Kader ne devait pas dépasser Aïn-Mâdhi.
On envoya à Ben-Gannah une dizaine de croix d'honneur. Il en donna à tous les siens, en commençant par les plus proches et comprenant dans cette distribution ses fils ou ses neveux en bas âge. Nous en avons vu, huit ans après, sur la poitrine de ces enfants devenus hommes. Par bonheur, ils s'en sont montrés dignes, et leurs vaillants coeurs les ont bien portées.
Depuis huit jours, notre marche avait été bien facile. Mais le passage du Teniat-el-Argoub et du Teniat-el-Saïba, qui se suivent entre le Mâder-Rhamra et M'Doukal, est vraiment rude et difficile. Tous les ans, me dirent les guides, il s'y perd quelques chameaux. II est à regretter qu'on n'ait pas encore eu le temps d'envoyer là un bataillon camper huit jours avec des pièces et des barres à mine pour rendre facile celle porte du désert. La route d'El-Outaia (Teniat-el-Sosyni) est meilleure.
Sauf le passage de ces deux cols, la route est facile et agréable. Le sol est accidenté, la végétation plus variée que dans le Sahara. Nous dûmes faire la grande halte sans eau, à seize kilomètres du Mâder.
A huit kilomètres de là, nous trouvâmes un sable mêlé d'argile et imprégné d'humidité. Bientôt après, une jolie rivière coulait dans un chenal en sable entretenu avec soin. Des troupeaux, des hommes, des femmes, commençaient à se montrer. C'était tout le mouvement qui avoisine un village riche ; et, de plus, des enfants courant au galop sur tous les chevaux, les mulets, les ânes de M'Doukal, y signalaient un jour de fête.
C'était en effet l'Aïd-Kebir, la Pâque musulmane. Chaque famille avait tué autant de moutons qu'elle comptait de mâles, même parmi les serviteurs. On avait choisi, pour le sacrifice, les plus beaux du troupeau, en les attribuant, par ordre de taille et de force, au chef, puis à son fils, puis successivement aux moins considérables. C'est que, si les péchés d'un musulman le chargent assez pour lui faire redouter le terrible passage du pont qui mène au paradis, il pourra se faire porter sur le mouton qu'il a sacrifié à la dernière Aïd-Kebir, et il importe, surtout pour les consciences chargées, que cet auxiliaire soit robuste. Ce jour-là, du reste, les enfants ont congé et peuvent tout se permettre. Ils ont surtout le privilège de courir sur toutes les montures qu'on leur interdit en tout autre temps. Je n'ai pas parlé des femmes; on sait qu'elles n'entrent pas en paradis.
M'Doukal a encore des palmiers. Mais il faut y dire adieu à leurs tiges élancées, à leurs élégants parasols, à leur gracieuse verdure. Déjà les arbres fruitiers des régions plus froides s'y mêlent en nombre égal. Les abricotiers, les figuiers, les orangers, les oliviers y comptent pour 8,000 sur 14,000 arbres payant la taxe à M'Doukal.
Notre camp à M'Doukal fut encore un des plus agréables de la route. Je l'avais établi au bord de la rivière, en dehors de l'oasis, et entre quelques groupes de palmiers que je m'efforçai de reproduire. Mes essais de dessin et une promenade aux environs occupèrent cette après-midi. A la nuit, nous fûmes joints par Cheik-Daïna, le commandant du goum des Saharis, celui même qui nous avait si bien accueillis à El-Outaia. Il m'était envoyé par le commandant Saint-Germain, alors de retour dans les Zibans. Daïna m'avait cherché depuis le matin, et avait fait une vingtaine (le lieues avant de nous joindre, Dans la lettre qu'il m'apportait, le commandant m'exprimait son regret de ne s'être pas trouvé à Biskra pour nous recevoir. "Nous traversions, me disait-il, le territoire des Saharis de Mâder-Rhamra à Berika. Il avait donc jugé à propos de remplacer les six hommes de l'escorte par six spahis de Damna commandés par le chef lui-même. Quant à Lârbi, il me recommandait de le garder jusqu'à M'Gaouc, où je trouverais un autre interprète. Mais, dès que Lârbi eut appris que le commandant était de retour, je le vis si empressé de le rejoindre, que je me décidai à lui rendre sa liberté le plus tôt possible. Je lui promis de le renvoyer à l'étape avant M'Gaouç, ses services m'étant inutiles en route.
Le lendemain nous devions longer le chott du Hodna, et traverser une région qui s'élargit beaucoup à l'ouest de nos possessions et au sud de la province d'Oran, mais dont l'existence est à peine sensible dans l'est de la province de Constantine. Après vingt-quatre kilomètres environ de route sur un sol léger, élastique, où la marche se prolonge sans fatigue, nous eûmes sous les yeux un lac considérable, se prolongeant à l'ouest à perte de vue, desséché du reste et dessiné non pas par une nappe d'eau comme un lac de Suisse, mais par l'absence de végétation et une efflorescence blanche, qui colore le sol comme du givre. Je descendis sur le terrain du chott, qui me sembla différer à peine de celui de la plaine voisine.
A trente-deux kilomètres de M'Doukal, nous trouvâmes Berika, la capitale d'un nouveau caïd, de Si-Mokran. Son caïdat est l'un des quatre gouvernements entre lesquels le duc d'Aumale a partagé l'ancien cheikat du Belezma. Le successeur des anciens cheiks vit à Batna comme un rayah détrôné de l'Inde anglaise. H nous avait rejoints l'année précédente pendant l'expédition des N'Memchas : il avait l'esprit dérangé, ou peut-être feignait-il d'être fou pour que le général Herbillon se défiât moins de lui. Si-Mokran appartenait, comme Ben-Meïoub, à l'aristocratie religieuse, employée comme contrepoids à l'autorité laïque des grands vassaux du pays, mais peu populaire, ce me semble. Si-Mokran fut, si je ne me trompe, assassiné quelques mois après. Ce jour-là, il était absent de Berika et je trouvai l'accueil que nous firent son fils et son frère poli, mais guindé et peu cordial. D'ailleurs, Berika n'est plus une oasis ; c'est un énorme douar de cent cinquante tentes qui peut se déplacer tous les huit jours et ne se rattache à aucun centre de culture permanente. II n'y avait aux environs que des pacages et quelques champs de céréales. Je n'y fis donc qu'une courte halte et remontai à cheval.
A un kilomètre des tentes, nous passâmes prés d'une ruine romaine (peu de chose), l'Aïn-Berika, le principal affluent du chott du Hodna, que nous allions remonter maintenant jusqu'au delà de M'Gaouc. Nous fîmes encore neuf kilomètres dans une plaine uniforme et peu boisée, niais que limitaient des montagnes déjà connues de tous. Au loin, à notre droite, nous apercevions le Metlili, dont nous avions longé le pied pour arriver à El-Kantara. Devant nous, et à gauche, Lârbi nous montrait le Bou-Taleb, et c'était un plaisir que chacun peut comprendre de revoir ainsi ses connaissances, la première datant de quelques jours seulement, tandis que j'avais vu le Bou-Taleb, de funeste mémoire, quand, l'année précédente, nous étions venus de Batna à Sétif, pour passer de l'expédition des N'Memchas à celle de Bougie.
Le vent était plus fort et plus froid que dans les Zibans. Nous campâmes au bord de l'O. Berika et dans l'intérieur de la gorge qu'il parcourt. C'était encore le désert, mais avec une eau bien plus abondante qu'au Kef-el-Khredim ; j'y pris, du capitaine Chambeyron, ma première, mon unique leçon de pêche à la ligne ; la pèche fut miraculeuse, et nous pûmes ajouter un plat de plus à notre dîner ; l'espèce de poisson blanc qu'on trouve seul dans tous les cours d'eau de l'Algérie en fit les frais.
Le soir, Lârbi nous fit ses adieux, et, jusqu'à la fin du voyage, je sentis l'absence de ce narrateur inépuisable, de cet interprète fidèle et intelligent, de cet utile majordome. Nul ne connaissait mieux le Sahara ; il pouvait parler de Touggourt et de Sour; nul n'avait vu pratiquer plus souvent les rapports de l'administration française avec les indigènes, il était l'exécuteur habituel des mesures de police de cette administration. Enfin, il était mi-partie Arabe et Européen, et comprenait les choses comme les langues des deux peuples.
La journée du lendemain nous ramena dans un des plus riches pays de l'Algérie. Nous remontâmes encore l'Oued-Berika, coulant dans un pays toujours plus accidenté. Nous le traversâmes deux fois, et enfin, à vingt kilomètres environ du bivouac, nous commençâmes à trouver des bois d'essences diverses, puis des clôtures, des fossés d'irrigation en très grand nombre et, par parenthèse, très gênants pour la marche, des jardins nombreux d'arbres fruitiers et des cultures de céréales.
Les trois frères de Si-Amran Ben-Djenan (car les jardins de cette vallée subsistent depuis longtemps et ont donné le nom à cette grande famille) nous reçurent avec toutes les démonstrations d'un dévouement extrême à la France. M. Marmier, le chef du bureau arabe de Batna, nous expliqua plus tard la splendeur de leur accueil par le désir de se faire pardonner je ne sais quelle grosse faute qu'ils avaient commise. Quoi qu'il en fût, notre arrivée fut une grande fête pour le village. Les restes de l'énorme diffa qui nous fut offerte suffirent à régaler toute la population, et tous les ateliers de salpêtriers nous furent ouverts.
M'Gaouç est en dehors des grandes lignes nord-sud de notre domination. Mais le chemin jusqu'à Constantine est facile : elle est placée sur une circonférence qui serait, de cette ville comme centre, tracée par Batna et Sétif. Elle communique sans aucune difficulté de terrains avec Zaïna, la jolie ville romaine qui marque la première étape de Batna à Sétif et que joint au Rummel une route difficile seulement pendant les quelques kilomètres que dure la traversée des O. Sellam. A M'Gaouç mène, les restes romains abondent, et les pierres de taille s'y retrouvent employées souvent comme à Biskra.
Mais les jardins et les arbres fruitiers caractérisent plus particulièrement ce canton de M'Gaouç. En partant le lendemain, nous suivîmes encore, en remontant la vallée sur une longueur de douze kilomètres, un pays toujours coupé de canaux d'irrigation, et riche de cultures et de jardins, d'abricotiers et de figuiers ; nous ne nous arrêtâmes pas pour prendre de l'eau, avant de tourner à droite pour gravir la montagne: nous nous en repentîmes plus tard. Nous avions laissé Daïna à M'Gaouc, et nous avions alors pour guides deux hommes de ces montagnes, parlant le chaouïa et fort peu l'arabe, en sorte que mes minces connaissances en cette langue ne pouvaient plus servir à me faire donner les indications relatives à la route.
Cependant celle-ci devenait intéressante. M'Gaouç est séparée de Batna par une distance de soixante-cinq kilomètres environ de l'ouest à l'est. Le commencement et la fin de cette distance sont en plaine, mais entre les vallées de M'Gaouç et de Batna, le chemin est barré par un contrefort élevé qu'il nous fallait franchir. Le chemin est assez bien tracé, mais rude et dénué d'eau. Il monte pendant onze kilomètres environ, et nous trouvâmes à peine quelques flaques d'eau rare et saumâtre pendant cet intervalle. Cependant quelques douars y sont semés, et quelques cultures paraissent çà et là à peu près aussi abondantes que dans quelques âpres traversées de la Lozère. Enfin, à vingt-trois kilomètres de M'Gaouç, et à une hauteur que j'évaluais à seize ou dix-huit cents mètres au-dessus de la nier, je trouvai du minerai de fer dans une sorte de plateau qu'entourait en demi-cercle la forêt de cèdres qui commence à ce point. Il me sembla que la forêt avait dû, dans un autre temps, être exploitée, au profit de l'exploitation de ce minerai.
Quoi qu'il en soit, elle couronne encore la montagne, et nous la traversâmes sur deux kilomètres d'épaisseur. Aussitôt cependant que nous arrivâmes au versant est, ces magnifiques arbres cessèrent, et firent place à d'autres essences parmi lesquelles domine le chêne-yeuse à glands doux. La transition est très brusque, et les deux forêts ne mêlent que sur une étroite lisière les cèdres que l'on va quitter, les yeuses, les cyprès que l'on va parcourir. Ce sommet s'appelle le Kef-Ervhéan.
Souvent nous avons trouvé des arbres que le feu avait attaqués par le pied et qui, tombés sous son action, restaient là inutiles. Ce gaspillage se retrouve partout dans les forêts que notre administration n'a pas prises encore sous sa surveillance. L'Arabe laisse subsister tout ce qui coûterait quelque peine à détruire; mais il ne ménage rien. Imprévoyant pour ses besoins privés, il l'est à plus forte raison pour les utilités générales. Les troupeaux qui parcourent ces forêts en été empêchent les jeunes arbres de croître, tandis que les vieux tombent peu à peu et ne sont pas remplacés. - De là vient, au reste, que la forêt ne se compose guère que de beaux sujets. Les chênes mêmes ont une force et une grandeur que l'yeuse ne m'a pas semblé atteindre ailleurs. Le cyprès n'a que rarement le port élancé qui le caractérise dans les terres profondes. Il est gros et souvent contourné.
La descente fut à peine plus facile. Nos guides nous quittèrent près d'un petit ruisseau d'eau médiocre où je fis faire une halte après six heures de marche (cinq heures de marche réelle, dont trois en montagnes). Ils m'expliquèrent dans leur langage ce qu'ils allaient faire en avant : il paraît que je les compris mal ; et en définitive nous ne les revîmes plus ce soir-là et je me trouvai chargé de la conduite de la caravane.
A six kilomètres de là, nous trouvâmes un jolie rivière, l'O. Kanduraïa, qui parcourt une riche vallée et va joindre, à ce que je supposais, l'Oued-Biskra. Nous nous y arrêtâmes avec plaisir. J'y fis boire les mulets et charger de l'eau pour les hommes, puis nous remontâmes dans la direction du Djebel-Touggourt, que j'avais reconnu pendant la descente, et nous nous retrouvâmes dans les chênes et les cyprès. Je continuai jusqu'à une petite éclaircie abritée par les bois et placée au bord d'un ravin. Nous y devions être à couvert du vent de la nuit, qui promettait d'être froid, et quelques arbres abattus autour nous permettraient d'entretenir un bon feu. Je pensai que nos guides étaient allés chercher un gîte dans quelque tribu, où je me gardai de les suivre.
C'était le dernier de nos bivouacs de choix, car nous devions joindre Batna le lendemain. Aussi je l'avais choisi avec sollicitude, et il fut en effet très apprécié de tous. Il ne fut troublé que par les chacals, sur l'un desquels je tirai sans l'atteindre. Je n'ai pas besoin de dire que les canonniers se firent une grande fête du feu magnifique qu'ils allumaient avec des cyprès gisant sur le sol et qu'ils entretinrent avec des chênes.
A SUIVRE
| |
| Perle des tribunaux !
Envoyé Par Thérése-Marie
| |
AVOCAT : Docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls ?
TÉMOIN : Non.
AVOCAT : Avez-vous vérifié la pression sanguine ?
TÉMOIN : Non.
AVOCAT : Avez-vous vérifié la respiration ?
TÉMOIN : Non.
AVOCAT : Alors, il est possible que le patient fût vivant lorsque vous avez commencé l'autopsie ?
TÉMOIN : Non.
AVOCAT : Comment pouvez-vous en être si sûr, Docteur ?
TÉMOIN : Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau.
AVOCAT : Je vois. Mais, est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie ?
TÉMOIN : Oui, c'est possible qu'il soit en vie et fasse le métier d'avocat.
|
|
|
BULLETIN N°13
DE L'ACADÉMIE D'HIPPONE
SOCIÉTÉ DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ET D'ACCLIMATATION
|
HIPPOPOTAME FOSSILE DE DUVIVIER
Par M. GAUDRY
Professeur de paléontologie
au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Extrait du Bulletin de la Société géologique de France, 3e série,
tome IV, page 501, séance du 19 juin 1876
Avec l'approbation de M. Gaudry et de cette Société.
SUR UN HIPPOPOTAME FOSSILE DECOUVERT A DUVIVIER
à 59 km. Sud de Bône (Algérie)
Mon savant ami, M. Sauvage, auquel M. Papier a adressé les fossiles nouvellement découverts à Duvivier, a bien voulu m'en confier la détermination. Ces pièces me paraissent intéressantes pour les paléontologistes qui cherchent â retrouver les enchaînements des êtres anciens avec les êtres actuels, car elles indiquent un Hippopotame dont la dentition est moins éloignée du type Cochon que celle des Hippopotames ordinaires. Le genre Hippopotame est un des plus aberrants dans la nature actuelle ; il est curieux d'apprendre que, pendant les temps géologiques, quelques-unes de ces différences ont été moins accentuées que de nos jours.
Les pièces recueillies par notre confrère M. Papier méritent aussi l'attention des personnes qui étudient la distribution géographique des animaux fossiles; elles révèlent en Afrique l'existence ancienne d'un groupe que l'on croyait jusqu'à présent avoir été confiné dans l'Inde. Souvent les découvertes paléontologiques font apercevoir des liens, non seulement entre les êtres des temps passés et ceux des temps actuel mais aussi entre des contrées qui ont aujourd'hui des faunes différentes. Falconer et Cautley ont trouvé dans l'Inde plus d'une espèce qui se rapproche des fossiles de nos pays; les animaux de Pikermi ont montré de grandes ressemblances entre les mammifères miocènes d'Europe et les mammifères actuels d'Afrique; les importants travaux de MM. Hayden, Leidy, Marsh, Cope, dans les Western Territories, indiquent des rapports frappants entre la faune française et la faune américaine pendant une partie de l'époque tertiaire.
Les échantillons de Duvivier qui ont été adressés à la Société géologique sont les suivants : quatre incisives presque entières et deux incisives brisées, deux canines, deux prémolaires et une moitié d'arrière molaire. Ces dents semblent provenir d'une même mâchoire inférieure.
Les figures 1, 2 et 3 représentent les trois incisives d'un des côtés de la mâchoire inférieure ; elles sont relativement assez petites et presque égales entre elles. Je pense que les plus grosses dents (fig. 1) étaient les premières incisives. Elles sont malheureusement très endommagées. Leur principal diamètre est de 0m,023. Les mitoyennes (fig. 2 et 2 a) sont un peu entamées par l'usure ; elles sont couvertes d'émail au sommet de leur couronne. Cet émail est épais, et non cannelé ; il forme une avance sur la face postérieure et sur la face antérieure ; l'avance est plus avancée sur cette dernière ; le plus grand diamètre est de 0m,020. Les coins (fig. 3 et 3 a) ont également un émail épais, non cannelé, avec bourrelets latéraux bien marqués, de sorte qu'il ressort sur le reste du fût; il forme aussi une sorte de languette ou avance sur la face postérieure, et surtout sur la face antérieure; le plus grand diamètre est de 0m,020. Les canines (fig. 4) sont à peine cannelées sur leur bord interne; elles ne le sont aucunement sur leur bord externe, où elles portent seulement des stries; elles ne sont pas très grandes ; leur largeur dans le milieu est de 0m,044. Les molaires ne présentent pas de caractères particuliers, sauf que la seconde prémolaire (fig. 5 et 5 a.) offre en dedans et en arrière un fort denticule, comme on en voit quelquefois aux dents de la mâchoire supérieure. La couronne de cette dent est longue de 0m,035 sur 0m,038 de hauteur.
L'animal fossile de Duvivier se distingue de l'Hippopotamus amphibius qui vit actuellement en Afrique par sa mâchoire inférieure qui porte six incisives au lieu de quatre, par l'émail de ses incisives qui est bien plus épais, non cannelé, et qui se détache mieux du reste du fût; par ses incisives presque égales , tandis que dans l'espèce vivante les premières incisives sont beaucoup plus grosses que les autres ; enfin, par ses canines, qui n'ont pas de fortes cannelures et ne montrent que des stries fines sur la face externe. Toutes ces particularités marquent une tendance vers les Cochons.
MM. Bayle et P. Gervais ont décrit des pièces d'Hippopotames fossiles trouvées en Afrique, dans la province de Constantine ; notre confrère Laurent, de si regrettable mémoire a donné au Muséum des échantillons provenant des bords du canal de Suez, que chacun de nous a pu voir à l'Exposition universelle de 1867. Ces débris d'Hippopotames, ainsi que ceux que l'on rencontre dans les terrains quaternaires d'Europe, présentent les mêmes caractères que l'Hippopotamus amphibius. On leur a quelquefois donné les noms de major ou de Pentlandi, mais je ne connais pas de motifs suffisants pour leur appliquer un nom spécial.
L'H. major du pliocène se distingue de l'H. amphibius par son extrême grosseur; d'ailleurs, tous les caractères essentiels des dents sont les mêmes.
M. Alphonse' Milne-Edwards m'a montré les pièces de l'espèce de Madagascar qui a été rapportée par M Grandidier. Cette espèce appartient au groupe où les incisives sont au nombre de quatre.
L'H. Liberiensis, qui vit à Liberia (Afrique), a des canines non cannelées, comme dans le fossile de Duvivier; mais par ses incisives il marque une tendance opposée, car ces dents sont réduites à deux à la mâchoire inférieure.
L'H. minutus, signalé par Cuvier comme ayant été trouvé dans un grès à base calcaire entre Dax et Tartas (1), avait des canines semblables à celles de l'H. Liberiensis. M. P. Gervais a émis l'opinion qu'il était très voisin de cette espèce (2).
Cautley et Falconer ont figuré dans la Fauna Sivalensis des Hippopotames fossiles de l'Inde qui ont six incisives inférieures. Ils les ont inscrits sous les noms d'Hexaprotodon (3) sivalensis, H. iravaticus et H. namadicus. A en juger par les figures qui ont été données et par les échantillons du musée de Paris, l'espèce de Duvivier ressemble extrêmement à l’H. sivalensis et surtout à l'H. namadicus. Mais, dans ses descriptions, Falconer (4) .n'a point fait remarquer que l'extrémité supérieure des incisives de ces animaux offre une disposition différente de celle qu'on observe dans les Hippopotames vivants. Si les dents de l'Inde eussent présenté les mêmes particularités qui se montrent chez l'Hippopotame de Duvivier, il n'est point probable qu'elles eussent échappé à un aussi habile paléontologiste, qui a justement passé pour avoir le don de saisir les moindres nuances offertes par les espèces fossiles. Je dois donc provisoirement supposer que l'animal de Duvivier n'est pas identique avec ceux de l'Inde.
D'après cela, je pense que les fossiles envoyés par notre confrère M. Papier se rapportent à une nouvelle espèce. On pourrait donner à cette espèce le nom d’Hippopotamus (Hexaprotodon) Hipponensis, pour rappeler qu'elle a été découverte non loin des ruines de l'ancienne Hippone, et que c'est à l'Académie d'Hippone que nous devons sa connaissance.
Le nom d'Hexaprotodon peut être admis comme nom de sous-genre, mais non pas comme nom de genre; car, ainsi que le pensait Cuvier, la présence ou l'absence d'une paire d'incisives ne saurait être considérée comme suffisante pour constituer un genre. Falconer a cité, dans la collection de M. Bail, à Dublin, une mâchoire inférieure d'Hippopotame qui a trois incisives du côté droit et deux incisives du côté gauche. J'ai également remarqué dans le musée de Paris une mâchoire d'Hippopotame où les incisives sont à droite en même nombre que chez les Hexaprotodon, et à gauche en même nombre que chez les Tetraprotodon.
On a vu, dans les pages précédentes, que, sous le rapport de la dentition, l'Hippopotame fossile de Duvivier est moins éloigné des formes des Cochons que les Hippopotames ordinaires. Il serait curieux de trouver les os des membres, notamment ceux des pattes, pour savoir s'ils ne diminueraient pas également la grande lacune qui existe aujourd'hui entre les Hippopotames et les Cochons.
Je pense être l'interprète. de la Société géologique en remerciant l'Académie d'Hippone, et principalement M. Papier, pour les pièces intéressantes qu'ils ont bien voulu nous communiquer.
(1) M. Tournoüer, qui a si bien exploré le sud-ouest de la France, m'a dit qu'il ne connaissait entre Dax et Tartas, au-dessous des sables des Landes, que la mollasse calcaire coquillière à Ostrea crassissima, dite Mollasse marine de l'Armagnac (miocène moyen ou supérieur). On devrait donc supposer que les débris d'une espèce d'Hippopotame, c'est-à-dire d'un animal de rivière, ont été déposés dans la mer. Il parait, d'ailleurs, que les Hippopotames vont quelquefois à la mer.
(2) Gervais, Zoologie et paléontologie générales, 1re série , p. 250. 1867-69.
(3) On sait que le nom d'Hexaprotodon fait opposition à celui de Tetraprotodon proposé pour les Hippopotames à quatre incisives.
(4) Falconer et Cautley, On the fossil Hippopotarnus of the Sewalik Hills (Palceontological Manoirs, t. I, p. 130; in-8, 1868). Les échantillons ou les figures que j'ai vu ont les extrémités de leurs incisives trop usées pour que j'ai pu les bien étudier.
EXPLICATION DE LA PLANCHE.
Fig. 1. Première incisive, vue en avant; la couronne est brisée.
Fig. 2. Seconde incisive inférieure, vue en avant. >
Fig. 2 a. Extrémité supérieure de la même, vue sur la face postérieure.
Fig. 3. Troisième incisive inférieure, vue en avant.
Fig. 3 a. Extrémité supérieure de la même, vue sur la face postérieure.
Fig. 4. Canine inférieure, vue sur la face externe.
Fig. 5. Seconde prémolaire inférieure, vue sur la face externe.
Fig. 5 a. La même, vue sur la face interne.
|
|
Nos racines bannies de la sphère publique
(Billet du Vicaire Général
M. Robert POINARD
Envoyé par Mme Bernadette Leonelli
|
Lentement mais sûrement le judéo-christianisme se fait balayer vers la porte de sortie. Oh bien sûr il ne s’agit pas d’une franche persécution bien tranchante et bien sanglante comme nos pères en connurent sous d’autres cieux en d’autres temps mais enfin, qu’on le veuille ou non, on nous prie de disparaître vers les arrière-cuisines en nous demandant de n’en plus bouger.
Années après années le bannissement se fait de plus en plus pressant.
Les crèches disparaissent de l’espace public sous le prétexte qu’elles blessent le regard du non chrétien : les santons sont jugés indésirables sur les places des villes et même des villages. Je lis dans « La Croix » du mercredi 18 décembre que le tribunal administratif d’Amiens a annulé une décision du conseil municipal de Montiers (Oise) qui avait décidé l’installation de la traditionnelle crèche de Noël sur la place du village. Motif ? La loi dispose qu’après 1905 on ne peut plus apposer de symbole religieux dans l’espace public hormis sur les édifices du culte.
L’avocat a eu beau argumenter qu’on était ici bien plus dans la sphère culturelle que dans le religieux, rien n’y a fait. Le juge administratif semble ignorer que même dans les familles non catholiques - voire même non croyantes - on trouve souvent des crèches au pied du sapin parce que cela fait partie des symboles de Noël et que cette fête est devenue elle-même au fil des siècles une fête de la famille, quelles que soient les convictions religieuses des uns et des autres. Le plus beau c’est que le recours en justice avait été introduit par une personne qui n’habite même plus le village et qui déclare, quand on l’interroge « qu’il y a des sujets bien plus importants ».
Eh bien je ne suis pas de cet avis. Ceci me semble non seulement important mais symptomatique et je n’en veux pour preuve qu’une autre affaire. Depuis des mois le journal gratuit « 20 minutes » avait prévu un supplément pour la fête de l’Immaculée Conception qui est dans le diocèse de Lyon l’occasion de rendre un hommage à la Vierge Marie en posant des lumignons sur le rebord des fenêtres le soir du 8 décembre. Ma famille s’est prêtée à ce rite durant toute mon enfance… Mais le journal a finalement décidé de ne pas publier son supplément parce que la prière de la Salutation Evangélique risquait de choquer ses lecteurs…
Comme nous le répète souvent Mgr Ravel, notre évêque, nous sommes entrés depuis quelques années dans un régime de laïcité qui ignore ou gomme tout ce qui est religieux. Et comme le dit Jean-Pierre Denis, le rédacteur en chef de « La Vie » : « Le christianisme n’est pas violemment éjecté de la sphère publique mais tranquillement banni de tous les espaces de la mémoire collective, de tout notre inconscient culturel. Nous vivons une entreprise de reniement paisible, insidieux, et politiquement correct en diable. »
Les idéologues pervers qui promeuvent une telle laïcité de renoncement, de déni et de nettoyage par le vide montrent par là leur ignorance crasse de la nature humaine et font le lit de futures guerres civiles. Tout d’abord la population française issue de l’immigration, comme tous les étrangers vivant dans notre pays, assimilent ce rejet du religieux à un refus de Dieu et renforcent encore le mépris profond dans lequel ils tiennent l’occident, terre d’athéisme. Et cela justifie encore davantage toutes les formes de « guerres saintes » qui se livrent sur notre sol contre une Europe devenue terre païenne d’où Dieu est banni.
Voilà comment nous fournissons avec la plus grande complaisance les bâtons qui nous rosseront et les bombes qui nous frapperont !
L’Europe, dans un masochisme irrationnel et suicidaire,
refuse de reconnaître ses racines judéo-chrétiennes.
Sa fin est donc inéluctable car, c’est une certitude,
ceux qui renient leurs racines sont sans avenir.
|
|
GRAVURES et PHOTOS Anciennes
De BÔNE
Envoi de M. Cinobatti
|
|
|
| Pour nos chers Amis Disparus
Nos Sincères condoléances à leur Familles et Amis
|
Décès de M. Gilbert RAMOS
"Chers(es) amis (es),
Madame Huguette RAMOS née ARCAMONE, ses enfants Martine, Patrick, et Eric, ses petits enfants et arrière petits-enfants, ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de Gilbert RAMOS.
Il nous a quitté le 12 décembre 2010 et a été inhumé dans la sépulture familiale au cimetière St Etienne à FREJUS (83). Né à Bône en 1930, il était le fils d’Emile RAMOS, « Les Meubles RAMOS » Avenue Garibaldi face à l’église Ste Anne.
Que tous ceux qui l’ont connu aient une pensée pour lui.
Sa fille Martine Bernardin-Ramos
Mon Adresse : Martine Bernardin-Ramos
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
| |
| "Né à BAB EL OUED"
Envoyé par Jean-Pierre Comitré
Si l'un de vous connaît l'auteur de ce poème, qu'il nous le fasse savoir, merci
| |
Nostalgie
A lire, trop beau, très vrai et rempli de souvenirs!!! (et quelle belle époque!!!!!!!!!)
Entre Saint-Eugène et Alger,
Est le quartier ou je suis né.
Entre Casbah et Carrières Jaubert,
C’est là aussi qu’est né mon père.
Sur la rive gauche d’un ancien oued,
Oui,…. Je suis né à Bab El Oued.
C’était ma foi un beau quartier
Un quartier plein de vie, un quartier animé.
Espagnol, italien, arabe, maltais,
Tous ensemble apprenions le français
C'était la tour de bab-el-oued
Quand on parlait dans notre bled.
Notre français était très pimenté
Il était même très pigmenté
Par les couleurs qu’on lui donnait.
Des couleurs aujourd’hui un peu oubliées.
Etchaffé par une voiture, la honte à la figure
Putain d’sa mère il avait la vie dure.
En bas la mer un jeu tu tapais
Quand tu faisais tchouffa les autres y rigolaient. »
Dans mon quartier on n’utilisait pas de « reloje »
Ce n’était pas la peine il y avait les Trois Horloges
Contre les hauts et les bas
Il y avait la Bassetta
Il y avait « Blanchette » à l’entrée du marché,
Il était très connu il vendait des beignets,
Derrière l’arrêt des trams sur la petite place
Il y avait « l’italien » qui nous vendait ses glaces,
Il y avait Slimane et son épicerie
Il y avait Lassale et sa charcuterie.
Prés du passage souterrain
Il y avait Moati et son commerce cossu
Cela était normal il vendait du tissus.
Il y avait Torrés magasin de chaussures,
Rue Suffren, Devesa, ses boudins à l’oignon,
Le cinéma Bijou qui manquait d’attraction.
La « maison Jaubert » la « cité des moulins »
Avenue de la Bouzareah, rue Sufren, rue Franklin.
Prés de l’usine Bastos, à coté du Plazza,
La boulangerie Amar, la boucherie Khaliffa,
Montiel le charbonnier, Lounés le marchand de légumes
Le bistro des Flechero juste là au coin
L’Armée du salut, et le moutchou du coin
C’est là que j’ai vu le jour,
Alors que mon père péchait au cassour.
Avenue de la Bouzareah, la boulangerie Seralta
La pharmacie Sastre, et puis celle de Kamoun,
Il y avait Henny, le boucher chevalin, Perez le coiffeur,
Otto le confiseur,Spadaro « le voleur »
Borras et Sampaul vous faisaient miroiter
Les glaces que Grosoli fabriquait
Vous parlerais-je des cafés, ou bien de leurs « kemia »
Tout ce qu’ils vous offraient remplaçait un repas.
Carottes au cumin, pommes de terre au persil,
Variantes et tramousses cacahuètes salées, ,
Escargolines, olives….tant qu’on en voulait.
C’était un vrai délire, j’en ai le souvenir.
Quand boire une anisette était un vrai plaisir.
Vous parlerais-je de Raisville, Padovani,
Les Voutes, la Pointe Pescade et les Bains des Familles ?
Le stade Marcel Cerdan ou jouait le S.C.A (la spardenia)
Ou bien des grandes rencontres A.S.SE / Galia
Cela n’est pas la peine vous vous en souvenez aussi
Et pourtant comme moi vous étiez un « petit »
Je me souviens aussi de ce qui c’est passé
Lorsque les Trois Horloges, notre centre d’intérêt
Le 23 mars 62 devint un centre de gravité
Et c’était vraiment grave, ce fut le début de la fin,
Cela je m’en souviens
Je m’en souviens très bien.
|
|