|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
177, 178, 179,
180, 181, 182,
183, 184, 185,
186,
| |
|
EDITO
L'automne de Choupinet 1er
On est tous un peu tristounet par la fin de l'été.
Heureusement que la Seybouse est là pour remettre un peu de lumière et de soleil pour nous consoler.
Oui, nous consoler, car Choupinet 1er, nous a fait encore des misères avec la reconnaissance honorifique de la trahison d'un criminel de guerre en Algérie. C'est tuer une fois de plus toutes les victimes de ses agissements et leur manquer de respect.
Puisqu'il en est à réhabiliter les traîtres, il peut continuer, il en trouvera des milliers de la guerre 39-45 en France et lors de l'épuration qui a suivie.
Comment les veaux ont-ils pu élire un tel président ?
Les veaux, les Français nommés ainsi par leur cher De Gaulle.
La Seybouse continue, avec l'aide de M. Christian Graille, à remonter l'histoire de la colonisation en Algérie pour aboutir au pays tel qu'il était en 1962 à notre exil. Le plus beau des pays en voie de développement.
Dommage que Choupinet 1er ne sache pas lire car en lisant la Seybouse il pourrait s'instruire utilement pour son pays et pour lui-même, mais c'est vrai qu'il a un tel appétit pour la finance qu'il en oublie le pays.
Ce mois-ci, je passe une Info de l'Etat Pied-Noir. Certains se demanderont qu'est-ce cet état P.N., d'autres rouspéteront, ou diront qu'est-ce cette utopie. Pour ma part, j'ai mes idées et je pense que chacun a le droit d'avoir les siennes, utopie ou pas. De grandes choses se sont réalisées grâce aux rêves de petits créateurs.
Avec la lecture de cette Seybouse, vous serez " d'attaque " pour cet automne.
Amicalement votre.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
IMAGE CHOC OU IMAGE VERITE…
Envoyé par Mr. Robert Charles Puig
|
1962. Comme une chimère
Dans une esquisse allégorique,
C'est toute l'épopée tragique
D'un rêve devenu cauchemar
Que je dessine en rouge et noir.
Un coup de crayon malhabile...
Mais se souvenir est Fragile !
Je puise au bord de ma mémoire
Ce pan ancien de mon Histoire...
C'est la Grande poste et le sang
Versé par des cœurs innocents.
Ils croyaient sauver l'Algérie
Mais périrent, sur ordre Impie !
Un spectre noir comme le crime
Transformait des vies en victimes.
J'ai tracé des traits rouges et noirs
Sur le papier pour rappeler
Un temps qui fut que désespoir
Jusqu'à l'Exode de juillet.
Robert Charles PUIG / 2018
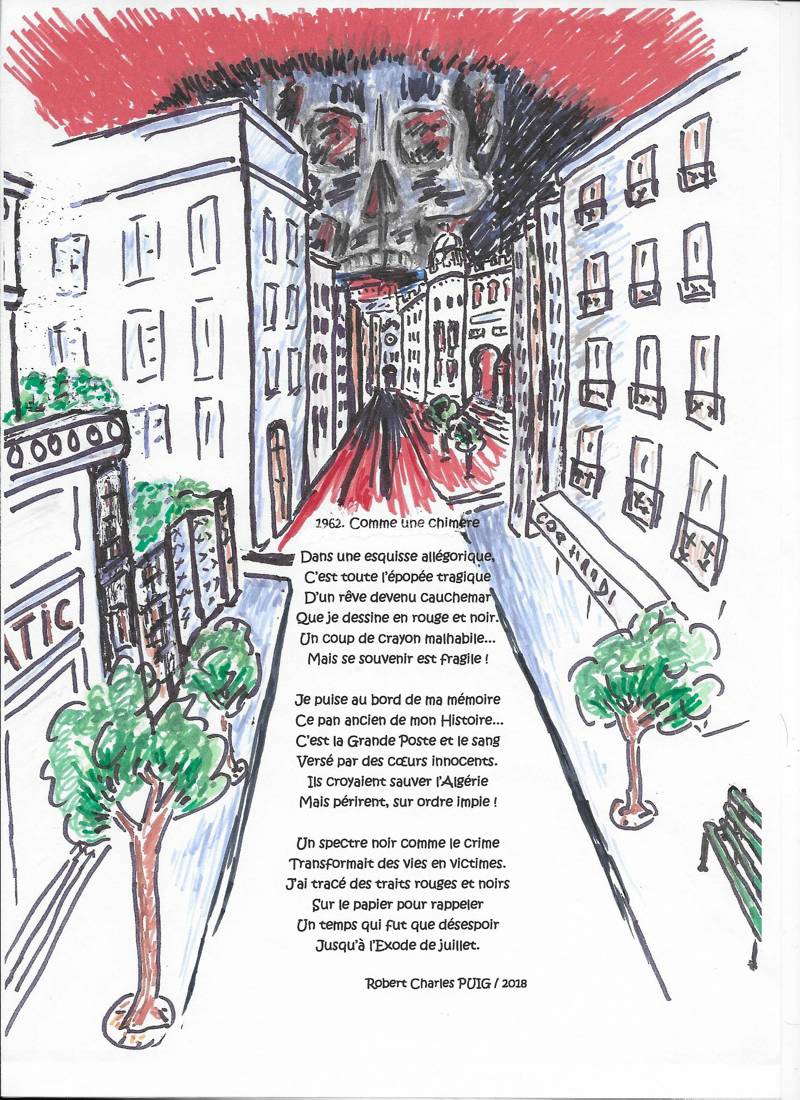
Sans doute que ce n'est pas la date...
mais y a -t-il une date pour se souvenir ?
Robert Charles PUIG.
|
|
FLEURISSEMENT
DU CIMETIERE DE BÔNE
|
|
Opération
" JARDIN des ETOILES 2018 "
Chers Amis et Compatriotes,
Depuis plusieurs années, notre ami Mounir Hanéche effectue annuellement pour la Toussaint une opération de fleurissement de tombes pour le Cimetière de Bône. Le même petit bouquet de fleurs pour tout le monde. D'autres prestations sont possibles, voir tarification ci-jointe.
Comme depuis plusieurs années, et à la demande de certains lecteurs ou familiers de la Seybouse nous étendons le fleurissement à tous ceux qui veulent bien y participer pour ce cimetière et ceux des alentours.
Avec le ferme espoir que le succès sera au rendez-vous.
L'Opération "JARDIN des ETOILES 2018" est lancée plus tôt, pour laisser un peu plus de temps à ceux qui veulent y participer. Elle se clôturera le 26 octobre afin de laisser à l'entreprise le temps de réaliser les commandes pour le 1er novembre.
Vous pouvez demander le bon de commande A M. Mounir Hanneche et à Mme Suzy Mons que vous devrez renvoyer pour contrôle et validation :
Après contrôle et validation, vous enverrez par la poste votre confirmation de commande signée avec votre règlement par chèque à l'ordre de Mme Suzy MONS.
Donnez-leur le maximum d'indications de la tombe (le nom - la localisation du carré, de la rangée et du N°, le nom du voisinage), si possible avec un plan.
Les plans des carrés sont sur le site de chez "Taddo" (ci-dessous)
http://www.piednoir.net/taddo/
Si vous avez des amis qui veulent en faire autant, vous pouvez leur transmettre les adresses, fichier et ces indications.
Merci de faire partie de ceux qui pensent à nos anciens restés là-bas.
Avec toutes nos amitiés
Mounir HANECHE (Entrepreneur) boneconstruction23@yahoo.fr
Suzy MONS (Bénévole) suzymons@hotmail.fr
BON DE COMMANDE ------->> CLIQUEZ ICI
COMME D'HABITUDE, la tarification est très raisonnable.
Le fichier et le bon de Commande sont protégées par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales personnelles ou par des associations pour des buts lucratifs.
|
|
Discours de David Rachline
Maire de Fréjus
|
|
A l'occasion de la cérémonie du 5 juillet dédiée au massacre d'Oran
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les anciens combattants,
Mesdames, Messieurs les rapatriés,
Mesdames, Messieurs les harkis,
Mesdames, Messieurs,
Nous voici réunis en ce 5 juillet, devant cette stèle de pierre frappée de l'Algérie Française, une nouvelle fois réunis au rendez-vous de la fidélité et du souvenir.
Le 5 juillet n'est pas une date comme une autre de la guerre d'Algérie.
C'est le jour du plus grand massacre de cette guerre.
Un massacre qui ne doit rien aux combats mais tout à la cruauté d'une populace haineuse et à l'impuissance voulue ou volontaire d'une armée aux ordres d'un gouvernement félon.
Je pèse mes mots : cette stèle n'est pas une stèle comme les autres, elle a été installée aussi pour dénoncer ces félonies d'un gouvernement Français qui abandonnera des Français et une part de son territoire !
Cette stèle est aussi celle des victimes de la guerre et des massacres. C'est également la stèle de ceux qui ont combattu jusqu'à la mort pour que l'Algérie reste française, pour que leurs foyers restent leurs foyers...
Voilà pourquoi, nous savons ce qui nous réunit ici, ce matin.
Nul besoin de grands discours pour ceux qui ont la mémoire et le cœur entièrement tournés vers cette part de nous-mêmes, vers cette Histoire récente.
Nul besoin d'explications fantasques pour tous ceux qui, ayant vécu le cauchemar de 1962, ont toujours redouté qu'il nous rattrape un jour, ici, sur cette rive de la Méditerranée.
Notre rassemblement est donc un témoignage vibrant au service de la vérité, de la loyauté et de la justice. Et pour la justice, nous sommes prêts à nous battre.
Nous ne sommes pas ici pour nous complaire dans la douleur et dans les regrets, nous sommes ici des combattants, des amoureux de la France, au service de notre Histoire, de notre peuple et de notre nation.
Nous ravivons la mémoire des disparus, des assassinés : des hommes, des femmes et des enfants d'Oran et de l'Algérie Française dont les gouvernements français ont nié jusqu'à l'existence en ne cherchant jamais la vérité à leur sujet, à leur égard.
Nous honorons des Français que l'État français, que l'armée française a abandonné à leurs bourreaux alors même qu'ils pouvaient, qu'ils devaient les protéger !
Nous rappelons le souvenir d'une lâcheté organisée, d'un abandon absolu, d'une fuite abjecte.
Nous rappelons les hommes Français mitraillés, les femmes Françaises abattues froidement, les enfants Français torturés et massacrés.
Nous rappelons les pieds noirs pendus, fusillés et massacrés !
Pour finir d'enterrer les morts, il faut les faire entrer dans l'Histoire.
Nous sommes ici les fils et les filles d'une histoire qui n'est pas terminée.
Nous sommes les héritiers d'une tâche à accomplir.
La France a abandonné les massacrés d'Oran.
Nous ne les oublierons jamais !
Nous clamerons toujours le droit de se réunir, de commémorer, de se souvenir
Et par-dessus tout de demander des comptes à ceux qui, il y a maintenant 56 ans, ont par lâcheté, par facilité et par déloyauté, laisser faire ou abandonner des citoyens Français face à la barbarie immonde et abjecte !
Que vive le souvenir de la France en Algérie, Que vive Oran la radieuse, Que vive Fréjus et Que vive la France !!!
|
|
|
LE MUTILE N° 54, 2 juin 1918 (Gallica)
|
|
REFLEXIONS D'UN MUTILE ALGERIEN
Lorsque sorti de l'enfer dans lequel j'ai vécu,.aussi bien en Belgique qu'en Artois, je suis revenu à Alger après avoir laissé une jambe à Ypres, je croyais rêver tant il y avait d'affluence au débarcadère de la. Compagnie Transatlantique, tant la foule que l'on dit pourtant avoir un coeur étroit, manifestait d'enthousiasme, de sympathie pour les premiers mutilés de guerre. J'appartenais on effet, au premier convoi des épaves de la guerre mondiale et j'étais comme mes camarades l'objet de l'ardente curiosité de cette agglomération de gens qui nous regardaient avec des yeux de l'autre monde.
De toutes parts on nous couvrait de fleurs. Les Dames de la Croix Rouge nous comblaient de friandises ci les propriétaires d'automobiles se disputaient l'honneur de nous véhiculer gracieusement.
C'était il est vrai en 1914. Depuis (mon Dieu comme tout change) j'ai assisté à maints débarquements de blessés, non moins glorieusement mutilés et j'ai été frappé du revirement de celte foule hier si vibrante de charitable et délirant d'enthousiasme, aujourd'hui si froide, qu'elle en est presque indifférente.
Les mutilés débarquent maintenant comme de vulgaires voyageurs, sans une main amie pour les guider, mais bien souvent poussés par une cohue qui bouscule tout, les blessés principalement, parce que leurs mutilations les fait se mouvoir lentement et j'ai fait cette amère réflexion :
Si la population ne fait pas ou presque pas cas de celui qui revient mutilé de la guerre, qu'adviendra-t-il de lui après la guerre ?
Les mutilés seront si nombreux, on sera si habitué à les voir qu'on ne fera môme plus attention à eux. L'égoïsme originel reprendra vite le dessus. La pitié du début, accrue par le tragique des circonstances, se changera en récriminations et en dégoût. On se détournera avec un haut le coeur du malheureux défîguré ; on trouvera agaçante et ridicule la marche de l'amputé sur ses pilons, on jugera bien importun le manchot qui ne peut pas, tout seul, ouvrir son parapluie et le sourd avide d'entendre et obligé à hurler sur le sommet de la voix.
Peut-être trouvera-t-on que j'exagère et cependant ces réflexions pour si attristantes qu'elles paraissent sont les résultats d'observations logiques car, ceci est la conséquence de cela.
Il n'est pas jusqu'aux oeuvres de guerre, spécialement crées pour les mutilés qui disparaîtront tour à tour tant la charité publique sera vite lasse. Je dis et répète sans crainte d'être démenti que ces oeuvres, quelles qu'elles soient, n'auront pas une longue durée.
Pourquoi me dira-t-on ? Mais parce que leurs ressources s'épuiseront ; parce que le sentiment auquel on a pu faire appel avec fruit pour les mettre sur pied et les alimenter d'abord, survivra peu à peu à la conclusion de la paix.- Et alors, que deviendront-les mutilés, qui fera respecter leurs droits, qui défendra leurs intérêts matériels et moraux?..
Il n'y a, à mon sens, qu'un organe où les dèsidératas de l'immense peuple des mutilés pourront être exposés avec quelque chance d'être entendus dans les hautes sphères gouvernementales où la voix des humbles ne parvient pas, toujours. Cet organe existe heureusement ici, puisque son existence me permet d'exposer mes idées. Plût à Dieu qu'il en existât un semblable dans chaque ville de France et d'Algérie puisqu'il est admis qu'il n'est pas une ville, pas un village, qui n'est son ou ses mutilés.
Pour ne pas être l'objet de la sollicitude de personne, pour rester dignes, dignes du grand rôle qu'ils ont joué sur le champ de bataillé, il faut aussi que dans le présent comme dans l'avenir, les mutilés ne perdent jamais de vue l'honneur que la France leur a fait en leur confiant, ses destinées, on les appelant, à combattre pour une aussi noble cause : celle de la Justice el de la Liberté; l'honneur qui s'allache au sacrifice qu'ils ont consenti, au sang qu'ils ont versé pour elle, aux médailles et aux croix qui ornent leurs poitrines, à la façon magnifique dont elle reconnaît le service qu'ils lui ont rendu et dont elle cherche à réparer le mal que la guerre leur a fait.
Aidés par le Pays dans la mesure où il peut les aider, les Mutilés ont le devoir de s'aider eux-mêmes. Ils ont le devoir de supporter allègrement et fièrement leur infortune, d'essayer de n'être à charge à personne, de se tirer d'affaire avec coque l'Etat nous accorde et, s'il se peut, de se remettre au travail bien vite, quittes à apprendre un nouveau métier si leur mutilation les empêche d'exercer celui qu'ils avaient avant la guerre et surtout, à moins qu'ils n'y soient contraints, à ne pas rester oisifs, car outre que l'oisiveté est mauvaise conseillère, ils auront vite fait de dépenser la petite pension que l'Etat leur alloue.
Ils seraient dans ce cas obligés d'avoir recours à la charité publique qui ne sera pas tendre pour le mutilé paresseux et indigne.
Que pense-t-on que dureront l'admiration, la pitié et la bonté dont on entoure les mutilés ? Peu de temps si nous en croyons ce que nous devinons, La guerre finie chacun reprendra ses occupations et il y aura pour faire concurrence à la pitié, la douleur de ceux qui auront perdu des êtres aimés sur les champs de bataille, dont le .caractère sera aigri et qui diront sans cesse " Si seulement j'avais encore celui qui est tombé là-bas, même défiguré, même mutilé, qu'importe ? S'il vivait seulement !"
Il faut donc ne compter que sur soi-même et prouver à la société que même diminué physiquement, un mutilé sait pouvoir quand il sait vouloir. Voilà le meilleur remède à nos maux.
Paul DUFOUR,
Amputé d'une jambe
Décoré de la Croix de Guerre
et Médaille Militaire
|
|
REVELATION SUR LA GUERRE D'ALGERIE ET LE PUTSCH DES GENERAUX
Par M. Jérémie Galibert
|
Savez-vous que d'après l'historien Guy Pervillé, les généraux du putsch d'Alger d'avril 1961 auraient envisagé, en cas de réussite, de remplacer de Gaulle à la présidence de la République par l'ancien Gouverneur de l'Algérie Marcel-Edmond Naegelen, un homme politique socialiste ? Autrement dit, et aussi surprenant que cela puisse paraître, si le putsch d'Alger avait réussi, c'est peut-être une figure du PARTI SOCIALISTE SFIO qui aurait pris le pouvoir à la place du général de Gaulle au nom de l'Algérie française ! Mais un socialiste PATRIOTE, ennemi acharné du FLN, et qui, comme les généraux du putsch, souhaitait éviter aux Pieds-Noirs et aux musulmans du parti de la France le choix entre "la valise ou le cercueil".
Et pendant ce temps-là, de Gaulle et son gouvernement, pour faire échouer le putsch d'Alger s'alliaient aux communistes… Communistes, qui proposaient de distribuer des armes à la population pour soutenir le régime et lutter contre les soi-disant généraux "fascistes".
A tel point, que le journaliste Georges-Marc Benamou a pu parler d'un "axe de Gaulle-Sartre".
Ainsi, à "l'axe Juin-Lacoste" de 1956 (quand le maréchal Juin, plutôt classé à droite, saluait vigoureusement l'action de répression du FLN menée par les socialistes au pouvoir), a succédé "l'axe de Gaulle-Sartre" de 1962, jusqu'à ce jour jamais remis en question.
De Gaulle, c'est le dérèglement des mœurs. Un dérèglement des mœurs où l'on vit des gaullistes, hommes de droite, s'allier à l'extrême gauche pour traiter de "fascistes" des généraux qui s'apprêtaient à remettre le pouvoir… à un homme de gauche républicain et patriote.
S'il y a bien un symbole à retenir de la décadence de ce pauvre pays, c'est peut-être celui-là. De Gaulle, à la fin de la guerre d'Algérie a préféré s'allier avec les communistes, les porteurs de valises et la gauche "anticolonialiste", CONTRE les Français patriotes de droite et de gauche. C'est là, peut-être, qu'il faut chercher la source du lamentable déclin de la France.
Gloire au socialiste patriote Marcel-Edmond Naegelen, qui a voté NON aux accords d'Evian, qui est resté solidaire des Pieds-Noirs et Harkis, et qui après l'"indépendance", a très vite dénoncé les dangers de l'immigration algérienne de masse déclenchée par ces accords d'Evian :
"Soixante-dix mille Algériens ont, depuis la proclamation de l'indépendance, demandé la nationalité française. Il n'en demeure pas moins que la présence sur le sol français, réduit à peu de chose près à l'hexagone, de cette masse d'un demi-million d'hommes de nationalité étrangère, pose un problème sans précédent au gouvernement et au peuple français. Leur nombre ne cessant de croître, il prend de plus en plus l'importance d'un danger pour la sécurité intérieure. [...] Nos plénipotentiaires à Evian n'ont pas songé ou n'ont pas voulu songer au danger que représenterait en cas de guerre cette présence dans notre pays de plusieurs centaines de milliers d'étrangers ou d'ennemis. Il leur fallait croire à la collaboration franco-algérienne et miser sur elle. Mais il n'est rien d'éternel dans les choses humaines et les accords et ce qu'on a appelé l'esprit d'Evian, n'ont pas duré plus longtemps qu'un coucher de soleil sur le lac. Les problèmes demeurent et, parmi eux, celui de la présence en France d'une masse grossissante de prolétaires algériens. Seuls, une rapide et considérable amélioration de la situation économique en Algérie, la disparition du chômage, la hausse du niveau de vie, la fin de la misère générale, le retour massif de ces travailleurs vers leur pays d'origine et l'arrêt à peu près total des départs pour la France pourraient le faire disparaître. Or l'Algérie n'entre pas dans une ère meilleure, la situation ne cesse de s'y aggraver." (Marcel-Edmond Naegelen, 1965)
Naegelen qui a également décrit les accords d'Evian comme "ce qui demeurera dans l'Histoire comme une des capitulations les plus néfastes et comme la plus injustifiable de toutes celles auxquelles ait consenti notre patrie".
Jérémie Galibert
|
|
ANNALES ALGERIENNES
Tome 1
2ème partie
|
|
LIVRE IV
Manière de combattre des Arabes.
Les hommes se sont toujours battus, et bien que plusieurs d'entre eux rêvent la paix perpétuelle, il est à présumer qu'ils se battront encore longtemps. Cependant, comme il n'est donné à personne d'indiquer le point où la perfectibilité humaine doit s'arrêter, il est possible que, nous arrivions un jour à cette concorde générale que rien ne troublera plus. En attendant, les hommes se battent dans ce siècle comme dans ceux qui l'ont précédé, mais tous ne se battent pas de la même manière, parce que tous ne sont pas dans les mêmes conditions d'existence politique et sociale.
Il est des peuples sauvages qui ne se battent que pour des intérêts privés, et individuellement ; le fort attaque le faible, le tue, le dépouille, et s'en va après ; c'est la guerre des bêtes féroces.
Il y a des peuples barbares qui se battent pour des collections d'intérêts privés accidentellement réunis en intérêts généraux, ou pour ceux d'un maître que les circonstances leur ont imposé.
Il y a, ou plutôt il y avait des peuples civilisés qui ne se battaient que pour des intérêts généraux, tellement liés aux intérêts privés que la cause générale était la cause personnelle de chaque citoyen.
Enfin il y a des peuples civilisés, plus ou moins libres, plus ou moins esclaves, qui trouvent que, quelles que soient la nature et l'intensité des intérêts, ils ne valent pas la peine qu'on se fasse tuer pour eux, et qui chargent de cette besogne de pauvres diables achetés à prix d'argent, ou des malheureux que la loi y condamne, s'ils n'ont pas dans leurs bourses le moyen de s'en affranchir.
Les Arabes sont dans la seconde de ces quatre catégories. Quant à nous, on peut dire, jusqu'à un certain point, que nous appartenons à toutes à la fois, ou du moins que nous y avons appartenu successivement dans un court espace de temps. Ainsi, sous la république et une partie de l'empire, nous avons appartenu à la troisième catégorie. Maintenant nous sommes dans la quatrième, et nos habitudes, de duels ou de guerres individuelles, nous mettent sous certains rapports dans la première.
Les guerres que se font les Arabes de tribu à tribu sont peu sanglantes et de courte durée, les intérêts qui leur mettent les armes à la main n'étant ni vifs, ni permanents ; mais elles se renouvellent assez fréquemment, tantôt pour une cause, tantôt pour une autre. Ces gens-là ne sont pas rancuniers, mais ils sont très irritables, et prompts à courir aux armes. Ces dissensions intestines se réduisent à quelques courses, à des surprises appelées Razzia où l'on pille des villages ou des douars, et à quelques engagements où les cavaliers des deux partis se contentent le plus souvent d'échanger quelques coups de fusil, sans en venir à des combats corps à corps; tout cela se fait sans beaucoup d'ordre. Les deux tribus ennemies, disposées en groupes confus, s'avancent à une certaine distance l'une de l'autre.
Puis des cavaliers se détachent de chaque groupe, successivement et au galop, en décrivant une courbe dont le sommet est tourné vers l'ennemi ; arrivés à ce point ; ils lâchent leur coup de fusil, et rentrent au milieu des leurs en parcourant toujours au galop la seconde branche de la courbe. Dans les cas assez rares où l'on en vient à l'arme blanche, les cavaliers, après s'être dégarnis de leur feu, passent le fusil dans la main gauche, mettent le sabre à la main, et chargent en fourrageur avec assez de résolution.
Les Arabes s'exercent fréquemment à cette manœuvre, qui est un des épisodes de toutes les fêtes. Les femmes, dans les tribus, assistent à ces sortes de tournois, couvrent de leurs acclamations les cavaliers qui montrent le plus d'adresse et de vigueur, et n'épargnent pas leurs sarcasmes à ceux dont l'inexpérience est décelée par quelque chute ou quelque gaucherie.
Ce sont ordinairement les Marabouts qui rétablissent la bonne harmonie entre les tribus. Cette mission d'humanité leur est d'autant plus facile, que la haine a peu d'intensité chez les Arabes. Cependant on a vu des guerres de tribus qui ne se sont terminées que par la dispersion totale des vaincus. C'est ainsi que les Oulad-Madi ont chassé de la plaine d'Hamza, les Aril, dont une partie est venue s'établir à Rassouta sous l'administration du général Voirol. Quelquefois les guerres se terminent faute de combattants; les vainqueurs se retirent successivement de la partie pour aller mettre leur butin à couvert, et raconter leurs exploits à leurs familles. D'autres fois les tribus se font tant de mal qu'il ne leur en reste plus à s'en faire.
Ainsi les Arabes m'ont raconté que deux tribus ayant formé réciproquement le projet de se surprendre, les guerriers partirent dans le même temps chacun de leur côté, mais en suivant des chemins différents, arrivèrent sur les terres de leurs ennemis, qui étaient restées sans défense, et les dévastèrent tout à leur aise, brûlant les habitations, enlevant les troupeaux et même les femmes et les enfants, sans se douter de ce qui se passait chez eux. Quand la vérité fut connue de part et d'autre, il ne resta plus qu'à se rendre ce qu'on s'était pris, et la paix fut rétablie d'elle-même.
Les cavaliers arabes sont armés d'un long fusil, qu'ils portent en bandoulière ; d'un ou de deux pistolets, logés dans un porte-pistolets à bandoulière, placé de droite à gauche ; et d'un sabre ou d'un coutelas, appelé yatagan. Quelques-uns ont en outre une lance à hampe courte, mais c'est le plus petit nombre. Les chefs et les cavaliers les plus riches ont de seconds pistolets, dans des fontes adaptées à leurs selles. Ils portent leurs cartouches dans de petites gibernes, fort élégantes et fort commodes, placées, comme les nôtres, de gauche à droite, et qu'ils peuvent ramener facilement devant eux. Le porte-pistolets et la giberne se mettent par-dessus le haïk, vêtement d'étoffe légère, qui leur enveloppe le corps et la tête, où il est maintenu par une espèce de turban, appelé reit, composé de plusieurs tours de corde en poil de chameau. Le haïk, serré au corps par les diverses pièces de l'équipement, et par une ceinture, ne gêne pas les mouvements ; mais les Arabes mettent par-dessus un et quelquefois deux burnous, ce qui rend l'ensemble du Costume assez incommode : il faut être bien habitué à le porter pour ne pas être embarrassé de cette surabondance de draperie, qui retombe sur les bras et rend les mouvements moins libres. Aussi les puissances africaines qui sont en progrès, telles que l'Égypte et Tunis, forment des corps dont le costume se rapproche de notre tenue militaire, dégagée de ce qu'elle a de vicieux ; nous, au contraire, par cette manie d'imitation enfantine, qui nous caractérise, nous avons formé des corps indigènes, ou plutôt des corps mixtes, car ils sont composés d'autant de Français que d'Africains, où nous avons conservé tout le costume oriental : cependant le corps des Zouaves, à part l'inutile turban et l'ampleur démesurée du pantalon, est assez convenablement équipé ; mais celui des Spahis réguliers n'est, sous ce rapport, qu'une parodie arabe, fort peu raisonnable et de très mauvais goût.
Les Arabes, que leur pauvreté force de combattre à pied, et les Kbaïles, qui sont presque tous fantassins, ont toutes sortes d'armes; des fusils, des carabines, des tromblons, des pistolets, des sabres, des yatagans, et enfin des, massues, quand ils ne peuvent pas avoir autre chose. On ne trouve plus chez eux ni arcs, ni flèches, comme nous en avons encore vu entre les mains des hordes de la Tartarie, lorsque la Russie les vomit sur le midi de l'Europe en 1814 et 1815.
C'est chez les Kbaïles que se fabriquent les armes qui ne sont pas importées d'Europe ou du Levant. Les yatagans de Flissa sont très estimés, et sont en effet d'assez bonnes armes. On fait de la poudre en plusieurs endroits ; mais elle est de médiocre qualité, et on en fait peu, car la fabrication en est lente et difficile, toutes les triturations se faisant à la main. Comme Abd-el-Kader, malgré sa puissance, n'a pu parvenir encore à établir des moulins, il paraît prouvé qu'il n'y en a nulle part dans la Régence. C'est encore chez les Kbaïles que se fabrique le plus de poudre. On en fait plus dans les montagnes du sud de Bougie que partout ailleurs.
Les Arabes se mettent en campagne avec fort peu de provisions. Chaque cavalier porte dans des musettes, appelées Djbirn, un peu d'orge pour son cheval et quelques galettes pour lui ; les Djbirn ordinaires sont en grosse étoffe serrée, mais les riches en ont en cuir, bien travaillées et fort ornées. Elles ressemblent pour la forme aux sabretaches de nos hussards. Ils les portent suspendues à l'arçon de la selle. Cette selle a la forme de celles que dans nos manèges nous appelons selles piquées, c'est-à-dire que le pommeau et la palette en sont excessivement élevés, ce qui fait que le cavalier y est parfaitement encadré ; une sangle et un poitrail l'attachent au cheval. Les étriers en sont très larges et les étrivières très courtes. La bride est composée de deux montants, d'un frontal et d'une sous-gorge. Le mors, qui est fort dur, a pour gourmette un anneau mobile qui passe sous la barbe du cheval ; tout ce harnachement est leste et commode, et peut être adapté au cheval dans un instant. Il n'a pas, comme le nôtre, cette surabondance de courroies qui rend le paquetage si long, et il paraît si difficile qu'on en a fait chez nous un art qui a ses règles et sa polémique, art sur lequel ont écrit des gens qui n'avaient rien de mieux à faire, et dont les rois de France n'ont pas dédaigné de fixer les préceptes par des ordonnances ad hoc. Les Spahis réguliers ont conservé le harnachement arabe, et ils ont bien fait, car il vaut beaucoup mieux que leur costume.
L'équitation, qui est chez les Arabes moins scientifique que chez nous, y est en revanche plus répandue. Ils ont moins de véritables écuyers, mais ils sont presque tous hommes de cheval. En somme, ils ont l'avantage sur nous à cet égard. Personne ne sait mieux qu'eux tirer parti des chevaux, et en obtenir des efforts que nous n'oserions pas même leur demander. Il est vrai qu'ils les usent assez promptement.
Les Arabes sont aussi de fort bons piétons, mais nous les valons bien en cela, nous les surpassons même lorsqu'il faut marcher chargé. Car nous sommes en général plus forts. Ils supportent les privations plus par habitude que par tempérament, et je doute qu'ils pussent lutter contre des besoins intenses et terribles comme les Français sont susceptibles de le faire. Ceux-ci, produits croisés d'une foule de races distinctes qui se sont partagé, ou qui ont traversé le sol fortuné des Gaules, sont à cet égard comme les mulets qui vivent de tout et de rien. Ils se laissent facilement aller aux délices du bien-être, mais leur tempérament de fer n'en est que légèrement amolli.
Dans les guerres qu'ils nous ont faites, les Arabes n'ont presque rien changé à leur manière de combattre. Cependant, dans les derniers temps, nous les avons vus quelquefois présenter des lignes de tirailleurs assez régulières, soutenues par des pelotons de réserve. A Alger ils n'ont jamais attendu notre choc, et se sont toujours dispersés à l'approche de nos colonnes qu'ils revenaient ensuite harceler dans nos mouvements de retraite. Cette tactique, qui est la meilleure qu'ils puissent employer, leur a quelquefois parfaitement réussi. Leurs attaques de postes retranchés n'ont été vigoureuses et poussées à fond qu'à Bône, lors de l'expédition du général Damrémont. Mais en général le moindre ouvrage en terre, le moindre blockhaus est pour eux une citadelle inexpugnable. Les Arabes, comme les Grecs d'Homère, cherchent à faire du mal à l'ennemi en s'exposant le moins possible, et n'attachent aucune idée de honte à la fuite, lorsque les chances ne leur paraissent pas assez avantageuses ; un d'eux me disait un jour à ce sujet, " personne n'aime à se faire tuer, pas plus chez vous que chez nous. Mais chez nous, lorsque la terreur de la mort l'emporte sur les passions qui nous poussent à combattre, nous nous retirons, parce que personne ne nous retient, tandis que chez vous les soldais sont maintenus à leur poste, malgré leur frayeur, par l'habitude d'obéir à des chefs dont la profession est de se faire tuer sans savoir pourquoi, et chez qui cette idée est bien enracinée. "
Les armées composées d'êtres passifs et combattants par accident, pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, ne seraient rien, en effet, sans cette classe d'officiers à profession permanente qui, à défaut de ces intérêts de masse, ont l'honneur de leur état à soutenir, et par contrecoup leur position personnelle, qu'une lâcheté compromettrait. Les peuples qui combattent pour les intérêts de tous, ne présentent pas toujours une organisation militaire aussi compacte, mais quoiqu'ils ne bravent pas le danger avec autant d'abnégation, ils font la guerre avec plus de persévérance, et fréquemment avec plus de succès.
Nous, nous sommes presque toujours exagéré le nombre des Arabes que nous avons eu à combattre ; la vérité est qu'à Alger ils ne nous ont jamais opposé que des forces inférieures aux nôtres, nous avons aussi le tort de beaucoup trop tirer. C'est une manie, ou plutôt une faiblesse dont on a beaucoup de peine à déshabituer les soldats. Aussitôt que dans une expédition ils aperçoivent un burnous, trois à quatre cent coups de fusil sont tirés dessus. Le soldat, après s'être enivré du bruit qu'il a produit lui-même, croit avoir assisté à un engagement véritable, tandis que le plus souvent ce n'en a pas même été l'ombre. L'enflure de nos bulletins contribue aussi puissamment à donner à nos jeunes soldats de fausses idées sur la guerre. En leur laissant croire que des tiraillements insignifiants sont d'importantes affaires, on les expose à perdre la tête devant un danger réel. C'est une chose à laquelle nos généraux ne sauraient trop réfléchir. Ces mensonges officiels n'ajoutent rien à leur gloire passée, et peuvent compromettre leurs succès à venir.
Tant que les Arabes ont été dénués de centre d'action, leurs rassemblements ont été difficiles et de courte durée ; mais depuis que la fausse politique du général Desmichels a laissé une puissance indépendante et formidable s'établir dans la province d'Oran, et que le général d'Erlon a souffert qu'elle s'étendît jusqu'aux portes d'Alger, ils deviendront plus faciles et plus redoutables. Nous en avons déjà la triste preuve dans la victoire remportée par Abd-el-Kader sur le général Trézel. Ayant passé plusieurs jours dans l'armée d'Abd-el-Kader, je puis donner ici des détails précis sur ces rassemblements armés des Arabes, en prévenant le lecteur, que tous ne présentent pas un ensemble aussi complet que ceux, que dirige la volonté ferme et éclairée de cet homme remarquable.
Lorsque je me rendis, en simple voyageur, auprès d'Abd-el-Kader, ce prince revenait de l'expédition qui mit sous sa domination la province de Titery et une partie de celle d'Alger. Son armée se composait de 1,200 fantassins soldés, formant un corps permanent, et de cinq, à six mille hommes des tribus, presque tous montés ; mais dans ce nombre, on ne devait compter que sur un corps de 3000 hommes de bonne cavalerie, le reste n'était qu'un amas assez confus de gens mal armés et mal équipés. L'artillerie se composait de quatre pièces légères, mais mauvaises et de divers calibres, et montées sur des affûts sans avant-train, grossièrement travaillés ; les flasques de ces affûts étaient deux bras de limonière, entre lesquels on attelait les mulets destinés à traîner cette informe artillerie. Les munitions étaient transportées à dos de mulets ; il y avait dans l'armée un grand nombre de mules et de chameaux pour le transport des tentes et des bagages. L'Émir avait auprès de lui une cinquantaine de cavaliers (Meukalia) permanents et soldés, composant sa garde particulière.
Comme on était dans le temps des moissons, et que d'ailleurs l'Émir n'avait pas besoin de beaucoup de monde, il renvoyait, successivement les cavaliers des tribus dont il s'éloignait, et les remplaçait par ceux des tribus dont il se rapprochait ; de sorte que, quoiqu'il lui arrivât du monde de tous côtés, son armée n'était pas augmentée, et restait fixée au chiffre de 7 à 8000 hommes. Mais je crois que s'il avait voulu avoir à la fois tout ce qu'il n'avait que successivement, il aurait pu réunir, après la soumission des contrées de la rive droite du Chélif, de 25 à 30 mille hommes.
Dans les marches pour aller d'un camp à un autre, les bagages, l'artillerie, ainsi que le campement, marchaient sous l'escorte de l'infanterie soldée et de cet amas de gens mal armés dont nous avons parlé plus haut. L'Émir marchait avec la cavalerie disposée en ligne de bataille continue d'une profondeur inégale, mais toujours assez considérable; à cent pas en rivant de chaque aile était un escadron assez régulièrement formé. Abd-el-Kader se tenait au centre, entouré de ses principaux officiers, et ayant derrière lui ses meukalias, sa musique et les bannières de sa famille ; on portait devant lui l'étendard général. Ce prince était mis très simplement et sans aucune espèce d'ornement; seulement on soutenait au-dessus de sa tête un parasol en brocart d'or.
Le camp était disposé de la manière; suivante : la tente de l'Émir, fort belle et fort vaste, était au centre, et gardée seulement par des Chaouchs ou huissiers. Autour de cette tente, mais à une certaine distance, étaient celles des secrétaires, celles des meukalias, et le magasin général ; les cinq Agas de l'Émir avaient leurs postes dans des directions et des distances déterminées de la tente de leur prince ; les Kaïds, placés sous leurs ordres, étaient établis de la même manière autour de leurs Aghas respectifs, et les Cheikhs et les cavaliers autour de leurs Kaïds.
Le camp formait un carré aux quatre angles duquel était placée l'artillerie. Les tentes de l'infanterie soldée étaient disposées sur les quatre faces du camp, dont elles bornaient l'enceinte ; de cette manière c'était l'infanterie qui couvrait la cavalerie. Le camp était levé et tendu avec une admirable promptitude, sans que personne parût présider à cette opération ; au moment du départ, l'Émir sortait de sa tente et allait s'asseoir sur un tabouret placé en avant de l'entrée principale ; là tout le monde était admis à venir le saluer.
Pendant ce temps, sa tente était abattue et chargée sur des chameaux ; à ce signal, toutes les autres tombaient à la fois et étaient chargées de même. Quand on arrivait sur l'emplacement du nouveau camp, la tente de l'Émir était tendue la première, celles des Aghas s'élevaient alors dans les directions et les distances prescrites, puis toutes les autres autour de celle-ci. Tout cela était fait dans un clin d'œil, et toujours de la même manière, de sorte que le camp présentait toujours le même aspect.
Le plus grand ordre régnait dans cette réunion d'hommes armés de tant de tribus diverses. Point de cris, de disputes, d'injures, partout le calme et l'union. Chacun savait ce qu'il avait à faire et le faisait sans hésitation et sans bruit. Il n'y avait cependant là aucune des règles de notre discipline ; point d'appel, point d'inspection de garde, point d'adjudant-major roque et grondeur, punissant, avec une comique gravité, un homme pour un, bouton de veste ou de culotte. J'avoue que je fus profondément surpris de voir le calme et l'ordre de ce camp. Cela me fit faire des réflexions sur la vanité de nos fameux règlements sur le service intérieur et de campagne. Il est vrai que les Arabes n'ont point de marchands de vin. Cela explique bien des choses.
J'ai déjà prévenu le lecteur qu'il ne devait pas juger toutes les réunions d'Arabes par celle que je viens de décrire. Cependant, l'armée du Bey de Constantine doit présenter les mêmes éléments que celle d'Abd-el-Kader ; mais je doute qu'il y ait autant de bonne volonté et de dévouement pour le chef. En effet, Ahmed-Bey n'est que la queue du gouvernement turc, tandis qu'Abd-el-Kader semble avoir sonné l'heure du réveil de la nationalité arabe, ce qui doit nécessairement exciter plus de sympathie chez les populations indigènes. Quant aux rassemblements que nous avons' eu à combattre dans la province d'Alger, ils ont toujours été peu nombreux et très désunis, même celui qui eut lieu à Soug-Aly sous l'administration du duc de Rovigo. Les Kbaïles de Bougie sont plus tenaces que les Arabes d'Alger, mais ils ne sont pas plus unis.
Plusieurs personnes ont dit qu'il était impossible d'atteindre les Arabes, et par conséquent d'en finir avec eux. Ceci n'est point exact ; d'abord je crois, ainsi que je l'ai exprimé dans l'article précédent, qu'en se conduisant convenablement, on ne serait que rarement obligé d'avoir recours à la force ; mais quand l'emploi en deviendrait nécessaire, il y aurait moyen de pousser la guerre jusqu'au bout, surtout dans la province d'Alger, où les Arabes ont plus à perdre que partout ailleurs. Pour cela, il ne faudrait pas marcher contre des troupes aussi mobiles que le sont les leurs, avec nos lourdes masses, et déployer contre eux un luxe de combinaisons stratégiques fort inutile dans ce pays. Il ne faut pas non plus perdre l'avantage que nous donne notre organisation militaire dans bien des cas.
Mais il faudrait avoir un corps léger de 1800 à 2000 hommes d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, lestes et convenablement équipés, et ne portant avec eux que des vivres et des munitions. Ce corps formerait toujours tête de colonne, et quand il rencontrerait l'ennemi, il le pousserait à toute extrémité. Dans les pays découverts, où les embuscades ne seraient pas à craindre, la cavalerie chargerait en fourrageur, chaque homme choisissant son ennemi, et ne s'arrêtant qu'après l'avoir pris ou sabré. Or, en poussant la charge avec cette vigueur, il est certain que nos gens les mieux montés atteindraient au moins les plus mal montés de ceux de l'ennemi. Dans les terrains où l'on pourrait craindre des embuscades, la cavalerie attendrait l'infanterie pour franchir avec elle les passages dangereux, et reprendre sa course après ; les colonnes régulières suivraient de loin le corps léger, pour lui prêter, en cas d'échec, l'appui de ses masses compactes. On réunirait de cette manière, les avantages de la tactique européenne et ceux de la manière de faire la guerre des Arabes. Il faudrait aussi rendre les troupes régulières un peu plus lestes, en les débarrassant de beaucoup de choses inutiles, et remplacer par des chameaux la plus grande partie de nos moyens de transports à roues.
Le bataillon de Zouaves et le corps des Spahis réguliers, pourraient former le noyau de ce corps léger, auquel le nom de Légion-Africaine conviendrait parfaitement.
|
|
LES IMAGES DU SOUVENIR
ECHO D'ORANIE - N°296
|
En trouvant ce matin ces images fanées
sur chacun des portraits, mon doigt s'est fait bien gourd
Et mes yeux ont cillé sur ce passé trop lourd
Où des ombres sans bruit déroulent les années.
J'ai parcouru longtemps, comme celui qui sème,
Parmentier, Perrégaux, mil neuf cent trente six,
Bouguirat, Jules Renard, Pasteur et Bou-Tlélis
Delmonte, Ali-Chekkal, classe de quatrième.
Blouses avec petit col ou très bel uniforme,
Frange d'Elizabeth, tresses de Laïla,
Sarrouels, sarraux noirs, à Oran, au Tlélat,
Ils sont là, souriants, comme copie conforme.
J'ai scruté les préaux, chacune des écoles
Répété quelques noms, Sibboni, Martinez,
Gérardin, Benamou, Bonnal et Fernandez,
Pensé à ces minois rieurs et sans paroles.
Montrez à vos voisins la douceur des visages,
De Tlemcen à Saint-Maur, aux confins de Lourmel,
Attachez vos regards aux enfants d'Er-Rahel,
Des cœurs purs se cachaient au creux des paysages.
Je n'ai vu nulle part de foulard islamique
Quelquefois un béret ou une chéchia
Quelques pleurs effacés pour une chicaya,
La photo n'a qu'un sens, la pose académique.
Avant de refermer "L'Echo de l'Oranie"
Regardez, vous aussi, l'école de Zégla
Les enfants au teint mat et les autres sont là,
Le temps semble si doux, si belle l'harmonie.
Qui donc a enfanté l'ignoble dramaturge
Venu par un matin briser cet univers.
Promettant pour demain de sinistres hivers,
Quel est donc ce Satan, ce terrible démiurge ?
Qu'êtes-vous devenus, tous ceux de la Marine,
De Paixhans, de Pasteur ou de Colomb-Béchar,
Mais j'ai le cœur meurtri et il se fait bien tard
Et ce soir près d'Agen, le chagrin tambourine.
André MASSON de Bou-Tlélis
|
|
|
LE SERVICE MILITAIRE AU 1ER ZOUAVES
Envoyé par M. piedineri
|
|
Récit humoristique en pataouète, par Toni-Pança, dans le Papa-Louette du 20 septembre 1913
A LES GRANDES MANOEUVRES
Tché comme on s'a chié l'os, cette année à les grandes manœuvres !
Les pieds comme des obergines j'ai !
On se dirait qu'on m'a passé dessur de la confiture des raisins de tant qui sont noirs. Mais qué des kilomètres qu'on s'a bouffé. On avait beau faire pour pas se fatiguer, la moitié de la route à pied, l'autre en marchant, z... la chemise elle était trempée, comme le pain quand Maria Pépa, elle fait la soupe des chiens.
Maintenant c'est fini... On a fait la deslocation. Aussi j'ai le droit de vous sortir ça qui s'a passé.
... Y a un mois, comme ça environ, le coronel du 1er zouaves, Codet, que c'est un camarade jambon, y s'envoie à la maison une lettre vec, sur l'enveloppe, S. M.. Mancotoque je savais quoi c'était ça. Je croyais que c'était des mauvaises paroles et déjà j'allais se lui envoyer mes témoins, quand Midjacague, qui s'a servi dedans l'Etat-Major, y me dit : ça, ça veut dire : " Serbice Militaire ".
Je l'ai bouclée en cinq secs, j'ai rouvert la lettre et j'ai lu :
" Mon Cher Toni,
" Tous les officiers du Régiment seraient heureux de t'avoir pour cette période d'enstruction. Viens, tu nous feras le plus grand plaisir. On tachera de te faire passer caporal.
" Je te serre les phalanges. Ton ami,
" Codet ".
Quand je me vois ça, fou j'étais. Moi caporal ? Atso ! qué d'attaque !
Toutes les femelles d'Alger elles vont s'arracher ma gueule. Qué gousto je vas faire ! qué gousto !...
D'autorité, je m'envoie à le coronel un pleumatique vec ces mots : " Accepte la combinaison. Démerde-toi pour me faire foutre dedans une compagnie d'al pello. Je te pisse au cu. " TONI ".
Quatre ou cinq jours après, j'étais à la caserne d'Orléans...
On m'a sorti des effets, ni bons, ni mauvais et une chéchia, si tant crasseuse, qu'il a fallu que je gratte la crasse, vec le couteau qu'on s'épluche les patates. Comme j'avais le malheur de rouspéter un petit cabot, pas plus grand que monze, y se met les mains sur les z'hanches et vec l'accent parisien y me sort :
- Regardez-moi c' t'enflé là. On lui a foutu une chéchia toute neuve et y rouspète. C'est peut-être le fils au Pape, ce bonze-là !
Le f... au Pape ! La p... de sa mère ! A moi y m'ensulte ! Je me pose parterre le paquet des effets que j'avais, je me l'empogne par les deux épaules et je t'y fous un coup de carabasse en pleine figure, si tant fort, que les chandelles qui sont sorties de son naze, elles ont fait la lumière électrique dedans la chambre. Plein de sang, y s'en va trouver l'adjudant. Reusement, çuilà était brave. Y vient à côté de moi et y sort :
- C'est vous que vous avez jonglé le Parigot ?
- Oui.
- Eh bien, mon vieux, vous aurez la permission cette nuit. Ça lui apprendra à faire le malin.
Moi que je me croyais de passer à le conseil de guerre, d'attaque ! La prochaine fois, si le sargent y m'enmerde je t'y fous à lui aussi une castagne dans les condices alors on me sort 8 jours de permission...
Rien plus y m'a arrivé, pourquoi, l'après-midi, le coronel Codet, y s'a passé dans la cour, la revue de nous z'autes. Quand la revue, elle est passée, y se fait former le cercle par tout le régiment et y parle comme ça :
" Messieurs,
Il y a dans vos rangs, le roi des louettes. Je vais vous le présenter. Tâchez de lui ressembler au moral comme au physique et la France, la Patrie, l'Armée, la République, elles seront fières de vous ! "
Et le coronel, y se fait la bouche, comme un cu de canard et y s'appelle :
- Toni-Pança !
Moi, je me sors un " présent ! " si tant fort que les aiguilles de la pendule de la caserne d'Orléans elles se sont arrêtées...
- Avancez au milieu du cercle !
Je m'avance. Les hommes y présentent les armes. Les z'officiers y font le salut vec le sabre et la musique qui se commande le chef, M. Enterré, elle se joue la " Marseillaise ". Quand tout le baccanal, il est fini, le coronel, y se jette sur moi et y m'embrasse comme si j'étais une joulie femme et y dit :
" Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, ce zouave doit être votre modèle, ça qui dira, vous direz, ça qui fera vous ferez ! "
Et s'adressant à moi :
- Allez, mon petit Toni, dis quelque chose pour voir si tous y z'ont compris. Alors ! je m'ouvre grande la bouche et je cris, fort, fort :
- Z... !
Alorsse tous, officiers, sous officiers et soldats y crient plus fort que moi !
- Tac !... Tac-Tac-Tac, Tac !.. z... z../
Dans le Sahel l'écho aussi. Adios on entendait plus que ce mot-là partout...
Alorsse le colon y dit :
- Pour les grandes manœuvres, ce sera le mot de ralliement !
La musique elle se joue le Chant du Départ. On rompe les rang et les sordats y me portent en triomphe à la cantine.
... Le lendemain, on était pas souriante... On se marchait sur la route de Blidah ! Vinga, vinga de marcher ! Les souliers - qui z'étaient un peu grands y faisaient tchaf ! tchaf ! tchaf !
Aïe ma qué rabia j'avais... Les ampoules et tout j'avais en dessur les pattes.
Alorsse comme il avait dit que je poudais faire tout ça que je voulais, je me lève les souliers... Deux minutes après, tous y se les enlevaient et y se les mettaient sur l'épaule.
On s'arrait dit une procession des maltais !
Enfin, on s'arrive à Blidah et la population elle nous fait une ovation terrible.
Bélichat, qu'il avait annoncé que j'étais zouave, il avait organisé une manifestation.
Tous y criaient : " Vive le 1er zouaves ! Vive Papa-Louette ! "
Le soir on a dansé bel gousto et on s'a fait dodo, chaque, vec une petite Mauresque d'al-kif. Ça qu'on a fait ça régare à personne.
Le lendemain il a fallu repartir et se commencer les manoeuvres. Pendant huit jours, madone ! qué des kilomètres, dans la montagne, dans les près, dans les rivières. Les zouaves, scaphandiers y doivent être.
Enfin, après toutes ces manoeuvres, on se fait un repos d'un jour, pourquoi, le général Drude y devait se venir en aéroplane vec Serviès.
A peine il arrive, comme un oiseau papasse, y descend à côté de nous et y se sort les félicitations à tout le monde :
" Bien manoeuvré, mes enfants ! Bien manoeuvré ! Les alboches n'ont qu'à bien se tenir, si ils veulent pas s'attacher une gamelle à la queue ! "
Après ça, y demande :
- Aousqu'il est Papa-Louette ?
Le coronel Codet y me présente et le général Drude y me dit :
" Mon vieux, tu as marché comme un nomme, tu as manœuvré comme un zèbre. Au nom de l'Armée Française, je te fais caporal ! "
Toutes les musiques, les fanfares elles se jouent des marches entraînantes et tous les régiments y se défilent devant moi.
Le ministre de la guerre, une merde de chien, il était à côté de moi !
Comme moi, je l'aime pas faire figure pour rien, je fais venir tous les commandants de Compagnie et je leur dis :
- Au nom de moi et de Papa-Louette, je vous prie de faire donner un litre de vin à tous vos hommes !
Tous y crient : vive Toni ! Saha Papa-Louette !
Z... ! malgré l'ovation, le lendemain, à pied je revenais à Alger, vec les pieds comme des obergines.
Là, on a repris les effets militaires et on nous a dit :
- Au revoir et merci !
Le colon y m'a envité à déjeuner à chez Maklouf et, au champagne maltais, y me sort :
- Toni, l'année prochaine tu seras nommé sergent !
Et moi, que j'en avais plein les pieds et ça que vous pensez, je lui réponds :
- Reprenez vos galons de caporal et laissez-moi tranquille !
Que le cu y vous tombe à vous et à les grandes manœuvres !
La prochaine fois que je fais les 17 jours, je demande à les faire dans les zouaves... sous-marins !
TONI-PANÇA
|
|
Un " télégramme "... dans la nuit
De L'Effort Algérien du 13 avril 1934
|
Que de similitudes avec années 2000 !!!
L'autre jour j'étais à la grande Poste d'Alger dans les environs du guichet qui paie les pensions aux anciens fonctionnaires civils et militaires retraités. Voyant que s'y agitaient avec maints gestes de protestation, je m'approchais en journaliste indiscret qui fourre son nez partout.
Et c'est ainsi qui j'apprenais que dans la nuit, I'administration avait reçu du Ministre un télégramme urgent dans lequel il était spécifié qu'un prélèvement de 10 pour cent serait fait sur toutes les pensions d'ancienneté dont l'échéance serait postérieure au 6 avril 1934
Si nous n'étions pas en régime de trêve politique et de " purée " budgétaire, je m'indignerais avec force conte un Etat qui, du jour au lendemain, sans crier gare, par un simple télégramme de nuit, fait ainsi une coupe sombre dans un budget familial qui, peut-être, est l'unique ressource de son bénéficiaire.
Mais nous avons fait tellement de sottises depuis la guerre - et par nous, j'entends l'électeur aussi bien que l'élu - que fatalement il devait arriver un beau matin où la Caisse du Trésor serait à sec.
Par une démagogie sans cesse croissante, on a gavé de subventions des offices et groupements insatiables : on a relevé traitements et pensions sans savoir si l'on serait en mesure de les payer : on a édifié des lois sociales coûteuse, justes peut-être en elles-mêmes mais d'autant plus inopportunes qu'il nous fallait solder les frais de la guerre. Bref, nos parlementaires ont jeté de la poudre aux yeux à tout le monde, et nous nous en sommes jetés à nous-mêmes.
Hélas ! Le revers de la médaille devait vite apparaître. Un simple télégramme urgent est venu, jetant peut-être la gêne dans un grand nombre de foyers modestes.
Puisse cette aventure détourner l'électeur de ce régime de facilité qui promet, donne et retire, régime qui fait la preuve une fois de plus du sans-gène de l'Etat, de son esprit d'imprévoyance et de son honnêteté toute relative.
Et en écrivant cette dernière phrase je n'entends nullement mettre en cause le ministère Doumergue. S'étant trouvé devant une caisse vide. Il fallait bien qu'il la remplisse, sous peine de banqueroute, c'est-à-dire de révolution.
Sait-on en effet que dans l'état actuel de noue législation il y a des pensionnés qui touchent une retraite égale à 70, 80 et même 100 pour cent du traitement d'activité ? Sait-on qu'il y a des fonctionnaires qui restent en fonctions au-delà de 70 ans, alors qu'il y a des jeunes gens de 25 ans, chevronnés de diplômes, qui attendent pendant des années entières une petite place de surnuméraire ?
Est-ce logique, raisonnable, humain ? Certes non, Il eût été préférable de donner un peu moins et plus sûrement : il eût été préférable surtout d'avantager les jeunes quitte à rogner un peu sur les vieux qui eux du moins, sont arrivés à un âge où l'on a moins de besoins, moins de charges de famille, et ont eu toute une carrière pour faire quelques économies.
Notre législation des pensions sent la démagogie à plein nez : et si nous protestons contre le télégramme un peu leste du 6 avril, c'est uniquement parce que l'Etat n'a pas tenu ce qu-il a promis.
Ainsi, nous sommes tous les victimes de nos égoïsmes d'après-guerre.
Nous nous sommes jetés - gros et petits - dans la jouissance jusqu'au cou. L'Etat a triplé ses dépenses. l'industriel a quintuplé sa production, les fonctionnaires ont décuplé leurs exigences, l'électeur a centuplé ses sottises... Quant à l'élu, il a suivi toute cette sarabande, sûr d'avoir la claque avec lui.
Hélas ! c'est l'heure douloureuse du retour en arrière. Après l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, les Etats-Unis, notre pays est obligé, de mettre un cran à sa ceinture. Il y aura des victimes, hélas !... Surtout parmi les petits, car dans ces affaires là ce sont toujours les petits qui trinquent.
Mais à qui la faute ?
Cela dans tous les cas nous prouvera qu'il y a une morale même dans les affaires, et que l'égoïsme n'est parfois qu'un mirage et une duperie.
PAUL RIMBAULT.
|
|
|
DJENDI
Envoyé par Mme Marquet
|
---------------------------------------------------------------
DJENDI
Eugénie, Melika, Manon
Pseudonymes: JENNY, JIMMY, Jacqueline DUBREUIL
Née le ? 1918 ? A Bône (Algérie) de Salah ben Chefrai Djendi Fallah et de Antoinette Silvani. Célibataire. Décédée le 18 janvier 1945 à Ravensbrück
Réseaux: I.T.G., F.F.C., F.F.L., B.C.R.A., S.S.M.F./T.R.Agent P2
Eugénie Djendi s'engage à vingt-quatre ans dans les Transmissions après le débarquement des Anglo-Américains du 8 novembre 1942 au Maroc et en Algérie où elle habite, chez ses parents, à Bône dont elle est originaire. Elle fait alors partie de celles qu'on surnomme les Merlinettes, du nom du chef des Transmissions, le général Merlin. Un centre d'entraînement est installé à Staouéli, près d'Alger.
Paul Paillole, commandant le 2ème Bureau d'Alger, dit Mireille Hui (qui fut des Merlinettes), contacte le général Merlin pour recruter des spécialistes radio. Avec Marie-Louise Cloarec, Suzanne Mertzizen et Pierrette Louin, Eugénie Djendi est volontaire. Recevant les jeunes femmes, Paul Paillole ne leur cache pas l'extrême danger des missions à effectuer, mais elles persistent dans leur engagement.
En janvier 1944, elles sont dirigées vers le Bureau Central de Renseignement et d'Action d'Alger (B.C.R.A.A.) puis à Londres (B.C.R.A.L.) pour suivre des stages d'instruction d'opératrices radio. Mireille Hui dit que ce stage dure deux mois. Il a lieu en Grande-Bretagne, à Saint Albans et à Ringway, près de Manchester. Le programme: renseignement, topographie, identification des effectifs et matériels ennemis, repérage des objectifs à bombarder, sport de combat, séances de tir, maniement des explosifs, conduite et mécanique auto et moto, parachutisme, transmissions (émettre de France plus de trente minutes sans changer de longueur d'onde ou de lieu est suicidaire).
Eugénie Djendi est incorporée à la mission Berlin, qui doit opérer dans la région parisienne. Elle est parachutée (avec la mission Libellule) dans la région de Sully-sur-Loire le 7 avril 1944. Elle établit alors la liaison avec Alger et Londres.
Arrêtée le 9 avril porteuse de tout son matériel radio, elle est interrogée avenue Foch et enfermée 1bis place des États-Unis.
Georges Pinchenier (alias Lt Lafitte), parachuté et arrêté avec ses deux radios, Jenny Djendi et Marcel Leblond, écrira en octobre 1945 au père de Pierrette Loin: "Transféré avenue Foch à Paris, où je suis resté jusqu'au 27 avril, jour de l'arrestation de Pierrette et de Marie-Louise (Cloarec*), j'ai été ce jour-là interné place des Etats-Unis avec mon radio, mais sans nouvelles de Jenny.
Peu de jours après, car les choses se savent vite en prison, j'acquis la certitude que Marie-Louise et son amie Suzy Mertzisen se trouvaient au-dessus de moi, mais je ne pus leur faire connaître ma présence faute d'arriver à entrer directement en communication.
Enfin, le 15 mai, mes deux voisines de cellule disparurent et furent remplacées par Pierrette et Jenny. Pierrette était ce jour-là d'un moral remarquable. Comme j'avais préparé mon évasion pour la nuit suivante, elle réussit, par un trou fait sous de la porte à me passer un plan de métro et 300 francs qui ne lui avaient pas été subtilisés. Elle me donna ce jour-là tous les détails que vous connaissez sur son arrestation et celle de nos camarades. Enfin elle m'affirma qu'elle n'avait nulle intention de rester en prison et qu'elle envisageait déjà la possibilité de s'enfuir. Je puis dire que c'est en partie grâce à elle que mon évasion réussit. Leblond, très déprimé, broyait du noir et me conseillait de renoncer à mon projet, et il se peut bien que, sans la présence dans la cellule voisine de mes deux braves amies, j'eusse renoncé à le mettre à exécution. Pendant toute la nuit, et les nuits étaient longues, elles attirèrent l'attention des gardiens sur elles par leurs cris, leurs plaisanteries et leurs chants. Tant et si bien que je pus achever mon travail et que j'étais libre au petit jour."
Jenny Djendi est ensuite internée à Fresnes et à Compiègne. Déportée le 15 août 1944, elle retrouve à Ravensbrück ses compagnes Marie-Louise Cloarec*, Pierrette Louin* et Suzanne Mertzizen*, qui ont été parachutées ensemble et ont été arrêtées quelques jours après elle.
Une fiche du ministère de la Défense dit: " Après avoir demandé plusieurs fois au commandant du camp, Fritz Suhren, leur transfert dans un camp de prisonniers de guerre, les jeunes femmes sont convoquées le 18 janvier 1945 vers 16h au bureau du camp. A partir de là, les témoignages laissent place à des suppositions.
Mme Postel-Vinay (témoignage du 20 septembre 1949, Arch. d'Alger) a connu personnellement au camp Jenny Djendi et surtout Suzy Mertzisen qui était devenue la meilleure amie de sa camarade tchèque Miléna Seborova. "Deux mois avant leur disparition, les quatre jeunes filles avaient été appelées à la Schreibstube, pour un interrogatoire d'identité. C'était l'usage avant les exécutions, mais pas invariablement. Ces femmes croyaient d'ailleurs qu'il s'agissait d'une réponse favorable à leur demande de transfert dans un camp de prisonniers militaires britanniques, d'autant que l'Allemand qui les avait reçues avait été très aimable et s'était inquiété de la santé de Djendi Jenny.
Le 18 janvier 1945, elles ont été à nouveau convoquées au bureau. Elles s'y sont rendues joyeusement, toujours convaincues qu'elles allaient être transférées dans un camp moins pénible.
Miléna Seborova, inquiète cependant, a suivi Suzy Mertzisen à distance. Elle l'a vue, en compagnie de ses trois camarades, sortir du bureau. Toutes les quatre avaient remplacé leurs chaussures par des savates légères." L'Allemande Ruth Neudecker, toujours volontaire pour les exécutions, les accompagnait.
Dans "Ravensbrück" (Ed. de la Braconnière, Neuchâtel), il est écrit: "A la même heure, la route qui passait devant le Crématorium et conduisait chez Siemens fut barrée par les S.S." Mme Postel-Vinay et ses camarades ont alors supposé qu'elles avaient été pendues, car elles croyaient savoir qu'un gibet avait été construit dans le courant de l'année 1944, à côté du Crématorium...
En fouillant l'immense tas de vêtements des mortes, Miléna Seborova a retrouvé le manteau gris de Suzy Mertzisen et celui d'une autre, qui contenait encore dans la poche sa carte à son nom."
Rosane (Renée Lascroux), professeur de C.E.G., camarade de Pierrette Louin au lycée d'Oran, déportée à Ravensbrück et libérée à Bergen-Belsen (cité dans le Bulletin du Club Austerlitz, repris dans Bulletin de l'A.A.S.S.D.N. n°184), rapporte: "Le 18 janvier 1945, le bloc français prend le deuil. Dès l'appel du matin, Pierrette Loin et Marie-Louise Cloarec, nos petites parachutistes, ainsi que Suzy et Jenny leurs compagnes radio (...) sont averties qu'elles doivent se tenir à la disposition du commandant avec interdiction formelle de sortir du block jusqu'à l'heure fixée - seize heures et demie.
Peu d'entre nous savent la nouvelle, l'on n'ose imaginer le drame, il est prudent de se taire pour les petites et pour nous-mêmes. J'ai passé la journée avec elles. Pierrette et Marie-Louise sont des enfants. Pierrette, à vingt-deux ans, reçut ses galons à Alger, elle aime l'Afrique où elle a préparé le débarquement américain. Marie-Louise est une vaillante bretonne de vingt-quatre ans, elle fait la guerre, et Suzy, de Metz, est maman d'une fillette de six ans. Jenny adore le risque.(...) Seront-elles traitées en soldats ? Le coup fatal éclate, quelle stupeur s'empare de nous, les mieux prévenues. Le soir nous attendons leur retour au block, sans espoir. Marie-Louise a imaginé mille conjectures, pleine d'illusions encore, elle a emporté plusieurs adresses. Pierrette n'a dit mot, elle pensait. Cependant, elles ont été fusillées. La nuit survient, le block ferme, les petites ne coucheront pas là. Le lendemain nous faisons d'adroites recherches. Sur un registre figure à côté des quatre matricules, la mention vague et classique: "transport sans destination". C'est étrange. Entre ses dents, une femme murmure: "c'est ainsi que l'on indique les fusillés."
Les témoignages ne se recoupent pas, les quatre jeunes femmes auraient été fusillées à 18h30 dans une baraque proche du crématoire ou pendues au gibet du camp.
Miléna Seborova, affectée à la buanderie, pense qu'elles auraient été pendues: il n'y avait pas de traces de balles ni de sang sur leurs vêtements. Même écho de Mme Lindell, rescapée du camp, qui dit (Archives d'Alger, document des Renseignements généraux du 18 Mai 1949) que Mlle Kate Johansen, norvégienne affectée au magasin d'habillement, a reçu les vêtements de quatre Françaises sans avoir remis de vêtements civils en échange. "Au moment où Mme Lindell constatait que ces défroques ne portaient aucune trace de balles et de sang, est-il dit dans le relevé de témoignage, un Allemand dont elle n'a pas connu le nom, employé au magasin d'habillement, a porté la main à son cou pour indiquer que ces femmes avaient été pendues."
Un rescapé hongrois d'Auschwitz, le Dr. Nyisli, rapporte qu'il existait aussi des balles de plomb de très petit calibre, tirées dans la nuque. Leurs corps ont été brûlés ou enterrés dans une fosse commune de la forêt.
Mireille Hui indique qu'elles ont été assassinées sur ordre de Berlin, d'après le témoignage du commandant S.S. du camp, Suhren, et de son adjoint, Schwartzhuber, interrogés après leur arrestation par les Alliés.
Déclarée "Morte pour la France", Eugénie Djendi sera décorée de la Légion d'Honneur et recevra la Croix de Guerre avec étoile de vermeil et la Médaille de la Résistance. *
Citations : "Opératrice radio, faisant partie d'un réseau de contre-espionnage, s'est dépensée sans compter pour mener à bien la tâche qui lui était confiée. A établi la liaison radio avec Alger et Londres et a transmis des messages importants pour le commandement."
(A l'ordre du corps d'Armée): "Jeune Française animée du plus pur esprit de sacrifice et d'un sublime héroïsme".
Lieu de mémoire: Le non d'Eugénie Djendi est gravé au Mont Valérien.
Références: "Les Merlinettes" de Mireille Hui (Ed. Livre à l'unité, 3ème édition mars 2000); Bulletin de l'A.A.S.S.D.N. n°3, p.38, n°18, p.107, n° 24, n°143, p.23, n°166, n°184, p.12; Archives d'Alger (n° 3331-64)
Si vous passez par le parc André Citroën, faîtes un détour par le square Eugénie-Malika Djendi et ayez une pensée pour les jeunes "Merlinettes" car c'est à elles aussi que nous devons notre liberté chérie.

|
|
| Les Berbères
Envoyé par M. Christian Graille
|
Les Berbères que les Algériens nomment Kbaili habitent les montagnes du petit Atlas depuis le royaume de Tunis Jusqu'à l'empire du Maroc ; ce mot arabe signifie nation, tribus, enfants du même père. Les Algériens l'appliquent à toutes les peuplades qui vivent dans l'intérieur des montagnes ; chaque montagne occupée par les Berbères porte le nom de Beni qui veut dire les enfants : c'est ainsi que dans la portion du petit Atlas que nous avons parcourue, nous avons trouvé les tribus de Beni-Sala, de Beni-Meissera, de Beni-Menad etc.
Les Berbères sont de taille moyenne ; ils ont le teint brun et quelquefois noirâtre, les cheveux bruns et lisses, rarement blonds, ils sont tous maigres mais extrêmement robustes et nerveux : leur corps grêle est très bien fait et leur tournure a une élégance que l'on ne trouve plus que dans les statues antiques. Ils ont la tête plus ronde que les Arabes, les traits du visage plus courts mais aussi bien prononcés ; ces beaux nez aquilins, si communs chez ceux-ci sont rares chez les Berbères ; l'expression de leur figure a quelque chose de sauvage et même de cruel ; ils sont extrêmement actifs et for intelligents
Ils parlent une langue particulière, le chovia, chilla ou Berbère qui n'a de rapport avec aucune des langues connues : ceux qui se mêlent de commerce et presque toutes les tribus qui habitent le versant Nord du petit Atlas, et qui, par cela, se trouvent continuellement en contact avec les Arabes de la plaine, parlent ou comprennent l'arabe mais tous ceux qui vivent retirés dans l'intérieur des montagnes n'entendent que leur langue naturelle.
On en voit souvent venir à Alger qui ne savent pas un mot d'arabe.
Dans cette ville on donne le nom de bédouin (qu'on prononce bédouine) à tous les peuples qui vivent à la campagne, sous des tentes ou des cabanes ; ainsi ce nom est aussi donné aux Berbères : du reste ils le méritent bien. On appelle bédouin en général ceux des Arabes et des autres peuplades du désert qui sont errants et ne s'occupent qu'à piller les passants, leurs compatriotes aussi bien que les étrangers.
Ils abandonnent souvent leurs montagnes pour venir piller la plaine ; quand ils savent qu'une caravane doit passer sur leur territoire ou dans le voisinage, ils se réunissent plusieurs pour l'attaquer.
Pendant mon séjour à Alger je les ai souvent vu venir au nombre de cent et même deux cents attendre sur le chemin les Arabes et leurs compatriotes qui venaient du marché pour leur prendre l'argent qu'ils rapportaient.
Le général prévenu de cela avait permis aux marchands d'arriver avec des armes jusqu'à nos avants postes ; là ils déposaient leurs armes et ils les reprenaient en repassant. Alors ils se réunirent plusieurs ensemble et se défendirent contre les pillards ce qui donna lieu à plusieurs petites batailles entre ces Barbares.
Les Berbères sont cruels nous en avons eu lieu de nous en convaincre dans les combats que nous leur avons livrés ; ils se portaient à toutes sortes d'atrocité contre ceux de nos malheureux camarades tombés entre leurs mains.
Habitations
Celles des Berbères sont des cabanes composées de quelques morceaux de bois fichés en terre auxquels ils attachent des roseaux ou de petites branches d'arbre qu'ils enduisent ensuite de terre grasse dans laquelle ils mêlent un peu de paille. J'ai vu quelques-unes de leurs cabanes construites en pierres non taillées mais disposées avec beaucoup d'art.
Toutes ces cabanes sont rectangulaires avec deux pignons et couvertes par un toit triangulaire surbaissé fait en chaume ou en roseaux. Elles ont rarement plus de dix pieds de haut ; on y entre par une porte basse et étroite assez bien fermée ; les fenêtres sont de petits trous ménagés sur les faces et dont très peu sont garnies d'un morceau de verre.
Ces cabanes ne sont presque jamais réunies en villages : on les trouve disposées par petits groupes dans les vallées et sur les versants des montagnes.
Sur la route de Médéa nous avons vu de ces groupes habités par plusieurs familles. Il en était encore de même dans les montagnes de Somatro et de Beni-Menad ; mais dans la tribu de Beni-Sala les cabanes étaient réunies quatre ou cinq ensemble formant un rectangle dont le milieu était occupé par une cour ; celle qui donnait entrée dans la cour contenait les écuries séparées par une espèce de vestibule dans lequel on passait ; les autres servaient pour loger la famille et serrer les récoltes.
Les alentours de ces cabanes sont assez propres ; on y voit des matmoures ou grands trous coniques pratiqués en terre dans lesquels ils conservent les grains, les légumes et les fruits.
A Beni-Sala nous avons trouvé de ces trous dans l'intérieur des chambres, bouchés avec de larges pierres recouvertes de terre battue.
Les soldats sont descendus dans plusieurs qui étaient remplies de fruits secs et de grands pots en terre cuite contenant du miel, de l'huile, du beurre fondu, des légumes secs et du couscoussou.
Dans presque toutes les chambres il y avait de grands vases faits en terre glaise séchée au soleil et dont l'épaisseur des parois n'était que de trois à quatre millimètres. Ces vases étaient remplis de grains que l'on pouvait retirer au moyen d'une large ouverture pratiquée à la partie inférieure ; ils étaient appuyés contre le mur ou contre de gros piliers en bois et fixés avec deux liens de fer placés l'un au milieu et l'autre à la partie supérieure terminée par un bourrelet de la même matière que le vase.
Nous avons vu aussi dans l'intérieur des chambres :
- des jattes pleines de lait,
- des pots de beurre et de miel,
- de l'orge dans les coins,
- des tas de petites pommes de terre.
Les ruches des mouches à miel, placées dans les vergers, autour des maisons, étaient faites avec des écorces de liège ou des roseaux liés entre eux.
Tout l'ameublement d'une maison des Berbères se compose de :
- deux pierres destinées à moudre le grain,
- de quelques paniers en roseau grossièrement faits,
- de pots en terre,
- de nattes en jonc
- et de peaux de mouton étendues sur le pavé et qui leur servent de lit.
Quelquefois il existe aux deux extrémités de la chambre des estrades élevées de deux pieds au-dessus du sol en bois ou en maçonnerie et sur lesquels ils placent les peaux de mouton et la natte de jonc qui leur servent de matelas mais nulle part, je n'ai vu de lit.
Les Berbères dorment bien sans cela : Ceux qui viennent au marché d'Alger couchent sur le pavé, au milieu de la rue, ou sur les terrasses des maisons dans le faubourg de Bab-Azoun ; la seule précaution qu'ils prennent est de s'envelopper en se cachant la tête dans la pièce de laine qui leur sert de vêtement.
Dans une cabane de Beni-Sala nous avons cependant trouvé une glace enfermée dans un cadre en bois doré, un petit vase d'émail et plusieurs boîtes peintes de différentes couleurs : c'est probablement la demeure d'un des principaux de la tribu. Toutes les maisons que nous avons visitées étaient meublées de la même manière. J'ai été assez surpris de trouver dans chacune un Coran écrit à la main et en lettres de plusieurs couleurs. En fuyant les habitants avaient peut-être laissé ce livre sacré à dessein pour préserver leur maison de la fureur du soldat.
Ces maisons sont fort étroites ; les femmes, les enfants et beaucoup de provisions se trouvent réunis dans la même pièce et de là résulte une odeur extrêmement désagréable qui est la même partout et qui vous suffoque en entrant : du reste c'est la même chose chez les paysans des Vosges et de plusieurs autres parties de la France.
A Beni-Menad, Sumata etc. les cabanes des Berbères sont construites au milieu de broussailles ; à peine y a-t-il autour quelques portions de terrain cultivé ; mais dans les montagnes de Beni-Sala, de Beni-Meissera etc., chaque groupe de cabanes est situé dans un verger planté de toutes sortes d'arbres et dont une partie sert de potager.
Je n'ai point vu de mosquées dans le pays mais çà et là quelques tombeaux de marabout identiques avec ceux des Arabes.
Costumes
L'habit des Berbères le plus simple se compose d'une espèce de chemise de laine à manches très courtes, liée à la ceinture avec une corde ; ils ont sur la tête une petite calotte blanche en feutre, assez semblable à celles de nos prêtres ; ils marchent presque toujours jambes et pieds nus.
Les chefs portent des babouches et des bottes rouges avec des éperons dans les grandes occasions et surtout quand ils vont à la guerre, ils mettent l'haïk qui est une pièce de laine blanche d'un mètre de large et de cinq ou six de long qui peut être comparée à la toge dans laquelle ils s'enveloppent en se drapant avec une élégance vraiment remarquable.
L'haïk passe autour de la tête où il est fixé par un cordon en laine brune qui forme jusqu'à quatre cercles placés au-dessus les uns des autres.
Lorsqu'il fait froid ils mettent le bernous comme les Arabes.
Le bernous est un manteau en laine blanche ou brune, portant un capuchon pointu, cousu à l'endroit de l'agrafe que les Berbères, les Arabes et en général tous les Algériens mettent pendant l'hiver et qu'ils emportent presque toujours avec eux quand ils sortent. Ces bernous se fabriquent dans toutes les villes et campagnes de la régence d'Alger mais les plus estimées viennent de Tunis ou d'Oran.
Le costume des femmes diffère peu de celui des hommes ; elles ne portent jamais de bernous et se jettent l'haïk sur la tête sans l'attacher.
Elles ne se voilent pas comme les Mauresques et les Arabes ; toutes celles que j'ai vu marchaient pieds-nus et n'avaient rien sur la tête dont les longs cheveux flottaient au gré du vent. Elles portent à leurs oreilles de grands anneaux, quelquefois en or ou en argent mais la plupart du temps en cuivre et même en fer.
Elles se font sur toutes les parties du corps et particulièrement sur les jambes et sur les bras des dessins de différentes couleurs et d'une régularité parfaite ; enfin elles se teignent en rouge avec du henné, les ongles, le dedans des mains et le dessous des pieds.
Leur manière de vivre diffère peu de celle des Arabes, les provisions que nous avons trouvés dans leurs cabanes indiquent de quoi ils se nourrissent ; ils mangent quelque fois du mouton et de la volaille qu'ils font cuire avec du couscoussou : comme ils élèvent un grand nombre de vaches et de brebis ils consomment beaucoup de laitages. Ils mangent des melons, les fruits de leurs arbres et ceux qui viennent dans les haies.
Leur boisson ordinaire est de l'eau pure, le vin leur est inconnu. Ils mangent les raisins et les font aussi sécher au soleil pour leur provision d'hiver et ils en apportent une grande quantité au marché d'Alger.
Ils ne font point de pain ; les femmes après avoir écrasé le grain entre deux pierres délaient la farine dans l'eau, sans la tamiser auparavant et en fabriquant une galette qu'elles mettent à cuire sous la cendre ou dans un plat de terre avec de l'huile rance. J'ai souvent passé plusieurs heures au milieu des Berbères qui venaient vendre des denrées à Alger, je les ai vu faire leur cuisine et la manger ; quelques-uns allaient dans les fondouks, espèces d'auberges ; mais le plus ordinairement, ils se réunissaient cinq ou six ensemble dans une partie renforcée de la rue ; là, ils mangeaient bien souvent sans pain des melons des figues de Barbarie, des poivres longs cuits dans l'huile rance etc.
Quand ils voulaient se régaler ils plaçaient sur trois pierres un pot de terre sous lequel ils faisaient du feu avec de petits morceaux de bois ; ils mettaient dans ce pot :
- un peu de graisse de mouton ou de mauvaise huile,
- des tomates,
- des oignons,
- des poivrons longs,
- du maïs vert,
- plusieurs sortes d'herbes aromatiques,
- enfin de la viande coupée en très petit morceaux.
Le pot ainsi rempli était recouvert avec un plat en terre dont le fond était troué comme une écumoire et dans lequel il n'y avait du couscoussou autant qu'il pouvait en tenir.
Les choses ainsi disposées et le feu toujours bien entretenu, le couscoussou sans être bouché cuisait à la vapeur du mélangé placé dans le pot inférieur.
Quand il était bien cuit on versait le tout dans un grand plat autour duquel les compagnons s'accroupissaient et mangeaient en prenant avec la main pour porter à la bouche.
Le repas fini ils se passaient une cruche d'eau dont ils buvaient et se lavaient la moustache ; ensuite ils s'enveloppaient dans leurs vêtements et se couchaient sur la place même où ils avaient soupé.
Industries
C'est bien certainement le peuple le plus habile de tous ceux qui habitent la régence d'Alger ; il exploite les mines de ses montagnes et obtient ainsi du plomb, du cuivre et du fer.
Avec le plomb les Berbères font des balles pour la guerre et la chasse aux fauves ; avec le cuivre quelques-uns des ornements que portent les femmes ; on prétend même qu'ils travaillent l'or et l'argent : le fait est que leurs armes sont souvent décorées de plaques d'argent parfaitement travaillées et qu'ils fabriquent une grande quantité de fausse monnaie qu'ils apportent à Alger et dans d'autres villes de la régence.
Les minerais de fer après avoir été fondus sont convertis en métal malléable au moyen de martinet.
Avec ce fer ils fabriquent des canons de fusil, des instruments aratoires et beaucoup d'ustensiles grossiers qu'ils vendent aux Maures et aux Arabes.
Ils savent convertir le fer en acier et font des couteaux, des sabres et autres instruments tranchants, peu élégants mais d'une assez bonne qualité.
Ils fabriquent de la poudre pour leur usage mais ils n'en vendent jamais. Cette poudre est beaucoup plus estimée que celle qu'on faisait à Alger. Je crois devoir faire observer ce que la fabrication de poudre exige de connaissances pour l'extraction du salpêtre ; les proportions du mélange, la manipulation qui annoncent que les Berbères sont beaucoup plus instruits qu'on le pense généralement.
On les voit venir vendre dans les villages et aux foires qui se tiennent dans la plaine de la Métidja un savon noir qu'ils font avec de l'huile d'olives et de la soude qu'ils retirent des varechs.
Les femmes aident leurs maris dans les travaux de l'agriculture mais elles sont plus particulièrement chargées du ménage. Pendant l'hiver et à leurs instants de loisir, elles filent et tissent l'étoffe blanche qui sert à vêtir les deux sexes ; elles font aussi une grosse toile de lin que l'on emploie à plusieurs usages.
Les tribus qui habitent sur le bord de la plaine ou dans les grandes vallées ont beaucoup de bestiaux ; leurs moutons sont petits et elles en retirent peu de laine. Elles ont une grande quantité de chèvres dont elles mangent la chair et boivent le lait.
Leurs vaches et leurs bœufs sont d'une espèce très petite mais leurs ânes et leurs mulets sont les plus beaux et les meilleurs de toute la Barbarie ; ils n'ont point de chameaux ce qui provient, sans doute, de ce que cet animal est mal constitué pour marcher dans les montagnes.
Nous avons trouvé chez eux les mêmes espèces de volailles que dans les environs d'Alger et en grande quantité.
L'agriculture
Les Berbères sont beaucoup plus avancés en agriculture que les Arabes et les Maures ; nous avons vu dans les montagnes de Belida (Blida) des vergers parfaitement tenus et des champs aussi bien cultivés qu'en France : ils savent disposer l'eau des fontaines pour arroser leurs jardins et pratiquent autour de certains arbres comme les orangers de petits réservoirs circulaires pour recevoir l'eau nécessaire à leur arrosement.
Ils cultivent la vigne à peu près comme on le fait dans les environs d'Alger ; ils ne font point de vin mais mangent les raisins et les portent vendre dans les villes ; ils en mettent à sécher au soleil une grande partie qu'ils conservent pour l'hiver.
Ils ont aussi beaucoup de figuiers dont ils mangent les fruits frais et secs.
Après avoir fait sécher les figues au soleil ils les pressent entre deux planches et en font une espèce de pain qu'ils apportent vendre à Alger.
Mais l'olivier est l'arbre qui est le plus particulièrement l'objet de leurs soins ; ils savent le greffer et lui font produire ainsi de très beaux fruits. Les olives sont employées à faire de l'huile qui a toujours un goût acre : on s'en sert :
- pour manger,
- faire du savon,
- filer la laine,
- conserver les olives elles-mêmes ; pour cela on remplit des vases d'olives quand elles sont bien mûres et on verse de l'huile dessus jusqu'à ce qu'elles soient toutes couvertes ; on bouche ensuite ces vases avec du plâtre ou de la terre glaise et elles se conservent ainsi pendant une année entière.
Ces olives sont si âcres, qu'il est impossible d'en manger ; cependant c'est un grand régal pour tous les habitants de la Barbarie. Je ne sais pas de quelle manière les Berbères fabriquent leur huile, mais comme elle est extrêmement âcre, il est possible qu'ils laissent fermenter les olives avant de les presser.
Ils recueillent aussi des amandes et des noix qu'ils mangent et qu'ils vendent mais ils ne les emploient pas à faire de l'huile : celle d'olive paraît suffire à leurs besoins.
Les arbres fruitiers,
- poiriers,
- pommiers,
- abricotier,
- pêchers sont cultivés avec soin dans les montagnes du petit Atlas : c'est de là que provenaient les plus beaux fruits que j'ai vu pendant tout le temps que je suis resté dans la Barbarie.
Les céréales ne sont pas autant cultivées par les Berbères que par les Noirs ou les Arabes. Ils sèment du blé, de l'orge qu'ils apportent vendre à Alger.
Mais l'olivier est l'arbre qui est le plus particulièrement l'objet de leurs soins ; ils savent le greffer et lui font produire ainsi de très beaux fruits.
Commerces
Les Berbères viennent vendre dans toutes les villes de la Régence et les foires qui se tiennent au milieu de la campagne à certaines époques, les outils et les ustensiles en fer et en acier qu'ils fabriquent. Ils y apportent aussi du savon noir, des fruits secs et frais et des olives confites. J'en ai souvent vu venir à Alger avec des mulets chargés de dattes qu'ils apportent jusque des contrées qui avoisinent le désert, à dix et même douze jours de marche d'Alger.
Ils vendent aussi des bestiaux, vaches, bœufs et moutons mais je ne les ai jamais vus vendre des chevaux ni de mulets. Ils nous apportaient beaucoup de volailles mais seulement des poules, poulets et pigeons.
Ils chassent les tigres, les lions et quelques autres bêtes sauvages pour vendre la peau.
Presque tous les singes que nous avions à Alger étaient apportés par eux.
Quoique Oran ne soit guère plus éloigné du petit Atlas qu'Alger, je n'ai jamais vu de Berbères venir dans cette ville pendant le temps que je l'ai habitée ; des officiers français qui y sont restés plus de sept mois m'ont dit n'en avoir jamais vu non plus.
Le principal commerce des Berbères consiste dans l'huile d'olive et la cire ; ils élèvent une grande quantité de mouches à miel dont ils apportent le miel et la cire dans les villes. Avant l'arrivée des Français ils étaient obligés de vendre leur cire au Dey.
Pour transporter l'huile, ils la mettent dans des peaux de chèvres ou de mouton dont ils ont lié les jambes et le cou. Ils chargent ces outres ainsi remplies sur des mulets ou des chevaux et les mènent dans la ville.
A Alger les marchands d'huile sont à la porte des fondouks (auberges) rue de Bab-Azoun : à leur arrivée, ces peaux étaient vidées dans de grands pots de terre cuite et on mesurait l'huile avec un instrument de fer blanc pour la distribuer aux acheteurs. Nous payions cette huile seize et dix-huit sous la bouteille.
Les peaux dans lesquelles on l'apporte ont le poil en dehors et s'en trouvent tellement imprégnées que les marchands, en les transportant, se graissent si bien, que leurs habits et leur corps sont dégoûtants.
L'industrie et la grande activité des Berbères font qu'ils gagnent beaucoup d'argent, surtout depuis l'arrivée des Français dans la Barbarie. Mais cet argent ne sert point à améliorer leur existence, ils l'enfouissent dans la terre : c'est du reste une manie commune à toutes ces peuplades qui habitent la régence d'Alger ; les Maures eux-mêmes qui vivent dans les villes et avec une espèce de luxe en sont possédés.
Les seuls objets que j'ai vu acheter aux Berbères sont :
- quelques morceaux de calicot,
- de petits mouchoirs et bandeaux pour femmes, faits avec des fils d'agavé (de ses feuilles on obtint du chanvre),
- des bijoux en similor (laiton mélangé à du zinc utilisé en bijouterie fantaisie),
- des verroteries,
- beaucoup de plats en bronze d'Alger,
- des vieux tapis,
- des nattes en jonc,
- des gamelles en bois,
- et quelques pots de terre.
Quand nous leur laissions examiner nos armes, ils ne manquaient jamais de nous demander si nous voulions les vendre, et bien souvent ils montraient l'argent et les objets qu'ils donneraient en échange : mon fusil à pistolet excitait surtout leur admiration ; ils ne cessaient de me répéter qu'il n'y avait que les Chrétiens capables de faire des armes aussi parfaites, et ils m'en ont offert jusqu'à deux cents francs.
Un négociant de Marseille, établi à Alger s'était avisé de leur vendre des armes en cachette ; il en avait un très grand débit et s'il n'eût pas été découvert, je suis persuadé qu'il aurait gagné beaucoup d'argent à ce commerce.
Si on n'avait rien à redouter de ce peuple on ferait un grand commerce d'armes et de munitions avec eux ; il n'y aura peut-être pas d'inconvénients dans quelques années d'ici.
Les Berbères viennent à Alger pour cultiver la terre, les jardins, et servir comme domestiques chez les Maures, les Turcs et les consuls européens ; j'en ai même vu quelquefois chez les Juifs ; ils font aussi le métier de porte-faix (piskeris).
Sous le règne du Dey, les Berbères qui venaient travailler à Alger et dans la campagne autour de cette ville étaient payés cinq sous par jour et quatre petits pains noirs qui valent deux sous les quatre.
Les Européens qui en ont à leur service m'ont assuré que c'étaient d'excellents domestiques, et sur la fidélité desquels on pouvait se reposer.
Quand les Berbères veulent quitter leurs montagnes pour aller travailler dans les villes, ils se réunissent le plus souvent qu'ils peuvent et vont trouver un Marabout qu'ils prient de les accompagner jusqu'à l'endroit où ils désirent se rendre, cela parce que leurs tribus étant presque toujours en guerre les unes contre les autres ils ne pouvaient les traverser sans être attaqués s'ils n'étaient conduits par un Marabout.
Voyage dans la régence d'Alger par M. Rozet,
Capitaine au corps royal d'État-Major. Tome second 1833
|
|
| Les Juifs
Envoyé par M. Christian Graille
|
Ils se sont probablement réfugiés en Afrique comme dans les autres parties du monde après la destruction de Jérusalem et la ruine de la Judée par l'empereur Vespasien.
Tous les Israélites sont enfermés dans l'intérieur des villes et logés dans des maisons qui sont meublées comme celles des Maures. Les habitations des gens aisés sont propres et tenues avec luxe, mais il en est tout autrement de celles du peuple.
J'ai vu jusqu'à douze familles réunies dans la même maison dont chacune ne possédait qu'une chambre dans laquelle on faisait tout ce qui concerne le ménage et où couchaient le père, la mère et jusqu'à six enfants.
Le costume se compose d'une large culotte qui ne descend pas plus bas que le genou et laisse toute la jambe nue, de deux vestes, dont l'une est à manches longues, brodée en soie ; elles sont toujours noires ou d'une couleur foncée. Quand il fait froid ou qu'ils vont en voyage ils mettent un burnous. La ceinture qu'ils portent est toujours bleue ou d'une couleur foncée ; il leur était défendu d'en avoir de rouge.
Ils ont la barbe longue et les cheveux rasés mais, au lieu d'un turban, il leur est permis de porter un bonnet bleu en laine autour duquel ils enveloppent un mouchoir noir de soie ou de coton.
Ils ne marchent jamais pieds nus ; ils ont toujours des babouches.
Tous ont une chemise de toile ou de calicot par-dessus leurs habits.
Le costume des femmes, réduit à sa plus simple expression, se compose d'une robe de laine noire ou bleue, très large, à manches courtes, qui descend jusqu'à terre sous laquelle elles ont une chemise blanche et un caleçon qui leur vient jusqu'aux genoux.
Elles portent de petites sandales en cuir ou en maroquin.
Toutes les juives portent les cheveux aussi longs qu'elles peuvent les avoir.
Elles les enveloppent dans un fichu de soie ou de coton qui forme la coiffure la plus simple.
Elles ont le visage découvert ; quand elles vont se promener ou sortent dans la rue elles jettent sur leurs épaules une gaze de laine blanche, qu'elles relèvent avec coquetterie en la prenant de la main gauche pour se cacher la moitié du visage.
Tout comme les Musulmanes elles se teignent avec du henné les ongles, le dessous des pieds et le dedans des mains ce qu'elles font au moins une fois par semaine.
Manière de vivre
La boisson ordinaire des Juifs est de l'eau mais ils font aussi usage du vin et de liqueurs.
Ils mangent beaucoup de viande et font des ragoûts dans lesquels ils mettent :
- de la viande,
- des tomates,
- des piments,
- plusieurs espèces d'herbes.
Ils aiment le couscoussou et chaque famille en prépare une certaine quantité, pendant l'été, pour sa provision.
Les Juifs sont les Algériens qui mangent le plus de pain ; ce pain renferme toujours du cumin ; il est extrêmement compact et peut se garder longtemps.
Ce pain est fabriqué de la façon suivante :
- On fait, sans levain, avec de la farine et de l'eau tiède une pâte très dure dans laquelle on met des grains de cumin ;
- on place ensuite cette pâte sur une table qui porte un levier fixé sur elle par une de ses extrémités de manière à ce que le bras puisse prendre un mouvement demi-circulaire.
- Une femme place la pâte sous le levier et une autre tenant l'extrémité du bras appuie fortement dessus ; à mesure que celle-ci relève le levier celle qui tient la pâte la retourne et cette manœuvre continue jusqu'à ce que le morceau soit parfaitement pétri ;
- alors on en fait plusieurs petits pains ronds que l'on porte au four.
- Les Juifs mangent toujours quelque chose avec leur pain :
- un morceau de poisson salé trempé dans l'huile,
- du fromage,
- des confitures,
- des tomates,
- des poivrons
et durant la saison,
- des pastèques,
- des melons,
- des figues de Barbarie.
Ils aiment le café qu'ils boivent plusieurs fois par jour.
Le couscoussou et la viande de mouton frite dans l'huile et conservée dans des pots sont avec les pommes de terre les principales provisions d'hiver.
Les gens aisés font des liqueurs, du vin et plusieurs sortes de confitures :
- abricots,
- coings,
- raisin,
- melon etc.
Pour prendre leurs repas les femmes et les hommes s'accroupissent ensemble autour d'une table ronde et basse et chacun se sert dans le plat avec ses doigts ; dans certaines familles on se sert de cuillers et de fourchettes.
En Afrique et ailleurs le peuple d'Israël ne s'occupe pas du tout de l'agriculture ; le commerce est sa principale industrie.
A Alger et dans d'autres villes de la régence j'ai vu des Juifs exerçant des métiers :
- de ferblantiers,
- de vitriers,
- de tailleurs,
- de chaudronniers,
- de fondeurs
A Alger quelques horlogers et bijoutiers.
Dans chaque ville il y a un certain nombre de bouchers qui refusent de faire usage de la viande de bêtes tuée par les Musulmans ou les Chrétiens.
Dans Alger, Oran, Bône et d'autres villes des juifs qui sont banquiers et font des affaires avec l'Europe et l'Asie ; mais en général ils s'occupent de commerce.
Ils ont des boutiques dans de nombreuses villes.
Le métier de courtier est uniquement exercé par les Juifs.
Beaucoup de Juifs sont musiciens et se louent pour jouer dans les cafés, les noces et aux jours de réjouissances. Leurs instruments sont des guitares algériennes qui n'ont que deux cordes ; ils ont aussi des guitares et des violons qu'ils font venir d'Espagne.
Dès que les Turcs se furent rendus maîtres de la régence d'Alger, les Juifs perdirent une grande partie des avantages qu'ils avaient et qu'ils prétendent avoir été accordés par leur grand rabbin Simon.
On toléra leur religion et on permit aux rabbins de leur administrer la justice ; mais dans chaque ville, un quartier particulier leur fut assigné pour habiter avec défense d'aller loger chez un autre.
- On les obligea à prendre des vêtements noirs et de couleur foncée ;
- l'usage de se couvrir le visage fut interdit aux femmes ;
- on défendit aux hommes de monter à cheval et de porter des armes, et toutes les fois qu'ils se trouvaient quelque part avec un Musulman, ils devaient lui céder le pas.
- Souvent lorsque les janissaires les rencontraient dans les rues, ils les accablaient de coups sans qu'ils osassent se défendre ; leur seule ressource état de s'enfuir à toutes jambes quand ils pouvaient y parvenir ; jamais ils ne se plaignaient.
- Lorsqu'ils se présentaient à une fontaine ils étaient obligés d'attendre que tous les Mahométans fussent partis pour pouvoir puiser de l'eau.
- Ils étaient exclus de tous les lieux publics fréquentés par les Musulmans, à l'exception des bazars.
- Quand un juif rencontrait un Turc il le saluait en se courbant.
Les janissaires s'autorisaient de grandes libertés : dans les campagnes ils entraient dans les maisons buvaient, mangeaient, courtisaient les femmes et prenaient tout ce qui leur faisait plaisir.
Tel est l'état de servitude dans lequel nous avons trouvé les Israélites lors de notre arrivée.
Religion
Les Turcs en opprimant le peuple d'Israël ne l'ont point privé du libre exercice de la religion de ses pères ; dans les villes il y a des synagogues (chenovas) où il se réunissait le samedi et aux époques solennelles en toute liberté ; il était même défendu, sous peine d'être puni de troubler ces réunions.
Un Juif prie Dieu soir et matin chez lui ; très souvent, il monte sur sa terrasse, au soleil levant, avec un voile de laine blanche sur la tête. Après avoir fait face à l'orient il récite ses prières.
Les travaux cessent le vendredi à six heures du soir et on se rend à la chenova pour assister à l'office qui se célèbre entre six et sept.
- Leurs livres de prières sont en hébreu.
- Les femmes n'ont pas obligation d'aller à la synagogue où elles occupent des tribunes séparées de celles des hommes.
Il y a six grandes fêtes par an qui durent plusieurs jours.
La première c'est le commencement de l'année qui arrive vers le milieu de septembre (Tischeri). Pendant les deux premiers jours on ne fait absolument rien, et on assiste aux offices.
Le dixième jour (Kippour, ou fête du pardon), on va le soir à la Chenova et on y reste pendant deux heures.
Le lendemain on y retourne à quatre heures du matin, hommes, femmes et enfants et l'on y reste jusqu'à sept heures du soir, sans boire ni manger : puis chacun retourne chez soi faire un bon repas, qui a été préparé d'avance.
Après ce jeûne, chacun fait des cabanes en roseau sur sa terrasse ou dans sa cour. Le 15 commence la fête des tabernacles : on y soupe dans la cabane où toute la famille se réunit.
C'est la troisième fête qui dure sept jours consécutifs : les affaires et le travail sont interdits pendant les deux premiers seulement.
Le deuxième mois Cheschvan n'a point de fête mais le troisième keslav en a une qui commence le 25 et dure huit jours : cette fête a été instituée en expiation de la profanation du temple par Antiochus Épiphane (Roi de l'une des branches de l'ancien empire d'Alexandre le Grand).
Chaque famille met à la porte de la chambre qu'elle occupe un chandelier à huit branches ; le premier jour on y allume une seule chandelle et ainsi de suite chaque autre jour. On peut travailler pendant tout le temps que dure cette fête ; elle se termine par une belle cérémonie qui se fait à la Chenova où tout le monde se rend en grande toilette.
Ce jour-là les tribunes de femmes sont remplies ; tous les hommes et les enfants ont un cierge à plusieurs branches dans la main ; quelques-uns ont de l'eau de rose dans des flacons qu'ils jettent en petite quantité sur les assistants.
Quand on a chanté les psaumes, on porte en triomphe l'Ancien Testament enfermé dans des étuis d'argent et l'on va le déposer sur la chaire, à côté des rabbins où chacun s'empresse de monter pour le toucher.
Les deux mois suivants, Thebat et Schebat n'ont pas de fête remarquable mais le sixième Adar en a une qui dure deux jours, le 14 et le 15 ; on ne travaille pas on va à la Chenova, on fait des aumônes aux pauvres mais en même temps on s'amuse et on fait bonne chère.
Cette fête a été instituée en mémoire de la révocation obtenue par Esther de l'édit de mort qu'Assuérus (Roi de Perse) avait lancé contre les Juifs.
Le 15 de Nisan qui est le septième mois de l'année commence la Pâque qui dure huit jours pendant lesquels on ne mange point de pain, mais une galette préparée sans sel et sans levain.
Les deux premiers jours et les deux derniers il est défendu de toucher de l'argent et de travailler mais pendant les autres on peut vaquer à ses affaires.
Tous les jours l'office se célèbre à six heures du matin.
Le 6 et le 7 de Sévan, on célèbre la Pentecôte en mémoire de la loi donnée sur le mont Sinaï.
Les trois autres mois : Themouz, Ab, Eloul n'ont point de fête mais le 9 de Ab est l'anniversaire de la prise de Jérusalem par Titus : ce jour-là tout le monde jeûne et reste plongé dans l'affliction.
On trouve une grande vénération pour les morts ; on visite les tombeaux où l'on prie en poussant des sanglots, appelant à haute voix ceux qui y sont enfermés. Voici la description de l'enterrement d'un Rabbin qui est la cérémonie funéraire la plus complète :
Le corps du défunt était placé sur un brancard et porté par quatre hommes.
Deux hommes portaient des cierges allumés de chaque côté du mort ; ses fils et ses parents suivaient enveloppés de leur bernous dont le capuchon était rabattu jusque sous leurs yeux.
Plusieurs Rabbins accompagnaient les fils de leur collègue. Au tombeau du Grand Rabbin (Simon Ben-Smis) les porteurs ont déposé le corps à côté de la tombe et tous les assistants ont ôté leurs souliers et sont allés la baiser.
L'assistance a chanté une prière puis tous les assistants se sont accroupis en rond autour du brancard. L'un des Rabbins d'une voix très émue a prononcé l'oraison funèbre suivie d'une quête.
La cérémonie funéraire ne se termine pas là : huit jours après, un Rabbin va faire une prière sur la tombe et au bout de 30 jours, 90 jours et 330 jours la femme va prier et pleurer sur le tombeau de son mari.
A toutes les fêtes de l'année et particulièrement à celle de l'an, chacun va prier et pleurer sur les tombeaux des siens.
L'éducation des enfants est faîte par les Rabbins dans les Chenovas ; Là on ne reçoit que les garçons ; il y a plusieurs degrés :
- dans le premier, sont reçus les enfants de quatre à huit ans ; ils n'apprennent qu'à lire en commençant par épeler dans des livres.
- Au second on enseigne l'Ancien Testament et l'histoire des différents peuples ;
- enfin dans les écoles du troisième degré les jeunes apprennent à écrire et à calculer avec des caractères hébraïques.
Les familles riches envoient aussi leurs enfants, quand ils ont terminé leur éducation chez eux, en Europe, surtout en Italie, pour apprendre le commerce et la langue.
Toutes les prières se font en hébreu mais la langue des Juifs de Barbarie est l'Arabe. Dans toutes les villes de la côte hommes et femmes parlent la langue franque (un composé d'espagnol, d'italien et d'arabe) dont ils font usage pour leurs relations avec les Européens.
Les jeunes filles ne savent ni lire, ni écrire ; il y a cependant des espèces d'écoles tenues par des femmes dans lesquelles elles apprennent à coudre et à broder. Chez elles, leurs mères les exercent aux travaux du ménage.
Les mœurs des Juifs sont assez douces : ils passent presque tout leur temps à s'occuper de leurs affaires et à remplir leurs devoirs religieux ; ils ne sont pas libertins ni débauchés ; l'hospitalité est leur plus grande vertu.
Voyage dans la régence d'Alger par M Rozet,
capitaine au corps royal d'État-Major. Tome second 1833
|
|
| Kabyles
Envoyé par M. Christian Graille
|
Depuis l'embouchure du Chélif jusqu'à celle du Mazafran, c'est-à-dire sur une longueur de soixante lieues et sur une profondeur de dix ou douze, s'élève, se ramifie la chaîne du Dahra.
Celle du petit Atlas s'y rattache par le Zaccar et ferme l'hémicycle de la Mitidja. Arrivé à ce point, le système se rehausse, s'élargit, se complique et garnit toute l'étendue de la côte jusqu'au voisinage de Bône.
Ce n'est pas tout : il faut compter, dans l'intérieur, l'Ouarsenis qui fait face au Dahra, le domine en hauteur et le surpasse en étendue ; puis d'autres grandes masses parallèles aux précédentes et qui séparent le Tell du Sahara comme celles-ci l'ont isolé de la Méditerranée ; tels sont le Djebel Amour, les Aurès, etc.
Ces régions de montagnes embrassent à peu près la moitié du territoire algérien ; elles sont presque toutes habitées par des Kabyles, race ou agglomération de races entièrement distinctes des Arabes.
Les différentes Kabylies n'ont entre elles aucun lien politique ; chacune même ne constitue qu'une sorte de fédération nominale où figurent, comme autant d'unités indépendantes, des tribus riches ou pauvres, faibles ou puissantes, religieuses ou guerrières, et subdivisées à leur tour en fractions, en villages également libres.
Quoiqu'il existe entre elles une frappante analogie de mœurs, d'origine et d'histoire, la disjonction des faits impose la nécessité de les considérer séparément. Autant de Kabylies, autant de pages détachées : il y aura celle des Traras, de l'Ouarsenis, du Dahra, du petit Atlas, du Djudjura et beaucoup d'autres.
C'est la dernière nommée que nous nous proposons d'écrire l'histoire, de la Kabylie du Djurjura, que beaucoup d'écrivains nomment exclusivement la Kabylie, et que nous appellerons, nous, eu égard à son importance relative, la grande Kabylie.
Cette région embrasse toute la superficie du vaste quadrilatère compris entre Dellys, Aumale, Sétif et Bougie, limites fictives, en ce sens qu'elles ne résultent point de la configuration géographique, limites rationnelles au point de vue de la politique et de l'histoire.
Plus qu'aucune autre Kabylie, celle qui va nous occuper, a fixé l'attention publique en France. Diverses causes y contribuèrent :
- son étendue,
- sa richesse,
- sa population,
- son voisinage d'Alger source de quelques relations commerciales,
- sa vieille renommée d'indépendance,
- celle d'inaccessibilité face aux grandes montagnes qui la couvrent.
Les montagnards de l'Afrique septentrionale ne commencent réellement à être appelés Kabyles qu'après l'invasion des Arabes ; ce serait donc dans la langue arabe qu'il faudrait chercher de préférence l'origine de ce nom.
Dès lors on ne peut plus guère hésiter qu'entre les racines suivantes :
Kuebila : tribu.
Kabel : il a accepté.
Kobel : devant.
- La première s'expliquerait par l'organisation même des Kabyles en tribus fédérées,
- La seconde par leur conversion à l'Islam. Vaincus et refoulés, ils n'auraient eu, comme tant de peuples, aucune autre ressource, pour se soustraire aux vengeances du vainqueur, que d'embrasser sa religion. Ils auraient accepté le Koran,
- la troisième n'est pas moins plausible. En appelant les Kabyles ses devanciers, l'Arabe aurait seulement constaté un fait en harmonie avec toutes les traditions, et conforme d'ailleurs au génie de l'histoire qui nous montre toujours les autochtones, puis les races vaincues, refoulées tour à tour dans les montagnes par suite des conquêtes successives de la plaine.
Chez les Kabyles, le mélange de sang germain, laissé par la conquête des Vandales, se trahit maintenant encore à des signes physiques : les étymologistes y joignent quelques rapprochements de noms : Suèves et Zouaouas, Huns et Ouled-Aoun. Etc. (Ouled signifie enfant, descendant. Ouled-Aoun: enfant d'Aoun).
Nous n'insisterons pas davantage sur toutes ces consonances plus curieuses que décisives.
La langue est la vraie pierre de touche des nationalités. Une nation est l'ensemble des hommes qui parlent la même langue.
Cette unité de langage existe, elle établit la parenté la plus certaine entre toutes les tribus Kabyles non seulement de l'Algérie, mais de la côte barbaresque, et cela suffirait pour vider sans retour la question des origines.
Les Kabyles dérivent donc d'un seul et même peuple autrefois compact, autrefois dominateur du pays entier ; mais, plus tard, refoulé dans les montagnes, circonscrit par des conquérants qui s'approprièrent les plaines, et morcelé de la sorte en grandes fractions devenues à la longue presque étrangères l'une à l'autre.
Depuis ce moment, la langue aborigène qu'on nomme, berberia, berbère, ou kebailia, kabyle, dut subir, en chaque point des altérations diverses, par suite du contact plus ou moins fréquent des Arabes, et par l'absorption variable des premiers conquérants européens.
Il en est résulté plusieurs dialectes que voici :
1° le Zenatia : Il existe chez les tribus kabyles qui, remontant vers l'ouest, s'étendent depuis Alger jusqu'à notre frontière du Maroc.
2° le Chellahya : C'est celui dont se servent tous les Kabyles du Maroc.
3° le Chaouiah : Il appartient à toutes les tribus kabyles qui se sont mêlées aux Arabes, et, comme eux, vivent sous la tente, entretiennent de nombreux troupeaux. Comme eux encore, elles comptent plus de cavaliers que de fantassins, et sont nomades sur un territoire délimité.
Naturellement, beaucoup de mots arabes se sont glissés dans ce dialecte ; il est très répandu dans la province de Constantine.
4° Le Zouaouïah : Il est parlé depuis Dellys et Hamza jusqu'à Bône. Il représente l'ancien idiome national dans sa plus grande pureté.
On y remarque toutefois, chez certaines tribus, une légère altération qui proviendrait du commerce avec les Arabes. Aussi sont-elles traitées, par les Kabyles purs, de Kebaïls-el-Hadera, Kabyles de la descente.
Les Romains appelaient Jurjura, mons ferratus, et quinque gentii les habitants de la région environnante. Ce nom qui signifie les cinq nations ou les cinq tribus, si l'on veut, révèle déjà, dans cette haute antiquité, une sorte de fédéralisme analogue à celui des Kabyles actuels.
Plusieurs villes romaines ont existé sur les côtes de la Grande Kabylie : Baga, Choba, Salvae, Rusucurrum. Tour à tour, on les a placées toutes à Bougie que les Européens connaissent depuis longtemps ; mais enfin l'opinion du docteur Shaw, confirmée depuis par la découverte d'une inscription romaine, fixe à Bougie la colonie militaire Salvae.
L'intérieur du pays renferme également quelques ruines de l'ère romaine ou chrétienne. A six lieues environ de Bougie, existe une ville souterraine qui renferme plus de deux cents maisons en briques, bien conservées, avec des rues voûtées et des murs très épais. D'après le dire des Kabyles, cette cité ténébreuse, qu'ils nommaient Bordj-Nçara, le fort des Chrétiens, aurait été bâtie par les Romains à la décadence. Le chef de toutes ces contrées y demeurait, disent-ils, avec ses gardes.
Cependant Les Kabyles ont toujours maintenu leur indépendance contre le gouvernement et descendent probablement de ces anciens Numido-Maurétaniens que n'ont jamais soumis les armes d'aucuns des conquérants de l'Afrique depuis les Carthaginois jusqu'à nos jours.
Ils n'ont pas d'autres séjours que les montagnes occupant toutes les branches de l'Atlas qui vont à l'est et tirent leurs dénominations particulières des noms différents de ces montagnes, tels par exemple : Beni-Chow, Beni-Zeroual, Beni-Zouaouch, Beni-Abbès etc ... ce qui veut dire dans cette langue enfants ou habitants de ces montagnes.
Les us et coutumes particuliers à cette région sont très divers :
- Le Kabyle se rase jusqu'à ce qu'il ait atteint vingt à vingt-cinq ans ; à cet âge il devient homme et laisse pousser sa barbe. C'est l'indice du jugement acquis, de la raison qui devient mûre ; été comme hiver, par la neige ou le soleil il a toujours pieds et tête nus ; ceux qui avoisinent les plaines portent quelquefois la chéchia.
- Le Kabyle a pour tout vêtement la chelouhha, espèce de chemise de laine qui dépasse les genoux et qui coûte de sept à huit francs ; il garantit ses jambes avec des guêtres sans pied, tricotés en laine qu'on appelle bougherous.
- Pour le travail il met un vaste tablier de cuir coupé comme celui de nos sapeurs. Il porte le burnous quand ses moyens le lui permettent ; il le garde indéfiniment sans aucun souci de ses taches ni de ses déchirures ; il l'a tenu de son père, il le lègue à son fils.
Sa maison est construite en pierres sèches ou en briques non cuites qu'il superpose d'une façon assez grossière. Le toit est couvert en chaume, en tuiles chez les riches.
Elle se compose d'une ou deux chambres. Le père, la mère et les enfants occupent une moitié du bâtiment, à droite de la porte d'entrée. Ce logement de la famille se nomme âounès.
L'autre partie de la maison, que l'on appelle âdaïn, située à gauche, sert d'étable, d'écurie pour le bétail et les chevaux.
Si l'un des fils de la maison se marie et doit vivre en ménage, on lui bâtit son logement au-dessus.
Le Kabyle ne croit point au mauvais œil et peu aux amulettes. " Ce qui est écrit par Dieu, dit-il, doit arriver ; il n'est rien qui puisse l'empêcher. ".
Cependant il concède à certaines vieilles femmes un pouvoir d'influence sur les ménages, sur les amours ; il admet les sorts propres à faire aimer, à faire haïr un rival, à faire divorcer la femme que l'on désire, etc.
Ses superstitions d'un autre ordre sont nombreuses :
Quiconque entreprend un voyage doit partir le lundi, jeudi ou samedi ; ces jours sourient aux voyageurs. Heureux celui qui commence sa route le samedi. Le Prophète préférait ce jour aux deux autres. On voyage, il est vrai le mercredi, le vendredi et le dimanche ; mais l'inquiétude ne quitte pas le voyageur pendant sa course.
Ne livrez jamais un combat un mardi.
C'est le jeudi qu'il faut choisir pour introduire sa future sous le toit conjugal ; cela sera d'un bon augure parce que la femme s'y réveillera le vendredi qui est le jour férié des musulmans.
Ne plaignez pas celui qui meurt pendant le ramadan car pendant le ramadan les portes de l'enfer sont fermées et celles du paradis toujours ouvertes.
Voir un chacal en se levant, présage heureux ; deux corbeaux avant de se mettre en route, signe d'un voyage prospère.
Voir un lièvre le soir, mauvais augure ; apercevoir un corbeau seul avant que de se mettre en route, motif d'inquiétude.
Les Kabyles, si incrédules au sujet des sortilèges, le sont moins sur la question des démons. Ils disent qu'il y en a en toute saison, excepté dans le Ramadan, parce que Dieu les force à rester en enfer pendant le mois sacré. Ils les craignent horriblement ; jamais un Kabyle ne sortira la nuit de sa maison sans les conjurer au nom de Dieu, le puissant, le miséricordieux. Il en fera autant quand il passera près d'un endroit où il y a eu du sang versé car les démons qui aiment le sang n'ont pas manqué de s'y donner rendez-vous.
Il existe aussi, si ce n'est un préjugé, du moins un mépris général de l'ânesse et à un tel point que dans certaines tribus un Kabyle pour rien au monde ne voudrait en voir une entrer dans sa maison.
Il travaille énormément et en toute saison ; la paresse est une honte à ses yeux.
Il possède de nombreux troupeaux qu'il fait paître ; il cultive moins de céréales mais s'occupe beaucoup de jardinage. Il passe sa vie à planter, à greffer ; il a chez lui :
- des lentilles,
- des pois chiches,
- des fèves,
- des artichauts,
- des navets,
- des concombres,
- des oignons,
- des betteraves,
- du poivre rouge,
- des pastèques,
- des melons.
Il cultive le tabac à fumer ; il plante des pommes de terre depuis quelque temps ; il possède des fruits de toutes espèces :
- olives,
- figues,
- noix,
- oranges,
- poires,
- pommes,
- abricots,
- amandes,
- raisins.
La principale richesse du pays consiste dans les oliviers dont beaucoup sont greffés et qui atteignent quelquefois les dimensions du noyer. Les olives d'une excellente qualité entrent pour une grande part dans la nourriture des Kabyles mais il en reste énormément à vendre soit comme fruit, soit comme huile. Celle-ci s'exporte dans des peaux de boucs à Alger, à Bougie, à Dellys, à Sétif, sur tous les marchés de l'intérieur.
La terre de labour n'étant pas très abondante, eu égard à la population, les Kabyles n'en négligent aucune parcelle. Ils donnent deux façons à la terre, ils la couvrent d'engrais mais ne lui laissent presque aucun repos ; on la trouve rarement en jachères ; ils ne pratiquent point l'assolement.
Chez eux un des membres de la famille s'expatrie toujours momentanément pour aller chercher fortune ; aussi en trouve-t-on à Alger, à Sétif, à Bône, Philippeville, Constantine, Tunis, partout. Ils travaillent comme
- maçons
- jardiniers,
- moissonneurs
- ils font paître les troupeaux …
Lorsqu'ils ont amassé un peu d'argent ils rentrent au village, achètent un fusil, un bœuf et puis se marient.
- Ils bâtissent leur maison,
- font de la menuiserie,
- forgent des armes,
- des canons,
- des batteries de fusil,
- des sabres (flissas),
- des couteaux,
- des pioches,
- des cardes pour la laine,
- des socs pour les charrues.
Ils fabriquent :
- des pelles,
- des sabots,
- les métiers pour tisser.
Chez eux se travaillent les burnous et les habayas, vêtements de laine, les haïks de femme, les chéchias blanches.
Leur poterie est renommée.
Ils font de l'huile avec les olives qu'ils récoltent dans leur propriété et confectionnent eux-mêmes les meules de leurs pressoirs.
Ils dressent encore des ruches pour les abeilles, font la cire et ne se servent pour les pains que de moules travaillés chez eux. Ils savent cuire les tuiles.
Dans certaines localités on confectionne des dalles de liège. Ils connaissent la chaux ; ils en sont, du reste, fort avares et ne l'emploient que pour blanchir les mosquées et les koubbas des marabouts.
Pour leurs maisons ils utilisent le plâtre qui paraît abonder chez eux. La carrière de Thisi chez les Beni-Messaoud, à une lieue et demie de Bougie, en fournit une grande quantité.
- Ils font du savon noir avec l'huile d'olive et de la soude des varechs ou la cendre de laurier-rose,
- tressent des paniers pour porter les fardeaux,
- confectionnent des nattes en palmier nain ou bien encore
- filent des cordes en laine et en poils de chèvre.
Les femmes ne restent pas oisives ; elles filent la laine et tissent avec cette matière l'étoffe blanche qui sert à vêtir les deux sexes.
Le lin, recueilli en petites bottes, puis séché sur l'aire, est broyé, filé par les femmes, et procure une grosse toile employée à divers usages.
Elles concourent à la confection de burnous qui, dans quelques tribus, Beni-Abbas et Beni-Ourtilan, par exemple, dépassent de beaucoup les besoins locaux et deviennent un objet d'exploitation.
Le Kabyle met tout son luxe dans son fusil. Il le préserve de la rouille, et, quand il le sort de son étui il le tient avec un mouchoir pour ne pas le salir.
Il demeure toujours drapé dans son orgueil. Cet orgueil prête de l'importance aux moindres choses de la vie, impose à tous une grande simplicité de manières, et pour tout acte de déférence, exige une scrupuleuse réciprocité. Il ne fait pas de compliments ; il va baiser la main, la tête du chef ou du vieillard ; mais quelle que soit la dignité, l'âge de celui qui a reçu cette politesse, il doit la rendre immédiatement.
Il regarde le mensonge comme une honte. Il prévient toujours son ennemi, et voilà comment il le fait : le gage de la paix entre deux tribus consiste dans l'échange d'un objet quelconque, d'un fusil, d'un bâton, d'un moule à balles, etc. C'est ce qu'on appelle le mezrag : la lance.
Tout porte à croire qu'avant l'invention des armes à feu, le dépôt d'une lance était effectivement le symbole de trêve et de bonne amitié. Quand une des deux tribus veut rompre le traité, son chef renvoie simplement le mezrag et la guerre se trouve déclarée.
En expiation d'un meurtre commis sur l'un des membres de leur famille il faut que l'assassin meure. Sa fuite ne le sauve pas car la vengeance est une obligation sacrée. Dans quelque région lointaine que le meurtrier se retire la vendette le suit.
Un homme est assassiné, il laisse un fils en bas âge. La mère apprend de bonne heure à ce dernier le nom de l'assassin. Quand le fils est devenu grand, elle lui remet un fusil et lui dit : " Va venger ton père ! "
Si la veuve n'a qu'une fille, elle publie qu'elle ne veut point de dot pour elle, mais qu'elle la donnera seulement à celui qui tuera l'assassin de son mari.
L'analogie est saisissante entre ces mœurs et celles de la Corse, elle se dessine encore davantage dans les traits suivants. Si le vrai coupable échappe à la vendette et lasse sa persévérance, alors celle-ci devient transversale, elle tombe sur un frère ou l'un des parents les plus proches, dont la mort nécessite à son tour de nouvelles représailles.
Par suite, la haine entre deux familles devient héréditaire. De part et d'autre des amis, des voisins l'épousent. Il en sort des factions ; il peut en résulter de véritables guerres.
L'étranger, quelle que soit son origine, est toujours bien reçu, bien traité. Ces égards sont encore plus grands pour le réfugié que rien au monde ne pourrait forcer à livrer. Les Turcs, l'Émir Abd-el-Kader ont toujours échoué dans leurs demandes ou leurs efforts contraires à ce noble principe.
Citons encore une coutume généreuse. Au moment où les fruits, les figues, les raisins, etc., commencent à mûrir, les chefs font publier que, pendant quinze ou vingt jours, personne ne pourra, sous peine d'amende, enlever aucun fruit de l'arbre. A l'expiration du temps fixé, les propriétaires se réunissent dans la mosquée, et jurent sur les livres saints que l'ordre n'a pas été violé. Celui qui ne jure pas paye l'amende.
On compte alors les pauvres de la tribu, on établit la liste, et chaque propriétaire les nourrit à tour de rôle, jusqu'à ce que la saison des fruits soit passée.
La même chose a lieu à la saison des fèves dont la culture est extrêmement commune en Kabylie. A ces époques, tout étranger peut aussi pénétrer dans les jardins et a le droit de manger, de se rassasier, sans que personne l'inquiète ; mais il ne doit rien emporter, et un larcin, doublement coupable en cette occasion, pourrait bien lui coûter la vie.
Le Kabyle, contrairement à la loi musulmane, prête à intérêts, à très gros intérêts, par exemple à 50 pour 100 par mois ; ou bien il achète, à bon marché et à l'avance, les récoltes d'huile, d'orge, etc.
Il aime à jouer de sa petite flûte, et chez lui, tout le monde danse, hommes et femmes, parents et voisins. Les danses s'exécutent avec ou sans armes.
Quand on célèbre le mariage, les parents ou amis du marié tirent à la cible. Le but est ordinairement un œuf, un poivron, une pierre plate. Cet usage donne lieu à une grande explosion de gaieté : ceux qui manquent le but sont exposés à de nombreuses plaisanteries.
Lorsqu'il veut se marier, le Kabyle fait part de son désir à un de ses amis qui va trouver le père de la jeune fille recherchée et transmet la demande.
On fixe la dot qui sera payée par le mari ; car ce dernier achète littéralement sa femme et le grand nombre de filles est regardé comme une richesse de la maison. Ces dots s'élèvent moyennement à une centaine de douros. Il arrive quelquefois que le futur mari ne possède point la somme tout entière ; on lui accorde, pour la réunir, un ou deux mois ; et, pendant ce temps, il peut fréquenter la maison de celle qui doit être sa femme.
Quand il s'est acquitté, il l'emmène en qualité de fiancée, la promène d'abord dans le village, armé d'un yatagan, (sabre turc de 60 à 80 centimètres, à lame recourbée.), d'un fusil ou d'une paire de pistolets puis l'amène sous son toit. Cette cérémonie se fait en grande pompe.
Chaque village a sa musique composée de deux espèces de clarinettes et de tambours. Ces musiciens figurent dans le cortège nuptial ; ils chantent en s'accompagnant ; les femmes font retentir l'air de leurs cris joyeux : you !
You ! You ! On tire une multitude de coups de fusils et les jeunes gens du village, en totalité ou en partie, selon la richesse de l'époux, sont conviés à un grand repas.
La naissance d'un enfant mâle donne lieu à la convocation de tous les voisins et des amis des villages environnants. On fait des décharges d'armes, on tire à la cible. Sept jours après le père donne un grand repas. La circoncision n'a pas lieu avant six ou huit ans, bien qu'elle devienne alors plus douloureuse.
Si c'est une fille qui vient au monde, on ne change rien aux habitudes de la vie, à l'aspect de la maison parce qu'elle n'accroît en rien la force de la tribu.
Lorsqu'une famille perd l'un des siens, tout le village est présent aux funérailles. Personne ne doit travailler ; tous se cotisent, à l'exception des parents du défunt, pour donner l'hospitalité aux Kabyles des autres villages qui sont venus apporter leur tribut à la douleur. Les morts ne sont point déposés dans une bière. Après les avoir soigneusement lavés, on les enveloppe d'une espèce de drap ; puis, on les confie à la terre.
La femme kabyle a une plus grande liberté que la femme arabe. Elle se rend au marché pour faire les provisions de la maison, pour vendre, pour acheter. Son mari aurait honte d'entrer dans de semblables détails.
Contrairement à la femme arabe qui ne peut paraître aux réunions avec les hommes et qui garde toujours son mouchoir ou se voile avec son haïk, la femme kabyle s'assied où elle veut ; elle cause, elle chante, son visage reste découvert. L'une et l'autre portent, dès l'enfance, de petits tatouages sur la figure ; mais le tatouage de la femme kabyle présente une particularité bien remarquable : il affecte ordinairement la forme d'une croix. Sa place habituelle est entre les deux yeux ou sur une narine. On perpétue cet usage sans pouvoir en connaître l'origine qui semble dériver de l'ère chrétienne.
Un fait digne de remarque appuierait cette conjecture en apparence : c'est qu'aucun taleb ou marabout n'épouse une femme, ainsi tatouée, sans lui faire disparaître le signe par une application de chaux et de savon noir.
Mais il convient aussi de remarquer que tous les tatouages sont interdits par le Koran, qui les flétrit du nom de ketibet el chytan, écriture du démon.
La femme kabyle prend ses repas avec la famille ; elle y participe même quand il y a des étrangers.
Abandonnée par son mari, elle rentre à la maison de son père ou de son frère et, tant que son isolement dure, elle jouit d'une entière liberté de mœurs. La femme divorcée se trouve dans le même cas.
Le divorce est très usité mais il est pour ainsi dire livré au caprice du mari. Celui qui veut divorcer dit à sa femme : je te quitte pour cent douros, et la femme se retire avec cette somme chez ses parents.
Si elle se remarie, elle doit rendre l'argent à son premier époux ; mais si elle ne contracte pas de nouveaux liens, elle le conserve en toute propriété pour subvenir à ses besoins.
Ce qui rend cette mesure nécessaire c'est que les filles n'ont aucun droit à l'héritage de la famille. La raison en est que la femme étant forcée de suivre son mari pourrait augmenter les ressources d'une tribu étrangère.
Le Kabyle est d'autant plus riche qu'il a plus de filles, puisqu'il reçoit une dot pour chacune et qu'il ne leur donne jamais rien.
Enfin, non seulement les femmes kabyles sont plus libres, plus considérées, plus influentes que les femmes arabes mais elles peuvent même aspirer aux honneurs et au pouvoir dévolus à la sainteté.
La Koubba de Lella Gouraya, qui domine Bougie, éternise la mémoire d'une fille célèbre par sa science et sa piété. La légende raconte qu'elle revenait, après sa mort, instruire les disciples fidèles qui s'assemblaient encore sur son tombeau.
Il y a dans la Kabylie d'autres koubbas consacrées à des femmes ; et on peut citer comme d'une haute réputation de ce genre, la fille du fameux marabout Sidi Mohamed-Ben-Abder-Rhaman (Sid ou si par abréviation : sieur, seigneur. Sidi : monseigneur. Abd : serviteur ; rhaman : miséricordieux. Abd-er-Rhaman serviteur du miséricordieux.) et Kafnaoui, qui reçoit elle- même les offrandes religieuses au tombeau de son père et que tous les Kabyles connaissent sous le nom de Bent el cheikh (Cheikh : vénérable et par suite, chef.) : la fille du cheikh.
Mœurs et coutumes de l'Algérie, Tell, Kabylie, Sahara
par le général Daumas, Conseiller d'État,
Directeur des affaires de l'Algérie. Édition 1853
|
|
| Les Arabes
Envoyé par M. Christian Graille
|
Les Romains qui s'étaient établis en Afrique après la fin de la troisième guerre punique, se rendirent maîtres, peu à peu de toute la partie septentrionale de ce continent qu'ils gardèrent jusqu'au règne de l'empereur Valentinien. Boniface, qui gouvernait les provinces d'Afrique pour ce prince, voulant se révolter contre lui, appela à son secours les Vandales qui s'étaient emparés de l'Espagne ; ceux-ci passèrent le détroit de Gibraltar sous la conduite de Gontharis et se répandirent dans toutes les possessions romaines qu'ils dévastèrent une grande partie.
Boniface, ayant compris qu'au lieu d'auxiliaires il s'était donné des maîtres, fit tous ses efforts pour renvoyer Gontharis avec son armée ; celui-ci refusa en disant que le pays qu'il avait conquis lui appartenait.
Le Romain marcha alors contre les Vandales avec toutes les troupes qu'il put rassembler ; mais il fut vaincu et forcé de s'enfermer dans Hippone où ils l'assiégèrent. Ayant été complètement battu dans une sortie qu'il avait tentée en désespoir de cause, il fut obligé de se sauver et d'abandonner l'Afrique.
Les Vandales, poursuivant alors leur victoire, chassèrent les Romains et se rendirent maîtres de tout le pays. Le chef des barbares se reconnut tributaire de l'Empereur et vécut en très bonne intelligence avec lui. Sous le règne de Justinien, Gélimer, roi des Vandales, ayant usurpé le trône sur son neveu, l'Empereur envoya contre lui Bélisaire (général byzantin) qui débarqua en Afrique à la tête d'une puissante armée, vainquit Gélimer et détruisit son armée à Tricamare près de Carthage.
Le Vandale se sauva dans les montagnes, mais étroitement bloqué et réduit à la plus affreuse misère, il fut obligé de se rendre. Bélisaire, après avoir envoyé ses lieutenants depuis Carthage jusqu'aux confins de l'empire du Maroc, pour chasser les Vandales et soumettre le pays, retourna à Constantinople avec Gélimer et ses autres prisonniers, et la puissance romaine se trouva ainsi rétablie en Afrique mais comme les soldats de l'Empire se révoltèrent plusieurs fois et qu'ils contractèrent des alliances la colonie tomba dans un état d'épuisement plus grand que jamais.
Les Arabes qui s'étaient emparés de l'Égypte menaçaient les provinces romaines qui avaient déjà consenti à leur payer un tribut pour ne point être inquiétées par eux ; mais en 397 ces conquérants s'avancèrent jusqu'aux portes de Carthage en ruinant les villes et en dévalisant tout le pays. Jean, général de l'Empereur Léonce arrêta les progrès des Mahométans et les força à abandonner tout ce qu'ils avaient pris sur les Romains ; mais ce mauvais succès ne les rebuta pas ; ils rassemblèrent une nouvelle armée, équipèrent une puissante flotte dans le port d'Alexandrie et vinrent attaquer les Romains en même temps par terre et par mer.
Jean, pressé de toutes parts, ne put résister et fut obligé de retourner à Constantinople avec le peu de troupes qui lui restaient. Rien ne s'opposant plus aux progrès des Arabes ils s'emparèrent de la province romaine et bientôt de toute la Maurétanie. Les habitudes des nouveaux venus différant peu de celles de Maures, ils ne tardèrent pas à vivre en bonne intelligence avec eux, et à leur faire abandonner le christianisme pour la religion de Mahomet.
Les Numides, restés dans leurs montagnes, se tinrent en garde contre les Arabes et ne voulurent point contracter d'alliance avec eux.
Les Goths conservaient encore quelques places sur la côte mais ils en furent chassés et les Arabes se trouvèrent ainsi possesseurs de tout le pays que les Romains avaient occupé, dans lequel la régence d'Alger se trouve comprise toute entière. Les Numides, guerriers et turbulents attaquèrent souvent les Arabes. Les Maures opprimés par les nouveaux venus se révoltèrent plusieurs fois ; mais les uns et les autres furent toujours vaincus et enfin obligés de se soumettre comme tous les pays subjugués par les hommes venus du centre de l'Asie et qui, sans le bras de Charles Martel, auraient envahi l'Europe entière et forcé les habitants à embrasser l'islamisme.
Voilà de quelle manière les Arabes sont venus s'établir dans la Barbarie : quelques-uns ont contracté des alliances avec les Maures, et ainsi altéré leur sang ; mais l'immense majorité, pleine de mépris pour les vaincus, n'a jamais voulu s'abaisser jusqu'à eux, et encore aujourd'hui la race arabe proprement dite est ce qu'elle était dans l'origine.
On peut diviser en deux grandes classes les Arabes qui habitent la régence d'Alger : les cultivateurs attachés au sol et qui logent dans des maisons ou des cabanes plus ou moins mal faites et les Nomades ou Arabes bédouins qui vivent sous des tentes, sans s'assujettir à rester dans aucune contrée. Du reste ce sont les mêmes hommes, parlant la même langue avec un peu plus ou moins de pureté, mais dont la manière de vie diffère beaucoup. Les Arabes sont généralement grands ; leur corps est bien fait et assez charnu, sans être ni gras ni maigre ; ils ont les cheveux noirs, le front découvert, les yeux vifs, la bouche et le nez bien faits, la figure ovale et les traits allongés ; leur peau est brune, quelquefois olivâtre ; j'en ai vu plusieurs qui étaient aussi noirs que des Nègres mais en conservant néanmoins tous les autres caractères de la race arabe. Il n'y a de différence entre les femmes et les hommes que celles que l'on trouve chez tous les peuples : après avoir vu quelques hommes, on reconnaît facilement les femmes à la première vue. Les Arabes sont courageux et fiers ; ils coupent la tête aux ennemis vaincus mais il est rare qu'ils se portent entre eux à des cruautés comme les Berbères et les Maures.
Habitations
Les cabanes des Arabes cultivateurs sont faites avec des branches d'arbres ou des roseaux qui ne sont presque jamais enduits de terre ; elles sont couvertes en paille avec des roseaux ou des feuilles de dattiers. Les cabanes ne sont jamais isolées mais réunies ensemble au nombre de dix ou douze et même quelquefois de quarante, formant ainsi de petits villages, et toujours entourées de haies de cactus auxquels on donne le nom de Dascars.
On trouve assez souvent, au milieu de ces cabanes, des maisons qui sont ordinairement habitées par des cheiks ou des nobles de la tribu : il y a aussi des mosquées construites à chaux et à sable ; mais la plupart du temps, ce n'est qu'une cabane un peu plus grande que les autres qui en sert. Chaque famille possède ordinairement deux cabanes, l'une pour elle et l'autre pour une partie du bétail. Tout l'ameublement consiste dans quelques pots de terre cuite pour faire la cuisine et traire les vaches ; des peaux de mouton ou des nattes de jonc étendues sur le sol et qui servent de lits ; plusieurs outres en peaux de chèvre et de mouton pour mettre l'eau, conserver le lait et le porter à la ville, enfin une lampe de terre haute de 0,50 mètre ; il y a en outre :
- les instruments aratoires,
- un métier à tisser la laine fait avec des morceaux de bois et de roseaux,
- des quenouilles et des fuseaux pour la filer,
- enfin, un moulin pour moudre le grain, composé de deux pierres qui entrent l'une dans l'autre et que l'on tourne avec la main.
Les tentes des Bédouins sont ordinairement faites avec une étoffe noire et blanche, composée de laine et de poils de chameaux. La pièce d'étoffe qui est extrêmement grande est placée sur des morceaux de bois au moyen desquels on lui donne la forme d'un prisme triangulaire, et couvre un espace de quatre mètres de long sur deux ou trois de large, qui sert à loger une famille, composée bien souvent d'un homme, trois ou quatre femmes et cinq à six enfants ; ils couchent là sur des nattes ou des peaux, pêle-mêle les uns avec les autres, et ayant presque toujours le métier à tisser la laine monté au milieu de la tente.
Dans les environs d'Alger, les tentes des Bédouins sont disposées comme il leur plaît et réunies ensemble au nombre de dix à vingt ; mais chez les tribus nomades qui vivent sous l'autorité d'un cheik, toutes les tentes de chaque tribu sont disposées en cercle et forment ainsi ce que les Arabes appellent un douar ; l'espace vide qui reste au milieu est destiné pour les bestiaux qu'on y fait entrer pendant la nuit. Dans chaque tribu, il y a une tente qui sert de mosquée et dans laquelle les hommes se réunissent à l'heure de la prière. Les tentes des Arabes sont toujours dressées de manière à ce que l'air puisse y circuler librement : ce qui fait qu'on y est très bien au frais pendant l'été.
Quand nous fûmes campés dans la presqu'île de Sydi-Efrougj ( Sidi-Ferruch) nous avions recouvert avec de la terre tout le tour des nôtres ; elles se trouvaient ainsi hermétiquement fermées, et il n'était pas possible d'y tenir pendant la chaleur du jour.
Dans l'été, les Bédouins couchent sous la tente ou à l'entour et les bestiaux restent dehors ; mais dans l'hiver on met le bétail à couvert et les familles qui ne possèdent qu'une tente se couchent avec leurs vaches, leurs moutons, etc., qui leur tiennent chaud pendant la nuit. Il y a de ces tentes, formées par plusieurs pièces d'étoffe qui ont très vastes et dans lesquelles on peut abriter de nombreux troupeaux.
Costumes
Les costumes des Arabes ne diffère presque pas de celui des Berbères :
Ils ont l'haïk et le bernous comme eux mais ils ne portent jamais rien dessous l'haïk si l'on en excepte les Cheiks qui sont toujours mieux mis que la multitude, et qui non seulement ont des chemises de toile, des espèces de voile en mousseline dans lesquels ils s'enveloppent la tête, mais encore des culottes larges comme les Maures et des bottes rouges. J'en ai même vu quelques-uns avec des vestes brodées en or par-dessous l'haïk.
Très peu d'Arabes portent des babouches ; le plus grand nombre s'enveloppe les pieds avec des morceaux de peaux de vache ou de bœuf dont ils mettent le poil en dehors et qu'ils lacent sur le pied et autour de la jambe avec une corde d'écorce d'arbre qui passe dans des trous faits tout autour du morceau de peau : quelques-uns marchent pieds nus comme les Berbères.
La chaussure de ces Arabes rappelle parfaitement celle des anciens Hébreux que nous voyons dans les tableaux d'église mais elle est beaucoup moins soignée ; leur costume a aussi quelque analogie avec celui du peuple d'Israël.
Les Arabes ne portent sur la tête que l'haïk lié avec une corde de laine brune, ou le capuchon du bernous ; je n'en ai jamais vu avec le turban. Ils se rasent la tête et laissent croître leur barbe.
Le costume des femmes se compose d'une chemise de laine blanche fort large, à manches courtes qui est lié avec une corde au milieu du corps ; elles portent les cheveux longs, flottant sur leurs épaules ou attachés avec un mouchoir et quelquefois avec une corde.
Leurs chaussures sont les mêmes que celles des hommes mais la plupart du temps elles marchent pieds nus.
Elles ne se couvrent le visage, avec un voile blanc ou un morceau de laine qu'elles se jettent sur la tête, que lorsqu'elles font des courses un peu longues ou qu'elles vont en voyage avec leurs maris ; mais quand elles restent dans le douar, elles ont le visage découvert et ne craignent pas de paraître en public dans cet état. L'usage de se tatouer les membres et la poitrine et de se dessiner des fleurs sur la figure existe chez les femmes arabes comme chez celles de Berbères : Elles se teignent aussi les ongles, le dedans des mains et le dessous des pieds en rouge avec du henné. Elles aiment beaucoup les bijoux, et celles qui ne peuvent point en avoir de fins en portent de faux ; je leur ai vu des bracelets, des boucles d'oreilles en cuivre et en fer, des colliers en noyaux de dattes et en bois de différentes couleurs.
Les Arabes riches prennent soin de leurs enfants et le vêtent aussi bien qu'il leur est possible ; mais ceux de la multitude sont presque toujours nus comme des vers ; ils restent ainsi, pendant des journées entières, exposés au soleil.
Manière de vivre
La sobriété est bien certainement la plus grande qualité des Arabes : de tous les peuples de la Barbarie ce sont eux qui mangent le moins et vivent le plus mal. Scrupuleux observateurs de la loi de Mahomet, ils ne boivent jamais ni de vin ni aucune liqueur.
Dans l'été quelques figues de Barbarie et de l'eau leur suffisent pour passer toute la journée ; ils ne mangent de la viande et du couscoussou qu'aux époques solennelles. Leur nourriture la plus habituelle se compose :
- du lait de leurs troupeaux, qu'ils boivent ou mangent en fromage,
- d'un peu de galette faite sur le feu dans un plat de terre avec de l'huile rance,
- des poivrons longs cuits dans l'huile etc.
Dans la saison ils mangent beaucoup de pastèques ; ils aiment beaucoup le café ; ils fument et prisent un tabac très fin qu'ils préparent eux-mêmes.
Industrie
Tous les Arabes en général, les nomades comme ceux qui habitent dans des cabanes ne travaillent que pour satisfaire leurs besoins, et comme ils en ont très peu, il en résulte qu'ils peuvent rester la plus grande partie du temps sans rien faire. : On les voit très souvent assis en grand nombre autour de leurs douars ou dascars, les bras croisés et occuper à regarder les mouches voler ou les passants aller et venir.
Ceux qui gardent les troupeaux sont couchés pendant les trois quarts de la journée avec un fusil à côté d'eux. Chaque tribu, on pourrait même dire chaque famille, fabrique tous les objets dont elle a besoin, à l'exception cependant des armes, des munitions de guerre et des instruments aratoires qu'elle achète des Berbères et des Maures. Ils font des nattes de jonc, des paniers de toutes sortes avec des feuilles de dattier nain les harnachements de leurs chevaux mais je crois qu'ils ne savent pas le ferrer car ils ne le sont presque jamais.
Ils font encore des sièges, des ruches à miel avec des fragments d'écorce d'agave qu'ils réunissent au moyens d'osiers qui les traversent en passant dans des trous pratiqués exprès ; ils fabriquent aussi, avec la même substance des paniers cylindriques pour transporter les fruits, et des cages pour mettre la volaille. Les charrues et les herses dont ils se servent, sont faites par eux : ils n'ont point de voitures et transportent leurs fardeaux sur le dos des bêtes de somme, dans des doubles paniers en feuilles de dattier, qui ont tout à fait la même forme que ceux dont se servent les Provençaux.
Ils font de la toile avec le lin qu'ils cultivent, mais seulement pour leur usage. Les femmes filent la laine et la tissent et fabriquent aussi des pièces d'une étoffe blanche qui a quelque analogie avec la flanelle grossière et dont les Arabes, femmes et hommes sont vêtus ; mais la principale branche de l'industrie des Arabes consiste dans leurs troupeaux et leurs chevaux.
Toutes les tribus sédentaires ou nomades ont toujours des troupeaux extrêmement nombreux ; une famille possède souvent plusieurs centaines de moutons, quarante vaches et dix ou vingt bœufs. Les troupeaux ne coûtent rien à nourrir : on les mène paître dans la campagne pendant toute l'année. On boit le lait des vaches et des brebis, dont on fait aussi du beurre et du fromage que l'on mange ou porte vendre dans les villes et aux foires.
Mais les chevaux sont les animaux que l'Arabe préfère à tous les autres et ceux dont il prend le plus soin. Ils ont aussi des mulets et des ânes mais en bien moins grande quantité que les Berbères et d'une qualité inférieure à ceux de ces peuples ; ils les emploient aux travaux de l'agriculture et à porter des fardeaux.
Agriculture
Les Arabes s'adonnent bien moins à l'agriculture que les Berbères.
Les tribus nomades ne cultivent pas autant que l'on dit plusieurs voyageurs : elles ne demeurent en général dan chaque localité que pendant qu'elles y trouvent l'eau et l'herbe nécessaires à la nourriture de leurs troupeaux ; aussitôt que l'herbe est mangée, elles lèvent leurs tentes et vont en chercher ailleurs.
Il y a cependant quelques-unes de ces tribus qui cultivent avec assez d'assiduité
- les céréales,
- le blé,
- le seigle,
- l'orge dans les champs qu'elles louent près des villes et dans les plaines habitées.
Quand elles ont semé, elles partent presque toujours, et reviennent au moment de la maturité faire la récolte, battre le grain qu'elles emportent ensuite, et bien souvent sans payer les impôts ni le prix du fermage. Les tribus de Bédouins que l'on rencontre sur la route d'Alger à Oran et celles de certaines plaines de la province de Constantine cultivent le riz et le lin.
Mais les tribus de cultivateurs sont celles qui vivent sous les cabanes ; on en trouve beaucoup dans la plaine de la Mitidja, surtout dans la portion située à l'Ouest du cours de la Chiffa : elles sèment :
- du blé,
- de l'orge,
- du seigle dans les terrains humides,
- du sarrasin,
- des pois,
- des lentilles,
- un peu de maïs.
Elles plantent aussi des pommes de terre mais ces légumes croissent mal en Barbarie ; cependant on les cultive avec le même soin qu'en Europe et les terres dans lesquelles on les met sont excellentes.
Les tribus arabes qui habitent aux environs de Belida (Blidah) sèment beaucoup de lin qui vient assez bien ; celles des collines du littoral s'adonnent un peu à la culture de la vigne et des arbres fruitiers, mais les tribus de la plaine ne s'en occupent pas du tout.
- Des melons,
- des citrouilles,
- des concombres,
- des poivrons longs,
- et des tomates,
Voilà ce que l'on rencontre dans le jardin d'une famille arabe.
Quand les céréales sont coupées, ce qui se fait avec une faucille très grossière, on en forme des gerbes à peu près comme en France, que l'on porte près des habitations ; là se trouve une place, l'aire.
Commerce
Le plus grand commerce des Arabes consiste dans les bestiaux qu'ils élèvent et les produits qu'ils en retirent : ils vendent des bœufs et vaches, des moutons, des chameaux et surtout des chevaux. C'est dans les provinces d'Oran et de Constantine que les chevaux sont le plus estimés, et qu'on en fait aussi un plus grand commerce. Toutes les tribus nomades ou sédentaires nourrissent beaucoup de moutons et récoltent une grande quantité de laine : chaque famille emploie une partie de cette laine pour des besoins ; le reste est vendu à un prix assez élevé parce que la laine est un des objets que les marchands européens recherchent davantage. Une grande partie des contributions se payait avec de la laine. Les cultivateurs, et surtout ceux de la province d'Oran, vendent une grande quantité de grains. Les Bédouins et les Arabes sédentaires viennent plusieurs fois par semaine au marché dans les villages où ils apportent
- du lait dans des outres ou dans des pots de terre,
- du beurre et des fromages,
- de la volaille, poules et pigeons seulement,
- et des œufs.
Pendant que nous étions à Alger, les Arabes, sachant que nous mangions du gibier et du poisson d'eau douce, se livraient à la chasse et à la pêche :
- lièvres,
- perdrix rouges,
- oiseaux des marais,
- poissons de qualité médiocre.
La chasse à laquelle les Bédouins se livrent davantage est celles des bêtes féroces dont ils vendent les peaux et celles des autruches dont ils vendent les plumes. Quand les Arabes viennent dans les villes vendre leurs bestiaux ou les produits de leur industrie, ils achètent :
- des souliers,
- quelques morceaux de mousseline ou de calicot,
- des couteaux,
- des armes,
- de la poudre,
- du plomb.
État politique
La population arabe de la régence d'Alger était en partie soumise au Dey, mais il n'y avait rien de moins réel que cette soumission, surtout pour les nomades qui s'en vont toutes les fois qu'on les tracasse un peu trop.
Ceux qui vivent dans des cabanes les abandonnent aussi fort souvent et vont en construire d'autres ailleurs. Pendant que j'étais à Oran les chefs du village Ras-el-Aïn composé de maisons construites à chaux et à sable vinrent trouver le commandant français et lui dire qu'ayant à se plaindre de la manière dont on se conduisait avec eux, ils allaient abandonner le village : effectivement dans la nuit même, toutes les familles qui l'habitaient s'en allèrent en emportant, sur les bêtes de somme, tout le mobilier et jusqu'aux portes et aux croisées des maisons ; le lendemain matin, nos soldats étant entrés dans ce village, le trouvèrent tout à fait désert.
Toute la population arabe est divisée par tribu ; une tribu est la réunion d'un certain nombre de familles, sous l'autorité d'un seul homme que l'on appelle Cheik et par le nom duquel la tribu est désignée ; on dit la tribu d'Ismaël, la tribu de Ben-Adré. Plusieurs tribus se réunissent quelquefois ensemble sous l'autorité d'un chef suprême que l'on appelle Kaït.
Voici comment les Cheiks sont élus : Il y a toujours dans chaque tribu un certain nombre de familles qui descendent plus ou moins directement du Prophète, dont les membres se sont distingués par leur courage ou leur savoir dans telle ou telle partie : ces familles forment la noblesse des tribus et tous les hommes qui en font partie portent le nom de Cheiks ou seigneurs. C'est parmi leurs familles que l'on choisit l'un d'entre eux pour diriger la tribu.
Cette dignité est quelquefois héréditaire mais le plus souvent élective ; le pouvoir reçu est fort étendu :
- justice dont les sentences sont exécutées sur-le-champ même s'il s'agit de la peine capitale,
- commandement des troupes,
- décisions de faire la paix ou la guerre.
Ils sont ordinairement assez riches pour subvenir à toutes les dépenses qu'entraînent le haut rang dans lequel ils sont placés : dépenses qui se bornent à donner quelques plats de lait aux étrangers qui viennent demander l'hospitalité, et très rarement à tuer un mouton pour les régaler : " Si j'avais su votre passage chez nous je vous aurais offert du lait et de la galette et si aviez voulu rester un jour avec moi, j'ai tué un mouton pour vous régaler " me disait un chef arabe dont j'avais visité la tribu pendant qu'il était absent.
Les tribus arabes ne sont ordinairement composées que de quinze ou vingt familles. Sous le règne du Dey, les cavaliers des Aghas étaient souvent occupés à poursuivre les tribus des Bédouins pour les forcer à payer les impôts ou s'emparer de leurs troupeaux en cas de refus. Alors les Cheiks étaient obligés de venir auprès du Bey qui rendait les bestiaux moyennant une somme d'argent aussi forte qu'il pouvait l'obtenir.
Religion
Ce sont les Arabes qui ont apporté l'islamisme dans la Maurétanie : ainsi il n'est pas étonnant qu'ils le professent encore maintenant comme les Maures auxquels ils l'ont imposé.
Ces deux peuples suivent exactement le même dogme : on les voit tous les jours réunis dans les mêmes mosquées et se livrant aux même pratiques ; mais en général les Arabes sont un peu moins dévots que les Maures ; ils ne font que rarement les ablutions commandées par le Coran et on ne les trouve pas souvent à genoux, au milieu de la campagne, aux heures de la prière. Ils observent néanmoins toutes les fêtes. Pour faire de la musique, ils frappent sur des peaux tendues ou même sur des planches avec un morceau de bois et jouent d'une flûte faite avec un roseau ; ils poussent des cris de joie et ils dansent en remuant leur corps de la manière la plus indécente que l'on puisse imaginer. On ne saurait dire en les voyant célébrer une fête s'ils ont pour objet de louer Dieu ou de conjurer le diable.
- Ils attribuent tout le mal qui leur arrive à l'influence des esprits ténébreux,
- ils croient à l'existence des génies et les redoutent beaucoup,
- ils sont aussi persuadés qu'on peut leur jeter des sorts et pour s'en préserver, ils portent sur eux des amulettes et ils en suspendent au cou de leurs chameaux et de leurs chevaux.
- Ils ont des devins qui leur prédisent l'avenir, moyennant une rétribution et ils leur accordent une grande confiance.
Les marabouts ont presque autant de pouvoir chez les Arabes que chez les Berbères : chaque père de famille a recours à eux ; ils l'aident de leurs conseils et lui promettent d'adresser des prières au ciel pour lui.
Les femmes visitent souvent ces saints personnages surtout lorsqu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants.
Quand on les enterre leurs tombeaux deviennent des lieux saints où l'on va faire des pèlerinages et porter des offrandes.
Il est d'usage que le chefs de tribu et les principaux citoyens en partant pour la guerre aillent au tombeau de quelque marabout pour le prier d'accorder un heureux succès à leurs armes et en lui promettant de lui faire hommage d'une partie du butin si leurs vœux sont exaucés.
Les personnes âgées sont l'objet de la vénération des familles ; les enfants prennent grand soin de leurs vieux parents. En cela ils ne ressemblent pas aux Maures qui font peu de cas des leurs, et les abandonnent quand ils ne peuvent plus gagner leur vie. On rencontre dans les rues d'Alger une grande quantité de vieillards errants seuls en demandant l'aumône.
Pendant que j'étais à Oran le fils d'un Cheik arabe qui habitait le village de Ras-el-Aïn fut tué par l'une de nos sentinelles dont il voulait violer la consigne sur une hauteur où se trouvaient plusieurs marabouts par entêtement.
Ce jeune homme avait été enterré sur une hauteur où se trouvaient plusieurs marabouts.
Pendant les huit premiers jours ils montaient à cheval armés comme s'ils partaient à la guerre et accompagnés de la femme du défunt ils se rendaient sur sa tombe et se prosternaient ; ils priaient à voix basse tandis que la veuve faisait retentir les airs de ses gémissements. La cérémonie durait environ vingt minutes et les cavaliers repartaient sans se préoccuper de la veuve.
Quand les morts sont en trop grand nombre pour qu'on puisse les conduire chacun dans leur tribu, on les enterre en les plaçant dans une fosse très profonde et en la recouvrant d'épines et de feuilles d'agave pour empêcher les chacals de s'adonner à leur macabre besogne.
J'ai ouï dire que les Musulmans croyaient que ceux des leurs qui étaient enterrés par des Chrétiens ne seraient pas reçus en paradis et c'est la raison pour laquelle ils attachaient tant d'importance à les enlever. Il y a bien quelque idée religieuse attachée à cette pratique.
Un Cheik arabe monté sur un superbe cheval et armé se présenta un jour devant la porte d'un petit fort à Oran en demandant de parler à l'officier qui commandait. Celui-ci craignant un piège sortit accompagné d'un caporal avec deux hommes ; aussitôt que l'Arabe l'aperçut il le mit en joue et l'aurait tué si le caporal n'avait fait feu sur lui ; il tomba raide mort et on l'enterra près du fort. Le soir même, quelques-uns des siens bien qu'ils fussent instruits de sa trahison vinrent demander son corps pour lui rendre les honneurs funèbres ; ils furent obligés de partir sans rien avoir obtenu.
Le lendemain, une jeune négresse, pieds nus, les cheveux épars et pleurant vint supplier le colonel Lefol de lui faire rendre le corps de son maître ; quand l'interprète lui eut dit qu'il était impossible d'obtenir ce qu'elle demandait, elle se jeta à genoux se roula par terre en poussant des cris ; on fut obligé de la faire emporter par des soldats.
Mœurs et coutumes
Cette hospitalité que l'on vante tant et qui semble avoir été transmises aux tribus par celles des patriarches ne s'exercent qu'envers leurs compatriotes et encore la violent-ils quelquefois.
On ne voyage que par caravane dans la régence d'Alger et comme ce pays est fort peu peuplé, on est souvent obligé de demander asile aux tribus nomades. Quand une caravane arrive dans une de ces tribus, le Cheik la prend toujours sous sa protection mais rarement sans rétribution. Le soir les voyageurs gardent bien leurs bagages et ils leur arrivent d'être volés.
Mariages
Les jeunes filles ne sont pas séquestrées et elles ne portent le voile que lorsqu'elles vont en voyage ; mais sous la tente, et quand elles vaquent à leurs occupations, elles ont le visage découvert. Les jeunes gens peuvent les voir et causer avec elles ; ils leur font la cour, les aiment et en sont aimés. Quand un jeune homme est épris d'une demoiselle et qu'il a su s'en faire aimer, il la fait demander par son père ou il la demande lui-même. Le mariage est toujours une espèce de marché : c'est le jeune homme qui fait sa dot consistant en bestiaux, quelques pièces de laine etc. ; les parents de la jeune fille font le trousseau.
Pour conclure le mariage on va devant le Cadi ou le chef de la tribu : les deux pères déclarent devant le magistrat l'intention d'unir leurs enfants. Ils se retirent ensuite après avoir fixé le jour des noces, celui où la jeune femme sera conduite chez son mari.
Ce jour arrivé toutes les jeunes filles du douar qui ont paré l'épouse, la placent sur le cheval de l'époux ; elles l'accompagnent jusqu'à sa nouvelle en frappant sur des tambours et en criant you ! you ! Quand l'épousée arrive devant la tente de son mari, les parents de celui-ci lui offre un breuvage de lait et de miel ; pendant qu'elle boit, tous les assistants chantent en dansant et font des vœux pour les nouveaux époux.
Immédiatement après le mariage, il n'est pas permis aux femmes de vaquer aux travaux ordinaires : elles sont obligées de rester enfermées un mois entier, et même d'avoir le visage recouvert d'un voile ; mais ensuite elles sont aussi libres qu'il est possible de l'être avec les Musulmans.
Les Arabes paraissent aimer beaucoup la musique. Des flûtes faites avec des roseaux, des espèces de tambours basques, des peaux collées sur des pots en terre dans lesquels on met quelques cailloux composent à peu près tous les instruments. On les rencontre souvent accroupis sous un arbre ou dans un buisson occupés à chanter sur un ton monotone. Tous ceux qui viennent au marché, montés sur des chameaux, des mulets ou des chevaux chantent, chemin faisant ; les voyageurs et les guerriers chantent aussi pendant la route.
Voyage dans la régence d'Alger par M. Rozet,
capitaine au corps royal d'État-Major
Tome second. 1833
|
|
| Les Maures
Envoyé par M. Christian Graille
|
L'historien de l'expédition de Bélisaire en Afrique, Procope, disait en parlant des Maures : " Ils habitent dans de mauvaises cabanes et dorment sur la terre ; les plus riches ont à peine quelques méchantes peaux de mouton pour se coucher. Ils portent le même habit pendant toutes les saisons ; c'est un grand manteau et une casaque faîte d'une laine fort rude. Ils ne connaissent ni le pain ni le vin ; ils mangent le blé et le seigle comme des bêtes brutes, sans les faire cuire ni les réduire en farine. "
Quand Bélisaire vint en Afrique pour en chasser les Vandales, il y avait déjà longtemps que ce pays avait été réduit en province romaine, et la presque totalité des Maures avaient embrassé le christianisme ; cependant il parait qu'ils continuaient à vivre dans l'état sauvage.
Selon Procope ils sont venus de la Phénicie, c'étaient plusieurs peuples qui furent chassés de leur pays par Jésus de Naye (personnage biblique, successeur de Moïse) et vinrent les armes à la main s'établir en Afrique.
Etant restés sur le bord de la mer, ils eurent beaucoup plus de relations avec les Européens que les Berbères qui se tinrent enfermés dans les montagnes. Les conquérants qui se sont succédés dans leur pays ont modifié leurs mœurs et beaucoup altéré leur race. Subjugués par les Arabes et gouvernés ensuite par les Turcs, ils ont embrassé l'islamisme et dès lors leur genre de vie a été peu différent de celui de Musulmans. Tous les Européens qui, en venant s'établir dans la Barbarie, se sont faits Mahométans, ont épousé des Mauresques et sont devenus des Maures eux-mêmes. Leurs enfants étaient d'une race différente de la primitive ; et comme des hommes de plusieurs nations de l'Europe (Espagnols, Français, Italiens et même Allemands) sont venus s'établir en Barbarie, on conçoit qu'il a dû s'ensuivre des variétés différentes dans le groupe d'hommes auquel on donne maintenant le nom de Maures.
Il existe cependant encore un certain nombre de familles qui n'ont point contracté d'alliances avec les étrangers et chez lesquelles on retrouve les caractères de la race primitive.
- Les hommes sont d'une taille au-dessus de la moyenne,
- leur démarche est noble et grave,
- ils ont des cheveux noirs,
- la peau un peu basanée mais plutôt blanche que brune,
- le visage plein, mais les traits en sont moins bien prononcés que ceux des Arabes et des Berbères.
Ils ont généralement
- le nez arrondi,
- la bouche moyenne,
- les yeux très ouverts, mais peu vifs,
- leurs muscles sont bien prononcés
- et ils ont le corps plutôt gras que maigre.
Les femmes sont constituées en proportion des hommes : elles ont presque toutes les cheveux noirs et des yeux magnifiques ; j'en ai vu de fort jolies. Elles ne portent jamais de corsets et, comme l'embonpoint est une grande beauté aux yeux des Maures et qu'elles font tous leurs efforts pour en avoir, elles ont le corps mal fait et surtout extrêmement larges des hanches.
Dès la plus tendre enfance, on leur tire la gorge afin de l'allonger et, avant trente ans, leurs seins, semblables à des calebasses tombent jusqu'au milieu du ventre. Les enfants des deux sexes sont extrêmement jolis :
- ils ont une physionomie douce,
- des yeux superbes,
- une belle intelligence.
Un an après notre entrée dans Alger, une grande partie des enfants maures parlaient français, seulement pour avoir fréquenté nos soldats et quelques négociants qui avaient des relations avec leurs pères. Les Maures forment la plus grande partie de la population des États algériens. Ils habitent tous dans des maisons plus ou moins bien construites et se trouvent réunis dans les villes et quelques villages ; très peu vivent séparément dans la campagne à une petite distance des villes, sur les collines, dans les vallées et les plaines cultivée.
Les Berbères et les Arabes les pillent et les tuent même quelquefois quand ils viennent se loger trop près d'eux.
Costumes
Leur costume diffère peu de celui des Turcs :
- ils portent le turban comme ceux-ci,
- ont une culotte très large qu'ils attachent avec une coulisse à la ceinture, sur le haut du corps,
- ils ont plusieurs vestes brodées en or ou en soie suivant le rang qu'ils occupent dans la société dont la dernière porte des manches longues qui viennent jusqu'au poignet. Pendant l'été ils mettent rarement celle-ci, et ceux dont les manches de chemises sont très courtes restent les bras nus ; les autres portent des manches longues fort larges qui viennent s'attacher aux poignets comme les nôtres.
- Ils ne se mettent jamais de bas ; ils ont aux pieds de mauvais souliers qu'ils nomment babouches.
Ils portent à la hauteur des reins une large ceinture de soie ou de laine teinte de différentes couleurs qui leur passe plusieurs fois autour du corps ; C'est dans cette ceinture qu'ils placeront :
- le Yatagan (sabre),
- le poignard,
- les pistolets,
- la bourse.
- Ils mettent leur tabatière dans la poche du gilet,
- pendent la blague à tabac à un de leurs boutons,
- tiennent presque toujours leur pipe à la main.
Ceux qui font le pèlerinage à la Mecque portent le turban vert ; c'est aussi, je crois, une marque de noblesse. Tous les Maures ont un burnous absolument semblable à celui des Berbères et des Arabes, qu'ils mettent pendant l'hiver et lorsqu'il fait mauvais temps.
Ils portent aussi un capuchon garni de manches longues qui leur sert d'habit et de chapeau à la fois ; ce capuchon est en laine brune et ornée de dessins extrêmement bizarres, fait avec des morceaux de draps de différentes couleurs cousus à côté les uns des autres. C'est le costume des gens aisés. Celui de la classe pauvre est dans le même genre mais il est bien moins élégant : Avec la culotte, faite de toile assez grossière, ils n'ont souvent qu'une mauvaise veste sur le dos et une calotte rouge qui leur couvre seulement le dessus de la tête ; ils n'ont pas toujours de ceinture.
- Tous sans exception se font raser la tête et laissent croître leur barbe,
- ils font des ablutions recommandées par le Prophète,
- ils prennent souvent des bains d'étuve.
Le costume des femmes diffère beaucoup de celui des hommes et il n'est pas le même pour l'intérieur des maisons et dans la rue.
Quand elles sortent les dames ne portent jamais de bas ; elles mettent leurs pieds dans des souliers découverts for mal faits ; elles ont un pantalon large de toile ou de calicot blanc qui vient s'attacher en fronçant au-dessus de la cheville et qu'elles fixent à la ceinture au moyen d'un cordon à coulisse comme celui des hommes.
Elles ont une chemise assez courte dont le bas entre dans le pantalon et qui lui couvre le haut du corps ; par-dessus cette chemise, les Mauresques mettent une ou deux vestes assez semblables à celles des hommes. Elles couvrent le pantalon avec un foulard ou un fichu de coton de différentes couleurs.
Leurs cheveux sont tressés ou fixés par un cordon autour de la tête ; elles portent un petit mouchoir blanc, attaché par derrière, qui leur cache toute la figure jusqu'aux yeux. Quand elles sont ainsi accoutrées, elles jettent par-dessus tous leurs habits une tunique en gaze de laine blanche qui leur couvre le dessus de la tête ; enfin une espèce de manteau en laine blanche ou en coton de différentes couleurs.
Dans l'intérieur des maisons les Mauresques ont deux espèces de costumes : le négligé et le paré. Le premier est pour se lever et vaquer à leurs occupations habituelles : elles sont alors jambes et pieds nus ; le haut du corps n'est couvert que par la chemise aux manches courtes.
Un petit caleçon fixé à la ceinture leur cache les cuisses et le ventre. Elles ont également :
- des bijoux aux oreilles,
- au cou,
- des bracelets aux bras,
- un gros anneau d'or ou de cuivre au bas de l'une des jambes.
Le costume paré que les épouses des Maures portent est fort riche et fort élégant.
- Les oreilles portent des boucles en diamant, en or, en argent ou même en cuivre, suivant l'état de la fortune,
- Le cou est garni de colliers dont la richesse varie en perles, en corail ou en or.
- Les femmes moins fortunées les portent en verroterie.
Les Mauresques sont généralement très propres ; n'étant comptées pour rien dans la religion, elles n'en observent pas les règles et ne font pas les ablutions exigées pour les hommes mais elles vont souvent au bain : c'est même le seul endroit où elles puissent se voir librement entre elles et où elles jouissent un peu de l'existence ; par ailleurs elles sont les esclaves de leurs maris et gardées à vue par des négresses.
Quand elles se sont baignées, ce qu'elles font toujours avant de ses parer de leur grand costume,
- elles se teignent les ongles,
- le dessus des pieds et le dedans des mains avec du henné,
- les sourcils avec du noir,
- et on leur dessine une petite fleurs bleue entre les deux yeux.
Une femme va au bain et recommence la même cérémonie toutes les semaines ; pendant l'été elles y vont même deux fois. Les femmes de la classe moyenne et celles du peuple y vont très souvent aussi.
Les enfants sont habillés comme leurs parents.
Quand les petites filles sortent, elles ont aussi le visage couvert.
Les garçons n'ont la tête rasée et ne commencent à porter le turban que lorsqu'ils ont atteint l'âge de la puberté, dix à onze ans. Ils laissent croître leurs cheveux et on les teint en rouge, ainsi que ceux des petites filles, encore avec du henné, à ce que je crois.
Manière de vivre
Les Maures pauvres et ceux qui habitent à la campagne vivent d'une manière peu différente de celle des Arabes : ils boivent du laitage, mangent des fruits et plusieurs espèces d'herbes, sans le faire cuire ni les assaisonner. Le pain est une galette qu'ils ne mangent pas tous les jours. Quand les figues de Barbarie sont en maturité, on voit les Maures,
- en cueillir jusqu'à vingt ou trente,
- s'asseoir à côté,
- les manger,
- boire ensuite un coup d'eau,
- aller se coucher sous un arbre pour dormir tout le reste de la journée ou s'y accroupir,
- fumer leur pipe sans penser à rien.
Ils prennent tous beaucoup de café sans sucre : c'est une eau noire dans laquelle il y a autant à manger qu'à boire, qu'ils obtiennent en faisant bouillir un peu d'excellent café avec du marc dans une grande quantité d'eau.
Il y a beaucoup de boutiques où l'on vend du café dans l'intérieur des villes, et on trouve aussi ces établissements sur les routes, comme en France des cabarets. Les Maures de la campagne s'y rendent en grand nombre ; ils s'accroupissent devant la porte où il y a toujours un porche fait en feuillage ou, dans les beaux cafés, une superbe colonnade, au milieu de laquelle jaillit une fontaine : là, les jambes croisées et la pipe ils passent des journées entières à boire quelques tasses de café ; quelques-uns jouent au jeu de dames français ; pendant ce temps les femmes et les enfants restent au logis.
Les hommes passent également leurs journées dans les boutiques des barbiers à écouter les contes que ceux-ci leur débitent.
Au mois de septembre, chaque famille tue autant de moutons que ses moyens le lui permettent et que ses besoins l'exigent. Toute la viande est coupée en petits morceaux et mise ensuite dans une grande chaudière en bronze ou en cuivre avec la graisse que l'on a tirée des animaux et de l'huile d'olives. On fait cuire, le tout une journée entière ; puis on remplit des pots de terre en ayant soin de mettre assez de graisse pour que la viande soit bien cachée ; on bouche ensuite les pots avec du plâtre ou de la terre glaise ; cette viande peut se conserver pendant plus d'un an.
Industrie
Les Maures sont flegmatiques et insouciants. Ceux des villes passent des journées entières accroupis devant les cafés ou les boutiques à boire du café et à fumer leur pipe.
J'en ai connu de très actifs avec beaucoup d'esprit ; plusieurs de ceux employés par nous dans la police d'Alger faisaient leur service mieux que les Français.
Les Maures de Barbarie exercent presque tous les métiers connus en Europe :
- menuisiers, - charpentiers, - tonneliers , - tisserands, - cordonniers, - tanneurs, - brodeurs, - tailleurs, - bijoutiers, - horlogers, - maréchaux-ferrants, - taillandiers (artisans fabriquant des outils de taille et de coupe), - armuriers etc.,
Mais tous ces métiers sont encore dans l'enfance et ceux qui les exercent travaillent avec tant de lenteur qu'on ne peut pas les regarder sans éprouver un sentiment pénible, les horlogers et les bijoutiers surtout. Dans les villes ils tiennent les boutiques et les cafés ainsi que les Juifs.
Une partie des Maures servait sur les corsaires du Dey, quelques-uns travaillaient dans les chantiers de la marine et dans les arsenaux ; beaucoup avaient de petits bateaux avec lesquels ils menaient promener, dans la rade, les personnes qui les payaient ; certains pêchaient avec des filets ou à la ligne sur le bord de mer.
Agriculture
Ceux qui possèdent ou habitent une maison de campagne ont presque toujours, attenant à la maison, un jardin assez bien tenu dans lequel il y a des arbres fruitiers, des fleurs et quelques légumes ; mais ce jardin est cultivé par des esclaves ou des Berbères qui se louent six sous par jour.
Le propriétaire et ses enfants dédaignent d'y mettre la main ; on les voit souvent accroupis derrière leurs ouvriers pour les empêcher de perdre leur temps. Chaque maison de campagne possède aussi des terres labourables presque toujours entourées de haies dont quelques parties sont cultivées, semées en blé, en orge ou en pomme de terre.
Il faut qu'un Maure soit bien pauvre pour qu'il se décide à travailler la terre.
Commerce
Quand un peuple ne s'adonne ni à l'industrie ni à l'agriculture, on conçoit que son commerce ne doit pas être très florissant ; aussi celui des Maures est à peu près nul. Ils n'ont à vendre que :
- des broderies,
- des tissus de laine, de soie,
- des fils d'agaves,
- des toiles.
Ils n'élèvent presque point de bétail.
Les produits de leurs jardins et de leurs champs suffisent à peine à leur consommation. Ceux qui tiennent des boutiques dans les villes achètent beaucoup d'objets des Berbères et des Arabes,
- du tabac, - de la bougie, - du savon, - des fruits secs et frais, - des instruments, - des outils etc., qu'ils revendent ensuite avec un léger bénéfice.
Les caravanes qui viennent de la Mecque leur apportent du café.
Les vaisseaux anglais leur amènent : - des sucres, - des calicots, - de la porcelaine,
et ils tirent d'Italie et de France :
- des bijoux, - des étoffes de soie, - de la mercerie, - de la quincaillerie.
Instruction
Malgré sa paresse et son insouciance, le peuple maure, pris en général, a peut-être plus d'éducation que le peuple français ; presque tous les hommes savent lire, écrire et un peu compter ; il y a un grand nombre d'écoles publiques dans la régence d'Alger et on instruit les enfants dès l'âge de quatre ans.
C'est le Coran qui compose à peu près toute leur éducation ; quand ils savent lire quelques chapitres de ce livre sacré, on les leur fait écrire. J'ai vu à Alger plusieurs Maures qui avaient de l'instruction ; ils parlaient plusieurs langues et connaissaient assez bien la géographie ; ils avaient même étudié l'histoire. Quelques-uns avaient fait leurs études dans les collèges de Paris. Les femmes mauresques sont privées d'éducation. D'après la manière dont on les élève elles ne peuvent pas aller dans les écoles publiques et leurs mères ne leur apprennent presque rien : comment pourraient-elles le faire puisqu'elles sont elles-mêmes ignorantes ?
État politique
La race maure vit dans une espèce d'oppression : dans les villes où il y a une garnison turque, les Maures étaient soumis à beaucoup plus de vexations que des Mahométans ne devraient en supporter de leurs coreligionnaires. Dans les campagnes ils étaient opprimés par les Arabes et les Berbères qui les pillaient souvent. Cependant le gouvernement du Dey leur avait accordé des prérogatives ; ils avaient des magistrats civils. Chaque ville avait un cadi maure ou le juge devant lequel toutes les causes étaient portées et dont ils ne pouvaient appeler des jugements qu'au souverain lui-même ; un mufti était plus particulièrement chargé de la justice religieuse et auquel le cadi demandait des conseils dans les cas où il se trouvait embarrassé.
Ils étaient soumis à tous les autres magistrats et agents de police du Dey ou de ses gouverneurs de province.
Le Dey ne les enrôlait dans son armée que lorsqu'il était attaqué par une puissance européenne ; le danger passé, ils s'en retournaient chez eux. Quand nous marchâmes contre Alger très peu de Maures avaient pris les armes pour défendre leurs foyers.
Dans la régence tous les emplois de gouvernements aussi bien que les grades dans l'armée étaient remplis par des Turcs, les Koulouglis et quelques renégats mais les Maures en étaient exclus. Ceux-ci ne pouvaient prétendre qu'à être imams, cadi ou mufti. Les fils ainés de marabout héritaient des privilèges de leurs pères et étaient aussi bien respectés par les Turcs que par les Maures.
Religion
Les musulmans algériens sont divisés en deux sectes : les serviteurs de Mahomet et ceux d'Ali. Les vrais Mahométans soutiennent la prédestination absolue,
- que Dieu est la cause du bien et du mal,
- qu'il est éternel comme sa loi,
- qu'il se rendra visible dans son essence même.
Ils ajoutent que Mahomet fut élevé en la présence de Dieu en corps et en âme et qu'il faut prier nécessairement cinq fois le jour.
Les sectateurs d'Ali prétendent que Dieu :
- ne produit que le bien,
- que lui seul est éternel et non sa loi,
- que les âmes des bienheureux ne voient Dieu que dans ses œuvres,
- que l'âme seul de Mahomet fut élevée dans le ciel et non son corps,
- qu'enfin il suffit de prier trois fois par jour.
Les Mahométans prient Dieu partout où ils se trouvent.
- Les marchands dans leurs boutiques,
- les voyageurs sur les routes,
- cultivateurs dans les champs, se prosternent et prient aux heures fixées.
Dans les villes et les village le crieur (muezzin) monte au minaret de la mosquée et après avoir hisser à une espèce de potence un petit pavillon blanc crie trois fois : " Il n'y a qu'un Dieu ; Dieu est grand et Mahomet est son prophète."
- Il ouvre la mosquée à minuit.
- A la pointe du jour que se nomme Emlebat Denor, il appelle pour la première fois les fidèles à la prière,
- il remonte sur le minaret après-midi, c'est le Dor,
- ensuite à quatre heures du soir, el Hasser,
- après le coucher du soleil el Mougroub,
- enfin une heure après le coucher du soleil, el Hatmet.
A cette époque aussitôt que la prière était finie, les mosquées étaient fermées et on ne les rouvrait qu'à minuit.
Dans la secte d'Ali, les prières se font :
- à la pointe du jour,
- à quatre heures,
- à neuf heures du soir.
Il n'y a jamais que les hommes et les jeunes gens adultes qui entrent dans la mosquée. Le pavé est toujours couvert de nattes de jonc et on trouve à la porte un bassin rempli d'eau ou une fontaine pour les ablutions. Tous ceux qui entrent ôtent leurs souliers dans le vestibule ; après être allés à la fontaine se laver les pieds, les mains, le derrière des oreilles, ils vont s'accroupir en se rangeant en lignes parallèles et en faisant face à la chaire où se trouve l'iman qui lit le Coran.
Beaucoup des assistants ont un chapelet à la main qu'ils passent dans leurs doigts en répétant les paroles de l'iman. A certains passages ils font tous ensemble des salutations et baisent plusieurs fois la terre dans le cours de la cérémonie qui dure environ une demi-heure. Aux occasions solennelles et quand ils le jugent convenables, les immense prêchent.
Les cérémonies dans les mosquées ont lieu tous les jours mais le vendredi est le jour férié de la semaine. C'est une obligation pour ceux qui sont dans les villes et les endroits où il y a un édifice religieux de s'y rendre ce jour-là au moins une fois après midi, ensuite chacun peut vaquer à ses affaires comme les autres jours ; Mahomet n'a point fait une obligation de repos le vendredi ; c'est un pavillon vert que le mound hisse sur le minaret ce jour-là ; le prince ou le gouverneur de la ville fait arborer son drapeau sur tous les forts et les tribus plantent les leurs autour des marabouts situés sur leur territoires.
Beaucoup de Maures ne travaillent pas le vendredi mais il y en a au moins autant qui ne changent rien à leurs habitudes si ce n'est d'aller à la mosquée après-midi .
Ce jour ressemble à notre dimanche et au samedi des Juifs.
Les Maures ont plusieurs autres jours de fête dans l'année. L'année mahométane est réglée sur le cours de la lune : elle se trouve ainsi divisée en douze mois dont chacun correspond à une révolution entière de cet astre autour de la terre ; on dit le premier jour de la lune, le deuxième jour de la lune, etc, et cela jusqu'au moment du renouvellement de la lune.
- Le premier mois de l'année se nomme mohharem ; il correspond à la fin de juin et au début de juillet,
- le second Safar et les autres
- Rabii-el-eouel,
- rabii-et-tany,
- Djoumad-el-eouel,
- Djoumad-et-tany,
- Redjeb,
- chaaban,
- Ramadan,
- Chaoual,
- Delkaadé,
- Delhadjé qui correspond à la fin de mai et au début de juin.
Ces mois sont alternativement de 29 et 30 jours : ainsi l'année se compose de 354 jours seulement.
- Le premier jour de l'année se nomme Achara. Les Maures célèbrent ordinairement ce jour en faisant des aumônes ou en versant quelques sommes dans les caisses destinées au soulagement des pauvres.
- La seconde fête est la naissance de Mahomet ; elle arrive le deuxième jour de Rabii-el-eouel . On met des lampions sur les minarets des mosquées, on en illumine l'intérieur avec un grand nombre de lampes et elles restent ouvertes toute la nuit. Les femmes font des pâtisseries et surtout des plats de couscoussou cuit avec du mouton ou des poules. Le soir les cafés sont illuminés et l'animation est faite par des musiciens ; les Maures parés depuis le matin de leurs plus beaux habits, vont boire du café et écouter la musique. La fête de Mahomet dure deux jours consécutifs pendant lesquels les musulmans vaquent à leurs affaires, vont à la mosquée aux heures voulues, vivent très bien chez eux, se réunissent le soir dans les cafés.
- Le Ramadan qui est le neuvième mois de l'année est le temps du carême qui commence en Chaaban à une époque que l'on appelle Herjan ; mais c'est particulièrement dans le mois de Ramadan que le jeûne est de rigueur. Pendant ce mois entier ceux qui observent bien la religion s'abstiennent de toute débauche et vivent le plus honnêtement qu'il leur est possible ; il ne leur est permis de boire que de l'eau, de faire un seul repas le soir après le coucher du soleil et ils ne doivent ni fumer ni priser durant toute la journée. Le 26, à midi, tous les bons croyants vont chez le mufti , chef des immense, et chez l'Adi, premier iman, avec une bougie en chantant des versets du Coran. En sortant de chez l'Adi on se rend devant la porte du palais du Dey ou celle du chef militaire de la ville et l'on récite une prière qui s'appelle Fata. Cette prière terminée, la procession se rend vers un marabout. Le 29, après le coucher du soleil, le mufti et tous les immense montent ensemble sur le minaret de la mosquée pour voir s'ils peuvent découvrir la lune et aussitôt qu'ils l'ont vu ils se rendent près du prince pour lui annoncer pour lui annoncer que la lune s'est levée et qu'elle leur promet une excellente année. Cet heureux évènement est aussi annoncé par un coup de canon ou une décharge de mousqueterie. Alors tous les hommes quittent leurs maisons pour se rendre dans les cafés.
- Le Beyram dure quatre jours durant lesquels on prie aux heures indiquées, on se divertit et on fait bonne chère ; il n'est pas défendu de travailler.
Les femmes ne paraissent point et ne prennent pas part à la joie publique ; il ne leur est pas même permis de se réunir dans les maisons pour se divertir entre elles ; cependant celles d'un même logis se parent de leur mieux et profitent de la bonne chère qui fait leur époux commun.
- La fête de l'Haïd-el-Kebir, arrive soixante dix jours après le Beyram dans le mois de Delhhadjé. Chaque famille tue un mouton. On va à la mosquée à six heures du matin et le quatrième jour, l'Agha va rendre une visite au souverain et fait jeter sur son chemin de l'argent aux pauvre : cette distribution se nomme l'Aouaïte.
- Enfin une fête des Maures a lieu le premier jour du mois de Chaoual que l'on appelle Herva en Barbarie . Ce jour-là après être sortis de la mosquée on se répand en foule dans la campagne, l'on coupe, avec une pièce d'or, du blé ou de l'orge que l'on emporte chez soi. Cette fête parait être peu solennelle et les autorités n'y prennent pas part.
Telles sont les fêtes observées par les Mahométans qui habitent la régence d'Alger ; les fidèles ne sont pas obligés de les chômer entièrement.
Voyage dans la régence d'Alger par M. Rozet
capitaine au corps royal d'État-Major.
Tome second 1833
|
|
Proche de la réalité
Envoyé par M. Elyette
|
|
Un gars meurt sur la frontière franco-allemande ..
Quand il arrive au ciel pour le jugement dernier, Saint-Pierre lui dit :
- Bon, votre vie sur terre, pas terrible... quelques adultères, pas souvent à la messe, des blasphèmes, etc., etc.,..
Je ne peux pas vous faire entrer au paradis, mais comme vous n'avez rien commis de grave et que vous êtes mort sur la frontière, je vous laisse tout de même le choix entre l'enfer allemand et l'enfer français.
- Mais Saint-Pierre, je ne connais ni l'un ni l'autre... pourriez vous m'en dire un peu plus SVP ?
- Et bien, dans l'enfer allemand, on vous met dans une grande marmite pleine de purin, des petits gnomes très vilains qui sentent mauvais mettent des bûches sous la marmite, un dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c'est tous les jours pareil !
- et l’enfer Français ?
- Et bien, dans l'enfer français, on vous met dans une grande marmite pleine de purin, des petits gnomes très vilains qui sentent mauvais mettent des bûches sous la marmite, un dragon vient allumer les bûches et vous cuisez toute la journée. Et c'est tous les jours pareil ! Mais, si vous voulez un bon conseil, je serais vous, je choisirais l'enfer français.
- Mais, Saint-Pierre, c'est exactement la même chose !
- Mais non, pas du tout ! Car dans l'enfer français :
un jour les gnomes sont en grève,
un jour on n'a pas livré les bûches,
un jour le dragon est en RTT,
un jour il est en congé maladie,
un jour ils ne trouvent plus la marmite,
un jour on n'a pas commandé le purin...
Et quand la CGT s’en mêle... je ne vous dis pas !
|
|
| Les Koulouglis
Envoyé par M. Christian Graille
|
Beaucoup de Turcs s'alliaient à des esclaves chrétiennes et les enfants qui en résultaient étaient considérés comme de véritables Turcs : ils pouvaient entrer dans la milice, jouir de toutes les prérogatives attachées à ce corps et par conséquent parvenir à tous les grades dans l'armée et aux charges les plus éminentes du Gouvernement, même être Dey. Mais les enfants qui naissaient des Mauresques mariées avec des Turcs n'avaient pas les mêmes avantages : ils formaient une classe à part et on les nommait Koulouglis. Les traits de leur visage et leur complexion décèlent leur origine : Ce sont généralement de très beaux hommes, bien faits, et qui ont un certain embonpoint. Ils ont la peau blanche et les muscles très prononcés mais leur démarche et tous leurs mouvements annoncent une nonchalance encore plus grande que celle de leurs parents.
La douceur et la tranquillité sont peintes sur leur figure. Je crois qu'en général ils ont un tempérament sympathique bien développé.
Je n'ai point eu l'occasion d'observer les filles des Turcs : ainsi je ne puis pas dire en quoi elles diffèrent des Maures ; mais elles doivent ressembler beaucoup à leurs frères et par conséquent être plus grasses et plus blanches que les Mauresques. Du reste on les élève et on les traite absolument de la même manière.
Le costume des Koulouglis ne diffère en rien de celui des Maures, seulement ils sont beaucoup plus propres : ils mettent dans leur manière de s'habiller une coquetterie qui convient assez à leur caractère et rappelle les mœurs asiatiques. Il ne me souvient pas d'avoir jamais vu un Koulougli exercer un art ou une profession quelconque dans les villes que j'ai visitées ; cela me fait croire qu'ils vivent généralement avec la fortune que leur ont laissé leurs parents dont les revenus étaient accrus par les prises des corsaires dans lesquelles ils avaient tous un certain intérêt. Beaucoup possédaient des maisons de campagne et des terres mais elles étaient cultivées par leurs esclaves qu'ils se contentaient de surveiller et de battre quand ils ne travaillaient pas bien. Leur instruction est la même que celle des Maures : ils fréquentent avec eux les mêmes écoles mais leur caractère insolent empêchent qu'ils ne profitent autant que les autres des leçons qu'on leur donne ; Je les crois en général ignorants et vains.
Dans l'état social les Koulouglis sont tout à fait confondus avec les Maures : ils ne conservent plus aucun des privilèges dont jouissent leurs pères ; seulement comme ils sont liés par le sang avec les Turcs ils n'avaient point à en redouter toutes les vexations qu'ils faisaient endurer à toutes les autres classes de la population mais ils ne pouvaient pas parvenir aux grades élevés dans l'armée ni aux places éminentes du gouvernement. Ce n'était guère qu'en temps de guerre qu'on les armait, encore étaient-ils commandés par des officiers turcs.
Nous n'avons pas eu l'occasion d'apprécier leur valeur. Dans les combats nous les confondions avec les Turcs et les Maures. Mais à en juger par leur conversation et la mollesse de leur vie ordinaire, ils ne doivent pas être de grands guerriers bien redoutables.
Je n'ai jamais vu de Koulougli se porter à aucun acte de violence ni menacer qui que ce soit.
Les fils de Turcs professent la religion dans laquelle ils sont nés mais avec la même indifférence que celles qu'ils apportent dans leurs autres actes. Ils vont cependant dans les mosquées aux heures de prière mais beaucoup moins exactement que les autres Musulmans. J'ai causé avec plusieurs qui ne croyaient pas en Dieu qu'autant qu'il est nécessaire pour ne point nier son existence : ils m'ont dit bien souvent qu'après la mort tout était fini pour les hommes et que ces jouissances éternelles qu'on leur promettait dans l'autre monde n'étaient que pour les consoler de quitter celui-ci. Cette manière de raisonner annonce des hommes qui ne sont point superstitieux : effectivement je ne les ai jamais vus se livrer à toutes ces pratiques dans l'exercice desquelles on surprend si souvent les Maures et les Arabes des amulettes et passer des heures entières à faire couler dans leurs doigts les grains d'un chapelet.
Je crois que les Koulouglis sont tous les habitants de la Barbaria, ceux qui ont les mœurs les plus douces ; ils passent leur vie dans des jardins remplis de fleurs au milieu de leur famille à se promener et à se faire servir par des esclaves des deux sexes.
Ils aiment beaucoup la parure et ils affectent sur eux et dans leurs vêtements une grande propreté : on rencontre souvent dans les rues et dans les environs de la ville les jeunes gens se promenant plusieurs ensemble et se tenant deux à deux par la main en cherchant à se donner des postures élégantes, se souriant et penchant de temps en temps la tête en signe d'amitié.
Je ne sais pas s'ils aiment beaucoup les femmes mais ce qui paraît bien certain c'est qu'ils se livrent entre eux à cette passion brutale dont nous avons déjà parlé plus que les autres peuples de la régence.
Dans les promenades qu'ils font ensemble et lorsqu'ils sont réunis dans les cafés ou devant les boutiques des barbiers on peut parfaitement distinguer en les observant pendant quelques heures ceux qui ont des liaisons les uns avec les autres.
Voyage dans le Régence d'Alger par M. Rozet,
Capitaine au corps royal d'État-Major.
Tome II. Édition 1833
|
|
| Mzabites
Envoyé par M. Christian Graille
|
Les habitants du Mzab, appelés Mzabites ou Beni-Mzab, forment un petit peuple de Berbères berbérisants de cinquante à soixante mille âmes, qui ont toujours su se préserver de toute contamination étrangère. Comme tous les Berbères ils ont accepté l'Islam.
Cette apostasie de toutes les nations qui habitaient l'Afrique septentrionale est un des faits les plus curieux que l'histoire ait eu à enregistrer ; au moment de l'invasion arabe en 643 le Maghreb tout entier était occupé par des populations chrétiennes ou juives ; il est certain que tous les chrétiens et presque tous les juifs se sont faits mahométans.
Ces conversions ne doivent pas être attribuées, ainsi qu'on pourrait le croire, à des rigueurs exercées en Afrique plus considérables que celles qu'ont eu à subir de ces même conquérants les chrétiens et les juifs de l'Arabie, de l'Égypte où une grande partie de la population a conservé le christianisme et le judaïsme, tout en acceptant la domination des mahométans.
Ce fait de l'apostasie des Berbères paraîtra moins extraordinaire si l'on se rappelle que ces populations avaient déjà eu à subir un changement de religion ; les Vandales lorsqu'ils envahirent l'Afrique au sixième siècle y avaient implanté l'arianisme ( Hérésie chrétienne d'Arius qui, rejetant l'unité et l'identité de substance du Fils avec le Père, ne reconnaît que partiellement la nature divine de Jésus-Christ refusant ainsi le dogme de la Trinité.) par le fer, le feu et le sang.
Déjà au quatrième siècle les chrétiens africains étaient fort divisés ; au moment de l'invasion arabe les dissensions religieuses avaient mis le trouble dans tout le pays.
Il n'y avait pas de si petite bourgade qui n'eût plusieurs évêques s'excommuniant les uns les autres. Les familles étaient divisées et il n'était pas rare de voir le père d'une secte, la mère d'une deuxième, le fils d'une troisième, la fille d'une quatrième et ainsi de suite.
Aussi un grand nombre de Berbères chrétiens acceptèrent-ils plus facilement une nouvelle religion qui se donnait comme la suite du christianisme et qui pouvait mettre fin à leurs luttes religieuses.
Ce sont les Berbères qui conquirent en grande partie l'Espagne ; c'est eux qui l'organisèrent et qui firent élever ces monuments merveilleux de la domination musulmane.
Il y en eut d'autres, les Touaregs, les Beni-Mzab qui se retirèrent dans le Sahara et y ont conservé dans leurs oasis les vestiges d'une civilisation qu'ils tiennent de Carthage et de Rome. Ils ont aussi conservé, quoique mahométans, l'usage de l'année solaire et ils donnent à leurs mois des noms qui rappellent les nôtres. Ils ne se servent du calendrier musulman que pour les fêtes.
Le fond de la croyance des Mzabites est basé sur la lettre du Coran ; ils ne reconnaissent aucun commentateur et n'admettent nullement la noblesse religieuse des marabouts.
Ils ne croient pas que la vertu puisse être donnée comme un nom par filiation. Dans la pratique de leur religion ils ont conservé plusieurs coutumes qui paraissent dérivées du christianisme ou du judaïsme que ces populations ont très probablement professé.
Ils font par exemple des ablutions beaucoup plus complètes que les Arabes ; ils ont dans leurs mosquées de petits cabinets dans lesquels se trouvent des cuves où ils se lavent le corps. Les israélites faisaient de même pour les purifications prescrites par la loi de Moïse.
Lorsqu'un homme a commis quelque faute grave, ils prononcent, contre lui, la peine du bannissement, véritable excommunication. Un banni devient complètement étranger :
- ses biens sont confisqués au profit de la mosquée ou distribués à ses héritiers,
- le banni est considéré comme mort,
- il devient une chose immonde,
- il ne peut plus entrer dans aucune ville du Mzab,
- aucun de ses concitoyens ne peut, sans encourir des peines sévères,
- loger sous le même toit que lu,
- lui donner une nourriture quelconque, ne serait-ce que de l'eau, est considéré comme une faute grave, et l'on est réputé avoir failli et obligé de payer l'amende si l'on laisse, même par mégarde, son burnous frôler les vêtements d'un banni.
Toute faute, depuis la plus grave jusqu'à la plus légère, peut être rachetée au Mzab d'une façon bien curieuse. Un Beni-Mzab, qui se sent la conscience peu en ordre, se rend, un vendredi, au moment de la prière, à la mosquée ; il se met au milieu du temple, dans la posture d'un suppliant, quand tous les fidèles sont réunis.
Le prêtre avant de commencer, lui demande ce qu'il veut ; le patient déclare devant toute l'assistance qu'il est coupable ; il énumère les fautes qu'il a commises et finit en demandant pardon. Il est admonesté par le prêtre, qui lui promet le pardon, s'il veut s'astreindre à la pénitence qui lui sera imposée et qui consiste à rester pendant un temps, plus ou moins long, privé de tout rapport avec ses coreligionnaires, quoique vivant au milieu d'eux.
N'est-ce pas là la confession publique et la pénitence du christianisme des premiers siècles ?
L'autorité des prêtres (la Djemâa, assemblée de notables) qui prennent le nom modeste de Tolba (étudiants) est considérable au Mzab tandis que le pouvoir civil est restreint à l'administration d'une seule ville.
La Djemâa a une domination complète sur la confédération toute entière.
Ce clergé a une organisation qui rappelle celle de l'église romaine; à sa tête se trouve un chef unique nommé par le chef des Tolba de chaque ville qui peuvent être assimilés aux évêques et c'est lui qui nomme de son vivant les chefs des Tolba.
Le pouvoir judiciaire tout entier est entre les mains de ces prêtres ; c'est eux qui condamnent sans appel les infractions aux lois du Mzab.
Quelques-unes de ces lois doivent être indiquées ici :
- Il est interdit aux Beni-Mzab d'épouser une femme de race étrangère. L'infraction à cette loi est punie du bannissement perpétuel.
- Les femmes mariées et les filles ne peuvent quitter le Mzab sous quelque prétexte que ce soit ; la peine est encore le bannissement perpétuel.
- Un Mzabite ne peut voyager avant d'être marié et s'il n'a pas d'enfant il doit, avant de partir, jurer qu'il laisse sa femme enceinte ; cette dernière loi est depuis quelque temps tombée en désuétude.
Les peines que peuvent infliger d'après la loi les Tolba sont pour les fautes graves,
- le bannissement à temps ou à perpétuité,
- pour les moindre,
- la bastonnade.
La peine de mort et la prison sont inconnues ; les amendes sont infligées par les Djemâa pour infraction aux règlements municipaux.
Les mosquées ont de grands biens et chaque citoyen est obligé à donner, suivant ses moyens, un tribut. Comme dans nos anciennes paroisses, se tiennent des registres de l'état civil où sont soigneusement enregistrés les naissances, les décès, les mariages.
Le mariage est au Mzab un acte sérieux ; la famille y est fondée sur des principes analogues à ceux des occidentaux ; le Mzabite est monogame, n'achète point sa femme, au contraire elle lui apporte une dot, et quoique la femme mariée ne sorte point du Mzab elle a une grande influence sur toute sa famille et se laisse voir des parents et des amis qui fréquentent sa maison. Le divorce existe bien au Mzab mais il est très rarement appliqué.
Les Tolba ne l'accordent que pour de graves motifs.
Les registres de l'état-civil ne sont pas les seuls à être tenus ; des chroniques sont rédigées et sont consignées sur tous les faits qui se passent au Mzab tout comme les procès-verbaux des réunions du clergé.
Chaque ville est administrée séparément par une Djemâa dont les membres, comme l'étaient les Sénateurs de Rome, les anciens de Carthage et ceux des conseils qui gouvernaient les villes des Phocéens, sont choisis parmi les chefs des anciennes familles de chaque cité.
Chaque Djemâa élit trois mokadem (gardiens) qui s'occupent d'une manière plus spéciale de l'administration de la commune. Ils ont dans leurs attributions :
- la police des marchés, de la voirie,
- la répression de tous les délits qui peuvent être commis.
Ce sont eux :
- qui sont chargés d'assembler la Djemâa,
- de porter à sa connaissance les affaires qui l'intéressent,
- de faire exécuter ses décisions.
Les Beni-Mzab, perdus comme ils le sont au milieu du Sahara, exposés aux courses des Touaregs, des Chaamba, etc., étant tous marchands et ayant des richesses considérables chez eux, ont dû se préoccuper des moyens de se mettre à l'abri de ces dangers, et ils ont su organiser une force militaire capable de les faire respecter.
Dans chaque mosquée se tient un rôle où est soigneusement marqué le nom de tous les hommes valides en état de porter les armes : il est indiqué sur ce même rôle si la personne est au Mzab ou si elle en est sortie, si elle a un cheval, un mulet.
Chaque citoyen est obligé d'avoir chez lui et de représenter aux tolba, chaque fois qu'il en est requis,
- un fusil,
- un pistolet,
- un sabre et une giberne,
- plus une provision déterminée de poudre et de balles.
Chaque ville est entourée d'une muraille soigneusement bâtie, dans les tours de laquelle veillent constamment plusieurs citoyens ayant leurs armes auprès d'eux.
Malgré cette milice, les Beni-Mzab ne se sont pas toujours crus assez forts, et ils ont quelquefois appelé à leur secours des nomades qu'ils ont pris à leur solde ; et cela souvent pour se livrer aux luttes intestines qui ont déchiré bien des fois leur confédération, qui est divisée en partis, comme l'étaient, au moyen-âge, les petites républiques italiennes.
Au physique, les Beni-Mzab se distinguent des autres Berbères en ce qu'ils n'ont presque pas de blonds parmi eux et des populations d'origine arabe, par leurs mains et leurs pieds très développés et leur taille petite et ramassée. Les Beni-Mzab sont trapus, parce qu'ils ont, dit-on, l'habitude de rester accroupis dans des boutiques ; cette raison est mauvaise : Les Juifs du Sahara sont généralement grands, et ils vivent tout autant dans les boutiques que les Beni-Mzab ; je crois que la courte taille du Mzabite provient plutôt du travail spécial auquel il est soumis dès l'enfance, et qui consister à tirer, plusieurs heures par jour, sur une corde pour puiser de l'eau ; un travail analogue a amoindri la taille d'un grand nombre de populations maritimes de l'Europe.
Si au Mzab l'on occupe manuellement tous les jeunes garçons, l'on est loin de négliger leur éducation intellectuelle : ils passent chaque jour plusieurs heures dans les écoles tenues par les Tolba et qui sont situées près des mosquées. Là on leur apprend, avec les préceptes de la religion et les lois particulières au pays, à lire, à écrire et calculer en langue arabe ; l'idiome berbère étant considéré comme un patois ne s'enseigne pas.
Plusieurs Mzabites font apprendre à leurs enfants les éléments de la langue française qu'ils comprennent et parlent presque tous et qu'un certain nombre lit et écrit.
Les Beni-Mzab du reste élèvent rudement leurs fils ; rarement ils les laissent jouer ; levés avec le jour, ils les envoient dans les jardins où ils puisent l'eau pendant trois ou quatre heures consécutives. En quittant ces jardins ils les font aller à l'école, et de l'école ils retournent travailler la terre ou sont employés dans les boutiques de leurs parents.
Tous les Beni-Mzab s'occupent ou se sont occupés de commerce ; ils ont et au Mzab et dans le Tell algérien ou tunisien des comptoirs dans lesquels ils vendaient toute espèce de marchandises, font des opérations de banque, etc. Leur industrie est assez développée ; ils se livrent en grand à la fabrication de la poudre et ils ont de quatre à cinq mille métiers sur lesquels les femmes fabriquent des étoffes d'un tissu ordinaire mais très apprécié.
- Les burnous,
- les haïks,
- les tapis du Mzab sont répandus dans toute l'Afrique du Nord et dans tout le Sahara, et le bas prix auquel une main-d'œuvre peu coûteuse permet de les livrer leur assure toujours un écoulement rapide et certain.
Le début dans les affaires d'un Beni-Mzab, quand il n'est point commandité par un parent, un ami ou un ancien patron consiste à aller dans le Tell vendre de ces tissus de laine. Quand un Mzabite est arrivé à Alger, Tunis, Constantine ou toute autre ville du Tell avec sa charge de tissus, il emploie l'argent que lui a procuré la vente de sa pacotille à ouvrir un étal de boucher ou une boutique de maraîcher et il passe un ou deux ans ainsi occupé. Au bout de ce temps, un autre Mzabite avec lequel il est associé et qui est resté dans le désert soignant les palmiers et la maison de l'ami qui habite le Tell, arrivera pour le remplacer dans sa boutique ; lui retourne au Mzab avec des marchandises et il ouvre un magasin dans son pays et ces deux associés commenceront ainsi une maison de commerce qui au bout de quelques années comptera plusieurs succursales, et avec le temps elle peut devenir très puissante. Il y a des Beni-Mzab aujourd'hui millionnaires qui n'ont point eu d'autres débuts.
Les femmes vivent constamment enfermées dans les maisons à filer et à tisser. Ces mille et mille commissions qui obligent nos ménagères à sortir à chaque instant du jour sont faites par les petites filles ; c'est elles qui donnent aux villes du Mzab de l'animation et de la gaieté ; elles sont forts gentilles et presque toutes jolies, ayant de grands yeux noirs et des traits réguliers, vêtues à peu près comme les autres filles du désert d'une robe en laine rouge ou bleue, retenue par des agrafes de métal et serrée à la taille par une ceinture ; elles n'ont aucune autre coiffure que leurs cheveux, qui sont arrangés d'une façon assez bizarre ; derrière la tête elles en font une sorte de couronne et de chaque côté des tempes une grosse coque ; cela leur donne une physionomie étrange ; elle est encore augmentée par l'usage où l'on est de leur badigeonner le bout du nez avec du goudron pour les préserver du mauvais œil.
Les savants ont déjà discuté sans conclure pour savoir à quelle race primitive l'on peut rattacher les Beni-Mzab ; je croirais volontiers qu'ils appartiennent à la race sémite et que ce sont ou des anciens israélites ou qu'ils descendent de ces peuples qui habitaient la Palestine et avaient une foule d'usages communs avec les Hébreux, tels que la circoncision.
Ne seraient-ils pas des Moabites qui vécurent longtemps dans l'amitié d'Israël et furent tributaires de David ?
Et pourquoi ne trouverait-on pas dans les Mzabites des descendants des anciens Carthaginois ?
Quelques colonies de ces riches et fiers marchands n'auraient-elles pas pu chercher, après la destruction de Carthage, un asile dans le Sahara ? Cette hypothèse expliquerait le soin religieux avec lequel ils ont toujours conservé la pureté de leur race et la tradition commune chez eux qui les fait originaires de l'Orient.
L'Algérie occidentale Algérie, Mzab, Tildikelt
Paul Soleillet (b) Édition 1877
|
|
| Les Noirs
Envoyé par M. Christian Graille
|
Depuis un temps immémorial, les Maures et même les Arabes qui habitent dans la régence d'Alger, ont des esclaves noirs des deux sexes qui leur sont amenés de l'intérieur du continent par des caravanes qui vont les chercher, ou des habitants des confins du désert qui en amènent sur la côte pour les vendre. Les caravanes qui vont dans l'intérieur de l'Afrique pour chercher des Noirs partent ordinairement de l'empire du Maroc ; elles amènent :
- de la quincaillerie,
- des toiles bleues,
- des draps verts et rouges, dont elles tirent un très bon parti en les échangeant contre de la poudre d'or et des Noirs.
Les marchands viennent ensuite vendre leurs esclaves sur toute la côte Nord de l'Afrique jusque dans l'Asie Mineure et même la Turquie. Parmi ces esclaves, il y a beaucoup d'enfants de cinq à six ans ; on y amène quelques fois des familles entières.
Les Noirs sont vendus suivant leurs qualités du corps et de l'esprit : un homme jeune et fort coûte depuis 100 jusqu'à 200 réaux-boudjoux (185 à 370 francs). Les femmes sont plus chères, surtout quand elles sont jeunes et belles et qu'elles savent bien travailler, c'est-à-dire coudre et faire la cuisine ; elles vont depuis 100 jusqu'à 500 réaux-boudjoux.
Les enfants de six à huit ans se vendent 50 et 80 boudjoux.
Presque tous les Maures ont des esclaves ; il n'y a que chez les gens pauvres chez lesquels on n'en trouve pas ; les gens riches en ont jusqu'à vingt.
Au mois de septembre 1831, le Cadi maure d'Alger avait douze femmes noires sans compter les hommes.
Les esclaves sont assez bien traités par leurs maîtres, qui les frappent à coups de bâton cependant toutes les fois qu'ils le méritent. Ce rude traitement n'empêche pas qu'ils ne leur soient fortement attachés, et qu'ils ne prennent leurs intérêts dans toutes les circonstances.
Les Noirs peuvent racheter leur liberté par des services ou à prix d'argent. Au lit de la mort beaucoup de personnes donnent la liberté à leurs esclaves ; alors ils se font musulmans s'ils ne l'étaient pas déjà et jouissent de tous les droits de citoyens. Voici de quelle manière a pris la naissance de la population noire que l'on trouve maintenant répandue dans les États barbaresques.
Tous les esclaves qui viennent du centre de l'Afrique ont, sur les deux joues, des marques faites avec un instrument tranchant qui sont ineffaçables, et c'est à quoi on distingue les esclaves émancipés des noirs nés dans la Barbarie. Quoique les Noirs et les Blancs cohabitent souvent ensemble, il n'y a point de mulâtres dans toute la portion des États algériens que j'ai visités. J'ai remarqué plusieurs noires et particulièrement dans l'intérieur des terres (à Blida et à Médéa), d'une couleur jaune un peu terne, avec des cheveux un peu crépus, le nez écrasé mais ayant la bouche bien faite et les traits généralement plus doux que celles qui sont tout à fait noires.
Il y a une variété de femmes noires comme du jais et que le Dey Hussein-Pacha recherchait particulièrement, dont les traits ont beaucoup de rapport avec ceux des figures romaines : elles ont le nez aquilin, les lèvres peu prononcées, les yeux grands, le front découvert.
Les Noirs accoutumés à vivre chez les Maures depuis le commencement de leur séjour dans le pays, habitent comme eux dans des maisons construites à chaux et à sable ; ils restent ordinairement dans les villes ou dans les environs à une très petite distance.
Costumes
Le costume des hommes est le même que celui des Maures ; ils portent le turban. Les Noirs riches sont toujours bien habillés.
Les femmes libres se vêtissent comme les Mauresques, en se couvrant la figure avec moins de soin cependant que ces dernières ; mais un grand nombre, et surtout celles de la classe pauvre, conservent leur costume d'esclave qui consiste dans :
- une chemise blanche à courtes manches,
- une culotte de toile brune,
- une pièce de toile bleue rayée de blanc dans laquelle elles s'enveloppent en se couvrant la tête de manière à ne laisser voir que les yeux mais certaines se promènent dans les rues avec le visage découvert. Elles aiment passionnément les bijoux ; elles aiment surtout les bracelets et les boucles d'oreilles.
Leurs enfants sont vêtus comme leurs parents, mais beaucoup vont tout nus durant leur enfance ou seulement affublés d'un morceau de laine ou de toile. Les aliments des Noirs sont les mêmes que ceux des Maures, mais ils aiment beaucoup la viande et en mangent plus souvent que ceux-ci surtout à Alger où ils tiennent presque toutes les boucheries.
Industrie
Quelques-uns sont cultivateurs mais le plus grand nombre travaille dans les villes et exercent toutes sortes de métiers. Il y en a qui sont :
- maçons,
- artificiers du Dey,
- musiciens.
Ce sont eux qui accompagnent les grands aux jours solennels et qui sont chargés de toutes les sérénades ou plus exactement tous les charivaris que l'on donne à différentes périodes de l'année. Leurs instruments sont :
- des castagnettes en fer,
- des peaux de moutons tannées collées sur des pots en terre ou sur des cylindres de bois,
- des guitares faites avec une calebasse ou de petites planches réunies ensemble par des cordes et recouvertes d'une peau de mouton,
- d'énormes chalumeaux composés de roseaux cousus dans une peau de mouton.
On conçoit, sans qu'il soit besoin de l'entendre, tout l'agrément de la musique que l'on peut faire avec de tels instruments ; cependant les Algériens y prennent beaucoup de plaisir et la préfèrent à la nôtre qu'ils trouvent embrouillée et sans caractère.
Djelep
Les Maures croyaient fermement que le diable donnait la connaissance de l'avenir à ceux qui en étaient possédés et qu'à leur tour ceux-ci transmettaient cette propriété à qui leur plaisait.
Ceux qui ont intérêt à connaître l'avenir vont trouver le chef des Noirs (le Kaïlausfan), lui demandent quand le djelep aura lieu et lui paient une certaine somme pour avoir la permission d'y assister car il n'est permis à personne de s'y présenter s'il n'en a pas préalablement obtenu l'autorisation qui étaient toujours refusée aux Juifs et aux Chrétiens.
Cette cérémonie ne peut se faire que quarante jours par an et à des époques fixées par le Kaïlausfan : elle commence ordinairement après le Ramadan ; on en fait prévenir les personnes qui ont demandé à y assister et celles que l'on croit qui le désirent.
Les futurs possédés, qui sont des femmes et des hommes, mais bien plus souvent des femmes, se rendent la veille au soir avec les principaux acteurs, et surtout un vieil homme et une vieille femme, dans une maison destinée uniquement à toutes ces pratiques superstitieuses ; là, les possédés sont mis dans une chambre garnie de coussins et de tapis et dont l'entrée est fermée par un rideau. Les deux vieillards, aidés par quelques personnes, prennent :
- du benjoin,
- de la gomme arabique,
- une essence qu'ils appellent sambel,
- quelques morceaux d'un bois nommé calcari, et jettent tout cela dans un réchaud de terre allumé.
Auparavant ils ont tué quatre poules ; avec le sang ils frottent les jointures de ceux qui sont enfermés dans la chambre : ils les parfument avec le mélange qu'ils ont mis dans le réchaud et les habillent chacun d'une manière différente.
On leur met des espèces de robes (caftan) qui leur descendent jusqu'aux talons, des ceintures et des bonnets garnis de coquillages qui ne sont pas assez assujettis pour les empêcher de frapper les uns contre les autres et de faire du bruit quand celui qui les porte se met à danser.
Le lendemain matin, et bien souvent la nuit même, arrivent vingt ou trente musiciens qui s'accroupissent sous la galerie du rez-de-chaussée, tous du même côté ; devant eux et en dehors de la galerie on met un petit tapis assez large pour recevoir les pièces d'argent que l'on jette dessus. Le pavé de la cour est bien nettoyé mais il n'est point couvert de nattes et de tapis et on ne peut marcher dessus sans ôter ses souliers.
Les personnes qui ont demandé à assister à la cérémonie sont introduites à mesure qu'elles se présentent. Un, au plus deux des possédés, accompagnés de plusieurs noires parées à peu près comme eux sont amenés au milieu de la cour : à leur arrivée on les parfume avec un peu de mélange jeté dans le réchaud et on les abandonne à eux-mêmes.
Les musiciens commencent alors un vacarme épouvantable.
Le possédé se met aussitôt à danser avec assez de tranquillité et en suivant très bien la mesure du charivari qu'on lui fait ; toutes les Noires qui l'accompagnent dansent en contrefaisant ses mouvements. Ceux du premier danseur sont de plus en plus précipités ;
- il s'anime,
- il entre bientôt en fureur,
- pousse des cris affreux et fait toutes sortes de contorsions : c'est le moment où le diable commence à s'emparer de lui.
Les assistants qui veulent avoir part à la faveur qui leur est accordée, s'approchent et jettent de l'argent sur le tapis ; ceux qui n'ont point d'argent donnent des bougies, du pain, de la viande etc. La musique redouble ; le possédé s'anime de plus en plus ; enfin, étourdi par le bruit et harassé de fatigue, il tombe sans connaissance : ses compagnons de danse se retirent et un des vieillards vient avec le réchaud pour lui parfumer tout le corps.
La musique cesse aussitôt qu'il est tombé. Au bout de quelques minutes il reprend des forces, il se lève, la musique recommence doucement, il se met à danser : les premiers danseurs et d'autres viennent l'accompagner et cela continue jusqu'à ce qu'il tombe encore. On recommence tant que la personne, femme ou homme, n'en peut absolument plus et alors on croit que le diable est entré chez elle.
La danseuse principale, la Pythonisse (femme possédant des pouvoirs de divination) était une belle noire de vingt à vingt-cinq ans ; elle avait une robe de soie verte rayée de jaune, une ceinture et un bonnet garni de coquillage et de grelots. Lorsqu'elle fut tombée plusieurs fois en dansant, la vieille arriva avec deux énormes poignards en fer dont les pointes étaient émoussées, et les lui donna.
La jeune femme se mit alors à danser en tenant un poignard dans chaque main, faisant des gestes convulsifs et poussant des cris qui dépassaient de beaucoup le bruit des caisses et des castagnettes.
Tout à coup elle se frappa avec les poignards d'une manière si violente qu'elle aurait pu se faire beaucoup de mal, si la vieille ne fut venue très adroitement les lui arracher des mains. Alors la danseuse rentrée en fureur, s'est jetée sur une femme mauresque qui s'était approchée d'elle ; elle l'a renversée, s'est penchée sur elle et lui a craché au visage. Celle-ci s'est laissée faire sans dire un seul mot ; elle paraissait même très satisfaite.
La Sybille (femme possédant un pouvoir de prophétie), après l'avoir quittée, s'est sauvée dans une chambre voisine ; mais elle en est bientôt sortie en poussant de grands cris. La musique a joué et elle s'est remise à danser de plus belle : elle était presque épuisée et je m'attendais à la voir tomber lorsque la vieille est arrivée avec deux bâtons ornés d'ivoire et garnis de franges aux deux extrémités. Après s'être emparée de ces bâtons ses forces sont revenues : elle dansa, puis tomba subitement sans connaissance. Un musicien s'est alors approché d'elle, s'est mis à genoux et lui a baisé les mains et les pieds ; aussitôt elle s'est relevée furieuse, l'a terrassé et après lui avoir fortement appuyé le ventre contre terre, elle lui a croisé les bras et les jambes, a fait tous ses efforts pour lui tordre le cou et l'a laissé aller ensuite.
Elle s'est remise à danser mais au bout de quelque temps elle est tombée sans connaissance et on l'a emportée. Le charivari des Noirs dure plusieurs jours de suite sans être interrompu pendant la nuit. Toutes les personnes disposées à recevoir le diable dans le corps, dansent les unes après les autres jusqu'à l'épuisement : il en meurt quelquefois dans la cérémonie et beaucoup gagnent des fluxions de poitrine qui les emportent quelques jours après.
Il n'y a guère que les Noirs qui se livrent à cet excès de démence. Les gens raisonnables se moquent de cette cérémonie barbare mais les esprits faibles et surtout les femmes y attachent une grande importance.
Les Noirs ne forment un peuple distinct des Maures qu'à cause de la couleur de leur peau et de quelques pratiques ridicules auxquelles ils se livrent ; ils jouissent de tous les droits politiques accordés à ceux-ci. Ils vont à la guerre comme soldats et sont généralement très braves.
Mœurs et coutumes
Les Algériens ont beaucoup de confiance dans leurs esclaves et il parait que ceux-ci ne les trompent presque jamais : c'est probablement la crainte des châtiments qui les retient.
Il est fort rare de voir un Noir rechercher une mauresque et jamais il ne contracte de mariage avec elle : de là vient que leurs familles conservent leur sang aussi pur qui s'ils vivaient dans l'intérieur de l'Afrique.
Voyage dans la régence d'Alger par M. Rozet,
capitaine au corps royal d'État-Major.
Tome second. 1833
|
|
| Les Touaregs
Envoyé par M. Christian Graille
|
Il est difficile de circonscrire exactement le territoire habité par les Touaregs.
La vie exceptionnelle qu'ils mènent échappe à toute appréciation géographique un peu certaine ; nous les retrouvons partout dans cet immense périmètre, cerclé par une ligne qui, du Tidikelt dans le Touat ( Régions du Sahara), descend à Tombouctou, longe le Niger de l'ouest à l'est et remonte par le Fezzan jusqu'à Rdamês, le point extrême de la province de Tripoli.
Un grand archipel montagneux égaré dans le centre à peu près de cette immensité et qu'on appelle le Djebel-Hoggar est le nid, le refuge des véritables Touaregs, des Touaregs-Haras. Cependant, quelques fractions de leur grande tribu ont fait élection de domicile plus près de notre Sahara. D'autres sont campées en avant et dans la proximité de Tombouctou qu'ils tiennent en état de blocus perpétuel. Beaucoup sans doute nous sont inconnus.
Jalonnés dans le désert, les uns au nord, les autres au centre, d'autres au sud, ils gardent les portes du Sahara et celles du Soudan prélevant sur les caravanes
- un droit de sortie,
- un droit de voyage,
- un droit d'entrée,
et si quelqu'une passe en contrebande, elle est impitoyablement pillée.
Quelle est l'origine de ce peuple singulier morcelé ainsi en tant de bandes, si distantes les unes des autres, et qui toutes, dans le Nord au moins, révèlent par leurs traits, par leurs mœurs, par leur langage, une race commune ? Nous renonçons, quant à nous, à résoudre cette question, et nous nous bornerons à résumer les notes éparses que nous ont fournies cent Arabes, qui avaient vu les Touaregs, avaient commercé avec eux ou voyagé sous leur sauvegarde. Les Touaregs prétendent descendre des Turcs ; nous croyons inutiles de discuter cette opinion accréditée sans doute par leur amour-propre car ils affectent de mépriser les Arabes qu'ils traitent en peuple vaincu. Quoi qu'il en soit, ils sont grands, forts, minces et de couleur blanche. Cependant les fractions que l'on retrouve autour des villes du Soudan sont de sang mêlé ; leurs yeux sont généralement très beaux, leurs dents très belles ; ils portent de grandes moustaches à la manière des Turcs, et sur le sommet de la tête une touffe de cheveux qu'ils ne coupent jamais et qui, chez certains d'entre eux devient si longue qu'ils sont obligés de la tresser.
Le tour de leur tête est rasé ; tous ont des boucles d'oreilles.
Leur costume consiste en une grande robe qui ressemble à la djellaba ou habaïa des kabyles ; elle est très large, très ample et faite de bandes réunies de cette étoffe noire étroite appelée soie qui vient du Soudan.
Dessous ils portent un pantalon qui a quelques rapports avec celui des Européens mais qui se soutient sur les hanches à l'aide d'un cordon passé dans une coulisse ; une ceinture en laine leur presse la taille. Pour coiffure, ils ont une chéchia très élevée, fixée à leur tête par une pièce d'étoffe roulée en façon turban et dont un des bout passé dans toute sa largeur sur leur figure n'en laisse voir que les yeux, " car disent-ils, des gens nobles ne doivent pas se montrer. "
Les chefs seuls portent des burnous.
Presque tous riches ou pauvres ont les pieds nus ; si on leur demande la raison : " C'est que, répondent-ils, nous n'allons jamais à pied. " Ceux d'entre eux pourtant qui, faute d'un chameau, sont obligés de marcher dans les sables portent des espèces d'espadrilles liées à la jambe par des cordons. Leurs armes sont :
- une lance très longue dont le fer est taillé en losange,
- un sabre large et long, à deux tranchants,
- un couteau fourré dans une gaine de cuir appliquée sous l'avant-bras où elle est fixée par un cordon de manière à ce que le manche de l'instrument qui vient s'arrêter au creux de la main soit toujours facile à saisir et ne gêne en rien les mouvements,
- un grand bouclier en morceaux de peau d'éléphants, consolidés par des clubs et dont ils se servent avec beaucoup d'adresse, complète cet arsenal portatif.
Les chefs et les plus riches seulement ont des fusils dont quelques-uns sont à deux coups.
Très sobres au besoin, ils resteront deux ou trois jours sans boire ni manger plutôt que de manquer un coup de main ; mais très gloutons à l'occasion ils se dédommagent largement après la razzia.
Leur nourriture habituelle est
- le lait,
- les dattes,
- la viande de mouton et de chameau et par exception,
- des galettes de farine ou du kouskoussou car ils n'ont que peu ou point de blé, celui seulement qu'ils pillent.
Ils sont riches en troupeaux de chameaux et de rares espèces de moutons qui n'ont point de laine mais un poil très court et qui se distinguent par une queue énorme. Les Touaregs parlent le Targuïa. Cette langue semble avoir un certain rapport avec le zenatïa car si nous en croyons les habitants du Touat, ils comprennent les Touaregs et s'en font comprendre.
Leurs femmes vont la figure découverte ; elles sont très belles et très blanches : " Blanches comme une chrétienne. " Quelques-unes ont les yeux bleus et c'est dans la tribu un genre de beauté fort admiré ; toutes sont très sensuelles. Leur costume consiste en un pantalon en soie noire, une robe large de même étoffe et de même couleur et une espèce de coiffe dont nous n'avons pu saisir la description.
Les plus riches se chargent de bijoux ; les autres n'ont pour tout ornement que des bracelets en corne aux avant-bras. Hommes et femmes portent au cou des colliers de talismans. Leur religion est la musulmane mais :
- ils prient peu,
- ne jeûnent point,
- ne font point les ablutions ordonnées,
- ne saignent pas les animaux comme le veut la loi ; ils leur coupent la tête d'un coup de sabre.
Aux jours de grandes fêtes de l'islamisme, au lieu de faire des prières, ils se réjouissent par des combats simulés, par des essais de petite guerre qu'ils mettent en pratique à la première occasion.
Ils n'ont, en un mot, de musulmans que le titre et il serait difficile qu'il en fût autrement au milieu de la vie sans cesse agitée qu'ils mènent. Cette forme de mépris pour le Coran et la terreur qu'ils inspirent aux Arabes n'ont pas peu contribué sans doute à exagérer leur détestable réputation. Sous les tentes du Tell on parle des Touaregs comme autrefois, chez nous, on parlait des Turcs.
Il n'y a, au reste, qu'une voix sur leur compte :
" Quels sont leurs ennemis, demandions-nous à un Touati ? Ils n'ont pas d'amis nous répondit-il. " Un autre nous disait : " Je n'ai rien vu de bon chez eux que leur beauté et leurs chameaux. Braves, rusés, patients, ne vous fiez jamais à eux ; ils sont de mauvaise parole. Si vous recevez l'hospitalité chez l'un d'eux, vous n'avez rien à craindre de lui, sous sa tente, ni quand vous serez parti ; mais il préviendra ses amis qui vous tueront et ils partageront vos dépouilles. "
Si nous nous dégageons de tous ces préjugés, nous trouvons chez ces peuplades des vertus de famille qui révèlent de grandes qualités instinctives. Ainsi la polygamie y est très rare et tout à fait exceptionnelle. La dignité de la race s'y perpétue sans mélange d'alliances étrangères, même avec les Arabes que les Touaregs méprisent et dont ils se disent les seigneurs. Le deuil des morts aimés ou vénérés se porte religieusement et longtemps, et pendant ce temps de douleur, les amis et les parents du mort laissent croître leur barbe et ne peuvent pas se marier.
Concluons-en que, là, comme partout, le bien est à côté du mal et que la nécessité seule, peut-être, a compromis une nature sûrement meilleure que ne le disent les Arabes.
L'immense montagne appelée Djebel-Hoggar, le refuge principal des Touaregs du Nord, forme une espèce de quadrilatère. Presque tous ses pics sont boisés de grands arbres ; ses ravins tourmentés et rocailleux sont autant de torrents à la saison des pluies ; il y fait alors un froid humide contre lequel ces frileux habitants du désert luttent de précautions en s'enveloppant de vêtements de laine, espèce de burnous doublés en peau de chèvre. Ils vivent alors en famille sous leurs tentes circulaires, faites en peaux tannées. Leur seule distraction est la pipe dont abusent les hommes et dont usent largement les femmes.
Au printemps ils reprennent le désert. C'est également au printemps que les caravanes se mettent en mouvement. Elles savent d'avance que les Touaregs les guetteront au passage ; aussi le chef des plus prudents s'entendra-t-il avec le chef le plus voisin des bandes errantes qui lui donnera quelques cavaliers sous la sauvegarde desquels la caravane continuera sa route, changeant de protecteurs d'espaces en espaces et payant à tous jusqu'à destination, et selon l'importance de ses marchandises, un impôt forcé que l'amour-propre des Arabes déguise sous le nom de cadeau en échange d'une protection. Dès que les espions ont éventé l'immense convoi, ils le suivent à la piste, de loin, prudemment, en se cachant dans les plis des vagues de sable, pendant que d'autres sont allés donner l'éveil à leur bande commune.
Elle arrive sur ses rapides maharas, ces chameaux de courses, se disperse dans l'espace, et quand la nuit sera venue, quand la caravane se reposera, sur la foi de ses sentinelles, des fatigues de la journée, les voleurs s'en rapprocheront ; chacun laissant son chameau à la garde d'un complice et à quelque distance. Les plus adroits s'avanceront en rampant, lentement, sans bruit ; et le lendemain, dix, quinze, vingt chameaux, plus ou moins, mais toujours les plus chargés, manqueront au départ de la caravane.
Ces tentatives hardies sont fréquentes, non seulement dans le désert mais dans nos camps.
Les Arabes comme les Touaregs sont venus bien souvent voler les chevaux de nos officiers et des faisceaux entiers de fusils jusque sous les yeux des sentinelles. Les grandes expéditions sont décidées dans un conseil tenu par les chefs. Tous ceux qui doivent partager les dangers et les bénéfices de l'entreprise partent, quelquefois au nombre de quinze cents ou deux mille hommes, montés sur leurs meilleurs maharas.
La selle est placée entre la bosse de l'animal et son garrot ; la palette de derrière en est large et très élevée, beaucoup plus que le pommeau de devant, et souvent ornée de franges en soie de diverses couleurs. Le cavalier y est comme dans un fauteuil, les jambes croisées, armé de sa lance, de son sabre et de son bouclier ; il guide son chameau avec une seule rêne attachée sur le nez de l'animal par une espèce de caveçon (harnais), et parcourt ainsi des distances effrayantes, vingt-cinq à trente lieues par jour, sans se fatiguer.
Chacun ayant sa provision d'eau et de dattes, la bande entière se met en marche.
Le jour convenu, plutôt à nuit convenue ; car pour éviter les chaleurs du soleil et l'éclat des sables, elle ne voyage que de nuit se guidant sur les étoiles.
A quatre ou cinq lieues du coup à faire, tous mettent pied à terre, font coucher leurs chameaux qu'ils laissent à la garde des plus fatigués d'entre eux et des malades. Si c'est une caravane qu'ils veulent attaquer et qu'elle ne soit pas très forte, ils se jettent sur elle en hurlant un effroyable cri de guerre ; ils entrent dedans à coup de sabres et de lances, non point qu'ils frappent au hasard cependant ; l'expérience leur a appris à frapper leurs ennemis aux jambes : chaque coup de leur large sabre met un homme à bas.
Quand le carnage est fini le pillage commence ; chacun sa part désignée par les chefs. Les vaincus morts ou blessés, ils les laissent là sans les mutiler. Si la caravane est trop forte ils la suivent à quelques lieues, s'arrêtant quand elle s'arrête et faisant épier ses mouvements par des espions que les Arabes appellent chouaf : quand la discipline s'y relâchera, quand, sur le point d'arriver à destination elle se croira quitte de tout danger, de toute surprise et se gardera moins bien, ils tomberont sur elle.
Ce qui semble incroyable c'est que ces brigands redoutés et si généralement détestés dans le Sahara, fréquentent ouvertement et souvent isolément les marchés du Tidikelt, de Agabli, de A'ouef, de Rdamês où ils apportent du pays des nègres :
- des esclaves,
- de la poudre d'or,
- des défenses d'éléphants,
- des peaux tannées pour faire des tentes,
- des espadrilles dont les semelles sont inusables,
- des soies,
- du poivre rouge,
- des dépouilles d'autruches,
- une espèce de fruit qu'on appelle daoudaoua, produit par un arbre du même nom.
Les Touaregs du sud font sur la lisière du pays des nègres le même métier à peu près que leurs germains du Nord sur la lisière du Sahara. On les appellent Sergou à Timbektou (Tombouctou) et Kilouan dans le Bernou et à H'aouça.
La fraction principale de ces Touaregs sont les Soukmaren. De sang très mêlé ils sont tenus pour cette raison en grande infériorité par les Djouad du Djebel-Hoggar.
Pour tout costume ils ont :
- une chéchia,
- une espèce de caban en peau de chèvre,
- de misérables haïks.
Grands chasseurs ils passent des mois dans la montagne à courir la gazelle dont la chair fraîche ou séchée font leur constante nourriture avec le lait de leurs maigres troupeaux, un peu de grains et de dattes qu'ils rapportent du Tidikelt où ils vont vendre les produits de leur chasse.
Cependant les seigneurs du Djebel-Hoggar leur prêtent quelquefois des maharas pour aller en razzia mais à la condition de prélever la meilleure part du butin. Cependant les chefs du pays, bien que soumis aux chefs du Djebel-Hoggar sont beaucoup moins misérables que leurs serviteurs ; quelques-uns ont des troupeaux et leur commerce d'échange avec les caravanes de passage ou sur les marchés du Tidikelt leur fait une vie moins rigoureuse que ne l'est celle du bas peuple. Les Soukemaren sont en état d'hostilité permanente avec les Berbères des montagnes de l'Ouest ; si le hasard les conduit au même puits dans leurs chasses vagabondes, il est rare que les armes ne soient pas tirées et les combats antérieurs ont alors d'atroces représailles.
Ainsi s'écoule paisible mais aussi violente la vie dans le désert.
- " Nos coursiers, ils sont abreuvés du lait le plus pur ; c'est le lait de la chamelle plus précieux que celui de la vache.
- Le premier de nos soins c'est de partager nos prises sur l'ennemi ; l'équité préside au partage, chacun a le prix de sa valeur.
- Le vénérable honneur est dans la vie nomade. Que pourras-tu reprocher au Bédouin ? Rien que son amour pour la gloire et la libéralité qui ne connaît pas de mesure.
- Sous la tente le feu de l'hospitalité luit pour le voyageur ; il y trouve, quel qu'il soit, contre la faim et le froid un remède assuré.
- Au Sahara celui que le fer n'a pas moissonné vit des jours sans limite. "
Emir Abd-el-Kader
Mœurs et coutumes de l'Algérie : Tell, Kabylie, Sahara 1853
|
|
| Les Turcs
Envoyé par M. Christian Graille
|
Les Maures qui s'étaient retirés en Afrique après avoir été chassés de l'Espagne, avaient construit des vaisseaux avec lesquels ils se livraient à la piraterie, et opéraient de temps en temps des débarquements dans les îles Baléares et sur les côtes de la péninsule ibérique, pour dévaster le pays et traîner les habitants en esclavage.
Dans le but de réprimer l'audace de ces barbares, Ferdinand, sollicité par les conseils du cardinal Ximenès, envoya en 1504, contre le fort Mers-el-Kebir, une expédition qui s'en empara et y mit garnison.
Cinq ans après le cardinal Ximenès, après avoir noué des intelligences avec un Juif et quelques Maures de la ville d'Oran, partit lui-même à la tête d'une puissante armée, dont les troupes de débarquement étaient commandées par Pierre de Navarre, vint débarquer à Mers-el-Kebir et s'empara d'Oran qui ne fit pas beaucoup de résistance. Aussitôt après le cardinal retourna en Espagne, laissant à Pierre de Navarre le soin d'étendre la conquête sur toute la côte de Barbarie : celui-ci, parti du port de Mers-el-Kebir avec treize vaisseaux portant des troupes bien aguerries vint rallier une division navale qui l'attendait à Ivice, et après avoir rassemblé toutes ses forces il mis à la voile le 1er janvier 1510, alla débarquer près de Bugie (Bougie), malgré les efforts des africains rassemblés sur le rivage, et les poursuivit jusque dans la ville où il entra avec eux.
La chute de Bougie épouvanta toutes les autres villes qui envoyèrent aussitôt des députés au général espagnol pour faire leur soumission. Alger, qui n'était alors d'aucune importance, fut la première à se soumettre ; après s'en être emparés, les Espagnols bâtirent un fort sur une île de rochers qui se trouvait devant cette ville et dont l'augmentation des ouvrages a, depuis, fait la force de ce repaire de pirates.
Les Espagnols, maîtres du pays, rendirent aux Maures une partie des maux que ceux-ci leur avaient faits pendant leur séjour en Espagne : les Maures se révoltèrent plusieurs fois, et enfin, aidés par les Turcs, ils parvinrent à chasser les Espagnols.
Alger appela à son secours Sélim-Eutémi, guerrier arabe d'une grande réputation ; celui-ci s'entendit avec le fameux corsaire Barberousse, qui désolait alors toutes les côtes de la Méditerranée, pour attaquer simultanément la garnison espagnole enfermée dans le fort d'Alger. Ce fort fut pris ; mais après, les deux vainqueurs ne vécurent pas longtemps en bonne intelligence. Barberousse s'étant établi dans Alger avec ses compagnons de brigandage, parmi lesquels se trouvaient déjà un certain nombre de Turcs, fit mourir Sélim, et se trouva ainsi seul maître de cette ville ; mais il ne jouit pas longtemps de sa perfidie et périt deux ans après dans une bataille contre les Espagnols aux environs de Tlemcen. Chérédin, frère de Barberousse, lui succéda et prit aussi le même nom ; ce prince augmenta beaucoup les fortifications d'Alger, et il joignit au continent, par une jetée, le rocher sur lequel les Espagnols avaient construit un fort en 1510.
Continuellement menacé par l'Espagne, dont les expéditions sur la côte d'Afrique se succédaient très rapidement, Chérédin, mit ses États sous la protection du Sultan, et lui demanda du secours ; ce prince lui envoya quelques centaines de janissaires qui formèrent le premier noyau de cette milice, devenue depuis si redoutable à ceux qu'elle était d'abord chargée de défendre.
Voilà de quelle manière les Turcs se sont introduits dans la régence d'Alger ; depuis lors, le Grand Seigneur a toujours fourni au Pacha de cet État, son vassal, autant de troupes qui lui en fallait pour maintenir l'ordre dans ses provinces et les défendre contre les attaques des Européens. Quand les Deys d'Alger sont devenus indépendants, sous la condition de payer un tribut à la Porte ( siège du gouvernement turc à Constantinople.), ils ont demandé et obtenu d'avoir constamment à Constantinople et dans quelques autres ville de la Turquie, des recruteurs chargés d'enrôler et d'envoyer à Alger tous les hommes de bonne volonté. Cette condition fut consentie d'autant plus facilement que le Sultan vit là un moyen de se débarrasser de quelques hommes turbulents et des mauvais sujets qui infestaient ses provinces. De cette manière, les pertes que la milice algérienne éprouvait, soit par les combats, soit par la retraite des vieux soldats qui se mariaient et vivaient bourgeoisement, se trouvaient réparés au fur et à mesure.
Tous les ans le Dey d'Alger envoyait un bâtiment à Smyrne, dans l'Asie Mineure, pour prendre les hommes que ses recruteurs avaient enrôlés et les amener dans sa capitale : aussitôt que le navire, porteur de leurs nouveaux camarades, était entré dans le port, les janissaires prenaient des canots pour aller les visiter, et les engager, chacun de leur côté, à entrer dans sa compagnie. Celui qui pouvait en embaucher quelques-uns les faisait embarquer sur son canot et les amenait dans sa caserne, où ils étaient reçus en grande démonstration de joie et fort bien traités : de cette manière le navire se trouvait déchargé sans que le capitaine eût besoin de s'en occuper le moins du monde. Le jour même de leur arrivée, tous les nouveaux venus étaient conduits au palais par les chefs de la milice et présentés au Dey qui leur disait combien il était satisfait de les voir, et qu'il ne doutait pas qu'ils ne servissent avec autant de zèle et de courage que les anciens. La présentation terminée, on leur distribuait des habits et à chacun un sequin en or (neuf francs) ; après cela, ils étaient reconduits dans leurs casernes respectives. Comme les recruteurs d'Alger prenaient tout ce qu'ils rencontraient, et surtout une grande quantité de mauvais sujets qui, en s'engageant au service d'Alger, trouvaient le moyen d'échapper aux châtiments qu'ils avaient mérité, il en résultait que ceux que l'on amenait n'étaient pas tous des musulmans.
Lorsqu'un individu quelconque était engagé au service d'Alger, la justice turque n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Quand un assassin poursuivi pouvait partir et entrer chez un recruteur de cette régence et dire " je m'engage, " il ressortait dans la rue en disant à ceux qui le poursuivaient : " Je suis janissaire d'Alger " et les autres se retiraient confus. Le Dey le savait bien, et pour remédier à cet inconvénient, le troisième jour de l'arrivée des conscrits il envoyait un Badjerah (chirurgien) qui les visitait les uns après les autres, et circoncisait ceux qui ne l'étaient pas. L'opération terminée tous les nouveaux venus étaient inscrits sur les registres de la milice et ils jouissaient de toutes les prérogatives de ce corps comme leurs prédécesseurs.
Les janissaires d'Alger jouissaient de très grandes prérogatives mais s'ils se mariaient ils en perdaient une partie, et cependant beaucoup le faisaient malgré cet inconvénient ; en outre, ceux que l'âge ou des blessures forçaient à quitter le service, se mariaient presque tous et vivaient alors dans l'intérieur des villes comme les autres habitants musulmans. N'ayant point de femmes de leur nation, ils s'alliaient avec les filles des Maures ou des esclaves chrétiennes qui préféraient l'esclavage sous un mari à celui sous un maître ; les enfants qui naissaient de ces unions portaient le nom de Koulouglis. Les Turcs que j'ai vus dans la régence d'Alger étaient de beaux hommes, presque tous parfaitement constitués ; ils avaient le regard sévère, les traits du visage fortement prononcés et la peau aussi blanche que les Européens. Ceux d'Alger étaient de complexion assez reflète ; mais j'en ai vu à Oran et à Médéya (Médéa) d'aussi maigres que les Arabes. Leur manière de vivre est absolument la même que celle des Maures, avec lesquels on les voyait mêlés dans les promenades, les cafés et les boutiques de barbiers, et cela devait être, puisqu'ils étaient unis par les lien du sang, et qu'en outre ils professaient la même religion ; quant au costume, il diffère un peu, surtout celui des janissaires : les vêtements sont de couleurs plus tendres et plus richement brodés, le turban est aussi plus plat et souvent composé d'un cachemire ou d'un autre châle d'un très beau tissu.
Industrie
La plus grande partie des Turcs établis dans les États algériens vivaient tant avec leur solde, qu'on leur payait jusqu'à la mort, quoiqu'ils fussent retirés, que du produit des prises faites par les corsaires, à l'armement desquels il leur était permis de contribuer, et d'avoir ainsi, dans les prises, une part proportionnelle à la somme qu'ils avaient engagée ; mais quelques-uns aussi s'occupaient de commerce : plusieurs avaient des boutiques dans lesquelles ils vendaient des étoffes, des bijoux, des essences et autres objets de luxe.
Dans les premiers quinze jours qui suivirent la prise d'Alger, les Turcs qui avaient des boutiques continuèrent à les tenir ; j'ai plusieurs fois eu l'occasion de faire des emplettes auprès d'eux, et je les ai toujours trouvés d'une franchise et d'une loyauté remarquables : jamais ils ne surfaisaient leur marchandise, et quand on leur en offrait un prix inférieur à celui qu'ils avaient demandé : " Cela est impossible, répondaient-ils, nous ne surfaisons jamais. "
Les Turcs possédaient beaucoup de maisons de campagne dans les environs d'Alger, situées au milieu de beaux jardins parfaitement tenus et dans lesquels il y avait surtout une grande quantité de fleurs. Des champs enclos de haies, contigus à chaque maison composaient le domaine : ces champs ainsi que les jardins étaient cultivés par des esclaves et des Berbères, mais jamais la main d'un Turc ne touchait la pioche ou la bêche, l'agriculture étant pour eux un art avilissant ; ce préjugé leur est commun avec tous les peuples guerriers.
État politique
Les janissaires exerçaient un pouvoir despotique sur tous les autres habitants, de quelque religion qu'ils fussent : les Juifs étaient surtout l'objet de leur mépris, et en butte à tous les mauvais traitements qu'il leur plaisait de leur faire éprouver. Le souverain lui-même et ses gouverneurs de province, quoiqu'ils fussent également des Turcs, dépendaient continuellement de la milice. Dans ses émeutes elle leur demandait :
- des augmentations de solde,
- l'abrogation de telle ou telle loi,
- la création de nouvelles.
Quand les janissaires avait décidé que le prince ne pouvait plus régner, il lui était impossible de les faire revenir sur cette décision et de soustraire sa tête au yatagan ; quelque effort qu'un Dey condamné fit pour se défendre, il finissait toujours par succomber ; il avait la tête tranchée, et, immédiatement après, les janissaires en nommaient un autre à sa place auquel ils juraient obéissance et soumission et rentraient ensuite dans l'ordre.
Dans les temps ordinaires la milice turque était la seule force militaire du royaume : c'était elle qui faisait le service des places et battait la campagne pour contraindre les Arabes et les Berbères à payer les impôts ; mais en temps de guerre, surtout lorsqu'une puissance européenne menaçait de débarquer des troupes sur le territoire, l'on appelait aux armes les Maures, les Koulouglis, les Arabes, les Berbères et jusqu'aux esclaves nègres.
Mais ces soldats de circonstance ne jouissaient d'aucun des privilèges accordés aux Turcs qui conservaient toujours la haute main sur eux. Lorsque la flotte française vint mouiller dans la baie de Sydi-Elfroudj,(Sidi-Ferruch) les Algériens étaient occupés à élever des batteries sur le rivage pour s'opposer au débarquement de l'armée ; les travailleurs étaient des Maures et des Arabes, mais les Turcs qui se trouvaient là dirigeaient les travaux ou restaient assis les jambes croisées en les regardant tranquillement exécuter.
Au milieu des hordes qui nous attaquèrent le 19 juin (bataille de Staouéli), nous remarquâmes beaucoup de Turcs à cheval le Yatagan à la main et frappant du plat sur les Bédouins pour les faire marcher en avant : aussitôt qu'un groupe apercevait des Turcs se diriger vers lui, il se mettait à pousser des cris et à courir en avant de toutes ses forces. J'ai toujours beaucoup entendu vanter le courage militaire es Turcs : l'armée d'Egypte les avait vus résister comme des murailles et venir se faire tuer jusque sur les baïonnettes ; avant le départ de l'expédition contre Alger, les antagonistes du ministère, exagérant tous les périls que nous allions affronter, portaient au plus haut point la valeur des janissaires du Dey.
L'armée pensait comme eux à cet égard, et son plus grand désir était de se mesurer avec ses vaillants guerriers. Quand nous les rencontrâmes sur-le-champ de bataille, leur conduite ne répondit point du tout à notre attente : ils se défendirent mais ils prirent la fuite aussi bien que les barbares avec lesquels ils combattaient. Au col de Ténia, au passage de l'Atlas, les Turcs achevèrent de perdre notre estime : trois cents janissaires étaient réunis dans une gorge que cinquante hommes bien déterminés auraient pu défendre contre un régiment tout entier, et ils se sont laissé forcer par les tirailleurs d'un valeureux bataillon du 37e de ligne qui montait à la baïonnette malgré une fusillade bien nourrie et une grêle de pierres qu'on leur lançait de tous côtés ; et pour comble d'ignominie, ces mêmes janissaires sont venus sans armes, deux jours après, implorer la pitié du vainqueur devant lequel ils s'étaient si mal comportés.
Tant au spirituel qu'au temporel, les Turcs n'étaient jamais traduits devant les magistrats Maures ; il y avait un Cadi et un Mufti turcs dans chaque ville, chargés de rendre la justice à ceux de leur nation, et toutes les fois qu'un Turc se trouvait compromis avec des Maures, des Arabes ou des Berbères c'était toujours devant le cadi turc que l'affaire était portée.
Tous les autres Algériens recevaient en public les châtiments auxquels ils avaient été condamnés pour une cause quelconque ; les Turcs avaient la prérogative de n'être jamais punis devant ceux auxquels ils commandaient, même quand on leur tranchait la tête. Toutes les exécutions qui les concernaient avaient lieu dans la maison de l'Aga où on leur administrait la bastonnade ou bien on les décapitait, suivant la gravité de la faute qu'ils avaient commise.
La personne d'un Turc dans la régence d'Alger était aussi sacrée que celle d'un Roi européen : pour avoir tué un Turc, on était brûlé vif ou empalé ; quand il arrivait qu'un janissaire avait été assassiné dans une ville ou sur le territoire d'une tribu, l'Aga parait à la tête de sa cavalerie pour saisir les coupables ; quand ils parvenaient à s'échapper, ils prenaient vingt ou trente pères de famille de cette tribu et les amenait au Dey qui leur faisait presque toujours trancher la tête. Deux ans avant la prise d'Alger par les Français, un janissaire qui était allé dans une des tribus de la Métidja vivre pendant quelque temps à discrétion chez des Arabes, fut trouvé mort dans le marais où, selon toute apparence il s'était noyé ; aussitôt que l'Aga en eut connaissance, il envoya un détachement de cavalerie qui s'empara de quarante pères de famille et les conduisit à Alger. Les chefs de plusieurs tribus se réunirent à celui dont on avait pris les hommes et vinrent auprès du Dey protester de l'innocence de ceux qu'on accusait, et offrir une somme d'argent pour leur rançon ; le prince, après avoir pris l'argent et feint de croire aux protestations des Cheiks leur dit : " Vous n'avez qu'à aller à la porte de Bab-Azzoun, vous y retrouverez tous ceux que vous réclamez. " Ils les trouvèrent effectivement, mais tous pendus par le cou aux créneaux de la muraille.
C'est en employant une aussi grande sévérité que les Turcs sont parvenus à se faire craindre et respecter, au point qu'un seul homme pouvoir parcourir en sécurité le pays où nous ne pouvons pénétrer maintenant qu'avec plusieurs bataillons et que trois mille janissaires suffisaient pour maintenir dans le devoir un État qui a deux cents lieues de long sur quatre-vingt de large, et où nous sommes obligés, avec notre mauvaise tactique, d'avoir quinze mille hommes pour garder trois lieues de rayon autour de la seule ville d'Alger.
Dans les derniers temps, les Turcs commençaient cependant à perdre beaucoup de leur influence principalement sur les habitants des villes. Le blocus de la marine française empêchait depuis trois ans l'arrivée des recrues de Turquie et le nombre de janissaires diminuait sensiblement. Les Maures s'étaient déjà révoltés plusieurs fois contre les vexations qu'on leur faisait éprouver, et les janissaires leur disaient tous les jours : " Attendez que la guerre soit finie, nous vous remettrons à votre place. "
Instruction
On conçoit que dans une réunion de mauvais sujets d'hommes élevés comme le sont en général les Musulmans, il devait y en avoir peu d'instruits : c'est effectivement ce qui avait lieu ; néanmoins on en trouvait quelques-uns qui avaient fait des études assez étendues. Les secrétaires du Pacha, comme tous ceux occupant dans le Gouvernement des emplois qui exigeaient qu'on sût lire, écrire et un peu compter, étaient des Turcs. Les femmes étaient des Mauresques ; ainsi, leur éducation devait être tout aussi négligée. Quant aux enfants mâles, ils allaient dans les écoles publiques avec ceux des Maures et par conséquent ils recevaient la même éducation qu'eux.
Religion
La religion des Turcs qui vivent dans la Barbarie ne diffère en rien de celle des Maures et des Arabes : ils observent les mêmes pratiques et vont ensemble dans les mêmes mosquées.
Le mariage et la circoncision se célèbrent absolument comme chez les Maures. Les Turcs respectent les marabouts et vont les consulter quelquefois ; mais ils sont loin de s'abandonner aussi aveuglément à leurs conseils que les Arabes et que les Maures : quand un marabout était soupçonné d'avoir tramé quelque complot contre la sûreté de l'État, le Dey et ses lieutenants le faisaient arrêter et décapiter comme un autre homme. Je crois, en général, les Turcs beaucoup moins superstitieux que tous les autres peuples de la régence. Jamais je ne les ai vus porter au cou des amulettes pour se préserver de la malignité des sorciers et des embûches du Démon ; ceux auxquels j'ai eu l'occasion de parler de toutes les superstitions des Algériens en ont ri avec moi.
La grande vénération pour les tombeaux qui existent chez tous les peuples de la Barbarie, se retrouvent également parmi les Turcs de cette contrée. Presque chaque famille possède une sépulture particulière, close de murs, plantée d'arbres et d'arbrisseaux, ornée de colonnes en marbre qui soutiennent la galerie, et souvent embellie d'un jet d'eau qui verse dans un bassin de marbre blanc. Les tombeaux sont construits dans le même genre que ceux des Maures mais ils sont bien plus élevés et mieux soignés. Dans les cimetières environnant Alger, une grande partie des tombeaux turcs sont en marbre blanc travaillé en Italie ; le socle en maçonnerie sur lequel les quatre pierres de marbre sont posées est souvent garni de carreaux en faïence portant des dessins, comme ceux que l'on voit en Angleterre et dans le nord de la France. Je n'ai pas eu l'occasion de m'assurer si les Turcs vont souvent visiter les tombeaux de leurs parents mais le grand soin qu'ils en prennent doit le faire présumer.
Mœurs et coutumes
Toutes les fois que j'ai eu des relations avec les Turcs, je n'ai eu qu'à m'en louer : ils sont francs, loyaux et scrupuleux observateurs de la foi jurée ; les Maures et les Arabes, qui avaient lieu de s'en plaindre sous beaucoup de rapports, n'en étaient pas moins pleins d'estime pour eux, et ils furent profondément affligés lorsque nous fîmes enlever et conduire sur nos vaisseaux, pour être transportés en Asie, les janissaires et la presque totalité des familles turques qui habitaient Alger.
Quoiqu'ils n'aient pas la bravoure et l'impétuosité des soldats français, les janissaires possèdent cependant des vertus militaires ; s'ils étaient disciplinés et bien commandés je crois qu'ils feraient d'excellentes troupes : ils ont une résignation et un sang-froid imperturbables qu'on chercherait en vain chez les autres nations de l'Europe.
Lorsque la garnison du château de l'Empereur évacua, par ordre du Dey, ce fort dont nos bombes et nos boulets avaient fait un monceau de ruines, nous distinguions les Turcs de tous les barbares qui fuyaient avec eux, non pas par leur costume, mais parce que ceux-ci couraient à toutes jambes du côté de la ville, dans la crainte que le fort qu'ils savaient devoir sauter ne les ensevelit sous ses décombres ; tandis que ceux-là marchaient tranquillement la face fixée sur la terre, et semblaient se résigner à tous les malheurs qui les attendaient.
Le jour de notre entrée dans la belliqueuse ville, tandis que tous les habitants étaient enfermés chez eux, les Turcs rassemblés sans armes devant la porte de leur caserne, les bras croisés, l'air triste mais sévère, regardaient défiler nos bataillons qui allaient s'emparer des forts et de tous les magasins qu'ils possédaient quelques heures auparavant.
La capitulation consentie par le maréchal de Bourmont ordonnait aux vaincus de rendre les armes ; des détachements d'infanterie se portèrent dans les différentes casernes de la milice turque pour opérer le désarmement. Sur la sommation qui leur en fut faite, les janissaires, sans dire un seul mot, et avec une gravité toute musulmane, vinrent au milieu de la cour chargés des armes avec lesquelles ils en imposaient depuis si longtemps à l'Afrique et même à l'Europe, et les déposèrent en un monceau sur lequel ils daignaient à peine jeter les yeux en se retirant.
Avec ces bonnes qualités les Turcs de Barbarie ont des vices : l'indolence naturelle à tous les habitants de cette contrée n'est pas le plus grand ; comme les Maures ils passent des journées entières accroupis, les jambes croisées, à fumer leurs pipes et à boire du café ou à se passer dans les mains les grains d'un chapelet. Ils sont sanguinaires : ils tuaient souvent ceux qui leur déplaisaient, sans qu'ils les eussent attaqués de quelque manière que ce fût. L'habitude dans laquelle ils étaient de trancher avec le sabre toutes les difficultés que leur maître rencontrait faisaient qu'ils se conduisaient absolument de même que quand il s'agissait de leur intérêt personnel. On a vu très souvent des Juifs venant demander à un Turc l'argent qu'ils lui avaient prêté depuis fort longtemps recevoir pour toute réponse un coup de yatagan (sabre.) par la figure.
Tous les jours quelques janissaires allaient se promener dans la campagne, dévastaient les jardins et les vergers des Maures et des Arabes, et maltraitaient le maître ou ses esclaves, quand ils osaient venir s'y opposer. Ils entraient bien souvent dans les maisons et dans les tentes, se faisaient donner à boire et à manger à discrétion, courtisaient les femmes en présence du mari, et ne voulaient presque jamais s'en aller sans qu'on leur eut donné une assez forte somme d'argent.
En passant à côté de la cabane d'une famille arabe, un Juif qui venait souvent avec nous dans les expéditions militaires me dit : " Il n'y a pas encore trois ans que deux soldats de la milice sont arrivés le soir dans cette cabane dont le maître était absent. Les femmes les reçurent du mieux qu'il leur fut possible, et n'osèrent pas se refuser aux dernières complaisances, parce qu'elles craignaient qu'il ne leur en coûta la vie. Le lendemain avant de sortir, les Turcs demandèrent à déjeuner : on leur servit des fruits, du laitage et un poulet auquel il manquait une cuisse.
- Qu'est devenue cette cuisse ? demanda un des soldats à la femme qui le servait.
- mon fils a tant pleuré pour l'avoir, dit-elle, en montrant le petit garçon de trois ans qui était accroupi par terre, que je lui ai donnée.
- Amenez-le moi répliqua-t-il.
- La pauvre mère toute tremblante alla prendre son fils par la main et le conduisit au Turc, en se jetant à genoux et le priant, les mains jointes de ne point lui faire de mal ; mais ce barbare, sans répondre un seul mot, le saisit par les pieds et d'un coup de yatagan lui coupa la cuisse gauche qu'il jeta à la figure de sa mère en lui disant : " Voilà comment un Turc se venge des sottises qu'on lui fait. "
Ce trait de barbarie est si extraordinaire que beaucoup de personnes se refusèrent à le croire ; eh bien ! les janissaires du Dey d'Alger en commettaient continuellement de semblables, et je pourrais encore en citer plusieurs autres, si je ne craignais pas de fatiguer la sensibilité du lecteur.
L'amour des femmes est la passion dominante chez les Turcs ; ceux qui sont mariés, outre les quatre femmes que leur permet le Coran, ont presque tous, plusieurs concubines. Les janissaires qui perdaient une grande partie de leurs avantages en se mariant étaient presque tous célibataires ; mais ils vivaient avec les filles publiques chez lesquelles ils passaient la moitié de leur temps à se livrer à toutes sortes de débauches. Après avoir épuisé toutes les jouissances que l'on peut goûter avec Vénus, les Turcs, continuellement dominés par une imagination dépravée, se jetaient dans les bras de Cupidon ; et cela était si ordinaire parmi eux, qu'ils en convenaient très naïvement. Au reste c'est une turpitude commune à tous les musulmans de la Barbarie. Je n'ai point retrouvé chez les Turcs la sobriété des Maures et des Arabes : ceux que j'ai connu vivaient le mieux qu'il leur était possible ; cependant ils refusaient de boire ni vins, ni liqueurs.
S'ils fussent restés plus longtemps au milieu de nous, ils se seraient peut-être laisser tenter comme un grand nombre de coreligionnaires.
Voyage dans la régence d'Alger par M Rozet
capitaine au corps royal d'État-Major.
Tome second. 1833
|
|
LE BATEAU IVRE
Envoyé par Hugues
|
Forte baisse de la cote de popularité
Du "Jupiter" fantoche qui dirige la France.
Un seul "Gaulois" sur cinq lui accorde sa confiance.
Par ses fanfaronades, il tente de subsister.
Ses Ministres d'Etat ont quitté le navire.
Les premiers de la classe, un trio de ténors,
Tour à tour, abandonnent une croisière en délire
Qui dérive et plus de commandant maître à bord !
Le quinquennat n'est pas une course en solitaire,
Le paquebot France vogue grâce à son équipage,
Dont "mousses et Capitaine" se doivent d'être solidaires.
Le manque de cohésion conduit au sabordage !
Il condamne, sans procès, la colonisation,
Délaissant ses apports à ces peuples d'Afrique.
Repentance répétée n'est pas la solution.
La France rejoindra, bientôt, le Titanic !
Hugues JOLIVET
19 septembre 2018
|
|
| Les Français
Envoyé par M. Christian Graille
|
Dans les premiers temps de l'occupation, la population civile de l'Algérie ne se composait guère que de petits industriels. Un certain nombre de cantiniers avait suivi l'armée ; ses approvisionnements en attirèrent beaucoup d'autres à mesure que la conquête prit plus de consistance et que la guerre intérieure qu'il fallut soutenir augmenta l'effectif.
A ce premier noyau vinrent bientôt se joindre tous les gens qui, dans leur pays, sentaient leur avenir compromis, et qui ne trouvaient pas en France un assez libre essor à leurs mauvaises passions. A une époque où le sort de la colonie était encore incertain, on ne pouvait pas trop se plaindre d'une telle composition ; il n'y avait que des aventuriers qui pussent avoir envie de quitter la France pour aller habiter les côtes barbaresques et mener la vie des camps. Mais quand :
- toutes les incertitudes furent levées,
- que la question d'abandon fut tranchée,
- que la colonisation fut définitivement résolue,
- on comprit que la première chose à faire était d'attirer en Algérie les ouvriers nécessaires pour cette grande entreprise.
Aussitôt le Ministère de la Guerre fit adresser, par l'intermédiaire de son collègue de l'Intérieur, des circulaires aux préfets de tous les départements.
Ces circulaires réclamaient deux sortes d'ouvriers :
- les uns pour travailler librement, soit chez des particuliers, soit dans les ateliers du gouvernement,
- les autres, pour exploiter les terres mises à leur disposition, comme concessions de l'État.
La première catégorie comprenait, pour les hommes :
- les carriers, - les maçons, - les tailleurs de pierres, - les tuiliers, - les briquetiers, - les chaufourniers (ouvrier ayant la responsabilité de la bonne marche d'un four à chaux), - les charpentiers, - les menuisiers, - les plâtriers, - les marbriers, - les serruriers, - les forgerons, - les peintres en bâtiments, - les plombiers, - les charrons, - les charretiers, - Les maréchaux-ferrants, - Les taillandiers (artisan fabriquant des outils de taille et de coupe,) - et fabricants d'outils aratoires, - les ferblantiers, - les chaudronniers, - les calfats (ouvrier employé à reboucher les fentes de la coque d'un navire.), - les cordiers, - les terrassiers, - les manœuvres, - les garçons de labour, - les jardiniers-maraîchers, - les pépiniéristes et greffeurs, - les fontainiers et foreurs de puits.
Les femmes comprises dans cette catégorie étaient :
- les couturières, - les lingères, - les cuisinières, - les filles de ferme, - les dévideuses de cocons.
M. le Ministre de la Guerre promettait le passage gratuit aux ouvriers exerçant les professions ci-dessus énumérées et à ceux-là seulement.
Ces permis n'étaient point délivrés aux ouvriers qui avaient des enfants en bas âge, c'est-à-dire au-dessous de douze ans, à moins qu'ils ne s'engagent à les laisser en France.
C'était exclure la plupart des ouvriers mariés et n'attirer dans la colonie, avec les garçons, que les maris bien aises de se séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Néanmoins on admettait que ceux qui étaient porteurs d'un certificat de moralité délivré par le maire de leur commune. C'était exclure la plupart des ouvriers mariés et n'attirer dans la colonie, avec les garçons, que les maris bien aises de se séparer de leurs femmes et de leurs enfants.
Néanmoins on admettait que ceux qui étaient porteurs d'un certificat de moralité délivré par le maire de leur commune.
Les émigrants concessionnaires formaient la seconde catégorie d'ouvriers. L'Administration les destinait à la fertilisation et au peuplement des campagnes ; elle les groupait en centres agricoles. Ils se constituaient à l'aide de quatre éléments :
- les capitalistes, les propriétaires, les fermiers ou métayers, les industriels.
Ces derniers colons étaient :
- les aubergistes, les bouchers, les boulangers, les menuisiers, les charpentiers, les forgerons, les tuiliers.
Invités à faire, comme les autres, des constructions, ils ne devaient obtenir que deux ou trois hectares de terre et au maximum cinq hectares. Les colons concessionnaires étaient tous admis au passage gratuit. A leur arrivée, ils étaient reçus dans les dépôts d'ouvriers où ils étaient hébergés.
Les préfets furent invités à donner toute publicité possible aux renseignements fournis par le Ministre de la Guerre, et à les faire insérer dans les journaux de leurs départements.
La plupart des terres en France ont une grande valeur ; qu'elles soient réunies en corps de ferme ou divisées en petits champs, qu'elles soient labourables ou couvertes de bois, le propriétaire peut toujours en tirer part, soit par lui-même, soit par d'autres et est assuré d'un produit quelconque. Comme il était difficile en France de se faire une idée de ce que pouvaient être les terres en Algérie, l'offre de devenir concessionnaire devait être séduisante pour un grand nombre.
La grande ambition des ouvriers qui ne possèdent rien est de devenir propriétaires, et ce n'est pas pour autre chose qu'un si grand nombre souvent désirent des révolutions.
Les préfets, responsables de l'ordre public dans leurs départements, saisirent avec empressement ce moyen, qui leur était offert par le Ministre de la Guerre, pour se débarrasser de la population ouvrière qui ne pouvait pas ou ne voulait pas trouver de travail autour d'eux.
Toutes les facilités furent données pour une migration en Algérie à tous ceux qui étaient une charge ou un embarras. La charité s'en mêla comme la politique, et l'on vint même jusqu'à croire que cette migration était un moyen de rétablir la fortune de toutes les personnes ruinées.
Si la guerre avec les Arabes, qui n'était pas encore achevée, n'avait fait trembler la plupart, si l'idée que sur la terre d'Afrique on était à chaque instant exposé, non seulement à recevoir des coups de fusils, mais encore à être dévoré par une multitude de bêtes féroces, n'avait arrêté les plus intrépides, il eût été difficile, aux premières propositions qui en furent faites, de modérer l'ambition d'une foule de prolétaires français. Mais aussi on comprend les exigences de tous ceux qui ne craignirent point d'affronter de pareils dangers.
Les colons concessionnaires, en attendant leur installation, ne cherchaient point à travailler ; ils allaient devenir propriétaires, être riches ; ils pouvaient donc dépenser leur argent sans crainte. Quant aux autres, venus comme simples ouvriers industriels, ils marchandaient chèrement leur travail : le moindre apprenti menuisier ou maçon n'exigeait pas moins de 5 ou 6 frs pour sa journée.
Les maîtres ouvriers étaient hors de prix ; ils n'opéraient le plus souvent que comme entrepreneurs ou comme architectes Au milieu de tant de gens qui se croisaient les bras et qui bâtissaient des châteaux, en Espagne, tous ceux qui, moins préoccupés des rêves de l'avenir, ne dédaignaient pas de mettre aussitôt la main à l'œuvre voulaient au moins tirer compensation dans les jouissances du présent. D'ailleurs ils n'avaient ni famille, ni ménage à pourvoir : tout ce qu'il n'avait pas mangé dans la journée ils l'employaient le soir à se divertir.
Les ouvriers d'art, avec leurs salaires élevés, se tiraient généralement assez bien d'affaire et pourvoyaient à toutes les exigences de la nouvelle position qu'ils s'étaient faite ; mais ceux qui en étaient réduits, faute de pouvoir mieux faire, au métier de manœuvre ou de terrassier, un peu moins bien rétribué, réglaient plus difficilement les comptes d'aubergistes ou de cabaretiers. Ainsi des ouvriers gagnant 2 frs. 50 c. par jour se mettaient en pension à 60 frs. Par mois ; et ce n'était pas trop quand on songe qu'il ne leur fallait pas moins d'un litre de vin par chaque repas,
- plusieurs plats de viande,
- de la volaille,
- un dessert assorti d'un café.
Il restait bien peu pour leur entretien et leurs menus plaisirs, encore ne fallait-il pas chômer le dimanche. Quand par malheur le travail quotidien était interrompu, après avoir épuisé leur crédit, ils n'avaient d'autre alternative que de se serrer la ceinture ou de sacrifier leurs épaules à leur ventre, en vendant l'une après l'autre les différentes pièces de leur vêtement, jusqu'à la dernière chemise. En tout cas, ils entraient dans de très mauvaises conditions hygiéniques dont ils ne tardaient pas à ressentir les effets. Après plusieurs séjours à l'hôpital, le tempérament des plus robustes finissait par s'épuiser ; la moindre fatigue, le moindre refroidissement faisaient revenir la fièvre, et dès lors ces pauvres ouvriers maudissaient l'Afrique, quand ils auraient dû souvent ne s'en prendre qu'à leur inconduite et à leurs excès, ne songeaient plus qu'à retourner en France.
Bien peu de ces ouvriers se sont fixés en Algérie dans les premiers temps ; alors qu'il leur eût été si facile, par une conduite rangée et un peu d'économie, d'y prospérer et d'assurer leur sort.
C'était chose beaucoup moins aisée pour ceux qui étaient pressés de devenir propriétaires et qui s'imaginaient pouvoir subvenir aux charges de cette nouvelle position avec les seules ressources de leur travail. Ils attendaient des mois et quelquefois des années entières le bienheureux titre provisoire qui leur permettrait d'aller s'installer sur une concession.
La plupart avait déjà absorbé en frais de voyage et de séjour les quelques économies qu'ils avaient apportées. Leur nouveau domaine consistait le plus souvent en lots de consolation.
Ce genre de végétation était loin d'offrir à nos colons africains les ressources qu'offrent à ceux du Nouveau Monde les forêts vierges de l'Amérique. Là on trouve en abondance tout le combustible et tout le bois de construction nécessaire à une première installation.
Une touffe de palmier-nain à arracher donne autant de peine qu'en gros arbre à abattre, sans procurer les mêmes avantages : les racines de palmier-nain ne sont même pas bonnes à brûler. Du reste, moins les terres de l'Algérie sont en friche, plus elles ont été exploitées par les Arabes. Ceux qui voulaient s'y établir pour les mettre en valeur, et qui avaient besoin d'un autre abri que celui de leurs anciens maîtres, étaient donc obligés de tout apporter avec eux, nourriture, outils et matériaux.
Or les voies de communication de l'Algérie dans les premiers temps n'étaient pas faciles. Sans doute l'Administration bienveillante fournissait quelques matériaux à ses colons, leur donnait des planches avec lesquelles ils pouvaient se construire des baraques ; mais en étaient-ils beaucoup plus avancés ? Tout leur manquait pour vivre : et en supposant qu'ils eussent encore un peu d'argent, ils étaient obligés d'aller chercher au loin des provisions dont le prix doublait par la difficulté du transport. L'eau potable même leur manquait souvent. Ils avaient des terres, mais avant de pouvoir jouir d'une récolte, il fallait :
- les labourer,
- les ensemencer,
- les féconder par de pénibles et longs travaux.
Les mieux partagés succombaient à cette première tâche : que devait-il en être de ceux qui, avant de cultiver, étaient obligés de défricher ; travail préparatoire qui exigeait quelquefois dix fois plus de peine et qu'il eût fallu au moins plusieurs années pour accomplir ! En attendant, comment vivre ? Aussi, la nécessité de pourvoir aux besoins impérieux de l'existence forçait-elle nos premiers colons à délaisser leurs terres. S'il leur restait un peu d'argent, s'ils pouvaient disposer d'un peu de temps, tous leurs efforts se concentraient plutôt sur la construction d'une maison. C'était la condition pour obtenir un titre définitif, et avec un titre définitif ils pouvaient emprunter en hypothéquant leur propriété. Mais alors ils tombaient dans les mains des usuriers, et comme ils ne pouvaient longtemps payer par mois et jusqu'à 5 % d'intérêt, il leur fallait bientôt délaisser leurs maisons avec leurs terres. Toutefois la plupart n'attendait pas leurs créances. La misère en épuisant leurs forces, en paralysant leur bonne volonté, les avait démoralisé complètement et avait ébranlé leur santé ; les maladies avaient sévi et la mort avait exercé ses ravages. Partout on ne voyait plus que des impotents, des veuves, des orphelins.
Il n'y avait plus à songer qu'à des œuvres de charité : l'Administration de la colonie s'était transformée en bureau de bienfaisance et les dépôts d'ouvriers eux-mêmes n'étaient plus devenus que des succursales des hôpitaux.
Ces établissements dont la création remonte à 1842 avaient été développés dans les trois provinces ; il y en avait à Alger, à Oran, à Philippeville et à Bône. Le plus important, celui d'Alger, pouvait contenir environ 150 individus. Les hommes, femmes et enfants y étaient logés et couchés dans de vastes dortoirs divisés par catégorie, et recevaient chacun une ration de vivres qui leur était distribuée dans un réfectoire en deux repas par jour.
Le dépôt d'Alger, placé comme les autres sous la surveillance de l'Administration municipale était dirigé par un agent comptable auquel était adjoints des surveillants, des hommes de peine de des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul.
Toutefois le règlement de ces établissements avait été un peu modifié. Dans l'origine les colons concessionnaires devaient y être hébergés jusqu'au jour où ils seraient en possession de leurs terres ; mais comme cette mise en possession ne se faisait souvent, dans les premiers temps, qu'une année après le débarquement, pour ne point augmenter les charges de l'État, il avait été décidé que les séjours dans les dépôts, des colons concessionnaires ainsi que de simples ouvriers, serait réduit à cinq jours.
On admit néanmoins plus tard, au sortir de l'hôpital, ceux que, dès le début, on s'était empressé de mettre bien portants sur le pavé sans ressources suffisantes. Donner un asile aux ouvriers valétudinaires (dont la santé est chancelante et fragile) chancelante) était, sans contredit, beaucoup moins d'écarter du but primitif de ces établissements que d'en faire des auberges de départ, parti qu'il fallut prendre à la fin pour les utiliser.
Les premiers administrateurs, croyant que tout était réglé pour le mieux et que rien ne pouvait être ajouté leurs prévisions, se consolaient froidement de tous ces mécomptes en disant que ce qui était fait n'en restait pas moins acquis au sol, et qu'au pis-aller les premiers colons auraient servi à engraisser la terre. Mais, en attendant, le résultat n'était pas encourageant pour l'émigration. Les familles ainsi décimées n'en appelaient pas d'autres ; et celles qui étaient appelées au partage d'aussi tristes successions ne faisaient que déprécier partout les avantages de la colonisation africaine.
Malgré la paix profonde, malgré la sécurité qui, depuis plusieurs années, entouraient nos établissements ; malgré les rapports favorables à la colonisation qui ne cessaient d'être adressés par le Ministre de la Guerre, la population européenne de l'Algérie, en beaucoup d'endroits, tendait plutôt à décroître qu'à augmenter.
La misère était grande en France, et la disette de 1848 avait épuisé toutes les ressources alimentaires. On ne savait comment nourrir tous les pauvres gens des campagnes ; ils en étaient réduits, dans certains cantons de la Lorraine allemande, à disputer aux animaux leur pâture et à faire cuire quelques herbes pour ne pas tomber d'inanition.
Le moment était favorable pour essayer de peupler l'Algérie de bons ouvriers agriculteurs ; le gouvernement facilita donc les transports ; il chercha partout des terres à concéder, et pour que les petits colons n'éprouvassent plus de retard, il laissa aux autorités locales le soin de les pourvoir. Les commissaires civils eux-mêmes dans les moindres localités, purent les installer provisoirement. Dans les circonstances difficiles où le manque de pain avait mis la France, une nouvelle et large place se faisait donc en Algérie pour tous les colons de bonne volonté.
Partout il s'y trouvait d'anciennes concessions à vendre et de nouvelles à donner ; mais l'appât des concessions était devenu insuffisant. On parlait cependant depuis longtemps de la colonisation de l'Algérie. On y avait envoyé de commissaires scientifiques ; des économistes, des hommes d'Etat l'avait honorée de leurs visites ; les touristes commençaient à la sillonner en tous sens. Tous ces voyageurs à leur retour avaient bien voulu publier leurs impressions de voyage. Ils avaient chacun trouvé un nouveau système de colonisation qui devait assurer le succès mieux que tous les essais incomplets tentés jusqu'alors.
Chaque année aux Chambres, on voyait aussi revenir la question de la colonisation à propos du budget de l'Algérie. Cet énorme budget ne diminuait point : l'armée d'occupation était toujours très nombreuse ; on aurait voulu, en la diminuant, dégrever un peu l'État de sa charge la plus lourde, ou du moins préparer ce résultat pour le développement de la colonisation, par des dépenses productives qui en assureraient la prospérité.
Mais Louis-Philippe ne voulait de l'Afrique que pour l'armée, dont il ne savait que faire, et l'armée ne voulait non plus que pour son propre avantage de la colonisation qui la gênait. La colonisation n'entrait donc dans le budget que comme un accessoire obligé, elle ne devait servir qu'à justifier les autres dépenses.
L'État ne se souciait donc pas de se mettre en nouveaux frais, et l'on conçoit que les particuliers devaient être, de leur côté, médiocrement enclins à faire la guerre à leurs dépens, pour vaincre les difficultés d'une entreprise incertaine. Trop peu de personnes en France s'intéressaient à l'Algérie pour qu'il y eût lieu d'espérer qu'on prît de longtemps les mesures nécessaires pour attirer de nouveaux colons.
Mais sous la République les choses changèrent tout d'un coup de face, et la question de la colonisation prit une importance toute nouvelle qui vint frapper l'attention publique.
La cessation du commerce avait mis sur le pavé une masse d'ouvriers que l'industrie ne pouvait plus nourrir, et, plus que jamais, tous les regards se tournaient vers l'agriculture. Ce n'était pas là une affaire de circonstance et une crise passagère. Les statistiques faites précédemment avaient constaté que la population de la France s'accroissait chaque cinq ans de plus d'un million d'habitants, d'où il résultait qu'à la fin du siècle elle serait augmentée de 10 à 12 millions d'âmes. Naguère la récolte était venue à manquer ; cette perspective de population croissante avait beaucoup préoccupé les économistes : l'on s'était déjà aperçu du danger pour les finances de tirer de l'étranger la nourriture du peuple, sans être assuré de pouvoir y placer les produits de son industrie.
Au commencement de la République, ces considérations devenaient plus sensibles que jamais et les hommes d'État du jour comprirent très bien l'abîme dans lequel on allait jeter la patrie si l'on se s'empressait de diriger vers l'agriculture la masse nombreuse des ouvriers.
D'un autre côté les ouvriers commençaient à comprendre le triste rôle que l'industrie leur réservait, et ils jugeaient avec raison que la possession du sol était la première garantie de l'indépendance.
- Comment alors, sans bouleverser la société, satisfaire aux prétentions de la masse d'ouvriers repoussés par l'industrie ?
- Comment faire pour les rendre propriétaires sans léser les droits de ce qui y étaient déjà ?
- Il est vrai qu'il restait encore des terres en friche mais ce n'était pas les meilleures, et la plupart eussent exigé plus de travaux qu'elles n'eussent produit de fruits.
- Sous le précédent règne de l'occupation de l'Algérie était venue fort à propos résoudre une difficulté : celle de pouvoir faire la guerre et de préparer une bonne armée sans rompre la paix avec l'Europe, base principale du système d'alors. Sous la nouvelle République, il semblait que l'Afrique fut appelée à résoudre une nouvelle difficulté plus essentielle encore pour la France, celle d'attacher au sol une masse turbulente d'ouvriers, et cela sans troubler les anciens propriétaires, sans rompre la paix intérieure, non moins précieuse que celle du dehors.
Devenue toute politique la question de la colonisation algérienne devint présente dans tous les clubs, et bientôt, voulant répondre au nouvel élan qui commençait à se manifester, l'Assemblée Nationale n'hésita pas à voter un crédit de 50 millions pour l'établissement de colonies agricoles en Algérie. Depuis bientôt vingt ans on n'avait pas encore fait d'aussi grands sacrifices. Ces nouveaux millions, votés à l'occasion des ouvriers parisiens devaient-ils beaucoup plus servir à la colonisation africaine que ceux votés à l'occasion de l'armée ?
On vit bientôt la Seine se couvrir de nouvelles embarcations. Une quantité d'ouvriers s'étaient fait inscrire aux mairies de leur arrondissement, et ils briguaient l'honneur d'aller coloniser l'Algérie sous la bannière républicaine.
Ce n'étaient plus, comme autrefois, des vagabond de bas étage poussés d'étapes en étapes comme des troupes de bohémiens, par des préfets ou par des maires. Les nouveaux émigrants étaient les fils aînés de la patrie ; adoptés par elle, ils devaient mettre au service de la colonie leur dévouement et leur intelligence. Ils furent bénis à leur départ, bénis à leur arrivée. Partout salués sur leur passage, ils répondaient avec enthousiasme et fredonnaient des airs patriotiques avec le refrain : " Nourri par la patrie, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. "
Ce refrain favori, ils l'avaient sur la bouche en faisant leur entrée triomphale à Alger, ils le répétaient encore pour charmer leurs loisirs dans leurs nouvelles résidences.
Des Parisiens civilisés ne devaient pas procéder en arrivant dans la colonie comme de simples paysans : leur pain assuré, les jouissances intellectuelles, les intérêts sociaux devaient tout d'abord les préoccuper. Ceux de Fleurus ont poussé la chose au point de demander qu'avant de construire leurs maisons on édifia une salle de spectacle. Une troupe d'artistes s'organisa aussitôt, et au bout de quelques semaines on joua des vaudevilles et des drames dans ce fortuné village tout aussi bien qu'aux Variétés et à la Porte-Saint-Martin.
La salle de spectacle avait un autre avantage important, c'était de pouvoir servir de salle de club : les élections ne devaient pas tarder à avoir lieu, et les Parisiens ont depuis longtemps prouvé qu'ils savent sacrifier leur propre intérêt aux intérêts sacrés de la patrie.
Quand ce moment solennel fut arrivé, bien qu'on fût dans la saison des cultures, la plupart oublièrent les travaux des champs pour ceux de la politique.
Si tous les villages ne purent avoir des théâtres, tous au moins eurent des clubs ; de longues discussions s'y engagèrent dans les règles. Les principes de la République démocratique et sociale furent soigneusement élaborés au sein des nouvelles colonies agricoles, et des élections conformes vinrent réjouir la mère-patrie.
Du reste, la presse parisienne venait soutenir tous ces efforts. Le Lampion, le Père Duchêne, l'Aimable Faubourien, le Journal de la Canaille n'ont pas vécu assez de temps pour la civilisation de l'Algérie ; mais la Réforme, la République, le Peuple et tous les autres débris de la presse socialiste ont envahi nos colonies agricoles. Dans les cafés-billards de chacune de ces localités, les colons ont pu s'en saturer l'esprit et l'intelligence.
La politique a bien pu faire déserter les champs, mais elle n'a pas pu faire oublier le beau sexe Il fallait aux Romains panem et circenses (expression stigmatisant la conduite de la plèbe de Rome qui n'avait plus d'autre ambition que de distribuer du blé et des spectacles gratuits); les Parisiens avaient des goûts moins féroces : le pain et la danse leur suffisaient.
Les règlements militaires détournaient l'armée des clubs, mais ne leur interdisaient pas les réunions joyeuses. Officiers et soldats s'étaient donc mis de la partie pour ces innocents plaisirs. Dans tous les villages agricoles il y avait bal comme à la Grande Chaumière, le dimanche, le lundi et le jeudi. Certains directeurs des colonies se comportaient comme des princes, et daignaient ouvrir les bals par une contredanse avec leurs sujets bien-aimés.
Entre autres avantages offerts aux Parisiens dans les colonies agricoles, il en était une appréciable pour eux. En Afrique il n'y avait ni octroi, ni barrière : on pouvait boire sans déplacement ; liberté presque complète était accordée au commerce ; de sorte que bien des maisons de chaque village avait pu être transformée en cabarets, ermitages, rendez-vous d'amis, et tout le village devenir une guinguette perpétuelle très bien assortie.
Il y avait de quoi ôter jusqu'à regret du paradis perdu. Puis on était affranchi dans les colonies agricoles des sévères règlements de la police parisienne ; les jouissances de la vie pouvaient se prolonger tard : on y tolérait l'ouverture des cabarets jusqu'à une ou deux heures après minuit.
Les buveurs intrépides avaient jusqu'au jour la ressource d'emporter, en guise de punch, un bol de vin et d'aller boire près du corps de garde à la santé et sous la protection de la sentinelle. Il résultait malheureusement de tout cela certains abus, car quelquefois les têtes de nos colons se montaient et ils devenaient très peu maîtres d'eux.
Un jour, un colon d'Aboukir avait besoin d'argent pour payer le cabaretier ; son sac était vide, il ouvre la malle de sa femme pour lui prendre ses bijoux ; le fils mécontent de ce procédé, veut défendre le bien de sa mère. Notre colon, irrité de l'impudence de son fils, prend son fusil et lui décharge dans la cuisse qu'il perce de part en part. Sa femme se sauve, il prend un autre fusil et l'atteint aux reins.
La scène s'était passée en plein jour et devant témoins ; la justice allait informer, mais les témoins arrangèrent l'affaire. Ils avaient à cœur de sauver leur camarade, car, disaient-ils " le même accident pourrait nous arriver. " 'acquittement fut prononcé à la satisfaction générale. Quant à la victime elle apprit au sortir de l'hôpital où elle avait été transportée qu'une partie de ses hardes était vendue.
Pour ne point retourner avec son mari, elle demanda pour quelques jours au chef de la colonie un logement vacant qui lui fut refusé. On ne voulait point non plus lui donner les moyens de partir. Cependant, à force d'instances, elle obtint un congé de convalescence et put s'embarquer avec son fils encore boiteux. Les mêmes scènes ne se passaient point dans tous les ménages ; mais dans un très grand nombre, il y avait des désordres, de sorte que les gens tranquilles finissaient souvent par se dégoûter et sollicitaient leur rentrée en France, non à cause du climat, du pays, des Arabes, mais à cause du voisinage de leurs compatriotes.
L'installation précipitée des colons parisiens avait eu de graves inconvénients ; les maisons n'étaient pas construites ; on avait mis dans les mêmes baraques plusieurs familles ensemble, et les baraques elles-mêmes n'étaient séparées que par des planches. Il en résultait que :
- les femmes honorables,
- des jeunes filles,
- des enfants étaient exposés à entendre des propos qui révoltaient la nature, et à assister, une partie des nuits à des orgies abominables
Que si quelqu'un voulait imposer silence quand tous les tapageurs étaient échauffés, c'était un motif de plus pour les exciter. Trop souvent les militaires chargés de l'administration participaient à ces désordres, et l'on voyait des mères fermer les yeux pour être le lendemain un peu mieux partagées dans la distribution des rations. Dans quelques colonies cependant, des ordres sévères avaient été donnés pour empêcher les soldats de fréquenter les colons. On a pu, par de semblables prohibitions, préserver quelques villages composés de colons plus sérieux. Bon nombre de Parisiens avaient des mœurs très rangées, et aussitôt qu'ils furent installés dans leurs nouveaux logements, ils s'efforcèrent de reprendre les habitudes laborieuses, chacun selon sa profession.
Les uns ouvrirent des boutiques d'horlogerie, les autres s'appliquèrent à l'ébénisterie, à la confection des articles de Paris. Les moindres villages furent bientôt pourvus de toutes sortes de magasins. On y vit :
- des marchands de nouveautés,
- des marchands de modes,
- des coiffeurs au cachet et à l'abonnement.
Malheureusement le commerce n'allait pas, les ressources des colons diminuaient tous les jours ; ils ne pouvaient plus se passer les moindres fantaisies. L'industrie parisienne n'avait aucun succès chez les Arabes ;
- ils n'achetaient point de meubles,
- ils ne faisaient pas arranger de pendules,
- les modes les plus nouvelles ne tentaient point leurs femmes.
Que faire ?
Ces habiles industriels étaient complètement étrangers aux travaux de l'agriculture ; ils ne savaient pas comment s-y prendre pour utiliser les lots de terre qu'on leur avait assignés.
Néanmoins quelques-uns avaient essayé de faire des jardins ; ils s'étaient donné une peine incroyable à cultiver quelques légumes, à semer quelques carrés de pommes de terre mais :
- soit que les terrains eussent été mal préparés,
- soit que les semailles n'eussent pas été faites en temps opportun,
- soit que les arrosements eussent été mal combinés,
- la plupart des premières récoltes manquèrent et jetèrent un premier découragement dans l'âme de nos Parisiens.
Cependant, l'Administration, dès qu'il avait été question des colonies agricoles, pensant bien que les concessions ne seraient pas distribuées aux colons assez à temps pour les cultures, avait fait ensemencer par les Arabes une grande quantité des terres de la plaine appartenant à l'État. Quand la saison de la moisson fut arrivée, on annonça aux colons parisiens ce qu'on avait fait à leur intention ; il ne leur restait plus qu'à récolter. Pleins d'espérance, ils laissèrent femmes et enfants, s'embrigadèrent par petites troupes de cinq à six et partirent joyeux pour la plaine.
Les braves parisiens coupèrent leurs blés de leur mieux ;
- les uns essayaient les faucilles pour la première fois avec plus ou moins d'adresse, -- les autres prenaient leurs serpes, et croyaient mieux faire avec des instruments qu'ils avaient coutume d'employer.
C'était au milieu de l'été, au moment des grandes chaleurs qui cette année-là ont été extraordinaires. Ces braves gens n'étaient point habitués à de tels travaux et à un tel climat. Ils n'étaient pas non plus accoutumés à coucher à la belle étoile : après avoir été en sueur toute la journée, ils étaient bientôt saisis par la fraîcheur de la nuit. La moisson n'était pas achevée que presque tous avaient déjà la fièvre, à tel point qu'il n'en resta pas assez pour vanner le blé ; on fut obligé de confier ce soin aux Arabes.
Les pauvres colons furent renvoyés chez eux pour se soigner, et beaucoup, une année après, n'étaient pas encore débarrassés des maladies qu'ils avaient gagnées en cette circonstance.
Dès la seconde année, une partie ne songeait plus qu'à retourner en France :
C'était pitié de les voir arriver dans les dépôts d'ouvriers pour prendre leur passage. La première campagne les avaient rendus méconnaissables, leurs traits, si animés, n'exprimaient plus que des souffrances ; et ces citadins, naguère si élégamment vêtus, n'étaient plus couverts que de haillons. Cependant, comme les vivres avaient été assurés pendant trois ans, ceux qui n'espéraient pas encore trouver en France des moyens d'existence, restèrent courageusement jusqu'à l'expiration du délai. A cette époque plus des trois quarts étaient déjà partis.
Si les maisons et les concessions avaient pu se vendre, presque tous eussent liquidé leurs affaires dit à l'Afrique un éternel adieu ; mais les titres de concession ne devaient devenir définitifs qu'au bout d'un stage de six années. Quelques-uns s'armèrent donc de courage et dans l'espoir de ne point revenir les mains vides, prolongèrent leur exil : il leur répugnait d'avoir fait en pure perte une telle équipée.
Le Gouvernement de son côté voyant la manière dont le nouvel essai tournait avait suspendu le départ des Parisiens. On avait fini par ne plus envoyer dans les colonies agricoles que des cultivateurs étrangers à la capitale ; l'Administration locale elle-même, au fur et à mesure des vacances, s'efforçait de colloquer dans ces colonies des ouvriers déjà éprouvés et surtout d'anciens militaires. Il était bien juste de donner la préférence à ces braves et de profiter de l'occasion pour reconnaître d'une manière convenable des services qu'ils avaient pu rendre.
Comme la classe des agriculteurs est en définitive la plus nombreuse en France, il en résulte que c'est surtout au milieu d'elle que se font les recrues de l'armée.
Aussi nos soldats avaient-ils été d'un grand secours pour les colonies agricoles. Presque toutes les cultures et tous les défrichements y avaient été faits par eux. Depuis longtemps, un bon nombre avait été envoyés dans les fermes et les villages pour donner aux autres colons le secours d'une main-d'œuvre à bon marché. Beaucoup de militaires n'attendaient que leur libération pour se fixer en Algérie. N'ayant point eu à subir les mêmes privations que les pauvres colons, ils s'étaient acclimatés beaucoup plus facilement et ils avaient pu faire un excellent apprentissage dans toutes les cultures auxquelles ils avaient été appliqués.
Les anciens militaires faisaient d'excellents colons : malheureusement ils manquaient de ressources nécessaires ; la plupart n'avaient été enrôlés sous les drapeaux que parce que leurs familles étaient trop pauvres pour leur acheter des remplaçants. L'abandon des colonies agricoles par les ouvriers parisiens a levé pour eux un instant cette difficulté.
Héritiers des avantages faits à ces derniers, ils se sont mis à l'œuvre avec quelques succès et ont continué avec ardeur pour leur propre compte des défrichements qu'on leur avait fait commencer pour des gens qui peut-être ne les valaient pas.
Ces enfants gâtés de la République s'étaient bornés la plupart du temps à les laisser faire ; quelques-uns ne s'étaient pas même donné la peine de défricher leurs maisons : les palmiers-nains poussaient sous leurs lits comme en serres chaudes. Le temps perdu fut bientôt réparé avec des gens au courant du métier ; c'était la seule chose qui manquait aux colonies agricoles.
Les meilleurs colons français sont ceux qui sont venus dans les derniers temps et qui ont été le plus abandonnés à eux-mêmes. La plupart se sont placés comme métayers dans les fermes, ou ont pris des arrangements avec des propriétaires pour différentes cultures industrielles.
Quelques-uns, après plusieurs campagnes avantageuses, ont pu :
- faire des économies,
- acheter des bêtes,
- se pourvoir d'instruments aratoires,
- monter enfin un matériel de ferme suffisant pour entreprendre à leur propre compte des exploitations agricoles, soit en louant de petites propriétés, soit en finissant par demander des concessions.
Les plus sages, au lieu de faire des démarches pour les obtenir, se sont bornés à en acheter.
Les colons du Gouvernement se dégoûtent ordinairement du cadeau qui leur est fait. Venus pour vivre de leurs rentes en propriétaires, ils sont bientôt las d'un travail auquel ils ne s'attendaient pas. Les charges de leurs concessions leur pèsent : pour bien peu d'argent, pour le payement de quelques dettes, ils abandonnent tous leurs droits.
Ainsi d'anciennes concessions toutes bâties coûtent souvent moins cher que des constructions qu'il faudrait faire partout ailleurs. En tout cas il y a avantage à se loger dans une maison dont les murs sont déjà secs, sur le territoire d'un village déjà pourvu de fontaines et de routes, plutôt que d'aller camper au loin, dans des lieux encore sauvages comme les concessionnaires privilégiés. Parmi les colons qui réussissent le mieux on remarque
- les Basques,
- les Francs-Comtois,
- les Lorrains,
- les Alsaciens.
Les colons du Nord sont quelquefois plus éprouvés par les maladies que ceux qui arrivent de la Provence et du Languedoc. Mais en prenant les soins hygiéniques nécessaires, en évitant tout excès, en ne se plaçant pas à leurs débuts dans les plus mauvaises conditions, ils finissent par jouit d'une aussi bonne santé que dans leur pays.
Venus souvent pour faire un simple essai, ils sont les premiers à se fixer sans esprit de retour. On ne les voit pas revenir au pays qu'ils ont quitté que pour vendre quelques héritages ou liquider une succession. Leur exemple est un encouragement pour d'autres et détermine de nouvelles migrations. Ces migrations sont bien facilitées quand de pauvres ouvriers, en se déplaçant, sont assurés de trouver, à leur arrivée dans une colonie lointaine, des habitants de leur village qui les accueillent comme des frères, qui leur cherchent du travail, qui les guident et qui les aident à faire leur apprentissage.
Un tel patronage, toujours cordial et empressé, est préférable mille fois à celui que peut donner le Gouvernement. Aussi est-il à remarquer que les Français placés sous sa tutelle sont en général ceux qui se sont le plus fourvoyés.
Victimes, la plupart du temps, de la mauvaise direction qui leur a été donnée, isolés les uns des autres, nos compatriotes ont éprouvé beaucoup de déboires, ont été entraînés dans bien des ruines et n'ont fait que perdre le peu qu'ils avaient apporté. Au contraire, bons nombre d'étrangers, arrivés avec rien, sont parvenus en quelques années à amasser plus d'argent qu'une vie tout entière de pénibles travaux ne leur en aurait procuré dans leur pays, et ils ont fini par attirer dans notre colonie une foule d'ouvriers laborieux et intelligents.
Toutefois, il ne faut pas se le dissimuler, ce pêle-mêle de la colonisation artificielle de l'État a eu ses avantages. Sans doutes :
- ces ouvriers parisiens,
- ces paysans basques ou francs-comtois,
- ces marchands marseillais,
- ces anciens artistes,
- ces anciens militaires,
- ces anciens capitalistes,
- tous ces hommes déclassées attirés des quatre coins de la France vers notre colonies ont dû former dans les premiers temps un singulier amalgame, dans tous les nouveaux centres de population, avec les indigènes et les étrangers de toutes les langues.
Sur ce sol africain, il n'y avait plus l'amour du pays et les affections de clocher ; les liens de famille étaient presque entièrement rompus.
Cet isolement, au premier abord, portait un peu à l'égoïsme, éteignait le dévouement fraternel, était plus préjudiciable que favorable au prochain ; mais les épreuves de la vie retrempaient le caractère. Beaucoup de natures molles et efféminées ont dû se transformer en Afrique, y prendre la virilité.
Plus les difficultés de la colonisation étaient grandes, plus il fallait d'énergie et de force d'âme pour les surmonter. L'intelligence alors se développait ; elle n'était plus d'ailleurs sous l'empire d'une étroite routine. Chacun apportait de son pays des procédés dont il s'empressait de faire l'application, et l'expérience qu'il en faisait pouvait profiter à tous.
Le citadin en paletot conduisait sa charrue à côté du paysan en blouse, son voisin ou faisait marcher son chariot à la suite de quelques rouliers, transportant comme eux des marchandises pour utiliser son voyage.
- On causait dans les champs,
- on causait sur les routes,
- on fraternisait dans les auberges.
Quel que fût le point de rencontre, si l'un était obligé de descendre, l'autre devait chercher à s'élever : c'était un pas de fait vers la civilisation.
D'un autre côté, sous le soleil africain, beaucoup de préjugés devaient se dissiper.
A la suite des abus du siècle dernier et des révolutions qui s'en sont suivies, l'impiété en France a fait de grands ravages. Dans beaucoup de nos provinces où les sentiments religieux se transmettaient sans s'altérer d'une génération à l'autre, la foi est maintenant presque éteinte. On n'ose plus s'avouer Chrétien : on rougit d'un signe extérieur de piété ; et lorsque l'on vit dans la plus profonde ignorance de l'Évangile, on croit se relever en blasphémant le saint nom de Dieu et en prenant à parte les ministres de ses autels. Le profond respect des Musulmans pour tout ce qui touche à leur foi a dû nécessairement faire une grande impression sur ces malheureux enfants de la révolution, élevés dans l'oubli de Dieu et quelquefois la haine des prêtres.
Ces barbares infidèles priant Dieu plusieurs fois par jour, se prosternent au premier endroit venu, sans respect humain, sans s'inquiéter de ce qui se passe autour d'eux, ne doivent-ils pas leur faire honte à eux-mêmes et leur rappeler que toutes les pensées d'un homme civilisé ne doivent pas se porter vers la terre ? Puis ces jeûnes et ces abstinences, dont la rigoureuse observation pourrait paraître une inconséquence de la part d'hommes qui se laissaient aller à toutes leurs passions, ne devaient pas moins les réconcilier avec les pratiques plus douces et mieux entendues de l'Église. Les Juifs eux-mêmes observaient scrupuleusement les préceptes de leur loi et on les voyait tous interrompre leurs affaires et fermer leurs boutiques pour sanctifier le jour du Seigneur.
Faisant un retour sur eux-mêmes, nos colons les plus prévenus, dans un milieu si différent, ne devaient-ils point s'apercevoir que l'Église n'avait rien imposé d'extraordinaire ; qu'en réalité c'était moins l'Église que leurs propres passions qui les gênaient, et que s'ils n'avaient pas la force de les vaincre, ce n'était pas une raison pour se placer, vis-à-vis de Dieu au-dessous des nations barbares ?
Aussi est-il à remarquer que leurs sentiments religieux, bien qu'ils aient eu de fréquentes occasions de s'émousser en Algérie n'ont fait au contraire que se raviver.
Naguère, ayant fait halte à l'entrée de la nuit dans un petit village nous fûmes témoin d'un consolant spectacle. A peine la cloche avait-elle sonné que :
- tous les colons interrompaient leurs affaires,
- faisaient trêve aux conversations,
- quittaient leurs tables,
- sortaient de leurs maisons, hommes, femmes et enfants.
C'était la prière du soir qui, chaque jour pendant le carême les réunissait au pied des autels. Là, un bon prêtre, sans artifice de langages, mais avec toute l'ardeur de ses convictions,
- leur donnait quelques salutaires conseils,
- les édifiait sur les avantages de la vie chrétienne,
- parlait aux mères de leurs enfants,
- exhortait les pères à donner l'exemple du bien,
- à s'observer dans leurs paroles.
La petite chapelle était trop étroite.
Les femmes à elles seules remplissaient la nef, les hommes étaient entassés dans les tribunes.
Au moment de la bénédiction, tous se prosternaient dans un saint recueillement.
Un de ces colons avait pris un garçon arabe pour auxiliaire ; celui-ci :
- avait suivi son nouveau maître,
- avait écouté le Ministre de l'Évangile,
- avait admiré la sagesse de ses discours.
Nos colons parlaient déjà de le faire baptiser ; des missionnaires n'eussent pas eu une plus belle ardeur de prosélytisme ; et cependant dans leurs villages de France, ces gens de notre pays eussent tout au plus un jour de dimanche osé aborder l'église où ils avaient eux-mêmes été baptisés ; ce n'eût été, peut-être, que pour aller plaisanter sous le porche, pendant qu'à l'intérieur le curé aurait fait son prône devant les bancs.
A chaque instant on voyait nos colons :
- réclamer des prêtres pour leurs villages,
- demander la fondation d'une chapelle,
- s'offrir eux-mêmes pour la construire, ou du moins pour aider les maçons et apporter les matériels.
Le culte, les écoles étaient encore, avant les routes et les fontaines, l'objet de leurs pétitions et des faveurs qu'ils demandaient au Gouvernement Général et aux préfets, lorsqu'ils étaient honorés de leur visite.
Tandis qu'en France on ne voit que trop souvent les Conseils municipaux repousser les institutions religieuses pour l'enseignement primaire, les municipalités de l'Algérie appellent à l'envi les Frères des écoles chrétiennes : c'est un point que M. le Ministre, dans l'intérêt des instituteurs laïques, s'est cru obligé d'adresser une circulaire aux préfets de l'Algérie pour qu'à l'avenir ils n'autorisassent les écoles des Frères que dans les communes où l'on pourrait réunir au moins 200 enfants.
Ce serait donc se faire une très fausse idée de la population française de l'Algérie que de lui croire des sentiments moins élevés que ceux qui ont jusqu'ici honoré notre vieille France. Il se forme au contraire, sur le continent africain, une génération nouvelle fortement trempée, qui formera un contre poids salutaire au relâchement moral que les bouleversements sociaux ont apporté dans la mère patrie. On a vu, il y a quelques années, nos généraux et nos soldats africains garantir la paix intérieure, et tout récemment encore soutenir avec éclat la gloire de la France à l'extérieur. Le temps n'est peut-être pas éloigné où nos colons de l'Algérie apporterons eux-mêmes les plus belles pierres de l'édifice dans la reconstruction du nouvel ordre social qui doit remplacer la France à la tête des nations.
La colonisation de l'Algérie par Louis De Baudicour 1856
|
|
| Alsaciens-Lorrains en Kabylie
Envoyé par M. Christian Graille
|
Après nos défaites de 1870-1871 une société de protection des Alsaciens-Lorrains demeurés français s'organisait à Paris et plaçait à sa présidence le très regretté Monsieur le comte d'Haussonville, de l'Académie française.
A l'aide de souscriptions, le Comité d'organisation songea, après avoir consenti de nombreux sacrifices en France, à reporter sur notre belle colonie une partie de ses ressources pour secourir les enfants d'Alsace-Lorraine émigrés en Algérie.
Messieurs les Gouverneurs généraux, l'amiral, comte de Gueydon et le brave général Chanzy, mirent à la disposition de la Société des territoires pour y fonder des villages peuplés de colons Alsaciens-Lorrains.
Monsieur le comte d'Haussonville n'ignorait pas en acceptant la présidence de la Société qu'il aurait à conduire une entreprise complexe et de longue haleine, mais grâce à son dévouement il a pu surmonter toutes les difficultés.
En Kabylie, dans le département d'Alger, la Société dans un but tout désintéressé a réussi à créer et peupler à ses frais les villages de Bou-Kalfa, d'Haussonvillers et de Camp-du-Maréchal dans lesquels elle a installé successivement 195 familles comprenant 685 personnes.
Nous verrons ce que ces centres ont produit depuis leur création à ce jour.
La colonisation fut négligée durant les dernières années de l'Empire ; la Société de protection a contribué à appeler dans des circonstances exceptionnelles l'intérêt public sur la question de la colonisation en Algérie par les Européens et principalement de bons Français ; elle a ainsi rempli sa mission de bienfaisance et rendu service au pays.
Nous puiserons des nombreux et sérieux renseignements dans un rapport adressé à Monsieur le Gouverneur général de l'Algérie, au nom de la Société de protection, par le très honorable Monsieur Guynemer, ancien sous-préfet de Saverne, vice-président de la Société et président de la Commission de colonisation. Ce rapport remonte à mai 1891 ; nous n'en extrairons que divers passages afin de permettre aux lecteurs des Clochettes d'apprécier l'œuvre accomplie en toute connaissance de chose.
" La Société de protection, écrivait le rapporteur, a accompli en Algérie une œuvre multiple : Dès le début de l'émigration Alsacienne-Lorraine en 1872, elle s'est appliquée à secourir, aussi bien en Algérie qu'en France, les nombreuses familles qui, pleines de confiance dans la générosité de leur ancienne patrie, venaient lui demander asile. Une loi votée par l'Assemblée Nationale le 15 septembre 1871, sur la proposition de l'honorable M. Keller, avait promis 100.000 hectares de terres aux Alsaciens-Lorrains qui viendraient se fixer en Algérie comme colons.
Ils arrivèrent en foule et dès la fin de 1872 on en comptait 2.500, en mars 1873 il y en avait 3.260. Mais presque tous se trouvaient dans un dénuement complet, et comme en si peu de temps, il avait été matériellement impossible de rien préparer, le Gouvernement, malgré ses efforts et ceux des comités privés qui s'étaient créés à Alger, Oran et Constantine et sur d'autres points de l'Algérie, fut débordé par un flot d'émigrants.
Tout manquait pour les installer, l'argent et le matériel. Les terres elles-mêmes, bien qu'existant en principe (le séquestre prononcé récemment contre les tribus insurgées venait de mettre 600.000 hectares à la disposition de l'État) n'étaient pas réellement disponibles car elles n'étaient ni délimitées, ni alloties ; les formalités nombreuses qu'entraîne le séquestre n'étaient même pas accomplies
Quant aux anciennes terres domaniales, elles étaient en très petites quantités, du moins celles immédiatement cultivables, et, sur quelques points, dans la province d'Oran notamment.
Il fallut même acheter des terres aux Arabes pour y installer les nouveaux centres que le Gouvernement se proposait d'y créer, à Aïn Fekan, par exemple.
De là, des embarras de tous genres pour le Gouvernement de la Colonie, et des souffrances sérieuses pour les émigrés, qui durent pendant longtemps rester sous des tentes prêtées par l'autorité militaire, ou sous des gourbis en roseaux, exposés à la fièvre et au découragement, et disséminés un peu partout dans les trois provinces sur tous les points où le Gouvernement avait jugé utile de créer de nouveaux centres européens, soit dans un but stratégique, soit parce qu'il s'y trouvait des terrains disponibles."
Émue de cet état de chose, la Société de protection des Alsaciens-Lorrains envoya un premier secours de 100.000 francs en novembre 1872 ; cette somme fut répartie entre les émigrés.
Parmi les bienfaiteurs qui faisaient alors partie des comités locaux en Algérie nous citerons M. Noblemaire, M. Scherer qui était ingénieur des Ponts et Chaussées à Constantine, etc. ; nous ne pouvons ici les citer tous car ils sont trop nombreux.
M. l'Amiral Gueydon, gouverneur général de l'Algérie, proposa à M. le comte d'Haussonville de confier à la Société certains territoires séquestrés après l'insurrection de 1871, pour y établir aux frais de la Société et dans les meilleures conditions, des cultivateurs Alsaciens-Lorrains.
En mai 1873, sur la proposition de M. le comte d'Haussonville, l'Assemblée Générale des souscripteurs de la Société vota à l'unanimité une somme de 600.000 francs pour la création de deux villages.
Divers décrets mirent à la disposition de la Société de protection trois territoires, à savoir :
1° 2.549 hectares à Azib-Zamoun, aujourd'hui Haussonvillers, situé sur le chemin de grande communication n° 1 de Ménerville à Fort-National, à 31 kilomètres du port de Dellys et 82 kilomètres d'Alger. (Décret du 23 juillet 1875).
2° Bou-Kalfa qui a conservé son nom, situé sur le même chemin et à 3 kilomètres Ouest de Tizi-Ouzou et 101 d'Alger.
M. Jean Dolfus, ancien maire de Mulhouse avait essayé d'installer à ses frais, dans ce centre, des familles alsaciennes ; mais pour des raisons majeures il dut abandonner sa patriotique entreprise ; la Société de protection ne fit que continuer son œuvre.
Le territoire comprend 1.300 hectares.
3° Tadmaït, nommé aujourd'hui Camp-du-Maréchal, situé à 7 kilomètres d'Haussonvillers, 29 de Dellys, 17 de Tizi-Ouzou et 10 de Rébeval. Le territoire de colonisation comprend 1478 hectares. Ce centre est à proximité de la grande route ci-dessus dénommée. (Décret du 7 mars 1878).
Le Gouvernement fit exécuter les travaux publics des villages :
- lotissement des terres,
- empierrements des rues,
- chemins d'accès,
- abreuvoirs,
- bâtiments publics,
- plantations etc…
La Société de protection était tenue, par ces différents décrets, d'installer dans ces centres, à ses frais, des colons Alsaciens-Lorrains auxquels elle devait rétrocéder toutes les terres qu'elle avait reçues de l'État.
Haussonvillers
A la suite d'un traité conclu entre M. le comte d'Haussonville et M. Helferich, entrepreneur, 40 maisons furent construites avant le 1er novembre 1873 :
- Dix de ces constructions avaient trois pièces,
- vingt-cinq n'avaient que deux pièces,
- les cinq autres avaient quatre pièces.
MM. Biliare et Dérotuie, des Ponts et Chaussées consentirent à surveiller la construction tandis qu'ils dirigeaient les travaux de l'État tels que :
- nivellement du village, - empierrement des rues.
La Société adopta un système pour la répartition des terres ; elle partagea les terres labourables en lots de 10 hectares chacun, afin de permettre à chaque colon de cultiver dès son arrivée. La deuxième année chaque cultivateur avait 25 hectares de labour, un lot urbain, 30 ares de jardin et devait recevoir un hectare pour y planter de la vigne.
La Société reconnut la nécessité d'accorder 40 hectares en moyenne aux colons, le sol ne produisant pas ce qu'on croyait être en droit d'obtenir.
Pour assainir le village d'importantes plantations d'eucalyptus furent faites et les résultats obtenus furent excellents.
C'est ainsi qu'en novembre 1873, cent cinquante-huit Alsaciens-Lorrains furent installés à Haussonvillers, et recevaient dès leur arrivée :
- une maison avec les meubles indispensables, - des vivres, - des charrues, - des bœufs, etc…
Monsieur Drach, représentait la Société de protection à Haussonvillers et nous sommes obligés de reconnaître qu'il s'acquitta de sa mission avec beaucoup de dévouement, d'intelligence, et qu'il sut, par la force de son caractère faire respecter les nouveaux colons par les indigènes. M. Drach n'a pas eu la satisfaction de voir le couronnement de l'œuvre à laquelle il s'était si fortement attaché ; il mourut en 1885, regretté par tous ceux qui avaient pu le connaître.
Le nom d'Haussonvillers fut donné à ce centre d'après un vœu émis par le Conseil Général du département d'Alger dans sa séance du 21 avril 1875. Cela ne fut que fort juste et le nom du bon comte d'Haussonville restera longtemps, toujours, non seulement gravé dans le cœur des Alsaciens-Lorrains, mais aussi dans les annales de la colonisation en Algérie.
Haussonvillers fut rattaché administrativement à la commune mixte des Issers ; ce n'est qu'en 1884 que ce centre fut érigé en commune de plein exercice.
En 1885 la construction de la ligne ferrée de Ménerville à Tizi-Ouzou fit d'Haussonvillers une petite ville, l'Est Algérien y installait :
- la société des ponts en fer construisait des logements pour ses employés,
- ses bureaux,
- ses magasins,
- ses écuries,
- ses forges etc.
Tous les colons s'occupaient de transports et faisaient de très bonnes affaires ; malheureusement pour quelques-uns ils oubliaient qu'ils étaient avant tout cultivateurs et s'en ressentirent à la fin des travaux. Plusieurs virent croître leurs dettes envers la Société et ne pouvant faire face à leurs engagements furent expulsés. La Société perdit de ce fait la respectable somme de 90.267 francs.15.
A l'heure actuelle, malgré des récoltes médiocres, les colons d'Haussonvillers sont assez aisés, et l'on peut dire d'eux que ce sont des travailleurs.
La commune d'Haussonvillers avait une annexe, Camp-du-Maréchal, mais malheureusement pour elle cette annexe ne lui appartenait plus depuis 1891. Haussonvilliers faisait partie du canton de Bordj Ménaïel ; il avait une recette des Postes et un télégraphe ; la gare de l'est Algérien était à environ un kilomètre du village ; deux grandes routes passaient au-dessous de ce centre, celle de Ménerville à Fort National et celle d'Haussonvillers à Dellys.
On y cultivait les céréales, tabacs et vignes ; l'eau y était abondante.
Un moulin important était installé sur l'Oued-Chender : les grottes d'Oued-Chender méritaient d'être visitées.
La population de cette commune d'après le dernier dénombrement était de 242 européens et de 5.305 indigènes.
Haussonvillers avait un marché qui se tient le mardi de chaque semaine ; la Justice de paix y tenait une audience foraine tous les quinze jours.
Depuis sa création, Haussonvillers eut cinq maires dont quatre sont décédés, à savoir : MM. Martin, F Heitzler, Soulage et Runtz.
Camp-du-Maréchal
L'emplacement du village fut choisi par M. le comte d'Haussonville après avoir visité le terrain avec le regretté commandant Ricard, officier du génie, décédé comme général ; il choisit un plateau peu élevé situé à environ 300 mètres au Sud de la route départementale.
C'est sur ce plateau que le maréchal Randon, après son expédition de Kabylie en 1856 avait établi son camp.
C'est en mémoire du séjour du maréchal Randon que l'on a donné le nom de Camp-du-Maréchal à ce territoire.
M. le comte d'Haussonville consacra cinq mille francs à des plantations. Les rues et places du village étaient plantées en frênes de Kabylie, le terrain environnant le centre était entouré d'acacias, eucalyptus et autres essences résineuses dont l'efficacité est excellente contre les fièvres ; neuf mille arbres furent aussi plantés par les soins des Ponts et chaussées.
L'ensemble de ces plantations couvrait environ 27 hectares, mais beaucoup d'arbres disparurent furent pour faire place à la charrue.
Le lotissement de territoire fut exécuté par le service topographique et forma trente lots de culture d'environ 25 ou 30 hectares chacun pour les habitants du village et cinq fermes de soixante hectares chacune ainsi que d'importants terrains communaux.
La Société aurait dû donner à chaque colon une quarantaine d'hectares et ne créer aucune ferme.
- Les fermes les plus importantes Kremer et Penot furent vendues,
- celle de Becker mise en vente,
- celle de Drack louée partie à des colons, partie à des indigènes,
- enfin celle de Zunher occupée par un fermier français.
Les premiers colons qui furent installés à Camp-du-Maréchal y arrivèrent au mois d'octobre 1880. La Société de protection mit dans l'obligation ses protégés à verser 4.000 francs de cautionnement comme garantie de leur volonté de s'établir sérieusement en Algérie, mais elle s'engagea aussi, une fois ce versement fait par chaque colon, à lui fournir dès son arrivée :
1° à titre de prêt, une maison toute bâtie d'une valeur d'au moins 4.000 francs, c'est-à-dire égale au versement, ainsi que le mobilier nécessaire ; à titre d'avances remboursables, les semences, les animaux et instruments d'agriculture, les vivres dont il pourrait avoir besoin jusqu'à concurrence de 2.000 francs.
Monsieur Guynemer donna tous ces intéressants détails dans son rapport, il dit encore : " Aussitôt que ces avances auraient été remboursées à la Société, par le colon, quelle qu'en fût l'importance, la Société s'engageait, pourvu qu'il y eût les trois ans de résidence exigés par le décret, à lui transférer la pleine propriété de tout ce qu'il avait reçu d'elle, soit à titre de prêts, soit à titre d'avances ; c'est-à-dire le mobilier, le cheptel, les terres et la maison, celle-ci ne lui étant comptée que pour 2.000 francs, tandis qu'en réalité elle en avait coûté 4.770. En d'autres termes, les 4.000 francs que la Société demandait à ses nouveaux colons de Camp-du-Maréchal représentaient d'une part la moitié de la maison dont l'autre moitié devait leur être abandonnée en pur don, d'autre part la garantie des avances qu'elle s'engageait à leur faire jusqu'à concurrence de 2.000 francs. les colons ne devant, bien entendu, lui rembourser que ce qu'ils auraient réellement reçu d'elle ".
En résumé, moyennant 2.000 frs. nos colons ont reçu une maison de 4.770 frs. et une concession de 25 à 30 hectares. On reconnaîtra facilement que l'œuvre accomplie par la Société de protection a été belle et nous allons voir plus loin les résultats obtenus par les vaillants colons du Camp-du-Maréchal.
On supposait que le chiffre du cautionnement porterait atteinte au recrutement des futurs colons, il n'en fut rien ! Le comte d'Haussonville et son secrétaire général, Monsieur Henri Penot n'eurent que l'embarras du choix ; c'est à Nancy que ces messieurs se rendirent en 1880 et 1881 pour juger des aptitudes des familles qui se présentaient.
Le peuplement de Camp-du- Maréchal fut rapide, 26 colons reçurent des maisons construites, 12 construisirent à leurs frais ; à l'heure actuelle toutes les maisons ont été agrandies et l'aspect du village a bien changé.
Ajoutons que beaucoup de colons n'ont pas eu recours aux avances faites par la Société.
Camp-du-Maréchal avait été rattaché à la commune d'Haussonvillers en 1885 ; mais le décret du 13 mars 1891, érigeait Camp-du-Maréchal en commune de plein exercice.
Monsieur Eininger Félix, en sa qualité de maire, administra cette commune depuis le premier juin 1891.
Le village s'était embelli : des cassis-pavés permettaient aux eaux de ne plus croupir dans les rues ; chaque quartier avait sa borne-fontaine ; on construisit en ce moment une nouvelle conduite d'eau qui permettrait d'irriguer les jardins ; chaque colon ayant en moyenne une vingtaine de bêtes à cornes, on dût augmenter le nombre des abreuvoirs, un agrandissement s'était produit à l'est du village où l'on apercevait d'élégantes villas.
L'église a été bâtie par le Gouverneur ainsi que le presbytère et l'école de garçons qui a été dirigée à la création du centre par un instituteur laïque d'origine alsacienne ; l'école des filles a été bâtie par la Société de protection, en majeure partie au moyen de souscriptions particulières ; cette construction est le principal ornement du village de Camp-du-Maréchal ; elle a coûté 25.029 francs dont 15.950 proviennent des souscriptions, le surplus a été payé par la Société.
Voici le nom des principaux donateurs :
- M. le comte de Paris 5.000 francs
- Mme la comtesse de Greffuhle 4.000 francs
- M. le duc de Chartres 1.000 francs
- M. le prince de Joinville 1.000 francs
- M. le duc d'Aumale 1.000 francs
- M. le prince de Chalais 1.000 francs
- Mme Érard 1.000 francs
- M. le comte d'Haussonville 500 francs
- M. le prince Amédée de Broglie 500 francs
- M. le baron de Valry 300 francs
- M. le baron de Bussière 300 francs
- Deux anonymes 350 francs
Soit 15.950 francs
La Société a donné gratuitement à la commune ce bâtiment qui fait actuellement partie des communaux de ce village.
M. le Ministre de l'Instruction publique donna aux deux écoles du Camp-du-Maréchal des cartes murales et tout un matériel scolaire. L'église reçut également de lui un beau tableau, copie du Saint Sébastien de Ribot.
Un four banal avait été construit par la Société pour l'usage des colons ; cette construction sert aujourd'hui de dépôt aux appareils d'éclairage à l'acétylène.
- Une orangerie ancienne qui dépérissait a été rétablie,
- un puits a été creusé,
- une noria et une conduite d'eau construites pour l'arrosage de cette belle plantation.
h a c (h : hectare (a) : are (c) : centiare.)
- Terrains de parcours 160 40 70
- Pâturages plantés et marais 12 82 80
- Marais et plantations 27 99 30
- Aires à battre le grain 4 85 10
- Orangerie, noria, puits, labour 3 30 00
- Lavoir et abreuvoir 70
- Mairie et école de garçons 95 60
- Église et presbytère 48 10
- Four banal 36
- Dotation de l'école de garçons 6 50 00
- Dotation de l'école de filles 7 50 00
- Dotation de la cure 8 35 25
- Cimetière européen 70 40
- Cimetière musulman 9 60
Chiffre égal 233 97 91
Les canaux d'assainissement, les routes, chemins, ravins, cours d'eau, lignes ferrées, etc. comprennent 72 h. 05 a. 4 c.
A Camp-du-Maréchal les cochers installés par la Société n'ont pas abandonné leur concession ; en ce moment il y a encore 24 familles des premières établies ; plusieurs fils de colons mariés dans le pays travaillent avec leurs vieux parents ; les concessions vendues ont été achetées par les colons de Camp-du-Maréchal.
Malgré tout : travail, économie, réussite, les familles de nos colons sont nombreuses, les concessions trop petites et les enfants de ce riche village seront obligés d'aller occuper leurs bras ailleurs.
Un centre est en création près de Camp-du-Maréchal, je veux parler d'Horace Vernet ; de nombreuses demandes de concessions ont été faites par les fils de colons de Camp-du-Maréchal que l'on cite comme modèles de l'agriculture.
Le Gouvernement général leur donnera-t-il satisfaction ? Ne serait-il pas préférable de soutenir les familles qui sont actuellement installées en Algérie, avant d'avoir recours à nos frères de métropole ? Je ne suis pas de ceux qui ne voudraient pas voir augmenter le nombre de bons Français dans notre colonie, loin de là, mais j'estime que l'on doit songer surtout à ceux qui, acclimatés et connaissant la culture du pays, peuvent donner des garanties de réussite. Les fils des colons algériens devraient être donc préférés aux agriculteurs français que l'on expose aux maladies et très souvent à la misère.
En résumé, Camp-du-Maréchal est en pleine prospérité, on y cultive les céréales, les tabacs (ceux-ci sont fort appréciés par l'administration de l'État) ; les figues et les huiles sont d'un bon rapport ; le bétail y est trop nombreux, les terrains de parcours étant trop éloignés du centre et insuffisants ; on y fait aussi l'élevage de la volaille ; il y a de belles luzernes sur les rives de l'Oued-Sébaou ; enfin la plaine est magnifique.
Mais on redoute beaucoup de voir, d'ici quelques années, le Sébaou envahir cette plaine ; on parle d'endiguement, de construction de barrages, que sais-je encore ? En attendant on se contente de faire des études, des plans, etc. ; on gaspille l'argent mais on ne protège pas le colon.
La population européenne de Camp-du-Maréchal est de 224 habitants ; la population totale de la commune est de 7.883 habitants.
Camp-du-Maréchal a deux douars, à savoir :
- Sidi-Ali-Bou-Nab, qui renferme onze tribus et une population totale de 4.631 habitants,
- Beni Chennacha qui a aussi onze tribus et 2.366 habitants.
- Un marché dit Tléla qui se tient, ainsi que le nom l'indique, tous les mardis ; ce marché déjà important ne fera que prospérer ; on y montre l'arbre sous lequel le célèbre Beauprêtre venait s'abriter habillé en arabe pour surveiller les Kabyles.
La commune de Camp-du-Maréchal possède aussi une forêt de chênes-liège en plein rapport ; ce liège est très recherché et se vend 46 francs le quintal.
La ligne de tramways à vapeur sur routes vient se joindre à celle de l'Est Algérien ; cette jonction amène beaucoup de voyageurs dans la localité ; le trafic y est assez important.
Indépendamment des lignes ferrées il y a deux services de voitures qui vont de Tizi-Ouzou à Alger et de Camp-du-Maréchal à Dellys.
Un magnifique monument en marbre du Filfila, (Région de Philippeville : considérable gisement de marbre fameux du blanc le plus pur au noir le plus intense.) est élevé à la mémoire du comte d'Haussonville ; il a été sculpté par le célèbre Falguières.
La création des trois villages a coûté la respectable somme de 1.087.310 francs 63 ; la Société de protection des Alsaciens-Lorrains a payé avec ses propres fonds 804.094 francs 72 ; la Société de protection a consacré encore 129.196 francs 80 à secourir les colons Alsaciens-Lorrains, répartis sur les autres points de l'Algérie ; elle a donc employé dans la colonie pour les Alsaciens-Lorrains 1.216.497 francs 43.
La Société de protection des Alsaciens-Lorrains a accompli une belle œuvre ; Haussonvillers, Bou-Kalfa et surtout Camp-du-Maréchal peuvent servir de modèles à la colonisation.
Les Alsaciens-Lorrains sont de bons patriotes, de bons républicains et fidèles à leur religion ; ils ont toutes les qualités voulues pour réussir car ils joignent à l'amour de la famille celui du travail, de l'ordre et de l'économie.
Roumieux
Les Clochettes algériennes (30-05, 07-06, 05-07, 19-07-1903)
|
|
| Les Espagnols
Envoyé par M. Christian Graille
|
De tous les Européens étrangers qui sont venus s'établir dans notre colonie africaine, les Espagnols sont assurément les plus nombreux. Dans beaucoup de villes de l'ouest, et même dans quelques-unes de la province d'Alger, ils forment une portion notable de la population.
Une grande quantité d'haouchs ou de fermes de l'intérieur sont loués à des Espagnols. On les trouve jusque dans nos postes avancés. La moitié de la légion étrangère s'est recrutée parmi eux. Partout les filles espagnoles se mettent au service des particuliers, et la plupart, malgré tout ce qu'on peut en dire, sont encore les domestiques les plus convenables.
Les Espagnols, à la différence d'un trop grands nombre des premiers colons français, ne peuvent passer pour des aventuriers ; ils sont ordinairement mariés, et quelquefois à la tête de plusieurs générations lorsqu'ils se présentent dans notre colonie.
Les guerres civiles d'Espagne ont singulièrement favorisé cette émigration.
Bien des pères de familles, pour éviter d'y prendre part et soustraire leurs enfants à la conscription ont pris le parti d'abandonner leur malheureuse patrie.
L'État avait supprimé les ordres monastiques sans grand profit pour les contribuables, et encore moins pour les pauvres.
La misère était grande en Espagne et il semblait que Dieu eût voulu appesantir son bras sur cette nation catholique. Pendant plusieurs années, une sécheresse extraordinaire avait tari les rivières et ruiné plusieurs provinces en les privant d'irrigations. Aux fléaux de la guerre et de la disette était venu s'ajouter celui du gouvernement constitutionnel, qui, comme tous les gouvernements constitutionnels du monde, avait eu pour résultat de beaucoup obérer les finances de l'État en multipliant le nombre de ceux qui s'inscrivaient pour vivre et s'enrichir à ses dépens.
Lors de la première suppression des couvents, une grande partie des biens du clergé avait été vendue ; quand, avec la paix, on crut devoir un instant arrêter ces spoliations, on eut recours aux contribuables, et le génie fiscal s'épuisa en inventions. On ne se contente plus, comme dans bien des pays, d'imposer des terres, on imposa tous les animaux.
- Les propriétaires durent payer 3 francs par mois pour chaque cheval, âne ou mulet,
- une somme de 1 franc également par mois, pour chaque poule,
- une somme analogue proportionnelle, selon son âge, pour chaque bête à l'engrais comme les porcs et les moutons.
L'entretien du bétail devenait une chose très dispendieuse dans la moindre exploitation agricole, et il était à craindre que, par économie, beaucoup de propriétaires et de fermiers ne laissent mourir des bêtes qui leur coûtaient par année, et même par mois, beaucoup plus qu'elles ne leur rapportaient : aussi le fisc espagnol eut-il soin de mettre un impôt sur toutes les bêtes qui viendraient à mourir.
Bien des petits viticulteurs avaient leur deuil du bétail, ils leur restaient les pioches pour travailler leurs terres.
On imagina alors d'imposer les pioches, et les malheureux ouvriers n'eurent pas même la consolation de pouvoir garder tous leurs outils : ils eussent été pour eux un luxe ruineux. Ce nouvel impôt fut un de ceux qui exaspéra davantage les pauvres Espagnols. Soumettre les bêtes à un impôt personnel leur paraissait déjà bien inique, ils se révoltèrent à l'idée d'un impôt de ce genre frappant des objets qu'ils ne mangeaient pas.
Le fisc espagnol imagina beaucoup d'autres choses pour les impôts indirects ; il ne s'attaqua pas seulement aux denrées mises en vente, il fit payer aux gens des campagnes le droit de pouvoir manger eux-mêmes les fruits de leurs récoltes.
L'Algérie était exempte d'impôts ; tout ouvrier espagnol y apportant une pioche trouvait de son travail un prix élevé dont la valeur n'était pas amoindrie par de nombreux besoins.
Un bras de mer d'une cinquantaine de lieues sépare Oran, l'Andalousie et la province de Valence. Les vents d'Ouest sont fréquents sur ces parages, la moindre balancelle, par un beau temps, fait le trajet en une journée. Sans beaucoup de frais, les Espagnols peuvent donc se transporter avec tout leur mobilier de l'autre côté du détroit.
Ils retrouvent à Oran les débris de constructions qui ont élevées leurs pères pendant le cours d'une domination de plusieurs siècles. Les Français qui ont repris le pays aux Maures sont catholiques comme eux ; ils leur semblent rentrer dans une patrie momentanément abandonnée. La province d'Oran s'est donc naturellement, en grande partie, peupler d'Espagnols. La ville d'Oran, à elle seule, en possède11.000 sur une population européenne de 22.000 habitants.
Alger est un peu plus éloigné de l'Espagne, la traversée est d'environ du double ; néanmoins les vents, presque toujours favorables y ont poussé encore plus d'Espagnols. Pendant longtemps, le peu de vie de la colonie française se trouvait concentré à Alger. L'État y faisait exécuter de grand travaux, et les capitaux privés n'affluaient que là. Il fallait des bras pour tous ces travaux, les Espagnols en fournirent.
La ville d'Alger a compté un instant près de 20.000 Espagnols. La plupart dans les commencements ne gagnaient pas moins de 5 frs par jour en extrayant de la pierre ou en faisant des travaux de terrassement. Ils s'adonnèrent bientôt à des travaux plus avantageux encore et plus conformes à leurs goûts. On en vit un grand nombre louer les jardins abandonnés des environs, y établir des norias et, grâce à des irrigations bien entendues, fournir à la ville une grande abondance de légumes. A peine la ville de Blidah était-elle occupée qu'ils y accoururent.
Ils y transformèrent en jardins potagers les orangeries que la guerre avait dévastées et, avec les eaux de l'Oued-el-Kébir, appliquèrent largement leur système d'irrigation. La ville de Blidah est encore en grande partie peuplée d'Espagnols, ils y forment plus du tiers de la population européenne.
Drapé dans sa couverture de laine à carreaux blancs et bleus, l'Espagnol arrive dans notre colonie avec sa fierté primitive ; il méprise l'infidèle, el Mauro, dont il a fini par devenir victorieux et il ne comprend pas les attentions bienveillantes qu'ont pour lui les Français.
Il appartient à une race noble et valeureuse qui, pendant plusieurs siècles, a tenu le premier rang parmi les nations européennes et qui toujours a su résister avec intrépidité à toute invasion étrangère.
Il lève sa tête, il aime sa patrie qu'il est obligé de fuir ; rien, malgré tout, n'est plus beau que l'Espagne. Les troubles politiques qui dévorent ce peuple n'ont point altéré ses sentiments monarchiques non plus que sa foi vive ; il respecte l'autorité mais il ne rampe jamais devant elle, comme de guerre lasse les révolutionnaires de bien des nations.
Moins avancés en civilisation que le Français, les Espagnols n'ont pas les même besoins. Chez ces derniers les garçons se couchent tout habillés sur la dure, une pierre leur sert d'oreiller : le chef de famille seul se donne le luxe d'un lit quand il est dans l'aisance.
Le mobilier de leur ménage n'est guère plus coûteux et plus embarrassants que celui des Arabes. Quelques tabourets formés avec trois petites planches leur servent de sièges, ils s'y reposent les bras appuyés sur leurs genoux et la cigarette à la main.
A l'heure du repas chacun se range autour d'une petite table basse qui peut à peine contenir une gamelle et les morceaux de pain des nombreux convives ; le riz, coloré de safran, à défaut de légumes verts, est le mets le plus ordinaire ; souvent il est remplacé par quelques harengs salés, cuits sans gril, sur la braise ou la cendre ; la viande et le vin n'entrent dans le festin que le dimanche et jours de fête.
Les Espagnols sont sans contredit les meilleurs ouvriers agriculteurs de notre colonie. La plupart venant des contrées méridionales de l'Espagne, il n'y a pas pour eux de changement de climat ni de culture lorsqu'ils émigrent sur la terre d'Afrique. Leurs habitudes sobres leur rendent toutes les privations faciles ; une nourriture peu substantielle n'altère pas leur tempérament ; le moindre abri leur suffit ; ils peuvent s'installer partout comme les Arabes. Tandis qu'il faut pour attirer un fermier français des établissements coûteux et des avances considérables, le fermier espagnol se contente ordinairement d'une misérable cahute et quand il a un peu d'eau pour se créer un jardin potager il a bientôt pourvu à une grande partie de ses frais de nourriture.
En arrivant l'Espagnol va se trouver un compatriote de son village ou de sa province : si petite que soit l'habitation de son hôte, il y a toujours place pour s'y étendre la nuit sur le carreau ou sur la terre. On ne peut mettre de rallonge à la table mais on peut agrandir le cercle. Un nouveau venu aide dans ces travaux celui qui le loge et qui le nourrit.
Au besoin, on trouve bientôt à le placer domestique chez un autre Espagnol ; mais c'est moins à titre de mercenaire qu'il entre dans cette autre famille que comme adopté par elle pour la compléter et lui donner les bras qui lui manquent.
Il apprend là :
- un peu de français,
- fait son apprentissage du pays,
- se met en rapport avec les colons français et étrangers.
Bientôt il peut voler de ses propres ailes, se louer à la journée. Alors il peut gagner 2 francs cinquante centimes par jour, quelquefois un peu moins mais d'autres fois bien davantage.
En été, à l'époque des récoltes, où il faut des ouvriers à tout prix, les journées, selon l'éloignement et les fatigues lui sont payées 3 et 4 francs.
L'Espagnol qui a travaillé un an ou deux à la journée finit par louer pour son propre compte un petit jardin ou un coin de terre. Pour louer, il faut payer le terme ou le semestre d'avance ou si le terrain n'est pas en rapport, il faut vivre plusieurs mois avant de recueillir les fruits.
Mais le nouveau fermier ou métayer a déjà fait quelques petites économies ; il s'est constitué un petit crédit sur les lieux.
En arrivant il n'avait que sa pioche et quelques hardes ; il est maintenant bien approvisionné d'outils, il a un commencement de ménage ; bientôt il va acheter :
- un âne, - des cochons, - des poules, - une chèvre, - une charrue, - une charrette.
Ses bénéfices augmentent à mesure que son travail est plus facile et que ses engrais sont plus abondants. Quelquefois alors il entreprend de plus grandes cultures et se met à la tête d'une ferme de quelque importance ; mais le plus souvent il aime mieux faire l'acquisition d'un jardin et s'y établir.
Quant aux concessions, il n'y songe guère ; il n'a pas le temps à perdre pour solliciter, il n'aurait pas du reste assez de crédit pour en obtenir et il a trop d'intelligence pour ne pas comprendre que toute la valeur d'une terre n'est point dans son étendue mais dans les produits qu'elle est en état de donner.
L'Espagnol ne dispute donc pas les concessions du Gouvernement aux Français et aux Allemands : il leur laisse volontiers le soin de défricher à grand frais les broussailles et les palmiers-nains pour s'appliquer aux cultures industrielles.
L'Espagnol bon ouvrier refuse, quel que soit sa misère, de travaille le dimanche. Ce précepte de l'Église est le dernier qu'il abandonne ; il chôme les fêtes qui ne sont plus chômées en France et tient même davantage aux pratiques conservées en Espagne qu'aux préceptes les plus rigoureux du Christianisme.
Effectivement le dimanche est le seul jour de liberté du pauvre ouvrier ; quel que soit le plus ou le moins de ferveur de ses sentiments religieux, on conçoit qu'il ne veuille pas laisser prescrire ce beau privilège.
La fierté espagnole a besoin de sortir au moins une fois par semaine de l'esclavage du travail manuel. L'ouvrier espagnol croit qu'il est de la dignité de l'homme de donner essor à toutes ses facultés ; en cela il n'estime pas perdre son temps ; s'il arrive moins vite à la fortune, il y arrivera moins abruti. Toutes les consciences ne se purifient pas le dimanche, mais les visages s'ornent et s'animent, les rapports sociaux se fortifient et s'étendent.
Le dimanche les Espagnols se promènent, se visitent, s'amusent. Ils commencent par se parer de leurs plus beaux vêtements. Les hommes quittent les légers caleçons de la semaine pour enfermer leurs jambes dans d'étroites culottes :
- sur leurs blanches chemises, ils endossent de petits gilets qui sont loin de rejoindre le vêtement inférieur,
- une large ceinture de laine comble l'intervalle,
- une veste de drap noir jetée négligemment sur les épaules ajoute de l'originalité à ce costume qu'heureusement la mode ne vient jamais modifier.
Mais ce qui le distingue plus particulièrement, c'est son chapeau conique, plus ou moins tronqué, orné sur le côté de gros pompons noirs et garni de velours sur les rebords arrondis. Ce chapeau se place légèrement sur le front par-dessus un fichu de couleur noué autour de la tête.
La toilette des femmes et surtout celle des jeunes filles perd beaucoup de son originalité en Afrique, sous l'influence de la civilisation française.
Ces dernières ne peuvent résister à l'empire de la mode ; seulement elles adoptent de préférence les couleurs les plus éclatantes et surtout le jaune.
On ne leur voit jamais de bonnet sur la tête, elles préfèrent à cette coiffure les foulards ; au besoin elles ravissent à leurs épaules le fichu dont, pour sortir de leur maison ou entrer dans une église, elles ne manquent jamais d'encadrer le visage. Toute la préoccupation des jeunes filles est de bien se parer les jours de fêtes. Pendant la semaine, peu leur importe d'aller nu-pieds et en guenilles, de n'avoir sur elles d'autres ornements que leurs cheveux, pourvu que le dimanche elles aient une jolie toilette à produire.
Le père de famille aimerait mieux se priver de nourriture que de ne pouvoir, sous ce rapport, satisfaire ses enfants : d'un autre côté, il n'y a pas pour eux de meilleur stimulant au travail de la semaine que la pensée des joies et des réjouissances du dimanche.
Quand tous les amis sont réunis, le père de famille prend sa guitare et tous les jeunes, à tour de rôle, se mettent à danser deux par deux.
- Ils reculent,
- ils avancent à petits pas cadencés,
- ils pirouettent,
- ils élèvent les bras et quand leurs doigts ne sont pas encore assez habiles pour sonner des castagnettes, la mère qui n'a plus de jambes pour danser sait encore agiter ses mains pour compléter l'accord et marquer la mesure. Les danseurs s'embrouillent quelquefois, mais ils ne se trompent pas dans leurs regards, ni dans le jeu de leur gracieuse physionomie.
Les Espagnols ne dansent pas tous les jours, mais tous les jours après le repas du soir, l'hiver, autour de leur foyer, l'été, sur le pas de leur porte, ils aiment à s'entretenir en famille, à se distraire par un peu de musique. Il suffit d'une jeune fille dans une maison pour attirer de nombreux troubadours. L'empressement de ces derniers ne hâte pas pour cela les mariages ; on sait pendant des années tenir les plus empressés en suspens, et les choses ne se déterminent qu'après un long concours.
Le mariage est un triomphe, on ne peut manquer de le célébrer avec éclat.
La cérémonie toute religieuse du baptême n'entraîne pas chez les Espagnols à des fêtes moins animées : les parrains et les marraines y jouent le rôle important ; pour tous, ce sont de grandes occasions de réjouissances.
Les enterrements eux-mêmes sont souvent pour les Espagnols des jours de fêtes. Ils ne mettent pas moins d'empressement à rendre aux morts les derniers devoirs qu'à venir saluer les nouveau-nés.
L'usage est d'exposer le défunt sur son lit, après l'avoir revêtu de ses plus beaux habits ; tous les parents et amis sont invité à venir veiller la nuit auprès de lui. Les regrets s'expriment en rentrant par de vives démonstrations : on se console, si c'est une jeune fille, en s'extasiant sur la beauté de sa dernière toilette qui ne le cède en rien à celle d'une mariée ; quoi qu'il en soit, la conversation ne tarde pas à quitter tout caractère lugubre. Bientôt l'on passe des rafraîchissements, les cigarettes s'allument ; on parle de ses affaires ; on ne songe qu'au bonheur de passer encore ensemble quelques instants d'une vie fugitive.
Aussi ces veillées auprès des morts ne sont point du tout considérées comme de fatigantes corvées, et les plus jeunes y accourent souvent avec le même empressement qu'à une réunion joyeuse. Il est vrai que dans certaines circonstances ce n'est pas autre chose.
Quand un enfant meurt, c'est un ange de plus qui est monté au ciel ; il faut donc s'en réjouir malgré le chagrin de la mère ; et alors les chants, la musique et les danses ne discontinuent pas de toute la nuit. Ces usages choquent un peu nos mœurs. Ils les choqueraient beaucoup moins si nous avions conservé une foi aussi vive que les Espagnols. La mort, surtout lorsqu'elle s'attaque à d'innocentes créatures, ne peut inspirer aux chrétiens ni l'horreur, ni les regrets dont elle accable ceux qui ne comprennent que la vie matérielle. L'Église elle-même ne revêt pas ses ornements de deuil pour l'enterrement des vierges et des enfants.
On trouve naturel qu'un homme riche consacre sa vie au monde dans la joie et les plaisirs ; mais l'on n'admet pas qu'un pauvre ouvrier puisse à cet égard emprunter à la vie sociale des classes supérieures ; on lui fait un crime du moindre dérangement dans ses rudes travaux.
- N'est-ce point cependant un affligeant spectacle que cette vie d'isolement à laquelle sont réduits la plupart de nos ouvriers ?
- N'est-ce point-là ce qui enracine le plus la misère et dévore souvent en pure perte toutes les ressources des bureaux de bienfaisance et des hôpitaux ? il ne faut pas croire qu'un ouvrier qui passe ses dimanches et fêtes à visiter ses parents et amis, qui se dérange pour une fête de famille ou pour aller veiller les malades ou les morts, perde complètement un temps précieux.
Ces devoirs sociaux que s'imposent gratuitement les pauvres ouvriers espagnols, comme chez nous les gens qui vivent dans l'aisance, resserrent leurs liens, multiplient leurs relations, et partout où ils se trouvent, hors de leur patrie comme dans leur village, ils ne sont jamais embarrassés de trouver du travail ; ils se prêtent mutuellement tout ce qu'ils ont, s'entraident, se donnent la main, comme ils le disent ; il n'est même pas rare de voir une famille pauvre héberger de nouveaux arrivants des semaines entières, jusqu'à ce que toutes les provisions soient épuisées. Aussi la colonisation des Espagnols n'a-t-elle rien coûté à l'État.
La colonisation de l'Algérie par Louis De Baudicour 1856
|
|
| Les Italiens
Envoyé par M. Christian Graille
|
Les Italiens qui ont si longtemps entretenu des relations commerciales avec les côtes barbaresques, ont moins contribué que les Espagnols à peupler l'Algérie.
Du reste, il ne faut pas se le dissimuler, les Romains, leurs pères, dont nous voyons encore partout les traces sur le territoire africain, fournissaient très peu de colons au monde.
Leurs colonies ne se formaient pas, comme les colonies modernes, par des migrations de paysans agriculteurs. Les Romains comme les Turcs étaient des conquérants mais ils savaient mieux tirer parti de leurs conquêtes.
- Ils ne se bornaient pas à gouverner les vaincus,
- ils leur donnaient des institutions,
- ils leur communiquaient leur génie,
- ils exécutaient de grands travaux d'utilité publique, qui faisaient de la colonie une image vivante de la métropole. C'était une exploitation intelligente, car il n'y a de ville nulle part qu'avec la liberté. Cette nation corrompue a perdu avec l'empire du monde son aptitude au gouvernement politique : il ne lui est resté, en dehors de l'Église, où elle s'est régénérée et où elle règne encore, que le goût des arts, pâle reflet du génie de ses pères. En cela encore les Italiens de nos jours se sont laissé devancer ; mais ils n'en ont pas moins conservé d'habiles ouvriers pour le plus utile des arts, celui des constructions.
Les Italiens ont encore de bons architectes et de bons maçons. On trouve chez eux :
- des marbriers, - des briquetiers, - des plâtriers, - des chaufourniers (ouvrier ayant la responsabilité de la bonne marche d'un four à chaux), - des fumistes.
A peine de nouvelles constructions se sont-elles élevées à Alger, qu'aussitôt on a vu accourir une foule d'ouvriers italiens. Ils se sont fait entrepreneurs de la plupart de nos premiers travaux.
- Ils faisaient ouvrir des carrières,
- élevaient des fours à chaux,
- fabriquaient des briques.
Ils tiraient des ports d'Italie :
- le marbre,
- les carreaux de faïence,
- la pouzzolane (roche volcanique recherchée en construction pour ses qualités d'isolation thermique et phonique. ) et s'approvisionnaient à Trieste de planches et de tous les bois nécessaires aux constructions. La colonie n'a pas eu toujours à se féliciter de ces entreprises exécutées avec peu de bonne foi.
Mais ceux qui ont su prendre leurs précautions n'ont pas moins trouvé parmi les Italiens d'utiles auxiliaires et des ouvriers beaucoup plus expérimentés que ceux que fournissait dans les premiers temps la France.
On pouvait davantage compter sur eux :
- ils étaient plus rangés,
- moins dissipateurs,
- moins buveurs,
- ils supportaient mieux les chaleurs du jour,
- travaillaient avec moins de mollesse,
- allaient moins souvent à l'hôpital.
- Les manœuvres indigènes qu'ils employaient étaient mieux conduits,
- traités moins brusquement et avec moins de colère,
- ils ne s'embrouillaient pas dans leur service et ne se faisaient pas attendre. A part quelques jardiniers, les Italiens se sont très peu fixés au sol.
Ils ont concentré dans les villes leurs principaux établissements ; ils y ont ouvert :
- des maisons garnies,
- des salles de restaurateurs,
- des débits de liqueur,
- des fabriques de pâtes etc.
Ils ne se sont guère répandus au dehors que pour aller installer des guinguettes dans les faubourgs, ou pour ouvrir des cantines sur les routes. Plusieurs y ont élevé de petites baraques et même des maisons. Elles ont servi d'abri aux voyageurs ; mais l'agriculture en a très peu profité ; il est rare de trouver le moindre champ cultivé autour de ces pauvres auberges.
Les garçons italiens acceptaient plus volontiers que les Espagnols tous les emplois de domesticité ; leur fierté était moins grande, leur caractère plus souple ; ils s'accommodent mieux de tous les régimes et portent avec plus de goût la livrée de leur maître.
La tenue extérieure d'un Italien est rarement rustique ; il sait vivre de peu et il emploie à se bien vêtir toutes ses économies. Il ne s'abaisse devant les uns comme un mendiant que pour se redresser devant les autres comme un seigneur. Le métier de charretier est trop grossier pour les Italiens ; celui de cocher est plus conforme à leur allure. Sur toutes les places et à toutes les portes d'Alger, ils offrent leurs voitures aux passants. Traînés par la belle Italie ou tout autre corricolo (espèce d'omnibus à volonté), les amateurs de promenades peuvent visiter le Frais-Vallon ou s'enfoncer dans la vallée de la femme sauvage, ou bien aller se rafraîchir dans des retraites moins solitaires, au Belvédère, au Château-Vert. Pour toutes les excursions nautiques, le port d'Alger est rempli de bateliers italiens : ils alternent tous les jours avec les bateliers indigènes, non moins jaloux dans leur service, mais beaucoup moins fatigants pour leur payement.
La colonisation en Algérie par Louis De Baudicour 1856
|
|
| Les Maltais
Envoyé par M. Christian Graille
|
La population maltaise, trop à l'étroit dans son île, a fourni pendant un temps à l'Algérie plus de colons que l'Italie toute entière. Les Maltais parlent un dialecte qui se rapproche beaucoup de la langue arabe ; il n'a de différence avec cette dernière langue qu'en matière de foi.
Presque tous les mots maltais qui expriment une idée religieuse sont empruntés à l'italien : un sermon maltais ressemble beaucoup à une prédication italienne. Latins à l'église les Maltais redeviennent Arabes dans leurs relations mondaines. A part le Coran, ils s'entendent parfaitement avec eux. Si ces derniers, dans leur vie pastorale, nous rappellent un peu les patriarches de l'Ancien Testament, les Maltais offrent un type non moins remarquable du Nouveau Testament. On les prendrait volontiers pour ces pécheurs de Galilée, parmi lesquels Jésus-Christ choisit Saint Pierre et ses autres apôtres. Ils ont encore avec la foi, la simplicité et la bonhomie des temps anciens, que l'on retrouve avec la même langue et le costume oriental dans la chrétienté du Liban.
Aux avant-postes de l'Occident, les Maltais ont adopté nos habits comme nos rites. Les petites pièces de monnaie dont les Arabes font des colliers pour orner leurs femmes, ils en font des boutons pour garnir les gilets dont ils se parent les jours de fêtes.
Quant aux femmes simplement vêtues comme leurs maris pendant la semaine, elles rivalisent le dimanche avec les femmes espagnoles. Elles tâchent de racheter, par la valeur du vêtement, ce que la nature semble, en général, leur refuser en grâces et en distinction.
Du reste les Maltais font bande à part, et se mêlent très peu aux autres colons.
Les plus pauvres ne cherchent point à se placer comme domestiques, ni même aller en journée pour le compte d'autrui.
Les filles n'ont pas à s'inquiéter des troubadours ; à peine en âge de se marier, elles sont demandées par leurs compatriotes. Le mariage n'est pas attendu longtemps mais dès qu'il est résolu la fiancée, gardée à vue, ne peut plus sortir de la maison ; les jalouses exigences du prétendant ne sont comparables qu'à celles des Arabes.
Les Maltais sont les étrangers pour lesquels la plupart des fonctionnaires et des colons français éprouvent le moins de sympathie. On leur trouve de la superstition et des allures grossières ; on prétend qu'ils ne sont point à la hauteur de la civilisation. Néanmoins ils ont des mœurs irréprochables, ils font même à cet égard un assez grand contraste avec les autres Européens.
On les voit rarement commettre des excès et chercher même des divertissements : il faut une noce ou quelques circonstances extraordinaires pour leur faire un instant oublier le travail. Les jours de fête ils trouvent toujours le temps d'aller à la messe, et on les voit souvent affluer à la Sainte Table avec une piété digne des premiers chrétiens.
Dans leurs maisons, dans leurs étables, dans leurs boutiques, ils ont des images de Madone avec des lampes nuit et jour allumées.
Ils ont d'ordinaire cinq à six enfants et quelquefois bien davantage.
Tous les soirs avant de prendre son repas la famille recueillie s'agenouille devant les images vénérées ; chacun fait le signe de la croix après avoir pris de l'eau bénite ; le père commence la prière, la mère et les enfants répondent aux saints versets ; les Litanies et le Chapelet se murmurent sur toutes les lèvres et le sommeil ne commence qu'après les actions de grâce rendues au Tout Puissant.
Si parfois un ministre des autels vient visiter ces humbles chrétiens de la colonie, ils s'empressent d'orner et d'illuminer leurs petits oratoires intérieurs et demandent au prêtre de bénir, non seulement leurs demeures mais aussi leurs troupeaux.
Les Maltais sont très sobres, très économes, il ne leur faut pas plus pour vivre qu'aux Arabes eux-mêmes ; ils ne restent point oisifs, tous sont dans l'aisance, et même quelques-uns finissent par amasser de petites fortunes. Le commerce a pour eux beaucoup d'attrait. Ils commencent en arrivant par vendre, dans les rues d'Alger du sucre d'orge ou de la guimauve, ou bien ils vont au port chercher la marée et débitent du poisson dans les faubourgs, dans les villages environnants jusqu'à dix lieues à la ronde.
Quand ils ont ainsi amassé quelques écus, ils se font marchands de fruits et montent dans quelque carrefour un bel étalage d'oranges, de figues, de dattes, de raisins secs, etc.
Devenus un peu plus riches, ils s'installent dans une boutique. Ils ouvrent :
- des cafés,
- des débits de vin et de comestibles qui rivalisent avec tous les autres établissements de ce genre.
A moitié prix des Français, ils font déborder les tasses, ils remplissent davantage les verres, ils donnent pour 3 sous des portions abondantes et s'abonnent même aux journaux de la localité. Aussi voit-on affluer chez eux les ouvriers de toutes les nations qui ont des goûts simples et veulent vivre à bon marché.
Mais l'industrie la plus commune en Algérie parmi les Maltais est l'exploitation des troupeaux de chèvres : ils en ont amené de très belles de leur pays, qui ne valent pas moins de 50 frs pièce. Campé autour des villes, ils s'en partagent tous les quartiers pour aller dès le matin vendre du lait aux habitants.
Ce genre de profession était, dans les premiers temps, très lucratif pour eux, mais il ne tarda pas à soulever des plaintes aussitôt que les champs abandonnés furent remis en culture, et l'on conçoit que de ravages peuvent faire des troupeaux de dix à quarante chèvres circulant de tous les côtés.
Les administrations municipales se sont donc efforcées d'empêcher la trop grande concurrence du métier, en faisant payer patente aux chevriers et en imposant leurs bêtes. Aussi le lait de vache fourni par les colons commence-t-il déjà à compromettre l'industrie primitive des Maltais. Dans ce dernier temps, la plupart des chevriers, pour se tirer d'affaire, ont été obligés de s'adonner à l'engrais des cochons, dont la nourriture n'est pas souvent plus coûteuse que celle des chèvres, pour peu que l'éleveur soit industrieux.
L'éducation de ce genre de bétail est d'autant plus avantageuse pour les Européens que les Arabes ne leur font point concurrence. Ces derniers considèrent les cochons comme des animaux immondes, et croiraient se souiller en les approchant. Les Maltais ont quelquefois une quinzaine de porcs à l'engrais. Au bout de quelques mois ils les vendent au prix de 1 franc le kilo ; ils peuvent bientôt amasser ainsi plusieurs milliers de francs. Ils se lancent alors dans de plus grandes opérations. Beaucoup d'entre eux :
- se font bouchers,
- achètent des troupeaux de bœufs,
- louent de gras pâturages,
- spéculent encore sur les engrais,
- louent aussi et quelquefois achètent des propriétés rurales en valeur dont ils savent parfaitement tirer parti.
Ils y sèment des pommes de terre, des melons, des pastèques ou autres légumes qu'ils font vendre dans les villes par leurs compatriotes.
Pour attirer les bénédictions du ciel sur leurs récoltes, ils ont soin de faire la part du bon Dieu et des pauvres : le produit entier de tel ou tel champ est par avance consacré à des œuvres pieuses.
D'autres Maltais consacrent leurs économies à construire des moulins. Ils se livrent avec assez de succès au commerce des grains : pouvant parler la langue arabe, ils ont à cet égard de grandes facilités que n'ont pas les autres colons. Beaucoup de négociants les emploient maintenant pour les marchés qu'ils ont à faire avec les indigènes. Ils fourniraient au gouvernement d'aussi bons interprètes que les Juifs auprès de ces derniers et la France ne pourrait que gagner au change.
Quoique sujets britanniques, les Maltais semblent préférer la France à l'Angleterre et il y aurait peu à faire pour les attacher davantage à notre colonie. Ils sont assez répandus dans la province de Constantine, ils y ont acheté bon nombre de propriétés, ils possèdent déjà une partie de la ville de Bône. Faisons des vœux pour qu'ils s'établissent également d'une manière stable dans les autres provinces.
La seule protection que réclament les Maltais est celle de leur foi, et ils ont à cet égard à Malte des ressources qui leur manquent en Algérie.
Les curés de la colonie entretenus par le gouvernement savent rarement leur langue et, sans le zèle de quelques bons religieux qui parcourent le pays en missionnaires, bien des pauvres Maltais se trouveraient un peu abandonnés.
La colonisation de l'Algérie par Louis De Baudicour 1856
|
|
| Les Allemands
Envoyé par M. Christian Graille
|
La plupart des colons qui venaient s'établir en Algérie sont originaires des pays qui bordent le bassin occidental de la Méditerranée. Les Provençaux formant une grande partie du contingent fourni par la France, presque tous les étrangers sont des Espagnols, des Italiens ou des Maltais.
Quoique la nation allemande soit plus que toutes les autres portée vers l'émigration, l'Algérie ne possède encore qu'un très petit nombre de colons allemands, la plupart suisses.
Les Allemands du Nord jusqu'à présent, ne se sont guère écartés du courant qui chaque année les entraîne dans le Nouveau Monde. Le climat de l'Algérie n'est pas, assurément, le principal obstacle qui détourne d'elle les populations septentrionales ; notre colonie leur offre des régions tempérées bien préférables à celles qui les attendent en Amérique. Néanmoins, on ne peut en disconvenir, les colons du Midi arrivent en Algérie dans des conditions beaucoup plus favorables pour s'acclimater. Ils ont peu à changer de manière de vivre, et déjà ils sont façonnés aux précautions hygiéniques qu'il faut prendre dans les pays chauds.
Les méridionaux ont une constitution sèche, une peau peu perméable aux grandes transpirations ; ils réagissent bien contre le froid et recherchent instinctivement le soleil.
Ils sont légèrement vêtus, s'entourent le ventre d'une ceinture roulée par-dessus leurs vêtements, et, en été comme en hiver, ils ont :
- une veste,
- un manteau
- une pièce d'étoffe qu'alternativement ils endossent sur leurs épaules selon les vicissitudes de la température.
Leur alimentation légèrement excitante, se compose surtout :
- de légumes, - de poissons, - de fruits, - d'ail, - de poivrons, - de fromages.
On ne les voit point fréquenter les cabarets.
Un grand nombre exerce des professions industrielles ou se livrent au commerce ; ceux qui se consacrent à l'agriculture, ne font que des cultures industrielles : la plupart sont des jardiniers ; ils habitent ordinairement dans les villes ou les environs. Leur genre de travail est donc, en général, peu pénible, et les territoires où ils se fixent sont ceux qui offrent le plus de ressources, où il est le plus facile de se loger convenablement.
L'Allemand a une constitution plus forte, un tempérament plus sanguin.
Sa peau, fine et celluleuse, est sensible au froid comme à la chaleur ; il recherche avidement la fraîcheur ; il porte des vêtements épais qui condensent sur son corps des transpirations abondantes.
Laboureur, faucheur, bûcheron, les professions qu'il est dans l'habitude d'exercer réclament toute sa vigueur et l'entraînent plus ou moins loin des villes, dans les campagnes, souvent même dans les contrées désertes.
Ce sont des concessions de terres qu'il réclame en arrivant : s'il ne parvient pas à en obtenir, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller en exploiter au loin pour le compte d'autrui ; à moins que, n'ayant point de famille, il se place quelque part comme garçon de ferme ou comme charretier.
L'affaiblissement qu'il en éprouve au bout d'un certain temps, il le combat comme il le faisait dans son pays, avec de l'eau-de-vie, par des aliments substantiels, de la viande et du lard.
Obligé d'aller habiter de misérables baraques dans la plaine, il lui est bien difficile de lutter contre toutes les variations de la température, et, avant même que les maladies n'aient sévi, ne l'ait étendu sur son matelas, il s'ennuie de se trouver dans un pays si différent du sien, un pays sans arbre et sans verdure.
Le ton grisâtre des oliviers lui déplait, les cyprès l'attristent, il n'a rien de plus empressé que de mettre la hache sur les figuiers de Barbarie, dont les fruits lui semblent insipides et dont les épines l'inquiètent. Ces plantes dont les Arabes entourent leurs gourbis avec tant de soin, il les trouve, lui, d'une laideur affreuse, et il n'a rien de plus hideux à leur comparer que des péchés mortels.
L'horreur du péché mortel n'arrête point cependant, en Afrique, beaucoup de ces vigoureux athlètes du Nord. Le climat qui finit par les énerver, commence, en général, par beaucoup les démoraliser. Leurs filles elles-mêmes, avec leurs allures lentes, leurs yeux langoureux et peu de disposition à la guerre, n'en sont que plus faciles à prendre et plus accessibles aux séductions.
Les cabarets et les bastringues de tous les nouveaux villages de l'Algérie se garnissent particulièrement d'Allemands et d'Allemandes, et les désordres qu'ils entraînent ont pour les mœurs des inconvénients beaucoup plus graves que les habitudes coquettes, que les goûts poétiques de toutes les populations méridionales.
La colonisation de l'Algérie par Louis De Baudicour 1856
|
|
QUAND NICOLAS HULULE !
Envoyé par M. Hugues
|
"Je prolonge mes vacances et ne reviendrai pas.
Je monte m'allonger dans ma "couche" d'ozone.
Je boucherai les trous, un par un, pas à pas.
Adieu, mes amis Verts. Non, pas de carton jaune !"
"Pris de court, mes deux boss, Edouard et Emmanuel,
Ignorant, chaque semaine, mes récriminations
Au Conseil des Ministres. J'ai brisé le rituel
Du Président puissant, riche de son inaction !"
"Qui me remplacera à ce poste à haut risque,
S'il l'accepte, devra soumettre ses conditions.
Qu'il demeure Gaulois, aussi fort qu'Astérix,
Défenseur de nos us et de nos convictions !"
"Halte aux effets de serre, que je puisse respirer
Au-dessus de vos têtes. Que les nuées disparaissent
Pour observer la Corse qui m'a tant inspiré,
Pour choyer Ushuaïa, la source de mes richesses !"
Hugues JOLIVET
30 août 2018
|
|
BÔNE
Ecrit par Mme Lucette Travers
|
|
LA FORMATION DE LA VILLE
ET LES FACTEURS DE SON ÉVOLUTION
Sur la rive occidentale d'un golfe largement ouvert au Nord-Est, Bône, quatrième ville, deuxième port d'Algérie, n'est pas une création de la colonisation. On s'accorde pour placer au XIème siècle sa fondation, mais la vocation urbaine s'était affirmée dès l'antiquité, et Bouna el Haditsa succédait à Hippone, elle-même héritière d'un passé phénicien et sans doute égéo-crétois.
Contrastant avec les rives orientale et méridionale exposées aux vents (dunes) et aux courants (dérive méditerranéenne et contre-courant), la côte occidentale haute et découpée offre seule, en effet, sur ce littoral inhospitalier, quelques bons abris. Protégée des vents dominants du NW par les monts Édough et des tempêtes du N par le cap de Garde, elle enregistre moins souvent et plus faiblement qu'aucun autre point du littoral algérien les tempêtes du NE. Les conditions nautiques auraient déterminé une sélection en faveur de l'anse profonde du Fort Génois (Construit au XVème siècle par les Génois pour protéger leurs corailleurs qui échouaient leurs barques sur la plage voisine. Les assureurs marseillais refusèrent jusqu'en 1798 de reconnaître d'autre mouillage du 15 septembre au 15 mai.) ou de celle, moins sûre, du Cassarin.
Mais ces sites sont isolés de l'arrière-pays par les collines qui marquent la fin des monts Edough, et les anciens leur préférèrent l'embouchure de la Seybouse. La vallée est une excellente voie de pénétration méridienne (Au XVIIIème siècle, les bâtiments des concessions françaises l'auraient remontée pour embarquer des grains. Voir Elie de la Primaudais, Voyages.) qui permet à l'agglomération côtière de drainer, outre les produits de la basse et moyenne Seybouse, et du Bassin de Guelma, ceux des Hautes Plaines d'Aïn-Beïda, quelquefois même de Constantine, enfin les produits miniers du Kouif, de l'Ouenza et du Boukadra, des ovins, de l'alfa de la région de Tébessa.
La concentration dans cette vallée de la route et de la voie ferrée (1878) la confirmait dans son rôle de voie de passage et lui ajoutait, jusqu'en 1952, un intérêt général en assurant la liaison de Bône à la grande voie Tunis, Alger, Casablanca. La voie large Bône - Saint-Charles (16 décembre 1952) - aménagée, comme la route littorale d'Alger à la frontière tunisienne, sur le bord septentrional de la dépression subcôtière du Fetzara - , en détournant par l'artère Philippeville-Constantine la jonction au réseau principal, a presque totalement privé la vallée de cet intérêt général, déjà fortement diminué depuis l'établissement d'un service régulier de transports automobiles vers la Tunisie par la route Bône - La Calle. Mais cette modification, dans le sens E-W, des principales relations ferroviaires primitivement méridiennes n'a pas enlevé à Bône son rôle de tête de ligne. Nouvelle plaque tournante pour les télécommunications entre l'Algérie et la France (août 1956), Bône possède depuis 1939 un aérodrome (Les Salines). Trois compagnies (Air France, Air Algérie, Tunis Air) assurent les relations avec la France et l'Afrique du Nord.
Les courants commerciaux qui ont emprunté la vallée de la Seybouse ont toujours influencé l'activité du débouché maritime. Hippone d'abord, Bône ensuite furent un centre commercial des céréales dans l'antiquité et jusqu'au XVIIIème siècle, celui des peaux, des laines et des cuirs du XVIème au début du XIXème, des bovins aux XVIIIème et XIXème, enfin, au XXème, des minerais et des lièges, des vins et du tabac. Les productions de la plaine de niveau de base (100 000 ha) qui s'étend en arc de cercle sur 120 km sont intervenues irrégulièrement dans cette exportation. Une pluviosité supérieure à celle des autres plaines telliennes, encore augmentée sur les montagnes du pourtour, la présence des argiles du Numidien recouvertes d'alluvions, l'indécision fréquente de l'écoulement vers la mer (plaine subcôtière du Fetzara à l'W, dunes à l'E) en faisaient une région marécageuse, très malsaine, peu peuplée ; mais, en même temps, l'existence de prairies naturelles jusqu'au milieu de l'été autorisait un élevage important auquel s'ajoutaient des récoltes aléatoires, mais souvent appréciables, de céréales, tandis que la petite plaine de Bône (On appelle petite plaine de Bône la partie de la plaine comprise entre la ville à l'E, l'Edough et le Djebel Bou Kanta à l'W et au SW, le Bou Hamra au S.) assurait l'approvisionnement de la ville en fruits et en légumes.
Récemment, dans la mesure où elle a été assainie, sa population comme son influence dans l'économie bônoise ont augmenté. Depuis un demi-siècle elle est une région de polyculture où toutes les cultures Nord-africaines sont représentées et occupent en valeur, sinon en poids, la première place dans les exportations.
Bône avait effacé Hippone parce que son site, favorisé par des modifications géographiques locales (déplacement de la Seybouse vers l'W) et les transformations de la navigation, avait prévalu en fonction de conditions historiques et économiques nouvelles. En effet Bouna el Haditsa, Hippone-la Neuve, n'était pas comme Hippone un comptoir, mais un repaire de pirates distant de l'agglomération commerçante Medinat-Seybouse, qui s'étendait au pied de la colline d'Hippone, site d'une troisième cité où demeurait attaché le souvenir de saint Augustin. Ainsi à la fin du Xème siècle, il semblerait, d'après El Bekri, qu'il y eut trois centres, et Bouna El Haditsa, aussi appelée Bled el Haneb (Ville des jujubes) ou El Anebah, devint prééminente après l'invasion hilalienne grâce à son excellente position de défense tant contre les chrétiens qui venaient de la mer que contre les nomades de l'intérieur ; or, quel meilleur site pouvait s'offrir que cette butte dissymétrique rattachée au N à une zone de collines presque inhabitée ? Elle se termine brusquement à l'E par une falaise continue, abrupte sur la mer, tandis qu'elle s'achève en pente douce vers le S, sur la petite plage d'échouage gardée par le fort Cigogne, et à l'W sur une région marécageuse, ancienne zone de comblement lagunaire. En 1058, un rempart allait encore en accroître la sécurité, et en 1300 était construite sur la colline voisine la Casbah qui surveillait la ville.
Au milieu du XXème siècle, la France a opté pour ce même site ; l'augmentation du tirant d'eau des navires empêchait de prendre au sérieux les projets qui, jusqu'en 1842, voulaient faire renaître le port d'estuaire et entraîner ainsi la ville vers Hippone. Les projets d'aménagement (1844-1850) de l'anse du Cassarin se heurtèrent tous au problème des relations avec l'intérieur et avec la ville perchée. Ces mêmes difficultés furent évitées dans le projet de 1855, qui prévoyait l'aménagement du port dans la rade Cigogne ; la vieille cité gardait en outre le bénéfice de l'activité portuaire. Le site des Cassarins, simple rade abritée jusqu'au début du XXème siècle, est actuellement le lieu de concentration de presque toutes les manipulations : un trafic supérieur et diversifié a exigé une extension des quais, et les moyens techniques et financiers ont permis de résoudre le problème des relations par arasement de la pointe Cigogne et par creusement d'une tranchée de 27 m entre la colline de la Casbah et celle delà ville. Le port possède ainsi deux grandes voies de relation avec l'intérieur, l'une au Nord, l'autre au Sud du cours Bertagna, celle-ci assurant la presque totalité du trafic.
I. - L'aménagement de la ville
II n'y a pas eu création d'une nouvelle ville, mais implantation de population et d'activités nouvelles à l'intérieur de l'ancienne, et extension progressive par larges auréoles demi-circulaires à l'W d'abord (nouvelle ville, faubourg), au N et au S ensuite (fig. I, p.).
C'est dès le premier aménagement de 1833-1840 que la ville prend sa physionomie actuelle. Les principales rues, sauf une (rue Neuve-Saint-Augustin), furent ouvertes par l'autorité militaire dans un but stratégique pour faciliter la circulation entre la Casbah, les centres militaires et la porte de Constantine ou du Marché, où aboutissaient les routes de la plaine. Les rues rayonnaient autour de la place d'Armes rectifiée, vrai centre de la vie sociale et d'une activité commerciale qui se prolongeait vers la porte de la mer, dite du Commerce, par la rue Fréart et vers celle du Marché par la rue de Constantine. Celle-ci, principale voie stratégique, était aussi l'axe de la vie économique, les petites rues voisines lui devenant annexes. Ultérieurement (projet de 1855) il n'y eut que des rectifications de détail pour aérer la ville, hormis la rue Neuve-Saint-Augustin ouverte pour assurer la liaison entre vieux et nouveaux quartiers et la rue du 4 Septembre construite après 1874 sur l'emplacement des remparts.
Alors qu'Alger et Oran débordaient rapidement leur site primitif, la deuxième enceinte venue à l'W flanquer la première (1855) n'enfermait en 1861 que 32 maisons (768 personnes) groupées à la limite non aedificandi du vieux rempart, le long des axes commerciaux : rue Bugeaud, Lemercier (du caravansérail au marché et au port) ou Gambetta (portion urbaine de l'ancien chemin des Karézas).
De même que les relations avec l'arrière-pays avaient déterminé la localisation de la nouvelle ville, de même les voies de communication préexistantes, et non le site (1), ont imposé au plan certaines contraintes.
-1. La formation des marécages de la petite plaine de Bône, d'origine lagunaire (alluvions argilo-sableuses, peu ou point de pente), a été favorisée par la proximité de reliefs très arrosés, la convergence de leurs pentes vers l'usine à gaz et le caractère torrentiel des pluies ; l'assainissement, réellement obtenu depuis 1941, fut assuré par : 1° le remblaiement et le drainage des points bas vers un canal central tracé dans la partie la plus basse (actuel boulevard Clemenceau) ;
- 2° une protection contre les eaux marines : reconstruction de l'ancienne digue (1839) actuelle avenue de la Marne, - contre les eaux d'inondation des oueds par l'aménagement de ces oueds et endiguement (l'oued Deb, dérivé à partir du Djebel Bou Kanta dans un canal de 900 m, aboutissait en aval du pont d'Hippone), - contre les eaux des parties moyennes et basses recueillies hors du périmètre à protéger par un canal de ceinture, continu depuis 1941.
La discontinuité de l'endiguement entre le Zaffrania et le Pont Blanc, jusqu'en 1941 où la digue fut terminée, explique les nombreuses inondations du faubourg Randon (en 1907, 1 m près de l'usine à gaz). La dérivation de la Seybouse dans la Boudjimah, indépendante de l'assainissement, n'a été réalisée, en 1875, que pour empêcher l'envasement de la petite darse.
Les portes ouvertes au croisement de l'enceinte avec la route de l'Édough (Route ouverte en 1841 par le maréchal Randon pour permettre la pénétration du massif de l'Edough.) (porte Randon), avec le chemin de la plaine dit des Karézas, avec la route vers Guelma et Constantine (porte d'Hippone), ont entraîné une convergence des rues (La convergence de la porte Randon était antérieure au plan et correspondait au gué, puis au pont qui permettait de franchir l'Oued Zaffrania.), surtout manifestée à la porte des Karézas (place Maria-Favre) où aboutissaient deux voies commerciales (Lemercier et Gambetta) et une voie stratégique, rue Bouscarein, menant de la porte aux campements militaires. Cette convergence explique l'absence d'îlots rectangulaires analogues à ceux qui ont été tracés à l'Est de la rue Bugeaud (préexistante au plan), où les rues sont parallèles et perpendiculaires à l'esplanade de 60 m (zone non aedificandi) qui bordait le vieux rempart conservé. Cette esplanade, cours Bertagna d'aujourd'hui, est devenue l'artère de liaison entre vieux et nouveaux quartiers.
La construction de la ville suivant ce système préconçu est postérieure à 1871 et s'affirme surtout entre 1881 et 1891. Au début du XXème siècle, Bône est caractérisée, de part et d'autre de cette artère centrale, véritable axe de cristallisation de toutes les activités administratives et financières, par la juxtaposition de deux agglomérations qu'opposent leur plan et leurs formes architecturales, mais dont le contenu n'a pas encore de différenciation bien nette.
Une large zone récemment assainie, mais totalement inhabitée, séparait la ville d'une agglomération née de la prolifération de deux centres ruraux : le hameau de Sainte-Anne entre l'Oued Zaffrania et la route de ceinture de la petite plaine (boulevard Mermoz) et celui dit de la Colonne Randon (Doit son nom à la colonne commémorant l'ouverture de la route de l'Edough par le maréchal Randon.), vrai germe d'un nouveau quartier. Celui-ci est né de quelques maisons rurales groupées autour de la Fontaine, dans la pointe du V que formait l'intersection du chemin qui longeait la conduite d'amenée d'eau à la ville (Avenue Célestin-Bourgoin.) avec la route de Bône à l'Édough (Rue Sadi-Carnot.) ; il s'est .étendu par suite de l'importance croissante d'un carrefour où convergent deux nouveaux chemins : vers Sainte-Anne (rue Burdeau) et vers la Sebkha (rue Galdès). Il profite aussi de la proximité d'une porte de la ville (porte Randon) de l'autre côté du pont qui franchit le Zaffrania.
Son extension s'est faite d'abord vers le NW par comblement des espaces vides à l'intérieur du V initial, puis hors du V sur des terrains souvent inondés : vers le NE où s'opère la jonction avec Sainte-Anne, vers l'W le long de la conduite d'eau déjà longée par les maisons de campagne des citadins, et celles des chevriers maltais, vers le S sur la zone mal égouttée de la route des Prés-Salés et de la rue Galdès.
La première période de construction est contemporaine de celle de la nouvelle ville (1881-1891), mais elle se prolonge jusqu'en 1901, parallèlement à l'accélération d'un peuplement constitué surtout d'immigrants pauvres, qu'attirait la modicité des loyers dans ce quartier déjà constitué en centre semi-autonome ; son origine comme sa formation se retrouvent dans un paysage où alternent maisons individuelles à simple rez-de-chaussée et immeubles de rapport à deux ou trois étages ; ceux-ci sont quelquefois érigés aux dépens de l'ancienne cour de ferme, ils sont aussi (rue Sadi-Carnot) construits en façade et donnent accès, par un long couloir sombre, à l'ancienne maison rurale, restée très élémentaire.
L'extension de l'agglomération bônoise considérablement ralentie, sinon arrêtée, de 1901 à 1920 reprend ensuite avec une ampleur jusqu'alors inconnue, surtout entre 1927-1934 et 1948-1953 ; la formation comme le développement des faubourgs sous l'influence de facteurs divers a entraîné la différenciation de leur aspect, de leur contenu humain et économique, et créé trois zones différentes : au N, une banlieue à caractère résidentiel ; à l'W, une banlieue d'habitation et de petit commerce truffée d'îlots d'entassement, les relations avec la ville se faisant par la porte des Karézas ; au S, une zone industrielle.
Cette période d'étalement de la ville hors de ses remparts est caractérisée par l'importance des constructions de maisons individuelles : 86 p. 100 en 1932, 100 p. 100 en 1944, 52 p. 100 en 1949, contre 2 à 5 p. 100 d'immeubles de rapport. Cette forme d'habitat en " villas " explique partiellement l'extension rapide des faubourgs. Bône est ainsi une ville basse (moyenne, deux ou trois étages en ville même, un dans la banlieue), où surprennent d'autant plus les rares immeubles modernes, grands cubes isolés de sept ou huit étages. Ces nouveaux quartiers sont éloignés de la ville. Ils se sont étendus par comblement de l'espace demeuré vide à l'extérieur des boulevards périphériques, et la soudure n'est pas partout complètement réalisée. La raison de cet éloignement primitif est dans la persistance, jusqu'en 1926, d'une zone de servitudes militaires, partiellement occupée seulement en 1954 par des immeubles (location ou location attribution).
Localement, l'éloignement des faubourgs a pu être accru par l'existence d'une zone basse, le long du Zaffrania ; sur le bord extérieur de la Sebkha, à 900 m à l'Ouest de la porte des Karézas, entre le chemin des Lauriers-Roses et le faubourg Randon s'est constitué, après 1929, dans le cadre juridique des H.B.M. (Crédit Immobilier), un quartier au plan rectangulaire. Dans de modestes maisons individuelles entourées de petits jardins à caractère souvent utilitaire vit une population d'employés, de petits fonctionnaires, d'ouvriers européens : c'est l'Orangerie. Sa situation excentrique a entraîné la valorisation des terrains maraîchers ou de pâture compris entre le chemin des Lauriers-Roses et celui des Prés-Salés et leur transformation en lotissements parleurs propriétaires. L'occupation de la zone des Prés-Salés - la plus basse, la plus longtemps inondée - , déjà commencée au début du XXème siècle par quelques industries (usine à gaz, fabrique d'allumettes...), ne s'est achevée qu'après 1925 par l'implantation d'industries nouvelles. A l'Est de l'Orangerie, la construction alternée de maisons basses, individuelles et collectives, la transformation d'anciennes maisons rurales dans un but locatif, leur peuplement rapide par des familles de manœuvres, de petits employés, d'ouvriers français, mais surtout musulmans, expliquent la forte densité ; depuis 1942, et en 1954, un grand nombre de familles musulmanes de 4 à 7 personnes, et même quelquefois 9, s'y sont installées chacune dans une seule pièce.
A 1 km au Sud-Ouest de la même porte, près du carrefour du Marabout de Sidi Brahim, et à la limite même de la zone de servitudes militaires (rue Bélisaire actuelle) s'est amorcée vers 1905 la cité ouvrière. Sur dès terrains en contre-bas de l'Oued Deb, encore en 1902 dépôts d'immondices de la ville, des Musulmans édifient quelques constructions sommaires, bientôt englobées, la spéculation aidant, dans des lotissements (Auzas, Chancel, Deyron) où quelques maisons collectives alternent avec des villas et des constructions mauresques entièrement ceintes de murs blanchis.
L'extension vers le N et le S fut plus tardive. Au N, la salubrité du site n'exerce aucun attrait sur la population parce qu'il est isolé derrière la colline des Santons (pente W de la Casbah), et qu'il n'est desservi par aucune voie de communication commode (chemin du cap de Garde). L'arasement partiel de ce relief ne put résoudre le problème des relations, car l'enceinte fut reconstruite et, jusqu'en 1904, outre quelques exploitations rurales, seul existait le village arabe des Béni Maffeur. (Sur la pente W de la colline des Santons existait un douar que l'administration civile déplaça en 1847 sur la pente W de la colline du Bohatasse. Ce village porte le surnom de Béni Ramassés.)
La création de la banlieue Nord est due après 1906 à l'effort continu de l'homme (M. Baylet, un des doyens de la ville, à qui sont dus de nombreux renseignements.) qui dirigeait le Patrimoine Coopératif Bônois {P.C. ?., 1904). Cette coopérative se proposait, dans le cadre de la Loi Loucheur, de créer une cité-jardin destinée à la petite bourgeoisie. Mais l'opposition militaire à l'ouverture d'une porte, les préférences de la population pour l'W, l'absence de spéculation sur une grande partie de ces terrains (46 ha du P.C.B.) expliquent le retard de son extension. Né en 1906-1908 sur les pentes de la Casbah (Beauséjour), le quartier s'étendit entre 1931 et 1938, et plus encore depuis 1946 en intégrant à la proche banlieue la station balnéaire de Saint-Cloud. Son essor actuel tend à englober Chapuis.
Ce système coopératif a été adopté non seulement par le P.C.B., mais encore par le Crédit Immobilier et la Tabacoop. Ainsi s'explique une agréable banlieue : de coquettes villas bien adaptées au climat (La plupart des maisons possèdent, au rez-de-chaussée ou au premier étage, une terrasse abritée où se déroule une grande partie de la vie. L'entretien des toits en terrasse est très onéreux dans cette région de forte pluviosité. Aussi voit-on prédominer des toits de tuile rouge "d'importation) dans toute agglomération urbaine, sauf dans la partie orientale de la vieille ville, qui a conservé ses terrasses.) s'y étagent à flanc de coteau et forment une zone résidentielle où domine la petite et moyenne bourgeoisie (fonctionnaires, employés, artisans). Sur les terrains libres brusquement valorisés, les capitaux de la plaine ont été investis en maisons luxueuses, ou, après 1945, en immeubles qui contrastent par leur densité comme par leur confort avec ceux où la municipalité recasait les sinistrés de 1942. Ces derniers immeubles semblent devoir être le germe d'un nouveau quartier de construction dense et de peuplement ouvrier au milieu de la cité-jardin bourgeoise.
La liaison avec la banlieue Ouest, amorcée par les lotissements de terrains valorisés par la construction du lycée de garçons (1905), s'est réalisée après 1935 ; le village des Béni Maffeur, doublé d'un bidonville, est maintenant à la périphérie de l'agglomération. Mais ces deux banlieues Ouest et Nord ont une vie différente et restent dos à dos de part et d'autre de la zone verte du cimetière, du stade et de la pépinière.
La partie Sud, gagnée sur les marécages, le lit de la Boudjimah dérivée vers la Seybouse, et la mer (terre-plein Souleyre), est une zone industrielle caractéristique (On y trouve la densité la plus faible (28 hab. à l'ha) et une population où les chefs de famille sont gardiens, concierges, directeurs d'usine, employés des chemins de fer.). Cette fonction quasi exclusive est due à la persistance des servitudes militaires jusqu'en 1926.
Des industries s'étaient établies à la limite de ce périmètre interdit, S.A.P.C.E. (1897), Minoterie d'Hippone (1902), coopératives de transformation (1924-1926) ou, au-delà, SOLIEPNA (industrie du liège, 1923) ; cette zone industrielle prolonge le terre-plein Souleyre, qui, dès sa construction, fut destiné aux minerais (ter de l'Ouenza, phosphates du Kouif, soufre d'Héliopolis, etc.) et aux activités industrielles nées du port (centrales thermiques Bône I et II). Ultérieurement, des organismes stockeurs (dépôts d'hydrocarbures) s'y sont installés. La situation excentrique, la voie ferrée et la proximité du port étaient des facteurs favorables ; très rapidement, après 1926, s'installaient une industrie métallurgique de réparation et. de transformation (Durafour, Bourderon, etc.), des concessionnaires des grandes marques de matériel agricole, de traction, d'automobiles, ou d'outillage industriel. Après 1935, enfin, les grosses industries durent s'installer loin au Sud de la Boudjimah : Société Nord-Africaine d'approvisionnement Ferroviaire (S.N.A.F.), Aluminium J.P.
Derniers apparus à Bône, les bidonvilles sont, situés à la périphérie de l'agglomération, près des trois voies d'accès à la ville : la Choumarelle près de la route Bône - La Galle - Tunis (Nationale 12) ; Clemenceau en contre-bas de la route Bône - Philippeville - Alger (Nationale 12) et celui du Pont-Blanc en contre-bas de la route de l'Edough.
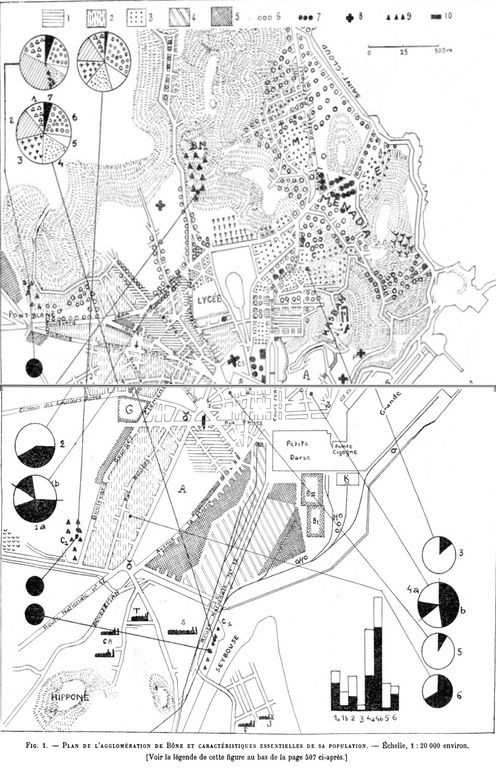 Légende de la figure 1 :
Légende de la figure 1 :
1, Zone d'immeubles de rapport. -
2, Maisons individuelles et maisons de rapport. -
3, Maisons individuelles avec jardin, construites à l'intérieur d'une coopérative, Crédit immobilier (C), E.G. A. (E), Maisoncoop (M). -
4, Emprise de la voie ferrée et CF. A. -
5, Zone industrielle (G, usine à gaz ; Bi.Bii, centrales thermiques Bône I et Bône II). -
6, Maisons individuelles. -
7, Grands immeubles postérieurs à 1945. -
8, Hôpital, préventorium (P), centre de santé (CS).
9, Bidonvilles (BM, Béni Maffeur ; Ci, Choumarelle ; C2, Bidonville Clemenceau). -
10, Bâtiments administratifs et industriels (CA, coopératives agricoles ; F, S.E.F.C.A.R. ; J, Aluminium J.P. ; S, S. A. P.C. E. ; T, Tabacoop). - K, Phosphates du Kouif. - O, Minerais de l'Ouenza. - H, Hydrocarbures. - A, Terrains militaires. -
Dans la Nouvelle Ville, au centre, les chiffres désignent :
1-1, la rue Bouscarein ;
2-2, la rue Gambetta ou de Tébessa ; dans le quartier des Lauriers-Roses ;
3-3, la rue Eugène-François ou des Prés-Salés ;
4-4, la rue Galdès.
Les cercles, en marge du plan, représentent :
- a) dans la moitié inférieure du plan, la proportion des deux groupes de population, européenne (en blanc) et musulmane (en noir) pour chaque quartier :
1, quartier des Lauriers-Roses (a, Sud ; b, Nord) ;
2, Faubourg Randon ;
3, Banlieue Nord ;
4, Vieille Ville (a, occidentale ; b, orientale) ;
5, Nouvelle Ville ;
6, Cités. Le graphique, en bas, indique, pour les mêmes quartiers (rappelés par les numéros des cercles), le rapport des densités des deux éléments de la population. Les cercles noirs se rapportent aux bidonvilles ;
- b) dans la partie supérieure gauche du plan, l'origine de la population des bidonvilles, reliés par une droite au cercle correspondant. Lieu d'origine :
1, Bône ;
2, commune de plein exercice de l'arrondissement ;
3, commune mixte de l'Edough ;
4, commune mixte de La Calle ;
5, département de Bône, à l'exclusion de l'arrondissement ;
6, ancien département de Constantine ;
7, départements d'Alger, d'Oran, Tunisie, Maroc.
Il. - ÉVOLUTION DE LA POPULATION
La courbe d'accroissement de la population de 1850 à 1954 exprime également l'évolution de Bône. Les hésitations des années 1830-1850, les épidémies meurtrières ou des événements politiques déterminent des dents de scie d'autant plus sensibles quo la population était plus faible, et. surtout européenne. Par contre, après 1872, le peuplement croit, irrégulièrement, mais constamment, sauf entre 1906 et 1911.
Évaluée à plus de 40 000 personnes au début du XIXème siècle, la population bônoise n'est que de 18 865 personnes en 1872 et, si elle double entre 1872 et 1901, l'augmentation mensuelle moyenne n'est que de 555 personnes. Or, après 1921, elle croit, de 275 p. 100 en 33 ans (1921-1954) et dépasse 100 000 hab. en 1950. Le groupe musulman, dont les recensements sont incertains, et qui fut minoritaire au XIXème siècle, n'a pas été déterminant dans l'évolution démographique d'une ville qui, jusqu'à la deuxième guerre mondiale, resta, après Alger et Oran, la plus européenne d'Algérie.
L'augmentation de la population est, pour la plus grande part, le résultat d'immigration ; l'excédent de naissances, faible en milieu européen jusqu'au début du XXème siècle, n'est important en milieu musulman que depuis 1944.
1. L'immigration européenne jusqu'à la première guerre mondiale. - La première vague d'immigration importante date de 1872-1881.
Précédemment amorcée par les travaux du port et du chemin de fer minier Bône - Aïn-Mokra, l'immigration s'accélère après 1871 en fonction de l'augmentation des besoins en main-d'œuvre nécessités par la construction des voies ferrées (Bône - Guelma). la reprise de l'activité minière favorisée après 1872 par la demande accrue des usiniers anglais, l'essai renouvelé des hauts-fourneaux de l'Allélick, les nombreux travaux d'édilité urbaine ; les immigrants, des hommes surtout, sont des Français, des Italiens, dont la seule colonie augmente de 63 p. 100 ; les Maltais ; en 1881, les étrangers constituent 55 p. 100 de la population européenne.
Ces immigrés se portent vers la vieille ville, où ils se substituent aux anciens habitants qui l'abandonnent pour la cité moderne ; ils s'accumulent aussi dans le faubourg Randon, dont la population augmente de 138 p. 100.
Ralentie après 1881, l'immigration reprend à la fin du XIXème siècle et au début du XXème ; la deuxième vague accompagne une autre période de prospérité entre-coupée de courtes crises économiques et coïncide avec le début d'un exode rural européen. Après l'achèvement de son réseau ferré (Bône - Guelma, 1878; Duvivier - Souk-Ahras, ouverte le 30 juin 1881 ; Guelma - Kroubs, ouverte le 29 juin 1879 ; Souk-Ahras -Tébessa, le 27 mai 1888).
Bône est devenu un centre important de commerce de gros, dont le rayonnement se fait sentir jusqu'à Tébessa, Biskra, Ouargla, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj. Des capitaux privés s'investissent dans des industries de transformation des produits de l'intérieur (usine de superphosphates, actuellement propriété de la ville elle fut créée par un particulier en 1897, fabrique de crin végétal).
Mais la prospérité est aussi en relation étroite avec celle d'une plaine dont la ruine du vignoble français fait découvrir la vocation viticole. Cette activité nouvelle se prolonge en ville (commerce d'exportation, chais).
L'activité générale s'accroît encore par la reprise de grands travaux dont elle est à la fois cause et conséquence : adduction d'eau, travaux du port, percée des Santons et de la tranchée de la Casbah, voie ferrée Bône - La Calle. A cet appel répond encore une immigration faite surtout d'Italiens ; les nouveaux arrivés se logent dans la vieille ville - où s'accentue la descente vers la nouvelle - et au faubourg Randon où la population est en majorité étrangère. L'apparente stabilité du groupe d'étrangers européens (10 651 en 1891, 10 584 en 1896, 10 837 en 1901) dissimule un double mouvement d'intégration au groupe français et d'immigration, raison même de la stabilité.
L'assimilation, consécutive à la loi de 1889, permet en 1891 aux Français d'être en nombre supérieur aux étrangers qui représentent 43 p. 100 des Européens en 1891 et 38 p. 100 encore en 1911. En même temps la proportion de Français nés en France passait de 38,5 p. 100 du groupe français en 1896 à 22 p. 100 en 1901.
Par contre, la prolétarisation de vignerons endettés et la constitution simultanée de certaines grandes propriétés viticoles formées par regroupement des lots ont déterminé l'arrivée en ville de ruraux. Une tendance à l'émigration s'affirme nettement en 1906-1911 où la ville traverse une grave crise économique, résultat conjugué de la mévente des vins et de la faillite des investissements financiers de la période précédente. Ainsi, si Bône représentait, en 1876, 4,8 p. 100 de la population urbaine algérienne, sa part tombe à 3,7 p. 100 en 1911 et même 3,5 p. 100 en 1921. Or une remarquable accélération du peuplement fait doubler la population entre 1921 et 1936 (41 177, 83 275). De 1926 à 1954, l'augmentation moyenne entre deux recensement" est supérieure à celle des trente années écoulées entre 1876 et 1906.
2. L'immigration depuis la première guerre mondiale. - La ville doit sa physionomie actuelle aux deux vagues d'immigration qui ont suivi chacune des deux guerres mondiales. Ces vagues sont toutes les deux caractérisée" par la diminution progressive de l'immigration étrangère en relation avec les politiques nationales, accentuée encore avec le contrôle de l'O.D.T. (18 p. 100 d'étrangers européens en 1921, 2 p. 100 en 1954). Elles diffèrent encore plus de celles du XIXème siècle par l'importance d'un afflux de Musulmans qui interviennent pour 59 p. 100 dans l'essor de la population entre 1926 et 1936, et pour 94 p. 100 entre 1936 et 1954.
La vague de 1926-1936, contemporaine de la grande crise de croissance de la ville, est la plus importante qu'ait connue Bône. Elle est en relation avec les transformations économiques de la ville et de sa région. Elle est caractérisée à la fois par une reprise de l'immigration française, différente des précédentes parce qu'elle est une immigration de qualité (surtout techniciens et cadres), et plus encore par l'exode de ruraux d'origine française ou musulmane. La population européenne de l'arrondissement, non compris Bône, diminue de 12 p. 100 (1 100) dans le même temps où celle de la ville augmente de 45 p. 100 (13 900) ; l'exode atteint surtout les centres de colonisation officielle où les terrains sont, ou rachetés par des Musulmans, ou annexés aux grandes propriétés européennes. D'autre part, les contrats de haddarat, d'autant plus utilisés que s'étend davantage la culture du tabac, permettent souvent aux propriétaires de vivre en ville. Les immigrants européens se répartissent également dans les différents quartiers de la banlieue Ouest, mais se dirigent aussi (20 p. 100) dans la vieille ville où ils aggravent l'entassement des Musulmans substitués aux Européens dans les vieux immeubles ; la densité y augmente de 47 p. 100 (1 700 hab. à l'ha en 1936). Hors de la vieille ville, les ruraux musulmans se réfugient à la périphérie W, surtout dans les cités (35 p. 100) et au Nord-Ouest du faubourg Randon (18 p. 100) où se créent des zones de peuplement musulman dense.
Cette dernière vague de 1945-1954 est à l'origine des bidonvilles, jusque-là inconnus aux abords de la ville. Elle est considérée comme la plus importante, car la municipalité n'a pu refouler les ruraux hors du périmètre de l'agglomération. L'extension de la surface bâtie dans la banlieue Nord, en relation avec le glissement de la population européenne dans cette direction, a pu faire croire à une augmentation de la population européenne que le dernier recensement ne confirme pas. L'excédent des naissances sur les décès (6 230), auquel s'ajoutent des naturalisations au nombre d'un millier, aurait dû entraîner une augmentation supérieure à celle enregistrée. Ainsi une légère immigration européenne, surtout de jeunes, apparaît d'autant plus certaine que se produisait en même temps une immigration française, de techniciens (travaux du port, de Bône II). L'extension de la ville vers le N est due surtout à un déplacement de la population à l'intérieur de l'agglomération.
Enfin, alors qu'en 1931-1936 l'excédent de naissances n'intervient que pour 4 p. 100 dans l'augmentation des Musulmans, il est ensuite pour moitié dans une augmentation dont l'autre moitié est constituée par l'arrivée de ruraux et surtout de couples jeunes. Cette nouvelle population s'accumule alors au Nord du chemin des Lauriers- Roses (20 p. 100), dans les cités (18 p. 100), aux Béni Maffeur (5 p. 100), mais surtout dans les trois bidonvilles qui représentent 45 p. 100 de l'augmentation totale : Choumarelle, p. 100; Clemenceau (Après 1954, en relation avec les événements politiques, ce bidonville avait triplé sa superficie. Une récente opération de cantonnement (janvier 1957) vient de le déplacer à 4 km au Sud de la ville, à proximité du nouveau chantier de dérivation de la Seybouse. Le déplacement des autres bidonvilles a depuis été réalisé par étapes.), 15,5 p. 100; Pont-Blanc, 13,5 p. 100.
3. Origine de la population musulmane et sa répartition (fig. 1). - Si l'on considère comme valable, pour l'ensemble de la vieille ville, une enquête faite en 1954 sur le quart de sa population, 74 p. 100 des Musulmans sont nés à Bône, 2,8 seulement dans un autre centre de son arrondissement, et, si 21,6 p. 100 viennent des autres arrondissements de l'ancien département de Constantine, la moitié est originaire des villes : Collo, Sétif , Guelma, Biskra, Kenchela, Constantine, Batna. Au total, on ne trouve que 13 p. 100 de ruraux, le plus souvent entassés dans des maisons où ils vivent cinq à sept par pièce, en famille ou par groupes de célibataires. Ils sont groupés par origine, ou par suite de liens familiaux ou matrimoniaux. Les hommes sont journaliers, le plus souvent portefaix, dockers, revendeurs, garçons de café, commis.
Un campement de 150 personnes amorcé en 1952 au Nord-Est de la vieille ville, sur des terrains bombardés, fait contraste par l'origine de ses habitants, tous originaires de l'arrondissement - 28 p. 100 étant de la banlieue rurale de Bône - et parce qu'il se compose en majorité d'hommes le plus souvent célibataires et tous journaliers. A la périphérie W, dans la cité du Pont-Blanc, où furent, en 1942, recasés des sinistrés, et dans la cité des Lauriers- Roses habitée depuis 1954 par des Musulmans justifiant de revenus suffisants, on trouve 60 à 65 p. 100 de Bônois d'origine.
Ces trois " camps péri-urbains " sont caractérisés par la structure d'une population (tableau1) où les enfants représentent 48 p. 100 ; si l'on ajoute à ceux qui sont nés hors de Bône après 1944 ceux qui, pour la moitié, sont nés à Bône même, on peut estimer que 35 p. 100 au moins de cette population ont moins de 0 ans, les 13 p. 100 restants ayant entre 10 et 20 ans. La jeunesse extrême de la population fait monter à 31,6 p. 100 le taux de Bônois d'origine, mais ce taux n'est que de 13,6 p. 100 pour le seul groupe d'adultes. L'exode rural est encore plus sensible à ne considérer que l'origine des hommes chefs de famille : 9 p. 100 seulement sont nés à Bône, c'est-à-dire dans la banlieue rurale ; ce sont les mariages de Beldi célibataires avec des Bônoises qui contribuent à accroître la proportion d'ensemble d'adultes bônois. Le " Pont-Blanc " seul présente, quelle que soit la catégorie considérée, une forte proportion de Bônois, en raison de sa formation à partir et autour de modestes maisons rurales et de gourbis anciennement installés.
Proportion d'enfants, d'adultes et de vieillards des populations européenne et musulmane de Bône en 1954, calculée pour 100 hab. de chaque catégorie.
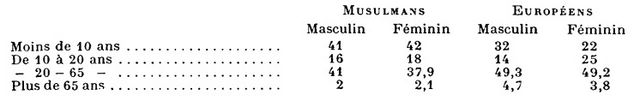 Origine des adultes des camps périphériques.
Origine des adultes des camps périphériques.
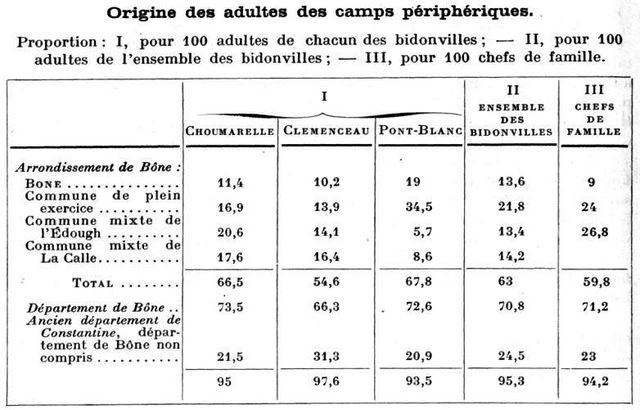
Le seul arrondissement, non compris le chef-lieu, fournit aux bidonvilles la moitié d'une population dont la plus grande partie (27,6) est originaire des deux communes mixtes de La Calle et de l'Édough. Si l'arrêt de l'exploitation minière d'Aïn-Barbar (1945) justifie partiellement l'exode des douars Ouichaoua et Tréat, généralement les sols sont trop pauvres, les parcelles trop exiguës pour nourrir une population qui augmente (2 366 locataires pour 2 722 ha dans la commune mixte de La Calle) ; 45 p. 100 des Musulmans des bidonvilles nés dans ces deux communes mixtes campent à La Choumarelle.
Herbillon, village mi-forestier, mi-maritime au Nord-Est de Bône, est de toutes les communes celle qui contribue le plus au peuplement de ces camps ; en 1954, ses originaires y représentent 18 p. 100 de sa population de 1948 ; la presque totalité de ces ruraux se réfugie au-dessous de la route d'arrivée à Bône, où ils constituent un sixième de la population du bidonville du Pont-Blanc. Cette immigration par groupes ou fractions de mechta, et non par couples comme dans les deux autres, assure le maintien des liens familiaux ou tribaux et des relations avec les lieux d'origine où les hommes retournent à certaines périodes de travaux (démasclage, ramassage des lièges).
Les mieux représentées des autres communes sont les centres les plus importants de la plaine, et aussi ceux où l'on trouve les meilleurs terroirs et la grande propriété européenne : de Duzerville sont originaires 9,9 p. 100 des Musulmans émigrés des communes de plein exercice, de Morris 9,3 p. 100, de Randon 8 p. 100, de Mondovi 4,4 p. 100. Ces ruraux représentent 2,7 p. 100, 4,4 p. 100, 1,7 p. 100, 1,6 p. 100 de la population de 1948 de chacun de ces centres.
Clemenceau se différencie par sa plus faible proportion d'originaires du département de Bône (2/3 au lieu des 3/4). Les 31,3 p. 100 viennent en effet des autres arrondissements de l'ancien département de Constantine et surtout de Kenchela, Biskra, des arrondissements de Bougie et de Sétif. Cette originalité s'explique par la proximité de la nationale 12, qui assure la liaison entre ces centres et Bône, et par l'étendue de la place vacant).
" Béni Maffeur ", dont l'aspect est si semblable à ces bidonvilles, doit à son origine ancienne d'avoir 51,2 p. 100 de sa population originaire de Bône ; pourtant après 1946 des ruraux se sont agglutinés à sa périphérie Nord, et, depuis 1931, Béni Maffeur a constitué une zone d'attraction surtout pour les immigrés originaires de Kabylie ; on y trouve 85 et 65 p. 100 des Musulmans de Collo et de Bougie habitant la périphérie urbaine. Il diffère aussi des trois bidonvilles précédents par la structure plus équilibrée de sa population : la part des femmes dans la population active est supérieure (femmes de ménage, surtout dans la banlieue Nord) et les hommes y ont un travail plus régulier. Quelquefois journaliers, ils sont le plus souvent chauffeurs, cantonniers, commis, maçons, ouvriers de carrières ou de l'industrie du liège. Enfin, si 95 p. 100 de la population des trois premiers bidonvilles déclarent être journaliers agricoles ou khaddars - situation antérieure à leur exode - , très rares sont les Musulmans des Béni Maffeur qui appartiennent à une catégorie agricole.
Soit à cause de l'intégration de centres ruraux (faubourg Randon, Sainte- Anne, Béni Maffeur), soit par suite de l'éclatement de la ville hors de ses limites (Orangerie, cités Auzas, des Lauriers- Roses ou du Pont-Blanc), les zones extérieures ne sont pas toujours caractérisées par un peuplement récent ou par des populations nouvelles. Mais des noyaux d'âge différent y voisinent. Dans la nouvelle ville, les places laissées vacantes par ce mouvement centrifuge sont, le plus souvent, prises pour l'exercice de professions libérales.
Les ruraux groupés en certains points de la périphérie ne quittent leur cabane que pour se réfugier dans une pièce louée ou sous-louée dans la banlieue Ouest. Ils ne pénètrent que rarement dans la vieille ville et seulement pour s'intégrer dans un groupe déjà installé. Là, l'attraction qu'exercent les zaouïas, les marabouts, les mosquées situées dans la moitié E (Marçais, Bône : la mosquée de Bou Merouan.) ou à la limite E de la place d'Armes, le souci manifesté par la bourgeoisie d'éviter le Nord et le Nord-Est où, à proximité des casernes, sont implantés les lieux de prostitution, expliquent la prédominance des Musulmans dans la partie orientale, la moins modifiée depuis 1830, la plus malsaine aussi. L'entassement depuis 1930 est tel que des îlots ont une densité ramenée à l'hectare de l'ordre de 5 000, surtout au fond de certaines impasses (impasse Saint-Nicolas, 4 930) ; de part et d'autre de la place d'Armes, la densité est dans le rapport de 3 à 2 (Est, 1 210 à l'ha, dont 890 Musulmans ; Ouest, 870, dont 390 Musulmans).
La relation est souvent étroite entre densité élevée et peuplement musulman : dans la nouvelle ville la densité moyenne (Calculée d'après le recensement de 1954 ; mais, pour la nouvelle ville seulement, il semble pécher par défaut.) de 386 (44 Musulmans) atteint 800 dans certaines rues où vivent des Musulmans (rue Maillot, 830) ; dans la banlieue Ouest, la zone bordière du chemin des Lauriers- Roses a une densité double (440 hab. à l'ha, dont 312 Musulmans) de celle qui, voisine, au Nord, est surtout peuplée d'Européens (210, dont 63 Musulmans). Les cités, seules, ont, bien que les Musulmans y soient en majorité, une densité relativement faible (280, dont 185 Musulmans) ; mais il faut tenir compte du fait que la plupart des maisons sont en simple rez-de-chaussée. La densité de la zone résidentielle (60) ne découle pas seulement d'une moindre proportion de Musulmans (13 p. 100) - le minimum étant atteint dans la nouvelle ville (9,4 p. 100) - , mais aussi de la structure de la propriété. Les densités élevées ne sont pas toujours liées au peuplement musulman, et nombreux sont les Européens qui vivent dans les mêmes conditions d'hygiène et de promiscuité (Une centaine vivent dans des baraques à proximité de la cité Auzas.) ; leur groupement en certaines zones est d'origine confessionnelle - israélites au Nord-Ouest de la place d'Armes (ancienne mellah) ou dans la rue Mesmer (commerçants en tissus israélites) - , ou ethnique - ascendance italienne ou maltaise dans le faubourg - , ou bien encore, depuis 1940, il s'explique par la crise du logement. Dans les taudis de la vieille ville, la tuberculose est bien plus fréquente qu'aux Béni Maffeur ou au Pont-Blanc, car si les conditions de vie (absence d'eau courante et d'égouts) sont semblables à celles des sous-locataires, du moins le site y est très aéré.
Aucune description cependant ne saurait donner une idée des conditions de vie des 3 000 hab. qui, à La Choumarelle, vivent entre les embouchures vaseuses de la Seybouse et de la Boudjimah, à l'ombre de l'usine de superphosphates, sur un terrain argilo- sableux quelquefois inondé eh hiver, toujours sillonné des rigoles d'écoulement des eaux sales ; l'eau s'achète, d'autant plus chère en été qu'elle est plus rare, et, sur ces 2,47 ha, la densité de la population atteint 1235, c'est-à-dire plus que la densité moyenne de la vieille ville orientale.
Le peuplement de cette grande ville mixte résulte donc de deux grands courants d'immigration successifs ; l'un a fourni la population française, en grande partie d'ascendance italienne ou maltaise ; l'exode rural explique qu'il ait franchi le cap des 100 000 hab. Le développement lent, puis accéléré de la ville est en relation avec les transformations économiques de la région d'abord, de la ville ensuite.
III. - Les fonctions de la ville et l'emploi
1. L'évolution des fonctions. - Dès le moyen âge, Bône était, avec Bougie, le port le plus fréquenté de l'Algérie. Mais cette activité n'a jamais été accompagnée par l'implantation de colonies étrangères. La première forme de la présence française à Bône fut en relation avec le monopole du commerce et de la pêche du corail que détenait une compagnie marseillaise, mais elle ne s'est manifestée que par un consul et quelques employés. De même qu'elle n'eut jamais de fonction religieuse, Bône ne fut pas capitale (préfecture depuis le 5 août 1955) et n'a pu jouer à l'Est le rôle d'Oran à l'Ouest.
Le partage des attributions économiques et politiques entre la ville littorale et Constantine explique que Bône ait souvent tenté de s'émanciper tant avant le XVIIIème siècle qu'après (Préfecture réclamée depuis 1869.). Enfin, Bône ne possédait pas non plus l'exclusivité du commerce de l'Est algérien; avant 1850, la région frontière de Tébessa - Souk-Ahras s'orientait le plus souvent vers la Tunisie, et, si des courants commerciaux ont existé entre le Constantinois et le littoral bônois, ils n'étaient que partiels ou sporadiques ; une partie se faisait par Tunis et par Rusicade, ou Stora, ancêtre de Philippeville.
La proximité de ce débouché, aussi incommode soit-il, a toujours été une menace pour l'expansion bônoise (" Le commerce de Stora anéantirait celui de Bône, parce que ce port est bien mieux à portée pour recevoir les blés et les laines de Constantine étant distant seulement d'une petite journée tandis qu'il y en avait trois de Bône à cette ville. " Voir lettre de Raynaud, agent de la Compagnie à Collo, Masson, Tableau des établissements français en Algérie.) ; Constantine, autant pour conserver une tutelle qui l'avantageait que pour obtenir un accès plus direct à la côte (22 lieues, au lieu de 40), a favorisé son débouché Philippeville au détriment de Bône, dont l'essor fut également freiné par la bienveillance du gouvernement en faveur de Philippeville. C'est dans l'organisation du réseau de communications qu'on peut le mieux saisir l'inégalité d'une concurrence qui vise à conquérir la plus grande partie de l'arrière-pays.
Alors que la liaison de Constantine à la côte était très tôt établie par la route Philippeville -Constantine (Construite sur les fonds primitivement votés pour la route Constantine - Bône.), les relations entre la capitale intérieure et Bône se firent jusqu'en 1862 par le chemin de campagne qu'avaient ouvert les troupes à travers les monts Penthièvre, au moment du siège de Constantine. Ce chemin était le plus souvent impraticable en hiver.
Si, en I860, Oran, Alger, Philippeville devenaient têtes de lignes du réseau ferré, Bône était oubliée. Il fallut attendre que soit applicable à l'Algérie la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer secondaires pour que soit approuvée la construction par la Société des Batignolles (remplacée ultérieurement par celle de Bône-Guelma) de la ligne d'intérêt local Bône - Guelma (1878) ; la liaison avec Constantine fut assurée en 1879 par Le Kroubs. De même la construction de la ligne Aïn-Beïda - Ouled-Rahmoun (et non Aïn-Abid) orienta vers Philippeville, aux dépens de Bône, toute une région dont les relations avec Bône étaient très anciennes ; la commission des travaux publics en avait ainsi décidé : " pour établir une compensation à la perte que fera nécessairement subir à Constantine et à Philippeville la construction de la ligne Sétif - Bougie ". La construction de la voie étroite Tébessa - Aïn-Beïda fut, en 1902, une tentative pour ravir à Bône cette région frontière ; le P.L.M. qui, en raison du prix de construction élevé de la voie Philippeville - Constantine (700 000 F le km), n'avait pu aligner ses tarifs sur ceux des autres compagnies, consentit, sur cette ligne, des tarifs spéciaux par groupage de marchandises : ainsi, on payait 163,20 F la tonne pour Philippeville - Tébessa, et 185,40 pour Bône - Tébessa (Chambre de Commerce de Bône.). Au contraire les conventions qui liaient la compagnie concessionnaire de Bône - Souk-Ahras - Tébessa à l'État étaient défavorables à une augmentation du trafic, auquel la voie d'ailleurs ne pouvait répondre, et la compagnie maintenait des tarifs trop élevés pour que des marchandises de peu de valeur fussent envoyées par fer jusqu'à Bône. Cette guerre des tarifs, antérieure d'ailleurs à 1903 dans tout l'arrière-pays, les nombreuses tentatives de Constantine ou de Philippeville (La Chambre de Commerce consentait des avantages exceptionnels.) ne purent cependant ravir à Bône la riche zone frontière dont le rachat des lignes par l'État (décret du 27 février 1915) et l'élargissement de la voie Souk-Ahras - Tébessa - Le Kouif orientèrent définitivement les échanges en sa faveur.
Les relations extérieures même défavorisaient Bône ; longtemps privée de service direct avec la métropole, la ville, d'abord tributaire d'Alger, le fut de Philippeville jusqu'en 1880. Au contraire, des relations directes et plus fréquentes avec l'Italie lui apportaient un flot continu d'immigrants.
D'autres facteurs ont contribué à ralentir l'essor bônois : la région fut si calme que la construction d'un réseau routier fut tardive : " l'éloignement de l'ennemi n'en faisait pas sentir la nécessité (Tableau des établissements français en Algérie, 1838-1839.) ". Il fallut attendre que soient affectés à des travaux d'équipement les crédits provenant des conventions de la Société Générale Algérienne pour que Bône soit enfin reliée à Constantine par Guelma (1872), à Souk-Ahras (1871), aux Béni Salah. Si l'on excepte Bugeaud - village forestier de contrôle sur la route de Bône à Herbillon - , Penthièvre (1847), Héliopolis (1848) et Nechmeya (1853), étapes sur la route Bône - Guelma - Constantine, la plupart des villages de colonisation ont précédé la route, et ultérieurement le chemin de fer ne fut pas l'instrument de mise en valeur qu'il aurait pu être. Les difficultés ou le prix élevé des transports augmentaient encore l'éloignement de ces centres établis loin des marécages de la plaine.
Enfin, la grande période de peuplement de la région est postérieure à 1870. De grandes propriétés européennes se constituèrent si rapidement après 1832 que le gouvernement dut renoncer aux projets de colonisation officielle dans la plaine de Bône - la majeure partie des terrains appartenait déjà à des Européens. Des sept centres projetés, Duzerville seul vit le jour avec cinq ans de retard. Ces grandes propriétés inexploitées ont entravé le peuplement, mais aussi retardé la mise en valeur, car les propriétaires se contentaient de couper les foins, d'engraisser du bétail, ou de louer aux Musulmans. Ainsi, Bône est, jusqu'en 1865, un centre d'exportation de foin (L'exportation des fourrages est souvent supérieure à celle du minerai de fer: 1855, 5 497 855 kg de fourrage, contre 1 395 000 kg de minerais. 1856, 4 555 767 kg de fourrage, contre 3 722 544 kg de minerais.), de bovins que lui fournissaient, outre sa plaine, les marchés de Guelma et de Souk-Ahras et dont elle ravitaillait Alger et Oran, de laines et de peaux. Mais ce commerce d'exportation n'eut qu'une faible incidence sur le développement de la ville elle-même.
L'exploitation minière, par contre, a très tôt intéressé la ville. Les premières mines exploitées (Belelieta, Karézas, Meboudja), les plus proches, étaient, il est vrai, les moins importantes et il fallut attendre la mise en exploitation d'Aïn-Mokra (1865) par la société Mokta El Hadid pour que la ville en retirât des avantages réels. L'évacuation n'avait plus lieu vers l'embouchure de la Seybouse. mais dans le port. La voie ferrée minière qui y aboutissait était, sauf en hiver, employée quotidiennement au transport des ouvriers qui ne pouvaient vivre à Aïn-Mokra rendu malsain par la proximité du Fetzara. La fabrication de fonte à l'Allelick, dans la grande banlieue, fut tôt abandonnée à cause d'un prix de revient trop élevé et du manque de débouché. La mine de cuivre, de plomb et de zinc d'Aïn-Barbar ne connut qu'une exploitation sporadique, mais le tout contribua à l'activité de la ville qui profita enfin de la mise en valeur des magnifiques forêts de chênes-lièges des environs (Édough, La Galle, Béni-Salah). Aussi, en 1881, 50,5 p. 100 de la population bônoise vivait de l'industrie et des mines et 29 p. 100 seulement du commerce, des transports, et de la pêche. A la fin du XIXème siècle l'épuisement des mines d'Aïn-Mokra, l'arrêt dans l'exploitation d'Aïn-Barbar entraînent l'effacement de la fonction minière, tandis que prédomine à nouveau celle de centre commercial. Le peuplement de la plaine et sa mise en valeur, la nouvelle liaison ferroviaire avec Souk-Ahras et Tébessa font de Bône un important centre de redistribution des produits importés. L'augmentation des exportations agricoles exige une extension des quais. L'agrandissement et la transformation du port sont réalisés suivant un projet considéré comme grandiose à un moment où les richesses minières du Sud-Est ne sont pas encore connues ; mais Bône espère que ce port sûr et bien équipé sera un nouvel instrument en sa faveur dans cette lutte d'influence où Bizerte s'ajoute à Philippeville.
On serait tenté de rapprocher l'essor de la ville de celui qui, dans le trafic portuaire, porte la marque de l'Ouenza. Or ce trafic n'a eu sur la ville qu'une influence indirecte : les minerais de fer - comme l'alfa, et les ovins - ne font que transiter à Bône et ne donnent lieu à aucune transaction ou transformation ; l'automatisme y fut constamment accru (0,3 p. 100 de la population active de 1954). Les phosphates du Kouif offrent plus d'intérêt pour une ville où ils sont la matière première de sa plus grande industrie chimique : l'usine de superphosphates (137 ouvriers en 1926, - 275 en 1955) produit en moyenne 56 000 t par an (C'est la seule des quatre usines de la S.A.P.C.E. à travailler pour l'exportation (5 000 t/an = Madagascar - Moyen-Orient). Elle ravitaille l'Est algérien et partiellement les départements d'Alger et d'Oran et la Tunisie.). La concentration, à Bône plus qu'à Philippeville, d'un certain nombre d'activités est cependant en relation avec l'augmentation du mouvement portuaire consécutif à l'exportation des minerais de fer : stations d'avitaillement des navires, petits ateliers de réparation navale (aucun chantier de construction), maisons d'importation de bois pour le bâtiment et la menuiserie, petites industries de transformation des lièges ou d'utilisation des déchets, etc. ; la construction d'une usine à briquettes par la Société charbonnière de ? Ouest (1924) est liée à la fréquence des navires anglais dont le charbon constituait un fret d'aller ; 95 p. 100 de la production ravitaillait les chemins de fer algériens. (La production actuelle de briquettes est faible.) L'électrification totale de la ligne minière et l'emploi plus fréquent de diesel électrique la privant de son principal client expliquent sa transformation récente (1948) en fabrique de boulets.
La centrale thermique Bône I - projetée depuis 1902 - est née (1927) de la nécessité d'électrifier la voie minière Bône - Souk-Ahras - Tébessa comme de fournir une énergie suffisante aux compagnies minières et aux industries nouvelles ; sa construction, l'équipement de la mine, l'installation des appareils de manutention du port, etc., entraînent, avec la multiplication d'ateliers de chaudronnerie et de construction électrique, la formation d'une industrie de construction mécanique représentée surtout par la succursale de la maison Durafour et Cie d'Alger. Cet atelier est, depuis 1929, associé à toutes les grandes réalisations de Bône, et son activité dépasse même la zone d'influence normale de la ville pour atteindre Sétif et Bordj-Bou-Arreridj. Enfin, la surface libre des terre-pleins devait attirer les sociétés pétrolières (Algéro-Naphte, fondée en 1905 pour recevoir des bidons de 18 l, construisit ses cuves en 1920 ; Esso Standard ; Société française des pétroles ; Société algérienne des huiles minérales. Seule, la société des pétroles Shell est installée quai Nord.) (1920-1940) ; Bône devenait alors pour tout le département de Constantine le centre d'approvisionnement en essence ; seul le ravitaillement en produits lourds était partagé avec Bougie. L'opposition gouvernementale (raisons stratégiques) à un agrandissement de la capacité totale des cuves vient d'avoir sa première conséquence dans l'installation de la British Petroleum Company à Philippeville, déjà proposée comme centre de ravitaillement de la base aérienne de l'O.T.A.N. prévue à Biskra. La distance jouant en sa faveur, Philippe ville obtiendra sans doute le ravitaillement du Constantinois.
2. Les entreprises coopératives. - La brutale croissance de la ville et les mouvements de la population sont surtout en relation avec les transformations économiques de la plaine. Bône est devenu le centre de commercialisation, de stockage ou de transformation de la plus grande partie des produits agricoles.
A l'origine du mouvement coopératif on trouve l'Union Agricole de l'Est transformée en syndicat (15 avril 1921) et la Tabacoop, née de la fusion (1921) des docks à tabac de Mondovi (quelques gros planteurs) avec la Société des planteurs de tabac de la région de Bône. L'organisation révèle la prééminence de la Tabacoop. Son comité directeur est par principe admis comme comité directeur de toutes les autres coopératives, de l'Union Agricole de l'Est, de la Caisse régionale de Crédit, des Assurances mutuelles ; de plus, contrairement à la doctrine du mouvement coopératif, il est intéressé directement au chiffre d'affaires de la Tabacoop. La Tabacoop (9173 coopérateurs musulmans + 709 européens en 1954. Elle occupe 1400 ouvriers en août et septembre.) centralise la presque totalité des tabacs récoltés dans les arrondissements de Bône et de Guelma et la plus grande partie de celui de Philippeville (capacité de stockage, 13 000 t) ; 60 p. 100 est livré à la Régie française des tabacs. La Société des tabacs dHippone Léger, l'agriculture dans la plaine de Bône (1952), inédit.) (S.A.R.L.), filiale de la Tabacoop qui possède 95 p. 100 des parts, commercialise les reliquats. Outre les fabricants algériens, elle a pour clients l'Indochine - les maisons JOB et Bastos ont des succursales - la Hongrie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne. Propriétaire de plusieurs immeubles urbains, de la Maison de V Agriculture à Bône, de 800 ha de chênes-lièges, de 1984 des 2000 parts de la société Scierie dHippone, d'une exploitation agricole à Bou-Hamra, et d'une ferme d'expérimentation à Barral, elle s'est annexé une usine à nicotine traitant les déchets de tabac, mais la production de sulfate de nicotine, totalement exportée vers l'Amérique, est très irrégulière.
La Tomacoop (248 sociétaires), créée en 1922 pour la mise en conserve des légumes, s'est limitée à la fabrication des concentrés de tomates. Elle transforme (1935, 18 084 q ; 1951, 43 000 q ; 1953, 102 000 q.) en moyenne deux tiers de la production de la plaine dans une usine qui pouvait, en 1956, traiter 2 500 quintaux par jour. La Cotocoop (1924) traite tous les cotons du département de Constantine (Bône, El Arrouch).
Depuis 1946, elle est intégrée à la coopérative cotonnière algérienne. La Cave coopérative, récemment augmentée d'une distillerie, ne contrôle qu'une faible partie de la production régionale (neuf autres dans l'arrondissement) ; la Frigécoop, créée en 1935 pour la réfrigération des viandes, fut transformée sans succès en Agrumcoop. Une industrie coopérative de salaisons, de saucissons et de conserves pur porc lui succéda en 1943, pour ne durer que trois ans. Les Docks silos coopératifs (1933) furent rachetés en 1950 parla Chambre de commerce de Bône, qui augmenta leur capacité (110 000 q à 160 000 q), pour leur permettre de servir de silos de transit.
Presque toutes ces coopératives, concentrées sur la rive droite de la Boudjimah, ont une activité saisonnière : en août et septembre elles emploient environ 2 000 personnes en plus du personnel administratif, des employés permanents de la scierie, de l'imprimerie, du centre d'études, etc., etc. Le rôle de cette organisation dans l'économie bônoise est d'autant plus important que la Tabacoop, véritable organisme tentaculaire, tente de contrôler directement ou indirectement une grande partie des activités urbaines et rurales.
La transformation locale des produits agricoles et la sélection qu'elle impose ont obligé les petits exploitants à faire de plus en plus souvent appel à la Caisse régionale de crédit mutuel agricole ; leur endettement, accentué après chacune des deux dernières guerres, explique la prolétarisation et le départ vers la ville de certains d'entre eux. La mécanisation des grands domaines après 1920 et la création d'un Labourcoop (1924) ont libéré une partie de la main-d'œuvre agricole. A partir de 1945, de nouvelles coopératives de labour se sont formées à Mondovi, Randon, Penthièvre, Duzerville. Les communes où existent ces coopératives sont parmi les meilleures pourvoyeuses des bidonvilles bônois (Duzerville, Morris, Randon, Mondovi). L'exode rural n'est pas sans relation non plus avec la récente politique adoptée par la Tabacoop pour remplacer sur les terres basses, humides et légèrement chlorurées, le tabac de mauvaise qualité par le coton; cette culture, où le khaddarat n'est qu'exceptionnel, diminue les emplois de travailleurs agricoles (coton, 70 à 110 jours de travail par ha ; tabac, 200 à 240 jours).
3. La concentration. - En 1935, presque toutes les activités urbaines sont en place ; on assiste alors, dans les secteurs non coopératifs, à une concentration en de grosses entreprises. Quelques ateliers ont encore un caractère artisanal (4 moulins à huile, quelques fabriques de poterie et de bijoux) ou semi-artisanal (fabrique de balais de sorgho), mais la difficulté des débouchés et la concurrence locale ont entraîné la disparition de nombreux petits exploitants.
Une seule des quatre minoteries de 1938 : les Moulins dHippone, alimente en farine les boulangeries et la fabrique de pâtes alimentaires ; elle produit aussi des semoules, dont 160 000 q sont envoyés en France. Une seule fabrique de pâtes alimentaires (six en 1936) concurrence aisément les produits français, grâce à une grande variété de profils, dispute le marché régional aux pâtes algériennes (Lavie, Audureau) et exporte vers la France par Rouen 75 p. 100 de ses couscous.
La Manufacture Algérienne de Tabacs doit sa forte production actuelle (130 t/an, capacité de 500 000 cigarettes /jour) à l'existence de capitaux locaux (Algérienne Automobile Transports et capitaux étrangers), et non à la culture de tabacs de la plaine, ou à la proximité du port. Elle n'utilise que 50 p. 100 de tabacs algériens, provenant autant de la Kabylie et de la Mitidja que de la plaine voisine, et les tabacs étrangers lui arrivent d'Alger par terre.
Les fermetures d'ateliers ont été nombreuses dans l'industrie du liège : des 14 entreprises de 1945 (20 en 1926), il n'en reste que 7. La plupart ne subsistent d'ailleurs qu'au prix d'une spécialisation leur permettant une production restreinte, mais certaine (flotteurs pour la pêche, bouchons de champagne), ou d'une entente avec une maison française. Depuis 1945 l'approvisionnement local est souvent difficile, les sociétés concessionnaires de forêts complètent leurs besoins en faisant monter les adjudications à des prix qui ne rencontrent plus la concurrence des petits bouchonniers, et actuellement une partie des lièges des forêts voisines de Bône est transformée à Collo ou à Djidjelli. La SOLIEPNA, seule industrie importante (près de 200 ouvriers), produit, outre les bouchons, tous les agglomérés de liège exportés par le port.
A l'ancienne industrie métallurgique de montage et de réparation s'est ajoutée, depuis 1939, une industrie de transformation, qui travaille pour l'exportation vers certains pays de l'Union Française. L' Aluminium J.P., fabrique d'ustensiles de ménage et fournisseur de l'armée de terre et de l'air, est la plus artificielle ; son implantation à Bône où existent les capitaux grève le prix de revient de frais de transport élevés ; les relations se font par route avec Alger, centre d'approvisionnement en matière première (lingots demi-ouvrés) et port d'exportation vers l'Union Française, la Syrie et le Liban ; l'Algérie n'absorbe que le quart de la production. La Société Nord-Africaine d Approvisionnement ferroviaire (S.N.A.F., 1938), filiale de la maison De Dietrich à Niederbronn, est née du besoin de rénover le matériel roulant des chemins de fer algériens et tunisiens (Le matériel roulant des sociétés minières est toujours importé de France). Bône fut alors choisi pour sa position centrale par rapport aux deux clients. L'usine, première forge d'Algérie, dont la capacité est de 600 wagons par an, n'en fournissait que 200 ; elle a dû ajouter à cette activité réduite la menuiserie de bâtiment.
4. L'emploi et la localisation des activités. - Le manque de débouchés extérieurs et la concurrence des produits français sur le marché intérieur obligent la plupart des industries à réduire leur activité (Certaines (outre les fabriques de bouchons) ont été obligées de cesser tout travail (Sefcar, conserves de crevettes, battue sur le marché français par la crevette égyptienne)). L'installation de nouvelles usines n'a pu et semble ne pas pouvoir réduire beaucoup le chômage. L'automatisme accru entraîne plutôt par moments une libération de manœuvres. Les ruraux ne sauraient être utilisés et les techniciens viennent le plus souvent de France. En 1954, le tiers de la population active européenne était employé dans ce secteur secondaire, contre 22,6 p. 100 dans le commerce et 20,5 p. 100 dans les fonctions libérales ; les Européens constituent les deux tiers du personnel industriel, l'autre tiers intéressant 12,3 p. 100 de la population active musulmane (La plus forte proportion de Musulmans est classée dans la catégorie des activités insuffisamment déterminées.).
A l'exception de la Tabacoop qui en août-septembre peut employer 1 400 personnes, aucune industrie n'en occupe plus de 300, six en ont plus de 200 (dont deux saisonnières), une dizaine (dont trois quarts relèvent du bâtiment) ont un personnel compris entre 100 et 200, toutes les autres emploient moins de 100 personnes. La dispersion des grosses industries au Sud de la Boudjimah s'oppose à la concentration des petites entre la gare et la Boudjimah et à leur étirement le long du boulevard Clemenceau, de la rue Eugène-François - où elles s'insèrent entre deux âges de l'agglomération - et autour du Pont-Blanc. Cette localisation engendre deux sortes de mouvement : des courants centrifuges vers l'W et vers le S, celui-ci renforcé par le grand courant N-S des Européens de la zone résidentielle ; des courants tangentiels vers le SE ou le NW alimentés surtout par les Musulmans des cités. Les mouvements centripètes sont engendrés par l'activité commerciale et viennent surtout du N et du NE.
Presque toutes les activités tertiaires sont concentrées entre la rue du 4 Septembre et la rue Maillot (On y trouve la presque totalité des restaurants et des hôtels.) ; elles se spécialisent le long des rues méridiennes.
La rue Bugeaud, bordée par les halles centrales, est l'artère principale du commerce d'alimentation ; la rue Maillot, immédiatement parallèle à l'W, est spécialisée dans les produits d'alimentation musulmane. Dans la rue Mesmer (première rue parallèle à l'E) sont situés les commerces de tissus (11/14) et plus particulièrement des commerçants israélites. La rue Perrégaux limite à l'E le quadrilatère où, entre les rues Thiers, Maillot et Gambetta, se trouvent 90 p. 100 des grossistes ; avec ses maisons d'équipement électrique et d'accessoires pour automobiles, elle est le prolongement en ville de l'avenue de la Marne dont l'activité est tout entière tournée vers l'équipement de la région. Les rues transversales (sauf la rue Gambetta, rue des commerçants mozabites) n'ont pas de spécialisation.
Toutes les activités financières (Banque de l'Algérie, Société Générale, Compagnie Algérienne, Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, Banque Industrielle de V Afrique du Nord, Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie, Crédit Lyonnais, Société Marseillaise de Crédit, Banque régionale pour le Commerce et d'Industrie. Deux seulement sont situées rue du 4 Septembre. ), judiciaires et administratives sont réunies sur le cours Bertagna ou sur son prolongement (P.T.T., Tribunal, Préfecture, Hôtel des finances, Ponts et Chaussées). Les galeries de la façade orientale abritent 80 p. 100 du commerce de luxe, tandis qu'à l'W les terrasses des brasseries et des cafés glaciers s'allongent à l'ombre des palmiers et des ficus.
Le commerce musulman a progressivement été rejeté vers la périphérie. Un des centres situé rue Bugeaud après 1890 a été déporté vers l'W par le déplacement du marché de détail à la porte des Karézas (place Maria-Favre) où se trouvaient, depuis le milieu du XVIIIème siècle, le caravansérail et le marché aux grains ; les rues convergentes sont, dans leur partie occidentale, tournées vers un petit commerce musulman. Le déplacement récent (1956) du marché près du bidonville du boulevard Clemenceau entraînera des modifications qu'il est encore impossible d'évaluer.
5. La capitale régionale. - Bône, siège des principales banques et des maisons de crédit, des sociétés minières (excepté celles de l'Ouenza et des phosphates du Kouif), des agences des compagnies d'assurances, des compagnies maritimes et aériennes, centre de commercialisation ou de transformation de la plupart des produits agricoles de l'arrière-pays, est aussi le centre de redistribution des charbons, des essences et des produits lourds, des produits alimentaires, du matériel d'équipement. La ville est devenue le centre d'une région économique dont les limites sont imprécises à l'Ouest (Le lac Fetzara a longtemps constitué une barrière.) et au Sud-Ouest : Jemmapes, Gastu, Auribeau étaient jusqu'en 1952 partagés entre les deux villes littorales ; la mise à voie large de la ligne Bône - Saint-Charles, en les reliant directement à Philippeville, les a presque totalement détachés de Bône. Au Sud-Ouest, Sedrata, Auribeau, Oued-Zenati dépendent économiquement de Constantine plus proche (L'influence de Bône dépasse le cadre de cette région pour les charbons, les essences, les charpentes métalliques (Durafour), les tabacs). Des facteurs nouveaux doivent modifier dans l'avenir les limites de cette zone d'influence. La création d'un département de Bône va réduire la zone d'interférence des influences bônoise et constantinoise à la limite administrative ; les zones de Tébessa, Ouenza, Souk-Ahras et surtout Guelma se tourneront vers Bône.
Le facteur le plus important pour l'avenir est, avec le projet d'organisation d'une zone industrielle - Zoia II - , la récente découverte du pétrole dans le Sud-algérien.
L'Algérie orientale qui fournit 82 p. 100 du fer algérien et la totalité des phosphates possède la seule voie normale électrifiée aboutissant au port bien équipé de Bône et la seule artère de transport d'électricité à 90 000 V. La centrale thermique Bône II (1952, 50 000 kW) est rattachée à la grande artère d'interconnexion de 150 000 V par Duzerville, d'où partent les lignes vers La Calle (22 000 V), vers Philippeville (60 000 V), vers Le Kouif et vers la Tunisie (90 000 V) à qui elle a fourni, en 1954, 10 000 000 kW. " Tébessa et Bône constituent donc une symbiose " ; l'aménagement de cette Zoia prévoit une pré-sidérurgie sur le carreau des mines (procédé Basset), l'enrichissement des phosphates du Djebel Onk au Kouif ; enfin, Bône pourrait devenir un centre d'industrie métallurgique.
Les récentes découvertes de pétrole à Edjelé, à Timentourine, à Hassi Messaoud posent le nouveau problème de son évacuation ; mais il ne semble pas que Bône doive être choisie comme débouché....
Lucette Travers.
Travers Lucette. Bône. La formation de la ville et les facteurs de son évolution. In: Annales de Géographie, t. 67, n°364, 1958. pp. 498-520;
doi : https://doi.org/10.3406/geo.1958.17012
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1958_num_67_364_17012
Fichier pdf généré le 30/03/2018498
|
|
COLONISATION DE L’ALGERIE
Les raisons de la conquête
Par M.José CASTANO,
|
« Chose étrange et bien vraie pourtant, ce qui manque à la France en Alger, c’est un peu de barbarie. Les Turcs allaient plus vite, plus sûrement et plus loin ; ils savaient mieux couper les têtes. La première chose qui frappe le sauvage, ce n’est pas la raison, c’est la force » - (Victor Hugo dans « Le Rhin » en 1842)
Lors de ses voyages en Algérie dans le but de « panser les plaies du passé », l’inénarrable François Hollande a reconnu publiquement que : « Pendant cent trente-deux ans, l’Algérie a été soumise à un système profondément injuste, brutal et destructeur. Je reconnais ici les souffrances que le système colonial a infligé au peuple algérien »… et encore : « La France est responsable d’une colonisation injuste et brutale ; elle est responsable des massacres d’innocents algériens à Sétif, Guelma et Khenattra »... tout en se gardant bien, de dénoncer ces centaines d’autres massacres d’innocents européens qui ont précédé les représailles et ces autres milliers de massacres d’innocents européens et musulmans fidèles à la France qui ont jalonné huit années de terrorisme aveugle et lâche.
Par cette indécente sélectivité minable, ce Chef d’état honni a injurié et humilié –non les Français d’Algérie, comme se plaisent à dire certains idiots utiles de service- mais, tout simplement, la France, son peuple, son Histoire, son honneur ainsi que la mémoire et le sacrifice de ses soldats.
Depuis lors, un florilège de réactions issues du milieu « progressiste » n’a pas manqué de vilipender en des termes diffamants l’œuvre colonisatrice de la France en Algérie. C’est ainsi, qu’encouragé par l’attitude et les déclarations du matamore élyséen remisé au placard depuis, ce petit monde de « moralistes à la conscience pure » n’a eu de cesse de monter les enchères en comparant le colonialisme français à l’esclavagisme… Il n’en fallut pas plus à son successeur « Choupinet 1er » ou « Jupiter », pour s’illustrer à son tour dans cette même Algérie si convoitée par les chefs d’état français en quête de nouveaux électeurs…
Le 15 février 2017, « Jupiter » déclarait à la télévision algérienne : « La colonisation fait partie de l’histoire française. C’est un crime, un crime contre l’humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant nos excuses à l’égard de ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes ».
Le 13 septembre 2018, le dénouement de tant d’infamies s’est concrétisé par la reconnaissance officielle par « Jupiter » de la responsabilité de l’Etat dans la disparition à Alger en 1957 de Maurice AUDIN, militant communiste pro-FLN. Soupçonné d’héberger des terroristes de la cellule armée du Parti communiste algérien, AUDIN fut arrêté le 11 juin 1957 lors de la « bataille d’Alger » par les parachutistes du général MASSU et mourra lors de sa détention.
Ce nouvel acte de « repentance » de « Jupiter » est conforme à ses prises de position antérieures sur « l’affaire algérienne ». En novembre 2016, dans un entretien au Point, il avait déclaré : « En Algérie, il y a eu la torture, mais aussi l’émergence d’un Etat de richesses de classes moyennes, c’est la réalité de la colonisation ».
Monsieur MACRON, dénigrer l’histoire de son pays, de son passé, sa grandeur, le sacrifice de ses aînés et de ses soldats est un acte criminel. Nous n’avons pas à tronquer notre histoire pour faire plaisir à telle minorité, telle association au « cœur sur la main » ou tel parti politique. « Dans cette rumination morose, les nations européennes oublient qu’elles, et elles seules, ont fait l’effort de surmonter leur barbarie pour la penser et s’en affranchir » écrivait Pascal Bruckner. Que ceux qui s’adonnent à ce type d’autoflagellation jouissive n’oublient pas cette mise en garde de Henri de Montherlant : « Qui a ouvert l’égout périra par l’égout. »
Ce dénigrement perpétuel de la France et de son passé colonial par nos « bien pensants », présidents en tête, martyrocrates de profession, faussaires de l’antiracisme, est le pire danger auquel elle est confrontée.
Ces déclarations infamantes, basées sur une méconnaissance totale du sujet, inspirées de surcroît par un sentiment anti-français, nous dépeignent, aujourd’hui encore, « l’Algérie coloniale, comme ayant été l’apartheid » et les soldats qui ont écrit son histoire dans le sang et les larmes, des « barbares ». Ces « historiens » de bas étage nous « rappellent » que « la colonisation était contraire aux lois de la République, notamment par son côté ségrégationniste » (sic). Quelle hérésie !
Si Charles X fut à l’origine de « l’expédition d’Alger », c’est précisément la République (la IIe) qui ordonna la conquête de l’Algérie. Cependant, à cette époque il n’était aucunement question de colonisation. Ce que Charles X et avec lui l’Europe- voulait, c’était supprimer la piraterie en Méditerranée. En effet, toute la côte « barbaresque », de l’Egypte à Gibraltar, n’était qu’une seule et très active base d’opérations de piraterie dirigée contre la France, l’Espagne, l’Italie et surtout contre les convois chargés de marchandises qui sillonnaient la méditerranée.
C’est pour réduire cette piraterie que les premières incursions chrétiennes de représailles sur les côtes algériennes virent le jour au début du XVIe siècle et permirent aux Espagnols, sous la conduite de Pedro Navarro, d’investir Alger et de libérer trois-cents captifs chrétiens. Pour les en chasser, les algériens firent appel en 1515 aux corsaires turcs qui occupaient depuis 1513 le port de Djidjelli en Kabylie, notamment à un pirate sanguinaire, Kheir-Ed-Din, dit Barberousse en raison de la couleur de sa barbe. Ils occupèrent Alger et y instaurèrent un régime de terreur, exécutant ceux qui refusaient la nouvelle domination turque. Ainsi, par l’entremise de ce pirate que le sultan de Stamboul avait nommé émir des émirs, beylerbey, la Turquie prit officiellement pied dans le bassin occidental de la Méditerranée. Alger était pour elle une base avancée, ce que Gibraltar et Singapour furent plus tard pour l’Angleterre. De là, elle pouvait porter des coups très durs à la navigation chrétienne. Avec ces ressources, Barberousse et les Turcs chassèrent les Espagnols et conquirent le territoire algérien, allant jusqu’à placer le pays sous la dépendance nominale du sultan de Constantinople. Le Maghreb était devenu une province turque.
Forte de ses soixante bâtiments dont trente-cinq galères, la flotte algérienne écumait la Méditerranée et amassait des trésors. De plus une autre source énorme de profits était constituée par l’esclavage. Il s’exerçait, pour une part, aux dépens de populations d’Afrique noire que l’on enlevait après avoir investi les villages et, pour une autre part, de la piraterie. L’avantage de cette dernière résidait dans l’échange des esclaves chrétiens contre de fortes rançons. Un bénédictin espagnol, le Père Haedo, estimait qu’Alger devait avoir 60 000 habitants et 25 000 esclaves chrétiens.
Quand Charles X décida l’occupation d’Alger, la Prusse, l’Autriche, la Russie, les grands de l’heure, approuvèrent sans commentaires particuliers. C’est ainsi qu’en cette aube du 25 mai 1830, la France partit pour l’Algérie… sans se douter qu’elle allait y rester 132 ans.
Aussi quant nos « historiens de salons » s’élèvent contre « la saisie de terres, l’annexion de territoires, l’évangélisation, le pillage des ressources minières » (sic), ils ne peuvent qu’engendrer le ridicule…
Concernant « la saisie de terres », ils voudraient nous faire croire que les premiers pionniers firent main basse sur de riches et fertiles terres agricoles enlevées de force aux indigènes… alors qu’en réalité, ils découvrirent un désert, une lande hérissée de broussailles au bord d’un marais pestilentiel où pullulaient les moustiques.
Sur l’évangélisation, nos « historiens » se sont encore fourvoyés… S’ils reprochent à la France cette annexion, ils « oublient » cependant de signaler que ce sont les ascendants des « victimes du colonialisme français » qu’ils défendent aujourd’hui avec tant de véhémence, qui sont les véritables colonialistes.
- Qui a annexé ce pays autrefois habité par la race berbère et qui faisait alors partie intégrante du monde occidental ?
- Qui a soumis par la force ce même peuple berbère, majoritairement chrétien, à la conversion à l’Islam ?
Quant au « pillage des ressources minières », que d’infamies !
C’est la France qui a découvert et mis en valeur à grand frais les zones pétrolifères et les gisements de gaz du Sahara prétendument destinés à assurer son indépendance… mais qui, en réalité, n’ont eu de cesse d’enrichir les apparatchiks algériens…
Durant l’épisode sanglant de la guerre d’Algérie, le leitmotiv constant des responsables du FLN était que la rébellion se justifiait par le besoin de plus de justice, de bonheur et de liberté pour la « malheureuse » population musulmane. Cependant au cours d’une audience qu’il accorda à un haut prélat d’Algérie, en septembre 1961, sa Sainteté Jean XXIII prononça : « Vous avez vos idées, c’est bien, mais moi j’ai constaté une chose : c’est que chaque fois que la France se retire d’un pays, la liberté et la civilisation reculent. »
Que ces paroles du Pape inspirent à nos gouvernants de fécondes réflexions !
-o-o-o-o-o-o-o-
« A son indépendance, nul pays extérieur au monde occidental, Japon et Afrique du Sud exceptés, ne dispose d’une infrastructure aussi développée que l’Algérie » (Béchir Ben Yahmed, fondateur de « Jeune Afrique »)
|
|
Rire avec Dieu
Envoyé par M. Fabien
|
Des textes remplis d'humour soufi, et de sagesse profonde pour apprendre à regarder nos imperfections et à les reconnaître…
Aux côtés de Jâmi, Attâr, Rûmî ou Ibn’Arabî, une quarantaine de maîtres soufis du XIe au XVe siècle composent cette anthologie souriante.
Les petites histoires truffées d’humour et de malice nous rappellent sans dureté nos faiblesses humaines.
Elles portent indéniablement une sagesse cachée, mais on peut tout simplement les apprécier pour leur humour stimulant.
Elles nous décrivent tels que nous sommes, humains et aveugles, imparfaits et tâtonnants.
L’autodérision, souvent présente dans ce petit ouvrage savoureux, nous aide à regarder lucidement les effets de notre Ego et à en rire d’un rire libérateur.
L’humour, tout autant que les propos sérieux, est un moyen de reconnaître et d’accepter nos imperfections, afin de mieux les corriger…
Un pèlerin soufi, à l’issue d’un long et dur voyage, atteignit enfin La Mecque et se rendit à la Maison de Dieu, à la sainte Ka’aba.
Totalement épuisé, il s’effondra sur place et s’endormit jambes tournées vers le Lieu sacré.
Un dévot, à la vue de cette irrespectueuse posture, secoua violemment le Soufi :
— Misérable ! N’as-tu pas honte d’avoir ainsi étalé tes pieds crasseux face à la Demeure où se tient Dieu ?
— Oui, assurément, répondit le pèlerin, mais je ne sais que faire.
S’il te plaît, aide-moi : place mes pieds dans une direction où Il ne se tiendrait point.
|
|
QUELQUES PAGES D'UN VIEUX CAHIER
Source Gallica
|
Souvenirs du Général Herbillon (1794 - 1866)
Publiés par son petit-fils
CHAPITRE X
Expédition dans le Djebel Aurès (1845) - Attaques d'Aydoussa (20 mai 1845) - Herbillon est nommé commandeur de la Légion d'honneur (20 août 1845) - Combats entre les Ouled-Sellam Guelala (décembre 1845) - Le colonel Herbillon passe au 38ème de ligne - Il est nommé maréchal de camp (novembre 1846)
Ce n'est qu'en 1845 que sont poussés les préparatifs pour envahir le Djebel Aurès.
Les motifs qui imposent aux troupes d'occupation la nécessité de parcourir l Aurès sont toujours du même ordre. La pacification ne s'étend que difficilement aux peuplades habitant les régions montagneuses.
Le Djebel Aurès était difficile à pénétrer. Les villages Placés sur des rochers et entourés de ravins profonds étaient considérés par les indigènes comme imprenables. Ils se croyaient donc certains de pouvoir commettre leurs méfaits sans être inquiétés.
La colonne expéditionnaire se compose de deux brigades sous le haut commandement du général Bedeau assisté du général Levasseur. Elle quitte Batna le 1er mai 1845; jour par jour, Herbillon nous donne le journal des opérations. Nous n'en retiendrons que deux épisodes.
Le 20 mai, mardi à 4 heures du matin, le camp fut levé. La colonne divisée en deux brigades se mit en route. La 1ère brigade, sous les ordres du général Levasseur, partit à 4 heures du matin; la 2ème sous mes ordres, ne commença son mouvement qu'à 6 heures. Après avoir parcouru les crêtes du Rass-Drah par de très mauvais chemins, nous fîmes une grande halte pour coordonner notre action avec celle du lieutenant-général qui devait attaquer le village d'Aydoussa par la gauche pendant que je l'attaquerais par la droite. Je reconnus le chemin que ma colonne devait suivre. J'étais accompagné du colonel Gouyon, chef d'État-major, de quelques spahis et d'une section de grenadiers.
Nous suivions la crête de la montagne, lorsque tout à coup nous nous trouvâmes en face d'une redoute que les Arabes avaient construite en pierres sèches. Aussitôt que nous fûmes en vue à environ 300 mètres, nous fûmes assaillis par une décharge d'une vingtaine de coups de fusil qui nous tuèrent deux hommes du 2ème de ligne et en blessèrent quatre.
Heureusement que j'étais à ce moment dans un fond avec mon escorte et défilé par un massif de broussailles. J'ordonnai à la section de grenadiers de s'abriter et à mon escorte de ne pas bouger.
Immédiatement je fis dire à M. le colonel Butafoco qui était en tête de la colonne de précipiter le pas, mais au lieu de suivre la crête, il s'était enfoncé dans la gorge et avait entièrement disparu, s'exposant ainsi aux coups des Arabes qui couronnaient toutes les crêtes. Je me trouvais donc isolé des troupes et si les ennemis avaient eu l'intelligence de saisir le moment, ils nous enlevaient.
Le colonel Gouyon, voyant la position fâcheuse dans laquelle l'éloignement de la colonne nous mettait, ne perdit pas une minute et descendant les pentes rapides du Djebel Drah, il arriva au moment où la droite du 61ème débouchait de la gorge. Il cria de loin que leur colonel était en danger. A ce cri, le commandant Gourgas, qui était en tête, donna l'élan et les deux bataillons gravirent avec ardeur la montagne. Ils arrivèrent tout essoufflés à l'endroit où le hasard nous avait placés. Immédiatement, nous nous élançâmes sur la redoute qui fut emportée.
Le 22, nouvelle aventure. Le lieutenant-général marche directement par l'oued Abdi, tandis qu'Herbillon est envoyé en flanc-garde :
On voyait les Arabes assis sur les cimes, leur fusil entre les jambes. Ils attendaient probablement que nous fussions entrés dans le défilé par où passait le seul chemin nous ramenant dans la vallée de l'oued Abdi. Je devais y rejoindre la colonne du lieutenant-général. Le défilé était dominé à droite par des rochers à pic, à gauche nous avions un torrent. Il n'y avait de place que pour un mulet.
Le sentier était rocailleux, glissant et surtout de grosses pierres formaient escaliers. Le passage était périlleux et je redoutais avec raison d'y être attaqué. Des cailloux lancés auraient suffi pour nous écraser.
Heureusement, un marabout, craignant de voir les villages incendiés vint à notre rencontre. Il portait un drapeau. Je saisis cette circonstance pour me servir de lui.
Je lui promis que les villages seraient respectés, mais étant données les intentions hostiles de ses coreligionnaires, je lui donnai l'ordre de marcher devant mon cheval, drapeau déployé, en lui disant qu'au premier coup de fusil tiré par les Arabes, sa tête tomberait.
Ces dispositions prises, j'entrai dans le défilé. Aussitôt que les Arabes faisaient le moindre mouvement, le marabout effrayé faisait immédiatement signe de ne pas tirer. Nous pûmes ainsi passer sans encombre.
Le vendredi 30 mai, je fus chargé de l'organisation du caïdat du centre de l'Aurès et quand le général Bedeau regagna Constantine, le 20 juillet, je restai sur place pour mettre de l'ordre et de l'entente parmi les tribus nouvellement soumises et assurer le paiement des contributions. Je rentrai à Batna le 28 juin 1845.
Pendant cette longue course dans les Aurès, j'eus soin de prendre note exacte, autant que possible, de toutes les tribus, fractions de tribus, noms de cheiks et des grands et, à mon retour à Batna, j'organisai tout ce pays. Le projet fut maintenu et approuvé par le général commandant la province, après examen du gouverneur général.
Il était de la plus haute importance de soumettre le massif de montagnes (Djebel Aurès) qui sépare en partie le Tell du Sahara et qui servait de refuge aux mécontents, entre autres les serviteurs dévoués du bey Hamed. La difficulté du pays, le caractère des habitants, l'isolement dans lequel ils vivaient, leurs décherahs qui, construits sur des rochers paraissent de véritables redoutes, tout faisait présumer que la résistance serait tenace. Il n'en fut rien, les montagnards n'ont tenu nulle part, ne s'entendant pas et craignant d'être incendiés, ils attendaient presque toujours que les colonnes s'avançassent pour venir implorer et se soumettre. Il n'y eut par conséquent aucun rassemblement nombreux. Certes, s'ils avaient été portés à se défendre, ils auraient eu toute facilité. Ravins profonds, défilés étroits et brisés, réduits souvent au lit d'une rivière, rochers inaccessibles et, de plus, pays totalement inconnu.
Il fallait à chaque instant étudier le terrain et souvent, malgré la plus grande prudence, on se trouvait dominé de tous côtés. On cheminait donc au hasard et pourtant aucun incident fâcheux n'est arrivé.
Cette expédition ne peut être considérée comme un fait de guerre difficile, mais comme le prélude de la soumission d'une race industrieuse, de l'occupation d'un pays dont les habitants sédentaires sont cultivateurs (en arbres fruitiers surtout). De plus, comme les tribus du Sud de ce pays aurésien sont en relations d'affaires continuelles avec les populations des oasis sahariennes, il était de bonne politique de relier les contrées en une seule sous une même autorité.
Une nouvelle distinction honorifique vient récompenser Herbillon des services rendus par lui dans l'Aurès, et le Roi, par ordonnance du 20 août 1845, l'élève à la dignité de commandeur de la Légion d'honneur.
Sans parler des razzias qui sont le résultat des courses faites autour du centre du Cercle pour châtier un crime, réprimer un commencement de révolte et qui s'échelonnent sur tout le cours de l'année, nous avons encore à noter avant la fin de l'année 1845, une expédition dirigée par le général Levasseur, commandant par intérim la province de Constantine et dont fait partie Herbillon.
De l'année 1846 il nous reste peu de choses ; le Moniteur du 27 août nous apprend seulement que : Toute la province de Constantine est dans la plus grande tranquillité. Le colonel Herbillon, commandant du Cercle de Batna, s'est établi sur les pentes de l'Aurès pour faire rentrer les impôts, opération qui se fait sans la moindre résistance.
Les cadres du 61ème sont appelés à rentrer en France.
Des pourparlers s'engagent à ce sujet entre le lieutenant-général Bedeau et le colonel Herbillon, pour que ce dernier reste à son poste. Une lettre du 14 septembre nous met au courant de la situation :
Constantine, le 14 septembre 1846.
Mon cher Colonel,
Je suis bien aujourd'hui, après avoir eu quelques accès de fièvre, et je me hâte de vous écrire pour vous dire que vous ne suivrez pas votre régiment, ou plutôt les cadres du 61ème qui vont successivement rentrer en France.
Je puis vous conserver par urgence. Le gouverneur sanctionnera, mais il serait mieux que vous pussiez trouver un permutant. J'ignore si déjà vous avez fait quelques démarches éventuelles. Voulez-vous que j'en fasse essayer près du colonel du 43ème de ligne ?
Répondez-moi, je vous prie, sans plus attendre, afin que nous n'ayons pas trop à débattre votre maintien. Nous le débattrions fort et ferme, s'il le fallait, mais mieux vaut se régler sans embarras.
Pressez autant que vous pourrez l'établissement des pièces que je vous ai fait demander pour l'État-major et envoyez-moi le plus tôt possible aussi le bataillon et la compagnie destinés au 43ème de ligne.
Recevez l'assurance de mon sincère attachement.
Le Lieutenant-Général, BEDEAU.
Encore une fois, le désir exprimé dans cette missive se trouvait réalisé avant que la lettre même fût écrite, puisque le 2 septembre, une décision royale affectait Herbillon au 38ème de ligne en résidence à Alger par permutation avec M. Berghoune.
Le nouveau colonel du 38ème ne rejoint d'ailleurs pas son poste. Il continue de commander à Batna. La haute protection du duc d'Aumale ne lui fait pas défaut. C'est à lui qu'il doit sa nomination au grade de maréchal de camp. Herbillon en évoque le souvenir en quelques mots :
Le Prince royal sut se rappeler les services que j'avais rendus et au mois de novembre 1846, au mariage du duc de Montpensier son frère, il me fit nommer maréchal de camp.
Cette nomination vaut à Herbillon de nombreuses lettres de félicitations, parmi lesquelles nous trouvons celles du colonel Jamin, aide de camp au nom du duc d'Aumale, du lieutenant-général Bedeau, du général Vaillant.
Paris, le 5 novembre 1846.
Mon Général,
S. A. R. Monseigneur le Duc d'Aumale me charge de lui servir d'interprète auprès de vous et de vous adresser ses compliments sur votre nomination au grade de maréchal de camp qui a été signée ces jours derniers.
Permettez-moi, mon Général, de vous prier d'agréer aussi mes félicitations les plus sincères et l'assurance de mes sentiments tout dévoués.
Lieutenant-Colonel V. JAMIN.
Mon cher Général,
Je suis bien heureux de pouvoir vous nommer ainsi, et cependant, n'ayant rien reçu d'officiel, je me serais abstenu de vous écrire aujourd'hui, si de nombreux avis très positifs n'avaient ici précédé l'officialité.
Soyez heureux de cette nomination et ayez surtout la bien agréable certitude qu'elle recevra le témoignage d'un assentiment unanime.
Vos services dévoués, intelligents et continus reçoivent ainsi une bien honorable et éclatante récompense. Vous fournissez un exemple de plus à ceux qui pensent que, malgré qu'on dise de notre époque, le meilleur chemin pour arriver sûrement est encore celui de la modestie, du travail et de la probité.
J'ajoute que je suis doublement satisfait de votre avancement parce que dans un moment où nous sommes obligés de lutter contre l'opinion de ceux qui disent qu'on ne doit rien attendre de la race indigène, c'est beaucoup qu'une distinction donnée à un des officiers qui depuis quelques années ont constamment réussi à prouver que pour obtenir des indigènes, il fallait se dévouer à eux, mais qu'en se dévouant ainsi on obtenait toujours de merveilleux résultats. C'est beaucoup enfin, pour notre politique dans ce pays que l'avancement successif donné aux chefs qui ont fait le plus de bien à la race indigène.
Je ne sais pas ce que vous a dit le colonel Jamin dont j'ai reconnu l'écriture.
Toutefois, puisqu'il s'est chargé de vous donner la nouvelle, vous pourrez écrire sans retard au duc d'Aumale. Adressez-lui vos remerciements respectueux et sincères, car c'est à lui que vous devez votre avancement que je n'espérais pas aussi prochain.
Quand j'aurai reçu l'avis officiel d'Alger, je vous dirai les paroles du Maréchal qui sans doute aussi aura appuyé vivement la bienveillance du prince.
Vous resterez sûrement dans la province, mais je ne puis rien dire quant à la destination, si ce n'est que sûrement je ferai tout ce qui dépendra de moi pour vous maintenir au moins quelques mois à Batna, tout en vous donnant le commandement d'une subdivision.
Croyez à mon attachement bien sincère.
11 novembre 1846. Le Lieutenant-Général, BEDEAU.
Mostaganem, le 20 novembre 1846.
Mon cher Général,
A mon arrivée à Mostaganem, j'apprends votre nomination au grade de maréchal de camp et je ne veux pas différer à vous dire qu'elle me cause un vrai plaisir. Je suis heureux de voir que mes souhaits ont si peu tardé à être exaucés. Ce qui ajoute à ma satisfaction, c'est la manière dont votre nomination est accueillie par tout le monde; toutes ne sont pas reçues ainsi. Permettez-moi en vous faisant mon compliment, de me dire votre
Bien dévoué serviteur. Général VAILLANT.
Laissez-moi aussi vous remercier une fois de plus de l'hospitalité si cordiale que vous m'avez accordée.
En lui envoyant sa lettre de service, le général Bedeau, Dans un post-scriptum de sa main, ajoutait :
P. S. - Je dois croire que vous serez appelé au commandement de la subdivision de Constantine dont le chef-lieu paraît devoir être prochainement fixé à Batna, mais ce n'est qu'un projet qu'il faut garder pour vous.
Cette nouvelle est confirmée par le Moniteur du 7 janvier 1847, qui annonce que le maréchal de camp Herbillon reçoit le commandement de la subdivision de Constantine en remplacement de M. le général Noël qui rentre en France. M. le général Herbillon séjournera jusqu'à nouvel ordre à Batna où il a été détaché par M. le général Bedeau.
Le Cercle de Batna n'est donc pas encore privé de la direction de son chef et organisateur. Herbillon ne le quittera que pour prendre le commandement supérieur de la province de Constantine qu'il a suffisamment parcourue pour être à même d'en diriger efficacement les travaux. C'est la fin de sa résidence à Batna que nous allons étudier maintenant.
A SUIVRE
|
|
23 SEPTEMBRE 1940…
Par M.José CASTANO,
|
L’AGRESSION BRITANNIQUE
SUR DAKAR
« L’empire, sans la France ce n’est rien. La France sans l’empire, ce n’est rien » (Amiral Darlan – Novembre 1942 )
Après avoir été donné à la France par le traité de Paris, le 30 mai 1814, Dakar devint, en 1904, la capitale de l’Afrique Occidentale Française (AOF). Située à l’extrémité occidentale de l’Afrique, elle occupait, en 1940, une position stratégique considérable qui faisait bien des envieux. Au point de séparation de l’Atlantique Nord et Sud, en avancée face à l’Amérique Latine, sur le chemin entre l’Afrique du Sud et l’Europe, Dakar intéressait tout le monde et en premier lieu les Britanniques qui, sur le chemin traditionnel de l’Afrique australe et de l’Asie par le Cap, retrouvaient là l’un des enjeux de leurs rivalités coloniales avec la France et voulaient profiter de son écrasement.
En septembre 1940, le Maréchal Pétain avait confié au général Weygand la délégation générale du gouvernement en Afrique et le commandement en chef des troupes. Ainsi se trouvait affirmée la volonté de défendre l’Afrique mais aussi de préparer les moyens de la revanche.
Le 31 Août 1940, soit près de deux mois après la lâche agression commise par ces mêmes britanniques sur la flotte française au mouillage et désarmée, dans le port de Mers El-Kébir (Algérie) et près d’un mois après l’entretien Churchill – De Gaulle (6 août 1940) sur les modalités d’une éventuelle attaque contre les forces françaises stationnées au Sénégal et demeurées fidèles au Maréchal Pétain, la force navale M (M comme « Menace ») britannique où se trouvait de Gaulle quitta les ports britanniques pour Freetown en Sierra Leone qu’elle atteignit le 16 Septembre.
Cette expédition reposait sur deux principes et deux ambitions :
- Churchill espérait mettre la main sur l’or de la Banque de France et des banques nationales belges et polonaises, représentant plus de 1000 tonnes d’or… et sur le cuirassé Richelieu, redoutable par sa puissance de feu (bien que son armement ne fût pas terminé), fleuron de la flotte française.
- De Gaulle désirait s’imposer comme le chef suprême de l’empire français en guerre… empire d’importance que le gouvernement de Vichy tenait, par ailleurs, à défendre ardemment.
Partie de Freetown le 21 septembre, la force M se présenta devant Dakar le 23 à l’aube. A 6 heures, un message de De Gaulle était adressé à la garnison en lui demandant de se rendre… sans effet. Sa seule présence qu’il espérait suffisante, ne provoqua pas à son grand dam les ralliements escomptés… le traumatisme de Mers El-Kébir était trop vif. Le gouverneur général de l'A.O.F., Pierre Boisson, commandant la Place, résolument rangé derrière Pétain, refusa catégoriquement de se rallier, affirmant sa volonté de défendre Dakar « jusqu'au bout » La décision de De Gaulle ne se fit pas attendre : Il fallait débarquer ! Une première tentative de débarquement se solda par un fiasco suivie de deux autres qui subirent le même sort. Une tentative de persuasion politique échoua et Thierry d’Argenlieu, arrivé par mer pour parlementer avec un drapeau blanc, fut accueilli par un tir de mitrailleuse qui le blessa mais son embarcation parvint à s'échapper. Il en résultait que de l’avis de De Gaulle et de l’amiral Cunningham, le patron de la flotte anglaise, la résistance allait être farouche…
En effet, face à l’armada britannique qui se préparait au combat, la France disposait, cette fois, de solides moyens navals ainsi qu’une sérieuse défense côtière. On en n’était plus aux conditions dramatiques de Mers El-Kebir où la flotte désarmée avait été littéralement assassinée ; cette fois, les marins français étaient prêts au combat et animés, de surcroît, d’un esprit de revanche parfaitement perceptible… et compréhensible. Avant la tragédie de Mers El-Kébir, la flotte française était la 4ème plus puissante flotte du monde ; elle était décidée à le prouver et cela d’autant plus qu’elle n’avait jamais été vaincue…
Sur cette résistance, De Gaulle écrira dans ses mémoires : « Décidément, l’affaire était manquée ! Non seulement le débarquement n’était pas possible, mais encore il suffirait de quelques coups de canons, tirés par les croiseurs de Vichy, pour envoyer par le fond toute l’expédition française libre. Je décidai de regagner le large, ce qui se fit sans nouvel incident. »
Ainsi se passa la première journée, celle du 23 septembre.
Dans la nuit du 23 au 24 septembre, plusieurs télégrammes furent échangés entre l’amiral Cunningham et Churchill, décidé à poursuivre l’affaire jusqu’à son terme : « Que rien ne vous arrête ! » Dans cette même nuit, un ultimatum anglais fut adressé aux autorités françaises de Dakar leur enjoignant de livrer la place au général De Gaulle. Le texte était fort maladroit et accusait les forces de Dakar de vouloir livrer leurs moyens aux Allemands. Il ne pouvait que provoquer l’indignation des défenseurs et ne recevoir d’autres réponses que le refus. Le gouverneur général Boisson, se remémorant la mise en garde que Georges Clemenceau adressa, le 9 août 1926, au président américain Coolidge : « La France n’est pas à vendre, même à ses amis. Nous l’avons reçue indépendante, indépendante nous la laisserons ! ».
Et Boisson de répondre avec fermeté : « La France m’a confié Dakar. Je défendrai Dakar jusqu’au bout ! ».
Depuis la tragédie de Mers El-Kebir, Vichy avait décidé de défendre fermement cette position stratégique française et avait envoyé à cet effet, de Casablanca, des bombardiers, des chasseurs et des croiseurs. Il y avait là : Un cuirassé (Richelieu), deux croiseurs légers, quatre contre torpilleur, trois destroyers, six avisos, cinq croiseurs auxiliaires, trois cargos et trois sous-marins. Par ailleurs, la force de frappe aérienne n’était pas négligeable… et elle allait le prouver.
Du côté anglais, la flotte était tout aussi impressionnante : Un porte avions (Ark Royal qui avait déjà opéré à Mers El-Kebir), deux cuirassés, trois croiseurs lourds, deux croiseurs légers, dix destroyers, deux dragueurs de mines et une dizaine de navires transports de troupes portant 4200 soldats –dont la fameuse 101ème brigade des Royal Marines… à laquelle s’ajoutait l’armée gaulliste composée de trois avisos, un patrouilleur, quatre cargos et 2700 soldats français.
Toute la journée du 24 se passa en échanges de coups d’artillerie de marine entre les deux flottes qui firent de nombreuses victimes parmi les marins des deux camps et la population civile qui subit également ce pilonnage. Des obus anglais de gros calibre (380m/m) tombèrent sur la ville, touchant, entre autres, l’hôpital et la caserne du 6° RAC, faisant 27 morts et 45 blessés. En soirée, la situation n’avait guère évolué…
Le lendemain, 25 septembre, la ténacité britannique continua. Les navires de la force M voulurent de nouveau s’approcher afin de poursuivre leur œuvre de destruction, mais, comme précédemment, ils durent se frotter aux bâtiments français (Vichystes, diront les gaullistes !) qui leur infligèrent de sérieux dégâts et cela d’autant plus que l’aviation française était maîtresse du ciel.
C’en était trop ! De Gaulle écrira : « L’amiral Cunningham décida d’arrêter les frais. Je ne pouvais que m’en accommoder. Nous mîmes le cap sur Freetown. »
L’armée française sortait vainqueur de la bataille en dépit de ses 203 morts et 393 blessés. Les 1927 morts de Mers-El-Kébir étaient en partie vengés.
Cette opération constitua un tournant idéologique pour les gouvernements, bien plus qu'un affrontement important du point de vue des forces en présence, du nombre des victimes ou des pièces militaires détruites ou endommagées. L’aventure anglo-gaulliste se solda ainsi par un cuisant échec et eut des conséquences considérables.
- D’un côté, le régime de Vichy sortait renforcé de l’épreuve et la cohésion des troupes de la marine –toujours invaincue- autour de la personne du Maréchal Pétain, revigorée.
- De l’autre, le crédit du général De Gaulle dégringolait en chute libre. L’homme se retrouvait isolé. Soudainement mis à l’écart, il fut politiquement menacé par l'amiral Muselier accusé à tort d'avoir été à l'origine des fuites qui empêchèrent le débarquement. Il ne s’en cacha pas dans ses mémoires : « A Londres, une tempête de colères, à Washington, un ouragan de sarcasmes, se déchaînèrent contre moi. Pour la presse américaine et beaucoup de journaux anglais, il fut aussitôt entendu que l’échec de la tentative était imputable à De Gaulle. » … « C’est lui, répétaient les échos, qui avait inventé cette absurde aventure, trompé les Britanniques par des renseignements fantaisistes sur la situation à Dakar, exigé par donquichottisme, que la place fût attaquée alors que les renforts envoyés par Darlan rendaient tout succès impossible… »
De son côté, Churchill, lui aussi, sortait de l’aventure en fâcheuse posture. Il dut subir les sarcasmes de la Chambre des Communes et fut à deux doigts d’être démissionné. S’il lui avait été facile de détruire, à Mers El-Kebir, une flotte désarmée (et pourtant alliée) causant la mort de 1927 marins, manifestement, avec Dakar ce fut tout autre et son désir de s’emparer de l’excellente et cohérente flotte française ou de la détruire se solda par un échec retentissant.
N.B : - Concernant la tragédie de Mers El-Kebir (3 juillet 1940), certains ont cru bon de justifier l’agression britannique par le fait que nos bâtiments seraient, inéluctablement, tombés entre les mains des Allemands. Je rappelle ce que j’écrivais à ce propos sur cette agression :
« L’armistice franco-allemand du 25 juin 1940 consacre l’échec de nos armées sur terre ; notre flotte, une des plus puissantes -qui n’avait pas été vaincue- est libre. Ni l’amiral Darlan, ni le général Weygand n’ont l’intention « …de livrer à l’ennemi une unité quelconque de notre flotte de guerre » et De Gaulle le dira, le 16 juin à Churchill en ces termes « La flotte ne sera jamais livrée, d’ailleurs, c’est le fief de Darlan ; un féodal ne livre pas son fief. Pétain lui-même n’y consentirait pas ».
Les Anglais, de leur côté, désirent que notre flotte, riche en unités lourdes et légères, se rende dans leurs ports. Elle aurait pu le faire, le 16 juin 1940, mais personne ne lui en donne l’ordre et la Marine reçoit l’assurance, « qu’en aucun cas, la flotte ne sera livrée intacte », mais qu’elle se repliera probablement en Afrique ou sera coulée précise l’Amiral Darlan. Hitler ne demande pas livraison de notre flotte (le projet d’armistice ne le prévoyant d’ailleurs pas), pas plus que de nos colonies, sachant qu’il n’est pas dans nos intentions d’accepter de telles exigences. »
Cet épisode sur Dakar confirme la justesse de mes propos car si la France métropolitaine était vaincue, l’Empire ne considérait nullement l’être. Si la France métropolitaine avait capitulé, l’Empire s’y était refusé et la marine française (ce qu’il en restait), comme elle s’y était engagée, avait rejoint les ports africains composant l’Empire afin de poursuivre le combat.
- Les alliés ayant débarqué le 8 Novembre 1942 en Afrique du Nord (opération « Torch »), les autorités Vichystes d’AOF, convaincues par l’amiral Darlan, signèrent le 7 décembre 1942, un accord avec les alliés, qui remit l’empire colonial français dans la guerre en formant « l’Armée d’Afrique » dans laquelle firent merveille les « tirailleurs sénégalais ». Lors de la constitution du Comité Français de la Libération nationale (CFLN), le gouverneur général Boisson démissionnera et sera remplacé le 1er juillet 1943 par le gaulliste Pierre Cournarie.
- Le Richelieu appareilla pour les Etats-Unis où son armement fut modernisé. Il participa au côté des Alliés à la guerre contre l’Allemagne puis, dans le Pacifique, à celle contre les Japonais. Il fut présent à la capitulation japonaise en rade de Singapour.
Le 1er Octobre 1945, il fut de retour à Toulon après 52 mois passés loin de la Métropole. Il participa à la guerre d’Indochine puis fut mis en réserve en août 1959, désarmé en 1967 et démoli en 1968.
« « L'âme de nos marins plane sur l'Océan, je l'ai vue ce matin, sous l'aile d'un goéland » » (Freddie Breizirland)
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
|
|
Une petite astuce de femme,
Envoyé par Hugues
|
Deux amies vont au restaurant.
En arrivant, elles voient le restaurant complètement plein.Pas de places.
La majorité des tables étaient occupées par des couples.
Une des deux femmes prend son téléphone portable et fait un appel à voix haute au milieu du restaurant en regardant les couples assis...
"Bonjour ma chérie. Je suis arrivée au restau et ton mari est ici, avec une autre femme. Viens de suite..."
Cinq hommes quittent précipitamment le restaurant et partent en courant .
Résultat : cinq tables libérées immédiatement.
|
|
EDITO du Général Antoine MARTINEZ
Envoyé par Mme Saurel.
|
Quand l’État cherche à faire taire les patriotes
Alors que le président de la République comptait sur les vacances pour étouffer ce qu'on appelle l'affaire Benalla – véritable scandale d'Etat qui l'éclabousse – il va bien falloir y revenir car elle a mis en évidence non seulement un dysfonctionnement des services de l'Elysée mais l'existence, dans le cercle le plus proche du président, d'un fonctionnement plutôt occulte, voire clandestin dans le domaine d'affaires liées à la sécurité de l'Etat et à la lutte contre le terrorisme. La journaliste du quotidien Le Monde qui a mené une enquête et révélé cette affaire l'indique clairement « Tout d'un coup, nous nous rendons compte qu'Emmanuel Macron dirige la France de manière assez opaque. On ne connaît pas exactement ces collaborateurs et pourtant, ils s'occupent de sujets aussi importants que la sécurité ou le terrorisme. Il y a un évident problème de transparence ». L'incident du 1er mai dans lequel s'est illustré ce très proche « collaborateur » n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg qui pourrait révéler un dérèglement dans le fonctionnement républicain de la présidence qui, avec sa « petite équipe », dirige « de façon assez opaque » le pays. Il ne faut d'ailleurs pas oublier les conditions dans lesquelles le président est arrivé au pouvoir il y a une quinzaine de mois, grâce à un hold-up démocratique permis par un coup d’État institutionnel qui a éliminé le candidat de la droite classique promis à la victoire. Par ailleurs, quand il a choisi de s'exprimer, tardivement, sur ce scandale Benalla, et en quels termes (!), ne l'a-t-il pas fait en chef de clan devant ses partisans, dévalorisant ainsi la fonction de président de la République, jetant le doute sur son sens des responsabilités et créant le risque de ne plus être légitime pour une partie des Français ? S'ajoute à ce qui précède la mise en évidence d'une inquiétude majeure du fait que le président, de surcroît chef des armées, accordait toute sa confiance à ce très proche « collaborateur », curieusement habilité secret défense. N'a-t-il pas pris un risque inconsidéré en ignorant qu'il peut être une cible pour des services étrangers ?
En tout cas, depuis son arrivée au pouvoir, un certain nombre d'événements ou de réactions tendent à démontrer son mépris pour les voix discordantes, voire son agressivité à l'égard des voix dérangeantes, et sa volonté de faire taire ceux qui veulent que la France reste la France ou que la France redevienne la France. Et dans cette entreprise de démolition de notre identité et donc de l'unité de la nation, une collaboration de circonstance pourrait avoir été imaginée et téléguidée par cette « petite équipe » entre des services de l’État, des officines et certains médias connus pour leur détestation des Français attachés à leur identité.
Sans revenir sur les circonstances de la démission du dérangeant général de Villiers, chef d'état-major des armées, il y a tout juste un an, à la suite d'une fuite dans la presse des propos tenus devant les parlementaires, il faut mentionner le limogeage, le 30 juin dernier, de Eric Fournier, non moins dérangeant ambassadeur de France en Hongrie, pour avoir dénoncé dans une note interne la «magyarophobie» des médias français et anglo-saxons et avoir estimé que la Hongrie est «un modèle, ayant su anticiper les problèmes posés par les mouvements migratoires illégaux». Il accusait, en outre, la presse de détourner l’attention du «véritable antisémitisme moderne», celui des «musulmans de France et d’Allemagne» et défendait l’héritage chrétien de la Hongrie. Autant de propos contraires au discours officiel plutôt immigrationniste et multiculturaliste franchement orienté vers l'islam. Ce télégramme diplomatique (TD) était envoyé le 18 juin au Quai d'Orsay (ministère des Affaires étrangères). Comme tout TD, il est confidentiel et transite par un système de cryptage hautement sécurisé. Mais il fallait justifier et donner une publicité à la sanction de l'ambassadeur qui s'était écarté de la ligne officielle. Alors, comment a-t-il pu être rendu publique par Mediapart ?
Deux explications et seulement deux sont concevables : il a été communiqué illégalement, soit par le ministère des Affaires étrangères, soit par l'Elysée. Une pratique non seulement perverse quant au choix du média mais révélatrice de la volonté d'imposer le silence à ceux qui s'opposent à la « transformation » en marche de la société sur le plan ethno-culturel et dénonciatrice de la collusion délibérée entre des services de l’État et des médias spécialistes de la délation acquis à cette « transformation » par l'immigration de peuplement. On le constate, la technique, toujours la même, a été rapidement rodée : on décide de neutraliser celui ou ceux qui ont été ciblés car ils dérangent, mais en prenant soin de le faire après les fuites organisées ou les informations préparées et publiées par un média manipulé ou pouvant avoir, en fonction des cas, le même objectif que le pouvoir.
C'est bien ce qui se produit dans un autre registre aussi dérangeant pour le pouvoir, avec la mouvance patriote, cette lèpre qui monte, car elle défend l'identité de la France et s'oppose à l'invasion migratoire et à l'islamisation du pays. Dans cette mouvance, les Volontaires Pour la France (VPF) semblent particulièrement ciblés. Et si cette « petite équipe » à laquelle appartenait M. Benalla s'occupait d'affaires de terrorisme, on peut penser qu'il ne s'agissait pas du terrorisme islamiste mais du terrorisme patriote fantasmé par nos dirigeants qui doivent en rêver et cherchent, en collaborant avec ce média servile et délateur, à en accréditer l'existence en préparant un scénario en lieu et place des VPF.
L'objectif est évident : tenter, en instrumentalisant la police et la Justice, de neutraliser ses dirigeants dont la voix discordante est devenue dérangeante pour le pouvoir. C'est pourquoi l'affaire Benalla (non pas l'incident du 1er mai, mais ce que pourrait révéler l'enquête sur la personnalité de l'individu et sur les activités de cette « petite équipe ») et l'affaire des arrestations opérées le 23 juin dernier dans la mouvance qualifiée par certains d'ultra-droite pourraient être liées. L'annexe jointe déroule une chronologie factuelle dont l'analyse permet de conclure à l'existence probable d'une collusion organisée et téléguidée entre des services de l’État et un média, Mediapart, dont l'objectif est de neutraliser la mouvance dite patriote et ses dirigeants. Elle est d'autant plus probable que des services sont aujourd'hui noyautés par des adeptes du système islamique et que Mediapart fait de la délation et de la lutte contre les patriotes qui s'opposent à l'islam une priorité. Il sera donc difficile de démentir cette collusion, cette collaboration entre la DGSI et Mediapart car certaines informations publiées par ce média ne peuvent être connues que de la DGSI. Par ailleurs, avec les pratiques plutôt occultes dénoncées par la journaliste du Monde, on ne peut que condamner la vilenie de ces collabos qui, après les arrestations des dix personnes de l'AFO (quelles sont les vraies raisons de ces arrestations ?) et l'interrogatoire subi pendant leur garde à vue, essaient plusieurs scénarii, notamment celui de provoquer la « guerre » entre mouvements patriotes afin qu'ils se neutralisent mutuellement. Pour déconsidérer les VPF et ses dirigeants, le journaliste Matthieu Suc de Mediapart n'hésite pas à déclarer (il est cité dans un article dont l'auteur est un sympathisant de l'AFO) que « la DGSI a contacté le général Martinez en 2017 pour lui demander de se calmer dans le recrutement » (sic) On ne peut que relever des pratiques qui sont celles des barbouzes, y compris chez certains « journalistes », orientés ou manipulés par la DGSI ou ceux qui donnent les ordres. Aucune bassesse ne les arrête. Ils sont complètement discrédités par de telles méthodes.
On le constate, la République inaltérable combat aujourd'hui les Français qui veulent défendre leur héritage historique, spirituel et culturel ainsi que le droit des peuples à la différence contre une vision immigrationniste et multiculturaliste. Cette dernière est, en fait, une véritable imposture devenue sanglante, chaque jour qui passe nous le démontre. Et cette République, qui n'a rien d'exemplaire car ceux qui la dirigent s'en servent en ignorant totalement la France, cherche à faire taire ceux qui précisément veulent qu'elle reste fidèle à son âme. Les patriotes, pour leur part, qui aiment avant tout la France, ne renonceront pas à leur combat malgré les menaces et les coups tordus alors que nous célébrons jusqu'à la fin de l'année le Centenaire de la Grande guerre. Nos anciens ont donné leur vie pour notre liberté et non pas pour que le peuple français soit aujourd'hui asservi, sur son propre sol, par d'autres peuples guidés par une culture ennemie de la sienne.
Général (2s) Antoine MARTINEZ
Coprésident des Volontaires Pour la France
Annexe
1. La présidence des VPF, jeune organisation patriote, confie sa présidence en juillet 2016 à un ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ancien député et à un général en 2ème section. Ce dernier se fait remarquer par une lettre ouverte au président de la République, le 23 décembre 2014, ce qui lui vaut d'être « suivi » depuis ce moment-là. En février 2016, en pleine crise migratoire, il participe, à Rungis, aux journées européennes contre l'islamisation et l'invasion migratoire. Un autre général, Christian Piquemal, est, lui, arrêté à Calais où la manifestation est interdite. Circonstances aggravantes pour le futur coprésident des VPF, il prend la défense du général Piquemal et signe, avec deux autres généraux et avec celui qui assure aujourd'hui avec lui la présidence des VPF, une lettre ouverte au président de la République. Il est alors menacé de sanctions pour avoir critiqué le gouvernement dans la gestion de la crise migratoire à Calais et pour s'être écarté de son devoir de réserve. Quelques mois plus tard, il crée le comité de soutien au général Piquemal, après la radiation de ce dernier du cadre des généraux en 2ème section décidée par le président Hollande, obtenant la signature d'une cinquantaine de généraux et amiraux en 2ème section et signe, en septembre 2017, avec dix autres généraux, une tribune consacrée à la menace qui pèse sur la liberté d'expression des militaires. Ces précisions semblent importantes et nécessaires pour expliquer la suite de la chronologie et fournir un éclairage particulier sur le déroulement des événements.
2. Le 12 octobre 2017, au cours d'une réunion régionale des VPF et à la suite d'un désaccord entre certains membres, la présidence des VPF signe un communiqué à destination de ses représentants régionaux et délégués départementaux chargés d'informer leurs membres. Ce communiqué rappelle les objectifs suivis par les VPF, le fonctionnement et les règles à respecter et officialise l'exclusion et la rupture avec deux de ses membres qui appartiennent au comité directeur et qui, de plus, ont créé une autre structure dénommée AFO (Action des forces opérationnelles).
3. Le 9 novembre 2017, la secrétaire générale de l'association Vigilance halal, association qui dénonce l'abattage halal et ses conséquences sur les consommateurs sur le plan sanitaire, a la désagréable surprise de voir avec son mari, à 06h00 du matin, la porte de sa maison enfoncée par 14 policiers armés et cagoulés. Elle subit un interrogatoire sur place qui se poursuit par une garde à vue d'une douzaine d'heures. On lui reproche notamment son « activisme politique » car elle active de nombreux réseaux numériques patriotes et pratique le tir sportif. La cause défendue par l'association Vigilance halal dérange manifestement l’État car elle rattache fort justement le halal à la charia (loi islamique) qui est un vecteur majeur de l'islamisation de notre société. Par ailleurs, au cours de son interrogatoire, elle est questionnée sur les VPF et sur le général Martinez, son coprésident.
4. Le 9 avril 2018, un premier article est publié par Mediapart. Intitulé « Forces de l'ordre liées à l'ultradroite violente : la DGSI s'inquiète », il n'est pas difficile de comprendre pour le lecteur un peu averti que quelque chose est en train de se tramer. Les mots ont, en effet, leur importance et « l'ultradroite violente » c'est très fort : ultra pouvant d'ailleurs être assimilé à jusqu'au-boutiste. Mais au fait, responsable de combien de morts jusqu'à présent ? Par ailleurs, si la DGSI s'inquiète c'est donc – il faut savoir lire entre les lignes – qu'elle suit l'affaire de près et qu'elle prépare une action. C'est bien le rôle de nos services de renseignement et de sécurité, anticiper. D'autre part, pour justifier le titre et l'alarmisme qui en découle, le média se réfère à une déclaration du directeur de la DGSI, non pas l'actuel, mais le précédent, Patrick Calvar, qui s'était exprimé il y a déjà deux ans, le 10 mai 2016, devant les députés de la commission de la Défense nationale. Selon lui, certains pourraient passer à l'action en répondant par des représailles sur les musulmans en cas de nouveaux attentats. Et il préconisait la surveillance et la répression de citoyens qui seraient susceptibles d'émettre des velléités d'action. Dans cet article très orienté qui mentionne de façon plutôt brouillonne un certain nombres de groupes ou groupuscules dont certains peuvent être violents mais qui n'ont manifestement pas grand chose à voir avec la mouvance patriote, Mediapart place les VPF au premier rang de la liste évoquée, en rappelant ses objectifs, la défense de l'identité française et la lutte contre l'islamisation du pays, et en présentant ses deux coprésidents.
En analysant bien ce premier article de Mediapart et en le resituant dans le contexte évoqué de cette « petite équipe » très active dans le cercle très proche du président de la République, on peut relever deux points qui font penser à une manipulation ou à une collaboration avec ce média. En premier lieu, Mediapart insiste sur l'origine de la création des VPF qui auraient été créés après les attentats du 13 novembre 2015, ce qui n'est pas exact. En fait, cette insistance, personnelle au média ou suggérée par la DGSI (qui reçoit des ordres), vise à faire croire que la motivation des VPF est, en réalité, de préparer des actions violentes pour venger les victimes des attentats. Cela permet, après avoir élaboré un scénario en lieu et place des VPF, d'instrumentaliser ensuite les services de police et la Justice en procédant par anticipation à d'éventuelles arrestations. En second lieu, il est très étrange que Mediapart n'ait pas fait état, dans son article, de l'AFO créée par deux membres des VPF exclus en octobre 2017. Mais cela n'était-il pas nécessaire et voulu, d'un commun accord DGSI/Mediapart pour ne pas éveiller l'attention des membres de ce mouvement dont une dizaine devaient être arrêtés le 23 juin dernier ? Et comme les coups tordus sont pléthores dans ces situations à la limite de l'illégalité, voire complètement illégales, ne cherche-t-on pas à neutraliser les VPF et ses dirigeants qui dérangent ? Le fait que Mediapart les placent au premier rang est une indication et dans ces conditions, l'arrestation des membres de l'AFO n'est-elle pas une attaque indirecte des VPF ?
5. Le 23 juin 2018, dix personnes soupçonnées de préparer des attentats anti-musulmans sont arrêtées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la section anti-terroriste du parquet.de Paris. Elles appartiennent selon les médias à l'AFO et deux d'entre elles sont les responsables de ce groupe. Il s'agit des deux personnes dont les VPF se sont séparées le 12 octobre 2017. Les médias indiquent qu'il s'agit d'une « structure clandestine et dissidente longtemps mise en sommeil et réactivée » (?) et ajoutent que l'enquête avait débuté en avril dernier. La date est à rapprocher du premier article de Mediapart du 9 avril 2018 (début avril également) : coïncidence improbable.
6. Le 25 juin 2018, Mediapart publie un second article juste après les arrestations dans les rangs de l'AFO et reste toujours autant, voire plus virulent et offensif contre les VPF. Le média persiste en s'appuyant sur une vision islamo-gauchiste qui lui est propre, usant de contre-vérités, fabriquant de fausses informations (fake news), se retranchant derrière la formule bien pratique « selon nos sources», ou en utilisant des informations connues de la seule DGSI. S'agissant de ces dernières, comment les a-t-il obtenues ? La DGSI les a-t-elle fournies de sa propre initiative, ou sur ordre ? De qui ? Cela confirme bien une collusion entre les services de l'Etat et un média acquis à la cause de la lutte contre ceux qui veulent défendre l'identité de la France et s'opposent à l'immigration extra-européenne de masse et à l'islamisation de la société. En tout cas, Mediapart persiste sur les motivations des VPF : «créés mi-2015, les VPF ont réellement été mis sur orbite au lendemain des attentats du 13 novembre ». Et pour s'en convaincre, il n'hésite pas à en justifier la cause : « l’un de ses membres fondateurs a perdu sa fille au Bataclan ». Cette information, évoquée par certains médias et concernant l'une des deux personnes de l'AFO exclues des VPF, a semble-t-il été démentie par le Parquet. Enfin, Mediapart fait croire que ses journalistes ont contacté les VPF au début du mois d'avril. En fait, la prise de contact s'est effectuée avec le secrétariat du mouvement qui, dans une réponse courte et de portée générale, fournissait les coordonnées téléphoniques d'un des deux coprésidents des VPF, en l'occurrence le général Martinez. Mais l'article était déjà rédigé et le coprésident des VPF n'a jamais été contacté. On notera le professionnalisme de journalistes qui s'autoproclament journalistes d'investigation mais qui n'en sont pas.
Antoine MARTINEZ
Officier général (2s)13/03/2018
|
|
INFO : ETAT PIED-NOIR
Par M. Jacques Villard
|
|
Note du Webmaster : Afin de couper court à toute polémique, je tiens à préciser que ceci est une information de l'Etat Pied-Noir.
Je ne fais parti d'aucune association, ni groupement ou similaire. Je tiens à ma neutralité afin de pouvoir informer et continuer mon travail de mémoire.
Même si je ne suis pas d'accord avec les couleurs de ce drapeau, par souci d'information je le présente sur la Seybouse. Chacun aura sa réflexion qu'il pourra transmettre, s'il le désire, à l'adresse mail en fin de message.
Merci de votre compréension, le Webmaster, J.P.B.
 Le Drapeau de l’Etat Pied-Noir
Le Drapeau de l’Etat Pied-Noir
Symbolique :
La Colombe de la Paix sur fond bleu nous renvoie à la devise de l’Etat : la Paix pour seul combat.
Les trois couleurs du Drapeau français rappellent notre amour de la France et notre attachement à la Francophonie.
Le Bleu de la mer évoque le support de notre arrivée en Afrique du Nord, de notre exil et de notre dispersion dans le Monde.
Le Blanc souligne notre engagement pacifique dans le monde et notre volonté de neutralité dans les conflits de ce monde.
Le Rouge marque, de manière indélébile, le sang versé et le sang reçu, les anciennes et les nouvelles générations de Pieds-Noirs.
Au milieu du blanc, le Soleil qui fit pousser le Peuple Pied-Noir et, au centre du soleil, ces Pieds-Noirs symboles de notre spécificité et de notre unité.
Les Trois Étoiles sont l’identification des contrées qui nous ont vus naître et prospérer : le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.
Historique :
Ce Drapeau est l’aboutissement d’une commande officielle effectuée le 22 juillet 2018 par l’Etat à Maître Jean-François Galéa, Médaille d’Or de la Société des Artistes Français, Ministre des Arts et des Lettres, Peintre Officiel de l’Etat, Président de la Commission de l’Identité Nationale. Des semaines de concertation avec un ensemble de créateurs pieds-noirs et de citoyens de notre Etat ont emporté cette représentation qui devient le seul drapeau officiel de l’Etat.
Le drapeau de l’Etat a été validé par le Conseil d’Etat réuni en cénacle le 8 septembre 2018 au Tholonet (Bouches du Rhône) sous la haute autorité de Maître John Henry Bennett, Président du Conseil d’Etat et en présence des personnalités suivantes (présentes ou représentées) :
M. Jacques Villard, Chef de l’Etat Pied-Noir, Président de la Fédération des Deux-Rives,
M. René Pico, Président de l’Assemblée Nationale,
Maître Jean -François Galéa, Ministre des Arts et des Lettres, Peintre officiel de l’Etat
M. Jean-Claude Intartaglia, Ministre de la Maîtrise de l’Energie et des Energies Renouvelables
M. Jean-Claude Lozano, Directeur Général des Services et des Etudes du SERES
Me Anne Laure Joly, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale, Députée de Paris
M. Pierre Laborda, Ministre des Affaires Etrangères et des Relations Européennes
Me Maryse Gillmann, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Députée de Lyon
M. Philippe Ruiz, Ministre du Bâtiment et des Travaux Publics
M. Michel Cau, Ministre du Renseignement et de la Sécurité
M. Warren Laborda, Ambassadeur Extraordinaire pour l’Amérique du Nord, ayant rang de Ministre
M. Claude de Bailleul, Secrétaire d’Etat à l’Emploi
M. Jean-Claude Marszalek, Vice-président de la commission CRATER représentant le Chef de l’Etat
Me Edwige Marszaleck, Assemblée Nationale, Députée de l’Hérault
Me Claudine Laborda, Assemblée Nationale, Députée des Alpes de Haute Provence
M. Guy Epaud, Président de la Commission CRATER
M. Alex Petit, Architecte officiel de l’Etat
Me Annick Massey, Collaboratrice du Président du Conseil d’Etat
Me Isabelle Galéa, Assistante du Président de la Commission de l’Identité Nationale Pied-Noir
Me Monique Sendra, Secrétariat du Cabinet du Conseil d’Etat et du Cabinet du Chef de l’Etat
M. Paul Casagrande (représenté), Ambassadeur Extraordinaire pour l’Italie, Consul Honoraire de la Sardaigne, ayant rang de Ministre
M. Gérard Darmon (représenté), Ministre de la Jeunesse et des Sports
M. Christian Pique (représenté), Ambassadeur Extraordinaire pour l’Océan Indien, ayant rang de Ministre
M. Christian Gouchet (représenté), Ministre de l’Intérieur
M. Jean Janjis (représenté), Ambassadeur Extraordinaire pour les Balkans, ayant rang de Ministre
M. Yves Juarez (représenté), Ministre du Tourisme
M. Yves Hélie (représenté), Secrétaire d’Etat à l’Artisanat
Me Catherine Delsol (représentée), Ancienne Ministre, Membre du Conseil d’Etat
M. André Delsol (représenté), Président du Conseil des Ministres
Ont été nominées les propositions de :
Me Anne Llorens-Sober
M. Jean-Paul Gavino
M. Alexandre Viniel,
M. Fréderic Beaunier
Notes : Les Pieds-Noirs se sont dotés de différents drapeaux, blasons, armoiries par ville, région, secteurs professionnels ou familiaux qui construisent comme en France la richesse de la mémoire de la Nation. Concernant le drapeau tricolore de la France, nous en avons gardé les couleurs mais pas la disposition. En effet, les bandes BBR sont verticales à l’origine et horizontales sur le drapeau pied-noir. Nous avons voulu apaiser la symbolique.
Le drapeau tricolore a mis des siècles avant de s’imposer aux Français. Ce fut une commande de la Convention en 1794 au Peintre Jacques-Louis David pour devenir le pavillon de la Marine de guerre. Il n’est le drapeau de la France sans interruption que depuis 1830. Il apparait vraiment dans la Constitution française qu’en 1958. En fait le drapeau tricolore ne détient que moins de deux siècles d’existence, mais des Pieds-Noirs sont morts pour le maintenir sur leur terre durant les deux dernières guerres mondiales, la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie.
Nous avons donc voulu respecter le principe d’une commande d’Etat à un peintre consacré. Il est à noter que Jacques-Louis David a terminé sa vie en exil en Belgique et que personne à l’heure actuelle n’a pu prouver si sa mort était vraiment accidentelle.
Maître Jean-François Galéa est le peintre officiel de l’Etat Pied-Noir. Lui aussi a choisi l’exil de sa terre natale et consacre sa vie bénévolement à la représentation magistrale des souffrances de son peuple. Nul mieux que lui ne pouvait être l’auteur et le maître d’œuvre de ce qui restera l’empreinte de l’existence de notre Nation dans le concert des Nations du Monde.
Le Chef de l’Etat Pied-Noir
Président de la Fédération des Deux Rives
Service communication Etat Pied-Noir : gppne.pcm.sc@gmail.com
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens d'ajouter Petit, Clauzel, Guelât Bou Sba, Héliopolis, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Duvivier, Duzerville, Herbillon, Kellermann, Milesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Penthièvre, Randon, Kellermann et Millesimo, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
|
Interdiction du niqab à l’école
Envoyé par Eliane
https://www.elwatan.com/edition/actualite/interdiction-du-niqab-a-lecole-08-09-2018
Par El Watan / 08/09/ 2018 l Par M.
Le ministère de l’éducation nationale décide de faire respecter le règlement intérieur
La décision a été annoncée par la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, à l’occasion de sa sortie, mercredi dernier dans la wilaya de Mascara où elle a donné le coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2018-2019.
S’exprimant sur la tenue vestimentaire des élèves et des fonctionnaires de l’éducation, elle rappelle le contenu du règlement intérieur des établissements scolaires qui exige, selon elle, que l’identité de l’enseignante et son visage soient connus par les élèves : «Il faut que l’identité du fonctionnaire de l’éducation soit claire.
On ne peut par gérer l’éducation et l’acte d’enseigner sans que les élèves ne voient le visage de leur enseignante. De même pour les enseignants qui doivent avoir un habit respectable.» La déclaration, même si elle est tout à fait ordinaire, suscite d’ores et déjà un tollé chez les islamistes et les adeptes de l’islamisme radical. Bénéficiant d’un laxisme qui aura duré plusieurs années, des enseignantes se permettent de venir dans les écoles et de se présenter devant leurs élèves avec une tenue ne laissant apparaître que leurs yeux. Inexistant il y a quelques années dans l’école algérienne, ce phénomène a pris de l’ampleur… même au niveau de certaines écoles primaires.
Et comme elles n’ont pas été rappelées à l’ordre par les responsables des établissements, ces enseignantes considèrent, aujourd’hui, le port de cette tenue comme un «droit». Pis, elles dénoncent même les responsables du secteur de l’éducation qui leur rappellent un règlement intérieur des établissements scolaires qu’elles sont censées avoir lu et approuvé. Dans une vidéo postée sur des réseaux sociaux, des femmes en niqab se présentant comme des enseignantes sont en état d’hystérie pour exprimer leur opposition à la décision de la ministre de l’Education nationale. Invoquant le Prophète et le Coran, elles se disent «prêtes à garder leur habit, quitte à quitter l’enseignement». Certain partis islamistes ont profité de cette déclaration pour monter au créneau contre la ministre de l’Education. Selon eux, il y aurait même un projet d’arrêté ministériel concernant l’interdiction du niqab à l’école.
Ce texte, selon des députés islamistes, contient deux articles. Le premier stipule qu’«il est interdit de porter des tenues vestimentaires qui empêchent l’identification de l’élève et qui peuvent dissimuler des outils de triche lors des examens et des tests scolaires». Le deuxième concerne les fonctionnaires de l’éducation et précise qu’«il est interdit de porter des tenues vestimentaires empêchant l’identification des fonctionnaires du secteur de l’éducation à l’intérieur des établissements scolaires».
Toutes nos tentatives de contacter les responsables du ministère de l’Education pour confirmer l’existence de cet arrêté se sont avérées vaines.
Madjid Makedhi
Sidi Amar en proie à l’insalubrité et à l’anarchie
Envoyé par Georges
https://www.liberte-algerie.com/est/sidi-amar-en-proie-a-linsalubrite-et-a-lanarchie-300006
Liberté-Algérie l Par M. Par B. BADIS - le 16-09-2018
ELLE EST L’UNE DES PLUS IMPORTANTES AGGLOMÉRATIONS DE ANNABA
Négligée par ses habitants et surtout par ceux qui ont à charge de l’entretenir, cette cité s’enlaidit chaque jour un peu plus.
La commune de Sidi Amar, l’une des plus importantes agglomérations de Annaba, implantée dans la daïra d’El-Hadjar, née de la masse ouvrière du complexe sidérurgique d’El-Hadjar, et dont la gestion a, tout le temps, brillé par un manque d’organisation flagrant, est la ville la plus abjecte en matière d’insalubrité dans la wilaya. Malgré les efforts des pourvoir publics, le laisser-aller et le laisser-faire et surtout l’incivisme sont à l’origine d’une situation catastrophiques, dont les conséquences négatives se sont répercutées sur tous les domaines. Se caractérisant par quatre spécificités : urbaine, semi-urbaine, semi-rurale et rurale, la commune de Sidi Amar, où la pollution industrielle du complexe Arcelor-Mittal a eu raison, dans un passé récent, de la santé de beaucoup de personnes, est désormais synonyme, pour la population annabie, de misère noire, de maux sociaux, de prostitution et surtout d’insalubrité. À l’image de sa voisine et limitrophe commune d’El-Bouni, les bidonvilles, qui font d’ailleurs aujourd’hui la réputation de Sidi Amar, poussent chaque semaine comme des champignons. Par exemple, du côté de la cité El-Karia, il n’est nullement question des normes de construction.
Les extensions sauvages des maisons et magasins sont désormais monnaie courante et se font au grand jour. En plus des centaines de baraques recensées et des multiples décharges sauvages, des étables en dur, au niveau des préfabriqués, ont été construites au vu et au su des services techniques de l’APC. Dans ces conditions, les mouches et les moustiques font forcément partie intégrante du décor. Au centre-ville, aux alentours directs du siège de l’APC, des égouts à ciel ouvert sont signalés depuis des semaines déjà. Alors au lieudit Terminus, ce sont les décharges sauvages qui caractérisent les lieux.
Négligée par ses habitants et surtout par ceux qui ont à charge de l’entretenir et de veiller sur elle, cette cité s’enlaidit chaque jour un peu plus. Un peu partout à travers les quartiers de Sidi Amar, on est vite attiré par le linge de couleur terne, en permanence suspendu aux fenêtres et aux balcons des immeubles.
Mieux, certains locataires transgressent manifestement toutes les règles édictées en matière d’hygiène et de sécurité. D’ailleurs, la stagnation souvent des eaux usées dans quelques endroits risque de générer de graves répercussions sur la santé publique. Pour sa part, le bidonville El-Ârayess (les mariées), qui a vu le jour à la limite de la cité Bouzâaroura (commune d’El-Bouni), qui grandit au fil des jours en l’absence de réaction des pouvoirs publics, offre des scènes d’une autre ère.
Ici c’est réellement la misère noire. La situation est des plus lamentables dans ce ghetto où vivent plusieurs centaines de pauvres familles pratiquement livrées à elles-mêmes. Des riverains de Sidi Amar signalent que les immeubles construits dans les années 70 et qui n’ont jamais été restaurés sont dans un état de délabrement outrageant.
Escaliers crasseux, murs fissurés, eaux dégoulinantes, chaussées et trottoirs accidentés où l’on note à longueur d’année des travaux urgents et exécutés à la hâte ; la circulation, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons, est très difficiles. La Coquette, une destination touristique par excellence, ne méritait pas de telles cités…
B. BADIS
Bidonville Sidi-Harb de Annaba
Envoyé par Annie
https://www.liberte-algerie.com/est/plus-de-500-habitations-illicites-demolies-299186
Liberté-Algérie Par - B. Badis le 03-09-2018
Plus de 500 habitations illicites démolies
Opération de démolition des habitations précaires non recensées dans la ville de Annaba.
L’opération doit aussi s’élargir pour toucher d’autres sites, à l’image de la cité Seybouse, Allalick, “Chantata” et El-M’haffeur.
Conjointement à l’opération de relogement des centaines de familles du chef-lieu de la wilaya de Annaba à la nouvelle ville de Draâ-Errich, une large opération de lutte contre l’habitat précaire et les fraudeurs du foncier a été lancée en grande pompe par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Annaba, assisté par les services techniques de l’APC de Annaba. Mise en exécution depuis pratiquement une semaine déjà, cette action, chapeautée par Benchadi Abdelkrim, directeur de l’OPGI, a touché jusqu’ici plus de 500 habitations précaires non recensées par les services concernés et où leurs anciens occupants viennent de bénéficier de logements sociaux. Nous apprenons auprès du premier responsable de l’OPGI que cette opération doit être menée le temps nécessaire jusqu’à l’éradication totale des habitats précaires. Mieux encore, celle-ci doit aussi s’élargir pour toucher d’autres sites, à l’image de la cité Seybouse, Allalick, “Chantata” et El-M’haffeur. Lors de ses différentes visites sur le terrain, le wali de Annaba avait affiché une volonté évidente de mettre un terme aux bidonvilles qui ceinturent notamment le chef-lieu de la commune de Annaba, et avait inscrit ainsi et comme priorité des priorités : “Annaba, sans bidonville d’ici la fin de l’an 2019”. Le chef de l’exécutif, principal artisan de cette opération, approché, hier, lors de la réunion de l’APW consacrée à la rentrée scolaire, a lancé un message plutôt menaçant aux autorités concernées. “Ici, c’est Annaba la Coquette. Elle mérite un meilleur sort. Aucune nouvelle construction n’est autorisée. J’exige une véritable lutte dans ce cadre, et surtout, je réclame des suites palpables.” La crise du logement, qui a été vécue dans les années 2000 dans toute sa dimension, constitue le talon d’Achille de la wilaya. Pour faire face à cette situation délicate, il a fallu mettre en place un plan spécial et arrêter des mécanismes exceptionnels, tant du point du vue de l’envergure avérée des programmes que de l’effort de mobilisation du potentiel foncier urbanisable.
“Et l’effort n’aura pas été vain”, affirme le wali, dans la mesure où la mise en œuvre du programme d’habitat initié par l’État, tous types de logements confondus, au niveau des différents nouveaux pôles urbains (Kalitoussa, Drâa-Errich et Aïn Djebara), aura atteint largement l’objectif escompté. La déclaration de Mohamed Salamani reflète la teneur de l’effort consenti pour planter les jalons du développement durable et inscrire la prospérité pérenne. “Nous sommes ici pour hisser la wilaya de Annaba au diapason des grandes villes européennes. C’est un souhait devenu la priorité de mes priorités. L’État a les moyens de sa politique. Cependant, nos ambitions à elles seules ne suffisent pas pour atteindre cet objectif. La construction de cette ville se fera avec la participation et l’engagement de toutes les parties concernées, pas avec les médiocres qui nagent à contre-courant de la stabilisation”.
Ces mots forts, empreints d’engagement, émanent du chef de l’exécutif qui estime par ailleurs, que “les atouts dont la wilaya regorge sont autant de gages d’un avenir prospère”.
B. BADIS
L’ALGERIE A DU MAL A RETENIR SES MEDECINS
Envoyé par Mylène
https://www.reflexiondz.net/L-ALGERIE-A-DU-MAL-A-RETENIR-SES-MEDECINS-4404-medecins-diplomes-en-Algerie-exercent-en-France_a53018.html
ReflexionDZ.net Par Ismain - 26 Septembre 2018
4404 médecins diplômés en Algérie exercent en France
4 404 médecins exerçant en France au 1er janvier 2017 sont diplômés des universités algériennes, selon les données du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) rapportées par Le Monde ce mercredi.
Confrontés au manque de moyens dans le secteur de la santé en Algérie, un nombre croissant de praticiens choisissent d’aller travailler en France. Ils sont là sans qu’on n’y prête attention, maillon essentiel du système de soins français. Si une part croissante des médecins qui exercent en France avec un diplôme étranger sont roumains, les diplômés des universités algériennes les talonnent. Selon le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), ils étaient 4 404 au 1er janvier 2017 (+ 60 % en dix ans). Soit environ le quart des médecins nés à l’étranger exerçant en France. Si l’on y ajoute ceux qui, nés en Algérie, ont été diplômés en France, ce chiffre monte à 14 305 personnes. Et encore, ces données ne concernent-elles que les praticiens inscrits au tableau de l’Ordre des médecins. Elles n’incluent pas ceux recrutés directement par les hôpitaux sous des statuts spécifiques. « Après l’instauration du numerus clausus dans les années 1970, on s’est retrouvé avec un manque chronique d’internes, d’où la volonté de faire venir des médecins étrangers », rappelle Victoire Cottereau, qui a fait sa thèse sur la question des « médecins migrants ». De nouvelles législations ont permis leur venue mais sous des statuts précaires : faisant fonction d’interne (FFI) et praticien attaché associé (PAA). « Ils ne sont pas inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins. Ils sont officiellement sous l’autorité d’un titulaire mais en réalité, assument la même charge de travail », souligne Victoire Cottereau. Payés jusqu’à deux fois moins que leurs collègues français, contraints de patienter des années pour passer les concours qui leur permettront d’obtenir un statut plein, nombre de médecins algériens font pourtant le choix de venir en France, pour travailler et se former. Dans un entretien au quotidien algérien francophone El Watan en août, l’économiste de la santé Ahcène Zehnati soulignait « une forte disposition à l’expatriation » des médecins algériens. « Si on prend les médecins nés en Algérie exerçant en France, le taux d’émigration est de 23,35 %. » Des chiffres qui varient selon les statuts et les spécialités mais témoignent d’une tendance : l’Algérie a du mal à retenir ses médecins.
Ismain
Le Président Bouteflika en guerre contre l'argent sale
Envoyé par Caroline
https://www.reflexiondz.net/Le-President-Bouteflika-en-guerre-contre-l-argent-sale_a52949.html
ReflexionDZ.net Par Belkacem - 17 Septembre 2018
Le Président Bouteflika en guerre contre l'argent sale
Le peuple algérien salue le “ big bang’’ du Président Bouteflika, qui annonce “le grand ménage” dans les grandes institutions. “L’argent sale, c’est fini”, tous les corrompus doivent passer au scanner de la justice. Fini les avertissements et les orientations, l’heure a sonné, il ne s’agit plus d’informer, mais de sanctionner, et tous les hauts responsables du pays, chefs de gouvernements, ministres, généraux, walis ou autres qui trainent des dossiers risquent maintenant l’effet boomerang. L’arroseur arrosé !
La dernière campagne de limogeage opérée au sein des grandes institutions sécuritaires du pays et qui a touché une vingtaine de généraux et généraux majors, des walis, des responsables de la police, de la gendarmerie, de la douane et des banquiers a démontré la main ferme du Président de la République, en ce qui concerne la lutte contre l’argent sale.
Des députés et sénateurs « Touche pas à ma poche», des chefs de partis politiques qui se cachent derrière des barbes bien taillées et des lunettes pour cacher le vrai du corrompu, et des anciens ministres à la tête des partis politiques à la cravate bleue pour séduire les citoyens , qu’ils sont toujours au pouvoir , des milliardaires aux yachts qui ont bâti leurs empires financiers sur le dos des banques publiques, des bambins gâtés des ministres et généraux qui ont servi comme prête-noms pour leurs pères pour s’accaparer des terrains et des biens immobiliers , des ‘’madame Dalida’’ qui ont transgressé les rangs des hauts responsables et les institutions de l’Etat pour peaufiner des statuts de femmes d’affaires , des patrons de médias qui ont blanchi et défendu la corruption … tous et toutes seront envoyés au poteau !
Cette guerre déclarée à la corruption et à l’argent sale, va immanquablement troubler la candidature de certains chefs de partis et milliardaires, qui se voient déjà en costume présidentiel ! Le répertoire du mobile du Bouchi est plein de noms de chefs de politiques et richissimes qui l’ont aidé. En effet des politistes des partis du pouvoir Fln, Rnd, Mpa, Taj et d’autres dans l’opposition, tel que le Msp proche du cercle de l’argent sale, où hommes de mains de la mafia financière sont ciblés par des enquêtes dans le cadre de l’opération déclenchée contre la corruption et l’argent sale.
L'argent algérien caché dans les actifs européens et blanchi via les sociétés immobilières, les concessions de voitures doit retourner au pays. Aucune faute n’est permise pour aider les noms inscrits sur la liste des corrompus. Le chef de la police de la sécurité de de l’aéroport d’Alger a tenté de prêter la main à l’un d’eux, a été limogé sur le coup.
La machine est en marche, pas plus tard qu’hier cinq puissants généraux majors récemment limogés ont fait l’objet d’une décision de retrait de leurs passeports. L’enquête sur l’argent sale et le détournement du foncier s’étalera sur trois dossiers importants, et des instructions ont été données aux responsables des services de sécurité, procureurs généraux et présidents de cour à travers les 48 wilayas pour déclencher des enquêtes. Il s’agit des dossiers des concessions et attributions non règlementaires des terrains destinés au foncier industriel, les concessions et attributions des terrains domaniaux et les attributions des crédits bancaires sans garantie.
Belkacem
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci-dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la Seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
|
De M. Bernard Pierre MARTIN
Une bouteille à la mer
"En 1961-62, j’étais affecté, comme sous-lieutenant, au CFJA de SEDRATA (Bône). J’y ai connu mon épouse, Marie-José Savalle-Martin qui était responsable du Foyer de Jeunes filles de la même ville. Elle était proche du Capitaine SAS, Camboulives et de son épouse.
Marie-José avait une amie à l’époque qui était affectée dans un autre Foyer de Jeunes Filles, à AÏN BEÎDA (Constantine), qui avait fait le même stage au CEMJA de Nantes qu'elle ; son père était régisseur d’une exploitation fruitière dans le Bônois. Elle s’est engagée dans l’armée après la dissolution du SFJA. Marie-José aimerait bien la retrouver. Elle s’appelle Maryse NORMAND.
L’avez-vous connue ; ou connaissez-vous quelqu’un qui pourrait l’avoir connue ?"
Bien à vous - Bernard Pierre MARTIN
Envoyé par Mme B.Ryter-Léonelli
Mon adresse est, (cliquez sur) : jacquesnardin@orange.fr
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Mai 2018
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
http://piednoir.fr/guelma
|
|
L’Eléphant dans le noir
Envoyé par Fabien
|
C’est le titre d’une célèbre histoire du soufi Rumi (XIIIème siècle) : Il était une fois des voyageurs qui, dans la nuit noire, se heurtèrent à un éléphant endormi sur ses pattes. Chacun en tâta avec effroi, une partie ; sur ce l’éléphant se réveilla et s’éloigna pacifiquement, toujours dans le noir de cette nuit sans lune.
Aussitôt les voyageurs encore sous le choc se mirent à décrire l’étrange animal que seules leurs mains avaient touché.
Si tous étaient d’accord pour lui trouver la peau rugueuse et couverte de poils durs, ils ne purent se mettre d’accord sur sa forme : c’est comme un énorme pilier, dit celui qui avait tâté le pied de la bête ; non cela a plutôt la forme d’un grand éventail, affirma celui qui avait palpé l’oreille ; mais pas du tout, c’est une espèce de corde, estima celui qui en avait saisi la queue...
Ainsi en est-il de l’homme qui n’a l’expérience que d’une partie de la réalité de l’Etre, et dont l’esprit limité ne peut en appréhender la totalité.
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
|
|