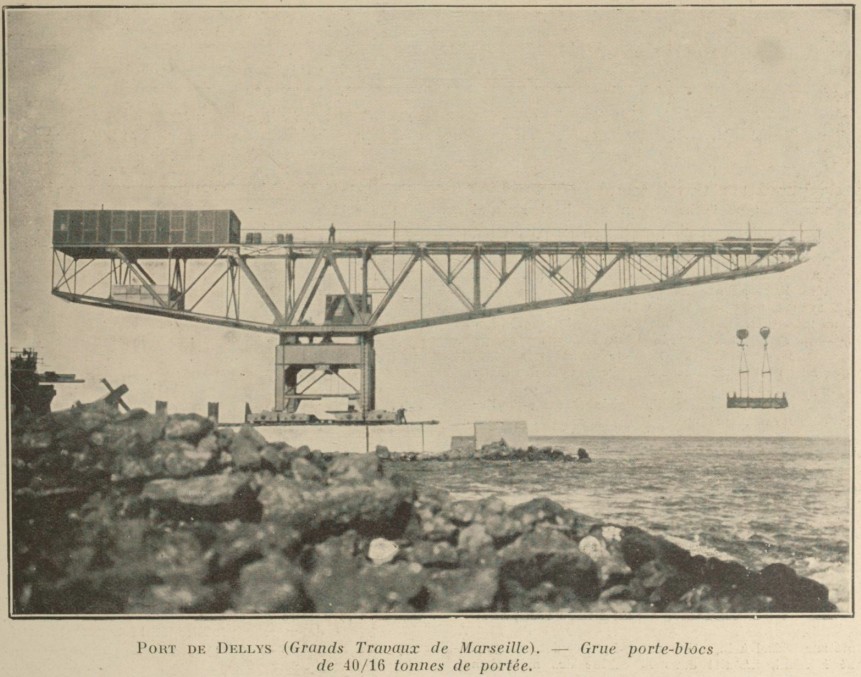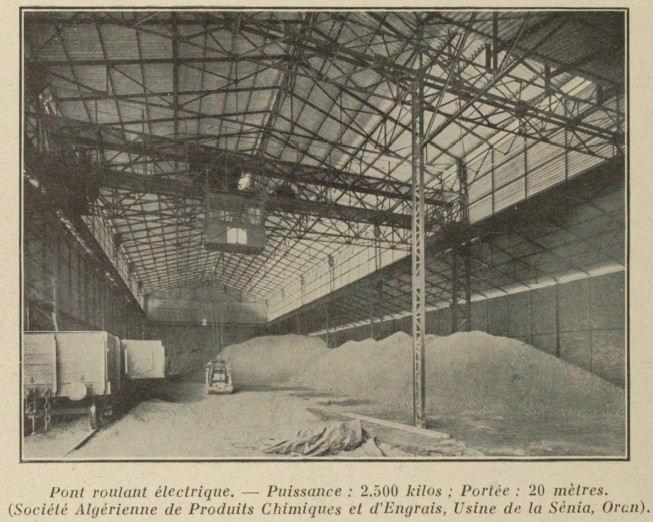|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
172, 173,
174, 175, 176,
177, 178, 179,
180, 181,
| |
|
EDITO
Pâques un premier Avril !
Chers Compatriotes, Amis et Amies de la Seybouse
Le proverbe " En avril, ne te découvre pas d'un fil ", ne s'est jamais autant appliqué que cette année ! Avec des jours nuageux ou pluvieux et des températures plutôt fraîches pour un début de printemps, espérons que bientôt nous pouvons au moins apprécier l'arrivée du soleil qui réchauffera nos corps maltraités par un hiver tempéré mais pas sain.
Je profite de cet édito pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques ! C'est la fête chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ et annonce la fin de la période de jeûne. Comme pour Noel, des non pratiquants se rendent à l'église pour assister à la messe avant de passer à la tradition du repas pascal, qui elle, est généralement respectée. Pour les enfants, c'est l'occasion de participer à la Chasse aux œufs que les cloches ont déposés au cours de la nuit et d'attaquer le rameau de friandises, béni le dimanche précédent.
Cette année, c'est aussi la tradition du " poisson d'avril " qui laisse la part belle à l'humour dans un esprit bon enfant. Mais à l'heure actuelle, que vous postiez une petite farce, un gros mensonge ou un simple poisson d'avril, toutes les originalités ne sont plus permises à cause de la " bien-pensance " qui tue la liberté d'expression ! Alors qu'allez-vous faire pour amuser vos Proches et Amis ?
Le pays, encore en proie aux attaques terroristes, reste endormi malgré le " sacrifice forcé " d'un homme jeune alors que cette place de remplaçant devrait être dévolue aux hommes politiques qui refusent la vraie protection aux citoyens. Oui au lieu d'une minute de silence à l'assemblée, les " politicards, mollusques, dégonflés ou traîtres " devraient commencer à se désigner comme prochain remplaçant d'otage et là, on pourra leur dire bravo et être satisfait de les payer grassement puisqu'ils ne sont pas capables de légiférer utilement. C'est un rêve que j'ai fait……
Combien de morts encore, avant une vraie prise de conscience des français qui ne veulent pas ouvrir les yeux et entendre les cris des martyrs. Assez de marches blanches, de bougies et de fleurs qui ne font le bonheur que des vendeurs qui se frottent les mains à chaque nouveau martyr. Assez de discours oiseux, de repentance, d'excuse, c'est de la répression forte et de l'action qu'on demande à ces tribuns.
Cette année le proverbe " En avril, ne te découvre pas d'un fil ", devrait être remplacé par " En avril, couvre-toi d'un fusil " puisque la nation ne te protège plus.
Bonne fête de Pâques avec la Mouna de Cagayous par Jean Brua,
Et bon 1er avril avec la caricature de Salomon Assus.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
.jpg)

|
|
LA MOUNA
par Toni Pança
Envoyé par Jérémy Lagarde
|
Tché qué bonne journée que j'a passé lundi darnier !
Scaragolette et sa sœur qu'elle se vend les petits beignets spagnols à la rue de la Bouzaréah, y z'étaient venus à la maison me sortir l'envitation pour se faire la mouna.
Vous savez ça que c'est la mouna, pas besoin que je fasse la splication...
Moi que je sais vivre et tout, j'y réponds : " Tu es brave Scaragolette, mais je t'enverrai une carte-postale pour voir si j'accepte. "
Et ce fant de loup y me dit :
- Tché ! dépis qué tu fraquentes le Governor, le chiqué et tout tu fais...
Je le laisse dire pourquoi sa sœur elle me fait des yeux demi-fendus qu'on se dirait le darrière d'une sépiat qu'elle se jette le noir...
Enfin, Scaragolette et sa sœur Assomption y s'en vont.
Deux jours après je leur z'envoyai la carte-postale, ousque je disais que j'acceptai la combinaison...
Lundi, à 6 heures du matin, à peine la boule de fromage de hollande qui a à le ciel y se sort les étincelles bien chauds, tous on se trouvait réunis à la Place Joubert.
Scaragolette y s'avait loué un tram des enterrements, vous savez ces trams que les essieux de l'habitude qui z'ont d'aller au cimetière de Saint-Eugène, y se pleurent tout le temps...
Assomption, qu'elle a passé son çartificat d'études à l'école Monze, elle se fait l'appel.
Tous y répondent présent.
Y avait moi, Scaragolette, Lahouère, Petit-Nain, Ninous le pêcheur des oursins juifs, la tia Pépa, la mère de Sansécals ; la tia Bolbassa, la tante de Midjacague, Midjacague aussi y était, La Frisée, la marchande de lait du Frais-Vallon, Baracous, le marchand de fromadgeots, Marie Frisols qu'elle est bonne chez le Procureur de la République, Sansesavatès, employé à le service du nettoiement, Meçieu Lamire, le Facteur du quartier, un homme des lettres.
Meçieu Tramontane, mon concierge et Mme Tramontane, sa femme ; son fils Charlot et sa fille Eusébie ; Tramousette et Favalcoul. Y avait aussi une chiée des z'autes que si je vous dis le nom, vous pissez dans les pantalons, de tant rigolos qui sont.
Dès que tous on s'a enstallé, Scaragolette, que c'est lui qui se fait le garçon d'honneur de la scursion, y se dit à le cocher :
Doucement, doucement, après qu'on s'a accroché à toutes les rails du tram élec, on s'arrive à la Colonne-Voirol.
Là, on se trouve Chevalier, le maire de Birmandreis, qui nous fait une réception d'al-pello. La musique et tout y avait... Le garde-champêtre y s'avait sorti la tenue de fantaisie.
Chaque y se prend un panier vec du manger dedans, du pain, des bouteilles de vin et cinq ou six bouteilles de l'Anis Gras et y se monte la petite montée qui se conduit à le bois.
Là, on se trouve une petite place de tant bonico que les femmes elles ont, de joie, embrassé à les z'hommes.
Après, chaque y va à darrière un gros arbre faire pipi, les hommes et les femmes ensemble pourquoi ce jour-là personne il a du sexe... comme y dit Meçieu Lamire, le facteur.
Quand tous y z'ont fini de faire pipi, aïdé ! on s'envoie dans les condices plusieurs miquettes d'anis bel gousto.
Après on se fait un petit tour à le bois, bras-dessus bras-dessous. Midjacague et Baracous y se marchaient en devant vec la guitare et la mandoline.
Scaragolette et sa sœur Assomption, y z'étaient restés pour faire le riz à l'espagnol, vec le poulet et les gnorès.
A onze heures, le ventre y commence à crier gazouze.
On se met à la table, parterre ; moi je me mets à côté Marie Frisol.
Qué pantcha qu'on s'a fait !
Mecieu Tramontane y s'avait tellement mangé des œufs qu'il a dû aller les casser à un petit coin où lui tout seul y pouvait aller... sa femme elle en pinçait, plutôt, pour la soubressade et le saucisson.
Après déjeuner, chaque il a chanté une petite chanson et vinga de boire du vin blanc, vinga de boire du vin blanc.
Les femmes elles avaient la tasse et nous z'autes on était demi-gaz...
On s'a touché la guitare et la mandoline et aïdé les polkas, les valses et le quadrille jusqu'à 5 heures.
A ce moment-là on se remet à table pour manger les restes de midi.
Vinga encore de boire, vinga de boire.
Tout le monde y commençait déjà à dire des bêtises et si Mecieu Lamire il avait pas été là, sûr y aurait eu des castagnes à la clef.
Enfin on s'avait tellement la tasse que Scaragolette qu'il était moins plein que les z'autes, il a été cherché le cocher vec le tramway, qu'il était resté à la Colonne.
On s'a monté tous dedans et comme on était doublé, les femmes elles ont dû s'asseoir sur les genoux des z'hommes.
Ce bâtard de cocher, histoire de rigoler y nous a fait passer par El-Biar puis par le Frais-Vallon pour qu'on sort à Bab-el-Oued sans passer par la ville.
Arrivé en haut le cimetière arabe, ce fant de loup de Scaragolette il éteint les lampes de le tram.
Aïe ma ! ça qui s'a passé !
Les femmes elles se faisaient : " Assez ! Assez ! "
Les z'hommes y disaient : " Ne crie pas, les autes y vont t'entendre ! "
Si vous voulez savoir ça que ça voulait dire tous ces cris, dans neuf mois allez chez les femmes qu'elles z'étaient avec nous et demandez-leur si elles ont pas fait un... œuf de Pâques.
Voilà comment on s'amuse nous z'autes le lundi de Pâques. On pense à tout, même... à la Patrie !
 Par TONI-PANÇA
Par TONI-PANÇA
(pseudonyme d'Henri Fiori,
valeureux combattant
de la Guerre 14-18
et futur député d'Alger)
(Source : Papa-Louette du 29 mars 1913)
|
|
|
LE MUTILE N° 50 de 1918 (Gallica)
|
|
Ceux qui aiment la France
Le coquet village de Bossuet en Oranie, qui n'a pourtant rien fait pour mériter un pareil affront à la suprême douleur de voir installé en son sein, un camp de détenus, rebut d'un peu tous les régiments et généralement de ceux qui pratiquent le culte de la crosse en l'air.
Ils sont nombreux et gaillards ces mauvais français dont hélas ! Quelques-uns sont gradés et attendent, en s'engraissant et en se gaussant des fatigues des territoriaux qui les gardent que la guerre mondiale ait pris fin.
Pour eux, il n'y a ni drapeau, ni patrie, mais l'instinct de la conservation qui prime tout. Peu leur chaut que le boche honni, tue, incendie, massacre en territoire français. Se doutent-ils seulement qu'il existe une France, ces misérables, qui n'ont même pas honte de leur lâcheté ?
Entendez leurs lazzis ignobles à l'adresse des vieux soldats qui les gardent impassibles et n'osent pas toujours appliquer la consigne parce que sévère, parce qu'ils sont pères et sans doute aussi parce qu'ils souffrent du ravalement de ces êtres abjects.
" De quoi ? La Patrie ? Connaît pas ! Non, mais des fois, plus souvent qu'on va aller se faire trouer la peau. Ah ! Non, alors, la peau avant tout ! "
Et celte réponse canaille faite par l'un d'eux, un costaud cependant à qui un vieux zouave, lui parlant du devoir de chacun en ces temps attristés était de savoir mourir en ajoutant : " vois-tu-moi, j'ai 44 ans, j'ai un neveu tué à Verdun, un autre horriblement mutilé de la jambe gauche et pourtant je suis prêt à partir et ne tournerai pas les talons ".
Et l'autre, cynique : " Et tu crois qu'il sera mieux regardé ton neveu parce-qu'il lui manquera une patte ? Tandis que moi, avec mes deux jambes, je serai plus beau gosse, je serai plus gobé et je me poserai un peu là, hein ? Tas de poires, ce n'est pas nous les pègres, c'est vous qui souffrez car nous nous trouvons très bien à Bossuet où l'on nous laisse tranquilles et si l'on veut nous expédier là-bas nous connaîtrons le filons pour repiquer au truc. Tiens, tu parles de devoir, eh bien moi j'ai un frangin qui a fait le Maroc, mais en 1914, il a fait comme moi, il est venu ici par le même truc. Et puis, tu sais, faut pas t'en faire, après la guerre il y aura l'amnistie !"
Et ce sont des français qui parlent ainsi et ils ne sont pas fous, puisqu'ils poursuivent leur campagne malsaine même étant détenus.
Il y a vraiment lieu de se demander pourquoi on laisse vivre de pareils êtres. Lorsqu'au plus fort de la mêlée ces gens ont fui, comment se fait-il que les fusils ne soient pas partis tous seuls ? Et puisqu'on a eu la sottise de leur laisser la vie sauve pourquoi les laisser inactifs quand les plus durs travaux devraient leur être imposés.
Il ne faut plus de fausse pitié pour ces infâmes qui espèrent en la mansuétude, en la commisération du gouvernement.
Le boche est incapable d'être pitoyable car en bochie on ne garde pas pour graine les trembleurs ; un feu de salve et tout est dit.
Nos pégriots se rient, de notre pusillanimité. Après la guerre ils parleront de leur séjour en Algérie comme d'une longue et dure campagne durant laquelle, sans eau, sous un soleil de plomb ils ont lutté contre les burnous.
Employez-les dans les fabriques d'explosifs où les matières délétères mangent le sang et tuent parfois, dans les Navires pour le transfert du charbon, au soleil sur les routes pour les travaux publics, bronzez, affaiblissez leur carcasse puisqu'il vous plaît de leur laissez la vie, mais, ôtez-les de nos yeux, leur exemple est trop pernicieux.
On a créé bien des lois durant la guerre sauf une seule dont je propose la teneur suivante dans deux articles :
Art. 1er. - Les Français qui ont refusé de marcher à l'ennemi sont privés de leur qualité de Français.
Art. 2. - Les mêmes individus ayant failli au plus saint des devoirs durant la guerre sont jugés indignes de vivre sur le territoire qu'ils n'ont pas défendu et expulsés.
Que l'on essaie et l'on verra si nous aurons autant de brebis galeuses.
JULLIÈ Albert
Mutilé de guerre.
|
|
| Bulletin - Oeuvre de saint Augustin et de sainte
Monique, patronne des mères chrétiennes
N° 3 - Avril 1878 - Brochure trouvée à la BNF
|
|
LA KABYLIE
MISSION DE KABYLIE
Lettre d'une Religieuse-Missionnaire d'Afrique à la Sœur Supérieur générale.
Très-révérende Mère générale,
Permettez-moi de vous donner quelques détails sur notre voyage et sur notre installation en Kabylie.
C'est le lendemain de la fête de saint Joseph, que mes deux compagnes et moi, nous nous sommes mises en route, pour nous rendre à notre nouvelle destination, le cœur plein de confiance en Dieu et nous appuyant sur la protection de saint Joseph à qui nous avions recommandé le succès de l'œuvre tout apostolique que nous allions entreprendre.
Le soir de ce jour nous arrivâmes à Tizi-Ouzou, petite ville française assise au pied des montagnes de la Kabylie. Une foule de curieux se pressait sur notre passage, attirés sans doute par la nouveauté de notre costume de religieuse-missionnaire. L'hospitalité la plus cordiale nous fut offerte chez les Religieuses de la Doctrine chrétienne, établies, depuis plusieurs années, dans cette localité.
Après quelques heures de repos, des mulets furent préparés et nous nous engageâmes dans l'étroit sentier qui devait nous mener, à travers les montagnes, aux Ouadhias.
La caravane se mit en marche notre inexpérience dans ce mode de voyager ne nous permettait pas d'avancer rapidement, nous nous serions exposées à des accidents graves.
Après avoir gravi la colline au sommet de laquelle est bâti le village des Arifs, un spectacle grandiose se présentait à nos regards les montagnes se succédaient sans interruption formant ainsi devant nous comme les degrés d'un immense amphithéâtre. Le sentier rocailleux sur lequel nous cheminions rendait notre marche difficile, il était bordé de profonds ravins et entouré d'affreux précipices. Un faux pas de nos montures pouvait nous précipiter dans cet abîme sans fond, aussi avec quelle ferveur nous nous adressions à la Sainte-Vierge pour arriver sans encombre au terme de notre voyage. Vers midi nous fîmes une petite halte, pour prendre un peu de nourriture, l'air vif des montagnes avait aiguisé l'appétit. Une heure après nous nous remettions en marche ; il nous tardait d'apercevoir la crête qui, porte le village des Ouadhias se dessiner à l'horizon. Le guide avait reçu l'ordre de nous faire part de cette bonne nouvelle, elle se fit attendre deux heures.
Nous arrivions alors à peu de distance du village de Taguemount-Azous, c'est la seconde résidence des Pères-Missionnaires, deux heures de marche nous séparaient encore de la tribu barbare où nous allions demander droit de cité. Nous arrivâmes enfin, et nous ne saurions assez témoigner notre reconnaissance aux Missionnaires pour les services qu'ils se sont empressés de nous rendre pour faire face aux nécessités du moment.
Nous ne pouvions demeurer seules, isolées au milieu de ces montagnes dont la cime est encore couverte de neige sans avoir avec nous le consolateur de nos âmes. Une simple table fut un autel et le très-révérend Père Deguerry, Supérieur général de la mission offrit le saint sacrifice'. Bientôt les visites ne firent pas défaut, les femmes et les enfants Kabyles vinrent en grand nombre nous voir, nous baisant la main en signe de respect. Je leur dis que nous étions venues dans leurs montagnes uniquement pour leur faire du bien, surtout pour donner des soins aux malades et instruire leurs enfants. Elles ont paru satisfaites. Elles nous font parfois d'étranges questions. Une de ces femmes me demandait, il y a peu de jours, où étaient mes enfants et quand est-ce que mon mari viendrait me rejoindre? "Je n'en ai point, le bon Dieu me tient lieu de tout, lui répondis-je. Elle a paru très-étonnée.
Nous avons déjà fait plusieurs visites aux femmes des tribus environnantes. Le cadre trop restreint d'une lettre ne me permet pas de vous donner aujourd'hui mes impressions sur ces différentes, visites. Je reviendrai plus tard sur cet important sujet.
Nous avons déjà gagné leur confiance ; on nous amène bon nombre de malades, et dans quelque temps, je ne doute pas que nous ne puissions ouvrir une école pour les jeunes filles Kabyles sur le modèle de celles que les Pères Missionnaires d'Afrique tiennent ouvertes pour les jeunes gens.
Combien ne doit-on pas gémir à la vue de l'ignorance de ces pauvres âmes ! Daigne le ciel exaucer nos prières et celle de tous les associés de l'OEuvre de Sainte-Monique, pour éclairer et convertir ces âmes qui sont encore plongées dans les ténèbres de l'erreur.
Daignez agréer, ma très-révérende Mère, l'expression de mon affectueux respect en Notre-Seigneur.
Sœur SAINT-FRANÇOIS de SALES,
Religieuse-missionnaire d'Afrique.
Ouadhias, le 20 avril 1878.
DES TRACES DU CHRISTIANISME.
Pour nos pauvres Berbères du Djurjura, de la même famille et primitivement héritiers des mêmes trésors, la liste des vestiges chrétiens est plus simplifiée. Sans doute, ils ne seraient pas plus appauvris que leurs frères des oasis, si au lieu de se contenter des retraites de l'Atlas, ils étaient allés, eux aussi, enfouir leur reste d'héritage au fond du Sahara. Mais moins séquestrés, obligés depuis des siècles à vivre en contact presque quotidien avec l'élément arabe, quelles éclaboussures n'en ont-ils pas reçues? Il est arrivé pour la religion ce qui est arrivé pour le langage. Tandis que les Touaregs ont conservé des caractères propres à leur langue et leur dialecte à peu près pur de tout mélange étranger, le Kabyle a perdu jusqu'au souvenir d'une écriture nationale, et le langage qu'il parle est mêlé de beaucoup d'arabe ainsi, pour la religion, était-il possible que le Coran n'empiétât pas largement sur un terrain si rapproché du sien ? et comme, pour le Coran, empiéter c'est ravager, nous pouvons nous estimer heureux que la dévastation ne soit pas plus radicale et en faire honneur à la ténacité kabyle.
Voici, au reste, si courte qu'elle soit, la liste des traces chrétiennes que le premier venu peut constater en Kabylie. Nous la donnons sèchement et sans plus de commentaire. Après ce que nous avons dit, quiconque a des yeux pour voir et un esprit non prévenu pour réfléchir, décidera lui-même si ce sont là des témoins authentiques du passé ou des contrefaçons de ruines.
1° Les tatouages en forme de croix. Sans être d'un usage général, on les rencontre fréquemment, surtout dans les tribus plus voisines de Bougie. Ces croix sont quelquefois à quatre branches égales, mais souvent aussi ce sont de véritables croix latines, moins susceptibles par conséquent d'être regardées comme de simples dessins d'ornementation.
2° Des maisons, dans plusieurs villages, notamment dans un village situé tout près de Fort-National, portent gravées au-dessus ou tout autour de leur unique entrée de petites croix très distinctes, taillées dans la pierre même ou encadrées dans une sorte de rosace ; et ce qui est plus remarquable, parfois la maison ainsi décorée n'est rien moins que la mosquée du lieu. Quelle surprise charmante de trouver à une telle place le chiffre du véritable maître !
3° Au moins dans deux tribus, l'une assez éloignée du Djurjura, dépendant du groupe kabyle de Cherchell, l'autre voisine de Zeffoun, la croix se retrouve jusque sur les tombes non pas il est vrai, dressée en signe d'honneur, comme dans nos cimetières, mais simplement couchée à terre et agencée assez primitivement avec ces pierres brutes dont les musulmans ont coutume d'entourer les fosses de leurs morts.
4° Quelques noms du pays sont marqués assez visiblement d'une empreinte chrétienne. C'est ainsi que chaque village kabyle à son Kanoun (canon, loi). C'est-à-dire tout à la fois un tarif d'amendes applicables à certains délits et un corps de droit local destiné à compléter ou à modifier la coutume commune le mot, grée par l'étymologie, romain par l'usage, n'est-il pas emprunté à la langue de l'Eglise ?
Chez les Aïl-Fraoucen, à une petite distance de Djemâ-Sahridy, un village, planté sur un piton élevé, porte le nom arabe de El-Mesloub, le crucifié, le crucifix. Que ce piton ait été jadis surmonté d'un crucifix vénéré, ou que la fidélité des habitants à leur antique foi ait mérité ce nom au village, nous n'avons pas à trancher le litige ; ce qui n'est pas douteux, c'est la signification du nom !
Ansloub, qui n'est que le même mot kabylisé, signifie, dans le langage kabyle, un homme fou, maniaque, hypocondriaque, à humeur solitaire et sauvage. Cette épithète n'aurait-elle pas été donnée, dans le principe aux individus qui étaient restés fidèles à l'ancienne religion, disons le mot, à la folie de la croix, et qui, par suite, obligés de rompre plus ou moins avec leurs concitoyens apostats, demeuraient à l'écart et étaient tenus en suspicion ? De là l'origine du nom. Bien entendu, nous émettons cette conjecture sous toute réserve.
De même, à quelques lieues de Bougie, il existe un village appelé Bordj-Nçâra, le fort des chrétiens (Nazaréens). On y voit des ruines que les gens du pays attribuent aux Romains, et une fraction de chrétiens y aurait persévéré longtemps dans la religion que Rome y avait établie.
5. Ce qui est moins matériel, bon nombre de Kabyles ont encore gardé un vague et lointain souvenir de leur origine chrétienne. Sans doute, pour la masse, ces tatouages et autres vestiges du christianisme n'ont plus le don de réveiller la moindre réminiscence d'un passé meilleur. Tous les Kabyles cependant n'en sont pas là. " Que signifie ce que vous portez sur le front ? " demandait à un Kabyle un zélé religieux de la Compagnie de Jésus. " C'est le signe de l'ancienne voie, de celle que suivaient nos pères. " Et pourquoi la portez-vous ainsi gravée sur le front ? " C'est qu'elle est le signe du bonheur. "
Une autre fois, dans le village des Aïl-Frah, confédération des Aïl-Iraten, un vieillard respecté du pays disait à ce même religieux, en plein village, et sans soulever un mot de réclamation parmi les notables qui l'écoutaient " Moi je suis vieux, je mourrai musulman mais mes fils que voilà et leurs compagnons pourront bien prendre ta route. " C'était encore un de ces montagnards qui disait un jour, sous cette forme sentencieuse familière au langage africain comme à celui de l'Orient " Le Sebaou change souvent son cours dans les crues, de l'hiver, mais il finit par revenir à son ancien lit ainsi nous, nous pourrons revenir à l'ancienne voie. " Et n'était-ce pas cette même pensée qu'exprimait un chef kabyle, peu après la conquête de l'Algérie, dans ces paroles rapportées par le général Bedeau "Nos ancêtres ont connu les chrétiens plusieurs étaient fils de chrétiens, et nous sommes plus rapprochés des Français que des Arabes.
Maintenant, qu'on dise que tout cela est dans la bouche des Kabyles, pure flatterie qu'avant notre arrivée ils ne soupçonnaient même pas que leurs ancêtres eussent pu être chrétiens, et que, si quelques-uns le répètent aujourd'hui, c'est uniquement pour l'avoir entendu dire à des Missionnaires impatients, et dans l'espoir de s'attirer nos sympathies. Serait-ce, par hasard, pour nous flatter qu'un marabout Kabyle, peu gêné et légèrement fanatique, aurait dit récemment à un Français, en lui montrant des ruines romaines du pays " Ce sont nos ancêtres qui ont fait ces monuments, ils étaient alors chrétiens n'ayant pas encore reçu de Dieu le don de l'islamisme, les malheureux s'adonnaient aux choses de la terre, que nous, musulmans, Dieu merci, nous savons dédaigner."
La vérité vraie est que, déjà au XVI° siècle, les Kabyles disaient aux Espagnols et à qui voulait l'entendre ce qu'ils nous ont redit des milliers de fois depuis la conquête. Pour ne citer qu'un témoignage, mais il serait aisé d'en apporter plus de vingt et de toute époque, l'historien Marmol, dans les notes qu'il a laissées sur son esclavage parmi les musulmans, raconte que de son temps les habitants des montagnes voisines de Bougie non seulement portaient l'image de la croix peinte sur leur visage, mais qu'ils se disaient chrétiens d'origine et grands ennemis des Arabes.
Ce n'est pas une tradition en l'air qui se perpétue ainsi de siècle en siècle dans la mémoire d'un peuple d'autant que le peuple dont nous parlons a, sinon, une pierre pour cervelle, comme le disent les Arabes, du moins, de l'aveu de tous, un cœur médiocrement sensible au culte des souvenirs.
J'allais essayer d'indiquer encore quelques signes de la touche chrétienne, qu'un œil attentif peut remarquer en Kabylie. On pourrait le faire, en soulevant un peu plus l'écorce musulmane dont parle le général Dumas, et en creusant résolument dans le vieux tronc.
Mais, réflexion faite, je m'arrête. Nous aurons bientôt à nous initier à l'état social de ces tribus et aux dispositions qu'elles semblent témoigner.
Le lecteur pourra alors juger de lui-même et en pleine connaissance de cause s'il est permis d'espérer, qu'à l'exemple du feu de Néhémie, le feu sacré de l'ancienne loi, étouffé en ce moment sous la boue, revivra un jour en faveur de ce peuple sous l'action pénétrante de la charité chrétienne.
Il est seulement un point, point capital dans l'appréciation du niveau moral d'une société, qu'il importe de signaler dès à présent comme une trace du passage de notre religion dans le Djurjura, c'est la rareté de la polygamie ; les marabouts, plus riches, sont presque seuls à se permettre ce luxe. On dira et on a dit qu'il ne faut faire honneur de cette coutume ni au christianisme ni aux Kabyles que, si ce monde est en général monogame, c'est uniquement qu'il est pauvre et avare. L'avarice et la pauvreté ne sont pas ordinairement d'aussi sages conseillères. Il est dans le cœur de l'homme des instincts brutaux contre lesquels les passions les plus fortes sont désarmées. Pour continuer après des siècles à retenir ces peuplades, encore plus ardentes et sensuelles que pauvres et avares, sur la pente de liberté, où les entraînait le Coran, il fallait un frein posé par l'Evangile.
J. Dugas.
Le révérend Père Dugas s'est endormi dans la paix du Seigneur à Alger, quelques mois, à l'âge de 34 ans, avant la publication de son article. Atteint d'une maladie sans espoir, ce jeune missionnaire n'a cessé jusqu'à son dernier soupir de travailler à la conversion des âmes.
A SUIVRE
|
|
| MEDITATION
Envoyé par Hugues.
|
 Jeudi Saint, la toute 1ère Messe Vendredi Saint : Crucifixion de Jésus
Catholiques, Semaine Sainte dans les cinq Continents :
La Cène du Jeudi Saint, la première Communion,
Vendredi, le Calvaire, pardon des pénitents,
Et le dimanche de Pâques, jour de Résurrection !
Semaine fondatrice de notre foi chrétienne,
Scellant à tout jamais le Don de Dieu à l'Homme,
Dont l'Amour infini, pour peu qu'on le comprenne,
Nous attire à Lui afin qu'Il nous consomme !
La Foi est un mystère, mais acte de raison.
L'homme n'est pas l'égal de son Dieu créateur,
Pour son humilité et par ses oraisons,
Il sera accueilli par son Libérateur.
Des humains, fort savants, recherchent dans l'Espace
Une autre "planète bleue" porteuse d'intelligence.
Leur quête est négative, à ce jour aucune trace
Ne vient contrecarrer de Dieu la cohérence !
Il appartient à l'homme de conquérir le monde
Terrestre et sidéral, s'il en a les moyens.
Qu'il envoie, s'il lui plaît, de multiples fusées-sondes,
Il ne rencontrera le moindre "citoyen" !
Il y a deux mille ans, Jésus venu sur Terre,
A sacrifié sa vie pour l'Homme et l'Univers !
Hugues JOLIVET
31 mars 2015
|
|
|
ANNALES ALGERIENNES
Tome 1
|
|
LIVRE VII
Arrivée du général Berthezène. - Marche générale de son administration. - M. Bondurand intendant en chef du corps d'occupation et de la Régence. - Aperçu des actes de l'administration militaire. - Établissement du droit d'enregistrement. - Acquisitions des Européens à Alger. - Essais de culture. - Analyse de divers actes administratifs.
Le général Berthezène, que le ministère donnait pour successeur au général Clauzel, avait, comme nous l'avons vu, commandé une division dans l'armée d'Afrique pendant la campagne de 1830. Du reste, rien ne le recommandait au choix du gouvernement, si ce n'est la conviction de trouver en lui plus de soumission que dans le vainqueur de l'Atlas.
Le corps d'occupation dont le général venait prendre le commandement, était formé du reste de l'armée d'Afrique, dont plusieurs régiments avaient successivement été renvoyés en France, et des corps de nouvelle création. Il comprenait le 15e, 20e, 21e, 28e et 30e de ligne, les Zouaves, les chasseurs algériens et 2 escadrons du 12e de chasseurs, plus un certain nombre de batteries d'artillerie et de compagnies du génie. Il y avait en outre une masse assez informe de volontaires parisiens qui s'accroissait chaque jour. Elle se composait d'hommes dont plusieurs avaient pris une part active à la révolution de juillet, et dont le nouveau gouvernement s'était hâté de se débarrasser en les envoyant en Afrique, aussitôt qu'il n'en avait plus eu besoin. On travaillait alors à les organiser plus régulièrement, et ils formèrent plus tard le 67e de ligne. La plupart n'étaient liés au service par aucun engagement légal, et s'étaient laissé conduire à Alger, trompés par les promesses de ceux qui avaient intérêt à les éloigner de Paris. On s'est plu à dire beaucoup de mal de ces hommes, qui cependant, dans toute circonstance, se sont conduits avec bravoure, et dont plusieurs ont rendu de vrais services au pays comme ouvriers d'art. En général les officiers étaient ce qu'il y avait de pire dans cette foule. Presque tous avaient usurpé ce titre, ou du moins pris des grades plus élevés que ceux qu'ils avaient réellement ; mais on fit bientôt les épurations convenables.
Toutes ces troupes étaient divisées en 3 brigades commandées par les maréchaux de camp Buchet, Feuchère et Brossard. Le général Danlion commandait la place d'Alger. Le général Berthezène avait pour chef d'état-major le colonel Leroy-Duverger. M. Bondurand avait été nommé intendant du corps d'occupation et de la Régence en remplacement de M. Vollant, qui était rentré en France.
Dès son début à Alger, le général Berthezène se montra homme d'intérieur et de calculs personnels. Il parut ne voir dans cette haute position qu'une occasion de faire des économies sur son traitement fort considérable; il était du reste incapable de l'augmenter par de coupables moyens. Cette étroitesse de pensée et de sentiments, très commune chez nos hommes de pouvoir, est ce qui les déconsidère le plus aux yeux de la nation. Elle pardonnerait plutôt l'improbité unie à un peu de grandeur qu'une honnête petitesse.
M. Bondurand, le nouvel intendant, et, par son importance administrative, le second fonctionnaire du corps d'occupation et de la Régence, était un personnage recommandable à bien des égards, puisque, peu fortuné, dans une position à avoir besoin de faire des économies, il vivait cependant d'une manière convenable ; mais ce n'était pas un homme d'une haute capacité. L'administration militaire, qu'il a longtemps dirigée avec un certain ordre matériel, n'a jamais donné en Afrique que de tristes preuves de son impuissance. En revanche, elle présente un personnel très nombreux. Cinq sous-intendants ou adjoints à Alger seulement, ont constamment été sous les ordres de M. Bondurand, et parmi eux se sont trouvés des hommes d'un vrai mérite de spécialité. Cependant elle n'a presque rien su créer dans le pays, et n'y a vécu qu'au jour le jour, preuve évidente d'une absence totale d'impulsion de la part de son chef.
L'armée a toujours reçu, et reçoit encore, les vivres de campagne, c'est-à-dire le pain, la viande, les légumes, le sel et le vin. C'est en France que se passent les marchés pour toutes ces denrées, excepté pour la viande, et quelquefois pour les grains. L'administration de l'armée d'Afrique n'y est donc pour rien. Elle reçoit seulement les envois et en constate la quantité. Mais l'armée à souvent eu à se plaindre de la facilité de ces réceptions ; des denrées évidemment avariées et quelquefois malsaines, ont été mises en distributions sans qu'il y eût urgence, c'est-à-dire impossibilité de faire autrement. La correspondance de l'état-major constate qu'à diverses époques, surtout à celles du renouvellement des généraux, des réclamations, je pourrai même dire des reproches très graves, ont été adressés à l'intendance à cet égard. Les soldats, accoutumés à juger trop légèrement peut-être ceux qui sont chargés de les nourrir, ont pu d'après cela accuser certains membres de l'administration d'une complaisance intéressée envers les fournisseurs.
Les marchés pour la viande se passent sur les lieux. Le mode de cette fourniture a souvent varié. Tantôt elle s'est faite par entreprise, et tantôt par régie. Depuis longtemps ce sont les comptables eux-mêmes qui fournissent, moyennant un abonnement réglé sur les mercuriales, et dont toutes les clauses sont à leur avantage : c'est ici que se décèle toute l'incurie de l'intendance ; ayant à pourvoir aux besoins d'une consommation considérable et fixe, elle devrait avoir un troupeau calculé sur ces besoins, troupeau qui ne coûterait rien à nourrir, car le domaine possède de vastes pâturages à peu de distance d'Alger, sur les bords de l'Arcath et du Hamise ; on aurait pu même trouver des terrains vagues à très peu de frais, beaucoup plus près encore de la ville. Ce troupeau, bien conduit, se multiplierait de lui-même, et fournirait à l'armée de la bonne viande, moins coûteuse que la mauvaise qu'on lui distribue depuis quatre ans. Au lieu de cela, chaque comptable a auprès de lui quelques bêtes étiques qu'il ne nourrit pas, et qu'il fait abattre quelques heures avant le moment où elles devraient mourir d'inanition. L'œil est attristé à la vue de ces squelettes ambulants qui se traînent autour des demeures de nos comptables, et que l'on destine à la nourriture de nos soldats. Un général a avoué en les voyant que l'existence de ces ombres de troupeaux administratifs suffirait, en bonne règle, pour motiver la destitution d'un intendant. Mais ce n'est encore rien : nos boucheries militaires sont si mal approvisionnées, même de mauvaise viande, par les moyens employés par l'administration, qu'à la moindre baisse dans les arrivages des Arabes, on est obligé de diminuer la ration, et qu'il est même arrivé quelquefois que la viande ait complètement manqué.
Les comptables, qui ont un intérêt personnel à acheter bon marché, ne se pourvoient que de mauvaises bêtes quelquefois malades, ou de bêtes volées, qu'ils ont par cela même à bon compte ; de sorte que notre administration militaire, non contente de mal nourrir nos soldats, donne des primes d'encouragement pour le vol aux Arabes eux-mêmes. Le chef du bureau arabe, pour avoir soutenu avec chaleur les droits de propriétaires indigènes et européens, qui avaient reconnu du bétail à eux appartenant dans le troupeau d'un comptable, s'est vu accusé l'été dernier par l'administration de nuire à l'approvisionnement de l'armée, parce qu'il voulait que ce bétail fût rendu. Voilà donc une administration qui avoue que le recèlement est mis par elle au nombre des moyens employés pour nourrir l'armée dans un pays où nous avons en prétention d'introduire la civilisation, et de faire cesser le brigandage.
Dans tout cela, l'administration militaire n'est pas seule coupable. Les généraux en chef auraient dû sans doute s'occuper eux-mêmes des besoins de l'armée et des moyens de les satisfaire ; il est même évident que, sans leur participation, l'établissement d'un troupeau général, d'un véritable troupeau avec croît et produit, comme en avait le gouvernement du Dey, était impossible ; mais enfin il était du devoir de l'intendant en chef de prendre l'initiative de la proposition, et je répugne à croire que les secours militaires eussent manqué à un établissement utile. Mais loin de là, l'administration paraît ne s'être jamais donné la peine d'étudier les ressources du pays, et même elle n'a pas su tirer parti de celles que l'autorité militaire lui a mises entre les mains; j'en citerai par exemple les foins fauchés sous le général Voirol, dans les vastes prairies du Hamise. Nous verrons dans le volume suivant que cette opération ne fut pas aussi avantageuse qu'elle aurait dû l'être, et cela par la faute de l'administration militaire.
En somme, cette administration, dont le chef a été pendant quelque temps à la tête de l'administration civile, n'a su ni produire une botte de foin, ni faire naître un veau. Ajoutez à cela qu'elle a toujours été embarrassée pour les moyens de transport dans tous les mouvements de troupe ; qu'elle n'a jamais su organiser les moindres convois auxiliaires dans un pays où la plus pauvre famille a une mule ou un chameau, et qu'enfin elle est une des principales causes de cet état de pétrification qui cloue l'armée sur le massif d'Alger depuis cinq ans.
Parmi les actes de M. Bondurand, il en est un qui mérite-les plus grands éloges, c'est l'établissement d'un hôpital d'instruction à Alger. Les cours en sont faits par des officiers de santé de l'armée, parmi lesquels se trouvent des hommes d'un profond savoir. Je citerai, entre autres, le savant opérateur Baudeus, qui, quoique fort jeune, s'est déjà acquis une réputation européenne. Ce célèbre chirurgien, passionné pour les entreprises utiles, comme tous les hommes dont le mérite sort des bornes communes, a puissamment contribué à l'établissement de l'hôpital d'instruction. M. Bondurand, qui en faisait le plus grand cas, entra parfaitement, dans ses vues, et aplanit toutes les difficultés avec une hauteur de vue et une persévérance que l'on aurait aimé à lui voir déployer dans toutes les autres branches de l'administration ; car, je le répète, M. Bondurand était un de ces hommes que l'on désirerait pouvoir louer en tout.
M. le général Berthezène était hors d'état de donner à l'administration militaire l'impulsion qu'elle ne pouvait recevoir de son chef direct. Il en fut de même de l'état civil, et ici la mollesse du général en chef, résultat naturel de son indifférence pour tout ce qui ne se rapportait pas exclusivement à lui, était augmentée de ce qu'une extrême méfiance de lui-même avait mis dans son âme de circonspection et d'incertitude. Quoique l'ouvrage qu'il a publié récemment, sans avoir rien de bien remarquable, ait néanmoins fait découvrir en lui plus de connaissances qu'on ne lui en supposait, il était peu en état de traiter des questions administratives d'un ordre élevé. Il devait donc être facilement réduit au silence par ceux que leur position avait familiarisés avec la phraséologie administrative, et prendre enfin l'habitude de leur céder sans discussion, mais non sans rancune ; car l'homme élevé en dignité pardonne difficilement à ceux qui le mettent trop souvent dans la dure nécessité de s'avouer son impuissance intellectuelle. Je touche ici une matière délicate dans ma position ; mais enfin je me suis consacré à la vérité.
Il est deux écueils auxquels nos généraux échapperont difficilement. Quels que soient l'éclat de leurs vies passées et le mérite de leurs services, bien peu d'entre eux ont la généralité de connaissances, et l'amour du travail nécessaires pour donner à la machine administrative une impulsion ferme et en même temps régulière. Ou ils ne tiendront aucun compte des observations ni des avis de leurs chefs de service, et alors ils agiront avec ignorance et brutalité ; ou ils les laisseront opérer sans contrôle, chacun dans la sphère de sa spécialité, et alors il y aura défaut d'ensemble, et tiraillement dans les actes administratifs. Chaque chef de service ne voit et ne doit voir que sa spécialité. Les considérations prises en dehors du cercle dans lequel il se meut, n'en sont pas pour lui ; de sorte que s'il n'existe pas au sommet de la hiérarchie administrative un homme capable de tenir dans ses mains tous les fils sans les confondre, il n'y a ni direction, ni but commun. L'administration des finances ne prend à tâche que d'augmenter les recettes, sans considérer si des mesures trop fiscales ne nuisent pas à la prospérité du pays. Celle des travaux publics ne voit que les constructions qui peuvent flatter l'amour-propre de ses membres sous le rapport de l'art, et ne s'enquiert pas si des constructions moins coûteuses et plus faciles ne conviendraient pas mieux à l'actualité ; et ainsi du reste.
Ce que nous venons de dire de nos généraux peut s'appliquer, par analogie, à beaucoup d'hommes politiques de l'ordre civil, car nous n'avons guère en France que des spécialités. Les hommes à connaissances générales sont extrêmement rares. Cependant il est évident qu'on aurait plus de chances de trouver dans la classe civile un bon gouverneur d'Alger que chez les militaires, puisque ici le choix ne peut porter que sur les quatre-vingts individualités de maréchaux et de lieutenants-généraux, dont les uns sont usés par l'âge, et dont les autres appartiennent à une génération à laquelle les bienfaits de la haute instruction ont complètement manqué.
Je prie le lecteur d'être persuadé que je ne cherche aucune allusion offensante pour qui que ce soit. J'avouerai même volontiers qu'il existe quelques exceptions à la règle générale, mais avouons aussi que dans un siècle de crises comme le nôtre, où chaque période de quinze ans amène des idées et des besoins nouveaux, les hommes d'une époque devraient disparaître avec elle, et ne pas attendre que le public leur apprenne d'une manière désobligeante qu'ils sont restés trop longtemps sur le théâtre. La patrie, reconnaissante pour quelques anciens services, les inscrirait sans trop d'examen sur les fastes de sa gloire, tandis qu'en s'obstinant à rester en scène, ils s'exposent à ce qu'après avoir reconnu ce qu'ils sont dans le moment, on ne vienne à examiner avec trop de curiosité ce qu'ils ont été autrefois.
M. Berthezène était arrivé avec des préventions plus ou moins fondées contre la plupart des fonctionnaires qu'avait employés son prédécesseur. C'est ce que nous avons vu en Afrique à chaque changement de général en chef. Le dernier venu s'est toujours imaginé que les fautes qui lui avaient été signalées, ou qu'il avait découvertes lui-même, tenaient exclusivement au personnel administratif, et qu'en changeant quelques employés, tout serait dit. Cependant, si un fonctionnaire s'égare, il vaut mieux le remettre dans la, bonne voie, que de le remplacer par un homme nouveau, qui, dans un pays d'étude et d'essai comme celui-ci, aura son éducation de localité à faire ; ce qui n'est pas peu de chose; il est vrai que pour mettre un homme sur la voie, il faudrait savoir soi-même où l'on veut aller.
Parmi ceux à qui le général Berthezène en voulait le plus, était M. Fougeroux, inspecteur des finances, avec lequel il eut d'assez vives altercations. Ce fonctionnaire était un personnage trop pénétré de son importance, et qui mit plusieurs fois à l'épreuve la patience du général en chef. Celui-ci obtint son rappel. M. Williaume le remplaça comme inspecteur des finances et comme membre du comité du gouvernement, qui prit le 1er juin la qualification de commission administrative; M. le sous-intendant militaire de Guirroie en était le secrétaire depuis quelques mois. Il avait remplacé M. Caze.
M. Girardin, directeur du domaine, étant rentré en France par congé, M. le contrôleur Bernadot prit le service par intérim.
M. Rolland de Bussy quitta les fonctions de commissaire général de police. Elles furent données au grand prévôt Mandiri, déjà Agha des Arabes, et dont les débiles épaules se trouvèrent ainsi chargées d'un triple fardeau.
Tous ces arrangements terminés, chaque chef de service se mit à faire de l'administration pour son compte, sans trop s'embarrasser de l'ensemble. Les projets d'arrêtés étaient soumis pour la forme au général en chef, et la machine allait comme elle pouvait.
Cependant comme il faut bien avoir au moins une idée à soi quand on est censé gouverneur, ne serait-ce que pour l'acquit de sa conscience, M. le général Berthezène avait celle de se rendre agréable aux Indigènes ; projet très louable, sans doute, mais qui ne fut pas toujours appliqué avec beaucoup de discernement. Les effets de sa bienveillance pour la population musulmane, se concentrèrent sur quelques Maures intrigants tels que Bouderbah et sa coterie. Cet homme adroit et insinuant se fit adjuger, à lui ou aux siens, la ferme du marché au blé (la Racheba), celle de presque tous les autres marchés où se perçoivent des droits, et tous les Fondouks (Caravansérails). Il commença alors à jouer un rôle important parmi les Musulmans, qui jusqu'alors l'avaient méprisé, comme un homme sans moralité, dont le nom avait plus d'une fois retenti devant les tribunaux. Il paraîtrait que ce fut à cette époque que les notabilités maures d'Alger se mirent à rêver une restauration musulmane faite à leur profit. Il y a même lieu de croire que des communications semi-officielles, venues de très haut, leur firent penser que la chose était possible, et que la France elle-même, fatiguée de sa conquête, y donnerait les mains.
Le 24 mai, M. le général Berthezène décréta qu'une première indemnité équivalente à 6 mois de loyer, serait payée aux propriétaires dépossédés pour cause d'utilité publique. C'est tout ce qu'ont reçu jusqu'ici les malheureux Indigènes dépouillés par l'administration française. Depuis cette époque, la masse de ces infortunés s'est prodigieusement accrue, et les indemnités qui leur sont dues s'élèvent au moins dans ce moment à 120,000 fr. de rente. On conçoit tout ce qu'une pareille somme enlevée annuellement à quelques centaines de familles, peu aisées pour la plupart, a dû y laisser en échange de misère et de désespoir. Cependant personne n'a voulu pénétrer dans le secret de tant de douleurs. De pauvres enfants tendent la main , au coin des rues, aux humiliants secours de l'aumône ; de malheureuses filles, destinées naguère à la chasteté d'un nœud conjugal, sont livrées par la faim à la prostitution, et personne ne s'enquiert de la cause de ces misères. Point de larmes pour le malheur obscur qui n'a pas de quoi payer des articles de journal, et qui ne peut venir dans un salon faire entendre ses plaintes entre une contredanse, et un écarté. Les commissaires que le gouvernement nous envoya en 1833, pour examiner la situation du pays, se sont aperçus cependant qu'il y avait des injustices à réparer. L'un d'eux a nommé à la tribune nationale une victime de notre administration ; mais quelle était cette victime ? Un Européen qui, après avoir acheté pour 800 fr. de rente une vaste ferme dans les environs d'Alger, s'est vu dépouiller de ses bâtiments que l'on fut forcé de lui prendre pour loger une partie de notre cavalerie, mais dont on lui paye 2,000 fr. de loyer. Voilà l'horrible infortune qui émut la philanthropie de l'orateur dont nous venons de parler.
Cependant, en allant dans les bals et dans les soirées, où il puisait ses observations, cet orateur pouvait voir à la porte des hôtels où il entrait des douzaines d'enfants à qui notre civilisation n'a encore donné, en échange de la boutique ou de l'atelier de leurs pères, que la sellette du décrotteur.
C'est au gouvernement lui-même, à la France, représentée par ses Chambres, que doit s'adresser le reproche de dureté et de mauvaise foi envers les indigènes dépossédés. Nous avons vu que le général Clauzel avait décrété que les immeubles du domaine serviraient de gage à leurs créances ; mais quelques commis du Ministre de la guerre, qui avaient étudié l'art de gouverner Alger dans les Institutes administratives de M. de Gérente et dans le Bulletin des lois, trouvèrent que cette manière de procéder sortait des règles communes, ce qui était vrai, et qu'il n'y avait aucun rapport entre les propriétés du domaine et les créances sur l'État , ce qui, dans l'espèce, était faux. Car voici la question réduite à sa plus simple expression : le gouvernement français s'impatronise à Alger, mais il ne connaît encore que vaguement ce qui lui appartient comme propriétaire ; or, dans cet état de choses, des motifs plus ou moins fondés d'utilité publique exigent la démolition d'une maison : cette maison se trouve appartenir au domaine; c'est bien, voilà une maison de moins pour le domaine, et il n'en n'est plus question. Un peu plus loin existe une seconde maison dont la démolition est également rendue nécessaire, mais celle-ci appartient à un particulier qui réclame, et vous dit : Peu loin de ma maison, dans telle rue, le Beylik en possède une de même valeur que la mienne, donnez-là-moi, et je vous tiens quitte.. Clauzel prévint cette demande, et y répondit d'avance par l'arrêté du 26 octobre, dont le ministre de la guerre a arrêté l'exécution.
Si c'eût été pour arriver au paiement de l'indemnité, par des moyens qui sortissent moins des habitudes administratives, rien de mieux ; mais comme cette mesure n'a eu d'autre résultat que la ruine des propriétaires dépossédés, il est évident, pour tout homme qui a médité autre chose que les Institutes administratives, que les commis du ministre de la guerre auraient dû, dans une question exceptionnelle et toute nouvelle quant aux détails, faire fléchir les règles matérielles de l'administration devant les lois immuables de la justice et de l'honneur ; et si je ne parle ici que des commis, qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions, ce n'est pas que je craigne d'arriver jusqu'au ministre, mais c'est que je suis en effet convaincu que la question d'Alger leur est abandonnée. Il est possible que celui qui, parmi ces messieurs, est plus particulièrement chargé de nos affaires, soit un homme supérieur, ce dont j'ai cependant eu, dans ma position, quelques raisons de douter ; mais s'il en est ainsi, qu'on nous l'envoie pour gouverneur, et peut-être, en voyant les choses de plus près, parviendra-t-il à ne laisser aucun doute sur la rectitude de son jugement, même dans l'esprit de ceux qui par devoir ont été obligés de lire ses élucubrations hebdomadaires sur Alger.
Le ministre de la guerre a donc, par l'organe de ses employés, assumé sur sa tête la responsabilité des injustices commises envers les propriétaires dépossédés. Si on eût laissé agir les généraux en chef, les indemnités auraient été payées. Jusqu'à l'arrivé de M. Pichon, le budget des dépenses civiles fut réglé par eux sur les recettes locales, et il est indubitable que l'indemnité aurait continué à y figurer. Lorsque le ministre voulut faire rentrer Alger dans le droit commun financier, il aurait dû ne pas avoir deux poids et deux mesures, et ne pas laisser les indigènes dans l'exception, lorsqu'elle leur était désavantageuse, en même temps qu'il les en faisait sortir en ce qu'elle avait de profitable pour eux. C'est cependant ce qui a eu lieu ; car, si, d'un côté, la législation financière ne permettait pas, en s'appliquant à la rigueur, de laisser subsister les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1830, de l'autre, notre loi fondamentale défend de dépouiller un propriétaire sans une juste et préalable indemnité. Malgré cette violation des lois de l'équité et de la logique, il ne faut pas croire que l'on soit dans les bureaux ennemi systématique des Maures. Bien au contraire, par une inexplicable contradiction, les mêmes hommes qui ont causé la ruine de tant de familles musulmanes, accueillent avec empressement tous les intrigants qui leur arrivent d'Alger. Ils les comblent de faveurs, de décorations et de pensions ; heureux quand ils ne s'en servent pas pour créer des embarras à l'administration locale !
La question de l'indemnité touche de près à celle du séquestre, nous avons dit que M. le général Clauzel avait ordonné la réunion au domaine de tous les biens des Turcs déportés. Cette confiscation fut convertie en séquestre par un arrêté du 10 juin 1831, rendu d'après une décision ministérielle du 27 mai. Ce séquestre pèse encore sur les biens des Turcs, et l'on ne voit pas trop quel en sera le terme. Je ne sais si le gouvernement attend que la propriété de tous ces biens ait passé entre les mains des Européens, ou s'il est embarrassé de les rendre, parce que lui-même en occupe plusieurs qui sont nécessaires à divers services publics.
Les dispositions de l'arrêté du 10 juin ayant été souvent appliquées, soit par erreur, soit par une fausse interprétation, à des Turcs non déportés, il y a eu quelques levées de séquestre partielles. Elles étaient d'abord prononcées par la commission administrative ; mais le ministre se les est ensuite réservées. Ainsi, des Turcs de la garnison de Mostaganem qui étaient à notre service, n'ont pu rentrer dans leurs biens qu'en vertu d'une décision ministérielle, quoique le séquestre qui les avait atteints, fut évidemment le résultat d'une erreur non susceptible de supporter la discussion. Cette obligation de recourir à Paris pour des choses aussi simples, diminue aux yeux des indigènes l'importance de celui qui commande à Alger, ce qui est un très grand mal ; le pouvoir a besoin d'y être fort, et d'y jouir d'une indépendance au moins apparente.
J'ai réuni une collection de faits qui pourraient faire connaître pourquoi on veut que ce soit à Paris que se règlent les questions de séquestre et d'indemnité ; mais il n'entre pas dans mes convenances personnelles de les publier en ce moment.
Cependant les Européens que l'espérance avait conduits en Afrique y faisaient chaque jour des acquisitions. Le 21 juin, un arrêté soumit à l'obligation de l'enregistrement tous les actes translatifs de propriété et de jouissance. Le 21 juillet suivant, le droit d'enregistrement fut fixé à 2 % pour les actes d'aliénation définitive ou de cession de jouissance pour cinquante ans et au-dessus. Il fut réduit d'un centième par chaque année pour les cessions de jouissance de moins de cinquante ans.
Il y a des choses fort curieuses à dire sur les acquisitions des Européens en Afrique, et cette matière mérite que nous nous y arrêtions quelques instants.
Plusieurs familles musulmanes chez lesquelles les préjugés religieux étaient fortement enracinés, ne voulant pas vivre sous la domination chrétienne, prirent le parti, dans les premiers mois qui suivirent la conquête, de s'éloigner d'Alger, et d'aller s'établir, soit dans le levant, soit dans les villes de l'intérieur de la Régence. Elles cherchèrent, avant de partir, à réaliser leurs fortunes ; mais les Musulmans qui restaient à Alger n'étaient pas dans des circonstances à faire des achats d'immeubles, et les Européens qui étaient venus s'y établir avaient plus de désirs que de moyens de devenir propriétaires.
La plupart ne pouvaient disposer que de faibles capitaux ; et ensuite, quand même ils en auraient eu de plus considérables, l'avenir du pays n'était pas assez assuré pour que des acquisitions pussent se faire par les moyens ordinaires, c'est-à-dire par l'échange d'un immeuble contre une somme quelconque d'écus ; car nous pouvions, d'un moment à l'autre, évacuer Alger, et les nouveaux acquéreurs se seraient vus forcés d'abandonner leurs immeubles, sans la moindre lueur d'espérance de rentrer dans leurs capitaux. Cependant, comme, d'un côté, il y a désir d'acheter, et de l'autre, besoin de vendre, on finit par s'entendre; les aliénations furent faites au moyen de rentes perpétuelles. Ce mode de transaction garantissait à l'acheteur, qu'en cas d'évacuation il ne perdrait jamais que quelques annuités, et laissait entrevoir au vendeur la possibilité de rentrer dans sa propriété.
Les rentes furent en général calculées au plus bas, relativement à la valeur que nous sommes habitués à donner aux propriétés foncières, de sorte que les Européens furent éblouis de la facilité avec laquelle on pouvait devenir propriétaire à Alger.
Une fois que cette manière assez commode d'acquérir fut établie, ce fut à qui deviendrait propriétaire. On avait commencé par acheter aux émigrants, mais bientôt on acheta de toutes mains. L'occupation militaire s'étendait sur un grand nombre de maisons dans l'intérieur de la ville et à l'extérieur. Les dévastations et les maraudes de nos soldats, tristes fruits d'une discipline extrêmement relâchée, rendaient presque impossible l'exploitation des propriétés rurales de la banlieue d'Alger. Les Indigènes, voyant donc qu'ils ne pouvaient tirer aucun profit de leurs propriétés ; soit rurales, soit urbaines, se mirent à les vendre aux Européens à des conditions qui se ressentaient du discrédit dans lequel elles étaient tombées ; les Européens les achetèrent, parce qu'elles étaient à vil prix, et qu'ils espéraient qu'une fois dans leurs mains ils parviendraient à les faire respecter. Mais il en fut presque toujours autrement : à l'exception de quelques sommités coloniales qui obtinrent des indemnités pour le mal qu'on leur avait fait, et des garanties pour l'avenir, précisément parce qu'elles étaient plus en position que d'autres de supporter des pertes, à l'exception, dis-je, de ces sommités, les propriétaires européens ne furent pas mieux traités que les Indigènes. On peut même dire que la dévastation et la maraude s'attachèrent plus particulièrement à leurs possessions ; car, comme il était de notoriété qu'ils avaient fait valoir ces éventualités de pertes, pour acheter à bon compte et profiter des malheurs des Indigènes, les soldats semblaient prendre à tâche de tourner la chance contre eux. Les chefs eux-mêmes mirent plus de négligence à faire respecter la propriété, lorsqu'ils surent que les pertes ne devaient plus tomber que sur des hommes qui les avaient fait rentrer en ligne de compte dans leurs transactions avec les naturels. Les militaires disaient ouvertement qu'ils ne prétendaient pas avoir conquis le pays pour enrichir des spéculateurs.
Ceux-ci, tout fiers de leur nouvelle qualité de propriétaires, poussaient souvent leurs prétentions jusqu'à l'injustice, et auraient voulu chasser l'armée de toutes les maisons qu'elle occupait. De là, des récriminations passionnées de part et d'autres, et les épithètes injurieuses de banqueroutiers et de Vandales qu'échangeaient deux classes d'hommes destinés à concourir au même but.
Mais tout ce qu'il y a de particulier dans tout cela, c'est que plus d'un militaire se mit dans la catégorie de ce qu'on appelait les banqueroutiers, et plus d'un spéculateur dans celle de Vandales. Plusieurs officiers achetèrent des maisons et des terres, et ne déployèrent pas dans leurs transactions plus de scrupules que les spéculateurs de profession, et un grand nombre de ceux-ci se mirent à dévaster leurs propres possessions, coupant les arbres, enlevant les boiseries, les marbres et les ferrements des maisons, enfin tout ce qui était enlevable ; après avoir réalisé de cette manière quelques milliers de francs, ils se laissaient exproprier par leurs vendeurs maures pour faute de paiement de la rente qu'ils avaient consentie.
A ces moyens peu délicats d'acquérir de l'argent et des immeubles, quelques Européens en ajoutèrent d'autres tout à fait criminels. Des manœuvres frauduleuses eurent lieu, pour faire croire à des propriétaires indigènes qu'ils allaient être expropriés par l'administration, et qu'ils n'avaient d'autres moyens de ne pas tout perdre que de se hâter de vendre à quelque prix que ce fût.
Les Indigènes, à qui nous donnions l'exemple de la déloyauté dans les transactions, ne tardèrent pas à nous imiter; lorsque toutes les propriétés du Fhos eurent été à peu près vendues, les achats firent irruption dans la plaine. On commença d'abord par traiter avec des Maures, propriétaires de fermes dans la Métidja, puis les Arabes se mirent aussi à vendre leurs terres, trouvant qu'il était très avantageux de se faire payer une rente d'un immeuble dont rien n'empêchait l'ancien propriétaire de continuer à jouir paisiblement ; car toutes ces acquisitions étaient bien au-delà de nos lignes, et les Européens ne pouvaient pour le moment songer à en prendre possession; mais on travaillait pour l'avenir, et dans l'espérance de voir arriver le jour où l'on cesserait de n'être propriétaire que de nom. Une fois parvenu sur ce terrain, les ventes ne furent souvent plus que des fictions où la cupide crédulité de l'acheteur était la dupe de la friponnerie du vendeur. Les Européens étaient tellement possédés du désir d'acquérir une parcelle du sol africain qu'ils achetaient tout ce qu'on venait leur offrir, non seulement sans voir l'immeuble, ce qui, du reste, était presque toujours impossible, mais en outre sur des titres faux ou altérés, et souvent sur un simple certificat de notoriété établi d'après la déclaration de sept témoins inconnus eux-mêmes.
C'est de cette manière que les mêmes propriétés ont été vendues en même temps à diverses personnes, que les Européens ont tellement été trompés sur les contenances, que si celles portées dans leurs contrats de vente étaient exactes, ils se trouveraient avoir déjà acheté dix fois la superficie de la Métidja, et qu'enfin on a même acheté des terrains qui n'ont jamais existé. Les Arabes se sont fait un jeu de tromper la cupidité des Européens, et il faut avouer que ceux-ci s'y sont prêtés avec une si stupide crédulité, qu'on est tenté de pardonner aux premiers une conduite qui ressemble autant à la mystification qu'à la friponnerie. Car enfin on voit à Alger des hommes qui s'imaginent avoir acheté pour deux ou trois cents francs de rente, deux ou trois mille arpents d'excellente terre bien complantée et bien arrosée, voir même des villages entiers peuplés de plusieurs centaines d'habitants.
Je fus un jour presque alarmé pour la santé morale d'un colon avec lequel je suis lié depuis longtemps, et qui vint me dire qu'il avait acheté dans la matinée le village de G*** qui est le plus beau, le plus riche et le plus peuplé de la plaine. Quelques jours après, mon service m'ayant conduit dans ce village, je demandai si en effet le territoire de G*** n'avait qu'un seul maître dont les habitants étaient les fermiers ou locataires ; mais je trouvai que chacun était bien convaincu d'être propriétaire incommutable de sa maison, de son jardin et de son que personne ne se doutait qu'un Européen l'eût acheté comme un serf de Moscovie.
Un autre colon assurait, ou plutôt était persuadé, avoir acheté un terrain de 150 zouandja (la zouandja vaut 25 arpents), en devenant propriétaire de la 10e partie de la ferme de Haouch-Toute ; mais un calcul de deux minutes lui prouva qu'à son compte, cette ferme, qui est perdue dans l'immensité de la Métidja, devait en occuper à elle seule la 10e partie.
Au reste, malgré de nombreuses déceptions, il est incontestable que beaucoup d'Européens possèdent véritablement dans la Métidja de belles et immenses terres, achetées de bonne foi et vendues de même. Ces acquisitions, fictives ou réelles, ont même dépassé la plaine, et se sont étendues jusqu'au-delà des montagnes. Quelles sont les conséquences de cet accaparement de la propriété foncière ? c'est ce que nous allons examiner.
La plupart de ceux qui achètent n'ont ni les moyens ni la volonté d'exploiter. Ils espèrent toujours qu'une nombreuse population européenne se formera en Afrique, et qu'alors ils réaliseront de gros bénéfices, en revendant leurs propriétés. Mais ils sont eux-mêmes un obstacle à l'accomplissement de ce rêve de leur ambition; car comme ce sont les travailleurs, c'est-à-dire les véritables éléments coloniaux qui devraient leur payer ce tribut, c'est sur ces derniers que serait pris le bénéfice, ce qui doit nécessairement les éloigner. En effet, un grand nombre de propriétés ont déjà été revendues plusieurs fois, et à chaque revente le prix de la cession a augmenté, parce qu'on s'est toujours cru de plus en plus près de l'époque où l'exploitation européenne sera possible, de sorte que maintenant la production se trouvera grevée de tous les bénéfices successifs de la spéculation mercantile, ce qui évidemment doit la rendre plus difficile, en la rendant plus onéreuse à ceux qui s'y livreront. Cette tendance à faire payer par le travail une prime à l'oisiveté, a quelque chose qui blesse profondément mes croyances politiques et religieuses, cependant je n'en fais pas un reproche aux particuliers, car elle est le résultat de notre organisation sociale.
Quelques spéculateurs plus éclairés que les autres, et qui voient que des prétentions trop élevées éloigneraient les travailleurs, ont le projet, lorsque ceux-ci se présenteront, de les établir sur leurs terres moyennant certaines redevances annuelles. Certainement c'est le moins qu'ils puissent exiger ; et cependant, qu'on y réfléchisse bien, si ce système prévaut, voilà la féodalité établie en Afrique.
C'est une chose digne de remarque, que de voir ainsi la vieille société européenne tendre à se constituer à Alger sur des bases qu'elle paraissait avoir brisées elle-même.
On peut donc presque dire, d'après ce que nous venons de voir, que le plus grand obstacle à la colonisation se trouve dans les colons eux-mêmes, qui ont acheté pour spéculer et non pour produire. Mais il est juste d'ajouter que si, dans le principe, le gouvernement leur eût accordé une protection plus efficace, ils auraient demandé à la production des bénéfices qu'ils furent réduits à chercher dans le brocantage. Je ne vois de remède possible aux conséquences funestes, pour l'avenir de la colonie, de l'accaparement de la propriété, qu'une mesure législative qui oblige les grands propriétaires de céder au prix de la première vente aux familles laborieuses qui voudraient s'établir dans le pays, les terres dont elles auraient besoin, et qui fixe en même temps le maximum de ce que chacun pourra posséder. Il est évident que ce n'est qu'en offrant ces avantages et ces garanties aux producteurs qu'on les attirera à Alger ; car ils n'y viendront certainement pas pour être les vassaux des accapareurs de terre. Ceux-ci pourront bien attirer quelques familles de cultivateurs équivoques, qui prendront la charrue comme un pis aller ; mais pour de véritables agriculteurs, hommes d'ordre, de travail et de persévérance, on ne les aura qu'en les rendant propriétaires.
Ces observations ne doivent blesser personne. En y réfléchissant bien, les acquéreurs de terre en reconnaîtront eux-mêmes la justesse. La plupart appartiennent par leur modeste origine à des familles qui n'ont dû qu'à la révolution de 89 leur complète émancipation, et ils comprendront combien serait ridicule chez eux la prétention de devenir seigneurs terriers, exploitants de prolétaires, prétention déjà si odieuse par elle-même. Au reste, leur propre intérêt le veut ainsi, car en agissant autrement, ils détermineraient leur ruine, en même temps que celle de la colonie.
Plusieurs Européens d'Alger comprennent très bien la question ; j'en connais même un qui, quoique propriétaire de plusieurs fermes, voudrait que le gouvernement mît le séquestre sur toutes les propriétés européennes de la plaine, et les distribuât ensuite par lots à ceux qui se présenteraient avec les moyens et la volonté de les cultiver.
Il est d'autant plus à espérer que les accapareurs de terre sentiront les inconvénients de leur système, que ce n'est que forcément, ainsi que nous l'avons laissé entrevoir plus haut, qu'ils ont donné dans le principe cette funeste direction à leurs entreprises. Dans l'origine on acheta pour exploiter, et dès le printemps de 1831 quelques fermes furent mises en valeur. Le docteur Chevrau, excellent homme, dont la perte encore récente à laissé de vifs regrets à Alger, MM. Faugeroux frères, MM. Roche et Colombon, se livraient à des essais de culture, que le succès paraissait devoir couronner. Ces derniers avaient même établi des travailleurs européens dans une ferme acquise par eux à Beni-Mouça, à une lieue et demie de la Ferme-Modèle. Ces exemples étaient imités dans les environs d'Alger ; mais lorsque l'on vit qu'en dehors de nos lignes, la guerre, sans cesse excitée par la fausse politique de nos gouvernants, venait détruire ce que le travail tendait à créer ; et qu'à l'intérieur, les produits agricoles étaient souvent la proie de ceux qui devaient les défendre, les exploitations languirent, et on se livra, en attendant des temps meilleurs, au brocantage des terres, exemple fatal, bientôt suivi par une foule de gens qui en firent un métier, sans avoir jamais eu la moindre velléité de culture.
Le gouvernement, cause première de cette déviation de l'activité coloniale, ne fit rien pour en arrêter les conséquences. Il établit un droit d'enregistrement, et s'applaudit sans doute d'avoir ainsi augmenté ses recettes de quelques milliers de francs. Cependant les achats des Européens avaient, et ont encore, pour notre politique, des inconvénients pour le moins aussi graves que ceux que je viens de signaler pour la colonisation. Les Arabes qui nous vendent des propriétés éloignées (On a acheté à Béni-Djead, à Béni-Khalissa, à Béni-Ménad, même à Béni-Menasser qui est à 25 lieues d'Alger ) le font presque toujours avec l'espérance, assez ouvertement avouée, que nous ne viendrons jamais les occuper, et qu'ils continueront à en jouir.
De sorte que chaque achat d'immeubles fait par les Européens, sur les points où nous n'avons point encore d'établissement, crée à l'occupation future une famille d'ennemis de plus. En outre, une foule d'immeubles ont été achetés à Blida, et l'administration doit s'attendre que si nous occupons jamais cette ville, elle viendra se heurter à chaque pas contre les prétentions des Européens, bien autrement exagérées que celles des Indigènes. Cependant l'occupation de Blida est indispensable, si nous voulons faire quelque chose du pays ; et voilà que ce sont des Européens qui rendent l'établissement plus difficile qu'il ne le serait sans eux ; car il est de notoriété que beaucoup n'ont acheté qu'avec l'arrière-pensée de rançonner l'administration si elle venait à avoir besoin de leurs immeubles pour les services publics. Le gouvernement n'a pas voulu le voir, quoique le fait lui ait été signalé. Il aurait été à désirer que tout achat d'immeubles eût été interdit aux Européens au-delà delà des points occupés par nos lignes ; mais le gouvernement, par son imprévoyance, s'est toujours plu à accroître ses propres embarras. Les fautes de l'administration et celles des particuliers, réagissant ainsi les unes sur les autres, nous ont mis dans une position où tout progrès sera impossible si on n'y met ordre.
Si l'administration du général Berthezène fut peu éclairée, en revanche elle fut très écrivassière ; 115 arrêtés furent signés par M. Berthezène, dont 45 formant législation ; 50 sur des objets transitoires, et 20 portant nomination à des emplois.
Dans ce nombre les dispositions fiscales jouent un très grand rôle. Le 20 mars un droit d'octroi, pour les objets de consommation apportés de l'intérieur, fut établi : le tarif réglé à cette époque fut modifié par arrêté du 30 juillet.
Le 21 mars un droit de 80 boudjous par mois (148 fr. 80 cent.) fut mis sur la boucherie juive, pour tenir lieu du droit de patente.
Le 11 juillet, ainsi que nous l'avons vu plus haut, les actes translatifs de propriété ou de jouissance, furent assujettis à un droit d'enregistrement. Le même jour le commerce du sel fut déclaré libre ; mais les introductions, par terre et par mer, furent frappées d'un droit de 3 fr. par quintal métrique, pour les sels français, et de 4 fr. pour les sels étrangers. Les sels ne furent point admis à l'entrepôt accordé pour d'autres marchandises par l'arrêté du 31 décembre 1830 ; mais le receveur des douanes fut autorisé à recevoir en paiement, sous sa responsabilité personnelle et moyennant caution, des traites à 3 mois de date, pour une moitié, et à 6 mois pour l'autre moitié des droits acquis au trésor. Le droit ne peut être restitué quelle que soit la destination ultérieure des sels qui l'ont supporté.
Le 28 juillet, un arrêté modifia quelques dispositions du tarif des douanes. Il fixa à 10 fr. par tête le droit d'exportation des bœufs et vaches ; à 12 fr. par quintal métrique, le droit sur la cire exportée sous pavillon étranger, et à 8 fr. celui de la cire exportée sous pavillon français.
Il existe quelques autres dispositions financières de l'administration de M. Berthezène, mais elles ne sont que d'un intérêt secondaire.
Pour ce qui est des domaines, le général Berthezène introduisit dans cette administration un principe dont l'expérience a démontré l'opportunité : ce fut la séparation du domaine militaire d'avec le domaine civil. Par arrêté du 26 novembre 1831, tous les immeubles appartenant au domaine, et affectés soit au casernement des troupes et au logement des officiers, soit aux magasins de l'artillerie, à ceux du génie et à ceux de l'administration militaire, furent concédés au génie militaire, qui fut chargé de leur réparation et de leur entretien. Cette mesure prévint la ruine totale des immeubles occupés par les troupes, qui étaient encore debout à l'époque où elle fut prise. Il est difficile de se faire une idée du désordre qui avait existé jusqu'alors dans l'occupation militaire.
A l'extérieur, les troupes s'étaient établies dans les maisons de campagne qui étaient à leur convenance, sans remise régulière, sans état des lieux ; en un mot, sans aucune des formalités qui devaient en assurer la conservation. A l'intérieur de la ville, lorsqu'on devait y établir des troupes et des officiers, on s'adressait au commissaire du Roi près de la municipalité, qui, sans étudier les localités, donnait mission à un de ses agents de livrer les maisons occupées. Celui-ci parcourait la ville, frappait à la première maison venue, et si on ne lui répondait pas, parce que la maison était abandonnée, soit par suite des émigrations, soit par l'absence momentanée des propriétaires, il faisait enfoncer la porte, et livrait ce local à l'occupation militaire, sans autre formalité. On conçoit que cette manière de procéder devait conduire immanquablement à la perte de tous les immeubles affectés au casernement, puisque personne n'était responsable de leurs dégradations, ni chargé de leur entretien. L'arrêté du 26 novembre mit un terme à ces abus.
Le général Berthezène avait déjà diminué en partie les inconvénients de l'occupation militaire, par la construction des casernes de Mustapha-Pacha, situées hors la ville, au-delà du faubourg Bab-Azoun. Cet édifice, dont le plan avait été fait sous le maréchal Clauzel, est une agglomération de bâtiments en pisé, à un seul étage, à toiture et terrasse à la manière du pays, et disposés parallèlement comme les baraques d'un camp. Il peut contenir 2,000 hommes. Les travaux commencèrent au mois de mars et furent terminées au mois d'octobre. Cet édifice, peu brillant, mais extrêmement utile, fait honneur à l'administration du général Berthezène.
D'autres travaux non moins utiles furent exécutés à cette époque. La jetée qui joint le rocher de la Marine au continent, et forme le port d'Alger, était tellement endommagée du côté de la dune de l'ouest, que l'existence des vastes magasins qui y sont situés était menacée. Elle fut réparée, avec autant d'habileté que de promptitude, par M. Noël, ingénieur hydraulique, chargé spécialement de cette mission. Un abattoir fut construit hors de la porte Bab-Azoun, par entreprise, et sous la direction de la municipalité. M, Melchior, maître maçon, qui en fut tout à la fois l'entrepreneur et l'architecte, y déploya des talents, et surtout une louable probité, qui le recommandèrent à la confiance publique, et lui valurent plus tard des avantages réels honorablement acquis.
On établit aussi 6 moulins à vent en dehors de la porte Bab-El-Oued. Les machines avaient été confectionnées en France, sous la direction d'officiers du génie ; mais les tours furent construites par entreprise, sous celle de la municipalité, qui en fit ensuite la remise au domaine militaire. Ces moulins placés dans un lieu où les vents sont variables et neutralisés par le reflux de l'air, qui tourbillonne dans une vaste gorge du Bouzaréa, ne fonctionnant presque jamais, leur construction donna lieu au premier exemple de cette violation des tombeaux dont on s'est fait un jeu depuis. Malgré la vive et juste indignation qu'elle faisait naître chez les Musulmans, les tours furent élevées sur les limites d'un cimetière, et l'entrepreneur, M. Zedda, trouva fort commode d'y employer les pierres sépulcrales qu'il avait sous la main. Cette méthode économique de se procurer des matériaux, augmenta en effet les bénéfices ; mais on assure que, pour se faire pardonner la profanation dont il s'était rendu coupable, il fut obligé de les partager avec le chef de la municipalité.
Avant notre arrivée à Alger, il n'existait pas dans cette ville de place, de forum proprement dit. Les marchés se tenaient sous des portiques, ce qui certainement était beaucoup plus commode, vu la chaleur du climat. Cependant, comme nos habitudes exigent une place, et qu'ensuite on désirait avoir un lieu de ralliement pour la garnison, on commença, sous l'administration de M. de Bourmont, à agrandir, par la démolition des maisons voisines, le petit espace quadrangulaire qui se trouvait au centre de la ville, en face de l'entrée principalement du vieux palais de la Djenina. Ce fut l'origine de la place du gouvernement que l'on a depuis longtemps le projet d'entourer de beaux édifices. M. le général Berthezène alloua au génie militaire (il n'était pas encore question à cette époque des Ponts-et-Chaussées) une somme de 20,000 fr. pour les premiers travaux de cette place, elle fut employée à la consolidation et aux réparations des beaux magasins voûtés qui sont en dessous.
A cette époque, les généraux en chef pouvaient disposer de plus de fonds qu'à présent, car ils réglaient eux-mêmes, comme nous l'avons dit plus haut, le budget des dépenses civiles, et même le mode de comptabilité.
Il nous reste, pour terminer ce que nous avions à dire de l'administration civile de M. Berthezène, à parler de ses actes relatifs à la municipalité, à l'agriculture, au commerce, et à la police.
M. Cadet Devaux avait fait entrer dans ses prévisions la nécessité d'une forte réserve en grains. Il en acheta 10,000 mesures, qu'il laissa tellement avarier par faute de soin, qu'il fallut les jeter ou les vendre à vil prix. Cette réserve fut alors fixée à 4,000 mesures, et ce fut le fermier de la Racheba qui dut la fournir ; mais il ne l'eut jamais. C'est le fermier du marché aux grains : il avait le privilège d'interdire la vente des grains ailleurs que dans le marché, et recevait un droit pour chaque meure vendue. Il payai au gouvernement une redevance de 25,000 fr. pour ce privilège.
Le 21 juin, un arrêté fixa à un an la durée des fonctions du chef de la nation juive, et régla qu'il serait nommé par le général en chef, sur une liste de trois candidats présentés par les notables Hébreux. Ce même arrêté mit auprès du chef de la nation juive, un conseil composé de trois membres également nommés par le général en chef, sur une liste triple de candidats.
Le 4 septembre, un arrêté, prenant en considération les dévastations qui se commettaient dans les environs d'Alger, et qui devaient détruire toute végétation, défendit la coupe des arbres, et mit en vigueur le dispositions forestières des lois françaises.
Le 15 juillet, l'introduction des céréales fut affranchie de tout droit. Lorsque cet arrêté fut promulgue, nous étions bloqués dans nos lignes par les Arabes. C'était après la funeste retraite de Médéah, dont nous parlerons dans le livre suivant, et on ne recevait plus rien de l'intérieur.
Le 24 mars, le port d'armes fut interdit à tous les Arabes de l'arrondissement d'Alger, sous peine de mort, sauf à ceux qui auraient une autorisation des Kaïds ou des Cheiks. Les délinquants durent être traduits devant l'autorité prévôtale. Cet arrêté est un non-sens continuel ; car M. Berthezène, qui n'a jamais occupé que quelques postes hors d'Alger, et qui n'a pris aucune mesure pour asseoir son autorité sur les Arabes, n'avait pas plus de prise sur ceux de l'arrondissement d'Alger que sur ceux du Yémen. Ensuite, qu'est-ce que l'autorité prévôtale, pour l'administration de la justice, après l'arrêté constitutif du 22 octobre qui n'en parle pas ?
Le 9 juin, parut un arrêté qui soumit à des formalités très gênantes le commerce des métaux, et autres matières propres à la confection des armes, et prescrivit de nouvelles dispositions pour les débits de poudre qui, comme nous le savons déjà, n'existaient pas.
Le 1er août, un arrêté rendu sous l'impression de la retraite de Médéah, prononça la peine de mort contre tout indigène qui ne ferait pas la déclaration des armes et des munitions qu'il aurait chez lui.
Le commerce des fers et aciers fut rendu à la liberté le 7 septembre.
M. le général Berthezène prit encore sur l'administration de la justice quelques dispositions, que nous allons faire connaître.
L'arrêté du 22 octobre 1830 ne disait pas devant qui seraient portés les appels des jugements correctionnels. Il était évident que, dans l'esprit du législateur, ce devait être devant la cour de justice ; mais enfin il fallait l'exprimer, c'est ce que fit un arrêté du 9 juin.
Le 20 juin, une commission fut créée pour la révision des arrêtés rendus sur la justice, mais cette mesure n'eut aucun résultat.
M. le général Berthezène, dans le cours de son administration, rendit quelques arrêtés confirmatifs ou infirmatifs de jugements prononcés par le Cadi, ce qui prouve qu'il était établi alors que le général en chef pouvait recevoir les appels en révision. Je signale ce fait, parce que plus tard une question de cette nature a amené un conflit fâcheux entre les deux premières autorités de la Régence.
|
|
CASTEL et SAHUQUET
de la famille HERNANDEZ
Envoyé par Mme Marquet
|
Robert Castel était Robert le Bègue dans La Famille Hernandez
- Que représentait La Famille Hernandez ?
- Robert Castel RC : La matrice de l'humour pieds-noirs. Jusqu'alors, seule existait la parodie du Cid en pataouète par Edmond Brua, qui avait remporté un succès local, et même algérois. La Famille Hernandez a été créée le 12 septembre 1957 en France, au théâtre Charles-de-Rochefort. Nous étions 19 amateurs sur scène, représentant toutes les composantes de la population algérienne: des Espagnols, des Français d'Algérie, des Algériens. La pièce a fait l'effet d'un petit coup de tonnerre. 15 soirées étaient prévues.
Mais les critiques parisiens, et non les moindres - Claude Sarraute, Pierre Marcabru, etc. - nous ont soutenus. Pour ma part, j'ai joué la pièce 1 700 fois.
- A quoi attribuez-vous ce succès?
-RC- A la naissance d'un style, jailli de scènes de la vie populaire algéroise, de trouvailles d'écriture et d'autodérision. Geneviève Baïlac dirigeait le Centre régional d'art dramatique d'Alger, Lucette Sahuquet, Anne Berger, moi et les autres, nous nous moquions tendrement de notre accent. Nous caricaturions nos excès et notre bonne humeur. Et puis Lucette avait du génie dans l'improvisation. Son fameux " Crie doucement ! " est intemporel. - Que racontait Purée de nous z'otres ?
- Le retour en France d'un couple de pieds-noirs. Purée de nous z'otres avait des résonances plus dramatiques que La Famille Hernandez. Après huit ans de bombes, nous étions 1 million à quitter la patrie pour rejoindre la mère patrie, à vivre un exil dans notre propre pays. Nous avions du chagrin, de la nostalgie, mais pas d'amertume, et aucune visée politique. Moi, quand je veux envoyer un message, je vais à la poste. Cela dit, nous avons peut-être su montrer que la communauté était digne de respect, à une époque où " Cinq Colonnes à la Une ", et beaucoup d'autres émissions, esquintait les Pieds-Noirs. Le message, inconscient, résidait dans la douleur de laisser de l'autre côté de la Méditerranée nos souvenirs, nos terres, nos maisons et nos morts.
Lucette SAHUQUET née le 6 septembre 1926 en Alger rencontre Robert Castel au Centre Régional d'Art Dramatique d'Alger dirigée par Geneviève Baïlac en 1956. Au cours de soirées privées, elle s'amuse avec son amie Anne Berger à créer un personnage proche de "La famille Hernandez" et demande à Robert Castel d'écrire des sketches.
Ainsi leur premier spectacle "Scènes de la vie algérienne" allait au fil des improvisations devenir "La famille Hernandez" de Geneviève Baïlac.C'est le 17 septembre 1957 que "La famille Hernandez" est créée au "Théâtre Charles de Rochefort" à Paris avec la troupe du CRAD d'Alger: Lucette Sahuquet et Robert Castel entre autres et une débutante nommée Marthe Villalonga. Cette pièce qui évoque la vie des Pieds-Noirs dans l'Algérie Française de la fin des années cinquante est un succès immédiat et la pièce sera jouée près de mille-huit-cents fois en France (Théâtre du Gymnase en 1958 ou Théâtre Antoine en 1960) et à l'étranger.
 La famille HERNANDEZ 1957
La famille HERNANDEZ 1957 SAHUQUET et CASTEL 1963 la purée de nouz'otres !
SAHUQUET et CASTEL 1963 la purée de nouz'otres !
Après l'indépendance de l'Algérie, le couple s'installe définitivement à Paris. En 1962, Lucette Sahuquet et Robert Castel jouent à l'Olympia des sketches orientés sur la vie des Pieds-Noirs. A cette occasion, leur prestation est gravée sur disque par le label RCA. Par la suite, ils signeront chez Barclay et enregistrerons plusieurs 45 tours qui remporteront un certains succès. En 1963, ils écrivent avec Jacques Bedos une fantaisie musicale intitulée "Purée de nous z'ôtres" qui relate le retour d'un couple de Pieds-Noirs en France. Créée au Théâtre des Trois Baudets, cette pièce sera donnée plus de cinq cents fois, Marthe Villalonga complétant la distribution.
|
|
De Tassin... à Hermillon.
ECHO D'ORANIE - N°253
|
Aux liens qui nous unissent
Enfants rebelles, Savoisiens d'Hermillon,
Petit village, aux maisons coiffées d'ardoises,
Assis, sur un flanc du massif de la Vanoise,
Vous partiez un jour, vers ce bel horizon.
Emplis de rêves pour lendemains envieux
Façonnés par cet homme, à l'esprit érudit,
Qui donnait à ce groupe un espoir inédit,
Pendant ces douces veillées, aux moments heureux.
Emigrants, aux valises pleines de courage,
De volonté et d'un bel amour de la terre,
Qu'aucun sol n'arrête, même le plus austère,
Ils avaient aux yeux, les plus beaux mirages.
Privations, sacrifices ont dû dresser,
L'homme et les épreuves, face à face luttant,
Que l'unité de groupe, dans ces durs instants,
A su, dans cette belle harmonie, triompher.
Naissance d'un monde où, les chemins et jardins
Dominent les belles et fertiles prairies,
Présageant des moments de petits paradis,
Vivre en ce village, qu'on appelle... Tassin.
Algérie, rejetés de ta terre aussi pure,
Nos racines coupées d'avec toi, beau pays,
Ici, gisent nos morts, et nous t'avons bâti,
Sous ce soleil ardent, dans le bleu de l'azur.
Vous, qui recherchez à raviver ce passé,
Vers l'âme d'Hermillon, d'où l'espoir fut parti,
Réunir les enfants, de vos parents hardis,
Vous comblez nos cœurs d'émotions éprouvées.
Pour ces recherches et rencontres réussies,
Valérie Darbel soyez-en remerciée.
J.P. SIBONI Juillet 97
|
|
|
LES ŒUVRES DE MUSETTE
LE MARIAGE DE CAGAYOUS
|
|
CHAPITRE VIII
Les Fiançailles
Après qu'on s'a donné la langue comme l'habitude elle veut, nous avons fait le manger de les fiançailles, à la maison, vec la tabe anrangée dessur la terrasse qu'on s'avait levé les pots des fleurs, les caisses, les cages et tout, pour qui aye la place. Y avait moi, Mamoiselle Thérésine, Madame Solano, mon père qu'il est aveugue, le pôvre, ma mère qu'elle mange rien que le café au lait, Chicanelle, Mecieu Hoc et Scaragolette qui s'a attrapé une pistache niméro ouahad. Ce petit salaud, il a voulu monter par force dessur la tabe pour chanter une chose qu'on chante de fans les rues et qui s'a appris tout seul. De tant que c'est plein des saloperies, s'a fallu qu'on s'emporte à Scaragolette dehiors oùsque y s'a f.. à g.. et à lancer des coups de pied tant qui peut.
Tout son père craché c'est, elle dit Chicanelle à la compagnie, pour pas qu'on se pense que, elle, elle a fait son petit toute seule, et que son sang à elle, c'est rien que le miel pur.
Mécieu Hoc, qu'il avait un peu la tasse, y se pélotait le pied à Madame Solano par en dessous la tabe, en disant comme ça que le bon dieu il est pas juste.
- A cause, ho ? Elle dit ma mère qu'elle aime pas qu'on parle mal dessur la réligion.
- À cause qui m'a laissé tout seul dessur la terre, y dit Mécieu Hoc, triste, et que mon cœur y veut pas venir vieux.
- Pourquoi vous le portez pas à la Goutte du lait ? Elle répond ma sœur.
Oilà que du temps qu'elle dit ça, Madame Solano elle y fout une poussée à Mecieu Hoc qui se tombe un verre plein du vin dessur son pantalon.
- Bous abez pas pas fini dé mé gratouiller mes engélures abec vote pié, vieille choffor qué bous êtes ! Cé escandalose, al final ! Bous bous fotez del pople où quoi !
- Maman, maman, je t'en prie, reste tranquille, elle dit Mamoiselle Thérésine, Mecieu Hoc il a pas fait esprès.
- Yo no vo pas que Mouchou Hoc, perIo cé qué dis, y se prend mon pie per one coffin de figues. Per Dios, manquarait plou qué mé toqua la barrique ossi ! Aspèce dé... dé... dé... poutéro !
Mecieu Hoc y perd la figure quand il entend ça qu'elle dit la vieille. Y s'a arréculé sa chaise, et il a dit qu'il a pas voulu y lever le respèque à Madame Solano, et qui s'a pensé qui s'amuse vec lui par en dessous le tabe.
Aïe qué rire ma soeur elle se tord du temps qu'elle s'en déshabille à Scaragolette pour qui se couche ; mon père et ma mère aussi y rigolent ; tout le monde on rit et, à la fin, Madame Solano elle s'a f….. à rigoler comme les autes tous.
Rien que Mecieu Hoc y reste sérieux, vec la figure malade. Plus rien y boit, plus rien y mange. Même que la pipe y s'allume pas, de la pétouche que Madame Solano elle y rentre dedans sa gargamelle.
A huit heures, comme ça, nous avons parti à le tréâte, en disant à mon père et a ma mère qui font entention à le pelit qu'on l'a couché.
Pas même on li paye le fauteuil à le gouverneur, Mecieu Hoc il a pas voulu venir vec nous autes.
Un qui fait les contremarques y m'avait soigi une loge de les galeries, taîba, d'aousqu'on voit tout, bien, sans que rien y l'empèche en devant.
La Favorite on joue.
Madame Solano jamais elle s'avait f…. ses pieds dedans un tréàte véritable. Une fois, basta, elle s'a vu La passion dedans le tréàte spagniol de l'Amistad, en dessous le boulevard. Oilà, en montant les escayers, elle commence de crier un tas des " réfotré " des "Jésous ", des " pougnètes " que le monde y s'arrétourne pour voir s'y sort pas
Une despute.
Parle doucement, maman, que les genses y nous régarent, elle dit Mamoiselle Thérésine.
- Tou vo qué yo mé mets one cadénass por bénir al tréate ? Tou es ridicoule abec tes escroupoules dé bégolaria. Qu m'a foutoute !…
- Oilà la misique qu'elle s'attaque à I'ouverture à la favorite, j'y dis à Madame Solano, faisez entention.
Qui est-ce esté Moucou abec la cagnette qui se fatigue dé faire des molinés dessur la baraquetta qué, se tienne al mélior dé las planchas ?
- Chef d'orchestre, c'est, çuilà là y commande à tous les musiciens pour la mésure.
- Per lorss y se toqua dé bâton dessour la cabessa dé fagnats qui sé donnent pas bon mésoure ?
- Juste.
Perquoi alor'ss y dessé tranquilles à çoss là que sé joga pas rien ?
- Esprès c'est.
Le piblic y commence de faire chut en s'arrétournant ; mais Madame Solano elle s'en f'... Quand le rideau y s'a lévé et qu'elle voit les trappistes vec le père-chef promener dessur le tréâte, elle crie fort :
- Malhoroses courés qu'on s'a espoulsés dé partout, y biennent trabailler al tréate à présent. Aïe, cette répoblique del démonios qué mal qué fait ! Aone qu'elle est la favorite qu'on sé parle ?
Aspéra, ho !
Vous êtes trop pressée, elle dit ma sœur que la rogne elle y venait.
- Parle pas, va, maman, elle di Mamoiselle Thérésine, que nous comprenons pas ça qu'on dit.
Madame Solano elle a .resté tranquille un peu. Mais quand le ténor il a chanté vec la basse, elle s'a lévé pour dire une chose, et après elle s'a assis sans dire rien. Aïe, si vous arriez vu à Madame Solano quand elle a vu les danseuses à l'acque d'après. Folle elle vient. File se pensait que les femmes elles avaient venues tout nues et elle s'y lâchait une bordée des eng... et des hou ! hou ! vergogna ! salopéria ! Bolez-bous bous cacher !
Pluss le pibiic on faisait chut, pluss fort, la vieille elle g.... Chicanelle elle me tirait le panetot pour' que nous partons et Mamoiselle Thérésine elle venait blanche comme le papier.
Le règlement y veut pas qu'on parle du temps qu'on joue, j'y dis à Madame Solano. Si vous voulez pas que la poulice elle nous fait sortir à tous déhiors, faut que vous fermez vote boîte un peu.
Elle, elle a rouspété une miquette et après elle a dit rien jusqu'à l'acque qui rentre le roi.
Comme sé dit cet Mouchou ?
- Le roi d'Espagne.
- C'est one émitation, perquoi Alfonso est en viage. Et dé quoi y sé mêle esté roi d'Espagne ?
La favorite, c'est soisandisant sa maîtresse qui s'en pince pour Fernand, l'ancien trappiste, qu'à présent il a sorti officier.
- Et esté vieil couré, perquoi y sé cri à tôt et monde ?
A cause que Alphonse y veut faire le divorce vec sa femme.
- Maria santissina ! Qué malhor ! Et perqUOi y sé torne sa figoure abec la reina. No s'y a pas traboqué l'honnor, no ?
Maman.. elle dit ma fiancée à la vieille, parle pas, va, que le monde y régare !
Cailla tou ! Péitite canoule qué bous êtes ! El vieil couré il a raison dé sé toquer Alfonso ! Réfotré, que bienne qué sa vestoute Fernando. Aïe !..
De quoi vous avez, ho ?
Et perquoi y s'a rompoute la sabre ?
A la porte ! Assez ! Chut ! Enlevez-le ! Y crie le monde en s'arrétournant par le côté oùsque nous étions. Mâ, qué rogne elle tenait Chicanelle. Je vous jure le feu il y sort par chaque oeil.
Merda ! elle répond Madame Solano tous !
Reusement l'entarcque il avait venu et l'escandale y s'a arrêté. On se faisait mauvaise figure à la vieille qu'elle avait tombé son chapeau en côté l'oreille et qu'elle s'avait déboutonné un souiller pourquoi elle se tient l'ognon dedans son pieds
- Qué popIe, qué sale pople qué sé tiene Alger. No sé respéqué pas les fames, no, cé caballéros malfoutoutes qué sé mange pas assez per cagare !
Je t'en prie maman, crie pas, laisse les qui disent ça qui veulent. Qu'ça te fiche à toi ?
C'est vrai, ça, elle dit ChicaneIIe.
Du temps que les femmes elles se serchent despute, j'a sorti pour aller acheter les berlingots aigues, comme ça en se les suçant la langue à la vieille elle parle pas. Même temps, comme je me crève de fumer, j'a tiré une douzaine des bouchées, dehiors et après je m'amène à la loge vec le cornet de quate sous. Esprès pour la vieille, je m'a soigi un morceau de berlingot pareil un bloc de le môle. Vec quate comme çullà, on se monte une villa.
Oilà pour vous, j'y dise Madame Solano. Gardez qui tombe pas dessur vote ognon qui se l'aplatit comme une savate.
- Pougnéta ! Cé la roqua dé pouces d'el bagno Delsone qué Cagayus y mé porte là, elle dit la vieille en s'enfilant le berlingot dedans sa bouche qui ressemble un couffin pour la pêche.
- A présent, pour blaguer, ouallo c'est, Mamoiselle Thérésine et Chicanelle elles ont mangé des pastilles du citron et de la menthe et le rideau et s'a lévé. C'était venu le dernier acque oùsque c'est plein des frères et des soeurs qu'on fait la prière vec le vieux en côté la croix.
Quand elle voit ça, Madame Solano elle quitte le berlingot de la bouche et elle commence de faire au nom du père vec longue dessur son nez qu'elle se l'a embrassé après..
- La Favorite elle a mouru, no ? elle demande Madame Solano, doucement.
Malade elle est, j'y réponds à la vieille. Mangez le berlingot, qu'est-ce que vous avez peur ?
La vieille encore elle a enfourné le bloc ; et comme elle peut plus parler, vingà de me taper des coups vec son coude dedans le ventre pour que j'y raconte tout.
- La femme en blanc qu'elle a tombé en côté la croix, c'est la Favorite et le trappiste, c'est Fernand.
Vite elle sort le berlingot et elle dit comme ça :
Et perquoi y s'a rangé la roba?
Pour rentrer à le couvent.
Et Mouchou Fernando ossi ?
Et alorss !
No se fote del pople comme ça ! N'y a pas à aucune pais de covent qué sé mélange les hommes abec les fames. Cé t'hontose, voui Mouchou, cé t'hontose, yo Io dirai à la figure del pape..
Chut ! Silence ! A la porte ! y commence à crier le monde. Un petit vieux maigue même y s'a lévé pour eng... à Madame Solano en li criant comme ça :
- Qui c'est qu'il a rouvert la cage à cette vieille perruche ensauvée ?
Mà, si vous arrez vu qué rabia elle s'a empognée Madame Solano quand elle a entendu ça lui dit le petit vleux !
Perrouche bous même, bieille caricatoure qué bous êtes ! Foumier ! Boudjaquèro ! Borraco ! Hou !
Comme le petit vieux y s'avait lévé encore du temps qu'on fait chut ! Assis ! A la porte ! Un bacchanal première classe, il lance son berlingot dessur la figure. Grande baroufa. La Favorite était finite, grace à Dieu, aussinon on s'enlève la vieille qu'elle s'avait attrapé son souillier pour y taper à le type. Mais le mélange que le piblic y se faisait pour partir y s'a bouché l'endroit qui se tient le vieux rouspéteur.
Qué potin, elle a fait Madame Solano ! Qué tombereau des ensultes elle y sorties à l'homme ! Enragée elle avait venue. Si je la tiens pas, en sortant par la porte, elle s'escarminte un endividu qui se ressemblait un peu à le petit vieux. Chicanelle elle se mangeait la bouche de peste. Mamoiselle Thérésine elle pleurait la pôvre, de la pétouche qu'on s'arrête à sa mère,
Une fois que nous sommes été déhiors, Madame Solano elle se pose en devant de moi, vec les mains desur son ventre, et elle crie comme ça :
Cagayus, bous êtes témoin qué yo été ensoultée en poublic per un vieil chiffonnéro qué m'a faite envergogner la figoure.
Vous y avez poché l'œil vec le berlingot ; sami-sami vous êtes. Pas besoin réclamer, allez ! .
La vieille encore elle grogne comme un chien qu'on y touche l'os. Pour pas qu'elle pense tout le temps dessur la baroufa, que ça fait faire la bile à ma fiancée et ma soeur, j'y a parlé :
Et ben, comment que c'est La Favorite. Taïba, hein ?
- Malabarraca, elle répond Madame Solano. No cé finit jouste.
- C'est pas jouli, ho ?
- AI total, parson né sé conné pas ça qué Fernando y débienne, Cagayus ?
De quoi !
- Si bous ténez on poco d'afficion per moâ qué vo bé débénir vote.. belle-mare, bous bous trottarez al fond el tréâte per saboir ça qué débiene Fernando ?
Vous voulez que je m'en vais demander à les artisses ça qu'on fait après la pièce ?
Amane !
Ben ségur, et perquoi non ?
II est trop tard à présent, maman, elle dit Mamoiselle Térésine ; après nous trouvons plus le tramélec pour rentrer à la maison.
C'est vrai, ça, y dit Chicanelle en me f…. une poussée comme si ça serait ma faute à moi tout ça qu'il arrive.
Demain matin, je marche à chez le Directeur j'y dis à Madame Solano. Faisez pantience.
La vieille elle a bougé la tête et après elle s'a assis dessur l'escayer pour s'anranger les boutons à son souillier vec l'éplingue à cheveux. C'qui parait que l'ognon qui s'a poussé dessur son pied y veut rien savoir.
- Aïe Jésous, qué mal qué mé fait ! Mé monté la dolor jousqu'al mélie qué mé cope la mécanica dé lé piés.
Pêche toi, va, que bientôt y a plus la place dedans le tramelec, elle dit Mamoiselle Thérésine.
Sûr que nous allons coucher ici, elle dit Chicanelle que la moutarde elle y monte dedans le nez. Dommage qui aye pas une charrette arabe pour qu'on nous porte à la maison vec la bougie dedans la bouteille cassee.
Aïe qué dolor, qué dolor qué mé fait ? Des agouilles, cé !
Tous les tramélecs v z'avaient f.. le camp sargés du monde. Dessur la place y reste une calèche, basta. Je me sors la monnaie de dedans la ceinture pour voir à le bec de gaz si y a moillien et après je I'appelle à le cocher pour qui s'amène.
Oilà la calèche qu'elle vient, et qui je me vois ? Chambignon. Atso !
Saha, fils, y me dit lui ; tu prends à l'heure ou à la course ?
Quand ma soeur elle a vu à le père naturel Scaragolette en devant de elle, elle a sauté en l'air comme si elle s'arrait tombée dessur le ressort de les canapés.
Dis rien, j'y dis à Chicanelle doucement aussinon y va sortir un escandale que le mariage y se casse.
Chicanelle elle a resté tranquille un peu pour que Madame Solano elle monte vec ma fiancée. Après elle a monté et pis moi.
Allume, j'y commande à le cocher, et gare que tes ch'vaux y rentrent pas dedans chaque café qui a dessur la route.
Pour faire son malin, Chambignon il y a donné les bruides à les betes, vec un coup de longe en côté les oreilles pour faire le démarrage Régence. Ça fait que, vec la secousse, nous s'avons embrassés tous ensembe et que j'a posé mon pied dessur son ognon malade à Madame Solano qu'elle s'a f... à g... comme la sirène à les remorqueurs.
Pourquoi vous vous quittez pas le souillier, j'y dis à Madame Solano ?
No sé podais pas, perquoi ça mé benou l'enfloure.
Aussi c'est toi que ti as voulu que je te prête mes bottines, elle dit Mamoiselle Thérésine ! Si ti arrais mis tes tiennes ça serait pas arrivé, oilà !
Cé la houmidité que mé fait soffrir, aspèce de borriqua qué tou es !
Ma soeur elle s'avait tourné la figure devant la calèche et chaque moment elle parlait doucement : grand lâche ! grand lâche ! Et le petit ?... Bâtard y reste ? Grand lâche!..Et vingà de cracher.
A la fin, à la fin, Madame Solano du temps que j'y touche un peu sa main sans faire semblant à ma fiancée, elle demande à Chicanelle de quoi elle a.
Bous bous amusez dé faire la récitacion des vernes à lé cocher ?
Non. Je me pense entre moi-même que la poulice elle arrêterait a tous les mauvaises genses qu'y a dedans la rue, y a boucoup des endividus qui s'en croyent qu'on serait en galère.
Prémier qu'on s'en angancharait al pétit mouchou qué yo li a a foutoute al berlingote à sa fatcha dé vieille navète.
Y en a qui sont pluss crapule que çuilà que vous parlez et qu'on les laisse tranquille, va. La canaille toujours elle gagne dessur les honnêtes genses.
Yo no dis pas qué non.
Qu'est-ce vous voulez qui fait un pôvre enfant qu'il a pas le nom pour manger, à présent que le monde il est si méchant ?
Et ossi qué ya des parsons que sé tiennent lé nom et qué sé tiennent pas la garaine per sortir on infant bibant. Cé l'injoustice del sort, ma fille.
On a beau dire, allez, quand même les hommes y sont lâches.
Ben ségur qué si la providencia sé débait arrécommencer à l'monde, qué no sé fabriquerait plous à aucoune homme.
En tendant ça qu'elle parlait sa mère vec ma sœur, ma fiancée elle rigolait et moi aussi. Chaque femme qu'on se l'a larguée et chaque femme qu'elle s'a perdu l'amour à force de marcher dessur l'almanach, faut qu'on se crache dessur les hommes. Les hommes c'est pareil : Çuilà qu'il a plus le pétrole dedans sa lampe, comme çuilà qu'on se l'a jété, forcé qui se cassent le morceau dessur les femmes. C'empêche pas que toujours on se fait l'amour partout, pas vrai ?
La calèche elle s'avait arrivée en devant sa maison à Madame Solano. Pour pas que Chicanelle elle profite que nous restons nous autes deux vec chambignon pour y chercher chicane, j'a payé la course et nous avons marché jusqu'à la porte.
Madame Solano que son pied il avait venu gros, elle poudait pas bouger ; ça fait que nous l'avons porté moi et Mamoiselle Thérésine en dessous les bras en haut sa chambre. Vite en cachette, j'y a posé un bous qui doit rien à personne à ma fiancée quelle m'a fait la monnaie tout de suite et après, vingà de partir vec Chicanelle qu'elle m'attend en bas la porte.
A demain hein ? Elle crie Mamoiselle Thérésine.
- J'envoye pas le remplaçant, va !
Encore le goût y m'avait venu de monter l'escayer, mais ma soeur elle m'a tenu le panetot et nous avons marché à la maison.
Qu'est-ce qui t'a dit Chambignon ? elle demande Chicanelle.
Y m'a dit : Entention tu me donnes pas les ravachols, pas pluss.
Y t'a dit rien dessur le petit, dis la vérité !
J'te jure !
Le papier timbré faut que j'y envoye à ce fégnant pour qui bouge.
Pantience, va, Attends que je me I'attrape dedans un coin ! Il a pas fini de c…..
Laisse-le qui crève, ça vaut mieux !
Ma soeur elle se tenait un boeuf d'attaque. Une fois que nous avons allumé la bougie pour rentrer dedans note, chambre chaque, elle m'a dit comme ça :
Ecoute, Cagayous, personne y te force que tu te maries ; tu fais comme tu veux ; Moi ça me régare pas. Après si y sort des desputes rapport à ta belle-mère c'est toi que tu l'arras voulu. Bonsoir.
(A suivre)
|
|
La fontaine
Aïn El Acir (Yacine)
par Annaba-Patrimoine | Août 19, 2016
PRÉSENTATION
|
La Fontaine " Ain el Acir " traduite en français la fontaine du captif, se trouve à Ardh El khatib, l'actuel quartier du Caroubier, plus exactement rue de la Fontaine Romaine, à Annaba. Située au dessous de la Casbah (la citadelle) et à 600 m de la mer, elle surplombe le ravin de la plage du Lever de l'Aurore, anciennement Raml Ezabib.
Elle fut d'ailleurs la première escale des militaires français lors de leur débarquement en mars 1832 sur cette même plage et constitua un passage militaire stratégique pour la Casbah.
 Plan de situation
Plan de situation
 Photo ancienne de la fontaine
Photo ancienne de la fontaine
 Photo souvenir d'une femme européenne au début du XXe siècle
Photo souvenir d'une femme européenne au début du XXe siècle

Plus tard, au 20ème siècle, elle devint un lieu de détente et de repos, objet de visites lors de sorties scolaires. Et l'été, les visiteurs y venaient se rafraîchir et admirer la vue panoramique sur le front de mer.
Elle fut appelée à tort pendant la période française " la fontaine romaine " car les français à leur arrivée croyaient qu'ils s'agissait d'un vestige romain; et encore aujourd'hui une partie de son nom, " Acir ", se trouve déformée en " Yacine ".
Reconstitution de la fontaine Aïn El Acir
HISTORIQUE
La fontaine date probablement du 18e siècle. Son style rococo, une tendance artistique et architecturale qui se développa en Europe entre 1700 et 1790, le laisse du moins largement penser .
Les témoignages de la population rapportés par les historiens racontent que ce monument serait l'œuvre d'un captif européen. Le monument constituerait un moyen de se racheter ou de gagner la liberté pour ce captif, qui aurait probablement été hébergé au Kasrayne (les deux palais), non loin du Pont de la Tranchée, à 700 m de la fontaine. Ce palais fut construit par les ottomans, en deux ailes : l'une réservée à l'accueil des contres corsaires et leur butin, l'autre destinée à l'hébergement des prisonniers.
 Emplacement du Kasreyne
Emplacement du Kasreyne
 Vue du square de la fontaine " Ardh El Khatib "
Vue du square de la fontaine " Ardh El Khatib "
Car employer le savoir faire des captifs européens, faisait partie de la politique ottomane, à l'exemple du médecin captif italien Pascal Gamisot acheté par Salah Bey en 1771 et qui devient son médecin personnel, ou encore l'espagnol Sanchez, chirurgien à l'hôpital chrétien d'Alger en 1786.
Aujourd'hui, la fontaine " Aïn El Acir " est la dernière des quatre fontaines monumentales qui existaient à l'époque ottomane, après la disparition de Aïn Jerada, rue d' Alger, Aïn Chraïet, et Haoud Soukène rue El Fida, situées à la médina. Elles disposaient d'un dôme revêtu de faïences, d'un bassin en marbre et d'un enclos en fer forgé.

On comptait à cette époque une trentaine de bouches d'eau. Afin d'assurer le bon fonctionnement des fontaines et leur entretien dans le Sanjak Bleb El Anneb (Annaba), un responsable nommé " Caïd El Ayoune " était spécialement désigné par le Khalifa.
L'autorité de ce caïd s'exerçait aussi hors des remparts de la ville, pour le captage des sources, le financement des constructions hydrauliques à l'aide des subventions dont il bénéficiait auprès du beylik (les provinces).
Il est vraisemblable que de lui dépendaient les porteurs d'eau, appelés " sakka ", et qui pour des raisons plus humanitaires que professionnelles avaient droit aux repas offerts par les habitants de la médina. Cette tradition existe toujours chez certaines familles Annabis qui n'hésitent pas à offrir le déjeuner dès que les employés de l'Algérienne des Eaux effectuent des interventions dans les quartiers.
Une fontaine au style similaire, à Alger
ARCHITECTURE
 Reconstitution 3D de la fontaine
STYLE
Reconstitution 3D de la fontaine
STYLE
La fontaine Aïn El Acir avec son aspect pittoresque constitue une pièce unique en Algérie. Un mélange de style, entre la beauté de la faïence mauresque et le marbre blanc de Grèce.
Un témoin fort du style " rococo ", cet art décoratif qui se développa, comme nous l'avons dit plus haut, entre 1700 et 1790. Informe et surchargé, ce style est une fusion des styles rocaille et baroque.
Il se reconnait, dans l'architecture, aux lignes courbes et asymétriques rappelant les volutes des coquillages ou encore aux motifs mêlant fleurs, feuilles, fruits, rubans, etc. C'est le cas de la fontaine Aïn El Acir.
Détails de la sculpture de la fontaine :
Le capitaine Maitrot décrit avec détails la composition de la fontaine comme suit :
Elle (la fontaine) se compose d'une belle plaque de marbre blanc sculptée en demi-relief, mais en retrait, par rapport à la partie polie restée plane.
Le pourtour : est formé par un cadre à un boudin, un listel, un talon, un listel et un boudin de 0,11 m de largeur et fait en briques et ciment. Cet encadrement est moderne.
Le massif est en briques : il est actuellement complètement enterré et il a fallu creuser une tranchée en pente de 1,00 m environ, au point le plus bas, pour pouvoir l'atteindre.
Plaques de marbre : le devant de la fontaine est formé par une plaque de marbre blanc de Grèce. Celle-ci, haute de 1,50 m et large de 0,80 m, est divisée en quatre parties. Les deux premières sont circonscrites l'une à l'autre et occupent exactement l'intérieur du cintre de 0,40m de rayon, formé par le haut du monument.
1- La première : de 0,10 m de largeur, est plane et polie ;
2- La seconde : est en retrait de 10 à 15 mm et porte en demi-relief un vase formé de feuilles d'acanthe et chargé de six roses épanouies, disposées comme le seraient des oranges dans une corbeille : 3, 2 et 1, et entourées d'un rayonnement de feuilles. Des enroulements de feuilles d'acanthe et un écusson fleurdelisé forment, autour de ce motif, un cercle accosté à droite et à gauche d'un attribut en forme de médaillon du style dit cinq cent cents, c'est à dire formé de feuilles débordant les unes des autres.
3- La troisième partie : de 0,28 m de hauteur et de 0,80 m de largeur, est comprise entre deux baguettes polies de 0,015 m d'épaisseur dont la supérieure se termine, à chaque extrémité, par une accolade en rideau soulevé.
Un médaillon central, en demi-relief comme les autres motifs, est entouré de volutes capricieuses dans lesquelles le cinq cents domine. On remarque même. aux angles inférieurs, des cornes d'abondance desquelles déborde la feuille chère aux Grecs. Mais il est à remarquer que tous les motifs feuillagés du VI e siècle sont agrémentés de volutes du XVIIIème siècle.
4- La quatrième partie : de 0,88 de hauteur, est en discordance complète avec le genre des trois autres.
Sous une arcade presque ionique, de 0,05 m d'épaisseur et de 0,15 m de rayon, se trouve un motif assez compliqué de 0,83 m de hauteur.
Le vase : c'est d'abord un vase fait de deux volutes inversées, feuillagées en acanthe et réunies sur une triple feuille de rose. Il repose par pied formé de deux folioles collées à la tige et reposant sur cinq feuilles d'acanthe formant chevalet. Du vase sortent des demi-volutes reposant sur des feuilles de rose. Enfin d'une double feuille d'acanthe, sort un vase de même forme que celui du bas, sauf le pied qui est effilé au lieu de s'épanouir en cinq feuilles et est formé de trois feuilles de rose en godet.
Sur ce vase, sont disposées six roses beaucoup plus finies que celles de la première partie. Elles sont placées en pyramides 3, 2 et 1, mais le rang le plus bas est formé de trois fleurs vues du côté de la queue, de même de celle du sommet, tandis que celles du centre sont représentées du côté du cœur.
L'arcade : est supportée par deux colonnes torses à spirales inversées. Ces spirales sont doubles. L'une présente une gorgerette encadrée de deux filets au trait, l'autre est en boudin plat.
Les colonnes : sont surmontées d'un chapiteau formé de trois feuilles d'acanthe et haut de 0,05 m.
L'architrave : formée par la baguette, est supportée par deux colonnes de 0,04 m à l'astragale, en relief plat et à angles de chanfrein, et coiffées de chapiteaux presque corinthiens faits de trois feuilles sous un abaque.
Le Torre : des quatre colonnes ne repose pas sur la base, mais sur un tronc de cône aux formes curvilignes qui ressemble à un chapiteau de pilastre renversé.
Les colonnes torses : sont surmontées, au-dessus de la corniche à linteaux de l'arcade, par un petit kiosque ou une petite pagode chinoise à un étage et coiffée d'un toit à angles relevés.
Les mêmes colonnes reposent d'abord sur une double plinthe, puis sur une volute en S feuillagée dans la première courbure et terminée en feuille d'acanthe.
Les grandes colonnes : sont assises sur un dé sans corniche et avec double congé en haut et en bas, coiffé d'une double plinthe et posé sur un socle. Sur le corps du dé, se trouve en relief plat un losange vertical.
L'écoulement de l'eau : se fait par le dessus du grand vase qui représente le milieu du motif. L'eau tombe dans une vasque semi-circulaire de marbre gris clair, haute de 0,28 m.
La faïence : Les deux côtés de la fontaine sont plaqués actuellement de faïence claire, dans le ton jaune et vert, sur une hauteur de 1,32 m et une largeur de 0,44m, se détachant très nettement, sans être criard, sur un fond de ciment blanc. Au-dessus de ces deux panneaux, un petit cintre en corniche à un boudin et un H…..el de 0.03 d'épaisseur et de 0.22 de rayon, encadre une plaque de marbre blanc portant des inscriptions explicatives.
Le sol : de la tranchée est pavé à deux pentes, les murs de soutènement sont raccordés en glacis avec le sol, de façon à bien dégager la fontaine.
La grille : Une grille légère et d'un joli effet entoure tout le monument.
RESTAURATION DE LA FONTAINE
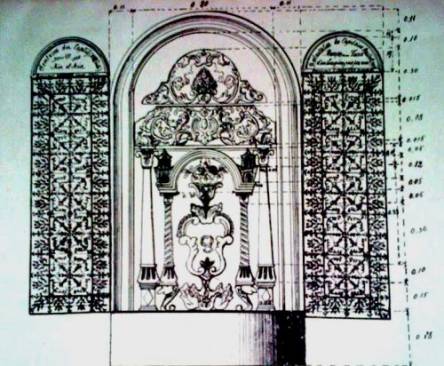 Relevé du capitaine Albert Maitrot
Relevé du capitaine Albert Maitrot
A l'époque française, plus précisément en 1913, une restauration de la fontaine fut réalisée grâce aux efforts du capitaine Albert Maitrot de La Motte-Capron.
C'était à l'occasion des fêtes du cinquantenaire de l'académie d'Hippone.
A cette occasion, il écrit d'ailleurs :
" Je suis des plus heureux de partager, avec ces Messieurs, le plaisir d'avoir arraché au vandalisme moderne ce gracieux vestige de l'époque de la Guerre en Dentelles.
 Délégation de scientifiques en visite à Hippone, 1913
Délégation de scientifiques en visite à Hippone, 1913
Ce fut-là, de la part de la municipalité de Bône, souligner d'un geste élégant et bien français l'acte exquis du grand ancêtre qui a su acheter sa liberté non d'un peu de vil métal, mais d'une œuvre d'art sans valeur commerciale, d'un étincelle du génie latin "
Deux plaquettes en marbre fut rajoutées. Celle de gauche porte l'inscription suivante :
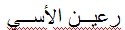 " Fontaine du captif " (XVIIIéme siécle) " Fontaine du captif " (XVIIIéme siécle)
Celle de droite donne son origine : " Rançon aux Turcs d'un Européen pris par eux ".
Au-dessous des plaquettes, ont été inscrits les noms de MM. Narbonne, maire de Bône, qui a autorisé les travaux, et Coudeyre, architecte de la commune, qui en a surveillé l'exécution.
 La fontaine après sa restauration en 1913
ÉTAT ACTUEL DE LA FONTAINE
La fontaine après sa restauration en 1913
ÉTAT ACTUEL DE LA FONTAINE

 La fontaine en 2014 La fontaine en 2015
La fontaine en 2014 La fontaine en 2015
Les fondations des constructions mitoyennes ont coupé la fontaine de sa source d'eau, probablement une nappe phréatique. Sans parler du vandalisme dont elle fait l'objet : une partie du marbre, cassée, a disparu ; la faïence est brisée elle-aussi et l'absence d'évacuation la transforme en bassin de rétention en hiver, le dysfonctionnement du réseau de drainage des eaux n'aidant pas.

 Caniveau qui inonde la fontaine
Caniveau qui inonde la fontaine
Aujourd'hui une intervention d'urgence est nécessaire pour la restauration de ce monument et son classement comme " monument national ".

Bénévolat pour la sauvegarde
de Ain El Acir le 24/05/15
Références :
Livre " Bone militaire 44 siecles de lutte" du Capitaine Maitrot
Livre " Annaba. 25 siècles de vie quotidienne et de luttes, tome II " de H'sen Derdour.
Livre " Bone, Hippone la royale tome II " d'Hubert Cataldo
Un remerciement particulier à Messieurs : Maghnine Mohamed Lamine, Dallel Arrar, Abderrazak Senouci, Attoui Réda, qui ont contribué à l'élaboration de cet article.
|
|
Illusions perdues
L'Effort Algérien N°259, du 20 janvier 1933 .
|
Le malaise économique dans L'Afrique du Nord
Pour arriver à leurs fins, les exploiteurs se sont organisés en bandes ou trusts. L'ensemble de ces trusts ressemble à une pieuvre immense étendant ses tentacules sur toute l'Afrique du Nord. Ils n'ont pas encore en leur nom propre toute la propriété foncière ni la totalité de l'industrie et du commerce, mais ils s'acheminent lentement et sûrement vers ce monopole, sous le regard béat et inconscient des pouvoirs publics.
Comment ont-ils fait main basse sur tant de biens à la fois, et comment s'apprêtent-ils à saisir ce qu'ils ne détiennent pas encore?
Comment enfin, sous un prétendu régime de liberté, la concurrence ne leur a-t-elle pas barré la route?
Si deux chevaux de courses attelés à des chars de même dimension, mais dont l'un roule à vide tandis que l'autre traîne une charge pesante, sont lancés sur une piste, de toute évidence, celui qui roule à vide laissera loin derrière lui son concurrent surchargé.
Ainsi entre deux capitalistes dont l'un observe rigoureusement les lois de la morale, de l'honneur, de la probité, tandis que l'autre a jeté hardiment par-dessus bord toutes ces vieilleries que le progrès a effacées, la lutte devient inégale sinon impossible.
Quand le franc se dévaloriserait, il parut naturel, puisque le prix de la marchandise était multiplié par le coefficient de dévalorisation, que le bénéfice le fût aussi. Mais ce calcul fort simple s'est trouvé en défaut dans les branches commerciales et industrielles où le monopole déjà ébauché faussait les lois de l'offre et de la demande et permettait aux trusts d'abaisser à leur gré les prix de vente.
En même temps le trafic de l'argent prenait des proportions inconnues et devenait la marque caractéristique de deux mentalités inconciliables. Alors que les arriérés, les rétrogrades, s'embourbaient dans leurs procédés antédiluviens de transactions honnêtes et de taux modérés, ceux que le progrès avait séduits, qu'avait conquis la théorie de l'évolution, plus vite que les aéroplanes ne franchissent l'espace, ont brûlé les étapes et jeté leur dévolu sur des champs immenses jadis réservés à l'activité de millions d'hommes de plusieurs siècles.
Comment la loi tournée, retournée, torturée de mille façons, a-t-elle servi leurs desseins ; comment la plupart des petits commerçants se sont-ils tout-à-coup et comme par miracle vu grever d'un nantissement qui les annihile ; comment la foule des petits propriétaires a-t-elle - avec épouvante - vu disparaître son bien, soit qu'il ait été acquis à vil prix, soit qu'on l'ait nanti d'hypothèques impossibles à liquider ; comment le petit colon, après avoir peiné, sué, crevé de fièvre et de misère, a-t-il été obligé de laisser ses terres à un usurier au centième du prix qu'elles lui avaient coûté ; comment beaucoup de fonctionnaires, dépités que des confrères moins méritants, et placés plus bas dans l'échelle sociale, se soient hissés par degrés et avec une rapidité vertigineuse vers des traitements de 100.000, 200.000, 500.000 et plus, se sont-ils bolchévisés, nous ne dirons pas avec raison, mais avec une rigoureuse logique ; comment les ouvriers, les employés, sont-ils devenus les instruments anonymes de patrons anonymes, et,
Réduits au rôle de machines, ont-ils senti leur dignité blessée, leur existence menacée et leur rêve d'émancipation à jamais détruit ; comment la Franc-maçonnerie, battant en brèche toutes les traditions et se toutes les forces nationales, a-t-elle réussi à garder, pour les petits monstres qu'elle a couvés, tout le fruit d'un siècle de labeur ; comment l'Etat algérien, réduit au rôle de soliveau, s'est-il borné à enregistrer tant de catastrophes et n'a t-il rien fait pour les prévenir ou en limiter les effets désastreux ?
Jean du Toile
|
Petite chronique Histoire :
d'hier à aujourd'hui
Envoyé par Marius Piedineri
|
La guerre d'Algérie dans les Mémoires de Jean-Marie Le Pen
Chers lecteurs, je viens de lire une partie du premier tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen, publiées il y a un mois aux Editions Muller. Voici un petit compte-rendu - neutre, je précise - de ce qu'il écrit sur la guerre d'Algérie, les Harkis et les Pieds-Noirs :
D'abord il admet ne pas toujours avoir eu raison, reconnaissant à de Gaulle d'avoir été plus visionnaire que lui à propos de la démographie algérienne et de la difficulté, voire l'impossibilité d'intégrer, selon lui, des dizaines de millions d'Algériens musulmans à la nation française.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il a décidé de "retourner sa veste" et d'approuver de Gaulle.
Le Pen rend un long hommage à Bastien-Thiry, Denoix de Saint-Marc, Salan, Jouhaud, et tous ceux qui se sont opposés à la politique algérienne du Général, tout en regrettant certaines violences de l'OAS (à laquelle il n'a pas appartenu), parmi lesquelles l'opération ayant défiguré la petite Delphine Renard.
Il condamne la trahison des Pieds-Noirs, des musulmans francophiles et de l'armée, et écrit : "en Algérie comme lors de la Seconde Guerre mondiale, la faute du Général touche moins son choix politique que son attitude morale", ajoutant que "la fin de la guerre d'Algérie a été bâclée sur le plan économique et politique."
Dénonçant l'illusion géopolitique d'un de Gaulle qui souhaitait se débarrasser au plus vite de l'Algérie et de ses populations pour devenir le leader des "pays non-alignés", il regrette ensuite sa décision de donner au FLN le Sahara qui n'aurait selon lui jamais dû lui appartenir, privant ainsi la France de son indépendance énergétique, de ne pas avoir "voulu sérieusement explorer les solutions intermédiaires qui auraient pu garantir les droits des populations françaises, la partition par exemple", ou négocier "l'avenir de l'Algérie avec d'autres que le FLN".
Sa position peut être résumée par ce passage, page 397 :
"Quitter l'Algérie était sans doute inéluctable, on peut même soutenir que la démographie a donné raison à long terme au général De Gaulle. Mais il y avait la manière, et la sienne fut horrible. Appelé au pouvoir par les pieds-noirs pour les sauver, il les livra au bourreau. Il a abandonné les harkis et tous les musulmans qui nous étaient attachés. En se prêtant à cette opération, l'armée décapitée s'est déshonorée. Elle a désarmé nos partisans avant de les livrer à la vindicte des fellaghas", etc.
Mais au-delà de de Gaulle, il met en cause l'ensemble de "ses contemporains" : ceux qui lui "obéirent comme" des "veaux", "à droite pour se tirer d'un guêpier qui les dépassait", et "à gauche par aveuglement idéologique".
Puis Le Pen termine en rendant un hommage au militaire musulman (sans doute parle-t-il de Rabah Khellif) qui, seul, décida d'intervenir pour sauver les Pieds-Noirs victimes de la barbarie du 5 juillet 1962, au moment où l'armée française restait l'arme au pied.
(Source : Jean-Marie Le Pen, Mémoires, Fils de la nation,
Editions Muller, 2018)
"Accords" d'Evian : 56 ans
En cette période de commémoration des 56 ans des "accords" d'Evian, voici ce que le grand ethnologue et intellectuel français Jacques Soustelle en disait deux ans après leur signature. De quoi faire réfléchir la FNACA et autres petits maires de province jamais sortis de leur village qui s'amusent à fêter le 19 mars :
"Les " garanties "[que les accords d'Evian] sont censés contenir ne sont que du vent. Elles ne sont fondées que sur la parole des négociateurs, c'est-à-dire exactement sur le néant.
Il est frappant d'observer que les Britanniques, quand ils ont quitté Chypre, où ils n'avaient pas à se préoccuper du sort d'une population d'origine anglaise, ont exigé et obtenu pour la minorité turque des garanties véritables que la France n'a même pas essayé d'obtenir pour les Européens d'Algérie. Ces garanties ont été incorporées à la Constitution, et l'indépendance n'a été accordée qu'à ce prix. La France, au contraire, a tout lâché en Algérie, et s'est contentée de vagues promesses sans consistance. Les accords d'hier ont déjà été violés mille fois dans leur esprit et dans la lettre, et ce n'est pas une métropole acquise au " dégagement ", ivre d'égoïsme, éperdue de repliement, qui ira faire un effort pour qu'on les respecte. La" dynamique de la paix " n'a pas joué, mais bien la dynamique de la capitulation.
Plus pitoyable et plus sordide encore s'il est possible que l'abandon des Européens est celui des Musulmans. Ces harkis, ces moghaznis, ces villageois des groupes d'autodéfense à qui l'armée n'a cessé de jurer qu'elle ne les livrerait pas à l'ennemi - et que soudain l'on a désarmés, jetés au couteau et au bûcher des tortionnaires : c'est un spectacle qui lève le coeur. [...]
Ainsi, sous le couvert d'Evian et à l'abri d'une phraséologie mensongère, l'Etat français aura-t-il toléré, souvent même facilité, un véritable génocide(1). Le peuple algérien de civilisation occidentale a été exterminé en tant que tel, broyé, dispersé. L'armée française l'a massacré rue d'Isly, les fellagha ont assouvi leur haine sur lui, l'immense majorité de la nation a assisté à son martyre avec une indifférence bovine. Les accords d'Evian n'ont servi qu'à une chose : fournir à cette indifférence un semblant de justification. Ils n'ont rien été, que le décor du génocide, comme une sorte de concert destiné à étouffer les cris d'un peuple assassiné. Tout redressement honnête de la vie politique française, tout retour à la vérité et à la dignité passe nécessairement par la condamnation totale de ce honteux traité, de cet acte de trahison qui sera un jour effacé de notre histoire."
(1) Je précise que je ne suis pas d'accord avec le terme de génocide utilisé par J. Soustelle. Je lui préfère ceux de nettoyage ethnique et d'ethnocide.
(Source : Jacques Soustelle, Sur une route nouvelle,
Editions du Fuseau, 1964)
Quant à moi, j'interpelle tous les historiens pour les inciter, désormais, à toujours écrire accords d'Evian avec des guillemets, puisque chacun sait depuis très longtemps maintenant que ces soi-disant "accords" n'ont toujours été respectés que par une seule des parties, la France, et systématiquement piétinés - le mot est faible - par le FLN, ce dès leur signature. La rigueur historique implique donc d'écrire "accords" d'Evian et non accords d'Evian.
Tourner la page
"Il faut tourner la page", "il faut tourner la page"... Les Pieds-Noirs connaissent la chanson. Mais cette chanson est très ancienne, comme le montre cet autre passage du livre de Jacques Soustelle :
"Un peuple qui renie une partie de lui-même, qui s'humilie devant une faction de meurtriers et lui abandonne ses propres frères, voilà ce que nous sommes devenus. Ils peuvent bien dire, les propagandistes du régime, que "la page est tournée" : cela n'est pas vrai. [...] Quand un crime a été commis et que la victime est morte, dit-on que l'assassin est innocent parce que celui qu'il a tué n'est plus en vie ? Or, un crime a été commis, à la fois le plus vil et le plus bête de notre histoire. La France ne sera redevenue la France que lorsqu'elle saura en rougir."
Ainsi comme on le voit, dès 1964, les Français d'Algérie auraient dû "tourner la page", au moment même où des centaines de familles étaient toujours en attente de nouvelles de leurs proches récemment disparus, la plupart ayant été enlevés d'ailleurs au lendemain des "accords" dits "de paix" d'Evian ! Je crois avoir trouvé le sens caché de l'expression "tournez la page", que l'on ne cesse de rabâcher aux Français d'Algérie depuis maintenant plus de 50 ans : "fermez votre bouche et disparaissez de la circulation".
Marius Piedineri
|
|

La célébrissime villa Salvatore Colli, de type mauresque située en face de la plage Saint-Cloud, à Annaba, véritable joyau du patrimoine national, puisque construite autour de 1850, a été démolie ce jour en dépit du bon sens. Qui a pris cette décision saugrenue de raser cette villa ? Qui a délivré le permis de démolir alors que plusieurs associations avaient tenté en vain de l'inscrire au patrimoine national ?
En effet, selon le site du patrimoine de Annaba, cette villa a été construite vers 1850 par son propriétaire, Salvatore Colli, qui était un tailleur de vêtements, de confession juive, d’origine andalouse. La maison est d’un style architectural singulier au regard de celui des autres habitations d’Annaba. Elle disposait même d’un jardin s’étendant jusqu’à la plage de Saint-Cloud.
Avant le début de la seconde guerre mondiale, la villa fut vendue à un notable des Chabias, un certain « Abdel Majid ZEMMOURI ». Puis, durant cette même guerre, elle fut réquisitionnée pour servir de maison de repos aux officiers anglais présents dans la région. Aujourd’hui elle appartient au descendants de M. Zemmouri.
La façade donnant sur la mer s’inspire de la mosquée de Cordoue 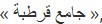 , plus précisément de ses arcs à cinq lobes (appelés polylobés), au niveau de la « maksourah » (l’enceinte réservée au calife) qui précède le Mihrab. La maison est un exemple unique à Annaba : elle exprime la beauté du style mudejar andalous. Elle reflète aussi très bien le métier de son bâtisseur et son penchant pour la sculpture, avec sa corniche en arcs entrelacés à trois lobes, ses chapiteaux, ses étoiles, etc. , plus précisément de ses arcs à cinq lobes (appelés polylobés), au niveau de la « maksourah » (l’enceinte réservée au calife) qui précède le Mihrab. La maison est un exemple unique à Annaba : elle exprime la beauté du style mudejar andalous. Elle reflète aussi très bien le métier de son bâtisseur et son penchant pour la sculpture, avec sa corniche en arcs entrelacés à trois lobes, ses chapiteaux, ses étoiles, etc.

Détail d’arcade de la villa Salvatore Colli

Arcs polylobés de la mosquée de Cordoue
La villa Salvatore Colli est orientée vers la mer. Sa terrasse est d’une échelle monumentale contrairement au reste de l’habitation dont l’échelle est plutôt conventionnelle et davantage utilitaire. Pendant les vacances, on ne vit qu’à l’extérieur : la terrasse, le jardin, la mer…
Autrefois, le jardin arrivait presque jusqu’au sable, seule une rue étroite l’en séparait. La maison est aujourd’hui dépourvue de jardin, tout comme l’ensemble des maisons de ce front de mer, du fait de l’élargissement de cette rue étroite. C’est ce qui explique également le contraste flagrant entre la façade monumentale et les modestes clôtures.
A l’intérieur de la maison, le salon est la seule pièce décorée. Il donne sur la grande loggia : ce sont les deux fenêtres à droite. Celles-ci sont très basses pour permettre une vue sur la mer depuis l’intérieur en position assise. Au milieu du salon, on trouve une belle cheminée en marbre italien, de style néo-baroque, très à la mode en 1850.
Un véritable désastre cette démolition (photo ci-dessus) qui dénote la parfaite et totale ignorance et le peu de culture des autorités locales et de ceux qui ont décidé de sa destruction alors que les habitants de la Coquette espéraient depuis des lustres une réhabilitation de cette belle maison pittoresque qui nécessitait une sérieuse restauration, car son état de dégradation était très avancé. Au lieu de cela, on a décidé de la raser.
Khidr Ali
Un crime abominable vient d’être commis à Annaba contre la célébrissime villa Salvatore Colli. Ce joyau d’architecture de style mauresque, qui fait partie de l’identité culturelle de la Coquette, vient d’être démolie par des mains incultes, insensibles aux charmes infinis de ce bijou.
Les auteurs de ce crime, qui est une agression aussi contre tous les authentiques enfants d’Annaba, sont certainement animés par le désir « culturicide » de récupérer l’assiette de terrain de ce monument situé face à la plage Saint Cloud .
Ce qui est tout aussi dramatique, c’est le silence du ministre de la culture qui a laissé faire, laisser perpétrer le crime, alors que les alertes de la part d’organisations de la société civiles n’ont eu de cesse d’être lancées.
A défaut d’empêcher cette forfaiture, Azzedine Mihoubi, qui se pique de culture et d’art aurait du exprimer au moins sa désapprobation, c’est le minimum pour un ministre de la culture digne de ce nom.
Sous d’autres cieux, où la culture n’est pas un mot de circonstances protocolaires, la démolition d’un édifice comme la villa Salvatore Colli aurait constitué un scandale d’Etat !
|
|
LES COLONS
Envoyé Par Jean-Claude Stella, 16 mars 2018
|
Mes chers amis,
J'ai décidé de défendre ceux qui parmi nous ont été les plus vilipendés : les colons. D'abord le terme est impropre car l'Algérie n'était pas une colonie. Il ne viendrait à personne l'idée d'appeler ainsi les agriculteurs de Corse.
Ils sont peu nombreux (8 % de la population européenne dont plus de la moitié ont des exploitations inférieures à 50 hectares) et n'ont pas pris les terres des musulmans. Si leurs rendements étaient supérieurs ce n'était pas parce que leurs terres étaient plus fertiles, mais parce qu'ils utilisaient des méthodes et des matériels modernes.
J'ai puisé tous les renseignements les concernant dans "L'Algérie de 1830 à 1862" de Jean-Marc VEYRON, "Étranger pour mes frères" de Jules ROY et sur différents sites d'Internet.
J'ai choisi trois exemples différents de personnalités très connues. D'abord celui d'un petit colon français PARIS qui n'a qu'un seul ouvrier agricole et qui a construit la ferme dans laquelle Jules ROY passera toute son enfance.
Puis celle d'un suisse Henri DUNANT qui n'est pas riche et qui doit emprunter pour monter une société de moulins modernes et qui se fera français dans l'espoir d'obtenir gratuitement une concession agricole. On ne s'improvise pas minotier ou agriculteur, ce sont de vrais métiers qui exigent de réelles compétences. Hélas ce n'était pas le cas pour le créateur de la Croix-Rouge. Ses affaires l'amèneront à la faillite et jusqu'à la fin de sa vie, il sera poursuivi par ses créanciers genevois.
Enfin celui d'un autre suisse, Georges-Henri BORGEAUD, qui lui n'a pas eu besoin d'emprunter pour créer la première école d'agriculture en Algérie. En investissant dans ce territoire, il a pris des risques et a réussi à faire souche. Son fils Lucien a fait l'acquisition du domaine de La Trappe et grâce à son talent l'a transformé en une exploitation agricole moderne. Son petit-fils Henri, ingénieur agronome et brillant gestionnaire, développera l'entreprise et deviendra le plus grand, sinon le plus riche colon d'Algérie.
Bien cordialement.
Jean-Claude Stella, 16 mars 2018
LES COLONS
Ferhat Abbas disait avec raison : "La France n'a pas colonisé l'Algérie. Elle l'a fondée." Le territoire algérien était formé de départements comme en Corse. Les Européens qui s'y sont installés après la conquête de 1830 n'étaient pas des colons mais des pionniers qui ont mis en valeur cette terre complètement abandonnée après l'invasion arabe. La main d'œuvre restera essentiellement européenne en 1900. Les agriculteurs étaient peu nombreux : 8 % de la population européenne dont plus de la moitié avaient des exploitations inférieures à 50 hectares. Le mot colons est impropre pour les désigner, le mot défricheurs serait plus approprié.
Dans "les villages de colonisation" ceux qui voulaient devenir cultivateurs recevaient gratuitement une concession de 2 à 10 hectares selon l'importance de la famille, leur profession, la qualité de la terre. Mais il fallait remplir deux conditions indispensables : avoir une robuste santé et de nationalité française. Ils devaient défricher et mettre en valeur leurs lots, en percevant des subventions leur permettant de s'équiper et de subsister jusqu'aux prochaines récoltes. Trois années leur étaient accordées pour le faire au terme desquelles les maisons construites au village et les champs attribués seraient définitivement acquis. Ceux qui n'auraient pas tenu leurs engagements seraient dépossédés, voire même expulsés. Ces premiers colons se mirent à entreprendre un travail de géants : défrichement, assèchement, constructions, cultures dans des conditions rudimentaires malgré les épidémies (malaria, dysenterie, typhoïde et parfois typhus) et l'insécurité que faisaient régner les bandes rebelles indigènes (les Hadjoutes en particulier).
En 1958 sur les 6 894 000 hectares utilisés par l'agriculture 2700 000 seront mis en valeur par 22035 européens surtout dans la Mitidja, la plaine de Bône et de l'Habra au prix de lourds sacrifices humains. À Boufarik, en quatre ans de 1837 à 1840, on compte sur 450 implantations enregistrées. 331 colons décédés. La mécanisation de l'agriculture en Algérie commença très tôt à la fin de la Grande Guerre. Les 4 194 000 hectares restants étaient détenus par 630 000 propriétaires musulmans, mais les rendements qu'ils obtenaient restaient faibles à cause de l'utilisation d'instruments de culture traditionnels et de méthodes de travail archaïques
 C'est à Rovigo, village de colonisation, fondé en 1850, qu'est né l'auteur des "Chevaux du soleil" Jules ROY. Il avait quatre ans quand son père le gendarme ROY apprend qu'il est le fruit d'une relation adultère et chasse la mère et le fils qui trouveront refuge chez les grands-parents maternels les PARIS à Sidi Moussa où son grand-père avait obtenu une concession vers 1854. Celui-ci avait construit une ferme composée de quatre murs grossiers, deux pignons et un mur de refend séparant la maison d'habitation de l'étable-écurie, le tout couvert de tuiles mécaniques. La maison surélevée à cause des inondations comprenait la salle à manger avec une longue table en bois patinée par l'âge et la cire, des bancs, deux ou trois chaises, des images naïves (Jean qui pleure et Jean qui rit), des calendriers offerts par les moissonneuses Mac Cormick, et, chose rare, une cheminée en souvenir de la Franche-Comté natale ; une chambre celle des grands-parents, une autre plus petite et une cuisine. L'eau, il fallait la chercher au puits dans l'arrosoir. Derrière la cave, assez vaste, avec des cuves de ciment et beaucoup de choses utiles. Le second corps abritait les bœufs et les chevaux. Devant une dizaine de noyers ramenés de Franche-Comté. Superbes et qui donnaient beaucoup de noix. Les PARIS n'étaient pas riches, ils avaient qu'une modeste orangeraie, protégée du vent par une haie de cyprès, 10 à 12 hectares de vignes et un peu de céréales pour les bêtes. C'est à Rovigo, village de colonisation, fondé en 1850, qu'est né l'auteur des "Chevaux du soleil" Jules ROY. Il avait quatre ans quand son père le gendarme ROY apprend qu'il est le fruit d'une relation adultère et chasse la mère et le fils qui trouveront refuge chez les grands-parents maternels les PARIS à Sidi Moussa où son grand-père avait obtenu une concession vers 1854. Celui-ci avait construit une ferme composée de quatre murs grossiers, deux pignons et un mur de refend séparant la maison d'habitation de l'étable-écurie, le tout couvert de tuiles mécaniques. La maison surélevée à cause des inondations comprenait la salle à manger avec une longue table en bois patinée par l'âge et la cire, des bancs, deux ou trois chaises, des images naïves (Jean qui pleure et Jean qui rit), des calendriers offerts par les moissonneuses Mac Cormick, et, chose rare, une cheminée en souvenir de la Franche-Comté natale ; une chambre celle des grands-parents, une autre plus petite et une cuisine. L'eau, il fallait la chercher au puits dans l'arrosoir. Derrière la cave, assez vaste, avec des cuves de ciment et beaucoup de choses utiles. Le second corps abritait les bœufs et les chevaux. Devant une dizaine de noyers ramenés de Franche-Comté. Superbes et qui donnaient beaucoup de noix. Les PARIS n'étaient pas riches, ils avaient qu'une modeste orangeraie, protégée du vent par une haie de cyprès, 10 à 12 hectares de vignes et un peu de céréales pour les bêtes.
La grand-mère avait quitté la ferme de ses parents à Boufarik pour s'installer à Sidi Moussa quand elle a épousé le grand-père. Quand celui-ci est mort des fièvres, elle a pris la suite. C'est elle qui commandait, c'est elle qui avait l'argent. Mais c'est l'oncle Jules qui conduisait la fermé aidé d'un seul ouvrier agricole indigène. Il ne dormait pas dans maison principale, mais s'était aménagé un logis dans les communs pour échapper à l'autorité de sa mère
Il y avait deux machines sous un hangar : une locomobile servait à battre le blé des moissons ou à défoncer la terre avec des socs énormes. La seconde, plus petite, tirait l'eau du puits dans un bassin. Bloquée sur ses roues, elle actionnait la noria. C'est dans cette modeste ferme que Jules ROY passa toute son enfance.
 Henri DUNANT, un suisse, pense que l'Algérie est un nouvel Eldorado. En 1858 il emprunte de l'argent à des banquiers genevois pour fonder la Société financière et industrielle des moulins de Mons-Djemila à Saint-Arnaud après avoir constaté que la population de Sétif était obligée de fabriquer sa farine elle-même. Mais l'autorisation de l'exploitation d'une chute d'eau pour faire fonctionner le premier moulin moderne n'arrive pas car les législations sur les cours d'eau et les terres ne sont pas claires et les autorités coloniales compétentes ne se montrent guère coopératives. En vue d'acquérir gratuitement à une concession agricole pour faire pousser du blé, il prend en 1858 la nationalité française. Henri DUNANT, un suisse, pense que l'Algérie est un nouvel Eldorado. En 1858 il emprunte de l'argent à des banquiers genevois pour fonder la Société financière et industrielle des moulins de Mons-Djemila à Saint-Arnaud après avoir constaté que la population de Sétif était obligée de fabriquer sa farine elle-même. Mais l'autorisation de l'exploitation d'une chute d'eau pour faire fonctionner le premier moulin moderne n'arrive pas car les législations sur les cours d'eau et les terres ne sont pas claires et les autorités coloniales compétentes ne se montrent guère coopératives. En vue d'acquérir gratuitement à une concession agricole pour faire pousser du blé, il prend en 1858 la nationalité française.
Une année plus tard, pour débloquer ses affaires, il décide de s'adresser directement à l'empereur Napoléon III alors que celui-ci s'est arrêté avec son armée en Lombardie. Ainsi en juin, il se trouve à proximité de la ville italienne de Solferino où il découvre les dégâts humains de la bataille qui s'y déroula. Il écrit un livre intitulé "La bataille de Solferino" qu'il publie en 1862. Une année plus tard, il participe à Genève à la fondation du Comité international de secours aux militaires blessés, désigné dès 1876 sous le nom de Comité International de la Croix-Rouge. La première convention de Genève est ratifiée en 1864 et se réfère largement à ses propositions. Premier prix Nobel de la paix en 1901, il est considéré comme le fondateur de la Croix -Rouge Internationale.
En Algérie, l'année 1865 est marquée par une série d'évènements catastrophiques : des révoltes, une épidémie de choléra, une invasion de sauterelles, des séismes, une sècheresse et un hiver inhabituellement rigoureux. Pour toutes ces raisons et aussi parce qu'il a négligé ses affaires pour promouvoir ses idées, la situation financière de DUNANT s'aggrave sensiblement.
En avril 1867 a lieu la dissolution de la société de financement participant à ses entreprises : le Crédit Genevois. Son affiliation au conseil d'administration de cette société provoque un scandale et il se trouve contraint d'annoncer la faillite de sa société alors que sa famille et des amis sont également impliqués dans ses entreprises par leurs investissements. Le 17 août il est condamné par le tribunal de commerce genevois pour faillite frauduleuse. Le 25 août il démissionne de son poste de secrétaire du Comité de la Croix-Rouge et le 8 septembre il s'en trouve complètement exclu.
En raison de l'engagement pour ses idées, ses affaires personnelles sont négligées et il s'endette encore plus, ce qui pousse son entourage à l'éviter. Entre 1874 et 1886, il poursuit une vie solitaire dans la misère matérielle, vivant notamment à Stuttgart, Rome, Corfou, Bâle et Karlsruhe. En juillet 1887 il parvient à s'installer à Heiden où il passera les dernières années de sa vie dans la dépression à l'hôpital de la ville dans la crainte d'être poursuivi par ses créanciers.
En Suisse le canton de Vaud est un canton essentiellement agricole. Il était administré par les Bourgeois, gens riches, essentiellement des propriétaires terriens, qui résidaient dans l'unique ville Lausanne. L'un d'eux, Georges-Henri BORGEAUD, ministre des cultes et de l'éducation du canton, directeur de l'école industrielle de Lausanne, décide de quitter son pays natal pour émigrer en Algérie où il pense que la chaleur du climat sera bénéfique pour sa santé.
Il y débarque en 1880 avec ses sept enfants, âgés de 14 à 22 ans. Il participe activement à la fondation de la première Ecole d'Agriculture de Rouïba qui ouvrit ses portes en février 1882. Il y enseigne et devint par la suite consul de Suisse en Algérie avant de s'éteindre, le 14 janvier 1889 à l'âge de 63 ans.
Son fils Jules lui succéde. C'est alors que les moines trappistes de Staouéli, quelques mois avant la proclamation de la séparation de l'Église et de l'État, ne pouvant couvrir les frais des désastres viticoles, décident en 1904 de mettre en vente leur domaine : 30 hectares de géraniums Rosat dont on tire 600 kg d'essence, distillée par 12 alambics ; 348 hectares de vignes… ; les caves de 130 m de long sur 18 de large ; 120 hectares de blé ; une centaine de ruches, 1800 arbres fruitiers ; prairies et forêts plantées ; le cheptel bovin, ovin et équin avec les bâtiments afférents. Avec ses deux frères Charles et Lucien, Jules en fait l'acquisition pour la somme de 15000 francs, ce qui est convenable compte tenu de l'état des lieux du moment.
En 1908, après avoir racheté les parts de ses frères, Lucien BORGEAUD reste seul propriétaire de la Trappe. Négociant en tissus, doué d'un sens aigu des affaires, il prend les rênes du Domaine. Il achète de nouveaux camions Berliet à Chaînes, électrifie la vinification, remplace les vieux fûts par des cuves en béton et élabore, avec l'aide d'œnologues, des vins haut de gamme pour une clientèle cosmopolite. Dès le début de ses activités au domaine, son fils Henri BORGEAUD fait preuve de telles capacités, à la fois agricoles et financières, que son père se décharge peu à peu sur lui. Le jeune Henri avait fait ses études à Alger, puis à l'institut Agronomique de Paris.
Lorsque la première guerre mondiale éclate en 1914, il demande sa naturalisation et de Suisse devint Français en 1915. Après quelques mois d'instruction à Saumur, il se retrouve dans les tranchées où il gagne sa légion d'Honneur, en récompense de sa conduite au front.
La guerre finie, il épouse Denise OUTIN de Tipasa, rencontrée lors d'un concert chez sa tante Hélène épouse de Jules BORGEAUD, Consul de Suisse. Henri BORGEAUD se consacre à son domaine et lui donne une impulsion qui déborde largement les limites de l'Algérie Les années 50 sont celles du grand décollage. Tracteurs Fergusson, camions citernes, chariots élévateurs, chambres froides, techniques d'irrigation sophistiquées et premiers désherbants font leur entrée à La Trappe. On y teste toutes sortes d'innovations propres à améliorer les rendements.
Le domaine possédait plusieurs cordes à son arc. Les agrumes et le maraîchage se sont développés. Clémentines et oranges devinrent des apports intéressants. La place des primeurs telles que pommes de terre et autres raisins de table est prépondérante. Il a concédé à son personnel des avantages sociaux alors inconnus en Algérie. Le logement pour tous est gratuit ainsi que l'électricité et le bois de chauffage. Chaque ouvrier peut jardiner un bout de terre et y construire un abri, distribution gratuite de lait et des produits de la ferme dont 45 litres de vin par mois pour les Européens (l'équivalent en argent pour les musulmans), entretien de l'école primaire située sur le domaine, dispensaire avec une infirmière et visite médicale une fois par semaine par le docteur Veille. Pharmacie et soins gratuits. Ajoutons à cela, qu'à chaque rentrée scolaire, Mme BORGEAUD habillait de pied en cape chaque écolier, qu'il soit chrétien ou musulman. Le domaine fournissait livres, cahiers, etc…
 Henri BORGEAUD n'eut qu'un seul vice, celui de la politique Il eut même quelques possibilités d'être pressenti pour la présidence de la République et c'est sur forte insistance de sa femme qu'il refusa. Henri BORGEAUD n'eut qu'un seul vice, celui de la politique Il eut même quelques possibilités d'être pressenti pour la présidence de la République et c'est sur forte insistance de sa femme qu'il refusa.
En mars 1963, M. DANJOU, le gérant, sonne très tôt à la porte de ses patrons. M. BORGEAUD se précipite hors de son lit. Des automitrailleuses encerclent le domaine, canons pointés sur sa villa. À la grille un préfet et des officiers l'attendent. On laisse aux époux BORGEAUD deux heures et la possibilité d'emporter une valise. Ce temps écoulé, le préfet rentre dans la chambre, sans même avoir frappé, et les presse. À ce moment précis les BORGEAUD eurent ces paroles : " Qu'avons-nous fait pour mériter un pareil traitement ?" et le préfet leur répondit qu'ils ne voulaient plus de rois chez eux.
Henri BORGEAUD alla payer ses employés, et sa besogne terminée, il revient vers sa femme et lui recommanda de ne pas tarder. Puis dignement, ils partirent abandonnant leur univers, oubliant leur valise, les mains vides sans un regard en arrière, ni vers les statues des saints, ni vers les vignes, ni même vers leur maison. Le règne prenait fin, après 60 ans de travail, de liens avec cette terre qu'ils aimaient tant, et à ce moment-là une vingtaine d'ouvriers de la Trappe assistaient à leur départ.
À leur arrivée en France, le couple acheta un domaine près de Cocherelle, mais le samedi 24 mai 1963 Henri BORGEAUD, atteint d'un cancer, décède des suites d'une opération, il avait 67 ans.
Sans être ostentatoire, la richesse des colons n'en est pas pour autant cachée. Pourquoi les Pieds-Noirs, défricheurs de terre, auraient-ils eu honte de leur réussite ? Combien de fois ne les a-t-on pas entendus dire : " Ce pays, c'est nous qui l'avons fait. Nos ancêtres, en découvrant la plaine de la Mitidja, il y a plus de cent ans, n'y ont trouvé que de maigres pâtures, des troupeaux étiques et des fièvres inoculées par les moustiques pullulant dans les marécages. Regardez à présent ce qu'elle est devenue : ce magnifique damier de cultures où les champs de céréales alternent avec les orangeraies et les vignobles accrochés aux collines. Puis balayant d'un grand geste l'étendue de sa propriété, le colon avait l'habitude de conclure, faisant allusion aux fellaghas : et maintenant qu'est-ce qu'ils nous veulent, à nous ? La terre ? Elle nous appartient. Et puis, monsieur, l'Algérie c'est la France, n'est-ce pas ? "
|
| BLIDA MA BIEN AIMÉE
De L. Grace Georges
Envoyé Par Mme Annie Bouhier
| |
|
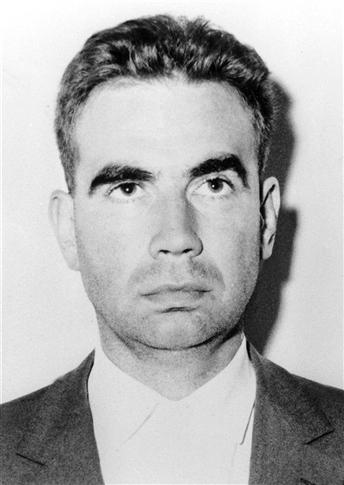 Il y a exactement cinquante ans, le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry rendait son ultime souffle face à un peloton d’exécution. Il avait été condamné à mort le 4 mars précédent par le tribunal militaire de justice pour son implication dans l’attentat du Petit-Clamart commis le 22 août 1962. Bastien-Thiry dirigea le commando qui cribla de balles la DS présidentielle sans faire de blessés. Il avait alors utilisé un journal qu’il avait agité afin d’indiquer à ses hommes le moment où il leur fallait tirer. Durant le procès, il tint tête à ses juges, revendiquant son acte en raison de ce qu’il estimait être une trahison du président de Gaulle envers les français d’Algérie et les harkis ainsi que pour la défense de l’Algérie française. Il sera arrêté en septembre 1962 après son retour d’une mission en Angleterre. Il fut défendu par les avocats Dupuy, Le Coroller, Isorni et Tixier-Vignancourt. Ceux-ci tentèrent de sauver sa tête en se basant sur une expertise médicale démontrant qu’il n’avait pas toute sa raison au moment de l’attentat, mais Bastien-Thiry refusa ce recours et préféra affronter son destin. Ce qu’il fera dignement et courageusement. Il entra ainsi dans l’histoire comme étant le dernier condamné à mort fusillé de l’histoire de France. De Gaulle aurait dit à son sujet : « Celui-là, ils pourront en faire un martyr ». Le général aurait refusé sa grâce essentiellement par ce qu’il mit en danger la vie de sa femme Yvonne et parce qu’il n’avait pas pris de risque personnel dans l’opération. Les deux tireurs, Alain de La Tocnaye et Jacques Prévost, également condamnés à mort, furent graciés par le chef de l’État. Il y a exactement cinquante ans, le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry rendait son ultime souffle face à un peloton d’exécution. Il avait été condamné à mort le 4 mars précédent par le tribunal militaire de justice pour son implication dans l’attentat du Petit-Clamart commis le 22 août 1962. Bastien-Thiry dirigea le commando qui cribla de balles la DS présidentielle sans faire de blessés. Il avait alors utilisé un journal qu’il avait agité afin d’indiquer à ses hommes le moment où il leur fallait tirer. Durant le procès, il tint tête à ses juges, revendiquant son acte en raison de ce qu’il estimait être une trahison du président de Gaulle envers les français d’Algérie et les harkis ainsi que pour la défense de l’Algérie française. Il sera arrêté en septembre 1962 après son retour d’une mission en Angleterre. Il fut défendu par les avocats Dupuy, Le Coroller, Isorni et Tixier-Vignancourt. Ceux-ci tentèrent de sauver sa tête en se basant sur une expertise médicale démontrant qu’il n’avait pas toute sa raison au moment de l’attentat, mais Bastien-Thiry refusa ce recours et préféra affronter son destin. Ce qu’il fera dignement et courageusement. Il entra ainsi dans l’histoire comme étant le dernier condamné à mort fusillé de l’histoire de France. De Gaulle aurait dit à son sujet : « Celui-là, ils pourront en faire un martyr ». Le général aurait refusé sa grâce essentiellement par ce qu’il mit en danger la vie de sa femme Yvonne et parce qu’il n’avait pas pris de risque personnel dans l’opération. Les deux tireurs, Alain de La Tocnaye et Jacques Prévost, également condamnés à mort, furent graciés par le chef de l’État.
Aîné d’une famille de sept enfants, fils de parents catholiques et d’esprit militaire, il se basa notamment sur la lecture de Saint-Augustin pour justifier sa participation à l’attentat du point de vue de sa foi catholique. De son mariage avec Geneviève Lamirand, il aura trois filles.
Communiqué d'Alexandre Simonnot
Hommage au Colonel Jean-Marie Bastien-Thiry
Envoyé par M. Francis Vaudlet Mars 2013
Colonel Jean-Marie Bastien-Thiry
 Rendons un hommage tout particulier au Colonel Basien-Thiry, héros et martyr de la Patrie, fusillé il y a aujourd’hui 50 années, le 11 mars 1963. Rendons un hommage tout particulier au Colonel Basien-Thiry, héros et martyr de la Patrie, fusillé il y a aujourd’hui 50 années, le 11 mars 1963.
Jean-Marie Bastien-Thiry était Lorrain, Polytechnicien, Lieutenant-colonel dans l’Armée de l’air et l’inventeur de deux missiles antichars, les SS-10 et SS-11. Il avait 36 ans et laissait une veuve et trois petites orphelines.
Organisateur de l’opération du Petit-Clamart, le Colonel Jean-Marie Bastien-Thiry aura tout sacrifié, sa famille et sa vie, pour que vive la France. Il nous a laissé, en versant son sang, un message, un modèle à méditer, à admirer et à suivre.
Alors que les tireurs du Petit-Clamart seront graciés par De Gaulle, celui-ci refusera d’accorder sa grâce à Bastien-Thiry.
Jean-Marie Bastien-Thiry est l’exemple parfait du dévouement, du courage, de l’abnégation, du don de soi et du sacrifice de sa vie envers la Patrie. Il est l’honneur de l’Armée Française.
Homme de Foi, grand Catholique, il mourra comme un Saint, marchant vers le peloton d’exécution son chapelet à la main, après avoir entendu la Messe. Refusant d’avoir les yeux bandés, il regardera la mort droit dans les yeux avant de pouvoir contempler ensuite la Vie Eternelle.
Assassiné sur ordre de celui qui aura trahi l’Algérie Française et livré des dizaines de milliers de Harkis et Pieds-noirs aux tortures les plus innommables des bouchers fellouzes du FLN, le Colonel Jean-Marie Bastien-Thiry demeure un Français modèle, un héroïque soldat dont le nom restera pour toujours inscrit sur le Martyrologe de la Nation.
Que Jean-Marie Bastien-Thiry repose en paix, aux côtés de tous les Morts pour la France, dans le Paradis des Héros, des Martyrs et des Soldats.
« Il semblait enveloppé d’une auréole »
Document
Envoyé par Mme Bernadette Leonelli

Le 11 mars 1963 tombait au Fort d’Ivry le colonel Bastien-Thiry, héros de l’Algérie française, fusillé sur ordre de De Gaulle.
Monsieur Pierre Sidos a, pour la première fois, autorisé la publication d’un document unique qu’il détient depuis trente ans.
Je ne puis dire la fierté que m’inspire le choix du Libre Journal pour cette publication.
Ce récit des ultimes instants du colonel Bastien-Thiry fut rédigé de la main même d’un témoin privilégié : un dirigeant de la police française qui, pour mieux servir la France dut cacher son admiration pour l’homme qui allait mourir et pour la cause à laquelle cet homme avait sacrifié sa vie. Nous reviendrons d’ailleurs prochainement, avec la permission de monsieur Pierre Sidos, sur cet épisode étonnant de l’histoire contemporaine.
Pour l’heure, ce témoignage extraordinaire permet de mesurer à quels drames de conscience ont été confrontés certains fonctionnaires de l’état gaulliste, en ces temps de trahison.
Il devrait rendre moins péremptoires les donneurs de leçons qui, sans risque, jugent et condamnent, un demi-siècle plus tard, des hommes qui n’ont fait que leur devoir « Pour que France continue. »
======================
Samedi 9 mars 1963 – 17 heures.
P…, commissaire divisionnaire à l’état-major de la police municipale, me demande au téléphone de mon bureau du 5ème district, avenue d’Italie, et m’invite a venir d’urgence à son bureau. Je ne puis m’empêcher de m’exclamer : « Je crois, hélas, deviner pourquoi ».
Je pars donc à la préfecture, et là, P… me confirme qu’en effet, si Prévost et Bougrenet de la Tocnaye sont graciés, l’exécution de Bastien-Thiry est ordonnée pour le lundi 11 mars au matin. Le moins qu’on puisse dire est que les choses n’ont pas traîné depuis le jugement qui doit remonter à quinzaine.
Nous voici à mettre sur pied le futur service d’ordre…
B…, commissaire de Choisy, assurera un isolement total des Prisons de Fresnes, avec des effectifs considérables.
L…, commissaire de Charenton, qui sera de ronde de nuit du 10 au 11, consacrera tout son temps à la surveillance de l’itinéraire Prisons-Fort d’Ivry ; effectifs généreusement prévus : on ne lésine vraiment pas…
B…, commissaire d’Ivry, assurera les fonctions judiciaires : accompagnement des autorités, présence sur le lieu de l’exécution et procès-verbal pour en rendre compte.
Je reviens chez moi, sans dire un mot, en proie au désespoir et au dégoût, me demandant comment je vais vivre ces quarante-huit heures d’attente…
Pour comble, je préside le soir même, le bal de la section de Gentilly de l’orphelinat mutualiste de la PP. Comment ai-je pu, avec mes pensées en désarroi, tenir devant les niaiseries de ces gens se contorsionnant, et faire le discours d’usage ?
Le dimanche est une véritable veillée funèbre : je ne sais où aller pour fuir les pensées qui m’assaillent. La journée passe, morne. Sans avoir dormi, je me lève à une heure du matin. Il pleut à torrents. Par les rues désertes je vais à la préfecture prendre contact avec les équipes en civil de la Brigade de direction, mises à ma disposition pour chercher, véhiculer et protéger au besoin les juges, le procureur général, l’aumônier, le médecin.
C’est un médecin de l’Armée de l’air qui doit assister, ô dérision, à cette mort. Les braves gars de la Brigade, des gens courageux toujours prêts à traquer les criminels, la nuit, sont ébranlés eux aussi. Ils ont à tour de rôle escorté le prisonnier tout au long des nombreux trajets Prisons-Fort de l’Est où siégeait le tribunal. Les rares contacts qu’ils ont eus avec Bastien-Thiry (entrevu quand il montait et descendait du fourgon cellulaire) leur ont laissé malgré tout une profonde impression que l’on éprouvait en le côtoyant, même sans lui parler…
" Il semblait enveloppé d'une auréole "
Je repasse au district, encore plus ému par ce bref aveu d’un humble flic. Je prends dans ma voiture mon chauffeur de service et un secrétaire et nous partons pour Fresnes.
Dès notre arrivée, je vois une dizaine de reporters de presse filmée ou de télé qui allument leurs projecteurs.
Cette attente des badauds de profession en prévision d’une curée, recherchant avidement tout ce qui se présente de sensationnel, me semble quelque chose d’indécent. Usant des consignes draconiennes que j’ai reçues, c’est sans ménagements que je les fais refouler dans le bistrot voisin qu’ils ont déjà fait ouvrir et où ces importuns ont établi leur PC.
Les effectifs arrivent, les commissaires mettent en oeuvre le plan qu’ils ont reçu, je reste rencogné dans le fond de ma voiture, après les avoir successivement revus.
Je suis embossé dans l’allée menant au pavillon résidentiel du directeur de la prison, M. Marti. Le condamné est dans le bâtiment voisin : le CNO (Centre national d’orientation), où sont habituellement concentrés les prisonniers en attente d’une autre affectation. Cette masse sombre est silencieuse : les CRS de garde aux abords courbent le dos sous l’averse. Ma radio grésille doucement. Paris est encore en léthargie ; la police prend la place sur l’itinéraire, sans bruit la pluie fait rage… J’écoute le vide… et prie.
Tout à coup, les abords de la prison s’animent : B…, qui attend près de la porte, pénètre dans le CNO en compagnie de M. Marti. L’aumônier suit. Survient Gerthoffer, le procureur général, silhouette falote, moulé dans un pardessus gris aux formes démodées ; il descend de voiture et saute pour éviter les flaques d’eau, faisant le gros dos sous les rafales. Ces vieillards allant faire tuer un être jeune, plein de vie encore, me semblent une énormité inhumaine.
Pendant ce temps, De Gaulle doit reposer dans sa majestueuse sérénité…
La gendarmerie, chargée de livrer le condamné au peloton d’exécution, a fait grandement les choses : une escorte de trente motos, celle d’un chef d’Etat, trois petits cars bourrés d’effectifs armés, pour s’intercaler entre les divers véhicules du cortège, prennent place sur l’avenue dite « de la Liberté ». Le car chargé de transporter le condamné, avec une garde de huit gendarmes, entre dans la prison. Nul n’ignore que la gendarmerie est le pilier de ce régime…
B… m’informe par radio que, toutes les personnalités étant arrivées, on va réveiller le condamné.
Il me relatera ensuite que c’est Gerthoffer qui est entré le premier et que Bastien-Thiry a aussitôt demandé quel était le sort de ses compagnons. Apprenant qu’ils étaient graciés, il sembla alors délivré de tout souci et entra dans une sorte d’état second, abandonnant toute contingence terrestre.
Il revêt son uniforme et sa capote bleu marine de l’Armée de l’air sans prêter un instant d’attention aux paroles bien vaines que ses avocats croient devoir prononcer.
Il entend la Messe à laquelle assiste également M. Marti. Il est, même aux yeux des moins perspicaces, en dialogue avec le Ciel. Au moment de communier, il brise en deux l’hostie que lui tend l’aumônier et lui demande d’en remettre la moitié à son épouse. Puis, après l’Ite Missa est, il dit « Allons »… et se dirige vers le couloir de sortie. A ce moment, les phares des voitures s’allument, les motos pétaradent, et j’annonce par radio la phrase que j’ai si souvent prononcée lorsque j’étais avec De Gaulle : « Départ imminent »…
L’état-major la reprend pour alerte générale.
Mais rien ne vient, et cette attente imprévue semble atroce. Pendant vingt affreuses minutes les avocats vont tenter une démarche désespérée : ils demandent au procureur général d’ordonner de surseoir à l’exécution en raison du fait nouveau qu’est l’arrestation récente d’Argoud.
Bastien-Thiry, absent de tout, revient dans sa chambre, stoïque, silencieux, méprisant devant ces passes juridiques où chacun s’enlise. Il ne dira pas un mot, ni d’intérêt, ni d’impatience…
B…, qui n’est pourtant pas un croyant, me dit : « Il est déjà parti en haut ».
Enfin, les palabres des hommes de loi prennent fin : le procureur refuse tout sursis.
Les phares s’allument de nouveau, les motos repartent à vrombir. Cette fois, c’est bien le départ. Je vois la voiture du condamné balayer de ses phares le seuil de la prison, puis se diriger vers le portail ; tout le cortège s’ébranle. C’est bien celui d’un chef d’Etat, dans son triomphe.
Ce condamné qui, au procès, a traité De Gaulle d’égal à égal et l’a assigné au Tribunal de Dieu et de l’histoire, comme renégat à la parole donnée, aux serments les plus solennels et sacrés, ce condamné est bien un chef d’Etat.
C’est bien le même cortège que j’ai si souvent commandé : voiture pilote avec phare tournant, motos devant, motos formant la haie d’honneur, motos derrière, et quinze voitures officielles suivant…
La pluie redouble ; je reste loin derrière, suivant la progression par radio codée… comme pour l’Autre…
Je décide d’aller directement au cimetière de Thiais, triste aboutissement… Je n’aurais pas pu assister à ce Crime, pas même rôder autour du Fort d’Ivry et entendre cette horrible salve.
Au moment où j’entre parmi les tombes, j’entends cette petite phrase de B…, et elle me restera longtemps dans l’oreille : « Allô… Z1… » ; le processus s’accélère… « Je vois le condamné contre son poteau ». Et, à 6h42, cette information : « Exécution terminée ». Je sais gré à B… d’avoir évité la formule consacrée « Justice est faite », elle serait si malvenue ici. Justice… où es-tu ? J’attends encore : rien. Donc, il n’y a pas eu défaillance du peloton comme pour le malheureux Degueldre.
Je vais avec D…, dont je connais les sentiments proches des miens ; nous nous rendons au carré des condamnés. C’est une triste parcelle recouverte de hautes herbes jaunies par le gel, entourée d’arbustes dénudés, frêles et désolés. Un trou a été creusé dans la glaise qui colle aux chaussures.
Enfin arrive un fourgon, escorté par le colonel de gendarmerie de Seine-et-Oise. On descend le cercueil en volige de bois blanc. L’aumônier arrive ; il est suivi du médecin, un grand maigre, tout gêné. Je viens saluer et me recueillir avec D… Les gendarmes se retirent ; les fossoyeurs, à l’abri dans le bâtiment de la Conservation tardent à venir. Nous restons là, tous les quatre, à prier devant cet humble cercueil, placé de travers sur le tas de glaise, courbant le dos sous les rafales de ce sale hiver qui n’en finit pas…
Dehors, les premiers banlieusards se hâtent vers le travail, indifférents à tous ces policiers massés devant le cimetière. Chacun va à ses occupations, c’est le monstrueux égoïsme des grandes cités.
Ainsi est mort pour son idéal, le Rosaire au poignet, Jean-Marie Bastien-Thiry, trente-quatre ans, ingénieur de 2e classe de l’aviation militaire, père de trois petites filles, devenues subitement orphelines, demeurant de son vivant 17, rue Lakanal, à Bourg-la-Reine.
Paris, le 11 mars 1963, 11 heures du matin
HOMELIE DE Mgr J.Y. MOLINAS
Durant la Messe célébrée en la Cathédrale de Toulon
Le lundi 11 mars 2013
Envoyé par Mme Bernadette Leonelli

Pour le Colonel J. BASTIEN THIRY assassiné le 11 mars 1963
Il y a cinquante ans, un homme tombait sous les balles du peloton d'exécution.
Nous savons, nous qui sommes réunis dans cette cathédrale, qui était cet homme et les raisons pour lesquelles il achevait prématurément sa vie dans les fossés du fort d'Ivry.
Depuis cinquante ans des générations d'hommes et de femmes se sont succédées. Peu nombreux ont connaissance de ce drame qui a cependant marqué l'histoire de notre pays. Cette mort est intimement liée à l'agonie et à la mort d'une province française, l'Algérie, mais plus encore au refus d'accepter de voir la France renoncer à sa mission de nation civilisatrice dans le monde et particulièrement sur toutes ces terres lointaines où son génie avait permis un bond de mille ans en avant. Nombreux historiens, géopoliticiens, philosophes expliqueront que ce dégagement était inévitable et que le vent de l'histoire nous y obligeait fut-ce au prix d'un abandon dramatique des populations qui avaient cru, elles, en la France. Mais des hommes se sont élevés contre ce qu'il faut bien appeler une forfaiture, une trahison, et donnèrent leur vie pour ne pas faillir à la parole donnée.
Et, parmi eux, il y eut Jean Bastien-Thiry. Jeune lieutenant-colonel, marié et père de trois petites filles, il n'hésita pas à sacrifier un avenir humain et professionnel prometteur, pour que la France ne se perde en succombant à " l'acharnement d'un très vieil homme ".
Comme l'écrivit son frère, Gabriel Bastien-Thiry, Jean " s'était fait de la France une idée trop belle, et de la justice humaine un concept spirituel ". Cette idée et ce concept dont les racines plongeaient dans la foi chrétienne façonnèrent toute sa vie. Oui, Jean Bastien-Thiry était un fervent chrétien, et cela depuis sa plus tendre enfance. L'amour du Christ l'avait tout naturellement ouvert à l'amour de sa patrie, la France. Ainsi, pétri par les pages de gloire de l'histoire de son pays et par le baptême qui marqua la France, il ne pouvait ignorer le drame qui se déroulait sous ses yeux, et dont il prévoyait clairement les conséquences désastreuses que non seulement la France mais aussi l'Europe auraient à endurer.
N'oublions pas le contexte géopolitique existant alors : d'une part, l'idéologie marxiste diffusant ses mensonges et pénétrant toutes les couches de la société ; des centaines de pays dans le monde asservis à cette dictature habilement présentée comme l'avènement de la liberté et de la démocratie pour les plus pauvres ; la menace militaire des pays du pacte de Varsovie prêts à envahir le monde libre; à l'intérieur la subversion, aux frontières les chars et les missiles. Et d'autre part, en Algérie et dans nombre de pays musulmans le réveil d'un Islam fait d'intolérance, de violences extrêmes et dont la volonté d'expansion dans le monde est clairement démontrée aujourd'hui.
En 1963, l'indépendance de l'Algérie est déjà survenue. Le nouvel état algérien n'a tenu aucun compte des accords d'Evian qui devaient permettre aux différentes communautés de continuer de vivre sur cette terre. Jour après jour, les nouveaux maîtres du pays, hier encore terroristes sanguinaires mais qui, bien qu'au pouvoir, n'ont pas renoncé à leurs méthodes, bafouent ces accords. Des milliers d'européens sont enlevés, des centaines de milliers de harkis sont massacrés dans des conditions horribles, l'armée française encore présente en Algérie, restant, sur ordre, l'arme aux pieds. Les églises sont profanées, les cimetières dévastés...Tout cela après la fusillade de la rue d'Isly à Alger, le 26 mars 1962, où l'armée française tira sur des hommes et des femmes qui revendiquaient seulement le droit de rester français sur une terre française, et le massacre horrible du 5 juillet à Oran.
La pureté de coeur et d'esprit de Jean Bastien-Thiry ne pouvait accepter que la France continua de sombrer dans l'ignominie, après que, comme le déclara le Président du Sénat Gaston Monnerville, " la Constitution eut été violée et le peuple abusé ". Nous ne tenterons pas ce soir de découvrir le cheminement qui amena Jean-Bastien Thiry jusqu'à l'attentat du Petit Clamart contre le président de la république, mais nous retiendrons comme certain que ce qui le conduisit jusqu'à cet acte, ce ne fut pas la haine de celui qui gouvernait alors la France, mais " la compassion pour les victimes " de cet homme, la volonté de " sauvegarder des vies humaines innocentes ", et l'amour de la France dont il ne voulait pas que l'histoire fût irrémédiablement souillée.
La mort courageuse de Jean Bastien-Thiry et de tant d'autres de ses compagnons qui ne se sont pas résignés à accepter le fatalisme d'une nation anesthésiée, nous amènent, cinquante ans après, à nous poser cette question : leur sacrifice a-t-il été vain ? On pourrait le craindre en constatant combien notre pays et l'occident chrétien en général semblent s'être détourné de leur destinée. Un chef d'état français n'a-t-il pas été parmi les plus déterminés opposants à la reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe ? La France, notre patrie, est aujourd'hui défigurée, et bon nombre de nos compatriotes semblent avoir renoncé à la fierté d'être français. Ne leur demande-t-on pas, encore et encore, de se battre la coulpe et de se reconnaître coupables de toutes les abjections commises sur cette terre. Depuis des décennies, on leur a retiré peu à peu les repères historiques, religieux et philosophiques qui les constituaient en nation. On enseigne dans nos lycées que le FLN, qui fut l'ennemi de la France et dont on s'acharne à vouloir dissimuler le terrorisme, la cruauté et le mensonge, incarna la révolte saine et courageuse d'un peuple opprimé pour se libérer du colonialisme français. Cinquante après, nombre d'algériens eux-mêmes n'y croient plus ! Et du coup, on passe sous un silence honteux les 30 000 soldats français morts pour la France en Algérie. Pire encore, on crache sur leur tombe. Peu à peu, on a effacé de notre histoire les grandes figures qui faisaient que l'on pouvait être fier d'être français. Je dis avec assurance et certitude que Jean Bastien-Thiry fait partie de ceux là. Hélas, en compensation, on a fait du show-biz un olympe et des saltimbanques et autres marchands de rêves, les maîtres à penser d'un peuple décadent.
Le bilan pourrait donc nous paraître bien triste. Et pourtant, la foi et l'espérance ne doivent pas déserter notre vie. Il n'est pas possible que les sacrifices de tels hommes ne finissent par porter du fruit. Autant de souffrances, (je pense à l'indicible souffrance que connurent les proches de celui dont nous faisons mémoire, son épouse, ses trois filles alors encore enfants, de tous ceux dont un des leurs tomba sous les balles du pouvoir) autant d'abnégation engendreront un jour de nouvelles générations qui se lèveront, et se reconnaitront en ce frère ainé qu'est Jean Bastien-Thiry. Animées par la foi, ils édifieront ce Royaume de lumière, de paix, de fraternité et de vérité que le Christ est venu instaurer sur notre terre.
Et pour nous les Pieds-Noirs, c'est un devoir de nous souvenir de la compassion de Jean Bastien-Thiry pour notre calvaire. " Les Pieds Noirs ne pourront oublier que cet homme, pétri de traditions, enchaîné par ses principes, a tenté l'intentable à cause d'eux. " (" Plaidoyer pour un frère fusillé " de Gabriel Bastien-Thiry)
Avant de rendre sa belle vie à Dieu, Jean Bastien-Thiry, heureux d'apprendre que ses camarades avaient été graciés, servit à sa dernière messe célébrée par l'aumônier. S'adressant au prêtre, il lui dit : " Mon Père, offrons cette messe pour qu'un jour redevienne possible l'unité des Français. " " Oui, mon Père, il faut qu'un jour les Français puissent être unis ! " Devant le peloton d'exécution " l'Homme a souri, et son visage a reflété un immense apaisement, une sérénité définitive. " Que Dieu sauve la France ! Amen

|
|
9 mars 1962 : nos soldats sacrifiés
pour accélérer les " Accords d'Evian "…
Publié le 8 mars 2018 - par Manuel Gomez
Envoyé par Mme Annie Bouhier.
|
Le sacrifice programmé
d'une unité de jeunes appelés métropolitains
Cet épisode de la guerre d'Algérie a été soigneusement occulté par le gouvernement français et par tous les médias, (mais l'ont-ils su ?).
Dix jours avant la signature des " accords d'Evian " l'armée française allait commettre, sur ordre de De Gaulle et de son gouvernement, la plus odieuse forfaiture de son histoire.
Voici comment le chef de l'État français avait décidé de refaire un nouveau Dien Bien Phu, en laissant massacrer une unité d'infanterie, composée essentiellement de jeunes appelés du contingent, basée non loin de Souk-Ahras, dans l'Est algérien, face au village tunisien de Sakhiet-Sidi-Youssef.
(Rien à voir bien entendu avec le fameux bombardement de ce même village le 2 février 1958 qui mobilisa toute la presse internationale et attira l'opprobre de nombreux pays contre la France)
Depuis le lever du jour de ce 9 mars 1962, une pluie d'obus tirés par l'artillerie lourde de l'ALN, installée en Tunisie, pleut avec une intensité sans précédent sur cette unité composée de jeunes recrues, des appelés pour la plupart.
Le commandant de l'unité n'a pas les moyens matériels de riposter car ses hommes ne sont équipés que d'armes légères.
En effet, sur ordre du gouvernement on lui a retiré quelques jours plus tôt son artillerie lourde plus un régiment de la Légion étrangère et une demi-brigade de blindés.
Ordre bien singulier puisque les services secrets avaient signalé une concentration inhabituelle de forces adverses en territoire tunisien, juste en face de ce secteur.
Sans cesse le commandant demande par radio à sa hiérarchie basée à Constantine et à Bône, l'appui de l'aviation pour le dégager.
La situation devient désastreuse à l'aube du 10 mars. Les tirs redoublent de violence.
Puis c'est le silence.
- " Je vous en prie, réagissez ! Nous risquons une attaque massive des fellaghas ".
De son poste d'observation, le commandant constate, à l'aide de ses jumelles, qu'à moins d'un kilomètre plusieurs brèches ont été ouvertes dans le barrage électrifié qui délimite la frontière entre les deux pays. Sur les collines environnantes des milliers de combattants de l'ALN progressent à découvert dans sa direction.
Ils sont à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau. Il sait qu'il ne pourra pas résister à une attaque de cette envergure et que tous ses hommes vont se faire massacrer. Il se demande pourquoi on ne lui envoie aucune aide.
Ce qu'il ignore c'est que l'état-major militaire a reçu l'ordre de ne pas intervenir.
Pour quelles raisons ?
Des négociations sont engagées avec les nationalistes algériens et Louis Joxe discute en ce moment même à Evian avec les représentants du GPRA.
Pour amadouer les dirigeants nationalistes, le gouvernement français a décidé quelques jours plus tôt un " cessez le feu unilatéral ".
Ainsi l'ALN (Armée de libération Nationale) peut agir en toute impunité et tenter une opération spectaculaire afin de négocier dans de meilleures conditions.
Et c'est pour cette raison que De Gaulle va sacrifier sans aucune pitié, sans aucune émotion, quelques centaines de jeunes soldats appelés du contingent dans le seul but de démontrer à la métropole la nécessité urgente de terminer cette guerre quel qu'en soit le prix.
Informé de tout cela, le lieutenant-colonel Lisbonis, commandant la base aérienne 213 de Bône, hésite à intervenir.
Un an plus tôt, au moment du putsch des généraux, il était resté fidèle à De Gaulle. Mais sa conscience le tenaille et il ne peut concevoir de ne pas se porter au secours de ces soldats français sacrifiés au nom d'une odieuse politique d'abandon.
Dès le lever du jour, il donne l'ordre aux escadrilles de décoller.
En quelques heures la victoire change de camp. Les pilotes des T-6 arrosent de leurs mitrailleuses les fellaghas, surpris par une attaque aérienne qu'ils n'attendaient pas, et les A-26 franchissent la frontière, les poursuivant et lâchant leurs bombes sur les positions de l'artillerie adverse.
Les soldats du contingent et la population civile sont sauvés.
Quant au lieutenant-colonel Lisbonis, il s'envole pour Paris.
Non pas pour être félicité mais par mesure disciplinaire.
Le gouvernement lui reproche d'avoir enfreint les ordres et d'avoir gravement compromis les pourparlers d'Evian, même au prix de la vie de quelques centaines de jeunes soldats français.
Le 14 mars 1962, le commandant de la base aérienne de Bône-les-Salines est mis aux arrêts pour avoir riposté aux attaques de l'ALN contre le barrage et sauvé quelques centaines de jeunes soldats et de civils français.
Manuel Gomez
2 Janvier 2018
https://ripostelaique.com/9-mars-1962-des-centaines-de-soldats-francais-sacrifies-pour-accelerer-les-accords-devian.html
|
|
| Jean de Brem
Par M. Guy Rolland
|
" Le Testament d'un Européen "
 "Je sens peser sur mes épaules misérables le poids démesuré du plus glorieux des héritages. A moi, qui ne suis rien et qui n'apporte rien, la civilisation fait un cadeau gigantesque : le patrimoine de l'Europe. Il est fait de trésors et de souvenirs. "Je sens peser sur mes épaules misérables le poids démesuré du plus glorieux des héritages. A moi, qui ne suis rien et qui n'apporte rien, la civilisation fait un cadeau gigantesque : le patrimoine de l'Europe. Il est fait de trésors et de souvenirs.
Chacun de nous, je crois, à Londres et à Vienne, à Berlin et à Madrid, à Athènes et à Varsovie, à Rome et à Paris, à Sofia et à Belgrade, doit ressentir le même drame.
Chacun de nous est le dernier des Européens.
Je suis le prince débile issu d'une lignée de colosses et qui va peut-être clore une race. Je mourrai sans postérité, stérilisé par l'atome ou égorgé par un fanatique. Et mes frères auront le même sort. Des géants nous précèdent, des héros et des savants, des explorateurs de la terre et des explorateurs de l'âme, des César et des Antoine, des monarques et des capitaines, des silhouettes sévères en robe de bure, de belles courtisanes ou des brutes implacables. Tout un cortège de grandes figures, magnifiques de splendeur et de puissance, se déroule à nos yeux, immense fardeau pour nos contemporains dérisoires. Voici que s'amassent à l'Orient les nuages sinistres de la ruée païenne et barbare.
Je vais mourir. Je meurs. Et la race Europe avec moi. Avec nous. Je ne laisserai rien.
Depuis cinquante ans j'ai dispersé l'héritage. Et laissé le royaume du ciel en friche. Je n'aurai pas d'héritiers dans ce monde hostile et chaotique. Je ne puis laisser qu'un message : l'histoire, la très belle histoire d'une civilisation mortelle, qui se croyait invincible. Une civilisation pour laquelle des milliards d'hommes ont lutté et vaincu pendant trente siècles. Personne ne sera là pour me lire. Qu'importe. Voici comme un dernier cri de rage et d'amertume.
Taxez-moi de romantisme, qu'importe !
Pour moi, le trésor du monde, c'est une infante de Vélasquez, un opéra de Wagner ou une cathédrale gothique. C'est un calvaire breton ou une nécropole de Champagne. C'est le Romancero du Cid, ou le visage hugolien de "l'enfant grec". C'est le tombeau des Invalides, ou le Grand Aigle de Schönbrunn, l'Alcazar de Tolède, ou le Colisée de Rome, la Tour de Londres, ou celle de Galata, le sang de Budapest ou le quadrige orgueilleux de la Porte de Brandebourg devenue le poste frontière de l'Europe mutilée.
Pour toutes ces pierres, pour tous ces aigles et pour toutes ces croix, pour la mémoire de l'héroïsme et du génie de nos pères, pour notre terre menacée d'esclavage et le souvenir d'un grand passé, la lutte ne sera jamais vaine.
Frêle Geneviève de Paris, patronne de l'Europe, seule contre les hordes mongoles, tu symbolises notre esprit de résistance. Et toi, vainqueur blond au visage de dieu, macédonien aux dix milles fidèles, Alexandre, toi qui conquis le monde oriental avec ta foi et ton épée, dressé contre le destin et le sens de l'Histoire, tu symboliseras peut-être un jour le triomphe de l'Europe impériale."
Jean de Brem (1935 - 1963),
Extrait de " Le Testament d'un Européen"
£££££££££££££
Jean-Nicolas Marcetteau de Brem écrit, en hommage au Colonel Bastien-Thiry, le poème épique " FORT D'IVRY A LA FRAICHE" que publie le Journal "L'ESPRIT PUBLIC" seulement quelques jours après l'exécution au Fort d'Ivry - le 11 Mars 1963 - de ce jeune Polytechnicien, père de trois petites filles. Le seul mort de l'attentat, fusillé la semaine qui suit sa condamnation par un tribunal militaire.
A la page 139 du Tome II de "C'ETAIT DE GAULLE" Alain Peyrefitte demande à Charles De Gaulle pourquoi il a fusillé Bastien-Thiry, sachant que Clémenceau et que Pierre Laval dans des conditions pires demandèrent grâce et l'obtinrent pour le condamné:
Réponse du personnage historique préféré des Français:
"Chaque peuple doit avoir ses martyrs, encore faut-il qu'ils soient dignes de cette fonction. Un de ces imbéciles de Généraux qui jouent au ballon dans la cour de la prison de Tulle n'aurait pas fait l'affaire. Bastien-Thiry avait quelque chose de romantique. Ce sera un bon martyr".

Le 18 Avril 1963 Jean de Brem est à son tour tué Rue de L'Estrapade, à Paris, par le Policier qu'il abat simultanément. Il permet ainsi la fuite de ses camarades. Il avait 27 ans. En 1956, il avait sauté sur Port Saïd en deuxième de stick derrière le Colonel Pierre Chateau-Jobert.
Il était Lieutenant, journaliste, écrivain, poète et guerrier. Il a exécuté le sinistre Lafont, banquier du FLN ainsi que le Maire d'Evian.
LA BALLADE DU CAVALIER
Un jour dans la fusillade
Galopant à l'inconnu
Nous allions en cavalcade
Tu étais mon camarade
Celui que j'aimais le plus
Un cavalier par bravade
Défia le plus résolu
Il porta son estocade
Ce fut toi mon camarade
Ce fut toi qui la reçus
J'ai vengé l'estafilade
Que ce coup t'avait valu
Mais tard dans la nuit froide
J'ai pleuré mon camarade
Près de ton corps étendu
Je suis ma route maussade
Et je chevauche sans but
Au hasard d'une embuscade
J'ai perdu mon camarade
Je ne rirai jamais plus
Prince écoute ma ballade
Et cet appel éperdu
Prie le dieu des cavalcades
De placer mon camarade
A la droite de Jésus.
Guy ROLLAND
|
|
| L'expédition d'Alger
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Elle fut entreprise par le gouvernement de la Restauration, non pas, ainsi que le prétendirent les journaux de l'opposition, comme une manœuvre de politique intérieure commandée par les circonstances difficiles où se trouvait le ministère de Polignac, mais comme une mesure d'honneur et d'intérêt national, devant laquelle le gouvernement, qui avaient tenté toutes les autres voies, ne pouvait plus reculer sans déserter ses devoirs.
C'est seulement au mois de janvier 1830 que la décision fut prise ; il fallait faire de grands efforts pour être prêt à la bonne saison, c'est-à-dire au mois de mai ou de juin au plus tard. Trois commissions furent constituées, qui travaillèrent d'abord séparément, puis se réunirent sous la présidence du prince de Polignac et en présence du ministère tout entier.
Le conseil, après une longue délibération, adopta le plan présenté par Dupetit-Thouars (officier de marine) qui consistait à débarquer à Sidi-Ferruch et à s'emparer du Fort l'Empereur d'où on dominait la ville ; les défenses de son front de mer, dans ces conditions, ne lui servaient à rien.
L'ordonnance de mobilisation parut le 7 février 1830 et l'expédition fut annoncée aux Chambres dans le discours du trône du 2 mars. Le 20 avril le Moniteur résumait les griefs de la France contre le Dey :
" A nos soldats, disait-il, est réservé la noble mission de venger la dignité de la Couronne et de délivrer la France et l'Europe du triple fléau que les puissances chrétiennes ont enduré trop longtemps : l'esclavage de leurs sujets, les tributs que le Dey exige d'elles et la piraterie qui ôte toute sécurité aux côtes de la Méditerranée."
La préparation de l'expédition fut effectuée avec beaucoup de méthode et de célérité. Les vieux amiraux, timides survivants de la marine impériale, prétendaient qu'elle exigerait six ou huit mois ; mais le baron d'Haussez promit d'être prêt pour le 15 mai et tint parole. Rien ne fut laissé au hasard. On réunit les forces de terre et de mer et le matériel de guerre, on rassembla les munitions et les vivres, on concentra les bâtiments de guerre, de transport et de débarquement. A la fin d'avril les troupes étaient réunies aux environs de Toulon et de Marseille. L'effectif total s'élevait à 37.600 hommes, 4.500 chevaux, 91 pièces d'artillerie.
Le commandement de la flotte fut confié à l'amiral Duperré et celui de l'armée de terre au général de Bourmont. Les deux hommes ne s'entendaient guère. Duperré, rude et brusque, d'humeur peu sociale, était un excellent marin et avait fait une brillante campagne en 1810 dans l'Inde. Ses opinions libérales le rendaient suspect au Roi et au Dauphin. Il ne croyait pas au succès de l'expédition et partageait sur ce point l'opinion de Wellington : " Les Français sont fous, disait celui-ci, un revers effroyable les attend sur la côte d'Algérie. "
Duperré résuma toutes ses objections dans une lettre qui était un chef-d'œuvre de prévoyance pessimiste ; il prévoyait un mois pour le débarquement qui, en fait, ne demanda que huit heures. Ce pessimisme de l'amiral eut peut-être compromis le succès de l'expédition sans la fermeté du baron d'Haussez et le sang-froid du général en chef.
L'opinion publique n'avait pas oublié que Bourmont avait abandonné sa division avant Waterloo pour rejoindre Louis XVIII à Gand. Il souhaitait évidemment, en prenant le commandement de l'expédition, effacer le souvenir de cette trahison. Bourmont avait pleins pouvoirs même sur Duperré et une ordonnance secrète l'investissait, en cas de nécessité absolue, du commandement suprême des forces de terre et de mer.
Les trois divisions de l'armée étaient commandées par les généraux Berthezène, Loverdo et des Cars. Le lieutenant général Desprez était chef d'état-major général, Lahitte commandait le génie, Valazé l'artillerie, le baron Denniée l'intendance. Les états-majors avaient été composés de façon à y faire entrer en nombre à peu près égal des officiers de l'ancienne et de la nouvelle armée. Chefs et soldats avaient une double appartenance. Les uns, comme Berthezène, Poret-de-Morvan avaient servi sous l'Empire et étaient demeurés fidèles à l'idée impérialiste ; le colonel Monnier, qui commandait le 28e de ligne, a inspiré à Alfred de Vigny le beau portrait du capitaine Renaud dans servitude et grandeur militaire ; quelques vieux grognards se rappelaient même l'expédition d'Égypte. D'autres officiers comme Loverdo et Lahitte étaient ralliés à la Restauration. Cet amalgame était de nature à effacer les dernières traces des discussions qui divisaient l'armée depuis 1815.
L'armée navale se trouva réunie le 23 avril. Elle comptait plus de 600 bâtiments, dont 103 bâtiments de guerre, divisés en trois escadres : l'escadre de bataille commandée par le vice-amiral Duperré qui arbora son pavillon sur la Provence, avec le vice- amiral Rosamel commandant en second l'escadre de débarquement et l'escadre de réserve. Le reste se composait de bâtiments de commerce affrétés qui constituait le convoi et l'escadrille de débarquement pour la mise à terre des troupes et du matériel. Il n'y avait que sept bâtiments à vapeur, avisos et remorqueurs de faible tonnage et l'expédition d'Alger fut, en fait, le dernier exploit de la marine à voiles.
Le 5 mai, le Dauphin passa la revue de l'armée et de la flotte qui, toute pavoisée, offrait un spectacle magnifique dans le cadre grandiose de la rade de Toulon. L'embarquement des troupes commençait le 11 mai et le départ eut lieu le 25.
La navigation fut très lente.
Le 30 mai on arriva en vue de la côte d'Afrique, mais le vent n'étant pas favorable, on rétrograda jusqu'aux Baléares où on resta jusqu'au 9 juin.
Le 12 on était de nouveau sur la côte de l'Algérie et on vit apparaître Alger avec ses murailles blanches, sa campagne couverte de jardins, son magnifique cadre de montagnes.
Duperré hésitait encore à se rendre au mouillage inconnu de Sidi-Ferruch, mais Bourmont, sans toutefois être obligé de montrer ses pleins pouvoirs, imposa son autorité : "Monsieur l'amiral, dit-il, cette fois il faut débarquer. La mer n'est pas mauvaise, vous savez que j'ai le droit de vouloir et je veux que nous débarquions. " L'opération s'effectua le 14 juin dans la baie qui se trouve à l'Ouest de la presqu'île de Sidi-Ferruch et qui offre, avec une belle plage de sable fin, un bon mouillage, bien abrité. La mer était calme et le fond excellent. Sur la presqu'île s'élevait une petite tour, appelée Tore Chica par les Espagnols, que quelques pièces de canon avaient fait prendre pour un établissement militaire, mais qui était simplement le minaret d'un édifice très religieux renfermant le tombeau du saint personnage qui avait donné son nom à la localité.
L'ennemi n'opposa qu'une très faible résistance ; au Consul des États-Unis qui s'étonnait qu'il laissât ainsi débarquer tranquillement l'armée ennemie, Hussein répondit que c'était afin de la détruire plus facilement.
La division Berthezène soutenue par le feu des bâtiments, s'empara sans peine de quelques batteries placées en dehors de la presqu'île. Le débarquement présenté comme si difficile par les adversaires de l'expédition, s'était opéré en quelques heures et nous avait coûté trente-deux hommes.
Cet évènement mémorable est rappelé par l'inscription suivante gravée sur la porte du fort élevé à cet emplacement :
" Ici le 14 juin 1830 par ordre du Roi Charles X, sous le commandement du général de Bourmont, l'armée française vint arborer ses drapeaux, rendre la liberté aux mers, donnant l'Algérie à la France. "
Le débarquement de l'artillerie et du matériel continua les jours suivants, gêné seulement le 16 juin par un violent coup de vent de Nord-Ouest qui mit la flotte en danger et à propos duquel on évoqua le souvenir de l'expédition de Charles-Quint ; mais heureusement vers midi, le vent passa à l'Est et la mer se calma.
Il fut décidé qu'on fortifierait la petite presqu'île de Sidi-Ferruch pour en faire un camp retranché et une place de dépôt. On y établit des parcs, des magasins, des hôpitaux, des fours à cuire le pain.
La distance entre Sidi-Ferruch et Alger est d'environ vingt-cinq kilomètres. Trois combats qui nous rendîmes maîtres de la ville furent livrés sur ce trajet : ceux de Staouéli, de Sidi-Khalef et du Fort l'Empereur.
Le plus important des trois fut celui de Staouéli. L'Agha Ibrahim, gendre d'Hussein, commandait les forces de la Régence ; il avait avec lui la milice turque forte d'environ 6.000 hommes, les Koulouglis et les Maures d'Alger ; le Bey de Constantine avait amené 13.000 hommes, le Bey d'Oran 6.000, les tribus kabyles fournirent 15.000 hommes environ ; au total les forces de l'Agha s'élevaient à près de 50.000 hommes.
Il se proposait d'enfoncer l'aile gauche de l'armée française et de la couper de la presqu'île de Sidi-Ferruch.
Le 19 juin au matin, toutes nos lignes furent assaillies ; le premier choc fut terrible, mais après une lutte acharnée, les Algériens durent se replier sur leurs positions.
Les Kabyles lâchèrent prise les premiers ; le reste suivit. A midi les hauteurs de Staouéli étaient conquises et le camp turc occupé.
Nous avions 530 hommes hors de combat, dont 57 morts ; les Algériens avaient perdu deux fois plus de monde.
La prise du camp de Staouéli produisit un grand effet. L'arrivée des fuyards et des blessés jeta le désarroi et la consternation dans Alger et les Kabyles regagnèrent leurs montagnes.
Bourmont aurait pu sans doute dès ce moment poursuivre l'ennemi, s'emparer d'Alger et terminer la campagne. Mais ne voulant rien laisser au hasard, il préféra attendre le matériel de siège, les munitions et les subsistances que lui amenait le convoi qui, parti le 18 de Palma, n'arriva que dans la nuit du 24 au 25. Staouéli fut reliée à Alger par une route.
Le 24 juin un nouveau combat fut livré à Sidi-Khalef. Dans les journées des 25 au 28 juin les Turcs commandés par le Bey du Titteri, Mustapha-Bou-Mezrag, qui avait remplacé l'Agha Ibrahim, tentèrent un nouvel effort et firent éprouver à l'armée française des pertes sérieuses.
Le 29 on reprit la marche en avant destinée à envelopper le Fort l'Empereur ; la division des Cars était à gauche, la division Loverdo au centre, la division Berthezène à droite. Le chef d'état-major commit ce jour-là une faute grave.
Du point de départ de l'armée, on n'apercevait ni le Fort de l'Empereur, ni Alger ; comme la plaine de la Mitidja était couverte de brouillard, on crut voir la mer de ce côté ; l'état- major en conclut que la carte de Boutin était fautive et que l'armée était engagée beaucoup trop à droite. Il fit appuyer les troupes à gauche vers la Bouzaréa, à travers un pays difficile et coupé de profonds ravins ; il en résultat un grand désordre dans la ligne de bataille ; les colonnes s'égarèrent et se heurtèrent dans une confusion extrême, dont, fort heureusement, l'ennemi ne profita pas. Après quoi, au prix de grandes fatigues et de contremarches pénibles, on parvint à regagner les positions qu'on occupait le matin.
Le Fort l'Empereur que les indigènes appelaient Bordj-Moulay-Hassan ou bordj-et-Taous (le fort des paons) devait son nom européen à ce qu'il avait été construit sur le point même où Charles-Quint avait planté sa tente en 1541, mais pour nos soldats l'Empereur ne pouvait être que Napoléon.
C'était le seul ouvrage avancé qui défendît du côté de la terre la Casbah et la ville d'Alger, dont les murailles s'étendaient en contre-bas à environ 1.200 mètres au Nord-Est de sorte que la prise du Fort l'Empereur rendait la défense de la ville impossible. Le Khasnadji (chef du gouvernement) s'y était enfermé avec 800 Turcs et 1.200 Arabes. Les troupes creusèrent des tranchées pendant quatre jours puis, quand les travaux d'approche furent suffisamment avancés, le 4 juillet au matin l'artillerie de siège commença le bombardement. En quelques heures, les murailles s'écroulèrent. Les Turcs montrèrent un grand courage mais bientôt leur feu fut éteint. L'ordre de battre en brèche allait être donné lorsqu'à dix heures, une formidable explosion se produisit ; des flammes, des nuages de fumée et de poussière s'élevaient jusqu'à une grande hauteur, des pierres pleuvaient dans toutes les directions. Les Turcs, avant d'abandonner le fort, avaient fait sauter la poudrière.
L'explosion avait ouvert une large brèche par laquelle les troupes se précipitèrent, le fort fut occupé et mis immédiatement en état de défense.
Le Dey parlait de résister encore mais la population ne lui permit pas.
A deux heures de l'après-midi, un des secrétaires du Dey, le Kodja Mustapha, se présenta en parlementaire au quartier général. Puis vinrent deux Maures qui offrirent à Bourmont de lui apporter la tête du Dey ; le général répondit que cela ne lui ferait aucun plaisir et que le Roi de France avait comme coutume de prendre les villes, non les têtes de ses ennemis.
A quatre heures le secrétaire du Dey revint avec le Consul d'Angleterre, M. Saint-John ; celui-ci proposa sa médiation que Bourmont refusa nettement. Le général Desprez rédigea le texte de la capitulation et le plus ancien interprète de l'armée, Bracewitz, qui avait fait la campagne d'Égypte trente-deux ans auparavant, partit avec le kodja pour la porter au Dey.
La remise de la capitulation donna lieu à une scène dramatique ; les cris de fureur des janissaires furent tels que Bracewitz crut son dernier jour arrivé ; il mourut quelques jours après des suites de l'émotion qu'il avait éprouvée.
Le Dey cependant accepta les conditions qui lui étaient imposées.
Le 5 juillet au matin, la capitulation fut signée. En voici le texte :
1° Le fort de la Casbah, tous les autres forts qui dépendent d'Alger et le port de cette ville seront remis aux troupes françaises le 5 juillet à midi.
2° Le général en chef de l'armée française s'engage envers son Altesse du Dey d'Alger à lui laisser la liberté et la possession de ce qui lui appartient personnellement.
3° Le Dey sera libre de se retirer avec sa famille et ce qui lui appartient dans le lieu qu'il fixera et, tant qu'il restera à Alger, il y sera, lui et toute sa famille, sous la protection du général en chef de l'armée française ; une garde garantira la sécurité de sa personne et de celle de sa famille.
4° Le général en chef assure à tous les soldats de la milice les mêmes avantages et la même protection.
5° L'exercice de la religion mahométane restera libre ; la liberté de toutes les classes, leur religion, leur commerce et leurs industries ne recevront aucune atteinte, leurs femmes seront respectées ; le général en chef en prend l'engagement sur l'honneur.
6° L'échange de cette convention sera faîte le 5 avant midi. Les troupes françaises entreront aussitôt après dans la Casbah et successivement dans les autres forts de la ville et de la marine.
Ainsi le drapeau français remplaçait désormais le pavillon des barbaresques sur les murs d'Alger la guerrière. Les soldats vêtus de rouge, qui d'après d'anciennes prédictions, devaient mettre fin à l'existence de la Régence, entrèrent dans la cité des pirates par la Porte Neuve. Cette entrée ne se fit pas sans quelque désordre et manqua de solennité. Les voies étaient encombrées et l'état-major n'avait pas donné ses instructions en temps voulu. Le général Lahitte pénétra d'abord avec deux compagnies d'artillerie. Peu après Bourmont fit son entrée à la tête du 6e de ligne. Le quartier général fut établi à la Casbah que le Dey avait quittée et que les indigènes commençaient à piller.
La casbah, dont l'imagination française avait fait un palais féerique, apparut en réalité comme une habitation à peine tolérable. Les appartements du Dey et de ses femmes étaient si sales et si infestés d'insectes, qu'il fallut les passer à la chaux pour s'en débarrasser. Des marchandises de toute espèce, provenant des prélèvements de la Régence sur les cargaisons étaient entassées dans les magasins.
Le Khasnadji donna les clefs des salles qui renfermaient le Trésor de la Régence, mais déclara qu'aucun registre n'en indiquait le montant, ce qui était faux.
Une commission fut chargée d'inventorier les monnaies d'or entassées pêle-mêle et d'en prendre possession. On trouva 48.700.000 francs qui furent expédiés en France et couvrirent largement les frais de l'expédition évalués à 43.500.000 francs.
On s'attendait à trouver des sommes plus considérables, d'où la légende du pillage de la Casbah qui ne repose sur rien sinon sur les antipathies du quartier général et du général Loverdo qui se renvoyèrent ces accusations.
Aucun excès ne fut commis par nos troupes ; les maisons pillées le furent par les Juifs et par la population indigène. L'Allemand Pfeiffer déclare que " l'armée française se conduisit plus noblement que ne l'eussent fait les troupes de n'importe quel peuple. "
Nos pertes pendant l'expédition d'Alger s'élevèrent à 2.300 hommes hors de combat, dont 400 morts. Parmi ces derniers était le fils du général en chef, Amédée de Bourmont, grièvement blessé à Sidi-Khalef et mort à l'hôpital de Sidi-Ferruch.
Bourmont apprit le deuil qui le frappait le jour même de l'entrée à Alger : " L'armée, écrivit-il à Polignac, perd un brave soldat, je perds un excellent fils. "
Le journal des Débats désarma devant cette douleur paternelle : " M. de Bourmont est noblement réconcilié avec la France, le sang de son fils a payé pour lui. "
Le 7 juillet eut lieu une entrevue entre le général en chef et le Dey qui venait reprendre les objets qui lui appartenaient. D'après les renseignements donnés par Bacri, il serait parti avec 18 millions de fortune, dont 8 millions en bijoux, diamants et pierres précieuses.
Résigné à la volonté de Dieu, Hussein s'embarqua le 10 juillet pour Naples sur la frégate la Jeanne d'Arc avec sa famille, son harem, sa suite, en tout 110 personnes dont 55 femmes et un bagage considérable.
La nouvelle de la prise d'Alger fut apportée à Toulon par le bateau à vapeur le Sphinx ; transmise par le télégraphe, elle arriva le 9 juillet à Paris. La dépêche fut remise au baron d'Haussez qui sauta à cheval et galopa sur la route de Saint-Cloud.
En arrivant au château il aperçut de loin le vieux Roi qui se promenait avec la duchesse d'Angoulême au travers de ces futaies magnifiques qu'il devait peu de jours après quitter en fugitif sous les huées de la populace : " Sire, cria d'Haussez, Alger est à nous ! " Une vive rougeur colora les traits pâles et fatigués du Roi :
" On s'embrasse en un pareil jour," et il donna à D'Haussez une chaleureuse accolade. Le bâton de Maréchal de France fut donné au commandant en chef de l'expédition et la dignité de Pair de France à l'amiral Duperré. Il y eut quelque enthousiasme dans le Midi qui était en relations constantes avec Alger et qui souffrait de la piraterie, mais dans le reste de la France, la chute d'Alger éveilla peu d'écho et n'arrêta pas l'orage qui montait contre la monarchie :
" oui, Alger est vaincu, écrivait le journal des Débats, mais non pas la charte. Elles vivent et elles sont debout ces lois qui défendent de faire la guerre sans crédits votés régulièrement, ces lois qui condamnent les ministres qui dépensent l'argent du peuple sans autorisation. La victoire est au Roi, à l'armée, à la France mais la faute est aux ministres et le droit d'accuser et de punir aux Chambres. Chacun aura ce qui lui est dû, nos soldats leur gloire, nos ministres leur punition. "
Le dimanche 11 juillet, le Roi se rendit à Notre Dame pour assister à un Te Deum. Tout était morne et silencieux sur le passage du cortège. " Quelques cris évidemment achetés, dit d'Haussez, firent seuls les frais de la joie publique." Le Roi en fut très affecté.
L'expédition d'Alger avait été bien préparée et bien conduite. Le débarquement était l'opération difficile. Dès l'instant qu'il s'était effectué dans de bonnes conditions la partie était gagnée et l'armée ne devait pas rencontrer beaucoup de résistance.
" Jeter avec succès, dit Raynal (intendant) une armée de 40.000 hommes sur un point de la côte rapprochée d'Alger ; obtenir des vents le temps de débarquer le matériel nécessaire à cette armée, tel était le problème que la fortune se chargea de résoudre. L'inexpérience de l'ennemi et la bravoure de nos troupes firent le reste. "
Par l'occupation d'Alger, la France donnait une base solide à sa politique coloniale dans la Méditerranée ; elle devenait prépondérante dans le bassin occidental de cette mer et portait une atteinte grave à l'omnipotence de Gibraltar et de Malte ; elle plantait le premier jalon de son futur empire africain.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française, Alfred Martineau, professeur au Collège de France.
Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté de lettres de Paris. Édition 1930
|
|
| Alger jusqu'au départ de Bourmont
(5 juillet-2 septembre 1830)
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Quoique la prise d'Alger n'ait pas eu un caractère purement accidentel, on ne savait pas trop ce que l'on ferait de la nouvelle conquête.
On ignorait presque tout du pays, de son gouvernement, de ses habitants. Le petit manuel distribué aux officiers au moment du départ de l'expédition, intitulé : Aperçu historique, statistique et topographie sur l'État d'Alger, montre que sauf sur Alger et ses ouvrages fortifiés on ne savait rien de précis.
Le gouvernement de la Restauration n'eut d'ailleurs pas beaucoup de temps pour prendre parti, puisque la nouvelle de la capitulation d'Alger ne parvint à Paris que le 9 juillet et qu'à la fin du mois, la vieille monarchie avait cessé d'exister. Il n'y avait en France qu'une très faible minorité qui eût l'audace de vouloir faire de l'Algérie une terre française. Jusque dans le ministère, notre occupation rencontrait une vive résistance et le Dauphin lui était très hostile. On arguait que la France n'entendait rien à la Colonisation et ne tirerait jamais aucun parti de la Régence.
Quant à l'opposition, après avoir combattu l'expédition d'Alger, elle soutint bientôt au contraire la nécessité du maintien de l'occupation : " Supposez, disait le Journal des Débats, un ministère qui n'eût aucune difficulté intérieure, la question diplomatique est simple. Nous gardons Alger parce que nous l'avons pris et qu'il n'appartient à personne. Nous y ferons un établissement de guerre et de commerce qui assure notre juste influence sur la Méditerranée. La Russie approuve et l'Angleterre, dans sa situation actuelle, se plaint sans s'opposer. "
Le gouvernement n'avait pris aucun engagement vis-à-vis de personne, mais Polignac disait vrai en affirmant que la France n'avait pas arrêté le plan de conduite qu'elle suivrait après la destruction de la domination turque. Dans ses notes diplomatiques, il spécifiait que la France entendait garder sa liberté d'action, mais qu'elle était disposée à se concerter avec les autres peuples chrétiens au sujet du sort de la Régence.
On songea un instant à partager le pays entre les puissances de la Méditerranée ou à donner Alger à l'ordre de Malte, ou encore à le remettre à la Porte qui y installerait un Pacha comme dans les provinces de l'Empire ottoman. Cependant les relations étaient plus que tendues avec l'Angleterre. A Alger le Consul Saint-John, après avoir proposé sa médiation, avait refusé d'entrer en relation avec Bourmont et avait prodigué à Hussein jusqu'à son départ les témoignages de sympathie et de dévouement. Après l'embarquement du Dey, il continua à surveiller et à dénaturer tous les actes de l'autorité française. Les ports de Malte et de Gibraltar regorgeaient de troupes et de navires et Saint-John écrivait à son chef, lord Aberdeen : " Dites-moi, je vous prie, si vous voulez que j'empêche les Français de venir s'installer ici. En ce cas, je saurai provoquer une telle agitation chez les indigènes qu'ils ne pourront rien faire dans ce pays."
Les instructions de Bourmont lui prescrivaient " d'éviter avec soin de ne rien faire ni rien dire qui puisse préjuger sur nos intentions ultérieures à l'égard d'Alger ou gêner plus tard la liberté d'action que la France doit se réserver pour l'organisation et la disposition définitive de ce pays."
Quelques jours après la capitulation d'Alger, le général en chef rétablit les consuls dans leurs attributions, ce qui était un acte de souveraineté. M. de Laval fut fort mal reçu lorsqu'il vint en informer le foreign (office bureau du ministère des Affaires étrangères) : " Vous n'avez pas à vous occuper de notre consul, répondit lord Aberdeen, puisqu'il est accrédité auprès du Dey. "
Le 26 juillet, dans une audience, lord Aberdeen fit entendre à notre ambassadeur des paroles encore plus comminatoires : " Jamais, lui dit-il, la France, même au temps de la République et de l'Empire ne nous a donné de pareils sujets de plaintes. " " Milord, répondit le duc de Laval, je ne saurais ni dire ni prévoir ce que vous pouvez espérer de la modération de la France, mais ce qui je sais, c'est que vous n'en obtiendrez jamais rien par la menace. "
Lord Stuart ayant, sur ordre de son gouvernement, communiqué une demande d'explications à Charles X, le Roi lui retourna sa dépêche avec cette annotation : " Pour prendre Alger, je n'ai considéré que la dignité de la France ; pour le garder ou le rendre, je ne consulterai que son intérêt."
Le maréchal de Bourmont agit, aussitôt après la capitulation d'Alger en homme assuré que la conquête de l'armée resterait acquise à la France. Il commit néanmoins, dans la courte période qui va du 5 juillet au 3 septembre 1830 des fautes assez nombreuses ; il avait su tailler, il ne sut pas recoudre. Il n'y eut pas d'organisation du pays, pas de compréhension vraie de sa situation et de ses besoins. Il est juste de dire que cette carence et due en partie au contre coup des évènements qui se produisaient en France ; l'incertitude sur le sort de la conquête, les divisions de l'armée, les maladies, le découragement, tout contribuait à compliquer notre tâche.
Le général en chef, son état-major et l'intendant général se montrèrent tous trois incapables d'administrer convenablement la ville d'Alger. Le premier soin de Bourmont, aussitôt que l'armée eut pris possession de la ville fut d'ordonner le désarmement de la milice turque.
Les janissaires célibataires au nombre de 2.500 furent embarqués pour Smyrne ; ceux qui étaient mariés, un millier environ, reçurent d'abord la permission de rester à Alger, mais quelques jours après, Bourmont, se croyant trahi par les Turcs, ordonna de tous les expulser, mesure qui fut exécutée de manière assez brutale. Les Turcs pourtant n'auraient pas mieux demandé que de nous servir ; ils disaient que le Roi de France avait sans doute un trésorier comme le Dey et que son argent en valait un autre. Habitués à commander aux indigènes, connaissant de longue date les mobiles auxquels ils obéissaient, les rouages de leur société, ils nous auraient rendu de précieux services.
Tout disparut de l'ancienne administration de la Régence ; dans la Casbah, les soldats, sous les yeux de l'intendant général, allumaient leur pipe avec les papiers de l'administration. On n'arriva à se renseigner approximativement sur l'état des propriétés et des revenus publics que par les déclarations plus ou moins exactes des particuliers et l'amin (magistrat) des eaux qui connaissait seul le tracé des aqueducs alimentant la ville d'Alger, n'opéra aucune remise de service. Nous donnâmes toute notre confiance aux Maures et aux Juifs.
" Les Maures sont intelligents, dit Denniée (intendant général), ils deviendront pour nous des agents actifs et d'utiles intermédiaires. Par eux ces immenses tribus d'Arabes seront en peu de temps nos alliés et nos pourvoyeurs. "
C'était se faire beaucoup d'illusions et sur le dévouement et sur l'influence de ces éléments de la population. Bourmont paraît s'en être aperçu : " Je destine les principaux emplois civils aux Maures ; mais dans un pays où l'habitude d'obéir au plus fort existe, on ne peut confier l'autorité première qu'à des gens de guerre et je me trouve ici obligé de choisir parmi les Kabyles et les Arabes les principaux chefs du pays, et j'en exclus les Turcs."
Dès le 6 juillet une commission de gouvernement présidée par Denniée fut constituée pour établir les besoins et les ressources du pays, les institutions qu'il s'agissait de modifier ou de remplacer. Cette commission était composée du général Tholozé, commandant la place d'Alger, du consul Alexandre Duval, neveu de celui qui jadis avait insulté le Dey, du payeur général Firino de l'officier interprète d'Aubignosc. Ce dernier qui avait longtemps résidé dans les pays barbaresques fut nommé lieutenant général de police et devint, de fait, le premier chef de l'administration algérienne.
Une commission municipale composée de Maures et de Juifs fut chargée de renseigner la commission de gouvernement ; elle était présidée par Ahmed-bou-Derba, homme d'esprit fin et rusé, mais sans moralité aucune et plus tracassier qu'habile. Les troupes vivaient en bonne intelligence avec les habitants d'Alger mais le passage subit de la vie active des camps à l'oisiveté du bivouac eut une influence fâcheuse sur la discipline et la santé des soldats. Les maisons de campagnes des environs d'Alger furent dévastées. L'armée fut bientôt décimée par les dysenteries et les entérites. Les infirmeries étaient encombrées.
Du 25 juin au 10 août il y eut 9.000 entrées dans les hôpitaux.
Bourmont qui ne se faisait aucune idée sur la situation véritable de la régence, parait avoir cru que la prise d'Alger amènerait la soumission du pays tout entier : " Tout le royaume d'Alger, écrivait-il, sera probablement soumis au Roi avant quinze jours sans avoir un coup de fusil de plus à tirer. "
Il pensait qu'on pouvait sans inconvénient rappeler une des trois divisions de l'armée d'Alger. Il donna l'investiture au Bey du Titteri, Mustapha-bou-Merzag qui signa une déclaration par laquelle il reconnaissait le Roi de France pour son souverain, lui rendait hommage et s'engageait à lui payer les tributs coutumiers. Mais Mustapha ne tint pas ses promesses et ne tarda pas à se tourner contre nous.
Le Bey d'Oran, Hassan était bien disposé en notre faveur mais il était assiégé par les indigènes et sollicitait l'appui des troupes françaises. Mers-el-Kébir et Oran furent occupés sans résistance. Une expédition fut envoyée à Bône où Damrémont prit possession de la Casbah et de ville.
" On a lieu de croire, écrivait Bourmont, que l'occupation de Bône décidera le Bey de Constantine à se soumettre et qu'il demandera à traiter aux mêmes conditions que le Bey du Titteri. "
En fait, les villes où était établie la domination turque paraissaient disposées à accepter notre souveraineté, mais, derrière les Turcs, nous ne devions pas tarder à découvrir les indigènes des tribus, montagnards ou nomades, cultivateurs ou pasteurs, Kabyles ou Arabes, autrement redoutables et résistants, sur lesquels il fallut conquérir le pays.
L'expédition de Blida mit en lumière notre situation véritable. Bourmont crut qu'il était utile de montrer que les troupes françaises ne craignaient pas de s'éloigner du littoral, et, bien qu'on l'eût averti du danger, voulut s'avancer jusqu'à Blida, situé à 48 kilomètres d'Alger, au-delà de la plaine de la Mitidja, au pied de l'Atlas et entourée de populations kabyles. Tout alla bien à l'aller mais lorsqu'on voulut revenir sur ses pas, les Kabyles se ruèrent sur la colonne et lui firent éprouver des pertes assez sérieuses.
L'échec de Blida encore aggravé par l'évacuation de Bône et d'Oran qui suivit de près leur occupation montra que nous n'étions pas invulnérables. Ce fut un premier avertissement qui nous montra que la destruction de la domination turque ne nous rendait nullement maîtres de la Régence.
La prise d'Alger était un fait accompli : la guerre d'Afrique commençait.
La nouvelle de la révolution de 1830 parvint à Alger le 11 août, d'abord par un bateau marchand apportant à Jacob Bacri une lettre d'un de ses correspondants de Marseille, puis par un navire de guerre. Une lettre du général Gérard, ministre de la guerre invitait le général de Bourmont à rester à rester à Alger : " D'heureuses circonstances, disait-il, vous ont séparé de vos collègues ; la France vous sait gré de vos succès et le gouvernement saura vous récompenser de vos services. " Bourmont parait avoir songé un moment à aller se mettre à la disposition de Charles X mais Duperré refusa le concours de la marine et une partie de l'armée était hostile à cette solution. Lorsque l'émotion du premier instant fut tombée, il prit le bon parti et travailla à conserver Alger à l'armée et l'armée à la France. Il fut convenu avec Duperré que l'armée navale et l'armée de terre quitteraient ensemble leurs couleurs et un ordre du jour du 16 août leur prescrivit de substituer la cocarde et le pavillon tricolore à la cocarde et au pavillon blancs.
Le 2 septembre le général Clauzel arriva à Alger à bord de l'Algésiras ; le maréchal de Bourmont lui remit le commandement et fit ses adieux à l'armée. Bourmont s'embarqua le lendemain. Il avait demandé à l'amiral Duperré un bâtiment de guerre pour quitter l'Afrique ; ce bâtiment lui fut refusé. Il dut noliser à ses frais un petit brick de commerce autrichien et partit avec deux de ses fils. Son bagage était si minime que deux Maures suffirent à le porter. Un petit coffret renfermant le cœur de son fils tué pendant la campagne était le seul trésor qu'il emportât d'Alger. Un seul officier encore obscur l'accompagna presque seul jusqu'au bord de la mer ; ce courtisan du malheur s'appelait La Moricière.
" Il faut rendre cette justice au maréchal de Bourmont, dit Reynal, qu'il était impossible de se conduire avec plus de prudence et de modération qu'il ne l'a fait lorsque la nouvelle des évènements de juillet est venue frapper l'armée d'étonnement. Il a évité la guerre civile et donné l'exemple de la soumission en prenant lui-même la cocarde tricolore et en faisant arborer le drapeau tricolore sur la Kasbah. "
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau, professeur au collège de France.
Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard, professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930
|
|
| La monarchie de juillet et l'Algérie
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Les relations diplomatiques de la France avec les puissances européennes se trouvèrent profondément modifiées par la Révolution de juillet. Le gouvernement de Charles X, bien vu de la plupart des souverains de l'Europe, se trouvait en bonne posture pour résister aux objections et aux menaces de l'Angleterre.
Après 1830, la Sainte alliance se reforme contre la France :
- Le tsar, Nicolas qui avait poussé la France à entreprendre la campagne d'Alger refusait de reconnaître Louis-Philippe,
- en Autriche, Metternich faisait appel à la solidarité des souverains contre l'esprit révolutionnaire,
- en Prusse Frédéric-Guillaume II était animé des plus mauvais sentiments à l'égard de la France.
Le Roi Louis-Philippe était suspect aux vieilles monarchies par ce que le tsar appelait " une usurpation de famille ". Déjà en 1815, les souverains avaient écarté le duc d'Orléans, dont l'accession au trône aurait créé pour eux-mêmes un précédent redoutable et inquiétant. Les scènes tragiques de juillet n'étaient pas pour les faire changer d'opinion.
Le nouveau gouvernement se trouva donc rejeté du côté de l'Angleterre. Mais cette puissance n'allait-elle pas mettre comme condition à son bon vouloir l'évacuation d'Alger ? Le duc de Wellington y songea : "Sachons profiter de l'occasion, écrivait-il, à lord Aberdeen, et hâtons-nous de régler toutes nos difficultés avec la France. "
Le gouvernement eût été jusqu'à un certain point excusable de faire la part du feu en abandonnant notre conquête récente ; Il faut lui savoir gré de ne pas avoir cédé à la tentation.
Si la Restauration a eu le mérite d'envoyer nos soldats à Alger, la monarchie de juillet a eu celui de les y maintenir. Le rôle personnel du Roi Louis-Philippe en cette affaire fut considérable. Il défendit la jeune France africaine contre les jalousies du dehors et les préventions du dedans. La guerre d'Afrique fut, comme l'on dit, le roman militaire de la monarchie bourgeoise, le rayon d'idéal dans une époque assez terne.
Pour mieux marquer l'importance qu'il assignait à l'Algérie dans les destinées nationales, il y envoya successivement tous ses fils, le duc d'Orléans, le duc de Nemours, le prince de Joinville, le duc d'Aumale, dont les noms sont indissolublement liés à l'histoire de la conquête.
Sans appui dans le Parlement, mal servi par ses ministres et ses ambassadeurs, abandonné par l'Europe, il finit par triompher de l'Angleterre et de sa mauvaise volonté.
En 1833, Lord Aberdeen, dans une séance de la Chambre des lors, prétendit que Louis-Philippe, au moment de son élévation au trône, avait pris l'engagement de retirer l'armée d'Afrique : " Il existe, déclara-t-il des documents qui prouvent clairement que des engagements positifs relativement à Alger ont été ratifiés non seulement par le Roi de Français mais encore par ses ministres. "
C'est là une pure légende. Les documents historiques des archives françaises et anglaises, les actes et les paroles des ministres de Charles X et de Louis-Philippe montrent au contraire que la France avait gardé toute sa liberté d'action.
Les recherches ordonnées par le duc de Broglie, qui fit dépouiller avec soin toute la correspondance et interrogea M. de Bois-le-Comte, directeur des affaires politiques sous le ministère de Polignac, donnent un démenti aux assertions contraires.
Le gouvernement était résolu à conserver Alger, mais résolu également à s'abstenir de toute déclaration officielle à ce sujet. De là le vague et l'imprécision qui régnèrent longtemps, au moins en apparence.
La question de l'évacuation ou de la conservation d'Alger fut débattue en septembre 1830 au Conseil des ministres ; la discussion fut assez vive ; M. Molé se prononça nettement pour la conservation et les autres ministres, d'abord hésitants, se rallièrent à sa manière de voir.
Les instructions du prince de Talleyrand, nommé ambassadeur à Londres, furent rédigées en conséquence ; elles étaient très nettes et très fermes : " La France, disait le Roi, a un intérêt pressant à diminuer la prépondérance de l'Angleterre dans une mer qui est la sienne et dont l'Angleterre n'est même pas riveraine. Elle doit chercher toutes les occasions de rendre l'occupation, de Malte et des îles ioniennes, inoffensive. L'entreprise d'Alger peut avoir les conséquences les plus avantageuses pour notre avenir maritime.
Sur cette question la France est en opposition d'intérêt et de politique avec l'Angleterre et aura besoin de toute l'habileté de son ambassadeur. L'affaire d'Alger forme la partie la plus délicate de votre mission. L'évacuation serait contraire à notre dignité et à nos intérêts."
Diplomate de la vieille école, Talleyrand, qui avait toujours désapprouvé l'expédition d'Alger, affectait de dédaigner les questions coloniales. Il parlait le moins possible de ce sujet brûlant : " J'aimerais bien que nos journaux en fissent autan. Il est bon qu'on s'accoutume à notre occupation et le silence est le meilleur moyen. "
Le temps en effet travaillait pour nous. Le 15 novembre 1830, le ministère tory du duc de Wellington fut renversé par un vote de la Chambre des communes. Talleyrand, très influent dans la haute société anglaise n'était pas étranger à cette chute.
Sur ces entrefaites, de graves évènements européens, la révolution belge, l'intervention autrichienne dans les États pontificaux, l'insurrection de Pologne, enfin et surtout la question d'Orient, reléguèrent au second plan la question d'Alger.
Les Français occupaient Anvers, les Russes étaient aux portes de Constantinople, tous les souverains étaient aux prises avec la marée montante des peuples ; l'affaire d'Alger était bien peu de chose à côté de ces graves soucis.
L'Angleterre aimait mieux nous voir à Alger qu'aux bouches de l'Escaut ou à Alexandrie. La satisfaction de nous avoir écartés des Flandres malgré la révolution belge amena le gouvernement britannique à s'accommoder de notre occupation de l'Algérie.
La France put y maintenir son armée, sans toutefois déclarer encore expressément ce qu'elle entendait faire de sa conquête.
A Alger le Consul Saint-John gardait toute la confiance de son gouvernement et ne changeait rien à son attitude : " Il est animé à notre égard, disait le général Sebastiani, d'une évidente malveillance, il semble se plaire à susciter des embarras à nos généraux. " Il ne cessait de répéter aux indigènes que notre occupation était provisoire, que l'Angleterre s'opposerait à notre maintien en Afrique et il entretenait parmi les musulmans le secret espoir d'une évacuation prochaine. Il s'attachait à surveiller et à dénaturer tous les actes de l'autorité française.
La nouvelle de la révolution de juillet et de la désorganisation qui s'ensuivit le remplirent de joie. Il aurait voulu que l'Angleterre profitât des circonstances pour récolter ce que nous avions semé : " Comme je serais heureux, écrivait-il, si nous pouvions mettre la main sur ce pays ! Je vois clairement maintenant que nous pourrions le coloniser et que nous en tirerions d'immenses bénéfices. La principale difficulté est de faire comprendre aux indigènes les avantages qu'ils tireront d'un établissement européen. Or, les Français en sont et en resteront toujours incapables, tandis que notre caractère, qui est bien connu jusqu'aux extrémités de la Régence, nous concilie toutes les populations."
L'Angleterre ferma l'oreille aux insinuations de son fougueux représentant, qui sembla se résigner mais demeura prêt à profiter de toutes les circonstances.
Malgré ses préoccupations européennes, malgré l'entente cordiale, le gouvernement britannique se garda de rien dire ou faire qui pût comporter de sa part une reconnaissance tacite de notre occupation. Le langage des ministres français était soigneusement surveillé.
Au début de 1832 Casimir-Perier ayant déclaré que notre occupation militaire serait maintenue à Alger, lord Londonderry en profita pour interpeller le ministère. L'année suivante le maréchal Soult ayant dit " qu'il n'y avait aucun engagement pris avec les puissances à l'égard d'Alger, que nous pourrions faire à Alger ce que nous voudrions, que les mesures prises par le gouvernement et les crédits militaires qu'il demandait rendaient peu vraisemblable une évacuation du pays," lord Grey se plaignit directement à Talleyrand qui recommanda la prudence.
En 1834, M. Stanley, ministre des colonies, répondant à une interpellation de sir Robert Peel, maintenait que l'Angleterre n'acceptait pas la prise de possession d'Alger par la France.
En 1838, lord Palmerston reparla encore des droits de la Porte sur l'ancienne Régence et déclara que la France n'y exerçait qu'une simple occupation militaire : " La France, on doit le savoir, répondit le comte Molé, ne transigera jamais. La question de nos droits sur Alger est une question jugée depuis longtemps et sur laquelle il n'y a pas à revenir. "
Palmerston dit à notre ambassadeur qu'il ne fallait pas donner à cette discussion plus d'importance qu'elle n'en avait : " Votre gouvernement, ajouta-t-il, peut être convaincu que la possession d'Alger ne deviendra jamais entre lui et le ministère dont je fais partie l'occasion ou même le prétexte d'un conflit sérieux. "
Les protestations de l'Angleterre prirent un caractère de plus en plus atténué, de plus en plus platonique. M. Saint-John continua longtemps à bouder ; en 1839 encore, au moment du voyage du duc d'Orléans, il présenta le corps consulaire sans aucun compliment, se bornant à dire les noms et les titres de ses collègues.
C'est seulement en 1851 que la Grande Bretagne en demandant l'exequatur (procédure permettant de rendre exécutoire en France soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, qu'elles aient été rendues en France ou à l'étranger) pour le consul qui succédait à Saint-John, reconnut la légitimité de notre occupation.
Le parlement et l'opinion
Le gouvernement de juillet obligé de ménager l'Angleterre, devait par ailleurs tenir compte du parlement et de l'opinion peu favorables à l'entreprise africaine. L'Algérie naissante rencontrait en France plus d'adversaires que de partisans.
Au Parlement, chaque année, au moment de la discussion du budget et surtout des crédits extraordinaires, les députés se plaignaient des dépenses à leur avis excessives qu'entraînait une conquête inutile et demandaient l'évacuation. M. Desjobert (député), le plus résolu des adversaires de l'Algérie, s'était fait une spécialité de la combattre, déclarant qu'elle était pour la France une cause de faiblesse, que l'argent qu'on y gaspillait serait beaucoup mieux employé en France même et que les Français étaient d'ailleurs incapables de coloniser : " On composerait plus de cent volumes, écrivait le général Dubourg en 1836, avec les écrits qui, depuis six ans, ont été publiés sur nos possessions du Nord de l'Afrique. La question est-elle maintenant éclairée ? Elle est plus embrouillée que jamais ; grâce au besoin irrésistible que nous avons à faire briller notre esprit, à notre passion pour la controverse, on est parvenu à tellement dénaturer une question positive, que beaucoup de personnes bien intentionnées en sont venues à penser que peut-être il serait plus avantageux d'abandonner Alger puisque nous ne savons pas en tirer parti. "
Toutes les dissertations sur l'Algérie et sur son avenir ne méritent guère de retenir l'attention ; si çà et là on y trouve une idée juste, c'est bien par hasard ; les auteurs en général ignorent complètement les données du problème. Parmi ces brochures, une des plus lues fut celle de Maurice Allard, intitulée Considérations sur la difficulté de coloniser la régence d'Alger. On y trouve presque tous les arguments qui seront repris pendant plusieurs années par les adversaires de la colonisation algérienne et par l'opposition. Par qui faire cultiver ce pays ? La traite des noirs est supprimée. Les Européens ne s'acclimateront pas, les indigènes sont indomptables. Le pays est d'ailleurs pauvre ; ni les cultures européennes ni les cultures tropicales n'y rencontreront de bonnes conditions : " Hâtons-nous, conclut l'auteur, de renverser dans le port d'Alger les fortifications de cette ville barbare, et que désormais nul vaisseau ne puisse y trouver un abri ; ramenons en France cette armée qu'une terre inhospitalière dévorerait en peu de temps, dont nous pouvons avoir besoin ailleurs et qu'attendent sur nos fortunés rivages les félicitations et les honneurs de la patrie. "
Les plaidoyers des partisans de la colonisation, des " colonistes " comme on les appelait à cette époque, insistaient sur les avantages que la France pouvait retirer de la colonisation de l'Algérie, mais les arguments qu'ils faisaient valoir ne s'appuyaient que sur des données bien vagues, parfois même erronées, comme c'était le cas lorsqu'ils préconisaient les cultures tropicales, canne à sucre, café, indigo, coton.
Au Parlement, il ne fut question d'Alger ni en 1830, ni en 1831, pas plus à la Chambre des Pairs qu'à la Chambre des députés. Un premier débat eut lieu en 1832 à propos du budget de la guerre ; le rapporteur, M. Passy, se plaignit des frais élevés qu'occasionnait le corps d'occupation ; le maréchal Clauzel, M. de Laborde, se prononcèrent en faveur de la colonisation, les ministres Casimir Périer et Soult se montrèrent très réservés.
En mars 1833, à propos d'une demande de crédits supplémentaires, d'éloquents discours furent encore prononcés mais sans qu'il en sortit rien de définitif.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau, professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises et l'expansion de la France dans le monde. Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930
|
|
Assunto: Historiette de saison...
Envoyé par M. Alain
|
Il a neigé toute la nuit. Voilà ma matinée.
08:00 : je fais un bonhomme de neige.
8:10 : une féministe passe et me demande pourquoi je n'ai pas fait une bonne femme de neige.
08:15 : alors je fais aussi une bonne femme de neige
08:17 : la nounou des voisins râle parce qu'elle trouve la poitrine de la bonne femme de neige trop voluptueuse.
8:20 : le couple d'homo du quartier grommelle que ça aurait pu être deux bonshommes de neige.
08:25 : les végétariens du n°12 rouspètent à cause de la carotte qui sert de nez au bonhomme. Les légumes sont de la nourriture et ne doivent pas servir à ça.
08:28 : on me traite de raciste car le couple est blanc.
08:31 : les Musulmans de l'autre coté de la rue veulent que je mette un foulard à ma bonne femme de neige.
08:40 : quelqu'un appelle la police qui vient voir ce qui se passe.
08:42 : on me dit qu'il faut que j'enlève le manche à balai que tient le bonhomme de neige car il pourrait être utilisé comme une arme mortelle. Les choses empirent quand je marmonne : « ouais; surtout si vous l'avez dans le .. ».
08:45 : l'équipe de TV locale s'amène. Ils me demandent si je connais la différence entre un bonhomme de neige et une bonne femme de neige. Je réponds: «oui; les boules » et on me traite de sexiste.
08:52 : mon téléphone portable est saisi, contrôlé et je suis embarqué au commissariat
09:00: je parais au journal TV; on me suspecte d'être un terroriste profitant du mauvais temps pour troubler l'ordre public.
09:10 : on me demande si j'ai des complices.
09:29 : un groupe djihadiste inconnu revendique l'action.
Morale : il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est juste la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
|
|
France… Rappel ! L'Algérie
Par M. Robert Charles PUIG
|
| 63 / France… Rappel ! L'Algérie… et un des éléments contribuant à sa fin : les barbouzes du pouvoir gaulliste.
Inutile de dire combien le livre-documents de Jean-Jacques JORDI : Un silence d'Etat, aux éditions Soteca, permet de rétablir une vérité occultée par les pouvoirs politiques français en place depuis plus de cinquante années. Le livre ouvre les yeux des Métropolitains, car nous savions, nous, sans avoir le droit à la parole, toute l'ignominie de ces pages de la vraie histoire la fin de l'Algérie française, tout le mal dont nous avons souffert à travers les mensonges, les exactions et la collusion de l'Etat avec les terroristes, dans la perte de cette magnifique province.
Bien entendu, " les disparus civils européens de la guerre d'Algérie " le sous-titre du livre de J-J. JORDI, me semble être le premier acte d'une saga où devrait suivre, car ils le méritent " Les disparus Harkis et Supplétifs arabes de la guerre d'Algérie " (C'est une réflexion d'un ancien Harki qui a commandé le livre dans une librairie en rupture de stocks qui m'a été rapportée, et que je fais mienne)
Je reviens à mon sujet principal : les barbouzes et je rappelle une phrase de Roger Frey Ministre de l'intérieur, en février 1962. Il affirmait : " Il n'existe aucun personnel chargé de la lutte anti-OAS ". Il mentait car les " barbouzes " existaient depuis 1961. (Historia : la fin de l'Algérie française, N° 424 bis édité en 1982)
C'est dans le bureau parisien de l'avocat Pierre Lemarchand, ancien du service d'ordre du RPF gaulliste que fut créé le SAC (Service d'action civique). Il y avait J.-B Biaggi, des " Volontaires de l'Union française ", Lucien Bitterlin, responsable de la fédération algérienne du mouvement pour la coopération (MPC) et animateur à Radio Alger en 1960, et bien entendu la présence, à la réunion, de Roger Frey et de son adjoint, Alexandre Sanguinetti. Ils créeront le SAC, sous couvert, certainement d'obédiences secrètes et en dehors des autorités officielles, par ailleurs bien informées par leur Ministre de l'intérieur, en recrutant des truands pour combattre l'OAS. Une opération d'envergure sous la direction de Dominique Poncharlier, ancien de la DGER (ex SDECE) secondé par André Goulay et Yvan Le Tac.
Le financement du SAC est assuré par le MCP de Jacques Dauer, de nombreuses associations gaullistes (Claude Raybois, le colonel Gentgen…) domiciliées à la même adresse que le SAC ! La sécurité militaire se fourvoie aussi dans cet assemblage fait pour la torture et le meurtre : Jean Morin, délégué général en Algérie, Claude Vieillescazes et Louis Verger. Ils fournissent les armes et les laissez-passer. Jean Dubuquoy et Louis Dufour assureront les soldes et les fameuses villas - lieux de tortures - autour du centre de la capitale algéroise.
Tout est en place pour combattre, avec des moyens énormes, l'OAS !
Le SAC, pot de fer, avec une logistique d'Etat puissante, va donc s'opposer à un mouvement patriotique unique dans les annales de la lutte pour le maintien de l'Algérie française au sein de la France : l'OAS, pot de terre, peut-on dire. D'une manière honteuse, inavouée à ce jour, la propagande officielle va étouffer, durant des décennies, le rôle du SAC en occultant les sordides actions criminelles des barbouzes et de ses parrains du gouvernement français en place où " l'équerre " joue le rôle de l'aigle nazi de 1940 / 45 !
Si l'OAS reste, aux yeux des médias, le " terroriste " à dénoncer, à abattre, le pouvoir à Alger, au Rocher-Noir et l'exécutif à Paris placent sous silence les actions sanguinaires des équipes du SAC et de ses judokas : Jim Alcheik et le pire, Roger Bui-Thé ! Ils ne sont pas les seuls à mettre en pratique leurs méthodes vicieuses de truands, d'autres débarquent par dizaines en Algérie, pro-gaullistes, provocateurs, bourreaux, kidnappeurs, assassins. Ils ont un objectif : mener des actions démoniaques et perverses contre l'OAS et les patriotes de l'Algérie français, parfois jusqu'à l'élimination physique de la victime.
Des villas d'El Biar à celles du Telemny ou depuis l'école de police d'Hussein-Dey, les équipes barbouzes de Bitterlin, bientôt soutenues par Michel Hacq, directeur à la PJ et envoyé à Alger avec deux cents policiers et commissaires anti-OAS, vont agir en toute impunité, d'une manière sauvage et inhumaine, sous couvert d'un gaullisme toujours muet sur ces exactions depuis 1962.
La lutte sera sans pitié, mais ne l'oublions pas, montré injustement d'un doigt accusateur par tous les médias, le temps de l'OAS a duré moins de deux ans. Celui du FLN meurtrier, huit longues années. Celui du SAC, à partir de 1961, assez de temps pour qu'un jour il soit reconnu responsable de ses crimes et surtout de sa participation aux massacres des innocents en renseignant et soutenant le FLN dans des enlèvements d'européens et des assassinats. En effet, les barbouzes du SAC et du pouvoir gaulliste " avouent " bien leur rôle de traitres lorsqu'ils sont obligés, par peur de l'OAS qui les poursuit, de se " réfugier " à la Redoute, au Radjah, un hôtel dont le propriétaire est le Bachagha Bouabdellah, proche du FLN.
Traqués par l'OAS, les barbouzes commettent les pires bavures : des enlèvements ; des interrogatoires des plus horribles ; des actes de tortures et de crimes les plus impardonnables contre des civils européens jusqu'à l'indépendance et… sans doute pour certains, même après.
Officiellement, les barbouzes n'ont pas existés, le SAC non plus en Algérie, mais J-J Jordi cite une " mission C " dans son livre. Y-a-t-il une différence entre barbouzes, SAC et " mission C " ? Je ne le pense pas.
Ce fait certain, irréfutable, vérifiable, demeure aujourd'hui, en 2011, indigne de la cinquième république, du pouvoir en place et demande des explications parce que le gaullisme, des ministres à la botte du gaullisme, des associations favorables au général ont contribué matériellement et financièrement à ces exactions du SAC. Ils ont soutenu des criminels et ont été les acteurs sanguinaires de la fin de l'Algérie française.
Nous ne seront plus là pour découvrir les documents d'archives de ces années d'Algérie française, en l'an 2070, mais ils existent ces écrits, ces traces, et devront un jour désigner les coupables.
Robert Charles PUIG / novembre 2011
|
|
" Le sacrifice du matin "
L'édito de Charles SANNAT du 26 mars 2018
|
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ce qui domine, c'est évidemment l'émotion.
Ce qui reste, c'est la beauté d'un geste et la décision d'un homme.
Ce qui reste, c'est l'histoire, la grande et la petite.
Ce qu'a fait le colonel Beltrame n'est pas uniquement un acte héroïque, c'est bien plus que cela.
C'est un sacrifice.
Le sacrifice du matin.
Cette expression n'est pas de moi. C'est le titre de l'ouvrage écrit par Pierre Guillain de Bénouville, l'un des plus grands résistants pendant la dernière guerre mondiale aux côtés d'un Henri Frenay ou d'un Jean Moulin.
" Ce livre héroïque est la symphonie de la Résistance. " Ce jugement de François Mauriac définit ce livre exceptionnel, dont rien n'a terni l'éclat…
Que dit-il ? En substance, que " la résistance fut, en vérité pour chacun de ceux qui y participèrent, le matin d'une nouvelle vie et les résistants ne demandent pas autre chose à ceux qui ne furent pas avec eux dans l'action que d'unir au sacrifice du matin le sacrifice du soir ".
Se sacrifier pour les autres, se sacrifier par amour, par engagement, pour les autres, pour le pays pour des idées qui nous dépassent.
Ce sacrifice permet de poser quelques réflexions.
D'un côté, un homme qui se sacrifie pour en sauver d'autres (qu'il ne connaît pas), de l'autre, un homme qui, lui, tue aveuglément. Ceux qui ne voient pas la différence entre ces deux actes, entre les deux hommes, ne verront jamais rien.
Les deux vont mourir, l'un en sauvant, l'autre en tuant. Ceux qui pensent que tout se vaut, que tout est " égal ", que tout est pareil, ne penseront jamais convenablement.
Tout ne se vaut pas. Cruel contraste.
D'un côté, un homme qui s'engage au nom d'une transcendance que l'on peut nommer croyance catholique, ou France, ou Patrie, bien commun, service du public, des gens, de ses concitoyens.
De l'autre, une classe politique inepte. Vendue. Massivement corrompue, inféodée à des pouvoirs supranationaux et qui vendent consciencieusement les intérêts supérieurs de notre pays et donc de son peuple (dans toute sa diversité).
Terrible différence entre " eux " et " lui ".
D'un côté, des féministes et autres bien-pensants qui hurlent au " machisme " à l'égalitarisme dégoulinant " homme-femme ", à la " modernité " de la " pâââritééé " qu'il convient de dire en bêlant tant il est impossible de déroger à cette mode sans risquer tous les qualificatifs les plus odieux, alors qu'il n'en est rien. Homme et femme ne seront jamais identiques, et cette différence est fondamentale. Père et mère, aussi importants et complémentaire, mais surtout le véritable amour pour une femme c'est d'accepter parfois… Le sacrifice, celui où l'on dit " les femmes et les enfants d'abord ", parce que tout ne se vaut pas, que les femmes et les enfants sont notre part d'éternité. Au moment des choix, au moment où soufflent les vents, certains choisissent de prendre la place d'une femme otage. La vie d'un homme vaut moins que celle d'une femme.
Il n'y a pas d'égalité (sauf celle de droit bien évidemment).
Les féministes refusent aux hommes ce qu'il y a de plus beau, à savoir d'accepter volontairement de se sacrifier par amour pour elles.
Terrible paradoxe
Le méchant était fiché " S ", quelle honte me direz-vous, c'est l'échec des services de renseignements, encore un autre terroriste connu des services de police et de gendarmerie. Vous pouvez le voir comme cela. En réalité, si nous inversons le raisonnement, nous nous rendrons compte que tous ceux qui commettent un acte terroriste sont fichés S. Cela veut dire que le travail qui a été fait par notre renseignement est d'une immense qualité. Nous avons parfaitement su identifier ceux qui peuvent s'avérer potentiellement dangereux.
C'est très rassurant. Les estimations vont de 10 à 20 000 fichés S. Le problème n'est ni le renseignement, ni le fichage. Le problème c'est l'action politique qui en découle. Que veut-on faire de ces renseignements ? Manifestement pas grand-chose. Nous attendons, enfin pas nous, " eux ", c'est les petits sans grandeur qui nous dirigent. Ils attendent, ils ne prennent aucune décision.
D'un côté, un homme doté d'un exceptionnel pouvoir de décision et de conviction. De l'autre, des nains hésitants.
Terrible contraste encore.
D'un côté, un homme à la foi inébranlable dans sa religion catholique et dans son pays, de l'autre des nihilistes sans foi ni loi - et je ne parle pas du terroriste qui a bien une foi - mais de nos dirigeants qui nous dirigent vers les abîmes pour tous.
Terrible contraste entre la force de ceux qui croient et la puissance de la transcendance de certaines idées et le nihilisme consumériste de nos masses décérébrées.
Le sacrifice de cet officier, dans la plus pure tradition de la grandeur de la France, renvoie à ce que sont tous les autres, c'est à dire pas grand-chose.
Terriblement dérangeant de voir ainsi pointées, par l'exemplarité des actes d'un homme, nos bassesses et lâchetés quotidiennes.
Peut-être que le colonel Beltrame ne le savait pas, mais en s'offrant en sacrifice pour notre pays, pour chacune et chacun de nous, sans rien attendre, il nous a montré d'une manière éclatante, éblouissante, la différence entre être un Homme et donner des leçons de bien-pensance sur le petit écran, à la radio, ou dans la presse écrite. Il nous montre aussi la nécessaire humilité dont il faut savoir faire preuve sur les grands sujets.
Il nous a montré, par sa grandeur, la petitesse de ceux qui aujourd'hui sont aux commandes de notre pays et ne manqueront pas de parader devant son cercueil.
C'est eux (et ceux qui les ont précédés en " responsabilités ") qui ont rendu nécessaire le sacrifice de cet homme qui n'a pas failli quand il a fallu choisir.
C'est eux qui ont rendu possible le Bataclan, Nice, et toutes les tueries qui endeuillent que trop régulièrement notre pays, et celles à venir, hélas, déjà prévisibles.
Enfin, il est également important de dire que nous avons à faire face à une guerre idéologique. À cette guerre idéologique qui repose sur l'idéologie de l'islam radical, nous ne pouvons pas qu'opposer les armes, la prison, ou la répression évidemment indispensable. Comme dans toute guerre idéologique, nous devons gagner les âmes et les cœurs. À une idéologie aussi forte, il faut opposer une pensée toute aussi forte.
Il est évident que les imbéciles qui pensent que la " laïcité " ou le " consumérisme " sont suffisants se trompent terriblement.
Le colonel Beltrame, lui, a su opposer sa croyance à une autre idéologie mortifère en montrant l'évidente supériorité du sacrifice par amour, à la tuerie par la haine.
Son sacrifice est un acte retentissant.
Nous passerons des heures sombres, mais je ne doute pas que partout en France, le geste de cet officier saura inspirer les " gueux " que nous sommes et qui sauvons les nations par rapport aux " riches " qui les vendent.
Il a fait le sacrifice du matin, à nous tous de nous unir à lui dans le sacrifice du soir, pour que demain, un autre jour se lève sur la France, plus pacifié que la veille.
Au colonel Beltrame. La Patrie reconnaissante et la population aussi.
Charles SANNAT
" À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes " (JFK)
" Ceci est un article 'presslib', c'est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s'exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l'actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d'information quotidienne sur www.insolentiae.com. "
|
LES FRANÇAIS EN ALGERIE (1845)
Source Gallica : Louis Veuillot N°18
|
XXVI -
LES FETES DE JUILLET A ALGER. - BAL CHEZ LE GOUVERNEUR - TOUT EST DIT. - SOUVENIRS
Il faut que je vous parle de la célébration de notre anniversaire de juillet. L'anniversaire de juillet, non pas celui de la conquête, mais celui de la révolution des Maures, que dites-vous de cela ? N'est-ce point assez bizarre ?
Vous savez que je n'aime point les fêtes politiques, particulièrement celles qui consacrent le souvenir des révolutions : elles irritent le vaincu, et je n'ai jamais Vu qu'elles honorassent beaucoup le vainqueur. Qu'un peuple aille voir danser des saltimbanques en mémoire du jour où ses concitoyens se sont entr'égorgés, rien ne me parait plus sauvage, surtout lorsqu'on a eu, comme en 1830, la prétention de tout terminer par une charte qui ne reconnaît ni vaincus ni vainqueurs. Je concevrais qu'on eût bâti une belle église, comme autrefois les Suisses, lorsqu'ils avaient du bon sens, élevaient une chapelle sur leurs champs de bataille, et que dans cette église on priât solennellement Dieu de donner la paix à tous les morts, et la concorde à tous les vivants ; mais les mâts de cocagne, les orchestres en plein vent, le pathos parlementaire, les banquets de la garde nationale, tout cela me paraît digne des hommes d'Etat d'Haïti. A certains égards, la révolution, la Convention elle-même, cette bête féroce effroyable, ont mieux eu que nous, dans leur brutalité, l'instinct de ce que doit être une fête publique. Je trouve aux programmes tracés par les maîtres des cérémonies de la Terreur une espèce de grandiose stupide où nous n'arrivons plus. La fête de la Raison, la fête de la Liberté, la fête de la Jeunesse, la fête de l'Etre suprême, c'était égyptien, grec, romain, absurde, tout ce que l'on voudra, mais c'était une idée.
La fête de juillet, c'est un coup de poing, c'est pire encore, et je ne sais pas ce que l'on peut y voir, sinon que cent mille Français dans Paris, ce jour-là, boivent outre mesure pour vexer les carlistes. Mettons cependant que, pour des raisons qui m'échappent, la chose ait du sel à Paris ; quel piquant lui trouve-t-on à Alger, où les carlistes n'existent point ? N'importe, au milieu d'un peuple qu'il a conquis, le Français se veut réjouir d'avoir chassé ses oppresseurs.
Il est vrai que les Maures et les Arabes raisonnent peu ; mais ils voient clair, et ces fêtes ne sont guère propres à leur donner une idée avantageuse de notre supériorité morale. Tout ne s'y passe pas fort majestueusement à Paris; à Alger, c'est pire. Sur un coin de la place du Gouvernement dansaient quelques misérables mozabites en costumes de femmes. La foule y paraissait prendre plaisir, mais je vous assure qu'il n'y a point de sergent de ville commis à la protection des mœurs dans les bals masqués de Paris, qui ne se fût scandalisé de ces infâmes contorsions qu'ici la police autorise, et que peut-être elle soudoie. Il faut avoir étrangement perdu le sens chrétien et le sens moral pour qu'un pareil spectacle ne révolte pas. On m'a dit, comme je m'en indignais, que ce n'était là qu'un abrégé de ces danses mauresques où souvent les autorités civiles et militaires, et les princes eux-mêmes, assistent officiellement. Soit ! C'est triste !
Au-dessus des mozabites, sur une corde tendue dans les airs, un homme, en troubadour du moyen âge, et une femme, un chrétien et une chrétienne, faisaient des cabrioles terribles. Vous m'accuserez de fanatisme, mon cher ami, mais, je l'avoue, ce m'était une douleur, et une douleur poignante, de voir deux êtres baptisés se livrer à ce métier pour divertir toute cette canaille musulmane qui regardait, gravement. Si j'étais gouverneur de l'Algérie, j'interdirais sévèrement aux chrétiens ces fonctions immondes ; ce serait une des premières choses à quoi j'emploierais mon pouvoir. Je ne voudrais pas que ma foi fût déshonorée dans la personne de tous ces coureurs d'aventures, qui font, pour gagner quelques pièces d'argent, ce qu'un Turc et ce qu'un Maure n'auraient jamais voulu faire.
Je vous passe les mâts de cocagne, les tourniquets, les lampions, le théâtre populaire, où j'ai reconnu de loin que deux gendarmes bafouaient un maire de village; vous connaissez ces amusements d'un grand peuple. Venez voir par ici de la couleur locale ; voici la danse des nègres, beaucoup plus décente que celle des mozabites, et beaucoup plus divertissante. On ne saurait s'amuser d'une manière plus africaine et plus enragée. Sous ce soleil dévorant, quinze ou vingt citoyens du Sennaar, noirs comme des diables, trempés de sueur, enfarinés de poussière sautent, à se briser l'échine, aux sons de la plus furieuse musique qui fût jamais. L'un d'eux frappe de toute sa force sur un monstrueux tambour, les autres font sonner des castagnettes de fer que vous prendriez pour d'honnêtes casseroles si elles vous étaient présentées. Il n'y a point de flûte à l'opéra qui charme autant ces oreilles noires, et Tulou serait méprisé s'il venait ici offrir son talent. Pourtant ce n'est rien encore que la musique, il faut voir ces figures, ces têtes rasées, ces petits yeux, ces larges lèvres et ces plus larges bouches, démesurément ouvertes par un rire de béatitude. Pour l'amour du grotesque, allez trouver un nègre, et faites-lui plaisir, afin que vous puissiez voir un nègre content, car c'est la plus plaisante chose du monde. Néanmoins la vue de cette grande danse fatigue à la longue ; mais il n'y a point d'hypocondrie qui puisse tenir contre la danse des petits bâtons, dont je regrette de ne pouvoir vous donner le nom technique. Les danseurs se mettent en rond.
Chacun d'eux est armé d'un petit bout de bois équivalant à une baguette de tambour, dont il frappe alternativement sur le bâton de celui qui le précède et sur le bâton de celui qui le suit. On va lentement d'abord, et d'un air grave qui a bien son mérite, vu la physionomie des acteurs ; mais la musique s'anime, il faut s'animer avec elle ; et chacun alors, pourvu qu'il donne son coup et garde son rang, peut faire de ses bras, de ses jambes, de son corps, ce que bon lui semble. L'inspiration du moment est la seule règle des poses ; vous ne pouvez imaginer ce qui en résulte, cela dépasse toutes les rondes du sabbat et toutes les chinoiseries possibles. Les uns sautent comme des grenouilles, les autres frétillent comme des couleuvres. Il y en a qui prennent des airs enfantins, il y en a qui exécutent leurs sauts de carpe avec une gravité magistrale. Bref, heureux le roi de Tombouctou s'il connaît son bonheur !
Revenons à la haute civilisation, qui danse tout comme la sauvagerie, et franchissons des considérations philosophiques dont les humanitaires du dix-huitième siècle ne se seraient pas abstenus en pareille rencontre. Voyez-vous Jean-Jacques Rousseau prenant feu à cette ressemblance, et Diderot et Voltaire, et les cent géomètres de l'Encyclopédie, chacun à sa manière, s'escrimant pour prouver que rien ne ressemble au blanc comme le noir, car ils témoignent tous deux leurs joies par des danses, donc... et tout y passe, lois, coutumes, religion. Trop heureux le bramine catholique, si l'on ne finit pas par démontrer qu'il est très-inférieur au prêtre des fétiches. Il me semble que je les entends. Mais, puisque la mode en est aujourd'hui méprisée, laissons-les où ils sont, et concédons-leur la moitié de ce qu'ils ont dit. Dans le fond, je pense, comme eux, que les barbares et les sauvages ont de quoi nous répondre, tant que nous ne leur montrons pas cette croyance que nous dédaignons si fort et qui fait notre seule supériorité. Je voudrais qu'on me pût dire en quoi le menuet mérite plus d'honneur que la danse des petits bâtons.
Le gouverneur, se pliant à l'usage, a donné un grand bal où l'on a invité toute la population présentable d'Alger. On y voyait un mufti, des cadis, des imams, un rabbin, le président du consistoire, des commissaires de police, des juges, des mulâtres, des juifs, des hommes de lettres, des Turcs, des Arabes, des Maures, un descendant des Zegris de M. de Chateaubriand, des Prussiens, des Anglaises, etc., etc., je n'aurais jamais fini. Il s'y trouvait, vous le pensez bien, une quantité d'épaulettes de toutes graines. Les civils mêmes, comme disent ces messieurs militaires, s'en étaient chargés autant qu'ils avaient pu, et vraiment ici la garde nationale est sur un tel pied de guerre, qu'on peut lui pardonner l'attirail. Les juifs étaient arrivés les premiers, conduisant leurs femmes au regard humble, couvertes de diamants. Les toilettes européennes ne sentaient point du tout leur province. Alger, malgré les diligences et les chemins de fer, est plus près de Paris que Pontoise ou Chartres. La musique jouait des airs de France, le coup d'œil ne manquait pas de charme.
Le théâtre était bien disposé pour la fête. On avait élevé à la hauteur du premier étage un plancher qui, joignant entre elles les quatre galeries intérieures, formait un vaste plain-pied, où d'élégantes colonnettes de marbre, travaillées et dorées, traçaient le salon de danse, recouvert d'un dôme de pavillons aux couleurs de tous les pays européens : les barres d'Angleterre, les étoiles américaines, l'aigle d'Autriche, la croix des cantons helvétiques, l'aigle de Russie, et même les clefs de Rome, s'unissaient sur les têtes de ces pacifiques danseurs. Des guirlandes vertes reliaient les colonnes de marbre encore surmontées du croissant doré, et venaient, aux quatre angles, se rattacher à des faisceaux tricolores, où les marins, qui sont très entendus en ces sortes de choses et qu'on avait chargés de toute la décoration, s'étaient empressés de mêler de petites gerbes de lauriers-roses, non sans quelque velléité d'allégorie. Les Hadjoutes, il est vrai, gâtent encore la plaine, mais ils ne la gâteront pas toujours. Les galeries restaient libres pour les sièges des dames et la circulation des invités graves ou gros, ce qui, dans un bal, revient au même. Ces personnages, desquels je faisais partie, avaient encore, pour se livrer aux charmes de la causerie et du jeu, deux grands salons qui se trouvent de chaque côté au niveau de la salle de bal, et qui ont conservé presque entièrement leur caractère algérien, c'est-à-dire qu'ils sont revêtus de porcelaines aux couleurs brillantes, de boiseries, de plafonds sculptés et dorés, et que, pour tous meubles, les sofas y abondent. Enfin, contiguë et parallèle à l'un de ces salons, s'ouvrait une large et vaste terrasse, où l'on jouissait en liberté de l'air frais de la nuit, de la limpidité du ciel, du bruit, de la vue et de l'odeur de la mer. Ah ! ceci était beau! Pour plafond la voûte étoilée, et quelles étoiles ! pour lustre la lune, et j'ai fort envie de dire : Quelle lune ! Je ne veux point vous la décrire, faute d'objet de comparaison. Mon cher ami, votre lune d'Europe ne vaut rien, et quel que soit l'ancien goût que j'aie eu pour elle, c'est fini : mon cœur inconstant appartient à la lune d'Alger.
C'était vraiment quelque chose d'original et de charmant à voir, de cette terrasse, que ces trois salons où passaient, dans une douce lumière et dans un bruit harmonieux, toutes sortes d'uniformes, toutes sortes de parures ; des fronts chauves et cicatrisés dans les batailles, des fronts jeunes et chargés de fleurs, d'autres fronts chargés d'énormes turbans.
Je regardais, et j'étais obsédé de souvenirs confus ; je me creusais la tête pour découvrir où j'avais déjà vu quelque chose de semblable. Enfin je trouvai ce que je cherchais, j'ose à peine vous le dire. C'était à Paris, il y a bien longtemps, dans un mélodrame dont je serais fort embarrassé de vous donner le nom ; mais la scène se passe à Venise. Rien n'y manquait, ni la musique, ni les femmes, ni les fleurs, ni les déguisements. Voici Shylock, voici Othello, voici le barigel, voici la terrasse voisine de la mer où les personnages importants se retirent pour conspirer à voix basse au bruit des flûtes et des violons ; rubrique théâtrale d'un effet sûr, à ce que je pense, car elle est souvent employée. Voyons donc : ne se trame-t-il pas ici de mauvais desseins ? La barbe et le turban de ce mufti pourraient voiler de noirs mystères : La Savoie et son duc sont pleins de précipices !...
Je m'amusai tout seul, un bon moment, de cette bouffonnerie, quoique je n'eusse pas lieu d'être très-fier de mon rôle, puisque, dans le drame que je me plaisais à construire, je n'étais qu'un comparse. Mais j'ai assez vécu pour qu'une pareille assimilation ne révolte plus ma vanité. Dans les grandes affaires de ce monde, le comparse est le personnage favorisé du ciel ; seul il n'a rien à craindre du spectateur, il lui importe peu que la pièce soit applaudie ou sifflée; laissant l'aventure à la moitié de son cours, il peut rentrer paisiblement chez lui, longtemps avant qu'on baisse le rideau.
C'était ce que je me disposais à faire, car le bal, que j'aimai naïvement, n'a plus aujourd'hui le grand secret de me faire battre le coeur. Que de folies dont nous guérit le temps, quand nous voulons un peu nous prêter à ses merveilleuses cures ! Je dis le temps, je ne puis croire qu'un plus grand médecin soit nécessaire pour arracher du coeur d'un homme jusqu'au moindre penchant pour la parfaite puérilité de ces jeux du monde. Est-il besoin d'être chrétien pour se dire que dans un moment les bougies seront éteintes, le rideau baissé, que tout ce qu'on pourra voir ne vaut pas une heure d'étude ou de sommeil, et que quitter la comédie avant la fin, c'est la quitter au beau moment ?
Je fus arrêté dans mon mouvement de retraite par un jeune officier, qui me demanda s'il était vrai qu'un fort parti d'Hadjoutes se fût avancé jusqu'auprès de Dely-Ibrahim et eût enlevé des habitants. Ce bruit n'était pas fondé, mais il n'avait rien d'invraisemblable.
"Eh bien ! dis-je à mon questionneur, jeune capitaine fort expérimenté et fort brave, si l'on vous ordonnait de monter tout de suite à cheval ? - Ah ! s'écria-t-il, je le voudrais bien! Je préviendrais ma danseuse, et j'aurais tout d'abord le plaisir de fumer un cigare, ce que je ne puis faire ici. En une heure je serais au milieu de la plaine, dans les herbes, dans les broussailles, dans le pays sauvage.
Plus de dames parées, plus de musique et plus de danse, plus de maison, pas même un abri, pas même un arbre ; mais, filant à pas de loup par les ravins les plus sombres, je surprendrais peut-être l'ennemi. Deux ou trois cents cavaliers, autant de piétons... la bonne aubaine ! Feu sur tout cela ! un bon feu bien nourri, qui en couche par terre, pour commencer, un joli petit peloton. Ils ripostent, mais nous courons dessus à l'arme blanche, principe Bugeaud ; nous pénétrons dans la masse, et à coups de sabre, on en pique, on en coupe, on en tue jusqu'à s'engourdir les bras. Ils crient, ils demandent grâce : point de grâce à ces pouilleux-là ! Les chevaux se cabrent en piétinant sur les blessés et sur les morts, on tue toujours. Enfin ils disparaissent, on ne peut plus les atteindre, nous revenons vainqueurs. Je suis mis à l'ordre de l'armée, j'avance d'un cran, et je demande à recommencer. Voilà, marabout !
Il y a une autre chance, ajoutai-je. - On sait cela, reprit-il. Je suis mortellement blessé, comme l'autre jour Brocqueville ? Alors on sauve ma tète, si on le peut ; on me porte à l'hôpital, j'y meurs, tout est dit."
Il me quitta sur un appel de l'orchestre, et un moment après je le vis valser.
Tout est dit ! pauvres aimables fous ! Mais j'aime encore mieux cela, mon ami, oui, j'aime mieux cette férocité naïve et cette soif d'avancer à travers le sang, en jouant sa vie, que l'adresse de ces filous qui n'ont qu'une brutalité d'esprit impuissante à surmonter la couardise de leur coeur. Il y en a aussi de ceux-là sous l'épaulette, car l'épaulette ne donne pas plus le courage que l'habit d'académicien ne donne le style, et que la soutane ne donne la vertu. Ce sont surtout ces chacals qui sont cruels, et qui, ne parlant que de tuer toujours, excitent la bravoure des autres à faire ce qu'ils ne font pas. Ils s'arrangent, eux, pour ne paraître là où l'on tue qu'après qu'il n'y a plus rien à tuer. Ils sont bien, à mon sens, les plus odieux des hommes, et je ne sais rien dans l'univers qui m'inspire autant d'horreur. Je supporte plus volontiers, je l'avoue, le petit renard civil, qui fait sa route en gants jaunes dans les salons et dans les boudoirs. Celui-là aussi veut avancer, et Dieu sait quels moyens il y emploie; mais du moins il n'est pas carnassier et anthropophage comme ces hyènes en habit décoré.
Voilà ce que c'est qu'un bal en Algérie et les joyeux propos qu'on y tient ; car n'allez pas vous imaginer qu'on parle autrement dans les temps de repos de la contre-danse. Le militaire se présente aux dames comme un être intéressant tout près d'être fauché dans sa fleur, ce qui les attendrit extrêmement pour la plupart. Quand j'étais tout jeune, je voyais jouer beaucoup de vaudevilles ; ce fut du parterre des théâtres que j'appris d'abord à connaître le monde. A la longue, il me sembla que ces peintures, qui m'avaient d'abord plu extrêmement, étaient par trop fades et nigaudes, et ne pouvaient être vraies.
J'ai vu le vrai monde, et je suis revenu sur mon jugement : le vrai monde ressemble infiniment au vaudeville, c'est à s'y méprendre, et j'y bâille, comme j'avais fini par bâiller aux entretiens des acteurs. Vous vous rappelez cette histoire grecque d'un peintre si excellent dans son art, que les oiseaux s'y trompaient et venaient becqueter les fruits imités par son pinceau. Pauvres acteurs, pauvre monde, à quoi perdez-vous le temps ! Encore s'ils s'amusaient ! Mais j'ai vu la coulisse, et, pour un que son rôle divertit ou plutôt enivre, cinquante et cent sont assommés du leur. Ce fard et ces parures trompent à peine quelques enfants ; ils ne déguisent à celui qui les porte ni sa faiblesse, ni ses infirmités, ni sa misère; ce sourire n'endort même pas des angoisses toujours vives, personne ne s'abuse, personne n'espère rompre le triomphe cruel du lendemain. Que fait-on ? Le plus inutile des mensonges : on se ment à soi-même, on cherche le bonheur où l'on sait bien qu'il n'est plus. Mais au fond de cette folie gît une lâcheté sans bornes : on voudrait aimer ces tromperies parce qu'on ne veut pas aimer la vérité. Est-ce que je suis trop sévère ? Je pourrais le croire si j'avais moins longtemps vécu. C'est de bonne foi que je parle.
Ceux qui touchent à la trentième année, et qui vraiment se plaisent aux chimères de la jeunesse, je n'ai pas leur secret. Un homme, lorsqu'il a passé vingt-six ans, connaît la vie et la mort, il est déjà mort une fois ; les souvenirs de son existence première le servent bien mal s'il entreprend de la recommencer. Je ne dis pas qu'il n'a ni esprit ni coeur, je dis qu'une grande lumière a été refusée à son coeur et à son esprit. Est-ce qu'il ne se demande donc jamais ce qui lui reste de tant de Coupes épuisées ? Est-ce qu'il n'a rien vu se faner, mourir et disparaître ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose de sérieux de croire à quelque chose d'éternel ?
|
Mamie réaliste !
Envoyé Par Eliane.
|
|
Elle fête ses 98 ans.
Sa famille a réservé tout un restaurant et la fête bat son plein lorsque l'un de ses petits-enfants, Hervé (50 ans) lui demande :
- Grand-mère, excuse-moi d'aborder le sujet, mais au vu de ton grand âge, il serait peut-être temps de formuler des souhaits quant à tes obsèques.
Les discussions s'arrêtent et tout le monde est suspendu aux lèvres de Lucile:
- "Je veux être incinérée.... "
Ouf ! Lucile a bien pris la question et y a répondu avec intelligence, puis ajoute :
- Je souhaite aussi que mes cendres soient dispersées sur le parking de l'hypermarché.
- Mais mamie, pourquoi le parking de l'hypermarché. Tu ne souhaites pas qu'on conserve tes cendres au funérarium ?
- Non ! Je préfère le parking de l'hypermarché car je suis sûre que vous viendrez me voir au moins une fois par semaine.
|
|
|
Chantiers nords-africains
Trouvé à la BNF 01-1932
|
Les appareils de levage
et de manutention en Algérie
Les importants travaux exécutés, depuis quelques années, pour la mise en valeur des ressources jusqu'à présent inexploitées de notre grande Colonie nord-africaine, ont entraîné la mise en œuvre de moyens d'exécution modernes de plus en plus puissants et perfectionnés.
En particulier, les travaux d'extension des ports et la construction de nouvelles jetées, permettant d'assureur aux navires et paquebots de la Métropole des points d'attache plus nombreux et plus sûrs, ont nécessité, dans beaucoup de cas, l'étude et la construction d'importants engins de levage et de manutention.
Le Titan de France, division des appareils de levage et de manutention des Etablissements Baudet, Donon et Roussel, à Paris, qui s'était déjà signalé par un certain nombre de réalisations intéressantes d'appareils de ce genre, a livré dernièrement, à la Société des Grands Travaux de Marseille, pour la construction d'une, jetée dans le port de Dellys, une grue porte-blocs de 40/16 tonnes dont l'importance est illustrée par le photographie ci-contre.
Cette grue, du type flèche et contre-flèche horizontales, pivotante sur portique roulant, se déplace sur une double voie de 1 m. 055 - correspondant au gabarit des chemins de fer algériens - et progresse sur la jetée au fur et à mesure de son état d'avancement. Les deux voies de roulement sont écartées d'axe en axe de 6 m. 50.
Afin d'assurer une bonne répartition des charges et de réduire au minimum les réactions par galet, la translation se fait sur 32 galets par l'intermédiaire de 4 trucks à 2 boggies chacun, munis eux-mêmes de 4 galets et disposés de telle façon que leur portage soit assuré même malgré des dénivellations importantes de voies.
L'appareil permet, à l'aide d'un chariot porte-poulies à 2 crochets de levage, roulant sur le dessus de la flèche, et de treuils fixes disposés dans une cabine à l'arrière de la contre-flèche, de lever soit des blocs de béton de 40 tonnes à une portée de 25 mètres, soit des caisses basculantes à enrochements de 1'6 tonnes à une portée maximum de 35 mètres.
Les blocs de béton et les caisses à enrochements sont pris à l'arrière sur un chariot porte-blocs ou sur une plate-forme, puis amenés, par une rotation de la grue, à l'emplacement où les matériaux doivent être immergés. Des dispositifs spéciaux permettent le basculage des bennes et le décrochage automatique des blocs après immersion.
Les différents mouvements de la grue sont assurés par des moteurs électriques à courant continu 220 volts, alimentés par l'intermédiaire d'un groupe électrogène de 70 CV, avec moteur Diesel à injection mécanique et démarrage instantané à froid, installé dans la cabine des mécanismes.
Cette cabine, spacieuse et largement vitrée, est disposée à l'arrière de la contre-flèche. Une seconde cabine, disposée dans la flèche, renferme les organes de manœuvre et permet de suivre la charge dans toutes ses positions.
Dans un autre ordre d'idées, pour une application d'un tout autre genre, le Titan de France a fourni, à la Société Algérienne de Produits Chimiques et d'Engrais, Usine de La Sénia, à Oran, un pont roulant électrique à benne preneuse pour la manutention, le stockage et la reprise de phosphates.
Cet appareil, représenté à la photographie ci-contre, est disposé dans un bâtiment métallique d'une longueur de 70 mètres environ, édifié par la division de Constructions Métalliques des Etablissements Baudet, Donon et Roussel.
Ce pont roulant, du type à poutres droites, est prévu pour une puissance de 2.500 kilos, il a une portée de 20 mètres entre axe des chemins de roulement. Il est muni d'un chariot à benne preneuse 4 câbles, d'une capacité de 8 à 900 litres. Les manœuvres d'ouverture et de fermeture de la benne peuvent être réalisées à distance, depuis la cabine de manœuvre ; il est alimenté par un courant triphasé 220 volts 50 périodes.
Il permet de réaliser aisément un débit de 40 tonnes à l'heure soit pour la mise en stock des phosphates, soit pour la reprise au stock et l'expédition par wagons.
Les deux installations décrites ci-dessus n'ont donné lieu, depuis leur mise en service, à aucun incident, malgré les conditions de marche pénibles et le travail intensif aux-quelles elles sont soumises.
R. Vanhoutte
|
|
QUELQUES PAGES D'UN VIEUX CAHIER
Source Gallica
|
Souvenirs du Général Herbillon (1794 - 1866)
Publiés par son petit-fils
CHAPITRE V
Arrivée en Algérie. - Premières impressions. - Promotion au grade de chef de bataillon (7 mars 1838), - Camp de M'Djez-Amar. - Nommé commandant du Cercle de Guelma (novembre 1839).
Deux lettres retrouvées nous donnent les premières impressions du futur vainqueur de Zaatcha :
Oran, le 17 mars 1837.
Mon Ami,
Après une traversée de sept jours qui, à cause du mauvais temps a été assez pénible, nous sommes arrivés en Afrique. Notre débarquement s'est opéré à deux heures d'Oran, sous le fort de Mers-el-Kebir ; de là nous nous sommes rendus en ville en traversant les montagnes qui bordent la mer ; enfin, nous avons atteint notre destination le 27 février à 5 heures du soir.
En recevant l'ordre de nous rendre en Afrique, nous nous attendions à de grandes privations. Nous n'avons pas été trompés. Nos soldats, enfermés dans l'ancienne Kasbah, ont de la paille pour lit et les officiers ont le même avantage ; cette privation d'un bon lit n'est rien pour nous, mais ce qui est pénible, c'est de voir le désordre qui règne dans l'administration, c'est de rencontrer une nuée d'employés qui pillent, volent, regorgent de tout pendant que nous autres, cheville ouvrière de l'armée, nous sommes obligés de nous disputer pour obtenir les vivres qui nous sont dus.
Nous nous attendons à aller au camp d'ici la fin du mois et dans les premiers jours d'avril ; nous présumons qu'on poussera une reconnaissance sur Tlemcen pour ravitailler cette ville dans laquelle un bataillon se trouve enfermé.
Nous ne pouvons pousser nos promenades bien loin, dans la crainte de rencontrer des Bédouins qui probablement nous mettraient dans une position à ne plus rentrer en ville ; aussi ne hasardons-nous pas nos courses hors des limites des blockhaus.
Tout est hors de prix; en arrivant, ayant été forcé d'acheter un cheval, je l'ai payé 500 francs sans le harnachement; c'est une belle bête, race du pays; de plus, comme il n'y a aucun moyen de transport et que tout est à nos frais, je me suis pourvu d'un âne qui m'a coûté 100 francs. Me voilà donc équipé et monté, mais ma bourse est entièrement vide. Pour la remplir un peu, je viens de m'arranger de manière à me contenter de mes vivres ; aussi ma nourriture est à peu de choses près, la même que celle de nos soldats.
D'après ce que je vois et ce que me disent les officiers qui sont ici depuis plusieurs années, je crains que les millions que la France jette dans ce pays n'aient pour tout résultat que d'enrichir quelques spéculateurs qui, sans probité, sans foi, viennent en Afrique pour réparer les torts de la Fortune à leur égard enfin, avec de la philosophie, j'espère me mettre au-dessus de tout ce que je vois et de ce que j'entends.
==========
Camp de Bredhea, 2 juillet 1837.
Mon Ami,
Voici quatre mois que je suis en Afrique et sur ces quatre mois, trois ont été passés en bivouac, changeant de camp à chaque instant. Enfin, on nous promet que le 15 de ce mois, nous rentrerons à Oran. Pour mon compte, j'en suis enchanté.
Nous avons fait, sous les ordres du général Bugeaud, une expédition qui, malgré qu'elle fût de courte durée, fut pénible.
Partis le 17 mai du camp que nous occupons aujourd'hui à 8 lieues d'Oran, avec un convoi très considérable, nous avons ravitaillé Tlemcen et progressé jusqu'à l'embouchure de la Tafna où la paix fut faite avec Abd-el-Kader, le chef arabe le plus influent du pays. Nous revînmes ensuite en côtoyant la mer et depuis le 7 juin, époque du retour de l'expédition, nous campions à 12 lieues d'Oran.
On vient de nous rapprocher de la ville, puisque le camp de Brédhéa n'en est qu'à 8 lieues. Nous avons bien souffert de la chaleur, surtout les 5 et 6 juin, où le thermomètre marquait 45°. Nos hommes, épuisés et suffoqués, tombaient haletants ; rien ne pouvait leur faire faire un pas de plus.
La journée du 5 a été particulièrement cruelle, mais tout cependant alla pour le mieux, puisque le soir nous avons eu le bonheur de réunir tout notre monde.
La marche de la troupe étant réglée de manière à s'arrêter près des ruisseaux, nous marchions quelquefois des journées entières sans trouver l'objet de notre désir. Aussi à peine était-on arrivé à l'endroit où on devait bivouaquer que les soldats, les chevaux, les chameaux, etc... se précipitaient dans le ruisseau qui n'était bientôt plus qu'un bourbier et parfois on ne rencontrait plus que de l'eau saumâtre...
A la suite de l'expédition, le général en chef Bugeaud a fait des mémoires de proposition et il vient de me proposer pour le grade de chef de bataillon... Je n'aurai rien à, me reprocher ; mes services, mes campagnes, ma conduite sont des titres à l'avancement. Si je ne réussis pas, je patienterai encore cinq ans, époque où je me retirerai et là, libre de mes actions, je me consolerai de l'injustice des hommes...
Le maréchal Bugeaud lui tint parole et fit donner, le 7 mars 1838, le brevet de chef de bataillon à celui dont il disait :
Voilà un officier véritablement distingué, instructeur remarquable, rôle, activité, dévouement, il a tout ce qu'il faut pour faire un excellent chef de bataillon et plus tard un chef de corps ( Rapport du général Bugeaud.)
La satisfaction du nouveau commandant se traduit dans une lettre à son frère, le 2 avril 1838, dont on peut extraire ces lignes :
Je pars demain 3 avril par le bateau à vapeur pour me rendre à mon nouveau régiment (2e régiment de ligne) qui est divisé par le détachement de Bône à Constantine. Me voici encore une fois avec de nouvelles figures et de nouveaux chefs...
Enfin, le pas le plus difficile est fait et il ne me reste plus qu'à aller ; l'Afrique a cela d'avantageux qu'avec la santé on est presque forcé de faire son chemin.
Le vieux registre devient plus prolixe et les notes sont plus complètes et rédigées avec un soin minutieux. On sent que le cœur y est et que la nouvelle tâche passionne le conteur.
J'arrivai à Bône le 14 avril 1838 et comme mon bataillon se trouvait à M'Djez-Amar (1), je prenais toutes mes dispositions pour me rendre à mon poste, lorsque le 24, le colonel Roux, qui commandait la subdivision, apprit par un rapport que M. le lieutenant-colonel Dorlhac du 12e de ligne, qui s'était dirigé chez les Bene-Oudjessa, avait été forcé de revenir à marches forcées après une perte d'un officier et plusieurs soldats tués et quelques blessés.
(1) Le camp de M'Djez-Amar, établi sur la Seybouse, formait tête de pont sur la route de Bône à Constantine.
A cette nouvelle, le colonel me donna l'ordre de me rendre immédiatement à M'Djez-Amar pour y prendre le commandement. Je partis le 27 et le 29 j'arrivai dans ce camp. Le lendemain, le lieutenant-colonel me remit le commandement.
A mon arrivée, je pris connaissance du pays, des troupes et je m'occupai de suite de mettre de l'ordre (il y avait désordre complet, au point que les sous-officiers et les soldats mangeaient à volonté) et surtout de relever le moral des officiers et de la troupe qui, par suite de l'échec reçu, n'avaient aucune confiance dans leurs chefs.
Les tribus kabyles et arabes qui entouraient le camp furent particulièrement le sujet de mon attention et de ma surveillance. Je me mis en relation avec tous les chefs ; je travaillai avec eux et je pris intérêt à tout ce qui pouvait les flatter. En très peu de temps, je gagnai leur confiance et je me mis parfaitement au fait du pays que je parcourus en tous sens, c'est-à-dire partout où l'on pouvait aller, car à cette époque la soumission était peu étendue. Continuellement, les courriers, les convois étaient attaqués et les voyageurs isolés assassinés.
C'est au mois de juillet 1838 que dans la province de Constantine on fit l'essai de lever les impôts. Ce fut M. le commandant de Mirbeck des spahis de Bône qui fut chargé de cette mission par M. le maréchal Valée.
Cet officier supérieur arriva à M'Djez-Amar le 13 juillet et de concert avec lui, nous réunissions le caïd Bou-Mourad, le caïd Ben-Said et tous les cheiks. L'impôt fut fixé, mais très modérément pour habituer petit à petit les Arabes à être tributaires de la France.
C'est à cette époque que s'éleva le différend entre les tribus arabes et kabyles, qui ne fut terminé qu'en 1840. Il provenait de ce que les Kabyles, s'étant emparés du territoire arabe, refusaient d'être soumis à un caïd arabe et ne voulaient dépendre que d'un caïd kabyle.
Le maréchal Valée était à ce moment gouverneur général de l'Algérie et le général de Négrier commandait la subdivision de Constantine.
M. le général de Négrier était d'une très grande sévérité envers les Arabes. Homme impartial, juste, d'une probité à toute épreuve, cet officier général s'était attiré l'estime et l'amitié des indigènes qui le respectaient et le craignaient. Mais le maréchal Valée lui était opposé, il ne l'aimait pas.
Il n'était nullement question de son changement lorsque le général de Galbois en débarquant de Bône, me fit donner l'ordre d'arrêter le courrier à son passage à M'Djez-Amar. (Ce courrier portait l'ordre à M. le général de Négrier de remettre à M. le général de Galbois le commandement de la province.) Comprenant combien il serait pénible au général de Négrier de ne recevoir son ordre de remplacement que par son successeur, sous le prétexte que je n'avais pas compris, je laissai partir le courrier et le brave général eut le temps de faire ses préparatifs de départ. D'un autre côté, M. le général de Galbois, en arrivant à Constantine, y trouva très bon accueil. (Il fut très content de la non-exécution de son ordre qui l'aurait mis dans une situation délicate vis-à-vis du général de Négrier.)
Le général de Galbois arriva au camp le 27 juillet et le général de Négrier y passa le 3 août.
M. le maréchal Valée allant à Constantine, s'arrêta à M'Djez-Amar la journée du 20 septembre. C'est d'une conversation que j'eus avec lui que date la confiance qu'il me témoigna.
Voici les faits :
Le caïd Bou-M'Zad étant insatiable de pouvoir, ne pouvait endurer que les Kabyles qui s'étaient emparés du pays de Guerfa (25 kilomètres sud du camp de M'Djez-Amar.) ne fussent pas sous ses ordres. De là, querelles continuelles avec les cheiks kabyles qui lui refusaient obéissance. Le caïd avait demandé audience au maréchal qui, ne connaissant pas les traditions du pays, ni les localités, ne pouvait donner solution aux réclamations qui lui étaient soumises. Il me fit appeler. Je lui donnai clairement l'explication des prétentions de Bou-M'Zad, en lui signalant que les Kabyles s'étant emparés par les armes de tout le pays de Guerfa ne pouvaient être soumis qu'à un des leurs, sans quoi il n'y aurait aucune tranquillité dans le district de M'Djez-Amar.
Le maréchal me laissa juge dans cette affaire délicate et, en sortant de ma tente, ayant rencontré le colonel Vaillant du génie, qui l'accompagnait dans son voyage, il lui dit : "Colonel, connaissez-vous ce chef de bataillon ? c'est un officier supérieur que je laisserai en Afrique. "
A son retour de Constantine, le 26 octobre, il me dit qu'il m'avait placé au commandement de La Calle. Mais ce fut à Guelma que je fus envoyé.
Le 30 septembre, le 2e bataillon du 12e de ligne avait quitté M'Djez-Amar pour rentrer à Bône. L'importance de ce point fortifié avait en effet perdu toute raison d'être depuis la chute de Constantine, le 13 octobre 1837. M'Djez-Amar avait servi de place de dépôt, de station tête d'étapes, en quelque sorte, à cause de sa situation sur la route directe de Bône à Constantine. Mais c'était Guelma qui devait en réalité retenir l'attention des organisateurs de la province.
Le 15 novembre, je quittai à mon tour le camp, emmenant avec moi l'autre bataillon. Tous les hommes, officiers et soldats, avaient la fièvre et ne pouvaient faire la route pour cause de faiblesse; je fus donc forcé de prendre pour les transporter les voitures du génie, de l'artillerie qui se trouvaient en ce moment au camp. Ce fut avec peine que j'arrivai le 16 à Dréan où je reçus l'ordre de rester.
Pendant les sept mois que j'avais commandé à M'Djez-Amar, presque tous les soirs, des coups de fusil étaient tirés sur le camp. Les nombreux convois qui y passaient pour ravitailler Constantine étaient très souvent attaqués. Les fièvres sévissaient sans relâche. La mortalité était grande et ce qui était le plus inquiétant, c'était le découragement qui existait souvent dans les corps composant la garnison.
Ce fut mon début dans le commandement d'un poste difficile et dans les affaires arabes. Je me livrai entièrement à l'étude des mœurs, des coutumes et de la langue indigène. Je me familiarisai avec les questions litigieuses et en quittant le camp, je regrettais déjà cette vie d'émotion que je n'avais encore qu'effleurée. C'est pendant mon séjour à, M'Djez-Amar que des constructions furent faites pour caserner les troupes. Elles furent plus tard remises à M. l'abbé Landmann pour la création d'orphelinats.
Je partis le 16 décembre pour aller prendre le commandement de Guelma. Pendant mon séjour à Dréan, je n'eus qu'à visiter les environs ; je fis le voyage de Bône où je pris congé de mon régiment, qui déjà s'attendait à rentrer en France.
M. le colonel Roux aurait désiré me conserver, mais mon parti était irrévocablement pris : rester en Afrique, y faire mon chemin... ou succomber.
A SUIVRE
|
|
| PHOTOS de BÔNE
Envoyé par M. J.L. Ventura
|
Abattage des Arbres rue Sadi Carnot
Devant le Toit Collectif Bônois

|
|
Récit de Denoix de Saint Marc
Envoyée par Mme Annie Bouier.
|
Mère, voici vos fils et leur immense armée.
Qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère.
Que Dieu, mette avec eux un peu de cette terre
Qui les a tant perdus, et qu'ils ont tant aimée.
Tu as raison, c’est drôle un nom de famille.
Parfois ça ne veut rien dire mais ça dit tellement de choses sur celui qui le porte.
Un patronyme on le reçoit à la naissance, on le transmet un peu plus tard, on en est pas vraiment propriétaire.
Du coup, c’est précieux, ça s’entretient ; c’est la dernière richesse de celui qui n’a rien, et tant qu’on a un nom, on est encore, quelqu’un.
Chez nous tu vois on en évoquait plein des noms tout le temps : Nom de scènes, de plume, d’emprunt, des noms à coucher dehors, de jolis noms qui rappelaient des comptoirs et des rivages lointains.
Bon faut dire qu’à la maison, y avait des noms qu’on n’avait pas le droit de prononcer en vain ; et bizarrement, qu’on prononçait souvent, en vain.
Et parmi tous ces patronymes l’un d’entre eux m’étonnait par sa sonorité, c’était un nom étrange et à rallonge, qui ne m’était pas familier, il ne ressemblait pas à ceux qu’on entendait.
Et pourtant sa seule évocation, suggérait qu’il recelait des Denoix de Saint Marc ! Un drôle de nom celui d’un chevalier d’un corsaire ou d’un aventurier.
Quand on est grand on le sait, Denoix de Saint Marc, c’est un nom de Ministre ou de commission, un nom qui fleure bon l’administration.
Bref ! Denoix de Saint Marc c’est un nom de gens sérieux un nom de gens bien …
Un nom, pour lequel on fait des éloges, pas des procès. A la rentrée solennelle du Barreau de Paris, le Premier Secrétaire fait l’éloge d’un Confrère, le Deuxième Secrétaire doit faire le réciter d’un procès.
Et pourtant !! Ministère Public contre Denoix de Saint Marc,
Ce procès là j’le connais par cœur, je le connais si bien que j’en ai presque des souvenirs,
Ecoute, écoute le grésillement des transistors.
« Non rien de rien, … »
21 avril 1961, depuis quelques mois on diffuse cette chanson ; Edith Piaf l’a dédiée aux légionnaires engagés en Algérie depuis 7 ans déjà.
Dans les maisons bourgeoises, on entend des airs de swing et de jazz qui se mêlent aux chants traditionnels arabo-andalous que crachent les gargotes alentours.
Soudain, la musique s’arrête et la radio éructe un message incompréhensible.
« Le 1er REP quadrille Alger avec à sa tête le Commandant Hélie Denoix de Saint Marc, le Général de Gaulle ! déclare l’état d’urgence ! ». Le reste des noms et des informations se perd au milieu des ondes.
A Bordeaux un ancien résistant se souvient d’un jeune camarade idéaliste.
A Rennes, et à Paris des anciens déportés revivent avec émotion une nuit de décembre 1943.
Un jeune partisan vietnamien réchappé miraculeusement de l’enfer des vietminh lui ! pense à ce commandant rencontré dans les vallées du Tonkin.
Ce 21 avril 61, le Général Challe arrivé clandestinement à Alger avait convoqué Hélie Denoix de Saint-Marc pour lui révéler son plan, et lui proposer de prendre part à un coup d’Etat.
« Notre action n’a rien de fasciste ou d’antidémocratique, nous souhaitons contraindre De Gaulle à revoir sa position et à négocier. »
Denoix de Saint-Marc a 39 ans, l’acte est grave quelles qu’en soient les raisons, il le sait bien. Pourtant en moins d’une heure son choix est fait, il prendra part au putsch. Ce soir-là il réunit ses hommes et leur dévoile le plan, pas un ne refuse.
Ni dans les marches ni dans le danger, ni même dans les défilés, personne ne sépare la légion.
En une nuit le 1er REP s’est emparé des places fortes, l’aéroport, l’hôtel de ville, la radio.
Challe prend la parole « Je suis à Alger pour tenir notre serment, celui de garder l’Algérie. L’armée ne faillira pas à sa mission et les ordres que je vous donnerai n’auront jamais d’autres buts. »
En réalité, De Gaulle à Paris est serein, il sait tout du complot, il sait que Challe n’a pas d’appui et que le projet est voué à l’échec. Il laisse faire, le coup est un prétexte idéal pour s’arroger les pleins pouvoirs, et déclarer l’Etat d’urgence.
Le lendemain il prononcera pour la forme une allocution évoquant à tort « un quarteron » et non un quatuor « de généraux en retraite ».
Retiens, le pouvoir, c’est d’abord une parole, une voix.
Le coup est un échec, les putschistes sont lâchés ; les soldats doivent déposer les armes et rentrent dans leur caserne. Ils sont immédiatement mis aux arrêts, et transférés au fort de Nogent.
Le soir les gardiens les entendent chanter à tue-tête cette chanson de la môme dont ils ont amendé quelques strophes.
Ni le bien qu’on m’a fait, ni la prise du corps d’Armée d’Alger.
Sous le feu, quand un camarade tombe, en marchant, et même au fond d’une geôle, à la légion ! On chante !
L’officier lui, est loin de ses hommes.
5 juin 1961 Imagine, Paris, l’île de la cité,
Imagine, une salle comble, on est venu de partout pour voir l’homme que le Roi veut déshonorer.
Le procès passionne autant qu’il divise et la beauté du lieu elle, tranche avec l’ambiance de la salle.
Les hautes fenêtres laissent passer la lumière d’un bel après-midi ; au plafond, une toile de Bonnat, la Justice pourchassant le crime.
La grande salle d'audience de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Paris est un choix qui ne doit rien au hasard.
L’endroit est si beau et si solennel qu’aujourd’hui encore Magistrats, avocats et greffiers y prêtent serment.
Cette salle c’est un symbole, 15 ans plus tôt on y avait condamné Laval et Pétain.
C’est ici qu’on juge les traitres.
Depuis un mois on s’affaire, en 30 jours à peine, tout a été refait pour l’occasion.
Là des spots de lumières au cas où les audiences viennent à s’éterniser, ici des micros pour les témoins.
Pas de place pour le doute, tout le monde doit comprendre de quel côté se trouve la justice.
Transféré depuis la prison de la santé dans un camion grillagé, Hélie Denoix de Saint Marc est entravé, et pourtant les quelques escortes qui le croisent se mettent machinalement au garde à vous.
Ses grands yeux bleus scrutent la salle, il n’a pas peur
A la Légion on ne baisse jamais la tête ni devant la mort, ni devant Dieu.
Fils d’avocat, il le sait bien, la justice a quelque chose de théâtral : il faut humilier l’accusé, le contraindre à la pénitence.
Mais l’officier refuse la mise en scène imposée
Béret vert, uniforme d’apparat, et décorations sur la poitrine, pas question de perdre la face dans cette passe d’arme, dans ce duel entre l’épée et les robes.
Tant pis pour le résultat.
A côté du décorum, le verdict non plus n’est pas négligé.
Tout a été pensé, réfléchi pour aboutir à une condamnation exemplaire.
L’institution d’abord, au lendemain de la reddition De Gaulle commande un « Haut Tribunal militaire » sorte de juridiction ad hoc pour juger les félons.
Pas de recours possible, le Haut Tribunal militaire juge en dernier ressort.
Retiens ! La justice politique ne se déjuge jamais, elle ne supporte pas la contradiction. Seul espoir envisageable, une grâce absurde présentée à celui-là même qui avait créé cette institution.
En un mois à peine l’instruction, le déféré, l’acte d’accusation, tout est bouclé sur ordre, les rares interventions des juges ne sont que de pure forme.
Retiens dans les procès politique c’est le Prince qui juge pas la justice.
Le Tribunal aussi est composé sur ordre,
Maurice Patin qui officie habituellement à la Chambre criminelle de la Cour de cassation est choisi pour présider les débats, il est flanqué d’éminents juristes des Présidents de Cour d’appel, et de militaires de haut rang.
Quelques jours plus tôt on avait déjà jugé Challe et Zeller les architectes du putsch.
Le cas Denoix de Saint Marc lui, est différent, il n’a pas le profil convenu du réprouvé ; il n’est ni un idéologue ni un factieux.
Le Président Patin pose quelques questions pour la forme parce qu’il faut bien faire semblant toujours le même rituel:
- Nom : Denoix de Saint Marc
- Prénom : Marie Joseph Hélie
- Avez-vous déjà été condamné ?
- Oui par les Allemands.
Patin est furieux, cette marque d’arrogance, n’annonce rien de bon. Il reste pourtant impassible pas question d’engager un débat sur la légitimité des causes que chacun défend. Il faut absolument éviter que le putsch ait son martyr ou son héros.
C’était pourtant juste, issu d’une vieille famille du Périgord, Hélie Denoix de Saint Marc n’a que 18 ans lorsqu’indigné par la défaite, il entre en résistance.
Ici même dans cette salle nombre d’anciens camarades de toutes tendances politiques confondues sont venus témoigner pour dire qui ! est Hélie Denoix de Saint Marc. Les témoignages s’enchainent chacun raconte ce qu’il sait de l’accusé. Par petite touche, un portait, se dessine.
Monsieur le Président nous avons rencontré Hélie Denoix de Saint Marc une nuit de juillet 43. Alors que nous tentions de rejoindre la France libre nous avons été dénoncés par notre passeur arrêtés, livrés à Gestapo puis déportés dans des wagons plombés, envoyés au camp Buchenwald et affectés dans un camp de travail.
Buchenwald, une longue valse avec la mort.
Dans cet enfer, on perd son nom, on n’est plus personne Hélie Denoix de Saint Marc lui, a disparu : Il n’est plus que le Matricule 20543.
Enfin, lorsque ce 11 avril 45, les américains libèrent le camp, ils découvrent des cadavres entassés dans des fausses communes à peine recouverts par la terre.
Et pourtant, du bout du camp émanent des râles d’agonie.
Les libérateurs aperçoivent les corps décharnés de ces vivants en sursis. Saint Marc est de ceux-là, gisant inconscient parmi les mourants dans cette baraque putride.
23 ans, 42 kg, rongé par la dysenterie, il a perdu la mémoire et oublié jusqu’à son nom.
30 survivants sur un convoi de 1 000 déportés ; renvoyé chez lui, il n’en parlera plus.
Et comme pour conjurer le sort il intègre l’école des officiers de St Cyr, et choisit de commander des régiments de la légion étrangère dont le gros des troupes est composé d’anciens de la Wehrmacht de la SS.
Pas le temps pour la rancœur ou la haine. La légion est une patrie, où l’on pardonne presque tout !
«Monsieur le Président ! Notre génération n’a pas connu de valeur fixe nous avons appris à nous fier à notre conscience seule ; cela avait conduit notre camarade en déportation en 43, cela le conduit aujourd’hui à la prison de la Santé. ».
A la barre on évoque également l’Indochine et ses traumatismes, des mois à sillonner un pays, à former des partisans contre les Vietminh à se battre et à mourir avec eux.
Et puis un jour fin de mission. Ordre d’évacuer la zone.
« Jamais, jamais nous n’oublierons l’incompréhension et la peur sur les visages des villageois à l’annonce de notre départ. Le cauchemar des coups de crosse sur les doigts des irréductibles incrédules s’accrochant aux rebords des camions français.
Des coups de crosses sur les doigts de nos frères d’armes, finissant par lâcher pour s’écraser dans la poussière ».
« C’était les ordres ! ».
Pour le Général Ingold membre du jury, chancelier de l’ordre de la Libération, déporté-résistant et Gaulliste de la première heure cette histoire a quelque chose de familier.
Sollicité quelques jours plus tôt par des proches de Saint Marc, Ingold avait accepté d’intercéder en sa faveur à condition qu’il fasse pénitence et présente ses regrets.
L’accusé avait remercié ses amis mais catégoriquement refusé.
« Je ne regrette rien, j’ai agi en conscience, et je le dirai à l’audience ».
Dans son coin, l’Avocat Général reste silencieux, il note méthodiquement ce qui est dit en attendant son heure.
Jean Reliquet n’a pas été choisi au hasard ;
Ancien procureur général à Alger, il a parfaitement en tête, les enjeux historiques liés à ce procès.
L’Algérie. Une terre meurtrie, une terre qui mange ses enfants.
Des attentats, dans les cinémas, aux terrasses de cafés, dans les salles de concert,
On tue pour trois lettres,
M.N.A.,
F.L.N.,
O.A.S.
On tue pour venger Guelma, on tue pour venger Sétif, on tue pour la Nation, on tue pour être libre sur sa terre.
On tue au nom du tout puissant du miséricordieux ; on guillotine, aussi, au nom de la France.
Imagine une guerre où l’ennemi est sans uniforme agissant parfois sous le masque d’un vieillard, d’une jeune fille ou d’un enfant.
La grande muette veut faire parler, elle torture.
Pour Reliquet, cette pratique est indigne de la République, il alerte ses supérieurs, interpelle sa hiérarchie.
Aucune réaction, l’homme est seul avec ses convictions, les impératifs sécuritaires l’avaient emportée sur ceux de la justice.
L’épée l’avait emporté sur la robe.
Retiens bien ! L’histoire finit toujours par condamner les peuples, qui sacrifient leur droit pour leur sécurité.
Appelé pour rétablir l’ordre et la souveraineté nationale De Gaulle avait fait volteface, pour lui l’égalité risquait d’entrainer un exode massif des algériens en métropole.
« La France est un pays de clocher, hors de question de rebaptiser Colombey ».
Seule solution rationnelle : l’indépendance.
La métropole le soutiendra, elle a les yeux rivés vers l’Amérique et la consommation elle se désespère de voir sa jeunesse périr dans une guerre qui ne dit pas son nom
L’Armée ne comprend pas.
Depuis sa cellule, l’accusé lui, a préparé une déclaration
«Monsieur le Président Ce que j’ai à dire sera simple et court. Depuis mon âge d’homme, j’ai vécu pas mal d’épreuves : Résistance, Gestapo, Buchenwald, l’Indochine, Suez et l’Algérie.
Saint Marc explique comment on en arrive là, comment on passe d’officier exemplaire à celui de soldat perdu.
Un jour, on nous a dit qu’il fallait envisager l’abandon de l’Algérie. L’angoisse a fait place au désespoir et nous avons pleuré en nous souvenant de l’évacuation de la Haute-Région, Diên Biên Phû, l’entrée du Vietminh à Hanoï, des villages abandonnés et des habitants massacrés.
Nous pensions à toutes ces promesses solennelles faites sur cette terre d’Afrique, à tous ceux qui avaient choisi la France à cause de nous et qui, à cause de nous, risquaient une mort affreuse.
Nous pensions à notre honneur perdu.
On peut demander beaucoup à un soldat, en particulier de mourir, c’est son métier, pas de se dédire, de tricher ou de se parjurer. Oh ! je sais, Monsieur le président, il y a l’obéissance, il y a la discipline.
Depuis quinze ans, je suis Officier de Légion. j’ai vu mourir pour la France des légionnaires, étrangers peut-être par le sang reçu, mais français par le sang versé. « C’est en pensant à mes camarades, à mes sous-officiers, à mes légionnaires tombés au champ d’honneur, que le 21 avril, j’ai fait mon libre choix.
Terminé, Monsieur le président. »
Patin reste impassible pas question d’accorder à cet instant une quelconque solennité
Ironie de la scène la justice est aux ordres, le militaire lui, est libre.
Les consignes sont presque dictées pas d’acquittement.
L’Avocat Général Reliquet, l’homme qui s’est opposé à la torture et dressé contre l’armée tient peut-être sa revanche.
Depuis des jours il est encouragé par sa hiérarchie, et par les plus hautes personnalités pour requérir une peine exemplaire.
Dans cette pièce commandée par De Gaulle il joue le dernier acte.
Messmer alors Garde des sceaux le convoque ; lui parle des intérêts de la Nation et du danger que représentent les fanatiques.
Retiens ! On invoque toujours les intérêts de la nation pour insulter la justice
On lui enjoint de requérir une peine de 20 ans
20 ans pour punir, pour venger un affront
20 ans pour effacer une cause et un nom
Problème : Reliquet, croit au droit pour tous et en tout temps, en Algérie contre le FLN et les communistes, en métropole contre les putschistes, il pense que Code pénal est suffisant et qu’on n’a pas besoin de loi d’exception pour satisfaire les puissants ou l’opinion publique.
La peine envisagée contre Denoix de Saint Marc n’est ni juste ni adaptée.
Puisque Reliquet s’entête Michelet Ministre des armées et Messmer lui ordonnent par courrier de requérir la peine évoquée. Pas d’objection possible les ordres sont les ordres et il faut obéir.
Tant pis, l’Avocat Général se lève prend un bloc de feuille et s’approche du Président.
« Article 33 du Code de procédure pénale le Ministère Public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données,
Voici mes conclusions. »
Posant le tas de feuille sous le nez du Président, il poursuit immédiatement
« Elles sont fidèles aux consignes qui m’ont été données vous y trouverez la peine exigée…
J’entends pourtant, au terme du même article conserver ma liberté de parole… et requérir autrement.
La plume est serve certes, mais la parole est libre »
L’instant est rare et surprenant on n’a presque jamais vu ça. Les murmures de réprobation dans la salle laissent à présent place à un brouhaha.
« Silence ! Silence dans la salle ! »
Patin réprouve manifestement la démarche de Reliquet qui enchaine : « La faute si lourde soit elle, ne saurait effacer 20 ans d’héroïsme ».
Il faut une peine juste et adaptée, juste et adaptée.
« 4 à 8 ans de réclusion criminelle ».
Et Reliquet de conclure « beaucoup plus que cette peine l’abandon du métier des armes sera une sanction bien plus terrible pour ce soldat héroïque ».
A ce moment précis l’espoir est permis, Reliquet semble avoir entrouvert la porte et la défense tient quelque chose.
Le mot acquittement se murmure dans la salle.
L’instant est incroyable !!
Au tour de la Défense de prendre la parole, les chances sont minces, mais il faut s’engager dans chaque interstices tout exploiter, ne rien laisser au camp d’en face.
Cette plaidoirie je la connais par cœur !
La procédure d’abord ! Un Tribunal spécial, c’est une marque de défiance envers le peuple.
L’accusé comparait devant un Tribunal fantoche créé par l’article 16 spécialement pour punir et jeter l’anathème.
Quelle différence avec Riom, ou les sections spéciales ?
Par sa forme et par son but il est discrédité.
De plus comment considérer ce jury comme impartial et ce procès comme équitable alors qu’on a déjà condamné Challe et Zeller quelques jours plus tôt pour les mêmes faits.
Les faits ! La Vème République est un coup d’Etat née d’un coup d’Etat ; le pouvoir a sciemment laissé faire pour asseoir une légitimité qui lui faisait défaut et engager des réformes institutionnelles.
Le putsch avorté a été instrumentalisé pour servir les intérêts du pouvoir en place.
Les faits encore ! l’homme a agi par fidélité à un serment, redoutant nous dit-il un massacre à venir.
L’histoire dira comment, la France aura traité les pieds noirs et les harkis.
Un mot pour les juges enfin, leur rappeler que 20 ans plus tôt ces militaires, avaient eux-mêmes désobéis.
Un mot pour l’homme peut être aussi enfin, la vie d’Hélie Denoix de Saint Marc est une tragicomédie qui veut qu’au gré des caprices des puissants, on porte pour les mêmes faits, tantôt un uniforme d’officier et tantôt celui d’un bagnard.
Mais rien de tout cela n’a été dit.
Cette plaidoirie c’est la mienne.
On avait laissé à l’accusé deux jours seulement pour choisir son conseil, deux jours pas plus.
Jacques Martin-Sané un fidèle du Maréchal s’était proposé spontanément ; les proches de Saint Marc l’avaient pourtant mis en garde sur le profil de son avocat.
Qu’importe, il avait donné sa parole d’officier.
Me Martin-Sané n’a pas saisi la main tendue par le parquet, et s’est contenté d’une plaidoirie grandiloquente et un peu surannée pour réclamer l’absolution.
Peut-être n’avait-il pas vraiment compris qui, était Hélie Denoix de Saint Marc.
Oui je sais le soleil se couche, mais écoute encore un peu
Imagine la Cour des Invalides, des hommes en Képi blanc au garde à vous, réunis autour d’un vieil homme.
Cassée par les rhumatismes la silhouette a perdu de sa superbe, mais le regard lui, est resté le même.
Ses grands yeux bleus, scrutent l’horizon.
Déporté à 20 ans, dégradé, et emprisonné à 40, Hélie Denoix de Saint Marc a été successivement gracié, amnistié, puis réintégré dans son grade de commandant.
Non par décision de justice, mais par décrets successifs ; des caprices de Prince.
Aujourd’hui, 28 novembre 2011, il est fait Grand-croix de la légion d’honneur. « À titre militaire et au titre de l'Algérie ».
Soudain tout le monde se fige.
Aux morts !
A quoi pense-t-il ?
Quelques vers de Péguy que je t’ai récité sur les fils et sur la terre,
Une peine de 10 ans prononcée à la hâte ce 5 juin 1961,
A tous ces hommes morts pour la France, par la France
Ministère Public contre Denoix de Saint Marc, c’est l’histoire d’un procès qui n’aura duré qu’une après-midi et le procès d’une histoire, une histoire d’homme aussi.
Tu as raison c’est drôle un patronyme mais ça dit tellement de choses sur celui qui le porte.
Je ne comprenais pas vraiment pourquoi mon père me contait ce récit, peut-être qu’avocat lui-même, il me donnait tout simplement une leçon d’homme et de justice.
Peut-être aussi, parce que là-bas dans un vieux cimetière près de Constantine notre nom, est encore inscrit sur quelques pierres tombales laissées à l’abandon.
Un nom enraciné dans une terre qu’il n’a jamais revue que je ne connais pas et dont je me souviens.
Ce que je sais en revanche c’est que cette histoire tu la raconteras à ton tour, en lui donnant le sens que tu voudras.
Il est tard, maintenant, dors mon fils.
|
|
| HALTE AU FEU !
Envoyé Par Hugues Jolivet
|
En mars soixante deux, un ordre, cri de détresse,
Couvert par la mitraille des armes automatiques
Fauchant des Algérois. Situations critiques
Des Pieds Noirs spoliés par leur Nation traîtresse !
Halte au feu, désormais ! Les assauts de la Presse
Reprennent en écho les jugements iniques
Des plus hauts dirigeants de notre République :
"Repentance, crimes de guerre d'une France pécheresse".
Les victimes sont coupables ! Ont elles signé leurs torts
En choisissant l'exil vers la Mère Patrie ?
Leur seule alternative est valise ou cercueil !
Ils ont quitté leur sol, abandonné leurs morts !
Malgré leurs coeurs meurtris, reçus avec mépris,
Par des Maires réticents, peu enclins à l'accueil !
Hugues JOLIVET
3 mars 2018
|
|
|
Et revoilà « La torture en Algérie » !…
Par M.José CASTANO,
|
« Les moralistes ressemblent aux chimistes. Ils préparent des remèdes pour les autres, et s’en servent rarement. » (Pigault-Lebrun – « L’homme à projets »)
Dans le premier tome de ses Mémoires (éditions Muller) récemment paru, Jean-Marie Le Pen évoque, de nouveau, la pratique de la torture durant la guerre d’Algérie. Il a fallu pas plus à certains journalistes, emmitouflés dans leur bure de moralistes, de s’intéresser soudainement à « la question », dans l’attente de la petite phrase scandaleuse bien juteuse qui les propulserait aux nues de la gloire médiatique.
Sur cette torture pratiquée – on l’oublie trop souvent- dans le but exclusif d’obtenir des renseignements permettant la mise hors d’état de nuire de dangereux criminels ou visant à neutraliser des bombes prêtes à exploser, JMLP s’explique :
« L'armée française revenait d'Indochine. Là-bas, elle avait vu des violences horribles qui passent l'imagination et font paraître l'arrachage d'un ongle pour presque humain. (…) Cette horreur, notre mission était d'y mettre fin. Alors, oui, l'armée française a bien pratiqué « la question » pour obtenir des informations durant la bataille d'Alger, mais les moyens qu'elle y employa furent les moins violents possibles. Y figuraient les coups, la gégène et la baignoire, mais nulle mutilation, rien qui touche à l'intégrité physique.»
Le 26 février, Interrogé au micro de RTL sur son éventuelle participation à la torture si on le lui avait ordonné, il répondait :
« Sans doute. J'aurais fait mon devoir, préférant la vie d'une petite fille innocente à celle d'un tueur qui pose la bombe. Les consignes qui étaient données étaient d'éradiquer à n'importe quel prix la menace terrible que faisait peser le terrorisme, qui a fait des centaines de morts, de blessés et de mutilés, dont personne ne parle. Et c'était justement à la recherche de ces réseaux de bombes qu'un certain nombre de procédés ont été utilisés, beaucoup plus humains que de déchiqueter les jambes d'une petite fille. »
Il n’en fallut pas plus pour que cette justification de la torture entraînât la réaction d’un journaliste : « Comme à son habitude, le président d’honneur du Front national s’est fait remarquer par des propos particulièrement polémiques. »
En quoi ces propos sont-ils « polémiques » ?...
Dans « Mille et une pensées », Philippe Bouvard écrivait : « Le propre du moraliste est de tenir pour immorales les saletés qu’il a toujours rêvé de faire »…
Dans cette guerre sale, bestiale, cruelle et écœurante, l’ennemi (FLN) n’était pas franc et ne s’embarrassait pas de scrupules… Il était partout à la fois et on ne le voyait nulle part. Ce n’était pas un adversaire loyal, ne s’attaquant qu’aux militaires ou à leur matériel ; tout au contraire, ces terroristes étaient des criminels de droit commun, des gangsters de l’espèce la plus ignoble, et leur gang avait ses ramifications secrètes dans toutes les classes de la société française. Il fallait donc agir rapidement et impitoyablement à leur endroit et, pour cela, utiliser des moyens appropriés, fussent-ils, eux aussi, révolutionnaires.
Cependant, c’est grâce au silence et au secret dont ils s’entouraient que ces tueurs pouvaient opérer et porter les coups les plus dévastateurs. Le secret rompu permettrait de les interpeller et mettre la main sur les bombes, les armes de toute sorte, interdirait toute velléité d’attentat. C’était donc au secret qu’il fallait s’attaquer si l’on voulait éviter un bain de sang…
Mais comment s’y prendre ?
Imaginons être en face d’un homme pris alors qu’il vient de déposer une bombe et qui, seul, sait en quel lieu, à quelle heure elle explosera, tuant et mutilant à jamais des dizaines et des dizaines d’innocents. Si cet homme, s’enfermant dans son secret ne veut rien dire quand on l’interroge humainement, réglementairement, alors, que faut-il faire ? Et il faut faire vite car le temps presse ! Quelque part dans la ville, le tic-tac s’égrène lentement et c’est pour de nombreux êtres humains, une question de vie ou de mort. A tout prix il faut désarmer ce bandit, le faire parler quels que soient les moyens afin qu’il livre son secret… et de toutes les méthodes, seule la torture paraît être la plus efficace et, surtout, la plus rapide. C’est ça ou se contenter de ramasser des innocents déchiquetés par la bombe qui va exploser dans un instant et de les conduire à la morgue.
En Algérie, l’armée française dut, pour faire face au danger sans cesse croissant du terrorisme et afin de le mieux combattre, utiliser les mêmes arguments que l’ennemi : La torture.
Par celle-ci, cependant – et par elle seule - elle arriva à prévenir le harcèlement imminent d’un poste, l’embuscade tendue à une patrouille, l’explosion d’une bombe dans un stade, un café ou un cinéma, l’attaque d’une ferme, l’enlèvement ou l’assassinat d’une personne.
On a fait à ce sujet, au lendemain de la « bataille d’Alger », le procès de la torture. Si ses plus violents proscripteurs n’avaient pas été animés, souvent, plus par des arrière-pensées politiques que par des sentiments humanitaires, leurs appels auraient eu une autre résonance. Mais combien songeaient à condamner en même temps, et peut-être d’abord, la cause : Le terrorisme ignoble et aveugle ?
Durant ce conflit, les « moralistes à la conscience pure » n’ont eu de cesse de vilipender les parachutistes français pour leurs « opérations de police musclées » lors de cette bataille en leur opposant la « charité chrétienne ».
Mais où est la « charité chrétienne » dans ces visions apocalyptiques : Visages lacérés où les yeux manquaient, nez et lèvres tranchés, gorges béantes, corps mutilés, alignements de femmes et d’enfants éventrés, la tête fracassée, le sexe tailladé dont les tueurs du FLN se repaissaient avec un plaisir sadique ?
La révolution, la lutte pour l’indépendance de son pays justifient-elles de telles abominations ? « On dirait que les moralistes ont envie que les gens soient malheureux, afin de donner respectivement raison à leurs sentences » écrivait Charles Dantzig dans son « Dictionnaire égoïste de la littérature française »…
Les âmes chagrines disent que la conscience se révolte au spectacle de certains crimes. Hier, le FLN ; aujourd’hui, l’Etat Islamique et ses séides… Dans les deux cas, nous avons été - et sommes, de nouveau - en présence du plus monstrueux florilège du crime qui puisse se concevoir. Les images qui représentent les milliers d’hommes égorgés, les visages mutilés au couteau, les têtes tranchées, les fillettes violées ou déchiquetées par les bombes, les femmes lapidées ou vitriolées, reculent les limites assignées à l’horreur. Cependant, ces atrocités, répliques de tant d’autres commises en Algérie ne révoltent pas les consciences contre les criminels mais contre ceux qui les pourchassent et tentent de les neutraliser…
La conscience se corrompt dans ces contradictions parce que pardonnant là (l’assassin) et condamnant ici (le soldat), elle cesse d’être conscience pour se faire complice. La supercherie naît de ce qu’elle continue à se parer des attributs de la conscience et exige d’être reconnue comme telle. La complicité dissimulée sous le vocabulaire de la conscience, c’est la subversion. Les mots deviennent fausse monnaie.
|
|
LA RÉVOLTE DU 1er REGIMENT
ETRANGER DE PARACHUTISTES
Par M.José CASTANO,
|
« La mémoire n'est pas seulement un devoir, c'est aussi une quête » (Commandant Hélie de Saint-Marc - " Les champs de braises ")
… 12 Novembre 1960
Une nouvelle consternante parvient dans les unités parachutistes. Dans les Aurès, les fells ont surpris un groupe de combat du 1er REP à sa descente d’hélicoptères, faisant 11 morts et 6 blessés graves.
15 Novembre 1960
Dans la chapelle de l’hôpital Maillot à Alger, eut lieu la cérémonie militaire et religieuse en l’honneur des légionnaires tombés le 12. Ils allaient maintenant reposer comme tant d’autres dans cette terre d’Algérie qu’ils avaient défendue jusqu’à l’ultime sacrifice et qui était la leur désormais.
Au cimetière de Zéralda –qui gardera à jamais, dans son « carré légionnaire » les dépouilles mortelles de ces soldats morts pour la France- l’aumônier de la 10ème Division Parachutiste, le Père Delarue, bien qu’habitué à conduire des légionnaires à leur dernière demeure, se sentait, devant tous ces cercueils, bouleversé. Ce qui le mettait en rage, lui, prêtre, c’était l’absurdité de cette mort si elle ne correspondait plus à un sacrifice exigé par la Nation. Onze cadavres inutiles et scandaleux… Onze cadavres de plus dans cette longue liste… Et sa détresse, sa lassitude étaient immenses, de cette guerre où des hommes valeureux payaient de ce qu’ils avaient de plus cher pour racheter l’incompétence, la veulerie, les fautes et les palinodies de leurs gouvernants.
Tous écoutaient, muets et bouleversés, les dernières prières douloureuses de l’aumônier. Des paroles simples lui venaient aux lèvres. Il disait :
« Vous étiez venus de tous les pays d’Europe où l’on aime encore la liberté pour donner la liberté à ce pays… La mort vous a frappés en pleine poitrine, en pleine face, comme des hommes, au moment où vous vous réjouissiez d’avoir enfin découvert un ennemi insaisissable jusque-là… »
Et, d’une voix forte, il ponctua en criant presque :
« Vous êtes tombés au moment où, s’il faut en croire les discours, nous ne savons plus, ici, pourquoi nous mourons ! »
Puis le clairon, gonflant ses joues et les veines de son cou, lança vers les airs cette courte sonnerie saccadée : la sonnerie aux morts.
« Notre Père, qui êtes aux Cieux… » commença le prêtre, de sa voix qui tremblait et qui n’avait pas son impassibilité habituelle. Et tandis que se continuait le Pater, chez ces grands enfants qui écoutaient, recueillis, se reflétait un immense chagrin au souvenir de leurs camarades de combat. Chez certains, les yeux devenaient troubles comme sous un voile et, à la gorge, quelque chose s’étranglait. Sur toutes ces têtes alignées, flottait pour la dernière fois, l’ombre de ceux qui étaient morts, parce que la France, une dernière fois, le leur avait demandé. Et quand le prêtre, après un arrêt, et la voix plus grave encore, prononça les derniers mots de l’Ave Maria, d’une simplicité sublime : « Sainte Marie mère de Dieu… priez pour nous, pauvres pécheurs… maintenant… et à l’heure de notre mort », tout à coup, sur les joues de ces hommes rudes que l’on qualifiait « d’inhumains », de brusques larmes coulèrent, qui jaillissaient rapides et pressées comme une pluie…
L’émotion avait atteint un degré douloureux. La foule pleurait en silence communiant dans la douleur avec « ses soldats », « ses légionnaires ». Puis le nouveau chef du 1er REP, le Colonel Dufour, s’avança à son tour pour dire adieu à ses hommes. Il énuméra les noms de ceux qui ne feraient plus le chemin, tant rêvé, du retour dans leur foyer. Ces noms qui, bientôt ne vivraient plus que dans le cœur des mères, émurent le silence, cognèrent aux poitrines, bâillonnèrent les gorges et mouillèrent de nouveau les yeux. Puis il termina par ces mots :
« Il n’est pas possible que votre sacrifice demeure vain. Il n’est pas possible que nos compatriotes de la Métropole n’entendent pas nos cris d’angoisse ».
Il salua ; les clairons sonnèrent : « Au drapeau ». Les détachements présentèrent les armes et défilèrent, les yeux tournés vers les tombes. Les visages graves, bronzés et maigres, recelaient toutes les tristesses cachées, toutes les tares et tous les deuils qui les avaient amenés là.
« Nous ne savons plus ici pourquoi nous mourrons… » Ces paroles du père Delarue allaient avoir un écho immédiat : il allait, sur le champ, être banni d’Algérie et exclu des unités parachutistes.
Trois semaines plus tard, le Colonel Dufour fut relevé de son commandement pour avoir exprimé en public ses sentiments « Algérie française » et fut prié de quitter le sol algérien avant le 9 décembre 1960, date d’arrivée de de Gaulle à Oran. Ecarté de la Légion, affecté aux FFA, (Forces Françaises en Allemagne), (Offenburg), le Colonel Dufour choisira quelque temps plus tard la clandestinité et rejoindra, en Algérie, les rangs de l’OAS.
8 Janvier 1961
Un événement tout à fait extraordinaire venait de se dérouler au 1er REP. Pour la première fois depuis le début des guerres d’Indochine et d’Algérie, des officiers de cette prestigieuse unité refusaient de partir en opération. Ils se mettaient en grève ! Unanimement hostiles à la politique algérienne du général de Gaulle, ils n’acceptaient plus de voir mourir leurs légionnaires alors que l’indépendance de l’Algérie semblait inéluctable. A quoi pouvaient désormais rimer ces opérations incessantes et meurtrières à l’heure où le chef de l’état clamait qu’il voulait en finir à n’importe quel prix avec le « boulet algérien ». L’absurdité dépassait les bornes. Ils avaient donc décidé de faire la « grève de la mort ».
Un vent de panique souffla à tous les échelons de la hiérarchie. Quoi ! La « grève de la mort » ? Impensable pour des hommes qui étaient « soldats pour mourir » ! (1)
Une pluie de sanctions s’abattit sur les révoltés qui furent mis aux arrêts et mutés immédiatement en Métropole. L’un d’eux, le Lieutenant Roger Degueldre fut affecté au 4ème Régiment Etranger d’Infanterie mais il refusa de rejoindre son nouveau corps. Le 25 janvier 1961, il entra dans la clandestinité. Les dés de son destin étaient jetés. Une légende naissait…
A Zéralda, fief du 1er REP, le cœur n’y était plus et les questions que posaient les cadres rescapés de la purge n’obtenaient aucune réponse de la hiérarchie : le drapeau du FLN va-t-il flotter sur Alger ? Après avoir été vaincu sur le terrain, le FLN y sortira-t-il vainqueur ? Que vont devenir les Européens ? Et les Musulmans ralliés au drapeau français, eux qui ont cru aux promesses de l’armée ? Après l’Indochine, l’Algérie… L’armée sera-t-elle donc éternellement vaincue, éternellement parjure ?
Et de mains en mains l’on se passait une lettre. C’était une missive vieille de 2000 ans. Le texte, rapporté par Suétone, était de Marcus Flavinius, centurion à la 2ème cohorte de la légion Augusta. Destiné à son cousin Tertullus, il avait été écrit en Numidie (ainsi que s’appelait l’Algérie à l’époque romaine) : « Si nous devions laisser nos os blanchis en vain sur les pistes du désert, alors que l’on prenne garde à la colère des légions ! »
La colère des légions ! Elle se concrétisa le 22 avril 1961 avec le soulèvement des plus belles unités de légion et de parachutistes… et se termina par la dissolution du 1er REP.
(1) - En janvier 1885, lors des préparatifs de l’attaque de Bac Ninh, au Tonkin, le général de Négrier s’était adressé aux légionnaires des 1er et 2ème Bataillon en ces termes :
« Vous, légionnaires, vous êtes soldats pour mourir
et je vous envoie où l’on meurt ! »
|
|
BARBOUZES contre O.A.S.
Envoyé par Mme N. Marquet
|
A l'époque troublée de la fin de la bataille d'Algérie française, en novembre 1961, la police et les services de renseignement traditionnels ne suffisent pas à remplir toutes les tâches. Pour les plus compromettantes, on recrute donc des volontaires ; on recrute si vite qu'on n'a pas le temps de vérifier les casiers judiciaires. Et puis ce n'est pas chez les enfants de chœur que l'on peut trouver des gens qui savent manier un Beretta ou une mitraillette. Qu'importe, alors, si, parmi les hommes chargés de défendre l'action du Général, de combattre l'O.A.S., il y a d'anciens membres de " la carlingue ", la sinistre Gestapo française de la rue Lauriston. (C'est le cas de Georges Boucheseiche, dit le " gros Jo ".) Qu'importe s'ils sont proxénètes, tueurs, " braqueurs " de banques. L'essentiel est qu'ils obéissent.
Ils obéissent. Au début du moins. Certains de ces " mercenaires " se sont d'ailleurs engagés par conviction politique et ils font leur travail avec discrétion et efficacité. Mais les choses vont s'envenimer très vite. Et les filous, qui ne tardent pas à prendre le pas sur les fidèles, s'aperçoivent bientôt que la condition de mercenaire, avec les " couvertures " politiques qu'elle implique, n'est pas sans avantages. Sur Paul Comiti, gorille du général de Gaulle et organisateur de ces réseaux parallèles, commencent à pleuvoir les coups de téléphone des commissaires de police.
L'histoire est toujours la même. Au bout du fil le policier dit : " Je viens d'arrêter un type pour hold-up, il m'a présenté une carte tricolore en me demandant de vous téléphoner. " René Backmann - Le Nouvel Observateur n° 418 du 13 novembre 1972.
Nommé le 26 novembre 1961 à la tête de l'ensemble de la Mission C, Michel Hacq s'envole pour Alger. A ses côtés : Jacques Dauer et l'ancien champion de tennis Robert Abdesselam, devenu député. A un rang devant eux, Lucien Bodard, l'as des reporters, capte le maximum de bribes de la conversation des trois hommes. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Bodard est dans l'avion. Un rédacteur en chef de France-Soir a eu vent de la " Mission C " et a demandé au journaliste de reporter un congé en Corse pour aller aux renseignements. Le soir même, dans sa chambre de l'Aletti, Lucien Bodard tape à la machine le " papier " nourri et construit dans l'avion, où apparaît le mot " barbouze " .
Dans " France-Soir " du 2 décembre 1961, sous le titre " Les " barbouzes " arrivent ", Lucien Bodard, définissait leur mission : " Très prochainement, les autorités vont employer les principes de la guerre secrète contre l'Organisation de l'Armée Secrète (O.A.S.)… L'objectif c'est de décapiter l'OAS en arrivant à détecter et à capturer les 10 hommes qui, à eux seuls, l'ont crée et l'animent… En réalité, les événements de ces derniers mois ont prouvé que le gouvernement était trahi dès qu'il voulait faire procéder à l'arrestation des chefs de l'OAS en se servant des moyens normaux… Cette force de choc sera indépendante. Les nouvelles formations anti-OAS ne feront partie d'aucune hiérarchie classique. Ce seront des organismes autonomes, sans sujétion à l'égard des autorités normales, agissant par leurs propres moyens et ne dépendant que des instances les plus hautes. Ils agissent largement en dehors de l'armée et de la police. Avant tout, cette nouvelle force sera secrète. Un secret absolu couvrira les activités et surtout l'identité des membres des formations anti-OAS. Cette force appliquera les méthodes des commandos et de la guerre secrète. Il s'agira non seulement pour elle d'avoir des " tuyaux " mais de les exploiter immédiatement et de façon décisive. Tout se passera sans papiers, sans rien. Les transmissions et les communications seront réduites au minimum, de façon à ne pas donner l'alerte… Cette force sera surtout composée de" nouveaux ". Tous les as de l'espionnage, du contre-espionnage, de la guerre subversive, disponibles en France vont être envoyés en Algérie. Ce sont des gens sûrs, aux origines les plus diverses…"
Aux origines les plus diverses " est tout à fait exact. Il fait appel aux anciens du service d'ordre du RPF, à tous ses amis corses, au premier rang desquels Francisci et les Venturi." Parmi les 300 hommes qui luttaient contre l'OAS, on comptait aussi Jo Attia, Jean Palisse.
Les barbouzes ne viennent pas de " la piscine " du boulevard Mortier (siège de la DST) ; ils ne feront pas un métier de seigneurs. Comme dira Me Tixier-Vignancour au procès du général Salan : " On a fait l'amalgame entre la police régulière et une police irrégulière et supplétive, composée de bandits, de tortionnaires et de condamnés de droit commun". Et, comme a écrit Constantin Melnik, alors chargé de la coordination des services spéciaux à Matignon, dans ses souvenirs : "… Ces demi-soldes du gaullisme… laissant dans leur sillage tout ce que j'apprenais sur leurs éventuelles condamnations pour rixes, coups et blessures, voire proxénétisme… " Ce qui n'empêchera nullement Constantin Melnik d'assurer la transmission des ordres et des comptes rendus entre le Premier ministre Michel Debré, Michel Hacq et d'autres agents de liaison : Alexandre Sanguinetti (Intérieur M. Frey), le colonel Laurent (2e Bureau), M. de Rochefort (le Rocher Noir).Le ministère de l'Intérieur est bien placé pour recruter: il a sous la main, via l'administration pénitentiaire, tous les détenus " intéressants " . On recrutera pour Sanguinetti des tueurs dans les bas-fonds de Marseille : quelques mauvais garçons au casier judiciaire chargé (mais on leur promet de les " blanchir ").
Les " barbouzes " ont carte blanche pour liquider les hommes des commandos Delta et les réseaux OAS. On avait commencé en fait par les employer pour liquider les membres des réseaux FLN en métropole. Munis de cartes de police et de ports d'armes, les truands marseillais font des ravages, en Algérie comme en France.

En 1961, un certain Raymond Meunier, dit " Raymond-la-Science " , condamné pour vol à main armée, est libéré avec mission d'infiltrer les milieux OAS. Il travaillera surtout en métropole. Selon Leroy-Finville, chef de service du SDECE, qui le connaît pour l'avoir utilisé, c'est " le summum de la belle brute ; un colosse adipeux, difforme et flasque, une voix grasseyante aux intonations vulgaires… " .
La Sécurité militaire n'est pas plus " regardante " que la police. Sa recrue-phare est un certain Jean Augé, un second couteau de la Résistance devenu sans transition un caïd du milieu lyonnais. " Petit-Jeannot " reçoit l'ordre d'abattre à Alger deux agents du SDECE accusés de " trahison " . Plus tard, en 1965, le colonel André devra reconnaître avoir utilisé le savoir-faire d'Augé " en diverses circonstances " , sans plus de détails. Augé est mort le 15 juin 1973, abattu au cours d'un règlement de comptes de nature indéterminée.
Très vite, le MPC dispose de cinquante permanents, sans compter les chauffeurs et gardes du corps algériens fournis par le cheikh Zekiri, avec ou sans l'accord officiel du FLN.
A Alger, Trois équipes : - Lavier : Place du gouvernement, bab el oued, square Bresson et Bd de la République. - Dubuquoy : centre d'El Biar. - Lecerf : Champ de manœuvre, rue de Lyon, Belcourt, Kouba et Hussein Dey. Goulay, Pelletier, Lavier, Franck, Hortenzi et Dubuquoy. - André Laurent à la sécurité militaire, coordonnait, analysait et traitait les renseignements et avait fourni, au MPC, des armes prises au FLN.
Pour Orléansville, Guy Gits sera le responsable qui travaillera étroitement avec le préfet Mohand Ourabah . A Orléansville, deux chefs de secteur, huit responsables et vingt huit militants. Leur groupe de choc était constitué de six baroudeurs triés sur le volet.
A Oran, ils étaient basés au " Château Neuf ", QG du lieutenant-colonel Ranson, chef du 2e bureau qui fut exécuté par l'OAS et au collège Ali Chekkal protégés par les gendarmes.
Suite à la riposte de l'OAS qui entreprit la traque des Barbouzes Goulay et Lecerf demandent des renforts à Paris. Le MPC s'attela à un nouveau recrutement de " soldats " plus ou moins recommandables par l'initiative de Dominique Ponchardier. Envoi de la " mission C " et d'un corps de volontaires. Ces nouveaux commandos seraient appuyés par le soutien logistique d'une nouvelle recrue ; Ettore Lobianco dit " Mario " assisté de Gérard Maugueret et de Michel Dirand. Gaston Quetel (vice-président du MPC) assurerait l'information de Dauer sur les activités en Algérie, de ces hommes
6 décembre 1961 arrivaient à Alger le père Peysson de son vrai nom Jean Dufour, Claude Vieillard, Marcel Pisano, ainsi que huit judokas et spécialistes de arts martiaux, quatre juifs d'AFN dont Joseph Touitou, Alain Belaïche, deux musulmans, le père et le fils Amar, et quatre vietnamiens commandés par Jim Alcheik dit " Lassus " judoka qui utilisa ensuite son dojo parisien pour recruter une partie des membres du groupe Action, Viorme, et de son adjoint Roger Bui-Thé. Tous spécialistes de sports de combats, ils formeront le commando " talion " qui montrera très vite une efficacité redoutable. Ils seront logés dans une cinquième villa qui sera vite abandonné au profit de la fameuse villa Andréa. Ils auront pour objectif principal : annihiler la propagande OAS qui s'exprimait spectaculairement par des émissions de radio pirates. Le groupe Talion, qui a vraisemblablement servi de diversion au gouvernement de la république pour lui permettre de lutter contre l'OAS par d'autres moyens, fut décimé en peu de temps. Jim Alcheik mourut à Alger en janvier 1962, pulvérisé dans l'explosion d'une villa piégée par l'OAS. Peu avant Noël, nouveau colis : Jacques Andréi. Arrivé peu avant la fin de l'année à Alger, Clauzure, Biard, Pelletier, Hortenzi et Gauthier, tous membres du SAC (Service Action Civique) dont le chef sera Jacques Cohen " Mustapha ".Après le repliement à l'hôtel " Radjah " arrivée de Christian David agent du SDECE (qui assassinera le commissaire Gallibert). Débarquement des renforts recrutés dans le " milieu " marseillais. Dans la foulée François Marcantoni garde du corps d'Alexandre Sanguinetti et truand notoire, Ange Simonpieri , Marcel francisci, Dominique Venturi " Nick ", qui s'illustreront dans le domaine de la drogue, Glaise secrétaire de FO, s'impliqueront dans la lutte anti OAS
|
|
« Ma fin rêvée de Macron-la-honte
et du bal des voleurs »,
Envoyé par M. Fabien Alary
|
Par M. Bruno Adrie
Aujourd’hui, lorsque je contemple la tragédie humaine déclenchée et entretenue par les pays occidentaux en Syrie, je souffre pour les victimes exécutées lâchement par nos alliés soudards et terroristes. Je souffre de toutes les peurs, de tous les deuils, de toutes les meurtrissures et de tous les désespoirs ineffaçables qui ont été gravés dans le cœur d’une nation par le fer et le feu d’une guerre insensée.
Mais je ne souffre pas seulement, j’ai honte aussi, non pas d’être français, mais de voir ce que la France est devenue entre les doigts roses et manucurés d’une clique de hauts fonctionnaires, de chefs de bureaux, de petits diplômés arrogants aux regards pleins de mépris, de minets et de minettes privilégié.e.s, brossé.e.s et toiletté.e.s, vivant grassement – très grassement – à l’abri d’une crise qu’ils/elles entretiennent comme un incendie pour semer la mort et la démunition dans l’intérêt du Moloch affairiste néocolonial dit mondialisé.
J’ai honte de cette élite autoproclamée, poseuse, naïve au fond car ne doutant pas de son élitisme pourtant de ferblanterie, de cette bureaucratie du désespoir rémunérée par l’État, puis par le privé, puis par l’État, et ainsi de suite – ils appellent ça du pantouflage, moi j’appelle ça de la trahison – pour détruire, non seulement les salaires, mais aussi les savoir-faire, la culture, l’éducation et les solidarités qui doivent être le ciment d’une société et d’une civilisation.
J’ai honte de vivre dans ce pays dévasté par les propagandes, peuplé par une masse désormais avachie, aplatventriste, saignée sous les dents d’une réclame qui la vampirise, endettée pour des babioles tape-à-l’oeil et toujours hors de prix, troupeau naïf bêlant, courant à l’abattoir de la consommation et qui voudrait voir gravées dans le marbre – parce qu’il a sa fierté – ses convictions liquides toutes aspirées aux mamelles fétides d’une presse élevée dans les étables de la connivence.
Et c’est en vain que j’attends le moment de la grande grève des imbéciles enfin transfigurés, que j’attends le moment où ils cesseront d’acheter le papier fané des journaux, où ils préféreront les documentaires animaliers aux bulletins d’information présentés par les caniches de la bourgeoisie, où ils tourneront le dos aux meetings politiques organisés par des incapables de profession, où ils réagiront comme un seul homme – ou comme une seule femme -, coupant le contact, refusant toutes les gueuleries déversées par les instances communicationnelles qui tirent leurs millions de la bêtise, de l’irréflexion, du mimétisme grégaire, des croyances enfoncées à coups de slogans marteleurs et des habitudes jamais fouillées par le tranchant d’une conscience impitoyablement aiguisée.
Nul besoin d’être de droite ou de gauche pour les envoyer paître et les mettre sur la paille, tous ces flibustiers vivant du pillage de la nation. Il suffit de couper les robinets de la consommation, de vivre avec le moins possible matériellement et avec le plus possible spirituellement et intellectuellement. Et de savoir aussi se tourner vers l’Autre et l’aider – oh, pas grand chose – d’une parole, d’un geste, d’un regard, ça coûte si peu. Et surtout de ne pas lui nuire.
Le jour où nous ferons cet effort, ils tomberont, et ne pourront rien contre la somme de toutes nos paroles, de tous nos gestes et de tous nos regards, parce qu’enfin nous regarderons le Vrai.
Ce sera la fin de Macron-la-honte et de ses semblables, ce sera la fin du bal des voleurs.
Oh pardon, je rêvais, je m’étais endormi. S’il vous plaît, oubliez!
Bruno Adrie
|
Au revoir Padre !
Envoyé Par M. Hugues Jolivet
|
|
Au revoir Padre ! "60 ans au service de la France, 55 ans au service de l'Eglise ! 23 ans au service de la Légion ! Soldat et prêtre"... le Père Lallemand, est fait Légionnaire d'honneur avant de nous faire ses adieux empreints d'humilité.
60 ans au service de la France, 55 ans au service de l’Eglise, 23 ans au service de la Légion
C’est dans cette salle d’honneur du musée de la Légion étrangère, que sont accueillis chaque semaine selon un rite immuable les jeunes engagés volontaires en partance pour Castelnaudary, quatre mois plus tard ces mêmes engagés devenus légionnaires lorsqu’ils sont affectés dans leur régiment, et ces mêmes légionnaires aguerris par cinq à quarante années de service lorsqu’ils disent Au revoir à la Légion à quelques heures de leur retour à la vie civile. C’est donc dans cette même salle d’honneur que nous avons choisi de vous dire Au revoir, Padre, notre Padre. Vous ne vouliez pas faire de bruit en nous quittant, mais nous ne voulions pas que vous partiez dans l’indifférence. Dans la sobriété de cette salle d’honneur qui lui donne toute sa solennité, nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance pour ce que vous nous avez apporté. Nous, c’est la maison mère de la Légion étrangère bien sûr, mais ce sont aussi toutes ces têtes qui vous sont familières et qui représentent les régiments, les anciens, les familles et les amis qui vous sont si chers. Ces têtes présentes autour de vous, mais aussi tous ces visages des légionnaires qui sont passés par cette salle d’honneur.
60 ans au service de la France, 55 ans au service de l’Eglise, 23 ans au service de la Légion. Soldat et prêtre. Padre, vous êtes un homme de courage et un homme de foi, qui avez mis en pratique chaque jour cette citation du curé d’Ars, qu’aimait tant rappeler le Père Hirlemann, au point qu’il la fit graver dans l’église de Puyloubier : “on n’a rien fait tant qu’on n’a pas tout donné.”
Il est difficile de dissocier chez vous le soldat du prêtre, tant dans votre vie les vertus de l’un se sont nourries de celles de l’autre. C’est d’ailleurs ce qu’écrivit si bien l’un de vos chefs de corps, recevant un jour la redoutable mission de vous noter, et qui trouva cette phrase salvatrice, mais sonnant ô combien juste : « la sainteté est entrée dans la Légion. »
Il est difficile de dissocier chez vous le soldat du prêtre
Soldat, vous l’avez été, d’abord par le service des armes puisque comme chef de commando de chasse en Algérie, vous avez été cité à deux reprises. Soldat, vous le resterez comme aumônier militaire, en ayant troqué votre arme pour votre service quotidien des plus humbles, par votre présence rassurante et par le gain de deux autres citations. A cette bravoure du soldat, vous avez joint à maintes reprises le courage de l’engagement, physique et moral. En accueillant sur le port de Marseille sous la huée des dockers, une quarantaine de harkis et leurs familles, de la section de l’un de vos frères qu’il réussit, malgré tous les barrages, à envoyer en France, et donc, à sauver de l’assassinat par le FLN. Cela vous valut, par la pleutrerie d’un préfet et d’un évêque, d’être ordonné avec six mois de retard, non pas traditionnellement dans la cathédrale du diocèse comme vos amis séminaristes, mais en catimini dans votre village du Poitou.
Une des grandes vertus du soldat est la patience. Vous avez dû attendre six ans de sacerdoce pour rejoindre l’aumônerie militaire, que vous désiriez tant, car cette affection pour ces harkis, pour nos soldats et pour l’Algérie où l’un de vos frères y est mort pour la France, était alors punie.
En septembre 1970, vous accédez à l’aumônerie militaire, auprès des chasseurs alpins de Chambéry et de Bourg Saint-Maurice. Puis en 1972, ce sont les parachutistes du 3e RPIMa et en 1975 la Corse, principalement au sein de nos deux régiments de Légion qui y sont stationnés à Calvi, Corte et Bonifacio. Vous enchainez les missions, les exercices et les opérations en Corse, en Guyane, à Kolwezi, à Djibouti, et aux Comores. Mais ce que retiendront d’abord les légionnaires, c’est votre présence quotidienne auprès d’eux, à l’ordinaire quand vous servez la soupe, lors des marches et des manœuvres où vous donnez d’abord aux autres la nourriture que vous portez, lors des 8000 TAP, lors des 1er sauts des jeunes légionnaires. Vous êtes celui « qui ne parle pas comme les autres » disent les légionnaires. C’est vrai, l’aumônier ne donne pas d’ordre, mais vous êtes là, dans l’épreuve, dans la difficulté ou dans la solitude de ces légionnaires qui vous adoptent déjà comme l’un des leurs.
En 1981, vous quittez une première fois la Légion pour Pau et son 1er RCP que vous accompagnerez dans la douleur et dans l’épreuve du lâche attentat de Drakkar en octobre 1983 au Liban, alors que vous venez d’être nommé aumônier du groupement aéroporté à Albi, auprès du 3e RPIMa de Carcassonne. Puis c’est le Tchad, la Nouvelle-Calédonie, et la République centrafricaine. Vous quittez l’uniforme en 1986 et retournez au Tchad, pour 10 ans au service des chrétiens de l’armée tchadienne. Vous y côtoyez la misère, et le dénuement vous renforce dans votre foi au service des plus petits.
La sainteté est entrée dans la Légion
Montpellier, Castelnaudary, Aubagne, et aujourd’hui nos anciens de Puyloubier et d’Auriol. Le grand soldat bien connu de tous est aussi le saint prêtre qui déjeunait à l’ordinaire chaque dimanche avec les tous jeunes engagés volontaires en partance pour Castelnaudary, qui marchait avec eux pour qu’ils gagnent leur képi blanc, qui accompagnait les jeunes officiers en formation, qui aujourd’hui toujours conseille et réconforte ceux qui le souhaitent, qui visite les blessés, les malades et les anciens, qui marie, baptise, pardonne, enterre et absout.
Padre, vous aimez à dire « autre celui qui sème, autre celui qui récolte ». Soyez persuadé qu’en ces 60 années au service de notre pays, ce que vous avez semé auprès des plus humbles a déjà porté du fruit. La communauté légionnaire vous en remercie. Elle vous souhaite une bonne retraite partagée entre votre famille dans le Poitou et vos frères moines de Ganagobie. Elle souhaite vous exprimer sa reconnaissance d’une manière toute particulière : vous élever à l’honorariat. Vous ne rejoignez pas le millier de légionnaires de 1ère classe d’honneur, ni la centaine de caporaux d’honneur, mais la dizaine de légionnaires d’honneur que compte dans son histoire la Légion étrangère, car comme le dit l’Ecriture « celui qui veut être le plus grand, qu’il se fasse serviteur des autres ». Vous avez été le serviteur de Monsieur légionnaire. Il vous dit merci, légionnaire Lallemand.
|
|
|
Les brèves politiciennes explosent !
Par M. Robert Charles PUIG
|
|
Lors d'un entretien privé et sans caméra avec les journalistes, Macron annonce sans rougir - si je me réfère à ce que j'ai entendu brièvement à la télé - qu'il se sent " exceptionnel " en ce XXI é siècle ! Nous avons donc un devoir : le louer ! En effet, si le " Big-bang " a créé l'Univers, Emmanuel Macron, Jupitérien et nombril du monde a inventé la France du futur, mais oublie la façon dont il est devenu président et maître de l'Elysée ! Une erreur de casting !
Pourtant ne nous faisons pas d'illusion, le programme de François Hollande reste présent dans son jeu. Les réformettes sur la loi du travail qui profitent aux grandes entreprises n'empêchent pas que sur d'autres points, principalement la sécurité et la justice, les décisions à prendre restent du domaine des promesses... Bien entendu il y a des chiffres : on embauche des policiers, des gardiens de prison, 1.000 / 2.000, mais quand et comment ? Avec quels financements ? Peut-être celui qui est ponctionné sur les retraites des vieux travailleurs ? D'ailleurs chaque fois comme l'annonce Castanier, les chiffres sont flous. Comment annoncer 7 000 ou 10 000 places de prison sans plus de précision ? Pour un gouvernement de " Star up " c'est triste ce flou artistique, ce défaut de rationalité. Mais attention ! A travers certaines mesures nous sentons la griffe de Christiane Taubira, dont l'ombre plane sur ce gouvernement qui annonce la suppression des petites peines de prison.
Nous y revoilà ! L'indulgence bonasse et le paternalisme jocrisse remplacent la rigueur ! Le socialisme est omniprésent dans le macronisme avec le même objectif : que les victimes paient. Puis c'est le grand jour et Paris est en deuil !
Le Qatar - PSG a perdu son match retour contre le Réal-Madrid ! Vaincu à Madrid 3 - 1, il perd à nouveau dans son fief parisien 2 contre 1 dans cette ligue des champions qui lui semblait à portée d'un coup de pied au but. Les journalistes de toutes les chaînes sont navrés et comme d'habitude inconscients du vrai esprit de la " gagne " qui doit animer une équipe. Je me permettrai de dire cette formule éculée par le temps, mais toujours d'actualité : " L'argent qatari ne fait pas le bonheur des supporters parisiens des banlieues ! ".
Le football est victime du pusillanime dont nos gouvernants habillent le pays. C'est la victoire de la niaiserie et du genre sur le masculin et le féminin. Il est interdit d'être de son sexe ! On étouffe le désir et l'envie de la compétition. C'est Fahrenheit 451, vous connaissez ? La censure ! Des livres à ne pas lire et des films où il est interdit de boire, de fumer, sans plus de scènes violentes ou d'amour. Un monde aseptisé, sans esprit de conquête ni envie de gagner. Les garçons jouent à la poupée tandis que les filles construisent des ponts... Juste une France robotisée, uniforme et sans adrénaline, soumise à une castre d'élus " En Marche ! ".
Robert Charles PUIG / Mars 2018
|
|
Lettre ouverte du Général Antoine MARTINEZ au Président de la République
Envoyé par Mme Saurel.
|
Monsieur le Président de la République,
Lors de votre discours du 31 décembre dernier pour présenter vos vœux à nos compatriotes, vous affirmiez vouloir rendre la France plus forte et plus juste, 2018 devant être le renouveau de la concorde et de la cohésion de la nation. Vous inspirant d'une phrase célèbre vous déclariez : " Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays ", et vous invitiez les Français à s'exprimer pour " que toutes les voix, y compris discordantes, soient entendues ". Alors, si ma voix - en raison des propos qui suivent - sera probablement considérée comme discordante, vous devez au moins l'entendre. Sera-t-elle écoutée, c'est une autre affaire, mais l'important est qu'elle contribue à alimenter un débat devenu vital pour le salut de la nation, car comme vous le mentionniez dans votre allocution, " nous avons tous quelque chose à faire pour la nation ". C'est même un devoir pour moi qui l'ai servie longtemps sous l'uniforme et qui continue, avec d'autres lanceurs d'alerte, à la servir aujourd'hui avec conviction et détermination.
Comme vous le proclamez, vous êtes effectivement " le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire, d'une effraction ". Une brutalité de l'histoire organisée de main de maître par des officines clandestines liées à un pouvoir à l'agonie et qui a conduit en 2017 à l'élimination du candidat promis à la victoire de l'élection présidentielle. Et une effraction, résultat du hold-up démocratique qui a suivi. En bafouant ainsi la démocratie, on a réussi à empêcher le débat qui était devenu prioritaire, à savoir la nécessaire réaffirmation de notre identité culturelle et civilisationnelle face à la barbarie qui s'installe avec la complicité de collabos félons et qui constituera pour longtemps un obstacle à la concorde et à la cohésion de la nation. Un curieux déroulement forcé des événements pour espérer une France plus forte. Alors, si vous affirmez que "Je n'oublie pas d'où je viens ", vous permettrez d'affirmer à notre tour que nous n'oublions pas, nous non plus, d'où nous venons, ce qui précisément nous permet de savoir où nous ne voulons pas aller. Car l'histoire est tragique. Votre prédécesseur, refusant l'évidence, l'a découvert brutalement le 14 juillet 2016. Vous commettriez une grave erreur en misant toute votre action sur la seule amélioration de la situation économique du pays. Le vrai problème aujourd'hui n'est pas économique, il est culturel. Conduire la destinée d'un pays, d'un peuple ne se réduit, en effet, pas à une gouvernance inspirée du management des grandes entreprises. Il y a d'autres ressorts qui conduisent un peuple à vouloir faire ensemble, ce qui naturellement permet de vivre ensemble. Car un peuple a une histoire, une mémoire, une âme qui le caractérisent et ne pas vouloir en tenir compte et s'attacher à dégrader ou à détruire ce qui a constitué ce socle unificateur, en favorisant l'implantation d'un autre peuple porteur d'une culture totalement étrangère, c'est le vouer à sa perte. Ce n'est pas ce que les citoyens attendent de leurs dirigeants politiques.
A votre demande, la réflexion est aujourd'hui engagée et des projets de loi sont à l'étude (" fake news ", asile, immigration, islam). Tous ces thèmes, traités simultanément, sont cependant étroitement liés entre eux ce qui traduit en réalité - c'est un aveu implicite - la reconnaissance d'un même problème, d'un même péril : l'islam. L'islam qui n'est pas une religion, mais un corpus politico-religieux, un système qui régit tous les aspects de la vie quotidienne, une idéologie totalitaire et mortifère incompatible avec nos valeurs, notre civilisation et la démocratie. La lettre ouverte adressée au Premier ministre, le 09 août 2016, rappelant l'incompatibilité de l'islam avec nos valeurs et suggérant les réponses à y apporter vous est communiquée. Cela permet de porter ici l'attention sur ces projets de loi et la réflexion engagée et sur les doutes sérieux qu'ils suscitent quant à leur finalité, surtout après votre déclaration du 9 novembre dernier aux Émirats Arabes Unis : " Ceux qui veulent faire croire que l'islam se construit en détruisant d'autres monothéismes vous trahissent ". Sauf votre respect, ce propos est effarant car, hormis le signe malheureux d'une soumission qu'il traduit, c'est nier l'évidence et refuser de reconnaître le massacre ou la mise en esclavage d'une multitude d'êtres humains dans le monde et dans l'histoire parce que non musulmans ou qui ont refusé de le devenir. Doit-on rappeler que la seule relation entre l'islam depuis sa naissance et notre civilisation européenne forgée par notre héritage gréco-romain et judéo-chrétien est marquée par la confrontation continue ? Et depuis la fin de la Guerre froide, nos dirigeants politiques n'ont cessé de reculer sous les assauts de l'islam conquérant qui a su créer le désordre et la discorde jusque dans l'école. Cette école qui pendant très longtemps a été le lieu de baptême de la démocratie mais qui en a désormais sonné le glas.
Êtes-vous conscient que dans une multitude d'écoles, la langue française est devenue une langue étrangère ? Votre prudence, comme celle manifestée par vos prédécesseurs, résonne aujourd'hui, dans ce rapport de force engagé par l'islam et auquel vous n'échapperez pas, comme un renoncement à affronter l'esprit totalitaire. Lors de votre visite récente à Calais, le dialogue engagé avec un prétendu réfugié ne laisse aucun doute sur l'angélisme et la naïveté, voire le déni de nos autorités. Entré il y a deux ans illégalement sur notre territoire, il prétend avoir fui la guerre. Qui peut croire qu'un père de cinq enfants abandonnerait ainsi sa famille dans un pays en guerre ? N'est-on pas là devant ce que vous appelez une " fake news "?
S'agissant de l'asile, chacun sait que le droit d'asile réservé à ceux qui encourent dans leur pays les violences d'État est complètement dévoyé. On détourne aujourd'hui la loi sur l'asile en accueillant toute la misère du monde et en maintenant sur notre sol - en violation totale de nos lois - ceux qui en ont été déboutés et ce, au détriment de nos propres miséreux. Sur l'immigration, la démonstration est faite avec ces territoires perdus de la République et avec la violence meurtrière qui a jusqu'ici frappé la France et l'Europe qu'avoir accepté depuis plusieurs décennies une immigration musulmane, dans une société occidentale laïcisée qui a pour fondement le christianisme, sans exiger en contrepartie sa soumission à nos lois, à nos valeurs, à nos traditions et à notre mode de vie, est une pure folie. Quant à l'invasion migratoire que subit l'Europe depuis 2015, elle est globalement de même nature sur le plan culturel et constitue une attaque sans précédent des peuples européens visant à les déstabiliser puis à les déstructurer à terme avec une arme redoutable, la démographie. Enfin, la lutte contre la radicalisation n'est qu'une vaste farce consternante, car vouloir déradicaliser ces fous d'Allah, convaincus par leur idéologie de mort, est utopique et constitue donc une perte de temps et d'argent.
Alors, devant les drames qui se préparent, il n'est pas raisonnable de continuer à favoriser l'implantation de l'islam dans notre pays. Il faut au contraire adopter des mesures coercitives propres à inverser le cours des choses. Vous n'avez pas le droit de sacrifier l'avenir du peuple français et son histoire bimillénaire pour satisfaire les exigences des derniers arrivants et leur esprit de conquête. Votre devoir n'est pas d'organiser l'islam en France mais de faire respecter et appliquer nos lois et au besoin d'envisager la remigration de ceux qui considèrent la loi islamique supérieure à celle de la République. Nous ne voulons pas de la charia, la loi islamique, dans notre pays. Et la charia, qui a été déclarée incompatible avec la démocratie par la CEDH en 2003, c'est, entre autres, le voile - sous toutes ses formes - le refus de la liberté de conscience et par voie de conséquence de la liberté d'expression, le refus de la laïcité, le rejet de tout ce qui n'est pas musulman, l'infériorité de la femme, la mort pour les apostats, etc… Contrairement à ce que certains de vos conseillers préconisent, il est donc inimaginable de créer une taxe " halal " pour financer cette idéologie incompatible avec nos valeurs. Ce serait une double faute : admettre que la charia (halal=charia) est supérieure à la loi de la République et collaborer à son implantation criminelle. Cette pratique barbare d'abattage des animaux, indigne d'un pays civilisé, et qui de surcroît présente des risques sanitaires sérieux, doit même être supprimée.
L'heure est grave, Monsieur le Président. Gouverner c'est prévoir, et pour obtenir la concorde dans le pays, à condition de le vouloir, il faudra du temps (plusieurs décennies). Mais il faut auparavant réussir à rétablir un minimum de cohérence interne de la société sur les plans culturel et civilisationnel. Car l'obsession mondialiste et bien-pensante prônant le multiculturalisme qui n'est en réalité qu'un biculturalisme est une véritable imposture, mais une imposture sanglante. Et la menace qui pèse dorénavant sur la nation à cause de tant de trahison de la part de ses élites politiques peut être illustrée par ces trois citations révélatrices et à méditer :
" La nationalité musulmane est une supranationalité (…) Elle est au-dessus de toutes les nationalités (…) L'islam n'a plus à être considéré comme une simple religion mais comme un fait politique majeur dans notre pays (…) l'islam est un phénomène socio-politique (…) c'est une idéologie de lutte, une idéologie d'agression " (Dali Boubakeur, recteur de la Grande mosquée de Paris), " Ce corpus de textes et d'idées que nous avons sacralisé depuis de nombreuses années suscite l'hostilité à notre égard du monde entier (…) Est-il concevable que 1,6 milliards de personnes puissent penser qu'elles doivent tuer les autres membres de l'humanité, qui compte sept milliards de personnes aux fins de pouvoir vivre? " (Abdel Fattah al Sissi, président de l'Égypte), " Avec vos lois démocratiques nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques nous vous dominerons " (al Qaradawi, théologien prédicateur des Frères musulmans).
Il est donc temps de crever l'abcès. Repousser l'échéance ne fera qu'aggraver la situation car il n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour comprendre que l'absence de décisions fermes des dirigeants politiques pour inverser le cours néfaste de cette islamisation à marche forcée de notre pays, contraire aux intérêts de la nation française, conduira inévitablement au chaos, à la guerre - cette guerre qui vient inexorablement - sur notre propre sol. Car 30 % des musulmans dans notre pays aujourd'hui (28 % cf. rapport Institut Montaigne) sont radicalisés, réclament l'application de la charia et utilisent leur " religion " comme un outil de rébellion contre la société française et contre l'Occident en général. Ils combattent nos lois, nos valeurs, nos principes de vie et sont prêts à en découdre. Et des citoyens, de plus en plus nombreux, attachés à leur héritage historique, spirituel et culturel, exaspérés par l'aveuglement, le déni et le manque de courage de leurs élites politiques et ne comprenant pas leur absence de vision à long terme sont, eux, de plus en plus déterminés à vouloir défendre la terre de leurs ancêtres, leur patrie, contre les derniers arrivants qui rêvent du califat mondial. Il est déjà miraculeux qu'ils aient fait preuve de sang-froid et de responsabilité après les carnages et les actions barbares qui ont frappé la France récemment. Mais personne ne peut dénier au peuple français le droit de vouloir défendre son identité et manifester sa volonté d'assurer sa continuité historique. C'est son droit le plus légitime. C'est le droit de tout peuple, de toute nation.
Depuis trop longtemps, par naïveté, manque de clairvoyance, déni de réalité, voire collaboration croyant sauver ainsi la paix civile et sociale, la classe politique n'a cessé de fournir et mettre en place tous les ingrédients qui alimentent les tensions et conduisent à la guerre sur notre propre sol.
Il est minuit moins le quart, Monsieur le Président, trois fois cinq minutes symbolisées par les trois prochaines années de votre quinquennat. L'islam doit être soumis aux lois de la République ; et ceux qui ne l'acceptent pas doivent partir, voire être poussés vers la sortie.
Avec l'expression de ma très haute considération.
Antoine MARTINEZ
Officier général (2s)13/03/2018
|
|
Le psychiatre et le livreur de pizzas.
Envoyé par Mme Eliane.
|
Le patient :
- Docteur, j'ai un problème.
Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un caché dessous.
Alors, je me relève pour regarder sous le lit et, bien sûr, il n'y a personne.
Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que je n'ai peut-être pas bien regardé.
Alors je me relève pour vérifier de nouveau, sans résultat bien entendu.
Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit.
Et ça dure toute la nuit !
Docteur, tout cela me pourrit la vie, pouvez-vous faire quelque chose ?
Le psychiatre :
- Hum ... Je vois ... obsessionnel compulsif.
Comptez quatre ans d'entretiens de psychothérapie, à raison de trois séances par mois
et je vous guéris de votre obsession.
Le patient :
- Euh ... Combien ça va me coûter, Docteur ?
Le psychiatre :
- 60 euros par séance, soit 180 euros par mois,soit 216 0 euros par an et donc 8640 euros au final.
Le patient, songeur :
- Euh ... je crois que je vais réfléchir.
Le psychiatre, six mois plus tard : Par hasard, il rencontre le patient dans la rue.
- Alors ? Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir ?
Le patient :
- C'est que ... 8640 euros ... alors que mon livreur de pizza m'a résolu mon problème pour 30 euros seulement.
Le psychiatre, vexé :
- Votre livreur de pizzas ? vraiment ? et comment a-t-il fait ?
Le patient :
- Il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit !
Bonne journée Docteur.
|
|
Je suis née en Algérie
où j’ai vécu jusqu’à mes 20 ans.
Envoyé Par M. plusieurs internautes
|
Publié par Danièle Lopez le 8 mars 2018
J’ai, donc, fréquenté depuis mon plus jeune âge les musulmanes qui allaient en classe avec moi. Plus tard, celles et ceux qui ont travaillé avec moi.
A cette époque, je puis vous assurer qu’aucune de ces enfants, jeunes filles ou femmes ne portaient de voile. Elles étaient habillées à l’occidentale. Elles se maquillaient. Elles fréquentaient les garçons comme n’importe quelle adolescente européenne. Rien ne les différenciait de nous.
Bien sûr, il y avait des femmes plus âgées, ou en charge de famille, qui mettaient le drap (en Algérie, elles portaient le drap blanc) quand elles sortaient dans la rue pour faire leurs courses, par exemple. Un peu comme nos mères qui ne « sortaient pas en cheveux » parce que ce n’était pas correct. Mais, quand elles balayaient le devant de leur porte qui donnait sur la rue, elles ne s’encombraient pas du voile. Pas plus quand le voisin européen rentrait du travail et qu’elle le croisait dans le couloir.
En ce qui concerne le ramadan, les enfants ne le faisaient pas. Ils étaient les seuls à avoir droit à la cantine scolaire en primaire et les repas leur étaient servis tous les midis. Pas plus que les adolescentes, d’ailleurs, comme les demi-pensionnaires lorsque nous étions au Lycée. Les vieux – et encore pas tous, certains – respectaient cette tradition religieuse.
Mais, tous, fêtaient l’Aïd.
Je n’ai pourtant jamais vu de mouton égorgé devant nos portes ni devant les leurs. Ils faisaient leurs achats dans les mêmes épiceries et boucheries que nous.
Et, puisque nous parlons de mouton, parlons du halal.
Pas de boucherie halal dans nos quartiers. Tous les arabes qui y vivaient achetaient chez les bouchers ! C’était plus simple que ce que vous pensez.
Dans mon quartier, le boucher ne vendait pas de porc. Il vendait toutes les autres viandes. Et il y avait les boucheries-charcuteries qui, elles, vendaient toute les cochonnailles, de la viande à la charcuterie. Dans ces commerces, il n’y avait jamais d’arabes. C’est tout à fait logique. Quant à nous, si nous voulions acheter du bœuf ou du mouton ou du poulet nous allions chez le même boucher où les arabes achetaient. Jamais au grand jamais je n’ai entendu parler de halal. Même après l’indépendance, pendant un an et demi où j’ai encore vécu là-bas, je n’ai vu ni connu de boucherie halal.
Quant à la mixité, les femmes et les hommes, musulmans, juifs ou chrétiens, tous, travaillaient ensemble sans qu’elles aient été obligées de se couvrir ou être séparées d’eux. Personne ne s’en est jamais offusqué.
On travaillait tous les jours de la semaine ou presque. Le dimanche était le jour de repos pour tout le monde. Il n’y avait pas de prière pendant les heures de travail, pas de vendredi à la mosquée, la religion était l’affaire de chacun et elle n’intervenait pas dans la vie en communauté. Cependant, je ne doute pas une seule seconde que les arabes étaient de bons musulmans comme les Juifs étaient de bons israélites et pour les chrétiens, pareillement.
Nous arrivons en France, en 1962.
Il y avait déjà des musulmans, d’autres nous ont suivis.
Il n’existait aucune ségrégation. Les arabes vivaient dans les mêmes bâtiments que nous, nos enfants se sont élevés ensemble, sont allés en classe ensemble et, là encore, la religion restait cantonnée dans la sphère familiale. Ces musulmans vivaient absolument comme nous.
Jusque vers la fin des années 70. C’est là que tout a commencé. C’est pendant cette période que tout a changé.
C’étaient des Arabes venus du Moyen-Orient, je pense, en tout cas habillés comme des prophètes de l’ère de Mohamed, qui ont sillonné les chemins de France. Ces gens, nous les avons vus s’adresser aux musulmans, passant dans les ateliers, les commerces, les cités, les chantiers des bâtiments et travaux publics, partout…
Ce qu’ils se sont dit ? Nous ne le savons pas. Mais, toujours est-il que les musulmans ont changé subitement d’habitude et d’attitude. Ceux qui aimaient bien boire leur vin le midi, ne burent plus que de l’eau. Ils rentraient directement à la maison au lieu d’aller boire l’apéro avec leurs copains. Ils se sont mis à manger halal et les boucheries arabes halal se sont multipliées.
A ce moment-là, nous avons vu, même les plus jeunes garçons, ne se saluer qu’en arabe en portant leur main sur le cœur avec respect quand, la veille, ils s’en « tapaient cinq » avec les copains en rigolant comme des bossus. Les femmes se sont mises à porter le foulard. Le foulard simple. Les pères et les frères sont devenus plus rigides avec les filles. Dans les cités ont commencé à fleurir des appartements qui étaient réservés à la prière du vendredi, les premières mosquées.
Les jeunes gens, si insouciants quelques temps avant, se réunissaient entre eux. On n’y voyait plus aucune fille dans leurs groupes. Elles ont changé leurs habitudes vestimentaires. Et surtout, elles craignaient les frères ou les copains des frères parce que c’était devenu l’affaire de tous. Ils s’épiaient, se surveillaient. Les irréductibles étaient vivement réprimandés.
Et ils ont commencé à se regrouper dans les cités. En un mouvement presque synchronisé, les rares européens qui restaient ont été obligés de partir. Ces cités sont devenues majoritairement arabo-musulmanes. Exit l’européen avec qui ils vivaient volontiers peu de temps avant. On est musulman, on reste entre nous.
Vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué ces changements dans votre entourage.
Quel était donc le message qu’ont pu véhiculer ces « prophètes » aux musulmans qui vivaient en France ?
« Vous devez (re) devenir de vrais et bons musulmans en respectant les préceptes du Coran. » Certainement, vu le changement radical qui s’est opéré à partir de leurs visites.
Sous la menace, sans aucun doute possible. Mais quelle menace ? Nous ne le saurons jamais puisque les musulmans vivant en France n’en ont jamais parlé. Par crainte de représailles, sûrement.
Mais la réalité est là. Dans la discrétion la plus totale et silencieuse, ces gens ont imposé, aux musulmans qui étaient en France, l’interdiction de vivre à l’occidentale et l’obligation de vivre selon leur us et coutumes ancestrales, c’est-à-dire selon la religion islamique.
On peut, sans se tromper, dire que la radicalisation des musulmans a commencé à cette époque.
Et elle s’est amplifiée, durcie même, jusqu’à ce que nous ayons tous les jours des différends avec eux. Pour leurs coutumes vestimentaires. Pour leur exigence d’imposer le halal. Pour leur exigence de construire des mosquées. Et ces mosquées se sont remplies !
Mais ces différends ne cesseront jamais puisqu’à chaque exigence de leur part la démocratie recule et abdique.
Et, bêtement, dangereusement, tous ces gauchistes rancis qui arborent la laïcité comme un drapeau pour les défendre n’ont pas vu et refusent de voir que c’est notre identité que les musulmans annihilent.
L’endoctrinement radical qui s’est multiplié dans toutes les couches de la communauté musulmane en a même fait des terroristes. Nous les avons vus à l’œuvre. Pourtant, les pouvoirs publics ne font rien pour l’enrayer. Au contraire, ils inventent des maux nouveaux. La radicalisation ! L’islam politique ! Le salafisme ! Mais ils ne prennent aucune décision « radicale » pour terrasser ces maux. Ces maux qui nous grignotent comme des cancers.
On continue de leur construire des mosquées où sera enseignée la loi islamique. On subventionne des écoles coraniques quand on sait qu’elles enseignent la loi coranique.
Pourtant personne, aujourd’hui, n’ignore les préceptes du Coran.
Tant que nous continuerons à appliquer nos lois démocratiques, l’islam prendra de l’ampleur jusqu’à nous ensevelir totalement.
Nous n’avons pas affaire avec une religion pieuse et anodine. Nous avons affaire à des « guerriers » qui obéissent à cette religion, la loi du Coran.
Et le Coran exige la suprématie de l’islam dans le monde.
Est-ce que c’est si difficile à comprendre ?
Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Danièle Lopez pour Dreuz.info.
Danielle Lopez
|
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens d'ajouter Petit, Clauzel, Guelât Bou Sba, Héliopolis, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Duvivier, Duzerville, Herbillon, Kellermann, Milesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Penthièvre, Randon, Kellermann et Millesimo, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
|
| Pour nos chers Amis Décédés
Nos Sincères condoléances à leur Familles et Amis
|
Envoyé par M. Pierre Courbis
Décés de Monsieur Claude Charlier
HOMMAGE
Claude CHARLIER n'est plus .
II vient de s' éteindre à Mondovi ( Algérie) à l'âge de 75 ans .
Peu le connaissait .
Il était la dernière présence pied-noire permanente dans les villages de la plaine de Bône .
A 20 ans en 1962, il reste avec ses parents âgés, agriculteurs, à Mondovi : pour eux trois, pas question de quitter cette terre algérienne qui est aussi la leur, même si la France, trahissant ses engagements, s'en est retirée .
Au décès de ses parents, dans les années 90, malgré le terrorisme islamiste, sa volonté reste la même : cette terre est la mienne, je reste ici chez moi .
Jusqu'au bout, malgré ses ennuis de santé, il refusera de gagner la France .
Hommage à cet homme rude et modeste qui resta fidèle toute sa vie à notre terre africaine et à l'esprit pionnier de nos pères .
Pierre Courbis
©§©§©§©§©§©§©
|
|
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
|
La laïcité, dernière chance des musulmans
Envoyé par Eliane
http://www.lematindalgerie.com/la-laicite-derniere-chance-des-musulmans
Par Le Matin d'Algérie 13/03/ 2018 l Par M. Sid Lakhdar Boumédiene*
Dans les deux articles qui suivent, l'auteur souhaiterait remémorer les idées qui étaient « dans les cartons » lorsque nous sommes revenus militer en Algérie, en 1991. Même si nous avions échoué, mon rôle de responsable juridique m'avait amené à préparer la réflexion sur la Constituante.
Je lis dans les réseaux sociaux que deux axes de cette tentative reviennent avec force dans les commentaires. Le premier volet présenté dans ce texte n'avait jamais été publié, ni même débattu, car nous pensions que la matrice institutionnelle de la démocratie, soit les institutions, était ce qu'il fallait mettre en avant dans le temps. Ce sera l'objet de l'article suivant.
Je commencerai donc par ce volet non abordé à l'époque. Pour cela, il faut immédiatement rappeler la confusion, ou plutôt, le mensonge perpétuellement opposé par les détracteurs de la laïcité.
Une polémique de «mauvaise foi»
Dès qu'on aborde le thème de la laïcité, c'est un vade retro satanas qui nous est brandi, suivi des menaces les plus criminelles, sans compter celles des foudres du ciel. Rappelons donc ce qui échappe à ces détracteurs de mauvaise foi qui n'ont aucune instruction ou, qui en ont une et veulent garder le privilège d'abrutir et de dominer les autres.
L'idée de la laïcité n'est pas le combat contre la religion, bien au contraire cette disposition juridique permet la protection de toutes les croyances religieuses. Son objectif est de sortir de la sphère publique une croyance pour la réserver au domaine privé. En le faisant, on permet à toutes les croyances de subsister. J'ai presque du mal à rappeler cette évidence tant elle est pourtant simple à comprendre.
Le résultat contraire aurait été que les adeptes de l'une d'entre elles, se comporteraient en despotes par rapport aux autres et même, les chasseraient par une violente répression, voire par l'élimination physique pure et simple.
C'est exactement ce qui s'est passé avec les bûchers et les crimes abominables ainsi que la terreur qui s'est abattue sur le royaume de France et bien après sa chute. La religion juive l'a payé très cher et il n'y aurait eu aucune chance, absolument aucune, pour que la religion musulmane trouve sa place en France et en Europe.
Imaginons un seul instant la France avec l'omnipotence de la tradition judéo-chrétienne (la seconde ayant finalement acquis sa place dans la douleur). Imaginons une famille Le Pen au pouvoir, puissante de l'appui de millions de citoyens croyants et pratiquants ainsi qu'avec la légitimité constitutionnelle, sans séparation de l'Église et de l'État.
Cela donne immédiatement le ton de ce que serait une nation qui n'aurait pas adopté la laïcité. Le pari de la laïcité est par conséquent celui de la protection des religions malgré leur déclin programmé.
La laïcité, une planche de salut
Si nous refaisions une introspection dans le passé, que serait-il arrivé à la religion catholique en France et ailleurs dans le monde ?
A cette époque là du début du 20è siècle, l'Église avait mis deux genoux à terre, après une longue agonie qui débuta au 16è sicle, le premier coup de buttoir au despotisme religieux. Elle allait durer quatre siècles avant la mise en place de la laïcité.
Avec ses deux genoux à terre, la laïcité fut pourtant la planche de salut à laquelle cette obédience a pu se maintenir. Aujourd'hui, l'Église est encore présente et possède un champ d'action spirituel important dans le monde. Et même si la laïcité est une spécificité française, tous les autres pays modernes dans le monde ont relégué la religion à sa stricte place spirituelle, ce qui lui a permis de continuer paisiblement à survivre. Regardons minutieusement la situation et analysons pourquoi la négociation du concordat fut la planche de salut car l'Église revenait de très loin.
Un concordat indispensable à la paix
Peut-on croire un seul instant que l'histoire aurait fait grâce à l'Église en tant qu'institution (nous ne parlons pas de la foi elle-même) si la laïcité n'avait pas sifflé la fin de la partie de démolition d'une organisation qui fut le frein à tous les développements et la cause de toutes les soumissions ?
Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les républicains voulaient « bouffer du curé » et ils avaient tous les moyens de les faire définitivement disparaître.
Sans l'accord de laïcité, penserions-nous un seul instant que les Lumières et le triomphe de la raison auraient pu continuer à permettre une croyance en un Grand Invisible dans le ciel ? Penserions-nous qu'elles auraient permis la continuation de la propagation d'histoires fantasmées comme celle des prophètes qui marchent sur l'eau ou qui séparent les eaux de la mer rouge ?
C'étaient les hôpitaux psychiatriques qu'ils auraient réservé aux croyants, à défaut d'avoir pu les extraire de la mystique par l'éducation républicaine.
De plus, penserions-nous que sans la laïcisation, les héritiers du mouvement des humanistes, soit les défenseurs des droits de l'Homme actuels, auraient laissé plus longtemps survivre une organisation qui a semé la terreur, abruti les peuples, ruiné leur richesse économique et assassiné par millions au nom d'une doctrine ?
C'était les tribunaux les plus lourdement chargés en sanction pénale qu'ils étaient en droit de proposer, comme un gigantesque Nuremberg. Ce qui a failli se faire si la raison de la laïcité ne l'avait pas emporté.
Les promoteurs de la laïcité, républicains dans l'âme, ont compris qu'ils devaient faire preuve d'intelligence et ne pas confondre la foi avec l'abrutissement et le totalitarisme. La quasi totalité des européens, particulièrement en France, avait un fond de croyance profonde à cette époque. Les républicains ont su trouver l'équilibre par un accord.
La laïcité s'est alors toujours construite du concordat, ce qui a permis à la foi de se perpétuer dans la liberté et la sérénité. Autrement, elle se serait confrontée violemment à l'avancée de l'histoire et cela aurait été sa mort définitive.
N'est-ce pas d'ailleurs ce qui s'est passé dans les régimes totalitaires communistes ? Un despotisme en a chassé un autre car il n'y a eu aucune complaisance de la part de la misère qui s'est révoltée. On sait ce qu'est la suite, pas plus favorable aux peuples et même pire.
D'ailleurs, il faut toujours rappeler au jeune lecteur que le mouvement humaniste du 16è siècle, aidé par les avancées de la science et des découvertes, s'est toujours nourri d'hommes hautement croyants, parfois des prêtres dont une partie étaient d'éminents intellectuels et savants en théologie.
Ils ont tout simplement tenté de remettre l'Homme au centre des préoccupations religieuses et revenir à l'interprétation originelle des évangiles, soit l'amour, le partage et la tolérance.
Bien entendu, il ne faut pas faire d'anachronisme, leurs idées sont encore très loin des nôtres et ils nous sembleraient aujourd'hui de terribles despotes. Mais ils ont été la graine qui a fini par germer pour aboutir, quelques siècles plus tard, aux mouvements humanistes modernes.
La leçon pour l'Islam
Si nous excluons les esprits totalement endoctrinés jusqu'à l'abrutissement fatal, il reste comme interlocuteurs tous les musulmans qui ne veulent que la paix de leur foi et de celle des autres. À ceux-là, nous disons qu'il est encore temps qu'ils réagissent pour sauver l'Islam et que sa place soit définitivement assurée dans les siècles de prospérité à venir, si cette voie de la sagesse est choisie.
Seul un esprit totalement déconnecté de la réalité historique peut penser que les gens continueront à se faire égorger comme des poulets ou se faire exploser comme un feu d'artifice au jour de l'an. Déjà, les adeptes de cette voie, dont curieusement une majorité d'anciens délinquants, commencent à réfléchir sur le sens de la promesse d'une boîte de nuit éternelle et les cent vierges proposées à l'entrée du paradis pour récompense de crimes abominables.
Beaucoup d'entre eux implorent le gouvernement français pour que leurs enfants et eux-mêmes reviennent en toute sécurité sur un territoire dont ils ont voulu assassiner le peuple pour déviance supposée.
Alors, en conclusion, les musulmans sains d'esprit et aux facultés intellectuelles intactes doivent réagir s'ils ne veulent pas subir le même sort et voir la Grande Mosquée d'Alger se transformer en reposoir pour les pigeons et de lieux de visites pour touristes. Exactement le sort des grandes cathédrales du treizième siècle, bâties par le sang, la terreur et l'argent des peuples.
Ils peuvent entamer un chemin intelligent de réformes pour un accomplissement serein dans une république laïque qui leur donnerait toute la place qui serait la leur.
Car pour les laïcs, le problème n'a jamais été la foi mais ceux qui s'en servent pour abrutir et dominer les autres.
*Enseignant
PS : rappel du propos du début, jamais ce parti n'a discuté ni entériné le dossier de la laïcité. Mais il était dans la suite logique de notre attachement à une république débarrassée du régime militaire et des théocrates. Je l'aurais tout naturellement proposé si j'étais resté dans ce parti.
M. Sid Lakhdar Boumédiene
Un marché fleurissant
Envoyé par Nicole
http://www.observalgerie.com/actualite-algerie/societe/immigration/en-algerie-lacquisition-de-la-nationalite-francaise-est-un-marche-fleurissant/
Observalgérie.com l Par M. Par khaled Bel - 13/03/ 2018
En Algérie l’acquisition de la nationalité française est un marché fleurissant
La polémique enfle en Algérie. Des organismes et des bureaux spécialisé dans l’accompagnement des algériens désirant réintégrer et/ou acquérir la nationalité française, poussent comme des champignons, dont des enseignes qui mettent de grands moyens pour s’accaparer le marché juteux.
La crise économique et la hausse du nombre d’Algériens désirant émigrer, a réanimé le marché, jadis investit par des avocats et des écrivains publics. Cependant, la polémique enfle sur de présumées arnaques d’organismes profitant du désespoir des algériens.
Plusieurs médias accusent le malheureux candidat à l’externalisation des demandes de visas pour la France «Securidoc», de promettre des mirages aux algériens désirant acquérir la nationalité française. Le Bureau d’Aide à la Nationalité Française ouvert par ladite société propose un pack de services dans le cadre d’une convention avec le client, pour objectif de décrocher un «décret de naturalisation».En revanche, la société en question nie vouloir proposer un service lié à l’Etat français mais un service de consultation électronique indépendant.
Les prix pratiqués par la majorité des organismes spécialisés en la matière s’élèvent à 20000 dinars algériens pour la démarche de demande du Certificat de nationalité française (CNF). Des démarches judiciaires sont proposées en cas de refus, avec des tarifs élevés allant jusqu’à 4000 à 5000 euros, en faisant appel à des avocats en France.
M.M
Oran, Mostaganem… : on déteste ce pays !
Envoyé par Pierre
http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5257928&archive_date=2018-03-05
Le Quotidien d'Oran Par Kamel DAOUD - 05/03/ 2018
A Mostaganem, à l’ouest du pays, un bidonville tout neuf. Il s’est installé, là, entre nuit et lune, sur un terrain agricole à l’entrée sud de la ville. C’est l’effet d’appel de la rente et des logements sociaux. C’est la nouvelle méthode de chantage au social. Le régime « tient » la population par la promesse de logement, il en obtient votes et soumission; les demandeurs « tiennent » le régime par la demande de logement gratuit, le bidonville et les constructions illicites ou le blocage des routes. Juste à côté, une immense mosquée, hideuse, en deux ou trois étages. C’est la troisième donne de l’équation algérienne : le religieux comme occupation de l’espace, de l’esprit, du bras, avant-bras, tête et vision du monde.
La ville de Mostaganem, ses villages, sont devenus d’une saleté repoussante. Il n’y a qu’à s’y promener pour en avoir le cœur en semelle. On compare alors, sans cesse, la mémoire de l’enfance et le champ traversé de sachets en plastique, de déchets de chantiers. Et revient cette interrogation métaphysique : pourquoi ce peuple construit des mosquées partout, à bras-le-corps, sans esthétique ni architecture, et ne s’occupe ni de la saleté ni du travail, de la justice ou de la légalité, de l’école et de donner des noms aux étoiles ? Il y a une mosquée inachevée chaque cent mètres presque et surtout près des plages, dernier lieu de refuge du corps et de son droit au bronzage. Bien sûr, on va crier à l’impiété du chroniqueur parce qu’il parle de hideur des mosquées, de leur surnombre comparé aux entreprises, usines et fabriques, de l’insouciance face à l’écologie mais de l’obsession face au rite. C’est chose habituelle et facile de se réfugier derrière le dogme pour ne pas avoir à assumer le réel et de lyncher le premier qui parle de nos défaites. Et pourtant, il faut le dire : il y a trop de mosquées monstrueuses, construites n’importe comment, partout, sans arts ni utilité, destinées au vide et à apaiser les consciences. Et il n’y pas d’entreprises, de campagne pour un pays vert et propre, pour la santé de nos enfants, les loisirs, la joie et la vie. Triste tableau des villages traversés où s’adosser au mur et regarder la route est le seul pendant à la prière aveugle et hâtive. Eucalyptus coupés, stationnement en mode chamelle et pagaille et visages soupçonneux. Le pays est sans bonheur. Au village natal du chroniqueur, une grande salle au centre : « la salle des fêtes ». On s’en sert uniquement pour les obsèques et enterrements. Cela résume tout.
En ville, à Mostaganem, de même qu’à Oran, la nouvelle mode : des affichettes sous les « feux rouges » qui vous appellent à consacrer le temps de l’attente à la prière et au repentir. On rêve alors d’un pays où on appelle à ne pas jeter ses poubelles par les vitres de sa voiture, où on appelle à ne pas salir et cracher, insulter et honnir, qualifier de traître toute personne différente et ne pas accuser les femmes en jupes de provoquer les séismes. On rêve de respect de la vie, des vies. Mais ce n’est plus le but de la nation. La nation veut mourir pour mieux vivre dans l’au-delà, plutôt que construire un pays, une souveraineté, une puissance. On rêve de prier et de mourir. On rêve de mosquées à chaque dix pas pour ne pas avoir à faire dix pas debout sur ses propres jambes. On rêve que Dieu fasse la pluie, les courses du marché, la guerre, la paix, la santé, les hôpitaux, la Palestine, les victoires, les récoltes et les labours, pendant qu’on regarde descendre du ciel des tables garnies. On ne rêve pas, on attend, pendant que les Chinois travaillent. Les Turcs l’ont bien compris au demeurant : ils ont offert à Oran une grosse mosquée (encore une autre tout près de celle de Ben Badis) et se sont fait offrir une gigantesque entreprise de rond à béton. Les Turcs ont offert une mosquée, pas un hôpital, pas une école de formation pour le transfert du savoir-faire, pas une université. Non, juste une mosquée. Nous, on va prier et eux vont construire leur puissance.
Ces mosquées sont construites dans une sorte de zèle, parfois par des hommes d’affaires soucieux de se blanchir les os et le capital. Elles sont laides comme celle construite en haut de Santa Cruz, à Oran, servant juste à sanctifier un promoteur oranais, indécente de disgrâce et de pauvreté. Elles sont partout et le travail et le muscle ne sont nulle part. Et pourtant, on laisse faire l’affiche et l’architecte idiot. On ne demande pas d’autorisation, on n’a pas la foi sourcilleuse et la légalité en alerte. Aucun administrateur n’aura le courage de s’y opposer. On en aura pour fermer des locaux d’associations féministes à Oran. Là, le DRAG a du zèle en guise de courage et de la puissance. On a de la vaillance pour fermer deux églises car c’est plus facile, c’est du djihad et de la bravoure. On prétextera des agréments qu’on refuse de donner et de la fermeté qu’on n’a pas devant les affichages illégaux. Une question de muraille et de courte muraille selon nos proverbes.
Le mauvais goût national
On rêve. Je rêve de ce moment où on aura une entreprise algérienne chaque dix mètres, un appel à respecter la propreté de ce pays sous chaque feu rouge, une loi qui aura la même force face à une association de défense des droits de femmes que face à une zaouïa servile ou une mosquée clandestine ou une association islamiste. On rêve d’un pays, pas d’une salle d’attente qui attend l’au-delà pour jouir du gazon au lieu de le nourrir ici, sous nos pays, pour nous et nos enfants. On rêve et on retient, tellement difficilement, ce cri du cœur : pourquoi avoir tant combattu pour ce pays pour, à la fin, le maltraiter si durement ? Pourquoi avoir poussé nos héros à mourir pour transformer la terre sacrée en une poubelle ouverte ? Pourquoi avoir rêvé de liberté pour en arriver à couper les arbres et inonder le pays de sachets en plastique ?
Retour. Encore des villages, des moitiés de villes aux constructions inachevées, des hideurs architecturales, entre pagodes, bunkers, fenêtres étroites alors que le ciel est vaste, ciments nus, immeubles érigés sur des terres agricoles au nom du « social », urbanisme de la dévastation. La crise algérienne, sa douleur se voit sur ses murs, son urbanisme catastrophique, son irrespect de la nature. Les années 90 ont été un massacre par la pierre et le ciment. Le « social » des années 2000 a consommé le désastre. Au fond, nous voulons tous mourir. Camper puis plier bagage. C’est tout.
Arrivée près d’une plage à Mers El Hadjadj. Plage d’une saleté repoussante, inconcevable. On comprend, on a l’intuition d’une volonté malsaine de détruire les bords de mer, le lieu du corps et de la nature et de le masquer par des minarets et des prières. Car il y a désormais une mosquée à chaque plage. Insidieuse culpabilisation. Egouts en plein air. Odeurs nauséabondes. On conclut à une volonté nette de détruire ce pays et de le remplacer par une sorte de nomadisme nonchalant. Non, c’est une évidence : on n’aime pas ce pays, on s’y venge de je ne sais quel mal intime. Tout le prouve : la pollution, le manque de sens écologique, l’urbanisme monstrueux, la saleté, les écoles où on enterre nos enfants et leurs âmes neuves pour en faire des zombies obsédés par l’au-delà. Oui, c’est une volonté, on veut tuer cette terre. Et pendant ce meurtre, on ne trouve rien de mieux à faire que de s’attaquer à deux associations féministes à Oran. Bousculades, mots dans la tête, le cœur qui a mal, la main qui tremble sur le clavier. Tellement mal après juste une balade le long d’une route côtière. A revisiter les villages de son enfance devenus des cités-dortoirs et de mosquées défouloirs, des décharges publiques aux arbres coupés. Mais où est notre rêve de puissance et de liberté ? Pourquoi on veut tous mourir pour aller au paradis en fabricant un enfer pour nos descendants ? Pourquoi on veut tous construire des mosquées et pas un pays ? D’où vient cette maladie qui nous a conduits à nous tuer, tuer nos différences, tuer nos enfants qui ne sont pas encore nés et tuer le temps ?
Oran. La ville s’étend vers l’Est et mange ses terres et ses récoltes. Immeubles en cohortes. Procession vers le vide. Cannibalisme de la terre. Il y a de l’irréparable dans l’air. Près d’une cité-dortoir, sous un feu rouge, la même affiche « occupe ton attente par la prière ! » Le pays est une grande mosquée construite par des Chinois, meublée par l’Occident, ravagée par les racines et destinée à surveiller le corps et la lune. On y prie pendant que les Turcs travaillent, le monde creuse et conquiert, les nations se disputent les airs et les cieux.
Kamel DAOUD
PÔLE URBAIN KALITOUSSA DE BERRAHAL (ANNABA)
Envoyé par Alain
https://www.liberte-algerie.com/est/des-logements-sociaux-detournes-288799
Liberté Algérie Par B. Badis -12/03/ 2018
Des logements sociaux détournés
Entre sous-location et vente en deuxième main, le trafic bat son plein.
Plus de 30% des logements attribués sont vendus et 20% loués illicitement.
Plus de 30% des logements sociaux attribués jusqu’ici sur un programme de 6 820 unités au nouveau pôle urbain Kalitoussa de Berrahal (Annaba) auraient été déjà écoulés clandestinement, révèle une source crédible. Les prix de vente varient entre 300 et 400 millions de centimes, précise la même source. Ici l’on pointe un doigt en direction des ex-locataires principalement du chef-lieu de la commune de Annaba, notamment ceux d’El-M’haffeur, ainsi que Bouhamra et Sidi Salem (commune d’El-Bouni). Par ailleurs, nous apprenons de même source que 20% des appartements sont loués également de manière clandestine. Autres maux qui rongent aussi le site Kalitoussa, les maisons de rendez-vous.
De bénéficiaires des logements vendus auraient jeté leur dévolu sur les constructions illicites, implantées aux abords du chef-lieu de la commune de Annaba.
La majorité de ces constructions est essentiellement localisée dans la plus importante agglomération de Annaba, à savoir la daïra d’El-Bouni, sinistrement surnommée la ville des “mille et une bicoques”. Devant l’absence quasi totale des pouvoirs publics, la situation a atteint, de nos jours, des proportions alarmantes. Les localités de Saroual, Oued Nil, Chabbia et Kherraza, mitoyennes de l’autoroute Annaba-Berrahal, sont les plus ciblées par le phénomène tout aussi embarrassant de la construction illicite. L’anarchie ambiante et la déliquescence des institutions de l’État qui s’étalent au grand jour ont fait que des terres – tous statuts confondus – sont livrées à un véritable “pillage”. Un événement qui s’expliquerait par l’absence de réaction, voire l’implication du service technique de l’APC et des gestionnaires, et ce phénomène s’est transformé en “boîte de Pandore”.
Une situation qui s’est prolongée favorisant bien des dépassements à travers l’ensemble de ses localités, et qu’il sera très dur de redresser au vu des abus constatés, avouent des membres de certaines APC. Pour s’enquérir de la gravité de la situation, il suffit de faire une balade aux lisières des deux versants pour constater de visu “la catastrophe”.
De par sa situation géostratégique et de l’attrait qu’elle a suscité au début des années 2000, l’ex-Sonatiba a fait l’objet d’un trafic gigantesque du foncier. Certains parlent d’une véritable “ruée” sur les poches constructibles avec et sans l’aval des responsables locaux. Depuis, la situation s’est sérieusement dégradée et serait devenue incontrôlable, assure-t-on. “Le nombre des constructions illicites érigées ces cinq dernières années, notamment à Oued Nil et sur les hauteurs de Kherraza et Chabbia, dépasse et de loin celui réalisé depuis l'indépendance”, estiment des riverains. Le visiteur ne peut qu’être impressionné par le nombre de bâtisses réalisées sur des terres domaniales et forestières avec piliers et dalles en béton, mais n’ayant pas le moindre document autorisant leur construction. Le lieu choisi pour ce type d’habitat est généralement situé loin des regards indiscrets, autrement dit des terrains propices à l’implantation de constructions. Cependant, la complicité du service technique dans ce genre de situation est de mise. Aujourd’hui, le trafic du foncier attire les gens tels des charognards autour d’une proie.
B. BADIS
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci-dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la Seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
|
De M. Henry-Jean Fournier
Chers Lecteurs de la Seybouse,
Officier général en retraite, je travaille, depuis quelques années, sur la guerre d'Algérie (je suis notamment le président d'une association vouée à la recherche des militaires français portés disparus en Algérie - SOLDIS) et, à plusieurs reprises, j'ai été amené à m'intéresser à cette zone partculière que l'on appellait l'inter-barrage, comprise entre la ligne MORICE et la ligne CHALLE, à la frontière tunisienne.
Selon les informations que j'ai pu réunir, je constate en effet que cette zone, souvent présentée par les récits d'Anciens combattants d'Algérie, comme un "no man's land" dangereux, était en fait habitée par la population, dans les villages et que les agriculteurs y travaillaient dans leurs champs et dans les villages de cette région (Lamy - Lacroix par exemple)
Mais je n'ai pas trouvé de témoignages précis relatant ce genre de vie, qui devait quand même présenter certaines contraintes, du fait du contrôle exercé pour le franchissement des barrages.
J'aimerais donc bien avoir, si cela est possible, des témoignages expliquant comment les gens vivaient, comment ils se déplaçaient, comment ils pouvaient travailler ?
Comment ressentaient-ils les menaces potentielles créées par les tentatives de franchissement des barrages et les harcèlements nocturnes ?
Quelles étaient leurs relations avec l'armée française ? avec la population de souche nord-africaine?
La population était-elle contrainte à des mesures de sécurité (couvre-feu, garde des maisons, etc...)?
Comment allait-on d'un village à l'autre ? Librement ou en convoi ?
Connaissait-on le problème des réfugiés installés en Tunisie ?
ETC....
Espèrant que vous et que vos amis auront des souvenirs susceptibles d'éclairer ces différents points. Vous pouvez leur donner mes coordonnées et je vous remercie d'avance de votre aide. Et merci à M. BARTOLINI de m'avoir répondu et orienté vers "Le Petit Callois"...
Avec mes salutations très cordiales
Général Henry-Jean FOURNIER
PS - ci-joint : un document d'infos sur SOLDIS
Mon adresse est, (cliquez sur) : henry-jean.fournier@wanadoo.fr
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Mars 2018
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
http://piednoir.fr/guelma
|
|
L’allégorie du serpent
racontée par Donald Trump :
Envoyé par Eliane
|
En allant travailler un matin, sur le chemin le long du lac
Une femme, au cœur tendre, vit un pauvre serpent à moitié gelé.
Sa belle peau colorée de serpent était couverte de givre de rosée.
Oh ! s’écria-t-elle : « Je vais te prendre et m’occuper de toi »
« Prends-moi oh douce femme. Prends- moi, pour l’amour du ciel »
« Prends-moi, oh douce femme », soupira le serpent vicieux.
Elle l’enveloppa bien confortablement dans une couverture de soie.
Puis, le déposa près de la cheminée et lui offrit de miel et du lait.
Elle se dépêcha de rentrer à la maison ce soir-là.
Dès qu’elle arriva, elle vit que le joli serpent, dont elle avait pris soin, était rétabli.
« Prends-moi oh, oh douce femme »
« Prends-moi pour l’amour du ciel ».
« Prends-moi, oh douce femme » soupira le serpent vicieux.
Elle le serra fort contre sa poitrine. « Tu es si beau » lui dit-elle.
« Mais, si je ne t’avais pas ramené, tu serais mort maintenant. »
Puis, elle caressa sa jolie peau, l’embrassa et le tint serré dans ses bras.
Mais, au lieu de la remercier, le serpent la mordit violemment.
« Prends-moi dans tes bras, oh douce femme. Prends-moi, pour l’amour du ciel. »
« Prends-moi, oh douce femme » soupira le serpent vicieux.
« Je t’ai sauvé » cria la femme « Et tu m’as mordu, pourquoi? »
« Tu savais que ta morsure était empoisonnée et maintenant je vais mourir. »
« Oh, tais-toi, femme stupide », dit le serpent avec un sourire.
« Tu savais pourtant bien que j’étais un serpent avant de m’accueillir ! »
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
|
|
 C'est à Rovigo, village de colonisation, fondé en 1850, qu'est né l'auteur des "Chevaux du soleil" Jules ROY. Il avait quatre ans quand son père le gendarme ROY apprend qu'il est le fruit d'une relation adultère et chasse la mère et le fils qui trouveront refuge chez les grands-parents maternels les PARIS à Sidi Moussa où son grand-père avait obtenu une concession vers 1854. Celui-ci avait construit une ferme composée de quatre murs grossiers, deux pignons et un mur de refend séparant la maison d'habitation de l'étable-écurie, le tout couvert de tuiles mécaniques. La maison surélevée à cause des inondations comprenait la salle à manger avec une longue table en bois patinée par l'âge et la cire, des bancs, deux ou trois chaises, des images naïves (Jean qui pleure et Jean qui rit), des calendriers offerts par les moissonneuses Mac Cormick, et, chose rare, une cheminée en souvenir de la Franche-Comté natale ; une chambre celle des grands-parents, une autre plus petite et une cuisine. L'eau, il fallait la chercher au puits dans l'arrosoir. Derrière la cave, assez vaste, avec des cuves de ciment et beaucoup de choses utiles. Le second corps abritait les bœufs et les chevaux. Devant une dizaine de noyers ramenés de Franche-Comté. Superbes et qui donnaient beaucoup de noix. Les PARIS n'étaient pas riches, ils avaient qu'une modeste orangeraie, protégée du vent par une haie de cyprès, 10 à 12 hectares de vignes et un peu de céréales pour les bêtes.
C'est à Rovigo, village de colonisation, fondé en 1850, qu'est né l'auteur des "Chevaux du soleil" Jules ROY. Il avait quatre ans quand son père le gendarme ROY apprend qu'il est le fruit d'une relation adultère et chasse la mère et le fils qui trouveront refuge chez les grands-parents maternels les PARIS à Sidi Moussa où son grand-père avait obtenu une concession vers 1854. Celui-ci avait construit une ferme composée de quatre murs grossiers, deux pignons et un mur de refend séparant la maison d'habitation de l'étable-écurie, le tout couvert de tuiles mécaniques. La maison surélevée à cause des inondations comprenait la salle à manger avec une longue table en bois patinée par l'âge et la cire, des bancs, deux ou trois chaises, des images naïves (Jean qui pleure et Jean qui rit), des calendriers offerts par les moissonneuses Mac Cormick, et, chose rare, une cheminée en souvenir de la Franche-Comté natale ; une chambre celle des grands-parents, une autre plus petite et une cuisine. L'eau, il fallait la chercher au puits dans l'arrosoir. Derrière la cave, assez vaste, avec des cuves de ciment et beaucoup de choses utiles. Le second corps abritait les bœufs et les chevaux. Devant une dizaine de noyers ramenés de Franche-Comté. Superbes et qui donnaient beaucoup de noix. Les PARIS n'étaient pas riches, ils avaient qu'une modeste orangeraie, protégée du vent par une haie de cyprès, 10 à 12 hectares de vignes et un peu de céréales pour les bêtes.
 Henri DUNANT, un suisse, pense que l'Algérie est un nouvel Eldorado. En 1858 il emprunte de l'argent à des banquiers genevois pour fonder la Société financière et industrielle des moulins de Mons-Djemila à Saint-Arnaud après avoir constaté que la population de Sétif était obligée de fabriquer sa farine elle-même. Mais l'autorisation de l'exploitation d'une chute d'eau pour faire fonctionner le premier moulin moderne n'arrive pas car les législations sur les cours d'eau et les terres ne sont pas claires et les autorités coloniales compétentes ne se montrent guère coopératives. En vue d'acquérir gratuitement à une concession agricole pour faire pousser du blé, il prend en 1858 la nationalité française.
Henri DUNANT, un suisse, pense que l'Algérie est un nouvel Eldorado. En 1858 il emprunte de l'argent à des banquiers genevois pour fonder la Société financière et industrielle des moulins de Mons-Djemila à Saint-Arnaud après avoir constaté que la population de Sétif était obligée de fabriquer sa farine elle-même. Mais l'autorisation de l'exploitation d'une chute d'eau pour faire fonctionner le premier moulin moderne n'arrive pas car les législations sur les cours d'eau et les terres ne sont pas claires et les autorités coloniales compétentes ne se montrent guère coopératives. En vue d'acquérir gratuitement à une concession agricole pour faire pousser du blé, il prend en 1858 la nationalité française.
 Henri BORGEAUD n'eut qu'un seul vice, celui de la politique Il eut même quelques possibilités d'être pressenti pour la présidence de la République et c'est sur forte insistance de sa femme qu'il refusa.
Henri BORGEAUD n'eut qu'un seul vice, celui de la politique Il eut même quelques possibilités d'être pressenti pour la présidence de la République et c'est sur forte insistance de sa femme qu'il refusa.


.jpg)















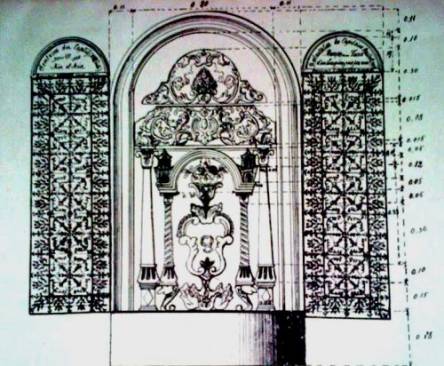












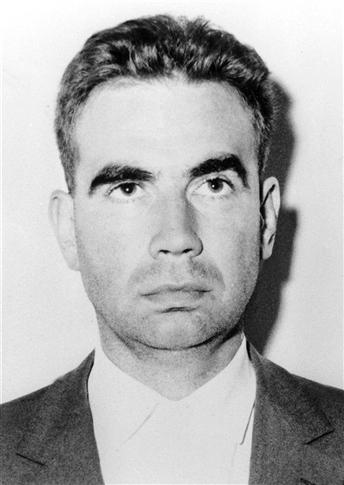 Il y a exactement cinquante ans, le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry rendait son ultime souffle face à un peloton d’exécution. Il avait été condamné à mort le 4 mars précédent par le tribunal militaire de justice pour son implication dans l’attentat du Petit-Clamart commis le 22 août 1962. Bastien-Thiry dirigea le commando qui cribla de balles la DS présidentielle sans faire de blessés. Il avait alors utilisé un journal qu’il avait agité afin d’indiquer à ses hommes le moment où il leur fallait tirer. Durant le procès, il tint tête à ses juges, revendiquant son acte en raison de ce qu’il estimait être une trahison du président de Gaulle envers les français d’Algérie et les harkis ainsi que pour la défense de l’Algérie française. Il sera arrêté en septembre 1962 après son retour d’une mission en Angleterre. Il fut défendu par les avocats Dupuy, Le Coroller, Isorni et Tixier-Vignancourt. Ceux-ci tentèrent de sauver sa tête en se basant sur une expertise médicale démontrant qu’il n’avait pas toute sa raison au moment de l’attentat, mais Bastien-Thiry refusa ce recours et préféra affronter son destin. Ce qu’il fera dignement et courageusement. Il entra ainsi dans l’histoire comme étant le dernier condamné à mort fusillé de l’histoire de France. De Gaulle aurait dit à son sujet : « Celui-là, ils pourront en faire un martyr ». Le général aurait refusé sa grâce essentiellement par ce qu’il mit en danger la vie de sa femme Yvonne et parce qu’il n’avait pas pris de risque personnel dans l’opération. Les deux tireurs, Alain de La Tocnaye et Jacques Prévost, également condamnés à mort, furent graciés par le chef de l’État.
Il y a exactement cinquante ans, le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thiry rendait son ultime souffle face à un peloton d’exécution. Il avait été condamné à mort le 4 mars précédent par le tribunal militaire de justice pour son implication dans l’attentat du Petit-Clamart commis le 22 août 1962. Bastien-Thiry dirigea le commando qui cribla de balles la DS présidentielle sans faire de blessés. Il avait alors utilisé un journal qu’il avait agité afin d’indiquer à ses hommes le moment où il leur fallait tirer. Durant le procès, il tint tête à ses juges, revendiquant son acte en raison de ce qu’il estimait être une trahison du président de Gaulle envers les français d’Algérie et les harkis ainsi que pour la défense de l’Algérie française. Il sera arrêté en septembre 1962 après son retour d’une mission en Angleterre. Il fut défendu par les avocats Dupuy, Le Coroller, Isorni et Tixier-Vignancourt. Ceux-ci tentèrent de sauver sa tête en se basant sur une expertise médicale démontrant qu’il n’avait pas toute sa raison au moment de l’attentat, mais Bastien-Thiry refusa ce recours et préféra affronter son destin. Ce qu’il fera dignement et courageusement. Il entra ainsi dans l’histoire comme étant le dernier condamné à mort fusillé de l’histoire de France. De Gaulle aurait dit à son sujet : « Celui-là, ils pourront en faire un martyr ». Le général aurait refusé sa grâce essentiellement par ce qu’il mit en danger la vie de sa femme Yvonne et parce qu’il n’avait pas pris de risque personnel dans l’opération. Les deux tireurs, Alain de La Tocnaye et Jacques Prévost, également condamnés à mort, furent graciés par le chef de l’État.
 Rendons un hommage tout particulier au Colonel Basien-Thiry, héros et martyr de la Patrie, fusillé il y a aujourd’hui 50 années, le 11 mars 1963.
Rendons un hommage tout particulier au Colonel Basien-Thiry, héros et martyr de la Patrie, fusillé il y a aujourd’hui 50 années, le 11 mars 1963.



 "Je sens peser sur mes épaules misérables le poids démesuré du plus glorieux des héritages. A moi, qui ne suis rien et qui n'apporte rien, la civilisation fait un cadeau gigantesque : le patrimoine de l'Europe. Il est fait de trésors et de souvenirs.
"Je sens peser sur mes épaules misérables le poids démesuré du plus glorieux des héritages. A moi, qui ne suis rien et qui n'apporte rien, la civilisation fait un cadeau gigantesque : le patrimoine de l'Europe. Il est fait de trésors et de souvenirs.