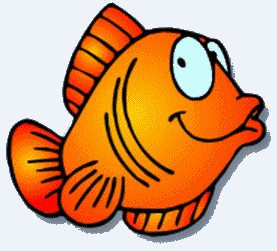|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
175, 176,
177, 178, 179,
180, 181, 182,
183, 184,
| |
|
EDITO
Le temps de repos
La Seybouse vit au rythme de l'année scolaire qui comme chaque année s'achève fin juin et marque une étape dans son long cours, qui est le repos estival.
Après un mois de juin très maussade, l'été est arrivé avec force cette année et ce n'est pas pour déplaire aux vacanciers. Mais qui dit été, dit farniente, couché dans un transat, les pieds en éventail, avec une boisson fraîche à vos cotés en train d'écouter les oiseaux. Pour certains d'entre-vous, vous profitez de ce temps libre pour lire et relire la Seybouse et vous nourrir de cette mémoire qui nous est si précieuse. La bibliothèque virtuelle de la Seybouse est riche et vaste pour les lecteurs.
L'été, c'est aussi l'occasion de s'intéresser à autre chose. Il est heureux de se reposer, se détendre, vivre des rencontres, visiter, accueillir, voir un bon film, visionner des photos, marcher, méditer.
Encore une fois, notre joie vient de la certitude d'être aimés par notre famille quelle soit naturelle ou composée d'amis sincères et dévoués qui peut faire de chaque personne le partenaire de son Alliance d'amour ou Amicale.
Cette joie, nous ne pouvons pas la savourer pour nous tout seuls. Elle est faite pour être partagée. C'est une joie propice, créatrice de rencontres, de cousinades, de retrouvailles, une joie qui ouvre pour tout le monde des chemins d'espérance dans ce monde truffé de fous et de politiciens qui nous le pourrissent.
Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur implication dans le cours de la Seybouse en oeuvrant tout au long de l'année à mes cotés. Mais je remercie aussi chacun d'entre vous pour la confiance que vous nous manifestez. Je vous retrouve toujours aussi nombreux à chaque sortie de Numéro de la Seybouse, et le succès de la revue (gratuite) avec toujours des nouvelles demandes d'adhésion qui témoignent de l'ambiance de notre communauté dans laquelle il fait bon vivre et où la mémoire est primordiale !
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Amicalement votre.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
ORAN 5 JUILLET 1962
Envoyé Par M. Hugues Jolivet
|

Commémorons, cinquante et six années plus tard,
L'odieux holocauste d'Oranais sans défense,
D'hommes, femmes et enfants victimes de racontars,
Offerts sur l'autel des dieux de l'Indépendance.
Accuser les Pieds Noirs de troubler leur victoire
Par des tirs sur leur peuple, en liesse, triomphant,
Est un fait démenti, en témoigne l'Histoire,
La barbarie régnait aux quatre coins d'Oran.
Résultat d'une lutte FLN - ALN,
Avec pour seul objet un accès au Pouvoir,
Provoque le soulèvement et déchaîne la haine
Contre tous les Français qu'ils ne veulent plus voir !
S'ils n'ont pas fait le choix de prendre la valise,
Leurs bourreaux, ce jour là, ont choisi le cercueil,
Ils veulent vivre sans eux, donc ils les neutralisent,
En les assassinant sans honte, nourris d'orgueil.
Des parents pleurent encore leurs morts, leurs disparus,
Sans nouvelles depuis lors, n'ayant pu faire leur deuil,
Regrettent que notre Armée, qui n'est pas accourue,
Soit aussi responsable de centaines de linceuls.
Hugues JOLIVET
25 juin 2018
|
|
|
"La France doit reconnaître le massacre d'Oran"
Envoyé Par M. Pierre Latkowski
|
|
Var Matin - 04/07/2018
INTERVIEW. Georges-Marc Benamou : "La France doit reconnaître le massacre d'Oran"
Dans un documentaire présenté en avant-première jeudi 5 juillet à Nice, Georges-Marc Benamou dénonce la "coalition du silence" qui continue de peser sur ce jour sanglant 56 ans après.
Cinq juillet 1962. Une chaleur de plomb étouffe Oran la radieuse. C'est la date choisie pour célébrer l'indépendance flambant neuve de l'Algérie.
Ce devait être un jour de fête. C'est devenu un jour de sang et de mort: 700 pieds noirs, chrétiens et juifs, ont été massacrés, enlevés, jetés dans des charniers. Paris savait. Le général De Gaulle savait. Il a donné l'ordre aux militaires français de ne pas intervenir. La France a fermé les yeux et les livres d'histoire.
Cinquante-six ans après, Georges Marc Benamou et Jean Charles Deniau revisitent ce "trou noir" de l'Histoire dans un documentaire intitulé Oran, ce massacre oublié et présenté en avant-première à Nice ce jeudi au Centre universitaire méditerranéen.
Oran, ce massacre oublié, c'est l'histoire du dernier grand mystère de la guerre d'Algérie…
"C'est l'équivalent de la peste qui s'est abattue sur la ville la plus douce d'Algérie. C'est un scandale. Un trou noir entre la fin de la guerre d'Algérie et le début de la révolution algérienne dit l'historien niçois Alain Gérard Slama. Une Saint-Barthélemy totalement enfouie, niée par le pouvoir français comme par le pouvoir algérien. En France, on n'a pas pris au sérieux cette histoire. Il y a eu une coalition du silence de la droite gaulliste et de la gauche anticolonialiste.
C'est un mensonge d'État comme on a menti sur les harkis. Selon le pouvoir gaulliste, il y a eu vingt morts. Les historiens ont montré qu'en fait, il y en a eu 700. C'est la journée la plus meurtrière de la guerre d'Algérie.
Mais idéologiquement cette journée ennuie tout le monde. Cela reste une tache pour le pouvoir français et pour une partie des révolutionnaires algériens."
Pourquoi ce documentaire ?
"J'ai décidé d'ouvrir tous les placards de l'Histoire de France, notamment ceux de la guerre d'Algérie. Comme j'ai été un des premiers à dénoncer le massacre scandaleux du 17 octobre 1961 perpétré par la police de Papon, je dénonce le massacre d'Oran. Je trouverais normal, légitime, minimum, qu'il y a ait enfin une reconnaissance de la République. Il faut en finir avec l'hémiplégie de l'Histoire. Il faut faire parler toutes les mémoires."
Comment avez-vous travaillé ?
"Depuis une quinzaine d'années, grâce aux travaux des historiens Jean Monneret et de Jean-Jacques Jordi, grâce à mon livre Un mensonge français , on commence à lever le voile. Ce documentaire est un travail d'enquête et d'investigation apolitique et approfondi. Avec Jean-Charles Deniau, nous avons instruit pour la première fois un dossier étayé et sérieux, un travail nourri de documents longtemps classés secret défense et révélés pour la première fois. Un travail bâti autour de témoignages."
Il y a aussi le témoignage de l'adjoint du général Katz qui représentait De Gaulle à Oran à l'époque des faits et qui continue de nier l'ampleur du massacre envers et contre les historiens…
"Il est aujourd'hui stupéfiant d'entendre un haut fonctionnaire français dire: "Les pieds noirs n'ont eu que ce qu'ils méritaient: leur petit massacre". L'État doit répondre! On ne peut rien faire contre la mauvaise foi du gouvernement algérien mais on peut reconnaître que le gouvernement de De Gaulle a couvert ce massacre d'État. La France a dit: "On ne va pas sauver les Français car sinon on relance la guerre". Cette raison d'État a broyé des centaines de vies. Je suis en colère. Ce De Gaulle là est au comble du cynisme assassin quand celui du 18-Juin est admirable."
La France a abandonné les pieds-noirs mais qui a tiré sur la foule ?
"La question de la préméditation reste un angle mort de cette histoire. Les commandos de l'OAS étaient partis à ce moment-là. On ne peut pas exclure l'influence d'un clan politique à l'intérieur de l'armée algérienne et une sorte d'exultation mortifère contre le colonisateur."
Oran, c'est aussi une partie de votre histoire personnelle ?
"Oran et sa wilaya (région, Ndlr), ce sont des paysages d'enfance mais ma vraie attache c'est la Méditerranée. Moi, j'ai eu la chance de quitter l'Algérie en juin 1962 en avion. J'ai grandi à Nice. On habitait près de la fac de science à Valrose. J'ai été au lycée du Parc impérial à la fac de droit où j'ai obtenu mon diplôme d'avocat. J'ai vécu une très belle jeunesse. J'ai quitté cette ville en 1980 mais j'y reste très attaché. Ma mère y habite toujours. Nice a changé, elle est plus fun que quand j'étais étudiant. Elle a rajeuni, mué sans s'enlaidir."
Comment sortir de l'histoire passionnelle de la guerre d'Algérie ?
"Une des solutions, c'est de dire toutes les vérités gênantes. Dire ce qui s'est passé à Sétif, au congrès de la Soummam (réunion des dirigeants de la révolution algérienne en 1956, Ndlr). Dire la vérité sur les divisions du FLN, sur les dessous de la bataille d'Alger. Ce n'est que comme ça qu'on arrivera à une mémoire commune. Certains écrivains algériens font la passerelle: Boualem Sansal, Kateb Yacine, Kamel Daoud ou encore Yasmina Khadra. Alice Zeniter aussi pour les écrivains français. C'est davantage par les écrivains que par les politiques qu'on trouvera une issue."
|
|
|
LE MUTILE N° 51 du 5 mai 1918 (Gallica)
|
|
La première victime des Allemands en Algérie
Si Corneille a pu dire que "la valeur n'attend pas le nombre des années". Nous devons compléter prosaïquement le fameux vers quoique nos héros à cheveux blancs méritent infiniment plus que de la prose : "La valeur, ajouterons-nous, ne succombe pas non plus au nombre des années, "
C'est que cette guerre sans précédent ni comparaison possible dans le passé a fait jaillir de tous les âges comme de tous les cœurs un commun et égal héroïsme, où s'exprime le fond séculaire de notre race et dans des vieillards notre vieille vocation sans cesse, rajeunie qui est "proprement la vocation du sublime ". Ce propos d'Eschyle, vieux soldat lui-même, s'applique mieux, encore, aux Français de 1918 qu'aux Athéniens de - 490 avant notre vie, comme les Perses antérieurs au Christ étaient moins barbaresque les pseudo-chrétiens évangéliques dont l'épée n'est pas une croix mais un outil de boucherie et dont le casque à pointe ne surmonte que de lourdes cervelles fumeuses hantées par les seules images du meurtre lâche et stupide, garnies par la seule obsession de la boue trempée de sang. Marathon auprès dé la Marne ne lut qu'une courtoise partie de tennis un peu chaude et un peu rouge ; Herscès, auprès de Guillaume II, fut un parfait gentilhomme.
Oui, si Corneille nous revenait, tiré de son tombeau par le son horrible et divin de la nouvelle et inimitable Epopée, combien de rythmes variés, supérieurs, s'il se peut, à ceux du Cid ne frapperait-il pas sur sa fière enclume, pour célébrer les Rodriguez à tête chenue, avec les enfants improvises hommes, et quels hommes ! les fronts labourés des stigmates de la vie, ployés aux ombres du soir avec les fronts vierges dès souffles mauvais et dressés vers les baisers de l'aurore.
Héros magnifiés, héros ignorés, héros oubliés, il n'importe. Vous êtes tous notre gloire, la gloire éternelle. Votre anonymat pétrit et fait flamboyer ce nom seul : France qui est - le seul nom nécessaire ! -
N'empêche que le Mutilé obéit parfois au devoir de mettre en lumière les héros modestes que l'on néglige et qui négligent de se rappeler à notre souvenir et à notre admiration, car s'il faut sacrifier à la France, les Français jusque dans leur juste orgueil, les noms propres sont cependant utiles à citer lorsqu'ils signifient une leçon, une date. Voici précisément un de ces noms exemplaires et faisant date. C'est le nom d'un vieillard. Dimiglio Orasio âgé de soixante et onze ans fut le 4 Août1914, la première victime des Allemands en Afrique. 11 travaillait sur les terres-pleins du port de Philippeville pour les Ponts-et Chaussées lorsque le chevaleresque "Goeben" bombarda cette ville sans défense. Atteint gravement il subit l'amputation de l'avant pied gauche, et depuis incapable de tout travail, il attend sans amertume que la Patrie lui paye sa dette.
Mais évoquons Marathon. Un historien contemporain nous rapporte que le premier, soldat qui y fut blessé et qui était lui aussi un vétéran reçut de grands honneurs des magistrats d'Athènes, que la République le tenant pour un symbole vivant du salut de la Grèce le logea au temple de Minerve Politique, et que c'étaient les jeunes gens des principales familles qui lui servaient sa nourriture "Ainsi qu'Hébé faisait aux dieux ".
Nous n'en demandons pas tant pour le modeste Dimiglio Orasio ; mais nous voulons qu'il ne meure pas de faim.
René MASSON.
|
|
LE GENERAL FRANCO
ET LES PIEDS NOIRS
Par M.José CASTANO,
|
Une page méconnue de notre Histoire .. -
Les 29 et 30 juin 1962, l'Espagne du général Franco vint au secours des Oranais malmenés par les sbires du général Katz, en affrétant 2 ferrys, « le Victoria » et « le Virgen de Africa ».
Pour accoster le long des quais d'Oran, il fallut longuement parlementer avec les autorités françaises réticentes et même donner à la France un ultimatum, risquant un grave incident diplomatique…
Le 30 juin, à 10h du matin, malgré l'opposition de De Gaulle, le général Franco donna l'ordre à ses capitaines d'embarquer cette « misère humaine » qui attendait depuis des jours sous un soleil torride, sans la moindre assistance, un hypothétique embarquement vers la France.
Franco prévint de Gaulle qu'il était prêt à l'affrontement militaire pour sauver ces pauvres gens sans défense abandonnés sur les quais d'Oran et menacés d’être exécutés à tout moment par les barbares du FLN. Joignant le geste à la parole, il ordonna à son aviation et sa marine de guerre de faire immédiatement route vers Oran.
Finalement, face à la détermination du général Franco et craignant un conflit armé, De Gaulle céda et le samedi 30 juin, à 13 h, deux ferrys espagnols accostèrent et embarquèrent 2200 passagers hagards, 85 voitures et un camion.
Lors de l'embarquement, les courageux capitaines espagnols durent, cependant, s'opposer à la montée d'une compagnie de CRS sur leur bateau (propriété de l’Espagne) dans le but de lister tous les passagers et interpeller les membres de l’OAS fichés.
Ces capitaines expliqueront n'avoir jamais compris l'attitude arrogante et inhumaine des autorités françaises dans une situation aussi dramatique qui relevait essentiellement d’« assistance à personne en danger de mort »…
Contre vents et marées, finalement à 15h30, les quais d'Oran, noirs de monde se vidèrent et les bateaux espagnols prirent enfin la mer malgré une importante surcharge, à destination du port d’Alicante.
Durant toute la traversée, se mêlèrent les larmes de détresse, de chagrin… et de joie de ces pauvres gens en route vers leur nouvel exil, conscients d’avoir échappé au pire… Quand, enfin, la côte espagnole fut en vue, une liesse générale s’empara de ces « réfugiés » qui s’époumonèrent à crier avec des sanglots dans la voie « Viva España ! » … « Viva Franco ! ». Ils avaient, pour bon nombre d’entre eux, échappé à une mort programmée par les autorités françaises. Jamais ils ne l’oublieront !
En mémoire de Jean LOPEZ, coiffeur à Aïn-El-Turck (Oran) qui devait assurer mon embarquement et mon accompagnement jusqu’en Métropole (j’avais 15 ans). Jean fut enlevé précisément au port d’Oran par des ATO (auxiliaires de police du FLN). On ne le revit jamais…
A son épouse et à ses deux filles, avec toute mon affection.
-o-o-o-o-o-o-o-
LES SECOURS VENUS D'ESPAGNE



|
|
| Bulletin - Oeuvre de saint Augustin et de sainte
Monique, patronne des mères chrétiennes
N° 3 - Avril 1878 - Brochure trouvée à la BNF
|
|
LA KABYLIE VIII et IX
CONSTITUTION POLITIQUE DE LA KABYLIE
AVANT LA CONQUÊTE FRANÇAISE
GOUVERNEMENT DÉMOCRATIQUE.
FORME SPÉCIALE DE LA DÉMOCRATIE.
LE VILLAGE KABYLE
Voir spécialement, sur tout ce qui concerne l'état politique et social de ce peuple, la Kabylie et les coutumes kabyles, par MM. Hanoteau et Letourneur, et les Mémoires du maréchal Randon. Nous devons en outre plusieurs renseignements précieux aux Pères Missionnaires d'Afrique d'Alger qui dirigent les quelques écoles françaises établies en Kabylie.
Bien qu'elle ne soit point appelée à servir de type aux constitutions modernes, l'ancienne organisation politique du petit monde Kabyle peut offrir une étude curieuse. On y voit appliquée, durant de longs siècles, à une race encore debout, une formule de ce gouvernement direct du peuple par le peuple dont la recherche, depuis 1789, a fait rêver plus d'un cerveau.
Que la crudité de la formule ait été adoucie par les réformes françaises, il n'y a de quoi offusquer personne. Pour être avec son temps partisan de la démocratie, on ne cesse pas d'être raisonnable, et lorsqu'un conquérant civilise trouve sur la terre conquise une société par trop franche de lisières, n'est-il pas légitime qu'il lui donne quelques magistrats et même quelques gendarmes ?
C'est ce qu'a fait ici la France nous verrons bientôt dans quelle mesure. Pour le moment, nous nous transportons, à vingt ans en arrière, à la veille du 24 mai 1857, qui allait livrer à nos armes, tout le massif du Djurdjura. Qu'on nous permette toutefois de nous exprimer le plus souvent comme si l'ancien régime fonctionnait encore. Outre que le récit en sera simplifié, ce passé, hier encore intact, n'est pas tellement mort, tellement enfoui dans les souvenirs écroulés, qu'il n'en reste plus trace c'est un vivant mutilé ou meurtri, mais un vivant.
Que sont donc en politique ces derniers enfants de la mère-patrie ? En religion, nous l'avons vu, ils sont mahométans de la dernière heure, moins enlacés que les Arabes dans les filets de leur prophète, et, par suite, moins imperméables à notre influence. Sur le terrain politique, l'abîme qui sépare les nouveaux maîtres des nouveaux sujets est encore moins profond. Tandis que chez les vraies nations musulmanes le Coran enserre tout de son étreinte funeste, puisqu'il est la règle Universelle et unique, la Charte et le Code, la loi religieuse et morale, chez les Kabyles et, en général, dans toute la race berbère, il s'est heurté à un mur de franchises devant lequel il lui a fallu, sinon abdiquer totalement, au moins céder une bonne moitié de ses droits.
Tout prophète qu'il est, Mahomet n'a voix dans les conseils que si la coutume est muette. Lorsque la coutume parle, pas de Coran qui tienne contre elle. Le droit divin après la souveraineté populaire, le citoyen avant le croyant.
De là ce fait que, dans la tribu kabyle, au lieu d'être tout dépaysés comme dans la tribu arabe, nous nous trouvons à certains égards en pays de connaissance. Pour ne prendre que le côté le plus apparent de la question, la tribu arabe, avec sa population de pasteurs nomades, avec sa forme autoritaire, aristocratique, patriarcale, avec ses castes tranchées, ses kaïds et agha fastueux qu'ont vus à Alger tous les promeneurs de la place du Gouvernement, n'est-ce pas une région plus ou moins nébuleuse, une réminiscence des tentes d'Abraham ou d'Ismaël ?
La tribu kabyle, au contraire, a beau se régir par des coutumes très originales et très antiques, c'est un pays nous dirions volontiers plus moderne. Non seulement la vie sédentaire, mais l'administration municipale, la fédération, l'égalité, voilà autant de choses familières aux Kabyles. De temps immémorial, le flot démocratique coule à pleins bords le long des flancs de cette portion de l'Atlas.
Si de loin en loin, dans l'histoire de ces peuplades et sur un point de leur territoire, apparaît quelque vestige de monarchie, c'est une exception. Elles traversaient alors une crise, l'étranger, menaçait la montagne; l'intérêt de la défense nationale réclamait, une tête unique. De règle, le régime du Djurdjura c'est le régime républicain, dans toute sa simplicité agreste, sans noblesse titrée, sans armée fixe; bien plus, morcelé à l'infini et comme, limité, sans pouvoir suprême, sans autre lien qu'un lien fédératif assez lâche bref, un régime communal ,à déconcerter nos décentralisateurs les plus hardis.
C'est à tel point, qu'il n'aurait pas fallu nommer tout d'abord la tribu, comme si elle était ici la première unité politique. Le premier noyau de cette singulière nationalité, ce n'est ni la confédération, ni la tribu c'est le village. ( Les plus gros villages ont une population de quinze cents a deux mille âmes. Or, depuis la statistique donnée par M. Hanoteau, la subdivision de Dellys, qui embrasse le cœur même de la Kabylie du Djurdjura, renferme plus de deux cents soixante Mille habitants, sur une surface de 365,904 hectares. Qu'on calcule d'après ces chiffres le nombre de villages disséminés sur ces montagnes.)
Le village kabyle forme à lui seul une république au petit pied, ne relevant de personne dans l'état normal, ayant ses chefs, ses kanoun, ses fueros, si l'on peut ainsi dire, enfin sa vie propre et sa souveraineté distincte. Rien qu'à voir sa physionomie extérieure et les sites qu'il préfère, on devine qu'il est décidé à se suffire le plus possible. Perché la plupart du temps sur un piton, sur la crête étroite du contre-fort, ou échelonné contre la croupe rapide de la montagne, souvent bordé d'une ceinture de cactus, sans autre voie de communication que des sentiers difficiles avec ses maisons en pierre, presque sans couvertures, tellement serrées et entassées, qu'elles semblent n'en faire qu'une, n'a-t-il pas l'apparence d'une petite forteresse, armée contre l'étranger qui peut venir, armée aussi contre le voisin qui est là, tout près, plus immédiatement dangereux.
On conçoit cependant que sur une mer orageuse comme ce pays, où le vent de la discorde souffle fréquemment, la barque ne puisse pas toujours flotter seule à tous les hasards. De là, la tribu, réunion de plusieurs villages plus ou moins solidaires entre eux ; de là, la fédération kabyle, association égaiement solidaire, quoique beaucoup moins étroite, de plusieurs tribus : le tout réglé d'ordinaire par une loi topographique.
A peu près invariablement, la chaîne de montagnes représente la confédération, le contre-fort c'est la tribu, et le village est bâti sur un point militaire du système ; tout cela basé, par conséquent, sur une raison d'attaque ou de défense. Ce sont des peuplades liguées plutôt qu'unies"
Lorsqu'ils n'ont aucun intérêt général à discuter, les villages se passent très bien pour leur administration dit concours de la tribu. Chacun d'eux a son pouvoir, dirigeant, dirigeant sur toute la ligne. Rien de plus démocratique : ce n'est ni le check arabe, ni le maire de France, ni un "conseil municipal à la manière des nôtres, ni aucune assemblée élective c'est la réunion de tous les citoyens de la localité en état de porter les armes et de subir le jeûne du Ramadan; car, ici, avenir homme fait, soldat et citoyen, c'est tout un. Pour tout dire, en un mot, le mot propre du pays, le pouvoir dirigeant du village, c'est sa djemaa.
A la Djemaa (nous parlons toujours du temps antérieur à la conquête), le pouvoir politique, administratif, le pouvoir de voter l'impôt, de modifier le kanoun, de déclarer la guerre, de conclure la paix. Plus encore à elle le pouvoir judiciaire ; pas de magistrats proprement dits, ni tout le fonctionnement de nos tribunaux ; pas d'avocats ( Les parties plaident elles-mêmes leur cause. Les Kabyles ayant généralement l'élocution très facile, l'affaire les embarrasse peu. Du reste, la Djemaa est là pour rappeler les plaidants à la question ou à l'ordre.) pas d'avoués, pas d'huissiers ; c'est la justice réduite aux plus simples rouages. Si les parties n'arrivent pas à une transaction ou ne sont pas d'accord sur le choix des juges-arbitres (Ouléma ou savants, qui sont toujours des marabouts), la Djemaa, elle-même est constituée juge de plein droit et sans appel. Assemblée omnipotente, s'il en fut.
Chaque village possède bien, à côté de l'assemblée et pris dans son sein, son magistrat élu, I:amin, le maire, pour parler un langage intelligible. Mais cet amin a beau présider d'office les séances de la Djemaa. ( Les séances s'ouvrent par la récitation du F'atha, la première sourate du Coran. Cette récitation a lieu chez les musulmans au commencement et à la conclusion de toute affaire importante), il n'est que son mandataire, son agent, sans autorité propre, le pouvoir exécutif, mais dépendant et responsable plus brièvement, c'est l'officier préposé à la police municipale et judiciaire. Il est assisté dans ses fonctions par des sous-délégués, ce que nous appellerions ses adjoints, ce qu'ils appellent les temman (tamen au singulier), les représentants des Kharouha ou fractions de villages composées des familles de même souche et groupées en petit corps politique. Quelquefois, en cas de guerre, on pourra nommer un amin de la confédération ou de la tribu (amen-el-oumena, amin des amins). Mais d'habitude on regarde comme un luxe ce supplément de fonctionnaires, et l'on s'en soucie peu, la Kabylie étant par excellence le pays du gouvernement simplifié. C'est bien assez de l'amin et des temman, si modestes et gratuites que soient leurs fonctions et la Djemaa ne suffit-elle pas à tout ?
Quoique nous commencions à être accoutumés en France aux assemblées souveraines, ne sommes-nous pas un peu déroutés en voyant toutes ces miniatures d'assemblée armées d'une puissance si définitive ? Que chaque djemaa ait toute latitude pour décider s'il faut établir telle fontaine ou telle mosquée, pour s'occuper de contenir un torrent qui déborde ou d'ouvrir un nouveau chemin; qu'elle fixe les prestations en nature, même la quotité et la répartition de l'impôt, l'emploi de son budget très bien!
Mais que, sur les plus hautes questions de paix ou de guerre, changements ou abrogations de coutume, chacune ait légalement pour son compte le dernier mot, n'est-ce pas exorbitant ? Cette absence de toute autorité centrale, de toute cour suprême ayant droit d'évoquer à sa barre les abus trop criants des mille petites cours parsemées dans le pays, est-ce autre chose qu'une anarchie assez pauvrement déguisée ? Cette participation directe de tout citoyen aux affaires publiques, l'éligibilité de tous, de droit sinon de fait, au poste d'amin, n'est-ce pas la lutte, le chaos en permanence et à perpétuité ?
A. DUGAS.
A SUIVRE
|
|
ANNALES ALGERIENNES
Tome 1
2ème partie
|
|
LIVRE II
De l'établissement des Arabes en Afrique.
Entre la mer Rouge et le golfe Persique s'étend un vaste continent, que des déserts de sable séparent des autres contrées de l'Asie. C'est l'Arabie, berceau commun de toutes ces tribus guerrières qui étendirent leurs conquêtes depuis les Indes jusqu'à l'océan Atlantique : dédaigneuse de la civilisation des anciens peuples, cette région n'avait pris aucune part à la marche de l'esprit humain. Le luxe et les richesses des Assyriens et des Perses n'avaient pas ébloui ses habitants, dont la raison avait repoussé la forte, mais assujettissante constitution sociale des Égyptiens, leurs plus proches voisins. Lorsque les conquêtes d'Alexandre eurent rapproché de l'Arabie la civilisation grecque, l'Arabie sembla reculer pour en éviter le contact. Enfin, les lumières et les armes de Rome furent également impuissantes contre elle.
Satisfaits de cette existence patriarcale, libre et insouciante, qui fut la première phase de la société humaine, les Arabes semblaient effrayés du prix auquel il fallait acheter une civilisation plus avancée ; on aurait dit qu'ils avaient pesé dans la balance de leur exquise intelligence les avantages et les inconvénients d'un changement d'état, et qu'ils s'étaient déterminés à rester dans leur simplicité primitive, plus par calcul que par instinct.
Quoiqu'il répugne, au premier aspect, d'admettre que plusieurs millions d'hommes, dépourvus de lumières acquises, aient pu, par le raisonnement, s'entendre sur un point aussi délicat, il est une hypothèse très admissible qui nous explique comment cette combinaison d'idées a dû dominer chez les Arabes, c'est celle qui nous les ferait considérer comme les descendants de toutes les familles qui voulurent se soustraire aux jougs des monarchies, lorsque les diverses régions de l'Asie commencèrent à sortir de la période patriarcale pour entrer dans la période de civilisation. On comprend alors comment les Arabes, instruits par les traditions du foyer domestique, ont dû repousser par le calcul une civilisation que les leçons de leurs pères leur présentaient toujours comme escortée de là tyrannie. Cette hypothèse n'est point purement gratuite, puisque l'histoire des Arabes leur donne pour père commun, Abraham, qui quitta la Mésopotamie à l'époque de la formation du premier empire des Assyriens, et qui, après avoir habité quelque temps l'Égypte, vint enfin se fixer dans une contrée où il pouvait conserver les habitudes d'indépendance des premiers hommes. Nous pouvons donc considérer les anciens Arabes comme les réfractaires de la civilisation asiatique, qui absorba une part trop forte de la liberté primitive pour ne pas rencontrer de rebelles.
Quelle que fût au reste l'antipathie des Arabes pour toute organisation sociale, autre que celle que leur avaient léguée leurs ancêtres, ils n'étaient point complètement indifférents aux avantages de la science ni aux charmes des beaux-arts. L'empire éphémère de Palmyra, qui s'éleva à leurs portes et qui parvint à un assez haut développement intellectuel dans le IIIe siècle de notre ère, sans être cependant trop menaçant pour leur indépendance, les initia à quelques branches des sciences exactes, et donna une impulsion plus régulière à leur goût inné pour l'éloquence et la poésie. Leur imagination ardente et leur vie peu occupée les disposaient surtout à la contemplation, à ces rêveries mystiques, où l'homme, se détachant de son existence matérielle, s'égare avec délices dans les riants sentiers du monde des idées. Mais dans ces excursions vagabondes où ils n'étaient guidés, ni par les lumières d'une haute philosophie, ni par celles d'une révélation secourable, ils perdirent les traces de l'unité de Dieu, et tombèrent peu à peu dans les égarements de l'idolâtrie et dans ceux, plus excusables, de l'adoration des astres.
Telle était leur position lorsque Mohammed-Ben-Abdallah, que nous appelons Mahomet, parut parmi eux. Doué d'un génie vaste et profond et d'une immense force de volonté, il se crut ou feignit de se croire destiné par la Providence à ramener ses compatriotes à l'unité de foi et de loi des premiers patriarches. Après avoir mûri longtemps ses projets dans le silence de la retraite, il réunit un jour ses amis, leur annonça sa mission divine, et leur présenta les premiers versets (Les premiers dans l'ordre de la composition, car dans la disposition matérielle du Coran ils figurent dans le 96e chapitre.) du Coran. Certes, si l'on se rappelle combien sont rares les hommes à qui il a été donné de changer la face du monde par la propagation d'un principe moral, par la publication de quelque grande et sublime vérité ; si l'on considère combien il faut de génie pour ouvrir une voie nouvelle à l'humanité, de persévérance pour l'y conduire, et de dévouement pour la lui frayer, il est difficile de ne pas voir dans ces hommes d'élite, de nobles et spéciales créations agissant sous l'influence d'une inspiration divine qui les élève au-dessus de leurs semblables, et à ce titre de refuser à Mahomet cette qualité de prophète qu'il se donna lui-même en annonçant sa mission.
Ce grand homme, quoiqu'on l'ait accusé d'ambition personnelle et de vues intéressées, ne désira pas le pouvoir temporel. Il ne cherchait à agir sur ses compatriotes, que pour les éclairer par la persuasion et par l'exemple de ses vertus. Mais bientôt, persécuté par ceux qui avaient intérêt au maintien des anciennes croyances, il se trouva dans la nécessité, ou de laisser périr sa doctrine naissante, ou de la défendre par les armes. Dans un pays plus avancé que l'Arabie, une doctrine philosophique ou religieuse pouvait triompher de la force matérielle par sa seule influence morale ; mais il n'en était pas de même dans la patrie de Mahomet. On aurait bientôt cessé d'y croire à un prophète qui n'aurait pas su défendre par les armes ses sectateurs que les armes attaquaient. Mahomet repoussa donc la force par la force, et fonda un empire en même temps qu'une religion ; devenu prince et homme d'état, on le vit alors employer plus d'une fois la religion au secours de sa politique. Le Coran, qui n'avait d'abord annoncé que des vérités morales, se plia aux exigences du moment, aux besoins journaliers d'un empire naissant, et excita souvent les passions que le prince désirait mettre en jeu, quoique le prophète eût cherché à les amortir. De là les nombreuses contradictions que l'on trouve dans ce livre, dont on peut extraire cependant un cours complet de la plus pure morale, une législation ci-vile dont il serait à désirer que tous les peuples fussent assez sages pour se contenter, et même quelques idées d'économie politique de l'ordre le plus élevé.
Mahomet avait régné sur les Arabes en sa seule qualité de prophète, qui le mettait bien au-dessus d'un roi. Ses successeurs ne prirent que le titre de Califes ou lieutenants, pour indiquer qu'ils n'étaient que les dépositaires du pouvoir suprême, et que Mahomet, du haut des cieux, continuait à être le souverain réel des croyants. Dans peu d'années les Arabes, unis enfin en corps de nation, eurent conquis l'Égypte et la plus grande partie de l'Asie occidentale. Partout ils se montraient humains et généreux envers les vaincus, et surtout religieux observateurs de leur parole. Ils prêchaient leur foi avec ardeur, offraient des avantages à ceux qui l'embrassaient, mais ne persécutaient personne. Tous ceux qui se rangeaient sous les drapeaux de l'islamisme devenaient, dès cet instant, membres de la grande nation, et il n'était fait aucune distinction entre eux et les anciens Arabes. Ceux qui préféraient rester dans leur première croyance, devaient se soumettre à payer, pour les besoins de l'état ; un tribut égal au cinquième de leurs revenus, moyennant quoi ils conservaient leurs lois et le libre exercice de leur culte. Les Musulmans ne payaient eux que la dîme prescrire par le Coran.
Sous Omar second, successeur de Mahomet, Ben-El-Amery, que nous appelons Ameru, un de ses généraux, fit la conquête de l'Égypte, possédée alors, ainsi que le reste de l'Afrique septentrionale, par les empereurs d'Orient.
Cette conquête étant terminée, El-Amery envoya dans la Cyrénaïque un corps d'armée, commandé par Okba, qui soumit au Calife cette riche contrée. Ceci se passa vers l'an 640 de l'ère chrétienne.
Okba eut pour successeur, dans son commandement, Abdallah, qui poussa ses conquêtes jusque dans les environs de Carthage, et jeta sur les débris d'une ville romaine les fondements de Kairouan, destinée à contenir les Kbaïles.
Les troubles qui suivirent la mort du Calife Othman, retardèrent un peu les progrès de la conquête de l'Afrique par les Arabes. La paix ayant été rétablie par la cession du Califat faite à Moavie par Hassan fils d'Aly, quelques renforts furent envoyés à Abdallah, et la ville du Kairouan fut terminée.
Les guerres civiles ayant recommencé, on négligea encore l'Afrique; enfin sous le Calife Abdel-Maleck la conquête fut reprise, et Carthage, enlevée au Patrice Jean, que l'Empereur Léonce avait nommé gouverneur de la province.
A la mort d'Abdel-Malek, les Maures reprirent quelque avantage sur les Arabes. Mais le nouveau Calife, Walid, fils d'Abdel-Malek, envoya en Afrique Mouça-Ben-Nozeïr, qui en fit la conquête définitive. Cet homme, aussi habile politique que guerrier intrépide, mettait tous ses soins à faire oublier aux vaincus, après la victoire, l'humiliation de la défaite. Il rappela aux Maures leur communauté d'origine avec les Arabes, et parvint dans peu d'années à les ranger sous les lois de l'islamisme.
Ces Maures étaient chrétiens pour la plupart, ainsi que les descendants des colons Romains et Italiens que les empereurs avaient établi dans la Mauritanie; mais depuis l'invasion des Vandales, l'arianisme avait fait de grands progrès parmi les uns et les autres. Cette secte, qui ne reconnaissait ; point la divinité de Jésus-Christ, et qui ne voyait en lui qu'un prophète, se rapprochait beaucoup du mahométisme qui, à le bien prendre, n'est qu'un corollaire du christianisme, car Mahomet ne dit pas qu'il vient détruire, mais compléter l'œuvre du Christ.
Ce rapprochement rendit plus facile la tâche de Mouça ; de sorte que ce grand homme, après avoir triomphé matériellement des Maures, remporta sur eux une victoire morale plus glorieuse pour lui, et plus avantageuse pour les Arabes, en opérant dans la croyance des vaincus un changement qui devait affaiblir leur haine pour, les vainqueurs.
Les Kbaïles furent plus difficiles à persuader. Beaucoup d'entre eux étaient encore plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie ; mais Mouça, avec son habileté ordinaire, sut ménager leurs superstitions et leurs préjugés.
Pourvu qu'ils consentissent à reconnaître Mahomet pour prophète, peu lui importait qu'ils conservassent quelques traces de leurs anciennes croyances, laissant au temps le soin de purifier leur foi, et ayant d'ailleurs un but plus politique que religieux. Les Kbaïles de leur côté firent encore meilleur marché de leur religion que de leur indépendance, et tout en reconnaissant la suprématie des Califes, s'établirent à l'égard des Arabes dans cette position libre et ? ère que la plupart ont su conserver' avec une si admirable constance. Mouça ne voulut rien exiger de plus pour ne pas s'engager dans une de ces guerres de partisans où l'avantage est toujours du côté des indigènes. Ici il s'en remit encore au temps, qui peut-être aurait amené une fusion complète, si tous les successeurs de cet homme habile eussent imité sa modération et sa sagesse. Ne craignant rien des Kbaïles, qui sont disposés à laisser leurs voisins en paix, pourvu qu'on ne vienne pas les inquiéter, il vit en eux moins des administrés que des alliés qui pouvaient lui être utiles, et qui le furent en effet dans la conquête de l'Espagne.
Nous n'entrerons pas dans les détails de cette conquête, qui eut lieu sous les auspices de Mouça, et qui forme le plus brillant épisode de l'histoire des Arabes.
Ce peuple, vraiment magnanime, y déploya autant de générosité que de bravoure, et autant de science militaire que d'habileté politique. En moins de trois ans toute la Péninsule fut soumise, à l'exception des montagnes des Asturies, où Pélage réunit les débris de l'empire des Goths, et d'où devait partir plus tard la réaction de l'Espagne chrétienne contre l'Espagne musulmane. Partout les Chrétiens obtinrent les capitulations les plus avantageuses, et pendant les 800 ans que les Arabes occupèrent l'Espagne, on ne trouve pas un seul exemple qu'ils les aient violées.
Tarif, lieutenant de Mouça, commença la conquête que celui-ci continua. Ce fut le premier qui gagna la fameuse bataille de Xérès, où Rodrigue, dernier roi Goth d'Espagne, fut tué. Le Calife Soliman, qui régnait alors, paya ces deux habiles capitaines de la plus noire ingratitude.
Il les appela à Damas, sous prétexte de juger un malheureux différend qui s'était élevé entre eux, et les envoya en exil après les avoir accablés de traitements indignes ; il fit même assassiner, par ses émissaires, Abdel-Aziz, fils de Mouça, que son père avait laissé en Espagne pour y commander en son absence.
Il serait superflu de mettre sous les yeux du lecteur la liste plus ou moins exacte des successeurs de Mouça-Ben-Nozeïr dans le commandement de l'Afrique, dont l'Espagne ne fut longtemps qu'une succursale. Ces gouverneurs siégeaient à Kairouan. Les vastes et belles contrées qu'ils administraient étaient divisées en provinces, ayant chacune à leur tête un Ouali, qui en était le chef civil et militaire.
Chaque province était divisée en Caïdats, dont les chefs portaient le titre de Kaïd, comme de nos jours. La justice civile et la justice criminelle étaient, administrées par des Cadis, dont la position indépendante garantissait les droits de chacun. Les tribus Arabes, Maures, ou Kbaïles, avaient des Cheiks de leur choix, véritables tribuns, toujours disposés à s'opposer aux empiétements de l'autorité centrale. Tout cela formait un ensemble administratif dont les formes étaient plus despotiques que le fond, et où, contrairement à ce qui avait lieu dans le gouvernement féodal qui s'établit en Europe à peu près vers ce temps-là, c'était le peuple qui avait le moins à souffrir.
Le vaste empire des Califes se soutint dans son intégrité, jusqu'à la chute de la famille des Omeyyades. Les Abbassides, qui lui succédèrent, se montrèrent impitoyables envers la dynastie déchue. Presque tous les membres de cette illustre et malheureuse famille, furent massacrés.
Un d'eux, nommé Abder-Haman, jeune enfant intéressant par sa beauté et par les grâces de sa jeunesse, fut soustrait à la rage de ses ennemis, et conduit en Afrique, par un serviteur fidèle, qui le confia à la puissante tribu des Zénètes. Ces braves gens l'adoptèrent et l'élevèrent avec le plus grand soin, tout en cachant son illustre origine. Le jeune Omeyyade ne tarda pas à se faire distinguer par les qualités les plus brillantes, par ses succès dans les sciences et dans la littérature, et par son habileté dans les exercices du corps. On remarquait surtout en lui une maturité de jugement et une vigueur de raison bien supérieure, à son âge.
Vers la même époque les Arabes d'Espagne étaient, en proie à la plus déplorable anarchie. Après la mort tragique d'Abdel-Aziz-Ben-Mouça, que nous avons racontée plus haut, les gouverneurs de cette province s'étaient succédé les uns aux autres avec une incroyable rapidité. Les Califes, qui craignaient leur ambition, les changeaient à chaque instant, et leur laissaient à peine le temps de faire connaissance avec leur gouvernement. Il est facile de concevoir les inconvénients de cette méfiance exagérée. Ce fut sous un de ces gouverneurs éphémères qu'eut lieu la fameuse expédition des Arabes en France. Tout le monde en connaît l'épisode, et le triomphe de Charles-Martel.
Après la chute des Omeyyades, le défaut de fixité dans l'administration ne provint plus des Califes, dont l'autorité fut générale ment méconnue en Espagne, mais de l'ambition des chefs militaires, qui se disputaient à main armée les fonctions de gouverneur, et dont aucun ne fut assez puissant pour se maintenir dans ce poste dangereux.
Tous les maux vinrent alors fondre sur l'Espagne musulmane : la guerre civile désolait les campagnes et les cités ; l'agriculture était en souffrance, le commerce anéanti, et le peuple, qui mourait de faim, se livrait à des habitudes de brigandage. Les chrétiens des Asturies prenaient chaque jour de la force, et ceux de l'intérieur commençaient à s'agiter. Enfin la puissance arabe paraissait être à la veille de sa ruine. Mais, malgré tant de causes de dissolution, il y avait dans la nation une force vitale qui devait la faire triompher de ces embarras passagers.
Tous les grands des tribus, tous les savants et les hommes de loi se réunirent à Cordoue, et il fut décidé dans cette auguste assemblée, qu'il fallait faire disparaître de la scène politique tous ceux qui y avaient figuré jusqu'alors, et investir du pouvoir suprême un homme complètement étranger aux malheureuses disputes qui avaient été sur le point de perdre l'état. Ceci convenu, un Cheik prit la parole, et proposa le jeune élève des Zénètes dont il fit connaître l'origine et les grandes qualités. Il plaida sa cause avec tant d'éloquence qu'il entraîna tous les suffrages. En conséquence une députation fut envoyée secrètement en Afrique, pour offrir au jeune Omeyyade la brillante couronne d'Espagne. Celui-ci, après s'être consulté quelque temps, et avoir, pris l'avis de ceux qui avaient élevé son enfance, répondit aux députés, qu'il était fier du choix qu'on avait fait de lui, qu'il se sentait la force de supporter le fardeau de la royauté, et la volonté de gouverner selon les lois ; mais que s'il acceptait le diadème, il entendait être obéi de ceux même qui l'auraient placé sur son front, ce qui paraîtrait peut-être un peu dur à une génération élevée dans la licence des guerres civiles. Les députés répondirent que c'était bien ainsi que le comprenait la nation, puisque c'était pour mettre un terme à cette licence qu'elle avait jeté les yeux sur lui. Le prince, n'ayant plus d'objection à faire, fut salué du nom de Calife, et partit avec les députés. Les Zénètes lui firent les plus tendres adieux, et ce ne fut pas sans verser des larmes qu'il se sépara de ses fidèles amis. Rien n'est plus touchant que le discours que les historiens arabes mettent, en cette circonstance, dans la bouche du vénérable chef de cette tribu.
Le nouveau Calife, arrivé en Espagne, se trouva bientôt entouré d'une foule de peuple, empressée de se ranger sous ses lois. Les ambitieux, dont son arrivée dérangeait les calculs, voulurent en vain s'opposer à son élévation. Il les vainquit, et parvint dans peu de temps à rétablir l'ordre dans son royaume. C'est alors qu'il reçut le glorieux surnom dEl-Mançour, dont nous avons fait Almanzor. Aderhaman-Almanzor fut un des plus grands hommes dont s'honore l'humanité. Il fit régner l'abondance et la justice dans ses états, et traita tous ses sujets avec la même douceur, sans distinction de religion ni de race. L'agriculture et le commerce prirent sous lui un essor prodigieux. Les sciences et les arts furent cultivés avec succès. Il était lui-même un savant du premier ordre, pour ce temps là, et un littérateur fort distingué ; il établit le siège de son empire à Cordoue, où il construisit cette superbe Mosquée qui existe encore, et qui fait l'admiration des voyageurs.
Pendant qu'Abderhaman régnait glorieusement en Espagne, l'Afrique secouait le joug des Califes d'Orient. A la chute des Omeyyades les Kbaïles avaient pris les armes, et avaient été vaincus, non sans peine, par Hontala, gouverneur du pays. Ce dernier fut bientôt obligé, pour ne pas diviser les forces arabes, de céder son gouvernement à Abderhaman-Ben-Abib, un de ses généraux, qui s'était révolté contre lui. Cette générosité fut mal placée, car Abderhaman se déclara indépendant des Califes, en 750. Il mourut assassiné, et à sa mort tous les chefs de district voulurent se faire un état indépendant. Le Calife, El-Mançour-Djafar profita de cette anarchie. Il envoya en Afrique un de ses généraux, nommé Yérid, qui la soumit de nouveau; Yérid gouverna l'Afrique jusqu'à sa mort. Il eut pour successeur son fils Daoud, qui fut, en outre, nommé gouverneur de l'Égypte ; mais en 800, le gouverneur de l'Afrique, qui était alors Ibrahim-Ben-Adjeleb, se déclara de nouveau indépendant.
Cet Ibrahim fut le chef d'une dynastie qui régna à Kairouan, jusqu'en 912, et qui s'empara de Malte, de la Sicile et du midi de l'Italie, où sa puissance fut détruite par les Normands. En Afrique elle succomba sous les coups d'un chef de révoltés, nominé Abou-Mohammed-Obéidala, qui se disait descendu de Fatima, fille du Prophète, bien que plusieurs historiens avancent que ce n'était qu'un juif aventurier. Quelle qu'ait été son origine, sa fortune fut prodigieuse : il s'empara de tout l'ancien gouvernement de l'Afrique, et rendit tributaire le royaume de Fez.
Les fondements de ce royaume avaient été jetés en 787, par Edris-ben-Abdallah, descendant d'Ali, gendre du Prophète. Il avait fui l'Asie pour se soustraire aux persécutions des Abbassides, et fut accueilli par la tribu Maure d'Arouba. Son fils, Edris-Ben-Edris, bâtit la ville de Fez. Son septième successeur, Yahia, se soumit à payer tribut à Obéidala ; mais il fut bientôt détrôné par l'un des siens, qui disait ne plus vouloir reconnaître un prince avili.
Ses partisans appelèrent à son secours les Arabes d'Espagne, sur qui régnait, alors Abderhaman III, un des descendants et des successeurs du grand Almanzor. Le Calife de Cordoue rétablit les Edrissites, mais comme vassaux. Le dernier des Edrissites, s'étant révolté contre l'Espagne, en 985, fut pris et mis à mort par les troupes d'Almanzor, premier ministre du Calife Hichem, prince faible et incapable, au nom duquel Almanzor gouvernait. Le royaume de Fez fut alors réuni à l'empire de Cordoue.
Cependant la famille d'Obéidala devenait de plus en plus puissante. En 972, Moëz, arrière-petit-fils de cet heureux usurpateur, s'empara de l'Égypte, où il, transporta le siège de son empire. Il fut le chef de la dynastie des Califes Fatimides, qui succomba en 1200 sous les coups du fameux Saladin. Moëz, en partant pour l'Égypte, laissa en Barbarie, pour y gouverner en son nom, Yousouf-Ben-Zeiri-Ben-Menad, chef de la famille des Zéirites, qui ne tarda pas à se déclarer indépendant, et qui régna en Afrique, jusqu'en 1148.
En Espagne, le règne d'Hichem, ou plutôt celui de son ministre Almanzor, fut le dernier terme de la puissance du Califat de Cordoue. Après sa mort, arrivée dans les dernières années du Xe siècle, l'État fut déchiré par les guerres civiles, et tous les Oualis se déclarèrent indépendants. De là, l'origine de tous ces petits royaumes musulmans qui s'établirent sur les débris du Califat. Le roi de Castille, Alphonse VI, mit à profit les divisions qui régnaient chez les Arabes pour étendre sa puissance. Ceux-ci, désespérant de lui résister, implorèrent le secours de Yousouf-ben-Taschfin ; qui venait de fonder l'empire de Maroc, dont voici l'origine.
Gudala et Lantouna étaient deux tribus du Sahara, descendantes de celle de Zanakra ; elles vivaient dans la pauvreté et l'ignorance, lorsqu'un homme de Gudala nommé Yahia-ben-Ibrahim, fit le pèlerinage de la Mecque, et en revint avec le désir de voir ses compatriotes participer au mouvement de la civilisation arabe. En revenant, il s'arrêta quelques jours à Kairouan, où il fit la connaissance d'un savant appelé Abou-Amram ; il voulut l'engager à venir avec lui dans le désert, pour civiliser ses sauvages compatriotes. Amram, ni aucun de ses disciples, ne consentirent à entreprendre un si grand voyage, mais Amram donna à Yahia une lettre de recommandation pour un autre savant de la ville de Suz, nommé Abou Isaac, et qui, étant plus près du désert, se déciderait peut-être à y aller. Isaac ne voulut pas entreprendre lui-même cette tâche difficile, mais il fit partir avec Yahia le plus célèbre de ses disciples, nommé Abdallah-ben-Yasim. Celui-ci était un homme habile et ambitieux, qui profita de l'enthousiasme qu'il fit naître dans la tribu de Gudala, pour jeter les fondements d'un empire nouveau.
Il commença par soumettre les gens de Lantouna, et, après les avoir vaincus, il s'en ? t des prosélytes aussi ardents que ceux de Gudala. Ensuite, il soumit avec de grandes peines les Kbaïles de la contrée. C'est alors qu'il donna à tous ses gens la qualification respectée de Marabout, au pluriel Maraboutins, dont nous avons fait Almoravides. Abdallah ne voulut pas prendre pour lui-même le titre d'Émir, et il le donna à Zaccaria, Cheik de la tribu de Lantouna. Quant à lui, il se contenta de l'ascendant que lui assuraient la religion et le savoir. Zaccaria ayant été tué dans une bataille, son frère Bekir-ben-Omar lui succéda. Quelque temps après, Abdallah ayant péri d'un coup de lance, Bekir fut de fait, comme de nom, chef des Maraboutins, dont la puissance avait déjà franchi l'Atlas. Il jeta les fondements de Maroc. La guerre s'étant ensuite élevée entre ceux de Gudala et de Lantouna qui étaient restés dans le désert, il partit pour l'apaiser, et laissa à son cousin Yousouf-ben-Taschfin, le commandement du pays conquis. Celui-ci qui était très ambitieux, travailla pour lui-même ; et lorsque Bekir revint, il s'aperçut que son règne était fini. Il se résigna à son sort, proclama Émir son heureux cousin, et se retira dans le Sahara, avec de magnifiques présents que lui fit Yousouf pour adoucir ses regrets.
Yousouf-ben-Taschfin, soumit toute l'Afrique, depuis l'Océan jusqu'à Tunis, et réduisit presque à rien la puissance des Zéirites. Appelé en Espagne, comme nous l'avons dit, il battit les Chrétiens, soumit tous les petits princes Arabes, et rétablit ainsi l'unité de commandement chez les Musulmans de la Péninsule. Il mourut à l'âge de cent ans, après un règne long et glorieux, dans le cours duquel il ne prononça pas une seule condamnation à mort. Sa famille n'était pas destinée à une aussi longue série de prospérités. Sous le règne de son fils Aly, parut le fameux Mohammed-ben-Abdallah, fondateur de la puissance des Almohades. C'était un réformateur passionné des abus politiques et religieux. On le méprisa dans le commencement, mais on ne tarda pas à le craindre ; obligé de s'éloigner de Maroc, il se réfugia à Tinmal, dans les montagnes de l'Atlas, et souleva les Kbaïles. Il prit alors le titre de Mahiddin, ou directeur de la religion, dont nous avons fait Almohades, selon notre habitude de dénaturer tous les noms arabes.
El-Mahiddin étendit ses conquêtes dans tout le pays montueux, et eut pour successeur Abdel-Moumen, son disciple chéri. Celui-ci porta les derniers coups à la puissance des Almoravides. Il battit complètement, près de Tlemcen, Taschfin, fils et successeur d'Aly, qui chercha un refuge dans Oran. Ce prince voulut de là passer en Espagne, où son pouvoir était encore reconnu, mais en se rendant, la nuit, d'Oran à Mers-el-Kébir, par un chemin dangereux, son cheval, effrayé du bruit des vagues, se précipita du haut d'un rocher, et il périt dans cette chute. ( Ce chemin est toujours aussi mauvais, mais on construit dans ce moment une fort belle route d'Oran à Mers-El-Kébir. )
Après la défaite et la mort de Taschfin, Abdel-Moumen s'étendit comme un torrent sur toute la Barbarie, et mit fin en 1148 à l'empire des Zéirites, qui avaient perdu une grande partie de leurs domaines, mais qui régnaient encore à Kairouan. Il s'empara aussi de toute l'Espagne musulmane, de sorte que son empire s'étendit depuis la Cyrénaïque jusqu'au Tage.
Le triomphe des Almohades fut celui des Kbaïles sur les Arabes. Ces nouveaux vainqueurs se montrèrent moins généreux que leurs devanciers, et leur joug pesa assez rudement sur l'Espagne. C'est de cette époque que date cette teinte de férocité que l'on remarque dans la politique des gouvernements barbaresques. Cependant Abdel-Moumen avait introduit dans le sien quelques formes que nous appellerons constitutionnelles, ne pouvant trouver d'autres expressions. Un sénat à peu près indépendant, y traitait de toutes les affaires qui intéressaient directement la nation. Abdel-Moumen eut pour successeur, dans son vaste empire, son fils Yousouf, puis son petit-fils Yacoub. Ce dernier gagna contre les Chrétiens d'Espagne la fameuse bataille d'Alarcos, mais son fils Mohamoud, qui lui succéda, perdit celle non moins célèbre de Las Navas de Tolosa. Il alla cacher sa honte dans son harem de Maroc, d'où il ne sortit plus. Son fils Yousouf, jeune enfant ; ne ? t que paraître sur le trône, et sous son règne, l'empire se fractionna de nouveau. Les Arabes secouèrent presque partout le joug des Almohades, à qui il ne resta bientôt plus que Maroc, qui leur fut enlevé, en 1370, par la famille des Beni-Merin.
En Espagne, les Chrétiens s'emparèrent de Cordoue et de Séville, et réduisirent la puissance des Arabes dans cette contrée au seul royaume de Grenade, qui cependant, pendant deux siècles encore, brilla d'un assez bel éclat, jusqu'au moment où il succomba, comme chacun sait, sous les efforts combinés de Ferdinand et d'Isabelle.
En Afrique, la chute des Almohades amena la formation de plusieurs états, dont les principaux furent Tlemcen ou Tlemcen, Tunis, et Tripoli.
Le royaume de Tlemcen était composé de presque tout ce qui forme aujourd'hui la Régence d'Alger. La famille de Ben-Zian, dont il existe encore des membres dans le pays, y régna depuis 1248 jusqu'en 1560. Cette famille se disait Fatimide.
Le royaume de Tunis eut pour premiers princes les Beni-Hafzi. C'est sous cette dynastie qu'eut lieu la malheureuse expédition de St.-Louis.
On voit que c'est de la chute des Almohades que datent les états barbaresques modernes. L'histoire, outre les trois grands états que nous venons de citer, parle encore de plusieurs petits princes indépendants qui régnèrent à Alger, à Tenez, à Bougie et à Tugurth. Cette dernière principauté a conservé son indépendance jusqu'à nos jours.
Les Beni-Merin régnèrent à Maroc jusqu'en 1471. Les princes de cette race firent quelques expéditions en Espagne, mais elles furent plus souvent malheureuses qu'heureuses, et les rares succès qu'ils obtinrent ne servirent qu'à retarder de quelques années la chute de la puissance musulmane dans cette contrée. Abdallah, dernier roi de la famille de Beni-Melin, mourut assassiné. Des guerres civiles éclatèrent ensuite dans tout le royaume, qui fut divisé au gré des ambitions particulières. Mouley-Cheikh, appartenant à une branche cadette des Beni-Merin, régna à Fez ; mais Maroc, Suz, Sugulmesse, formèrent des états indépendants.
Cependant, les Musulmans ayant été chassés de l'Espagne, la Chrétienté commença à peser à son tour sur l'Afrique. Les Espagnols s'emparèrent de Ceuta, de Melilla, d'Oran, de l'île d'Alger et de Bougie. Les Portugais, de leur côté, s'emparèrent de tout le littoral de l'empire de Maroc. Ils firent des alliances avec les plus puissantes tribus de l'intérieur, et ils auraient fini par dominer tout le pays, si le fanatisme des populations n'avait pas été mis en jeu par des hommes habiles, qui voulaient l'exploiter à leur profit. Ces hommes étaient les trois fils de Mohammed Ben-Ahmed, Abdelkébir, Ahmed et Mohammed d'une famille de Chérifs; leur père, homme à grandes vues et à esprit persévérant, avait résolu, dès leur enfance, d'en faire les fondateurs d'une nouvelle dynastie, et toutes ses actions tendirent dès lors vers ce but ; la fortune de cette famille est le plus frappant exemple que l'on puisse donner de ce que peut une volonté ferme et soutenue.
Mohammed commença par faire parfaitement élever ses fils, et il les envoya ensuite en pèlerinage à la Mecque, d'où ils revinrent avec une grande réputation de sainteté, qui leur attira la vénération des Croyants ; mais, pour ne point éveiller les soupçons de l'autorité, ils affectèrent de vouloir rester étrangers à la politique et de ne s'occuper que de sciences et d'œuvres pies. L'aîné dut à cette conduite prudente d'être nommé directeur des écoles de Fez, et d'être chargé, peu de temps après, de l'éducation des enfants du roi. Les Chérifs, ayant alors accès à la cour, proposèrent à ce prince d'aller prêcher; la guerre sainte contre les Portugais, dans, les parties de l'empire qui n'étaient pas soumises à sa domination, lui faisant voir dans l'exécution de ce projet, un moyen d'éloigner tout à la fois les Chrétiens de ses états, et de réunir sous son sceptre toutes les provinces qui s'en étaient séparées.
Le monarque, à qui ce plan sourit, leur donna l'autorisation qu'ils demandaient. Ils se mirent en campagne, bientôt leur éloquence eut soulevé contre les Portugais des populations entières, qui, à leur voix respectée, marchèrent contre les ennemis de l'Islamisme. Les Portugais furent repoussés dans leurs postes maritimes, dont plusieurs leur furent même enlevés. Non contents de leurs succès contre les Chrétiens, les Chérifs attirèrent à eux toute l'autorité divisée jusque-là entre plusieurs petits princes, et nommèrent Émir leur père Mohammed, sans plus songer aux intérêts du roi de Fez, pour qui ils s'étaient engagés à travailler. Le nouvel Émir, qui était fort âgé, mourut bientôt, ainsi que son fils aîné tué dans un combat. Les deux autres, après s'être débarrassés par un crime du roi de Maroc, se partagèrent le pouvoir; Ahmed fut proclamé roi de Maroc, et Mohammed roi de Suz ; mais ce dernier, après quelques années de guerre civile, déposséda son frère et s'empara de toute l'autorité ; malgré les liens de reconnaissance qui devaient l'unir à la famille royale de Fez, il ne tarda pas 'à lui déclarer la guerre. Après quelques vicissitudes de fortune, le royaume de Fez passa, avec le reste du pays, sous la domination de Mohammed, qui, en mourant, laissa à son fils Abdallah un empire reconstitué par tant d'habileté, de ruse et de crimes.
Le successeur de celui-ci fut un autre Mohammed, que ses cruautés firent chasser par ses sujets. Il se réfugia au Portugal, et eut pour successeur son frère Mouley-Abdelmalek. Le roi de Portugal, Don Sébastien, voulant profiter de cette circonstance pour ressaisir ce que les Portugais avaient perdu dans le Maroc, fit une descente en Afrique avec Mohammed, mais il périt, ainsi que son protégé à la bataille d'Alcassar ; Abdelmalek, qui était malade, mourut aussi pendant l'action ; son frère Ahmed lui succéda et régna paisiblement jusqu'en 1603 ; après sa mort les guerres civiles recommencèrent. Un Kbaïle nommé Crom-El-Hadj s'empara de l'autorité souveraine à Maroc, mais toutes les autres parties de l'empire se déclarèrent indépendantes ; on vit même un juif régner sur quelques tribus des montagnes. Un Chérif venu de l'Arabie s'établit à Tafilet ; son fils Mouley-Rachid, homme féroce, mais habile, s'empara de tout le pays après plusieurs années de guerre, et fut le chef de la famille régnante actuelle ; il mourut en 1672.
Les Portugais perdirent successivement tous leurs établissements sur la côte de Maroc ; les Anglais, qui avaient occupé quelque temps Tanger, abandonnèrent cette place en 1634, dégoûtés des dépenses de l'occupation. Ce fut le parlement qui provoqua cette mesure. Les Espagnols conservèrent Ceuta, Mélia et quelques autres points peu importants.
Nous avons raconté, dans la première partie de ce volume, comment les Turcs s'établirent à Alger, sous le premier Barberousse. Cet audacieux corsaire s'empara ensuite de Tunis, qu'il enleva à Hamida-ben-Abos, qui y régnait légitimement, puis il marcha contre Tlemcen, sous prétexte de secourir le jeune roi, Abou-Hamou, qui avait été détrôné par un de ses oncles ; mais, après s'être emparé du pays, il se disposa à le garder pour lui, au lieu de le rendre à Abou-Hamou, comme il s'y était engagé. Celui-ci se retira à Oran, auprès du marquis de Gomarez, gouverneur de cette ville, qui prit sa cause en main, y voyant un moyen d'étendre dans le pays l'influence espagnole.
Les Espagnols, unis aux Arabes du parti d'Abou-Hamou, assiégèrent et prirent Callah, où les Turcs avaient mis garnison, et vinrent ensuite investir Tlemcen, où se trouvait Barberousse. Celui-ci se défendit longtemps dans le Méchouar (On appelle ainsi la citadelle de Tlemcen.) ; mais les vivres lui ayant manqué, il en sortit la nuit par une poterne avec ses Turcs pour tâcher de regagner Alger. Les Espagnols, s'étant aperçu de sa fuite, se mirent à sa poursuite, l'atteignirent au passage d'une rivière, et le tuèrent. Le marquis de Gomarez rétablit alors sur le trône de Tlemcen le jeune Abou-Hamou, qui se rendit tributaire de l'Espagne.
Après la mort d'Haroudj Barberousse, les Turcs reconnurent pour chef son frère Kaïr-Eddin que la Porte Ottomane nomma Pacha, et à qui elle envoya des renforts. Charles-Quint lui enleva cependant Tunis, où il replaça le prince légitime. Kaïr-Eddin, ayant ensuite été nommé Capitan-Pacha de l'empire Turc, quitta Alger, où il fut remplacé par Hassan Aga. C'est sous celui-ci qu'eut lieu, en 1541, la fatale expédition de Charles-Quint, qui paya bien cher, dans cette circonstance, ses succès de Tunis. Hassan-Aga, aussitôt après cette catastrophe, marcha sur Tlemcen pour détruire l'influence Espagnole dans ce royaume, et força le roi régnant à lui payer tribut.
Hassan-Aga eut pour successeur Hassan-Barberousse, fils de Kaïr-Eddin ; le royaume de Tlemcen, qui penchait vers son déclin, était déchiré par les querelles des princes de la famille royale, qui se disputaient la couronne, en s'appuyant sur Alger, sur les Espagnols d'Oran, ou sur le roi de Fez, dont les troupes entrèrent dans le pays ; Hassan leur livra bataille, et les défit complètement près de Mostaganem. Cette victoire assura la couronne de Tlemcen au prince protégé par Alger.
Hassan, qui avait des ennemis à Constantinople, fut remplacé en 1552 par Salah Raïs, homme habile et entreprenant, qui enleva Bougie aux Espagnols, et qui se préparait à attaquer Oran, lorsqu'il mourut de la peste. Après sa mort, la milice turque nomma pour chef un renégat Corse, nommé Hassan. Mais la porte avait nommé Pacha, Tekli, autre renégat, Sarde de nation, qui entra à Alger, et mit à mort son compétiteur. Il mourut lui-même assassiné, peu de temps après, et la Porte replaça alors à Alger Hassan-Barberousse. Dans cette seconde période de son administration, Hassan réunit à la régence d'Alger la ville de Tlemcen, et ce qui restait du royaume de ce nom. Il battit aussi le comte d'Alcaudète, gouverneur d'Oran, qui avait cherché à se rendre maître de Mostaganem. Sous les Pachas successeurs d'Hassan, les Algériens continuèrent à se rendre redoutables aux puissances chrétiennes, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que la plupart de ces Pachas étaient eux-mêmes des Chrétiens renégats. Hassan de Venise ; l'un d'eux, fit avec une puissante flotte une incursion sur les côtes de l'Espagne et de l'Italie, et en revint avec plus de 4,000 captifs et un immense butin. La force d'Alger fut accrue, en 1600, par l'arrivée des Mauresques ( On appelait ainsi les descendants des Maures d'Espagne que la persécution avait forcés d'embrasser le Christianisme, du moins en apparence ), qui, chassés d'Espagne par Philippe III, apportèrent en Barbarie leur industrie et leur haine pour les Chrétiens. Malheureusement le gouvernement turc, plus militaire qu'administrateur, ne sut pas profiter de ces éléments de prospérité industrielle et agricole. Il voulut ne rien devoir qu'à la guerre.
En 1601, une flotte Espagnole essaya d'attaquer Alger, mais le mauvais temps la força à s'en éloigner. Les Anglais ne furent pas plus heureux en 1620. En 1627, la milice turque envoya une députation au grand seigneur pour se plaindre des exactions des Pachas, que la Porte Ottomane imposait à Alger, et demander qu'on l'autorisât à nommer elle-même le chef de la Régence, s'engageant, du reste, à payer tribut à l'empire, et à continuer à en reconnaître la suzeraineté. Comme Alger coûtait plus à la Porte qu'il ne lui rapportait, le grand seigneur consentit à cet arrangement, à la condition qu'il y aurait cependant toujours un Pacha à Alger, nommé par lui, dont les fonctions se réduiraient à mettre opposition aux actes qui lui paraîtraient contraires aux intérêts de la Porte.
Le nouveau chef de la Régence prit le titre de Dey, qui en langue Turque signifie oncle. Ce fut sans doute un sobriquet dans l'origine.
Cette forme de gouvernement exista jusqu'en 1710 sous le Dey Baba-Aly, qui chassa ignominieusement le représentant de la Porte, et prit pour lui-même le titre de Pacha. Baba Aly étau assez fort pour ne pas craindre les suites de cette démarche. Il avait su, au reste, se créer à Constantinople des amis qui déterminèrent l'empereur à sanctionner ce changement dans le gouvernement d'Alger, lequel se trouva dès lors organisé tel que nous l'avons raconté dans la première partie de ce volume.
|
|
FUNAMBULE
ECHO D'ORANIE - N°296
|
Alizé des eaux troubles
Chemin mal aimé des murmures
D'une étoile étalée sur I'azur
Ville alanguie d'étoiles fauves.
J'irai poser mes mains sur l'aile
Qui m'a fait entrevoir le ciel.
Lumière entre deux pans d'ombre
Rai d'ailleurs mêlé de miel
Ange assoiffé de douceur
J'attends, j'attends
Le signe
Salutaire
Au fil des heures, mon âme s'égare
Et j'embrasse le fil qui m'enserre
Un pas de trop, un pas de plus
Le premier pas coûte autant qu'on le perd.
Funambule au sourire malheureux
Je sais quels combats tu abrites
En ton sein si fragile
Je sais de quelle argile ton être est fait
Dans la douleur et le renoncement
J'envie ton Parcours
Et je plains les silences
J'admire ton courage
Et je regrette ta lucidité.
La noblesse de ton cœur
Etouffe ton mouvement
Grâce d'un cil battant sur ton œil
Si fier
O combien triste !
Mais rien n'égale
Ta peur de tomber.
Laurence Davy-Esteban
|
|
|
Histoire des voyous d'Alger
ou " Les pieds-nickelés Pieds-Noirs "
Par M Piedineri
|
|
Fin XIXème-début XXème siècle. Dans le Paris de la Belle Epoque, les " apaches ", ancêtres des " blousons noirs ", font régner la terreur. Mais ces bandes de voyous d'un nouveau genre, seigneurs des bas-fonds Parisiens de Belleville et de Ménilmontant, auront des imitateurs dans tous les coins de France y compris chez les Européens d'Algérie, ceux que l'on n'appelle pas encore " Pieds-Noirs ".
On ne peut évaluer l'importance de cette pègre d'Alger (de toute manière, elle n'a jamais représenté qu'une infime minorité), mais il est vrai qu'à la suite d'incidents entre " apaches " survenus en juillet 1914, une trentaine de personnes étaient arrêtées dont dix-huit, tous repris de justice, écrouées à la suite d'une rafle à Bab-el-Oued . Une autre rafle effectuée quelques mois plus tôt dans ce faubourg amenait l'arrestation de onze individus. Moyenne d'âge : 17 ans. Quatre d'entre eux ont 20 ans (ce sont les plus âgés), tandis que les deux plus jeunes ont 15 et 16 ans . Une autre arrestation (menée cette fois dans l'ensemble d'Alger), pour six personnes, donnait une moyenne d'âge de 19 ans et demi . S'agissant maintenant des métiers déclarés, citons Joseph Gimenez, " se disant serrurier... sans travail " , Léonce Dumeny, camelot âgé de 21 ans , trois maçons dont le chef de bande de 18 ans Georges Vassier, demeurant rue de Picardie à Bab-el-Oued, Manuel Rodriguez, chauffeur d'auto se disant aussi " actuellement sans travail " , " Julot ", journalier de 17 ans, Auguste Albuixich, âgé de 20 ans, se disant imprimeur , un tapissier, un tailleur, un charretier et enfin un cordonnier. En janvier de la même année, quarante personnes étaient arrêtés à Alger, dont vingt assez suspectes pour être maintenus .
Assez cosmopolites quoique rassemblant quasi exclusivement Européens et juifs, l'écrivain Louis Bertrand offrait en 1899 une description intéressante de ces bandes de voyous d'Alger dans l'un de ses romans, lorsqu'il évoquait l'atmosphère des rues de la Marine :
" Du milieu de cette tourbe, surgissaient quelquefois deux ou trois voyous, Français le plus souvent, ou métis d'Espagnols, de Maltais, de Napolitains. Habillés de défroqués, pustuleux et blêmes, ils montraient quelque chose d'encore plus sinistre que le voyou parisien. "
Anne-Marie de Bovet, Française de Métropole qui n'aime guère les Arabes et tout ce qui vient du Sud en général, écrivait quant à elle, toujours à propos des rues du quartier délabré de la Marine :
" Au demeurant, résultat habituel des juxtapositions de races, la fusion ne s'opère que par les vices. Espagnols pouilleux, Maltais crapuleux, gouapes d'Italie, écume de Provence, est fâcheusement représentative de la postérité de Japhet. En contact avec la famille sémitique par les petits Juifs sordides et la tourbe de ces " Beni-Ramassés " n'ayant plus guère de musulman qu'un torchon sale enroulé autour de la chéchia crasseuse, ils ont mis en commun leur ivrognerie avec la fainéantise de ceux-ci et la lâcheté de ceux-là. "
Je vous avais prévenu que Mme de Bovet n'aimait pas les gens du Sud...
Le Gavroche Algérois Cagayous n'a pas non plus manqué d'évoquer ces " chiqueurs sans travail, vec la casquette à la mode ", tandis que le magazine Alger-Etudiant, dans un article consacré au quartier Belcourt présentait à ses lecteurs, parmi quelques figures traditionnelles du " tout-Belcourt nocturne ", " ce jeune apache en casquette avec ses pantalons étroits à la maquereau et son mouchoir au cou ", ou ces " voyous qui battent une ronda " (jeu de cartes) dans un " vieux café obscur ", " avec les regards et les expressions terribles que l'écran confère aux boys de l'Ouest américain " ... Truands du quartier Belcourt qui connaîtront d'ailleurs une renommée mondiale grâce à Albert Camus, qui dans son roman " L'étranger " invente le personnage de Raymond Sintès, proxénète notoire particulièrement violent.
Deux bandes s'affrontent à Alger en 1914, et cette rivalité va prendre une nette dimension " Bab-el-Oued contre Alger-Ville ", voire " faubourg ouvrier " contre " quartier riche ".
La bande de Bab-el-Oued sera les " Oxygénés ", son ennemie les " Dominos ". Leurs membres se fabriquent leurs propres codes, en particulier à travers le costume, renommés qu'ils sont pour leur impeccable élégance. Ainsi en janvier 1914, " quatre oxygénés reconnaissables à leur chevelure teinte, ont été pris " , indiquait L'Echo d'Alger. Les surnoms font aussi partie du jeu. On trouve par exemple, dans toutes ces bandes, Tarentino Joseph, dit " Cagayette ", Castaldi dit " le Catholique ", Goth dit " l'As de Pique ", Zitoun dit " Charlot ", Font dit " Z'yeux bleus ", Jacob Ouzilou dit " Paillasse ", François Ripoll dit " Poussat ", Gaëtan Immagini dit " le Frisé ", Jérôme Di Meglio dit " Dji ", " le Gommeux " alias Joseph Aboulker, " Caltarodj ", " le Juif ", " le Catalan "...
Ces voyous sont aussi des artistes ; voici ce que les apaches Oxygénés fredonnent le soir à la geôle :
" 1er Couplet
A Alger on remarque deux bleds
Alger-Ville et puis Bab-el-Oued
Où l'on rencontre deux camps retranchés
Les Dominos sont des barbots très riches
Qui s'disputent pour la femme à pastiche
Mais il est à remarquer
Que tous les Oxygénés
Se rebiffent pour la " Liberté ".
Refrain
Mais Agathe qui est la maîtresse
D'un Domino faut qu'on la dresse
Nous sommes ici tous de bons travailleurs
Qui n'combattent seulement que pour l'honneur
A la place Mahon faut qu'on apprenne
Qu'à la Carrière y a des hommes tout d'même
Nous sommes toujours prêts à nous mesurer
Avec tous ces em... [sic] "
Au-delà du folklore, ces rivalités donnent lieu régulièrement à des drames sanglants. L'année 1914 voit se dérouler plusieurs fusillades entre Oxygénés et Dominos, sur fond de suprématie, questions de maîtresse, honneur, vengeance, etc. Comme ce 20 avril où rue des Trois-Couleurs, à la suite de différends divers, le jeune maçon Georges Vassier, dit " Tchoulo ", chef des Oxygénés, blesse grièvement le Domino Jules Follana. Deux Oxygénés sont également blessés par balle, dont un grièvement. Le 27 août 1911 déjà, au Beau-Fraisier, les journaux nous apprenaient que " de paisibles joueurs de boules " étaient " provoqués et roués de coups par une bande de jeunes gens du quartier Bab-el-Oued " . Il y eut deux victimes, Messori et Vicidimoni, tués à coups de revolver. L'un des deux principaux accusés était mineur.
Ces vauriens se livrent à leurs méfaits en pleine rue, y compris place du Gouvernement, équivalent algérois de la Canebière. Ainsi Marcel Amat, 19 ans, mieux connu sous le sobriquet de " Petit Maréchal " et grand ennemi du chef de bande Antoine Pappalardo, le jour même où il fut blessé par un homme de main de ce dernier se promène en voiture dans les rues de Bab-el-Oued en criant à tue-tête : " Pappalardo, à ce soir ! ". C'est lui toutefois qui, ce soir-là, sera une nouvelle fois blessé, grièvement ... Ceux-ci, parfois véritables bras cassés, mettront en danger la vie de passants que seul le hasard aura placé sur leur route, comme ce 6 juin 1913, où c'est un inoffensif marchand de sandwich de 51 ans, François Rizza, qui est gravement atteint par une balle de revolver .
Oxygénés contre Dominos organisent enfin un soir de juillet 1914 une fusillade en plein cœur de Bab-el-Oued, blessant notamment une passante à la cuisse et manquant de toucher une fillette . Détrousseurs, ils s'en prennent à la fois à des Arabes et à des Européens démunis, mais aussi à la bourgeoisie algéroise. C'est à partir de là qu'ils commencent à inquiéter plus sérieusement la presse : " La vie est chère et nos apaches trouvent insuffisant le revenu qu'ils tirent de leurs relations féminines. Aussi commencent-ils à assommer pour les dévaliser les bourgeois qui sont obligés de rentrer tard chez eux. Maintenant que ces messieurs passent des paroles aux actes, va-t-on se décider à les prendre au sérieux ? " , se plaint par exemple un journal d'Alger.
Dans les journaux en effet, on s'interroge. Comment remédier à ce mal ? Si Henri Moineau, journaliste aux " Nouvelles ", songe à la relégation (peine d'éloignement s'appliquant aux récidivistes), son confrère de " L'Echo d'Alger " Albert Favreuil lance ses propres idées. La plupart étant somme toutes assez banales (traquer les souteneurs notoires, les condamner à l'emprisonnement...), quand vient enfin l'inévitable question de la nationalité : " Un autre moyen de lutte est encore l'expulsion du territoire français des souteneurs apaches d'origine étrangère - et ils sont la majorité à Alger - qui trouvèrent bon de conserver leur nationalité pour échapper aux obligations de citoyen français, mais trouvent également bon de pratiquer en territoire français leur honteux mais lucratif métier " .
Organisés sur le modèle des voyous Parisiens, les souteneurs y sont légion. C'est le cas par exemple de Thomas Cerdan, dit " Le roi d'Espagne " (en raison, paraît-il, de sa ressemblance avec Alphonse XIII), un des apaches Algérois les plus célèbres et les plus redoutés, membre de la bande des " Hirondelles " et jeune tapissier, mais surtout souteneur, de 17 ans. Présenté comme " despotique " à l'égard de ses nombreuses maîtresses, il comparaît en octobre 1914 pour coups et blessures sur l'une d'elles, Covès Dolorès. Mais il n'était pas seul : deux autres femmes, qui l'accompagnaient, et que L'Echo d'Alger présente comme de " fidèles sujettes du" Roi " " , continuèrent en effet à frapper Covès Dolorès, avant de lui voler sa montre en argent. Cerdan écope de six mois de prison et six ans d'interdiction de séjour. Une autre de ses " maîtresses ", Germaine Roussillon, " femme fatale " célèbre " dans le bas-monde de Bab-el-Oued " d'après L'Echo d'Alger, n'est quant à elle âgée que de 16 ans. Cerdan l'aurait enlevé et menacé avec une autre de les " brûler " avec son revolver si elles ne se prostituaient pas pour lui. Ce dernier refait parler de lui en 1921 lorsqu'un bateau l'emmène, comme forçat, d'Alger vers la Guyane. Au moment où il paraît sur le port, avant l'embarquement, une voix perçante part de la foule : " Assassin, tu as tué ma sœur, sois maudit " .

L'Echo d'Alger du 23 avril 1914,
" La fusillade de la rue des Trois-Couleurs ".
A gauche, le chef des Oxygénés, bande de Bab-el-Oued.
A droite, un membre des Dominos.
Mais ce sont également d'honnêtes travailleurs sans histoire qui peuvent basculer dans le crime. Alger sera ainsi troublé, l'année 1913, par le meurtre rue d'Isly du jeune truand Marseillais Alexandre Genre.
Alexandre Genre, âgé de 25 ans et tout juste arrivé de Marseille à Alger (d'où, probablement, son surnom de " Marius ") où il habite un garni de la rue Rovigo en compagnie de sa maîtresse, " danseuse ", va en effet mourir assassiné, le 16 février 1913 au soir, suite à un règlement de comptes l'opposant à trois jeunes Algérois. Décrit par tous ceux qui l'ont côtoyé comme une brute, mi-tombeur - mi-costaud, ce dernier cherchait alors à établir sa royauté sur le quartier d'Isly. Maquereau, il est déjà, à Marseille, sous le coup de quatre à cinq condamnations pour vol, abus de confiance et violences. Et si sa carte d'identité donne la profession de marchand de primeurs, sa carte d'électeur le dit pâtissier...
Le soir du meurtre, " vêtu élégamment d'un complet marron, chaussé de bottines vernies " et " coiffé d'un chapeau melon " , le Marseillais Genre se dispute, rue d'Isly, à la terrasse d'un café lorsque surgissent ses futurs meurtriers, dont l'un est armé d'un bâton, tandis qu'un autre cache dans sa poche un revolver... Une bagarre éclate après que Genre, muni semble-t-il d'un couteau, les ait accostés brutalement. Puis tout s'enchaîne, et le voyou Marseillais croule sous les coups de bâton :
" Un grand individu, vêtu à l'européenne, coiffé d'une chéchia, portant un burnous en laine blanche sur le bras et tenant une matraque à la main, riposta aux spectateurs qui lui reprochaient de s'acharner sur le fuyard [le fuyard en question est Alexandre Genre] : " Mais regardez donc dans quel état il a mis mon frère hier : c'est lui qui lui a poché l'œil de cette façon ! " Et il montrait un de ses compagnons, paraissant âgé de 16 ans, et vêtu à l'européenne, n'ayant du reste, nullement l'air d'un indigène ", relate L'Echo d'Alger du lendemain. Ce grand individu en burnous et chéchia frappant Alexandre Genre avec son bâton, c'est Charles Auguste Vidal, maçon âgé de 20 ans demeurant à Belcourt avec sa mère (" une brave femme " , d'après L'Echo d'Alger). Il s'était, en effet, ce soir-là " habillé en arabe " (sic), chose qu'il dit faire souvent. Son " frère " à l'œil poché, est en réalité un ami à lui, Joseph Alarcon, ouvrier-typographe du même âge demeurant rue Marengo (Basse-Casbah) et victime, quelques jours auparavant, alors qu'il assistait à un match de boxe salle Bussutil, de la violence gratuite d'Alexandre Genre. C'est après cette agression que Charles Vidal se proposa, voyant l'œil poché de son ami, de le venger. D'où les coups de bâton... Le troisième homme, ami des deux autres, Antoine Galati, forgeron-serrurier de 21 ans demeurant Rampe Valée, sera le meurtrier. Lui aussi, paraît-il, aurait eu des comptes à régler avec le Marseillais.
Genre échappant aux coups de bâton et poursuivi par les trois hommes, va trouver refuge dans le café Le Bar Mondial, où il cherche à se procurer un " pétard " pour, dit-il, " buter " ses agresseurs. En vain. Puis il menace de leur jeter une chaise sur la tête. Joseph Alarcon sort alors le revolver qu'il tenait dans sa poche mais, n'osant pas s'en servir, le passe à Galati. Celui-ci, mal vêtu et chaussé d'espadrilles, prend peur, et finit par tirer. Ce qui ne devait être a priori qu'un simple règlement de comptes à coups de bâton vire au drame. " Je suis touché ! ", s'écrie le Marseillais. " Au revoir, mes amis. Au revoir, mes amis. C'est fini, je vais mourir ", murmure-t-il ensuite avec difficulté, avant de rendre le dernier soupir. L'autopsie conclura à une hémorragie interne après perforation du poumon.
Les trois hommes quant à eux sont arrêtés le lendemain du crime, après avoir réussi à s'échapper au prix d'une longue course-poursuite avec la police. Charles Vidal, le Scapin en burnous, qui lors de son interrogatoire répète inlassablement " moi je n'y suis pour rien ! ", tente de se justifier devant les policiers :
" Hier, dimanche soir, à neuf heures, en allant avec Alarcon au Cinéma de la salle Barthe, nous avons été accostés par un grand type qui dit à mon copain : " C'est toi le petit d'hier ? " - Alors Alarcon répondit : " Laisse-moi tranquille, je ne te dis rien. " Voyant ça, j'ai dit au grand type : " Tu n'as pas honte de t'attaquer à ce petit ? Moi, si tu veux, je suis ton homme. Et nous avons commencé à " nous donner " " , avant d'évoquer en ces termes la fusillade :
" Au moment où il allait me cogner avec une chaise, un coup de " soufflant " est parti d'à côté de moi, et le type a " flanché ". Quand j'ai vu ce Trafalgar, j'ai joué des jambes avec Galati et Alarcon. "
Le journaliste de L'Echo d'Alger qui suit l'affaire, A. Dollé, décrira ainsi les trois accusés : " Ce ne sont pas des bandits endurcis, ni même, comme l'on dit dans la pègre, " des mecks à la redresse ". Jeunes gens [...] entraînés par des fréquentations peu recommandables, ils avaient, peu à peu, pris du mauvais pli. C'est ainsi qu'ils aimaient à mener grand bruit dans les lieux publics, à chercher querelle pour un oui pour un non, à échanger des horions, à en recevoir très souvent ; clients assidus des cafés et bars, c'est là qu'ils tâchaient de se donner l'illusion qu'ils étaient " des hommes ". Seulement, ils ont pris leur rôle trop au sérieux, et pour leur coup d'essai, ont tué un homme. "
Ceux-ci en effet n'avaient jusqu'ici jamais encouru de condamnations, et le même journal, quelques semaines plus tard, suite à leur mise en liberté provisoire présente les deux complices Alarcon et Vidal comme " des jeunes gens travailleurs " , tandis que Galati, auteur du coup de feu mortel, fait lui l'objet d'une détention préventive.
Les trois sont jugés, cinq mois après les faits, à la Cour d'Assises d'Alger. La salle d'audience est bondée. Nous sommes en plein mois de juillet, l'atmosphère est irrespirable. Les accusés, s'ils reconnaissent les faits, nient toute préméditation et Galati explique avoir tiré par peur d'être tué. En outre, toutes les personnes citées font des dépositions accablantes pour la victime. L'accent est mis sur le caractère violent d'Alexandre Genre. " Il m'a fendu la lèvre, je ne sais pas encore pourquoi ", explique le témoin Jean Sintès dit " Tchato ", récemment condamné pour vol, à qui le Marseillais porta un sérieux coup de poing à la figure. Et l'on en vient à fustiger... Marseille !, dont les voyous viendraient troubler la douce quiétude des Algérois. L'avocat de Charles Vidal, Maître Montès, qui ne manque pas d'esprit déclare :
<
br /> " Nous devons à la bonne ville de Marseille deux fléaux ; les grèves maritimes et les apaches. Ces derniers traqués par la police que l'on réorganise là-bas, viennent ici et songent immédiatement à régner en maître sur les petits algériens ; de là le drame que le jury a à juger ".
Mais oui, c'est évident !
Joseph Alarcon, quant à lui, ayant depuis quelques mois, contracté un engagement au 1er Tirailleurs, se présente en uniforme. Bon point. Son avocat demande la liberté :
" Son bataillon vient d'arriver par le " Timgad ", ses camarades ont défilé à Longchamp le 14 juillet, lui a défilé à la Cour d'Assises. [...] Permettez-lui d'aller reprendre son sac, son Lebel et de partir ce soir même avec ses camarades de régiment "...
Après une délibération très courte du jury, la Cour prononce l'acquittement des trois hommes, sous les applaudissements.

L'Echo d'Alger du 18 février 1913, " Le Meurtre de la rue d'Isly ". De gauche à droite : Charles Vidal, Antoine Galati et Joseph Alarcon.
Le phénomène de bande ne va pas s'enraciner à Alger, à l'inverse de Marseille ; Alger qui comme la Métropole voit la fin du temps des " apaches " au lendemain de la Première Guerre mondiale.
Ce qui ne doit pas nous empêcher de raconter quelques anecdotes.
Evoquons une bande de dangereux cambrioleurs, la " bande à Zigomar ", sévissant à Mustapha-Belcourt (banlieue d'Alger) à la veille de la Première Guerre mondiale. Une bande dirigée par Jean Hasselot dit " Zigomar ", mécanicien en rupture de ban aidé de son lieutenant Palaccio, ferblantier de 20 ans. Ces derniers s'attaqueront notamment à une fabrique de pâtes où ils dérobent une somme de six francs dans le comptoir, et, " mécontents de la recette " (on aurait pu le deviner), se mettent à répandre de l'encre sur les pâtes contenues dans la vitrine et à en piétiner une centaine de kilos. Ils rejoueront la même scène dans des bars du quartier où, après un échange de coups de feu, la police parvient à les arrêter. Police qui n'aura d'ailleurs aucun mal à les inculper : ainsi Jean Hasselot sera dénoncé, pour révéler sa participation à plusieurs cambriolages, par son chapeau de paille et... par ses espadrilles !
La citation de la chronique policière de L'Echo d'Alger vaut le détour :
" Tandis qu'il continuait l'interrogatoire d'Hasselot, M. Roddier s'aperçut que le bandit était chaussé d'espadrilles noires, dont l'une était tachée d'huile. Or il y a quelques jours, des cambrioleurs s'étaient introduits chez MM. Fratissier et Bouchard, 47, rue d'Isly. Ils avaient dérobé une certaine quantité de timbres et un brillant de valeur. Pour opérer avec plus de précautions, l'un des malfaiteurs avait jugé prudent de se déchausser. Il avait mis ses souliers dans un coin. Mais du bruit vint déranger les cambrioleurs ; celui qui s'était déchaussé n'eut pas le temps de reprendre ses souliers et se contenta d'enfiler une paire d'espadrilles noires, laissée par un employé. Or, détail consigné dans la plainte, l'une de ces espadrilles noires était tachée d'huile. Celles que portait Hasselot au moment de son arrestation provenaient donc bien du cambriolage. En outre, les souliers retrouvés chez MM. Fratissier et Bouchard chaussaient exactement " Zigomar ". Comme pour le vol du boulevard Général-Farre, Hasselot a nié. " (L'Echo d'Alger du 19 août 1913)
Les deux voyous sont aussi poursuivis pour un cambriolage commis l'été dans la riche villa algéroise du comte russe Schourak, résidant en Russie dix mois sur douze (il est en effet courant que les projets de cambriolage visent les villas, le plus souvent habitées par de riches Français Métropolitains et vulnérables une partie de l'été, ces derniers se rendant en Métropole pendant leurs vacances ).
Pour finir, citons une affaire de vol bien plus ordinaire mais non moins sévèrement punie, jugée en mars 1913 et relatée par L'Echo d'Alger :
" Le 17 décembre dernier, vers 11 heures du soir, Mme veuve Esposito, propriétaire d'un café sis à Bab-el-Oued, rentrait à son domicile privé et constatait avec stupéfaction que son armoire avait été ouverte, les tiroirs visités et que des bijoux, de l'or et du linge, le tout estimé à 1.500 francs environ avaient été dérobés. Les soupçons se portèrent immédiatement sur sa jeune domestique Jeanne Ferrandiz, âgée de 17 ans, qui, arrêtée, déclara que l'auteur du vol était son amant François Serrer, maçon, 22 ans, sur lequel cependant les meilleurs renseignements étaient donnés. Sous la menace de ce dernier, elle avait dû laisser s'accomplir le vol. A l'audience, Jeanne Ferrandiz maintient ses précédentes déclarations. Quant à Serrer, il affirme plus que jamais qu'il est innocent. " C'est, dit-il, pour se venger de mon abandon que Jeanne Ferrandiz m'accuse. C'est une vengeance. " " (L'Echo d'Alger du 2 mars 1913)
Après une remarquable plaidoirie du célèbre avocat Algérois Ladmiral, le tribunal acquitte François Serrer. Jeanne Ferrandiz, quant à elle est condamnée à la détention, pour trois ans, dans une colonie pénitentiaire.
Mais la délinquance à Alger, ce sont aussi les personnages troubles de la rue, tels certains joueurs de poker spécialisés dans la triche, ou les joueurs de " tchic-tchic " (jeu de dés). " Dans les cafés - on ne disait jamais bistrot - sur une table de marbre, on voyait [des] hommes en bleu de chauffe assis près d'un gros poisson ou d'une énorme pastèque qu'ils vous proposaient de gagner au " tchic-tchic " contre une mise de " cent sous et rendus " ", se souvient Gabriel Conesa, qui se rappelle également des " vrais " joueurs, se tenant près des Trois-Horloges, " les Arabes qui méprisaient poissons, allumettes et pastèques et ne jouaient que de l'argent contre de l'argent, des petits truands qui séjournaient périodiquement à Barberousse, prison qui domine le quartier " .
C'est ainsi qu'en octobre 1933 comparaît pour outrage à agent un certain Marc-Vincent Pastor, 26 ans, qui lorsqu'un gardien de la paix cherche à " empêcher l'un de ces encombrants Arabes joueurs de " tchic-tchic " d'exercer son métier, qui - affirme L'Echo d'Alger - consiste à exploiter les " poires " ", intervient, " prenant la défense de l'Arabe, s'adressant grossièrement à l'agent ". Pastor est ensuite conduit au commissariat, pour être condamné à huit jours de prison avec sursis .
Est-ce, au-delà de la vantardise, les exploits auxquels se livrent ce type de truands qui font dire à un " jeune ", " aux sourcils touffus, le veston canaille ", rencontré par l'écrivain Henry de Montherlant dans l'entre-deux-guerres à Bab-el-Oued : " Alger ? qu'est-ce que c'est, Alger ? Belcourt, y a que des nouilles. Mais Bab-el-Oued, c'est Chicago " ? Cela dit un journal Algérois, tout en admettant que " la bohème ", à Bab-el-Oued, " compte de nombreux représentants ", tenait à préciser que " sous la protection de Saint-Joseph et Notre-Dame [d'Afrique] ", le faubourg " conserve des mœurs pures " ...
Marius Piedineri
01 L'Echo d'Alger du 22 juillet 1914.
02 L'Echo d'Alger du 20 février 1914.
03 L'Echo d'Alger du 8 février 1914.
04 L'Echo d'Alger du 1er avril 1913.
05 L'Echo d'Alger du 3 avril 1913.
06 L'Echo d'Alger du 20 juillet 1914.
07 L'Echo d'Alger du 23 janvier 1914.
08 L'Echo d'Alger du 25 janvier 1914.
09 Louis Bertrand, Le sang des races, Robert Laffont, 1978 (1899), p. 202.
10 Franck Laurent, Le voyage en Algérie, Anthologie des voyageurs français dans l'Algérie coloniale, 1830-1930, coll. Bouquins, Robert Laffont, 2008, p. 881.
11 Alger-Etudiant, décembre 1932, " Nous vous présentons... Belcourt ", par Desportes.
12 L'Echo d'Alger du 25 janvier 1914.
13 L'Echo d'Alger du 26 mai 1912.
14 L'Echo d'Alger du 9 août 1913 et Annales Africaines du 13 juin 1913.
15 L'Echo d'Alger du 6 juin 1913.
16 L'Echo d'Alger du 20 juillet 1914.
17 Annales Africaines du 12 décembre 1913.
18 L'Echo d'Alger du 20 août 1913.
19 L'Echo d'Alger du 25 octobre 1914.
20 L'Echo d'Alger du 25 janvier 1914.
21 L'Echo d'Alger du 19 avril 1914.
22 Annales Africaines du 27 octobre 1921.
23 L'Echo d'Alger du 17 février 1913.
24 L'Echo d'Alger du 18 février 1913.
25 L'Echo d'Alger du 18 février 1913.
26 L'Echo d'Alger du 18 février 1913. Sur cette affaire : L'Echo d'Alger des 17, 18 et 19 février, 13 mars et 22 juillet 1913 ; Le Semeur algérien du 27 juillet 1913.
27 L'Echo d'Alger du 13 mars 1913.
28 Et en effet la villa du comte était en son absence occupée par le docteur Fuster, qui estivait alors en France (le gardien, M. Jourdan, jeune homme de vingt ans, était absent le jour du cambriolage).
29 Gabriel Conesa, Bab-el-Oued, notre paradis perdu, Robert Laffont, 1970, p. 142.
30 L'Echo d'Alger du 12 octobre 1933.
31 Franck Laurent, Le voyage en Algérie, op. cit., 2008, p. 970-971.
32 La vie algérienne, tunisienne et marocaine du 10 mai 1927.
|
|
CITATIONS
De L'Effort Algérien
|
Pour les hommes fortement racinés, la France, avec plus de majesté, c'est la mère, et la province, avec plus de tendresse c'est la maman.
M. DONNAY
Toute doctrine doit être jugée, selon les principes sociaux qu'elle fortifie ou menace.
C'est facile de se passer d'un mets dont on n'a point tâté ; il n'a pas de goût puisqu'on l'ignore.
J. CLARETTE.
Les hommes ont des girouettes sur leurs toits, et leurs doctrines changent avec le vent.
Catherine, EMMERICH
Les saints goûtent peut-être rarement la paix, mais ils connaissant la joie.
CHESTERTON
Il faut laisser faire Dieu et nous endormir comme des enfants dans le soir de nos soirs.
BARBUSE
La loi ne règle plus l'ordre, mais le désordre.
A. SUAREZ
Dix minutes font parfois la durée d'une existence ; en d'autres cas, vingt années coulent sans qu'on les voie.
ESTAUNIE
Plaçons la vérité sur tous les chemins ou peuvent s'enfuir ceux qui ont une heure désiré la lumière.
Jean MORIENVAL
L'homme de génie tirait de Dieu son prestige ; il portait au front comme une auréole de l'esprit créateur. Il n'est plus aux yeux des athées qu'un très habile ouvrier spécialisé dans son métier.
DE CUREL
Il vaut mieux faire une sottise de tout son cœur et avec fermeté qu'une bonne action avec faiblesse.
PRINCE DE LIGNE
|
|
|
| La monarchie de juillet et l'Algérie
Envoyé par M. Christian Graille
|
Les relations diplomatiques de la France avec les puissances européennes se trouvèrent profondément modifiées par la Révolution de juillet. Le gouvernement de Charles X, bien vu de la plupart des souverains de l'Europe, se trouvait en bonne posture pour résister aux objections et aux menaces de l'Angleterre.
Après 1830, la Sainte alliance se reforme contre la France :
- Le tsar, Nicolas qui avait poussé la France à entreprendre la campagne d'Alger refusait de reconnaître Louis-Philippe,
- en Autriche, Metternich faisait appel à la solidarité des souverains contre l'esprit révolutionnaire,
- En Prusse Frédéric-Guillaume II était animé des plus mauvais sentiments à l'égard de la France.
Le Roi Louis-Philippe était suspect aux vieilles monarchies par ce que le tsar appelait " une usurpation de famille ". Déjà en 1815, les souverains avaient écarté le duc d'Orléans, dont l'accession au trône aurait créé pour eux-mêmes un précédent redoutable et inquiétant. Les scènes tragiques de juillet n'étaient pas pour les faire changer d'opinion.
Le nouveau gouvernement se trouva donc rejeté du côté de l'Angleterre. Mais cette puissance n'allait-elle pas mettre comme condition à son bon vouloir l'évacuation d'Alger ? Le duc de Wellington y songea : Sachons profiter de l'occasion, écrivait-il, à lord Aberdeen, et hâtons-nous de régler toutes nos difficultés avec la France. "
Le gouvernement eût été jusqu'à un certain point excusable de faire la part du feu en abandonnant notre conquête récente ; il faut lui savoir gré de ne pas avoir cédé à la tentation.
Si la Restauration a eu le mérite d'envoyer nos soldats à Alger, la monarchie de juillet a eu celui de les y maintenir. Le rôle personnel du Roi Louis-Philippe en cette affaire fut considérable. Il défendit la jeune France africaine contre les jalousies du dehors et les préventions du dedans. La guerre d'Afrique fut, comme l'on dit, le roman militaire de la monarchie bourgeoise, le rayon d'idéal dans une époque assez terne.
Pour mieux marquer l'importance qu'il assignait à l'Algérie dans les destinées nationales, il y envoya successivement tous ses fils, le duc d'Orléans, le duc de Nemours, le prince de Joinville, le duc d'Aumale, dont les noms sont indissolublement liés à l'histoire de la conquête.
Sans appui dans le Parlement, mal servi par ses ministres et ses ambassadeurs, abandonné par l'Europe, il finit par triompher de l'Angleterre et de sa mauvaise volonté.
En 1833, Lord Aberdeen, dans une séance de la Chambre des lors, prétendit que Louis-Philippe, au moment de son élévation au trône, avait pris l'engagement de retirer l'armée d'Afrique : " Il existe, déclara-t-il des documents qui prouvent clairement que des engagements positifs relativement à Alger ont été ratifiés non seulement par le Roi de Français mais encore par ses ministres. "
C'est là une pure légende. Les documents historiques des archives françaises et anglaises, les actes et les paroles des ministres de Charles X et de Louis-Philippe montrent au contraire que la France avait gardé toute sa liberté d'action.
Les recherches ordonnées par le duc de Broglie, qui fit dépouiller avec soin toute la correspondance et interrogea M. de Bois-le-Comte, directeur des affaires politiques sous le ministère de Polignac, donnent un démenti aux assertions contraires.
Le gouvernement était résolu à conserver Alger, mais résolu également à s'abstenir de toute déclaration officielle à ce sujet. De là le vague et l'imprécision qui régnèrent longtemps, au moins en apparence.
La question de l'évacuation ou de la conservation d'Alger fut débattue en septembre 1830 au Conseil des ministres ; la discussion fut assez vive ; M. Molé se prononça nettement pour la conservation et les autres ministres, d'abord hésitants, se rallièrent à sa manière de voir.
Les instructions du prince de Talleyrand, nommé ambassadeur à Londres, furent rédigées en conséquence ; elles étaient très nettes et très fermes : " La France, disait le Roi, a un intérêt pressant à diminuer la prépondérance de l'Angleterre dans une mer qui est la sienne et dont l'Angleterre n'est même pas riveraine. Elle doit chercher toutes les occasions de rendre l'occupation de Malte et des îles ioniennes inoffensive. L'entreprise d'Alger peut avoir les conséquences les plus avantageuses pour notre avenir maritime.
Sur cette question la France est en opposition d'intérêt et de politique avec l'Angleterre et aura besoin de toute l'habileté de son ambassadeur. L'affaire d'Alger forme la partie la plus délicate de votre mission. L'évacuation serait contraire à notre dignité et à nos intérêts."
Diplomate de la vieille école, Talleyrand, qui avait toujours désapprouvé l'expédition d'Alger, affectait de dédaigner les questions coloniales. Il parlait le moins possible de ce sujet brûlant : " J'aimerais bien que nos journaux en fissent autan. Il est bon qu'on s'accoutume à notre occupation et le silence est le meilleur moyen. "
Le temps en effet travaillait pour nous. Le 15 novembre 1830, le ministère tory du duc de Wellington fut renversé par un vote de la Chambre des communes. Talleyrand, très influent dans la haute société anglaise n'était pas étranger à cette chute.
Sur ces entrefaites, de graves évènements européens, la révolution belge, l'intervention autrichienne dans les États pontificaux, l'insurrection de Pologne, enfin et surtout la question d'Orient, reléguèrent au second plan la question d'Alger.
Les Français occupaient Anvers, les Russes étaient aux portes de Constantinople, tous les souverains étaient aux prises avec la marée montante des peuples ; l'affaire d'Alger était bien peu de chose à côté de ces graves soucis.
L'Angleterre aimait mieux nous voir à Alger qu'aux bouches de l'Escaut ou à Alexandrie.
La satisfaction de nous avoir écartés des Flandres malgré la révolution belge amena le gouvernement britannique à s'accommoder de notre occupation de l'Algérie. La France put y maintenir son armée, sans toutefois déclarer encore expressément ce qu'elle entendait faire de sa conquête.
Alger le Consul Saint-John gardait toute la confiance de son gouvernement et ne changeait rien à son attitude : " Il est animé à notre égard, disait le général Sebastiani, d'une évidente malveillance, il semble se plaire à susciter des embarras à nos généraux. " Il ne cessait de répéter aux indigènes que notre occupation était provisoire, que l'Angleterre s'opposerait à notre maintien en Afrique et il entretenait parmi les musulmans le secret espoir d'une évacuation prochaine.
Il s'attachait à surveiller et à dénaturer tous les actes de l'autorité française.
La nouvelle de la révolution de juillet et de la désorganisation qui s'ensuivit le remplirent de joie. Il aurait voulu que l'Angleterre profitât des circonstances pour récolter ce que nous avions semé : " Comme je serais heureux, écrivait-il, si nous pouvions mettre la main sur ce pays ! Je vois clairement maintenant que nous pourrions le coloniser et que nous en tirerions d'immenses bénéfices. La principale difficulté est de faire comprendre aux indigènes les avantages qu'ils tireront d'un établissement européen. Or, les Français en sont et en resteront toujours incapables, tandis que notre caractère, qui est bien connu jusqu'aux extrémités de la Régence, nous concilie toutes les populations."
L'Angleterre ferma l'oreille aux insinuations de son fougueux représentant, qui sembla se résigner mais demeura prêt à profiter de toutes les circonstances.
Malgré ses préoccupations européennes, malgré l'entente cordiale, le gouvernement britannique se garda de rien dire ou faire qui pût comporter de sa part une reconnaissance tacite de notre occupation. Le langage des ministres français était soigneusement surveillé.
Au début de 1832 Casimir-Perier ayant déclaré que notre occupation militaire serait maintenue à Alger, lord Londonderry en profita pour interpeller le ministère. L'année suivante le maréchal Soult ayant dit " qu'il n'y avait aucun engagement pris avec les puissances à l'égard d'Alger, que nous pourrions faire à Alger ce que nous voudrions, que les mesures prises par le gouvernement et les crédits militaires qu'il demandait rendaient peu vraisemblable une évacuation du pays," lord Grey se plaignit directement à Talleyrand qui recommanda la prudence.
En 1834, M. Stanley, ministre des colonies, répondant à une interpellation de sir Robert Peel, maintenait que l'Angleterre n'acceptait pas la prise de possession d'Alger par la France.
En 1838, lord Palmerston reparla encore des droits de la Porte sur l'ancienne Régence et déclara que la France n'y exerçait qu'une simple occupation militaire : " La France, on doit le savoir, répondit le comte Molé, ne transigera jamais. La question de nos droits sur Alger est une question jugée depuis longtemps et sur laquelle il n'y a pas à revenir. "
Palmerston dit à notre ambassadeur qu'il ne fallait pas donner à cette discussion plus d'importance qu'elle n'en avait : " Votre gouvernement, ajouta-t-il, peut être convaincu que la possession d'Alger ne deviendra jamais entre lui et le ministère dont je fais partie l'occasion ou même le prétexte d'un conflit sérieux. "
Les protestations de l'Angleterre prirent un caractère de plus en plus atténué, de plus en plus platonique. M. Saint-John continua longtemps à bouder ; en 1839 encore, au moment du voyage du duc d'Orléans, il présenta le corps consulaire sans aucun compliment, se bornant à dire les noms et les titres de ses collègues.
C'est seulement en 1851 que la Grande Bretagne en demandant l'exequatur (procédure permettant de rendre exécutoire en France soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale, qu'elles aient été rendues en France ou à l'étranger) pour le consul qui succédait à Saint-John, reconnut la légitimité de notre occupation.
Le parlement et l'opinion
Le gouvernement de juillet obligé de ménager l'Angleterre, devait par ailleurs tenir compte du parlement et d l'opinion peu favorables à l'entreprise africaine. L'Algérie naissante rencontrait en France plus d'adversaires que de partisans.
Au Parlement, chaque année, au moment de la discussion du budget et surtout des crédits extraordinaires, les députés se plaignaient des dépenses à leur avis excessives qu'entraînait une conquête inutile et demandaient l'évacuation.
M. Desjobert (député), le plus résolu des adversaires de l'Algérie, s'était fait une spécialité de la combattre, déclarant qu'elle était pour la France une cause de faiblesse, que l'argent qu'on y gaspillait serait beaucoup mieux employé en France même et que les Français étaient d'ailleurs incapables de coloniser :
" On composerait plus de cent volumes, écrivait le général Dubourg en 1836, avec les écrits qui, depuis six ans, ont été publiés sur nos possessions du Nord de l'Afrique. La question est-elle maintenant éclairée ? Elle est plus embrouillée que jamais ; grâce au besoin irrésistible que nous avons à faire briller notre esprit, à notre passion pour la controverse, on est parvenu à tellement dénaturer une question positive, que beaucoup de personnes bien intentionnées en sont venues à penser que peut-être il serait plus avantageux d'abandonner Alger puisque nous ne savons pas en tirer parti. "
Toutes les dissertations sur l'Algérie et sur son avenir ne méritent guère de retenir l'attention ; si çà et là on y trouve une idée juste, c'est bien par hasard ; les auteurs en général ignorent complètement les données du problème.
Parmi ces brochures, une des plus lues fut celle de Maurice Allard, intitulée Considérations sur la difficulté de coloniser la régence d'Alger. On y trouve presque tous les arguments qui seront repris pendant plusieurs années par les adversaires de la colonisation algérienne et par l'opposition. Par qui faire cultiver ce pays ? La traite des noirs est supprimée. Les Européens ne s'acclimateront pas, les indigènes sont indomptables. Le pays est d'ailleurs pauvre ; ni les cultures européennes ni les cultures tropicales n'y rencontreront de bonnes conditions : " Hâtons-nous, conclut l'auteur, de renverser dans le port d'Alger les fortifications de cette ville barbare, et que désormais nul vaisseau ne puisse y trouver un abri ; ramenons en France cette armée qu'une terre inhospitalière dévorerait en peu de temps, dont nous pouvons avoir besoin ailleurs et qu'attendent sur nos fortunés rivages les félicitations et les honneurs de la patrie. "
Les plaidoyers des partisans de la colonisation, des " colonistes " comme on les appelait à cette époque, insistaient sur les avantages que la France pouvait retirer de la colonisation de l'Algérie, mais les arguments qu'ils faisaient valoir ne s'appuyaient que sur des données bien vagues, parfois même erronées, comme c'était le cas lorsqu'ils préconisaient les cultures tropicales, canne à sucre, café, indigo, coton.
Au Parlement, il ne fut question d'Alger ni en 1830, ni en 1831, pas plus à la Chambre des Pairs qu'à la Chambre des députés. Un premier débat eut lieu en 1832 à propos du budget de la guerre ; le rapporteur, M. Passy, se plaignit des frais élevés qu'occasionnait le corps d'occupation ; le maréchal Clauzel, M. de Laborde, se prononcèrent en faveur de la colonisation, les ministres Casimir Périer et Soult se montrèrent très réservés.
En mars 1833, à propos d'une demande de crédits supplémentaires, d'éloquents discours furent encore prononcés mais sans qu'il en sortit rien de définitif.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises et de l'expansion de la France dans le monde. Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
| La Colonisation
Envoyé par M. Christian Graille
|
Dans la proclamation qu'il adressa aux habitants à son arrivée à Alger, Bugeaud disait : " La conquête serait stérile sans la colonisation. Je serai donc colonisateur ardent, car j'attache moins de gloire à vaincre dans les combats qu'à fonder quelque chose d'utilement durable pour la France."
Il tint parole. Plusieurs gouverneurs avant lui s'étaient préoccupés de la colonisation mais Bugeaud réussit là où ils avaient échoué grâce à son énergie et à sa ténacité et parce que l'incertitude qui pesait sur l'avenir de l'Algérie avait pris fin avec la conquête intégrale.
Il n'eut pas toujours en cette matière l'appui des pouvoirs publics car le ministère ne partageait pas toutes ses idées et fut même souvent en conflit avec lui. Il avait l'amour, le culte de la terre. Il mérita le beau nom de " soldat laboureur " et fut fidèle à la devise qu'il s'était choisie : Ense et aratro.
Les idées de Bugeaud en matière de colonisation
Le 13 août 1841, Soult adressait au gouverneur général une très longue dépêche dans laquelle il indiquait les vues du gouvernement en matière de colonisation. Il insistait sur la nécessité de fixer en Afrique une population européenne française, autant que possible, passait en revue les divers points où la colonisation pourrait le plus utilement s'établir et les différentes formes à lui donner : Individuelle ou collective, civile, militaire ou pénale.
Bugeaud répondit le 26 novembre en exposant ses vues personnelles qui accusaient quelques divergences avec celles du ministre. Il était en matière de colonisation plus éclectique qu'on ne l'a dit :
" Le maréchal, dit un de ses historiens, n'est l'ennemi d'aucun système et a le rare mérite d'essayer volontiers une idée qui lui parait bonne même si elle ne vient pas de lui. "
Il a marqué sa forte empreinte sur la colonisation algérienne ; il a posé les fondements du système de colonisation officielle, qui a reçu par la suite des modifications diverses, mais qui a toujours été pratiqué. Il n'était plus possible de laisser la population s'installer au gré de sa fantaisie, livrée à tous les hasards de la guerre et de l'insécurité. Désormais le gouvernement prenait à son compte l'œuvre de la colonisation :
- il déterminait lui-même l'emplacement des villages,
- faisait le lotissement des terrains urbains et ruraux,
- désignait les colons auxquels ces terrains seraient concédés sous certaines clauses et réserves.
La colonisation par village et la concession gratuite étaient les deux principes essentiels ; ce système fut critiqué mais a finalement réussi à assurer le peuplement français de l'Algérie.
L'idée moderne du peuplement parait d'ailleurs avoir moins frappé Bugeaud que la possibilité d'une part d'assurer la subsistance de l'armée, d'autre part de consolider l'action militaire et au besoin d'y suppléer.
Il concevait les immigrants comme une garnison permanente qui permettrait de réduire l'effectif des troupes. Appuyer les mouvements de l'armée et participer à la défense du pays c'est ce qu'il exigeait des colons.
On était au lendemain des massacres de 1839 qui avaient ruiné la colonisation libre. La population fut organisée en milices placées sous l'autorité des commandants supérieurs.
L'armée et la colonisation
La préoccupation constante de Bugeaud fut d'associer l'armée à la colonisation. Il lui confia la construction des routes, les plantations ; il fit constituer à côté de chacun des camps permanents une exploitation agricole entretenue par la troupe. Les condamnés militaires sous la direction du colonel Marengo, bâtissaient les villages de Saint-Ferdinand, de Sainte-Amélie, de Douéra.
Bientôt le système fut généralisé ; c'est la main d'œuvre militaire qui installerait désormais les villages et ils ne seraient remis à la direction de l'intérieur qu'une fois construits et plantés.
Cet emploi de l'armée aux travaux préparatoires de la colonisation donna lieu à des réclamations ; on disait que le soldat ne devait que le service militaire et que l'employer à d'autres besognes c'était commettre un abus du pouvoir.
Bugeaud prétendait que l'armée devait être appelée à prendre une grande part à l'œuvre de colonisation. Les routes qu'elle ouvrait, les camps qu'elle bâtissait, les défrichements et les cultures qu'elle opérait, en justifiant complètement l'emploi des troupes aux travaux publics, signalaient l'armée comme un des agents les plus énergiques de la colonisation.
Il estimait que ce labeur loin de nuire au soldat lui était favorable tant au plan physique que moral, qu'il entretenait sa santé et sa vigueur, le préservait de la nostalgie et de l'ennui que produit le désœuvrement.
Il alla encore plus loin dans cette voie. Puisqu'il s'agissait d'une colonisation stratégique, il en conclut que le meilleur moyen de la réaliser était la fondation de colonies militaires.
En 1844, ses projets se précisent. Il propose de réserver aux colons militaires la majeure partie des terres vacantes ; ils seraient organisés en une sorte de légion, recrutés parmi les anciens sous-officiers et soldats encore sous les drapeaux ; ils obtiendraient d'abord une permission pour se marier en France ; puis revenus en Algérie avec leur femmes, ils recevraient un petit domaine où l'État construirait une maison, des instruments aratoires et du bétail, enfin l'habillement et la solde pendant trois ans.
Bugeaud comptait trouver 100.000 colons de ce genre ; à 3.000 francs par colon la dépense eût été de 300 millions à répartir sur dix exercices. Il demandait pour commencer 500.000 francs qui lui furent refusés par la Chambre.
Il revint à la charge en 1847. Tocqueville fit un rapport défavorable, dans lequel il condamnait en bloc la colonisation officielle et déclarait que l'État n'avait pas à intervenir dans l'établissement des colons, œuvre onéreuse et stérile. Le gouvernement retira le projet et le maréchal donna sa démission.
La colonisation militaire est certainement la partie la plus contestable et la plus éphémère de l'œuvre de Bugeaud. Trois essais furent tentés : l'un à Fouka avec des militaires libérés, les deux autres à Béni-Méred et à Mahelma avec des hommes ayant encore trois ans de service à faire.
Le recrutement des colons, assez médiocre, ne comprenait que peu d'agriculteurs de profession ; ils arrivèrent sous la conduite de leurs officiers ; ils reçurent des lots urbains et des lots ruraux et, déposant le sac et le fusil, commencèrent à manier la pioche et la charrue. On les maria avec des orphelines de Toulon auxquelles on donnait une petite dot de 700 francs.
Les colons demandèrent à être dissociés et à travailler chacun pour son compte ; les deux-tiers d'entre eux partirent et les villages ne réussirent qu'après l'adjonction des colons civils.
En réalité il fallait distinguer entre la colonisation militaire qui était une utopie et la colonisation avec le concours des militaires qui était possible et désirable.
Les Saints Simoniens
De 1841 à 1848 d'autres méthodes de colonisation furent essayés. A cette époque bouillonnaient les systèmes de rénovation sociale qui devait aboutir à la révolution de 1848 ; ces systèmes espéraient trouver en Algérie un champ d'expériences favorable. Les Saints Simoniens étaient nombreux :
La Moricière, Louis Jourdan (journaliste) Carette (scientifique, capitaine de génie) Berbrugger (archéologue et philosophe) Warnier (médecin, préfet, député) Urbain (journaliste, interprète) Arlès-Dufour (industriel) avaient adhéré à la doctrine de Saint Simon.
Membre de la commission scientifique de l'Algérie, Enfantin avait séjourné dans le pays de 1839 à 1841. La colonie lui était apparue comme un excellent terrain pour y fonder des établissements civils et militaires complètement régis par l'État, en un mot pour y tenter des expériences de socialisme.
Ainsi l'Algérie et l'Egypte dont les Saints Simoniens se sont beaucoup préoccupés, deviendraient les deux régions destinées à opérer la réconciliation de l'Orient et de l'Occident, de l'Islam et du Christianisme.
En 1843 fut fondé, par Enfantin, le journal l'Algérie qui inscrivit à son programme :
- la colonisation par l'État,
- l'emploi de l'armée aux travaux publics,
- la fondation d'établissements financiers,
- la création de rapports commerciaux avec le Soudan.
- Le Saint-Simonisme insistait sur la nécessité d'une organisation et d'une discipline en matière économique ; il signalait les dangers de l'individualisme. Les fouriéristes étaient plus soucieux de la liberté individuelle.
Enfantin et Bugeaud s'accordaient pour attribuer la médiocrité des résultats obtenus dans la colonisation à l'absence de méthode et de continuité dans l'effort ; ils proclamaient la nécessité de la discipline, le bienfait du principe d'autorité. Cependant les Saint-Simoniens, à l'encontre du maréchal, étaient en général favorables aux grandes concessions.
Essais divers. La grande colonisation
Les lieutenants de Bugeaud, La Moricière et Bedeau ne partageaient pas toutes ces idées en matière de colonisation. La Moricière en avait dressé une de la province d'Oran ; il s'agissait de libérer entre Oran, Mascara et Mostaganem 80.000 hectares sur lesquels on devait installer 5.000 familles ; l'État ne prenait à sa charge que les travaux d'utilité commune : enceinte du village, nivellement, adductions d'eau, chemins ; le reste devait être exécuté par les capitalistes à qui on concédait un village à charge d'y installer des familles.
En 1846 on mit en adjudication la concession à l'entreprise de six villages des environs d'Oran ; un seul, Sainte-Barbe-du-Tlélat, trouva preneur et l'adjudication ne tarda pas à avouer son impuissance. Même insuccès l'année suivante avec d'autres villages.
A Saint-Denis-du-Sig en 1846 on concéda près de 3.000 hectares à l'union agricole qui s'engageait à installer 300 familles européennes. On espérait échapper ainsi à la fois aux inconvénients des grandes concessions individuelles et de la petite colonisation. Les colons ne venant pas on embaucha des salariés. Le travail en commun fut, comme pour les colonies militaires, la cause principale de l'échec ; l'entreprise fut abandonnée en 1853.
De ces diverses tentatives de collectivisme agraire, il n'est rien resté en Algérie, mais l'étatisme s'y est conservé sous la forme de la colonisation officielle.
En 1841 M. de Courcelles visitant l'Algérie suggéra à Bugeaud d'y appeler des Trappistes. Le gouverneur se montra d'abord peu enthousiaste puis se rallia à ce projet avec l'appui de la reine Marie-Amélie.
Les Trappistes reçurent 1.000 hectares à Staouéli et une subvention de 62.000 francs à charge de construire des bâtiments et de défricher. Ils arrivèrent en 1843 avec à leur tête le père Régis ; ils eurent des débuts difficiles mais finirent par réussir d'une manière remarquable et par constituer une très belle exploitation.
Il n'en fut pas de même pour l'abbé Landmann, curé de Sélestat qui, voyant de nombreuses familles alsaciennes émigrer vers l'Amérique, voulut les détourner vers l'Algérie.
La ferme devait être dirigée par un prêtre, construite par des soldats, cultivée par des paysans travaillant en commun et demeurant dans l'indivision. Les résultats furent nuls, l'échec complet.
Dans la région de Constantine le général Bedeau proposait de consacrer à la colonisation 37.000 hectares ; le gouvernement se chargerait des travaux de sécurité, de salubrité et de communication mais, vis-à-vis des colons il bornerait son rôle à l'octroi de la terre après publicité suffisante, en ayant soin de mêler dans les concessions les grands capitalistes et les petits propriétaires, les indigènes et les Européens. La formule qui faisait une place à la grande propriété dans les intervalles des villages était assez heureuse ; les villages donnaient la sécurité, les bras, la main-d'œuvre ; la grande propriété les capitaux, les enseignements, les expériences culturales.
Aux environs de Boufarik l'Haouch-Souk-Ali (1.440 hectares) fut concédé en 1844 à Borély-la-Sapie qui :
- dessécha les marais,
- pratiqua la culture des céréales, du tabac, de l'oranger,
- fit de l'élevage.
La colonisation indigène préoccupait aussi le gouverneur. Bugeaud considérait le refoulement comme injuste et impolitique mais il croyait possible de resserrer sur leurs territoires les tribus qui avaient des terres en surabondance.
Ces emprises devaient être opérées contre paiement ou compensation équitable de manière à mêler partout aux indigènes une certaine proportion d'Européens. Soult parlait d'une colonisation sagement limitée sur des points choisis du littoral ; Bugeaud, au contraire, se refusait à admettre qu'il fût possible de circonscrire une partie de l'Algérie pour en faire une sorte d'île française.
En conséquence, il entendait faire marcher de front la colonisation indigène et la colonisation européenne.
Le foncier
En Algérie contrairement à ce que l'on imagine la grande difficulté a toujours été non pas de se procurer des colons mais de se procurer des terres pour doter ces colons. Bien qu'il ait dans le pays de grandes étendues de terres cultivables et non cultivées, il n'y a jamais eu, en raison des obstacles auxquels on se heurta pour l'acquisition des terres indigènes, de marché de terres comme au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Argentine. Pour accroître les surfaces disponibles, l'ancien domaine du Beylik ne suffisant pas, on confisqua les terres des tribus révoltées dans le Sahel et dans la Mitidja.
De 1830 à 1840, au point de vue de la propriété, on avait positivement vécu dans le chaos. Les transactions immobilières entre indigènes et Européens étaient tantôt autorisées, tantôt interdites.
Une commission fut nommée en 1842 en vue de sortir de ce gâchis et l'ordonnance du 1er octobre 1844, complétée et modifiée par cette du 21 juillet 1846 essaya pour la première fois de régler la question de la propriété foncière. On commença par régulariser la situation résultant des transactions antérieures ; pour le reste du territoire l'ordonnance prescrivit une vérification des titres de propriétés et déclara que toutes terres incultes devaient être réunies au domaine.
Cette idée de l'expropriation pour cause d'inculture était d'ailleurs conforme au droit musulman qui déclarait que la terre devait appartenir à celui qui la vivifie. Les deux ordonnances ne furent appliquées que dans le Sahel, une partie de la Mitidja, aux environs de Bône et d'Oran. Les ordonnances espéraient procurer à la colonisation des terres en abondance mais comme les formalités qu'elles prescrivaient étaient fort longues, le but ne fut pas atteint et les transactions se trouvèrent plutôt ralenties.
Le régime des concessions
Le régime des concessions des terres fut déterminé par l'arrêté du 18 avril 1841. Le colon recevait un titre provisoire qui fixait les conditions qu'il devait remplir et le délai qu'on lui accordait ; lorsqu'il avait exécuté les travaux de mise en valeur, il recevait un titre définitif ; jusque-là ses droits étaient limités ; il ne pouvait se substituer que des personnes agréées par l'administration et souscrivant aux conditions exigées par celle-ci ; il ne pouvait hypothéquer que pour dépenses de construction ou de mise en valeur et avec une autorisation spéciale.
Tout colon Français justifiant de 1.200 à 1.500 francs de ressources disponibles recevait dans un des nouveaux centres un lot à bâtir et un lot de culture de 4 à 12 hectares selon ses moyens :
- Il avait droit au passage gratuit pour lui et les siens,
- pouvait toucher en France des vivres de route,
- trouvait en arrivant des abris provisoires,
- recevait des matériaux pour bâtir, des bêtes de labour, des semences, des instruments agricole.
Le colon était entièrement dans la main de l'administration, mais celle-ci était amenée à lui consentir un appui très large pendant cette période.
C'est le gouverneur qui décidait les créations de centres et donnait les concessions. La direction de l'Intérieur était chargée :
- de la formation des nouveaux centres,
- du choix de leur emplacement,
- de l'allotissement des terres,
- du placement des familles.
Les résultats
Ils sont considérables pendant cette période. La colonisation fut méthodiquement entreprise à partir de 1842.
Une circulaire adressée aux préfets de France fit connaître les conditions à remplir pour obtenir une concession gratuite. Appel était fait en même temps aux ouvriers de métier, maçons, charrons, forgerons, charpentiers qui eux aussi devaient être transportés gratuitement.
A partir de 1843, les demandes de concessions devinrent de plus en plus nombreuses ; elles émanaient souvent de familles de petits propriétaires. Les immigrants français provenaient surtout des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle, des Vosges, de l'Isère.
Parmi les étrangers on comptait beaucoup d'Allemands originaires des pays rhénans, du pays de Bade, du Wurtemberg. En 1846, 800 émigrants allemands destinés au Brésil et abandonnés à Dunkerque furent établis dans les villages de la Stidia et de Sainte-Léonie.
Les Irlandais et les Suisses fournirent un certain contingent.
En 1845 il était délivré près de 6.000 permis de passage individuel ou de famille qui portaient sur plus de 14.000 personnes dont plus de 12.000 Français ; parmi ces derniers 5.000 étaient Alsaciens.
En 1845 l'afflux fut plus fort encore : 46.000 personnes débarquèrent ; le solde net des arrivées diminué des départs atteignit 20.000.. Il y eu plus de 1.800 demandes de concessions déposées à la direction de l'Intérieur. Ce fut le point culminant de l'immigration.
A partir de 1846 diverses causes le ralentirent. Les ordonnances de 1844 et 1846 sur la propriété arrêtèrent les créations de centres nouveaux et on n'eut plus de terres pour les demandeurs.
En février 1846, au moment de la grande insurrection on put craindre le retour des évènements de 1839. Enfin plusieurs mauvaises récoltes, des invasions de sauterelles, une crise immobilière à Alger exercèrent leur influence.
Les colons hésitaient à construire, s'effrayaient du défrichement, perdaient dans les débuts leur temps et leurs forces. A Sainte-Amélie, à Saint-Ferdinand on leur construisit leurs maisons, on leur défricha 4 hectares sur 12.
Les immigrants demandèrent à être groupés entre originaires de la même région : On peupla Chéragas de paysans du Var, comme la Stidia d'Allemands.
Les côtes étaient poissonneuses et inexploitées : trois villages de pêcheurs furent crées à Aïn-Bénian (Guyotville), à Sidi-Ferruch et à Notre Dame de Fouka.
Le chef d'œuvre de la colonisation à cette époque fut le Sahel d'Alger où s'élevèrent de nombreux et beaux villages ; d'autres furent créés dans la plaine de la Mitidja et en bordure de l'Atlas de Blida.
Les environs d'Oran et de Mostaganem, de Tlemcen, de Mascara, la banlieue de Constantine, les routes reliant Constantine à Bône et à Philippeville virent affluer de nombreux colons. Alger se développa et s'aménagea.
Des villes européennes se créèrent dans les trois provinces :
- A Blida, Miliana, Médéa, Koléa, Cherchell dans l'Algérois,
- A Oran Mostaganem, Arzew, Mascara en Oranie,
- à Constantine, Bougie, Philippeville, Bône, Sétif, Guelma dans le Constantinois.
Il y avait 1.500 kilomètres de routes, des services de voitures entre Alger et Médéa, entre Oran et Mostaganem, Mascara, Tlemcen.
Les ports s'outillaient, le commerce se développait.
La Métropole pouvait déjà constater les bénéfices que lui valait sa conquête :
- un accroissement de 40 pour 100 du tonnage de ses ports méditerranéens,
- une plus- value de 25 pour 100 des douanes, représentant un mouvement de marchandises de 60 à 80 millions.
En 1847, au moment du Départ de Bugeaud, il y avait en Algérie 109.000 Européens (28.000 en 1840) et 52.000 Français ; on comptait 15.000 colons ruraux (1.500 en 1840) dont 9.000 Français.
C'est à juste titre que le nom de Bugeaud est lié indissolublement à la conquête et à la colonisation et que, dès 1842 une statue lui a été élevée à Alger. Créateur de l'armée d'Afrique, conquérant et colonisateur de l'ancienne régence, il fut un puissant génie.
C'est à lui que la France doit l'Algérie
et par l'Algérie tout son empire africain.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930
|
|
| L'Algérie sous la Seconde République (1848-1851)
Envoyé par M. Christian Graille
|
Lorsque Bugeaud quitte l'Algérie en 1847 on peut dire que la période héroïque est close. Sans doute, longtemps encore, il y aura des opérations militaires et des insurrections. Le Tell même n'est pas entièrement conquis et le massif si fortement peuplé de la Kabylie du Djurdjura a conservé toute son indépendance.
Mais désormais un fait est acquis : c'est que les Français n'abandonneront pas l'Algérie, qu'ils ne se borneront pas non plus à occuper quelques points sur le littoral mais que tôt ou tard les indigènes devront se soumettre à leur hégémonie dont ne le garantiront ni les montagnes ni le désert.
Jamais plus l'incendie allumé sur quelques points ne s'étendra à l'Algérie toute entière. Il y aura encore de brillants faits d'armes, de pénibles expéditions, de glorieuses conquêtes. Cependant les questions relatives à l'organisation du pays et à sa mise en valeur passent désormais au premier plan.
Ce sont celles auxquelles l'historien doit s'attacher et préférence à partir de cette époque.
La révolution de 1848 et ses conséquences
Presque tous les généraux d'Afrique jouèrent un rôle politique dans la révolution et furent députés à la Constituante ou à la Législative. La plupart de ces officiers ne sortirent d'ailleurs pas grandis d'avoir été mêlés aux agitations politiques.
La candidature de Bugeaud à la présidence de la République prit un moment une certaine consistance mais il ne tarda pas à se désister devant les progrès de la candidature du prince Louis-Napoléon. Il fut nommé au commandement de l'armée des Alpes. Malade mais malade usé il mourut du choléra en juin 1849.
- Changarnier qui commandait l'armée de Paris aspirait lui aussi à la présidence de la République.
- Cavaignac fut ministre de la guerre et chef du pouvoir exécutif ; Il eut la redoutable tâche de maîtriser l'insurrection aux journées de juin. Lorsque le suffrage universel lui préféra Louis-Napoléon pour la République, il quitta le pouvoir avec l'estime universelle mais il avait perdu sa popularité et brisé sa carrière militaire ; il entra dans la vie privée, donnant jusqu'à la fin de sa vie l'exemple de la dignité dans la retraite.
- La Moricière après avoir pris part lui aussi à la répression des journées de juin fut ministre de la guerre et eut à ce titre à s'occuper de l'Algérie.
- Bedeau fut vice-président de l'Assemblée Constituante.
Dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851, les " Africains " Cavaignac, La Moricière, Changarnier, Bedeau furent arrêtés conduits à Mazas puis à Ham, sauf Cavaignac, " momentanément éloignés de la France " disait le décret qui les visait.
L'organisation de l'Algérie
La révolution de 1848 apporta des modifications considérables à l'organisation de l'Algérie et à la politique algérienne. Le pays fut doté du suffrage universel en même temps que la France ; elle élut quatre représentants à la Constituante, trois à la Législative.
L'Algérie fut déclarée territoire français mais elle serait régie par des lois particulières. Un conseil consultatif de neuf membres comprenant :
- deux représentants du peuple,
- deux Conseillers d'État,
- deux généraux,
- un membre de la Cour des Comptes,
- un inspecteur général de l'agriculture,
- un membre du conseil général des ponts et chaussées fut institué auprès du ministère de la guerre ; il était appelé à donner son avis sur toutes les questions intéressant l'Algérie. Les projets de lois, décrets et règlements concernant ce pays étaient soumis à son examen.
Ce comité fut reconstitué en1851 après le coup d'État et le nombre de ses membres portés à onze. Cette utile institution qui eût pu jouer un rôle important disparut en 1858 lorsque l'on créa le ministère de l'Algérie.
Pour l'administration générale la tendance dominante fut d'introduire en Algérie les règles de l'administration métropolitaine. Chaque province fut partagée en territoire civil ou indépendant et en territoire militaire.
Les départements furent soumis au régime général de la Métropole ; ils étaient administrés par des préfets, subdivisés en arrondissements et en communes avec des sous-préfets, des maires et des conseils municipaux élus. Le gouverneur restait investi de la haute administration du pays.
On avait décidé la séparation des deux administrations civile et militaire ce qui entraînait la suppression de la direction des affaires civiles et de la direction centrale des affaires arabes.
Ce régime d'assimilation était tout à fait prématuré. En territoire civil, l'autorité se trouvait partagée et les préfets en relation directe avec le ministère de la guerre ne dépendaient plus que faiblement du gouverneur.
Si le système ne donna pas de trop mauvais résultats c'est que le territoire civil était, à cette époque, fort peu étendu ; il formait une série de taches qui s'étendaient au voisinage d'Alger.
Dès lors les discussions entre les partisans du régime civil et ceux du régime militaire, discussions auxquelles on s'attacha à peu près exclusivement pendant le Second Empire et qui aboutirent à la suppression du gouvernement général en 1858. En réalité la pacification était encore trop incomplète et trop récente pour soustraire les indigènes au régime militaire.
Les gouverneurs généraux de 1848 à 1851 : Charon.
Sept gouverneurs se succédèrent de 1848 à 1851 : Changarnier, Cavaignac, de nouveau Changarnier, Marey-Monge, Charon, d'Hautpoul, Pélissier.
Quelques-uns ne firent que passer ; Charon, seul, demeura un peu plus longtemps (6 septembre 1848-22 octobre 1850).
Né en 1794, il appartenait à l'arme du génie ; entré à l'École Polytechnique en 1811. Venu en Afrique comme capitaine, il y était resté quinze ans, jusqu'au moment où il avait été nommé directeur des affaires de l'Algérie au ministère de la Guerre en juin 1848.
C'était un chef aimable et bienveillant, consciencieux, actif, honnête.
Il eut à lutter contre les bureaux du ministère de la Guerre qui cherchaient à annihiler complètement le gouverneur général.
La Moricière avait été remplacé au ministère de la Guerre par le général Rullières qui ne s'occupait guère de l'Algérie puis par le général Hautpoul qui ambitionnait pour lui-même le gouvernement général.
En fait les questions algériennes étaient traitées par le chef de division Germain, qui s'en remettait aux chefs et sous-chefs de bureau.
Quant aux affaires indigènes elles étaient abandonnées à l'interprète Ismaël Urbain, personnage qui tout en restant dans la coulisse, paraît avoir exercé une profonde influence sur les destinés de l'Algérie : nous le retrouverons en effet parmi les inspirateurs et les conseillers de Napoléon III.
L'instabilité des gouverneurs, des ministres de la Guerre et des chefs d'État qui présidèrent pendant cette période aux destinées de la France, impressionnèrent défavorablement les indigènes et neutralisèrent en partie l'effet moral de la soumission d'Abd-el-Kader.
Des troubles éclatèrent dans les villes, à Alger, à Oran, à Bône.
Des bruits extraordinaires commençaient à se répandre dans le monde indigène :
- on parlait d'une invasion marocaine,
- d'une rentrée d'Abd-el-Kader,
- de la prise d'Alger par les Anglais.
Une certaine agitation se manifestait chez certaines confréries religieuses musulmanes. Cette agitation était, à ce qu'il semble, encouragée et entretenue par les agents secrets de la Turquie et de l'Angleterre.
Le Sud : Zaatcha
Le Sud Constantinois était incomplètement pacifié. La situation était restée telle que la décrivait le duc d'Aumale en 1844 :
" Les Aurès ne sauraient être considérés comme soumis, la résistance y est seulement décomposée et non détruite. "
L'ancien Bey de Constantine était réfugié dans cette région et ses intrigues étaient une des principales causes de l'agitation.
En 1848, le colonel Canrobert conduisit une colonne dans l'Aurès et contraignit Ahmed à se rendre au commandant du cercle de Biskra. Notre vieil adversaire fut interné à Alger où il mourut en 1850 ; mais la crise était seulement retardée.
Il fallut 7.000 hommes de troupe et 53 jours de siège pour venir à bout de cette misérable bourgade saharienne de Zaatcha situé à vingt kilomètre de Biskra.
Ce village en pisé, tout entouré de palmiers, avec des murs séparant les jardins présentaient à l'assaillant des difficultés considérables.
Zaatcha communiquait d'ailleurs avec les autres oasis et avec les nomades qui lui envoyèrent des renforts.
Les ksouriens ayant refusé de payer l'impôt des palmiers, le lieutenant Séroka du bureau de Biskra tenta vainement de les soumettre malgré les renforts de zouaves amenés par Canrobert qui apportèrent le choléra, cause de grands ravages dans les troupes.
Après un siège en règle Zaatcha fut prise d'assaut. Cette bataille nous coûtait 1.500 hommes dont 30 officiers sans compter 600 morts du choléra ; 80 officiers avaient été plus ou moins grièvement blessés.
La prise de Zaatcha mit fin à l'insurrection.
Le général d'Hautpoul
Cette affaire fut la cause ou le prétexte du remplacement de Charon.
Il fut rappelé en France et nommé président du comité consultatif de l'Algérie.
Sa succession fut offerte au général Hautpoul qui paraît bien avoir été un homme assez médiocre.
Il aurait voulu signaler son gouvernement par la soumission de la Kabylie ; il avait arrêté ses plans en conséquence y essaya de les faire agréer par Paris. Il n'y réussit pas et une sorte de transaction fut proposée par le général Randon, ministre de la Guerre ; cette transaction soutenue par La Moricière, Bedeau, Cavaignac, Charon et acceptée par l'Assemblée législative consistait à soumettre la Kabylie des Babors, qu'on prit l'habitude à cette époque d'appeler la Petite-Kabylie avant d'aborder la Kabylie du Djurdjura ou Grande-Kabylie ; mais le général d'Hautpoul, membre de l'assemblée législative, ne pouvant exercer qu'un commandement temporaire fut obligé de rentrer à Paris au bout de six mois.
Pélissier prit l'intérim du gouvernement général qu'il avait déjà exercé pendant les absences du général Charon et qu'il devait garder jusqu'à la nomination de Randon (11 décembre 1851) ; le commandement de l'expédition de Kabylie fut donné au général Leroy de Saint-Arnaud.
La Kabylie
L'agitation qui s'était produite dans le M'Zab par la révolte de Zaatcha s'était également manifestée en Kabylie où de nombreux chérifs avaient fait leur apparition. De 1848 à 1851 des colonnes furent dirigées chaque année aux abords du massif du Djurdjura. Les opérations de 1849 et de 1850 avaient été relativement sérieuses mais la soumission de la région amorcée par Bugeaud ne devait être achevée que par Randon en 1857.
L'expédition valut à Saint-Arnaud le grade de général de division, puis le commandement d'une division de l'armée de Paris, enfin le ministère de la Guerre au 2 décembre.
Aussi a-t-on voulu voir dans cette campagne une préparation au coup d'État.
Au fond l'expédition et le choix de son chef étaient tout naturels et la politique intérieure ne paraît y avoir eu qu'une part minime, si elle l'eut réellement ; mais on donna aux opérations un éclat inusité en les faisant suivre par le commandant Fleury, aide de camp du prince Louis-Napoléon et par des officiers étrangers.
Fleury, qui avait été présenté au prince par l'ancien maréchal des logis Fialin de Persigny, était un brillant officier de spahis mais criblé de dettes qu'on paya.
Il fut chargé de pressentir d'abord Pélissier en vue d'un coup d'État et échoua ;
il s'adressa alors à Saint-Arnaud. On note dans la correspondance de ce dernier les progrès que l'idée faisait peu à peu dans son esprit :
" Je suis plus que jamais homme d'Afrique, j'appartiens à l'Afrique ; je hais la guerre civile, laissez-moi en Afrique. ".
A Paris des tentatives du même genre étaient faites auprès de Randon par le prince-président lui-même. Mais Randon déclara qu'il lui serait impossible de se prêter à un acte qui aurait pour conséquence d'entraîner des régiments hors de la ligne du devoir et que, si l'entreprise devait se poursuivre, il prierait le prince d'accepter sa démission.
Il en résultat que Saint-Arnaud fut appelé au ministère de la Guerre et Randon au gouvernement général de l'Algérie.
Pélissier avait espéré être nommé gouverneur général après Charon, puis après Hautpoul ; il dut se borner à faire l'intérim et après avoir remis le commandement à Randon avec beaucoup de dignité et de tact, il retourna à son poste à Oran.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
Une petite astuce de femme,
Envoyé par M. Hugues
|
|
Deux amies vont au restaurant
En arrivant, elles voient le restaurant complètement plein.Pas de places.
La majorité des tables étaient occupées par des couples.
Une des deux femmes prend son téléphone portable et fait un appel à voix haute au milieu du restaurant en regardant les couples assis...
"Bonjour ma chérie. Je suis arrivée au restau et ton mari est ici, avec une autre femme. Viens de suite..."
Cinq hommes quittent précipitamment le restaurant et partent en courant .
Résultat : cinq tables libérées immédiatement.
|
|
| La colonisation de 1848 à 1851
Envoyé par M. Christian Graille
|
La révolution de 1848 avait marqué son empreinte sur la colonisation algérienne. Les philanthropes des diverses écoles fondaient de grands espoirs sur l'Algérie pour débarrasser Paris des ouvriers en chômage et conduire à l'extinction du paupérisme. La colonisation de l'Algérie paraissait appelée à résoudre la crise sociale. L'État qui avait garanti du travail à tous les citoyens, donnerait un capital au lieu de donner un salaire comme sur les chantiers nationaux.
On concéderait 10 hectares par famille et on distribuerait ainsi 10 millions d'hectares à un million de familles. Les faiseurs de projets ne manquaient pas. Le moment leur paraissait favorable, le nouveau régime devant se montrer plus hardi que la monarchie de Juillet qui opposait toujours son veto aux tentatives de colonisation du maréchal Bugeaud.
Ces projets avaient pour la plupart un caractère utopique, les auteurs ignorant les données les plus élémentaires du problème ou se refusant à en tenir compte. Dans une brochure intitulée : Les villages départementaux en Algérie, on préconisait l'idée, juste en elle-même et qui sera parfois reprise par la suite, du peuplement régional.
Le système consistait à prendre dans chaque département un contingent de colons volontaires et à l'installer en Afrique en centre de population distinct. On établirait dès la première année 40.000 colons ; les frais d'établissement, évalués à 3.000 francs par colon seraient couverts par des centimes additionnels. Ces vues enthousiastes n'étaient pas universellement partagées.
L'économiste Léonce de Lavergne déclarait au contraire que la prompte installation d'une population agricole sur toute la surface de l'Algérie était une chimère ruineuse et rencontrerait des difficultés insurmontables, provenant de l'insalubrité, de l'insécurité et surtout du prix de revient. Il proposait de faire du pays une sorte d'État particulier, annexe de la France, se gouvernant et s'administrant lui-même par un système analogue à celui des colonies anglaises.C'est déjà la théorie du royaume arabe qui prévaudra sous le second Empire. Bugeaud aussi donnait son opinion. Ses colonies militaires, avec le travail en commun, avait été un essai socialiste et collectiviste.
Eclairé par l'expérience et la révolution de 1848, il brûlait désormais ce qu'il avait adoré ; il constatait l'échec de ses propres villages militaires où les colons avaient demandé à être dissociés. Par un singulier concours de circonstance, La Moricière, partisan de la colonisation capitaliste, était appelé à pratiquer la colonisation prolétarienne préconisée par Bugeaud. Il allait faire, dans des conditions assez défavorables et avec des colons dont la plupart n'étaient même pas agriculteurs, mais avec des crédits relativement considérables, les essais tant de fois réclamés par le maréchal.
Colonisation extraordinaire. Les colonies agricoles de 1848
Le décret-loi du 19 septembre 1848 ouvrit au ministère de la guerre un crédit de 50 millions pour être spécifiquement appliqué à l'établissement de colonies agricoles et aux travaux d'utilité publique destinés à assurer la prospérité de nos colonies. Le chiffre des colons était fixé à 12.000 pour l'année 1848. On distinguait les colons cultivateurs ou qui déclaraient vouloir le devenir et les ouvriers d'art. Les colons cultivateurs recevaient une habitation, un lot de terres de 2 à 10 hectares, des semences, des instruments de travail, du cheptel, des rations de vivres. Au bout de trois années, les concessions devaient être mises en valeur sous peine de dépossession.
On voulait que les premiers colons fussent en route avant le petit terme du 8 octobre et on les destinait au village de Saint-Cloud, créé aux environs d'Oran. Sur la Seine, d'immenses radeaux amarrés au quai de Bercy recevaient les émigrants avec leur mobilier. Ils partirent au milieu d'un grand enthousiasme. Le long convoi démarra, tandis que les musiciens jouaient la Marseillaise et que la foule amassée sur les deux rives poussait des acclamations. A Melun, les colons, pris pour des insurgés de juin furent assez mal accueillis.
En vingt ou vingt-cinq jours le convoi remonta la Seine, passa par le canal de Bourgogne, descendit le cours du Rhône puis fut remorqué jusqu'à Marseille ; de là les navires de l'État allaient déposer les émigrants sur la terre algérienne. Une douzaine de convois de ce genre furent organisés et en 1850 on avait transporté environ 20.000 personnes.
En vertu de la loi du 24 janvier 1850, les insurgés de juin détenus à Belle-Île devaient être transférés en Algérie et réunis dans un établissement disciplinaire spécial, entièrement séparé des colonies agricoles. Au bout de cinq ans, ceux dont la conduite était bonne pouvait obtenir une concession provisoire qui devenait définitive sept ans après. On en envoya 450 qui furent internés à la Casbah de Bône en attendant que le pénitencier de Lambèse fût prêt à les recevoir.
Il existait en Algérie une cinquantaine de villages européens et environ 20.000 habitants ruraux. L'émigration projetée devait doubler en quelques mois le nombre des centres agricoles et installer du premier coup 13.500 colons. Le territoire civil ne pouvant y suffire on s'adressa au territoire militaire. Les travaux préparatoires étaient exécutés par les officiers du génie ; les maisons étaient toutes construites sur le même modèle ; à défaut d'élégance, on pouvait espérer qu'elles seraient d'une parfaite solidité ; mais, en beaucoup d'endroits, les entrepreneurs employèrent de mauvais matériaux et commirent des malversations ; en revanche les fortifications furent très soignées.
Quarante-deux colonies furent ainsi créées : 12 dans la province d'Alger :
- Castiglione et Tefeschoun, aux environs de Koléa,
- Novi et Zurich aux environs de Cherchell,
- Marengo, El Affroun, Bou-Roumi entre Cherchell et Blida,
- Lodi et Damiette dans la région de Médéa,
- La Ferme et Pontéba près d'Orléansville,
- Montenotte près de Ténès.
21 dans la province d'Oran :
- Hassi-Ameur, Hassi-ben-Ferah, Hassi-ben-Okba, Hassi-bou-Nif, Saint-Louis, Fleurus, Mangin près d'Oran,
- Saint-Cloud, Saint-Leu, Damesme, Arzew, Moulay-Magoun, Kléber, Méfessour aux environs d'Arzew,
- Aboukir, Rivoli, Toumin, Karouba, Aïn-Nouissy, Aïn-Tedélès, Sour-el-Mitou à proximité de Mostaganem.
Il y avait une soixantaine de concessions par village sauf à Saint-Cloud où le périmètre était plus important.
9 dans la province de Constantine :
- Gastonville, Robertville, Jemmapes dans la région de Philippeville,
- Mondovi et Barral près de Bône,
- Guelma, Héliopolis, Millesimo, Petit dans la banlieue de Guelma.
Les villages ici étaient moins nombreux mais plus importants que dans la banlieue d'Oran ; chacun d'eux comptait 3.000 colons.
Les concessions étaient très peu étendues : 2 à 10 hectares. Il en résulta des dépenses inutiles car il fallut par la suite les réunir deux à deux.
Surtout, et ce fut la principale cause des échecs, ces ouvriers parisiens n'étaient nullement préparés aux travaux des champs. Il y avait parmi eux des horlogers, des ébénistes, des commis de magasins de nouveautés ou de modes ; mais les indigènes n'achètent pas de meubles et les modes les plus nouvelles ne tentent pas leurs femmes.
Les colons improvisés ne savaient pas se servir des instruments aratoires, employaient les semences à contretemps.
- On leur faisait des avances de grains, d'animaux, de matériel agricole,
- on leur fournissait des rations de vivres,
- on faisait même labourer leurs champs par des soldats ou des indigènes.
Dans certains villages, à Saint-Cloud par exemple, on comptait à peine 9 pour 100 d'agriculteurs.
D'autres difficultés provenaient du travail en commun qui avait été prôné dans les clubs comme offrant la solution du problème social, mais que devenus colons, les émigrants étaient unanimes à repousser. Enfin les professeurs et les moniteurs des nouveaux venus n'étaient guère mieux préparés que leurs élèves.
On a prétendu que ces colons de 1848 étaient paresseux, ivrognes, débauchés, indisciplinés, passant leur temps à boire et à faire de la politique. Ces propos ont été exagérés ; on considérait qu'un tiers était appelé à réussir ; à leur décharge ils rencontrèrent des difficultés inouïes ; ils furent très éprouvés par les fièvres paludéennes, par la dysenterie, par les épidémies de choléra de 1849 et 1850 ; les récoltes des premières années furent fort mauvaises ; ils firent preuve de beaucoup d'endurance et n'étaient que le premier contingent envoyé outre méditerranée.
La loi du 19 mai 1849 alloua 5 nouveaux millions pour l'établissement de 6.000 colons et l'administration prépara 12 nouveaux villages pour les recevoir.
5 dans la région d'Alger :
- Ameur-el-Aïn et Bourkika dans la région de Blida,
- Aïn-Benian, Bou-Medfa et Aïn-Sultan près de Miliana.
5 dans la province d'Oran :
- Bled-Touaria, Aïn-Sidi-Cherif, Aïn-bou-Diar et Pont-du-chélif aux environs de Mostaganem,
- Bou-Tlelis aux environs d'Oran.
2 dans la province de Constantine :
- Ahmed-ben-Ali et Sidi-Nasseur à proximité de Jemmapes.
On construisit 700 maisons, on fit les travaux d'adduction d'eau et de chemins nécessaires.
Cependant l'Assemblée Nationale commençait à avoir des doutes sur l'efficacité de cette œuvre.
Une commission d'enquête fut nommée le 20 juin 1849 afin de dresser un rapport circonstancié sur la situation des colonies agricoles ; elle devait examiner la situation matérielle et morale de ces colonies, voir ce qui avait été fait et ce qui restait à faire. Elle devait en outre donner son avis sur la question de savoir s'il convenait de doter les colons du régime civil et dire s'il fallait en envoyer de nouveaux Les 42 colonies agricoles furent visitées.
Le rapporteur observait que le principal vice des colonies résidait dans leur composition même ; former des colonies agricoles à Paris avec des Parisiens était un non-sens ; c'était de la compassion et de l'humanité mais non de la colonisation. Les immigrants étaient presque tous impropres à la vie des champs et sans goût pour elle.
Ils avaient montré beaucoup de bonne volonté mais ils avaient pu se rendre compte que l'agriculture est une carrière ingrate quand on y rentre dans le milieu ou le déclin de la vie car elle exige beaucoup de patience, de vigueur et de santé ; la différence du climat accroissait d'ailleurs les peines et les mécomptes.
Les colons comprirent qu'on leur avait demandé l'impossible. Il ne fallait pas se décourager mais apporter aux nouveaux centres un concours plus efficace et mieux dirigé, n'admettre ni célibataires, ni ouvriers d'art.
Si l'on formait de nouveaux convois d'émigrants il ne fallait en tout cas les recruter à Paris et ne pas les mettre en route avant que les villages fussent prêts à les recevoir.
La loi du 20 juillet 1850 apporta d'intéressantes retouches à l'organisation des colonies agricoles. Les colons destinés à compléter la population des villages fondés en 1848 seraient choisis parmi les soldats ayant servi en Algérie, les cultivateurs d'Algérie et de France mariés.
Les colonies continueraient à être placées sous la direction des autorités militaires jusqu'à l'expiration des trois ans pendant lesquelles elles recevraient des subventions de l'État, mais elles seraient rattachées au ressort de la justice de paix la plus voisine.
En 1851, on se borna à doter les centres des travaux d'utilité publique et des voies de communication qui leur manquaient encore ; on remplaça surtout graduellement les premiers colons par des agriculteurs de profession.
Les très mauvaises récoltes de 1849-1851 obligèrent à prolonger les allocations de vivres jusqu'en 1852.
A la fin de 1852, les titres d propriétés définitifs furent délivrés aux colons qui avaient mis en valeur leur exploitation.
D'après les documents officiels, les 42 colonies agricoles de 1848 comptaient au 31 décembre 1851 10.450 habitants ; on en avait amené 20.000 dont 12.000 en 1848 et 8.000 en 1849-1850. Parmi eux 3.000 étaient morts, 7.000 avait abandonné leur concession ou étaient rentrés en France.
On comptait 3.071 concessionnaires dont 1.858 anciens cultivateurs, 831 anciens militaires. 383 de professions diverses.
Les colons possédaient 26.000 hectares de terre, dont 15.000 avaient été défrichées et 11.000 ensemencés et 5.000 têtes de bétail.
Colonisation ordinaire et colonisation libre
On continua à créer des villages nouveaux, à peupler les anciens centres, à accorder des concessions en dehors des villages. On faisait appel à l'élément étranger et même temps qu'à l'élément national pour le peuplement ; l'Algérie reçut quelques contingents d'Espagnols, de Suisses, d'Allemands, d'Irlandais.
Soixante-sept familles du Valais furent installées entre le Mazafran et Koléa, notamment à Chaïba.
Des Mahonnais furent établis près d'un ancien fort turc appelé par les Français le Fort-de-l'Eau ; le domaine vacant du prince de Mir à la Rassauta fournit une partie des terres ; les Mahonnais, très laborieux, réussirent très bien dans la culture maraîchère.
En bordure de la Mitidja, au pied de l'Atlas, furent créés le village de l'Arba, au croisement des routes de Blida et d'Aumale et celui de Rovigo à l'entrée des gorges de l'Harrach ; dans la plaine du Chélif, près de Miliana, on fonda Affreville.
Aux environs d'Oran deux villages furent dénommés Valmy et Arcole ; dans la plaine des Andalouses on créa Aïn-el-Turk et Bou-Sfer.
Deux beaux centres qui se développèrent rapidement sur des terres excellentes furent ceux d'Aïn-Témouchent et de Sidi-Bel-Abbès ; dans ce dernier on profita des terres disponibles par suite de l'émigration des indigènes qui, en 1845, avait quitté la région pour ne pas vivre sous la domination des chrétiens.
Dans la province de Constantine, plus vaste cependant que les deux autres, le manque de terres vacantes et la densité de population indigène gênait le développement de la colonisation. On groupait les Européens dans les régions de Bône, de Batna et de Sétif.
A la fin de 1851, 4.773 concessions avaient été accordées ; elles portaient sur 19.000 hectares (Alger 13.000, Oran 3.000 Constantine 3.000).
La population européenne atteignait 131.000 habitants ; son développement avait été retardé par la révolution de 1848 et par les épidémies de choléra.
La population de la province d'Alger qui au début, absorbait la plus grande partie des éléments européens avait diminué (57.000 en 1851 au lieu de 73.000 en 1846) pendant que la province d'Oran (47.000) et celle de Constantine (27.000) progressaient. La population urbaine comptait pour 85.000, la population rurale non agricole pour 33.000, la population rurale agricole pour 33.000. L'élément Français (66.000) et l'élément étranger (65.000) était en nombre égal dans l'Algérois, les Français supérieur dans l'Est et moins nombreux dans l'Ouest où affluaient les Espagnols.
Les expériences faites amenaient à certaines conclusions que l'histoire de l'Algérie a toujours confirmées depuis. Elles montraient qu'il n'était pas possible de faire, dans ce pays, de l'émigration à dose massive comme aux États-Unis. On ne disposait pas d'étendues quasi illimitées de terres fertiles. L'Algérie ne pouvait absorber, comme on se l'est parfois imaginé, 2 à 300.000 émigrants par an. Les crises de 1846 et 1850 se sont produites précisément parce que la capacité d'absorption avait été dépassée en 1845 et 1848.
Si c'était une erreur de croire que les émigrants européens pouvaient affluer en masses compactes, s'en était une et non moins grande de croire le peuplement rural impossible. Voici, par exemple le village de Saint-Cloud :
En 1846, un Espagnol qui avait l'entreprise du service des voitures d'Oran à Arzew, établit en ce point, dans une région complètement inculte et déserte, un relais et une baraque, puis un magasin de comestibles. Un peintre de passage décore la baraque d'une enseigne qu'il intitule : " A Saint-Cloud. "
En 1848, 350 colons s'installent, tant bien que mal, plutôt mal que bien ; ils sont huit dans une chambre. La fièvre, le choléra les déciment ; en trois ans on compte 287 morts pour 134 naissances. Beaucoup repartent.
Deux cents nouveaux colons arrivent en 1850 pour combler les vides. Or, en 1898, Saint-Cloud fêtait son cinquantenaire. Il y avait 5.000 habitants, 500 hectares de vigne donnant 200.000 hectolitres de vin qui valaient près de 3 millions.
A Fort-de-l'Eau où la culture des primeurs enrichit 3.000 Européens montrait aussi que l'on pouvait assimiler les étrangers :
" Nous ne sommes plus des Mahonnais, disaient les habitants, nous sommes des Français algériens, tout comme les Lorrains, les Champenois ou les Provençaux nés en Algérie. "
La situation économique
Elle n'était pas encore très brillante ; elle se développait mais avec beaucoup de lenteur. On continuait à essayer les cultures dites coloniales ou tropicales.
En 1851 le blé tendre et le blé dur étaient cultivés sur 23.000 hectares, l'orge sur 15.000 hectares ; le seigle, l'avoine, le maïs étaient peu développés.
La culture de l'olivier s'étendait dans la province d'Oran, autour de Saint-Denis-du-Sig et de Tlemcen ; pour l'encourager des primes étaient données aux constructeurs des moulins à huile les mieux outillés.
La culture du tabac était prospère ; la récolte de 1851 était évaluée à 746.000 kilogrammes dont 446.000 provenaient des colons.
Les mûriers donnaient 7.800 kilogrammes de cocon qui, après filature, étaient envoyés à Lyon où ils étaient très appréciés.
On plantait le nopal (figuier de Barbarie) à cochenille qui donnait satisfaction à la teinturerie.
Le chanvre, le lin, le coton donnaient des résultats assez encourageants.
On essayait un peu au hasard le pavot, l'arachide, le sésame, le ricin, les plantes odoriférantes.
On importait des plants de quinquina du Pérou et divers végétaux de Bahia.
Parmi les progrès réalisés par les indigènes on signale surtout les constructions.
Un millier d'habitations privées ont été construites à notre instigation dans la province d'Alger, 800 dans la province d'Oran, 400 dans la province de Constantine ; elles ont coûté 2 millions et demi et ont donné du travail aux ouvriers européens pendant la crise de 1848.
Des caravansérails ont été édifiés aux frais des tribus pour jalonner les routes.
Des fondouks (bâtiments permettant d'entreposer les marchandises, d'abriter les animaux et d'héberger les voyageurs), des bains maures ont été installés.
On trouve dans les documents de l'époque assez peu de renseignements sur la production agricole indigène, dont on ne semble pas connaître ou comprendre toute l'importance.
On signale cependant les greffages d'oliviers et les plantations d'arbres fruitiers.
Des efforts ont été faits pour l'amélioration de la race chevaline, notamment par l'organisation de courses de chevaux auxquelles les indigènes se plaisaient à participer. On nota les progrès de la culture des pommes de terre, celle du tabac.
Beaucoup d'indigènes travaillaient dans les fermes européennes.
Avec la cessation de l'état de guerre, le commerce indigène, qui n'avait guère progressé depuis 1830 manifesta une certaine activité. Les principaux articles qui l'alimentaient étaient les céréales, les huiles, les laines.
En 1849 la Kabylie a donné 40.000 hectolitres d'huile. Quant au commerce des laines il était en grand progrès ; les indigènes du Sud commençaient à s'accoutumer aux billets de banque et les acceptaient en paiement. On signalait le rôle commercial des Mozabites comme courtiers de marchandises européennes.
En 1851 le commerce extérieur atteignait 86 millions. Les importations s'élevaient à 66 millions dont 42 venant de France, les exportations à 20 millions seulement dont 11 millions à destination de la France ; dans ce dernier chiffre, les huiles figuraient pour 6 millions ; le reste était représenté par des peaux, des laines, des céréales, du tabac.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
| L'Algérie sous le second empire (1851-1870)
Envoyé par M. Christian Graille
|
Le gouvernement du maréchal Randon (1851-1858)
Le 11 décembre 1851, le général Randon était nommé gouverneur général de l'Algérie.
Né à Grenoble en 1793, capitaine en 1813, il ne devint chef d'escadron qu'en 1830. Colonel du 2e chasseur d'Afrique en 1838, il fut maréchal de camp en 1841 et reçut le commandement de la subdivision de Bône ; il prit part à diverses expéditions, construisit des routes, amorça des travaux de colonisation.
Lieutenant général en 1847, il fut appelé en 1848 à la direction de l'Algérie au ministère de la guerre, en 1849 à la division de Metz et devint ministre de la guerre en 1851, poste qu'il quitta bientôt pour celui de gouverneur général.
Ce n'était pas un sabreur, on ne cite de lui aucun fait d'héroïsme, aucune action d'éclat, aucune parole lapidaire. Son caractère reflète dans sa physionomie calme.
Il était honnête, calme, bon administrateur, un peu terre à terre et sans beaucoup d'envergure ; méthodique et prudent, il ne laissait rien au hasard ; il n'avait assurément pas le génie militaire de Bugeaud. Il a pacifié le Sud sur lequel il se faisait d'ailleurs de grandes illusions, soumis la Kabylie, donné une vive impulsion aux travaux publics, continué autant que possible l'œuvre de Bugeaud concernant la colonisation qui répondait à ses idées mais qui était devenu impopulaire.
Napoléon III et l'Algérie
Il semble n'avoir jamais eu pour l'Algérie qu'une sympathie assez médiocre et disait que l'Algérie était un boulet attaché aux pieds de la France. Il ne semble avoir été frappé ni de l'avenir commercial et colonial du pays, ni de la mission de civilisation à remplir vis-à-vis des indigènes.
Dans les conflits entre les militaires et les colons qui prirent tant d'acuité sous le Second Empire, il était porté à prendre parti pour les militaires. D'autre part, il y avait parmi les colons algériens beaucoup de républicains avancés qui demeuraient hostiles à l'Empire et à l'Empereur.
Il s'inquiétait de voir que la défense de l'Algérie immobilisait 60.000 hommes qui pouvaient faire défaut en Europe. Sur ce point, ses idées se modifièrent à la suite de la guerre de Crimée où l'armée d'Afrique et ses chefs jouèrent un rôle considérable et glorieux.
Un drapeau fut offert par la population indigène aux tirailleurs qui pour la première fois allait combattre hors de l'Algérie. Les zouaves et les turcos devinrent extrêmement populaires : Saint-Arnaud, Canrobert, Pellissier, Bosquet, Yusuf, Mac-Mahon, Bourbaki qui s'illustrèrent dans cette campagne étaient tous des Africains. Cette guerre d'Orient, la première guerre européenne depuis 1830, prouva que l'Algérie n'était pas, comme on le prétendait, une cause de faiblesse et un sujet d'embarras en cas de complications européennes ; elle montra, au contraire, les ressources de tous genres qu'on pouvait tirer de son sol, en hommes et en approvisionnements.
Les transportés politiques
Pendant les premières années de l'Empire, l'Algérie fut choisie comme lieu de déportation politique. Aux insurgés des journées de juin vinrent se joindre les adversaires du coup d'État, plus tard encore divers suspects.
Les transportés étaient divisés en trois catégories :
- Ceux qui étaient internés dans les forts et les camps,
- ceux qui étaient admis dans les villages,
- enfin ceux qui étaient autorisés à se livrer à des exploitations particulières ou astreints seulement à résider sur certains points.
Les condamnés pouvaient passer d'une catégorie dans l'autre lorsque leur conduite donnait satisfaction ; dans la seconde catégorie ils travaillaient par escouades de vingt à des défrichements, des dessèchements, des cultures, des constructions ; dans la troisième catégorie ils se livraient au travail individuellement et pouvaient même obtenir des concessions mais ne recevaient plus d'allocations de vivres.
Un pénitencier avait été établi à Lambèse. Le domaine y possédait plus de 3.000 hectares d'excellentes terres permettant d'occuper 600 détenus ; le chiffre de ces colons involontaire s'éleva à 9.530.
Le plus fâcheux est que souvent les condamnées politiques et ceux de droit commun furent mélangés.
Dans les diverses catégories de transportés politiques quelques éléments furent utiles à la colonisation mais ce fut peu de chose auprès du tort fait à sa réputation dans l'opinion publique ; on la considéra comme un bagne affreux, un pays sinistre où l'on mourait de la fièvre et du choléra.
Tout changea à partir de 1851 en matière de colonisation, la théorie et la pratique.
La République de 1848 voulait franciser les colonies par l'assimilation et rêvait de trouver en Afrique la guérison de la crise ouvrière ; l'Empire comptait sur l'afflux des capitaux et des produits pour hâter la mise en valeur du pays.
Ce régime détourna de l'Algérie l'émigration française, empêcha cette colonisation familiale agricole qui lui aurait si bien convenu et qui correspondait aussi à l'état social de la métropole.
On opposa désormais aux procédés d'un paternalisme inconsidéré et tatillon du gouvernement de juillet et de la Seconde République ceux des colonies anglaises, où les terres étaient, disait-on, vendues à haut prix et sans conditions et où le seul avantage assuré au nouvel arrivant était la complète liberté d'agir.
On dénonçait les formalités qui entouraient l'obtention d'une concession, les retards qui en résultaient, la lourdeur des obligations imposées. L'administration se fatiguait des responsabilités et des charges qu'entraînaient pour elle ces colons soldés et entretenus.
Le cantonnement
La loi de 1851 laissait en suspens la question capitale ; celle de savoir comment on pourrait se procurer des terres pour la colonisation française sans injustice et sans dommage pour les indigènes. On essaya d'y parvenir par l'opération dite du cantonnement.
Dans les terres collectives des tribus, la nue-propriété appartenait à l'État, l'usufruit à la tribu. L'État imposait le partage qui avait pour conséquence le prélèvement d'une partie du sol en pleine propriété à son profit, le reste étant laissé au détenteur qui obtenait en échange de la jouissance qu'il perdait sur la portion attribuée à l'État, la pleine propriété du sol sur lequel il était cantonné.
La conception du cantonnement était ingénieuse et aurait certainement procuré à l'État de vastes surfaces pour la colonisation si le système avait été appliqué sur une grande échelle. On ne devait opérer que de proche en proche, selon les besoins du peuplement européen.
Les terres revenant au domaine étaient administrées par lui jusqu'au jour où elles étaient mises au service de la colonisation pour être concédées gratuitement ou vendues aux Européens.
Les indigènes possédaient plus de terre qu'ils n'en pouvaient utiliser pour la culture et le parcours ; rien de plus légitime que de prélever sur le reliquat disponible les espaces nécessaires à l'expansion de la colonisation.
Les opérations de cantonnement portèrent au total sur une superficie de 343.000 hectares ; les indigènes, au nombre de 56.000 reçurent 282.000 hectares avec modération et équité.
Les grandes concessions
L'administration était assiégée de demandes de grandes concessions ; il était d'ailleurs conforme à la politique impériale de provoquer la venue des capitaux plutôt que des colons.
En 1852, des capitalistes de Genève eurent l'idée de faire appel au gouvernement français pour faciliter une émigration suisse dont le besoin se faisait impérieusement ressentir ; ils demandaient 500.000 hectares, tous les frais étant laissés à la charge du gouvernement mais celui-ci refusa. Il concéda cependant à une compagnie genevoise de création récente une concession de 20.000 hectares de terrains domaniaux dans les environs de Sétif. La compagnie devait construire en dix ans dix villages et y installer 500 familles originaires de Suisse et possédant chacune au moins 3.000 francs.
Chaque colon avait droit à une maison bâtie, cédée par la compagnie au prix de revient et à un lot de 20 hectares. Celle-ci, comme rémunération pour chaque village construit et peuplée par elle, aurait en pleine propriété 800 hectares sur les 2.000 formant le périmètre du centre. Le gouvernement prenait à sa charge les travaux de routes, d'adductions d'eau, d'édifices publics.
Les colons payaient immédiatement les deux-cinquièmes du prix des maisons, la compagnie avait une hypothèque pour le reste dont elle touchait l'intérêt à 5 pour 100 ; elle faisait simplement un placement hypothécaire.
Le premier village, Aïn-Arnat, à 8 kilomètres de Sétif fut fondé dès 1854 ; 50 familles s'y établirent formant un effectif de 400 personnes originaires des cantons de Vaud, de Genève et d'Argovie. Le dirigeant de la société M.Sautter de Beauregard proposait d'amener tous les ans 15 à 18.000 familles de 50 feux (foyers ou familles).
L'examen de ces projets mirifiques fut sagement ajourné. Bientôt les difficultés commencèrent, l'émigration vers Sétif s'arrêta. La compagnie s'efforça de la ranimer en installant des agences de recrutement à Berne et à Turin ; elle parvint à rassembler 3.000 émigrants, Suisses, Allemands, Italiens sans ressources et qui n'étaient pas de véritables colons.
Quatre nouveaux villages, Bouhira, Messaoud, Mahouan et El-Ouricia furent construits mais non peuplés ; ils comptaient 222 colons et 421 ouvriers assimilés aux colons qui ne représentaient pas une population stable. Comme d'ailleurs aucune obligation de résidence n'était imposée, la compagnie se contenta bientôt d'un simple simulacre, afin de toucher la prime et de prélever les 800 hectares de terres qui lui étaient attribués pour chaque village ; elle s'arrangea d'ailleurs pour mettre dans son lot les meilleurs domaines.
Bientôt elle renonça complètement à faire venir des colons et se contenta de louer ses terres aux indigènes. Mais au point de vue du peuplement, les résultats étaient nuls. Les 2.956 émigrants qui étaient arrivés diminuèrent de plus en plus ; les villages tombèrent en ruine ; il n'y a plus aujourd'hui sur cet immense domaine qu'une centaine d'Européens.
La petite colonisation
Randon était personnellement partisan du peuplement démocratique et de la petite propriété. Un certain nombre de villages nouveaux furent implantés.
En 1852, furent fondés Sidi-Moussa près de l'Arba et Chaïba près de Koléa, en 1853, Aïn Taya et Matifou, en 1854 la Réghaïa.
La colonisation s'installa dans le haut Cheliff, aborda la plaine d'Aumale et les premiers contreforts kabyles. En Oranie de nouveaux villages fermèrent le cercle autour de la Sebkha et s'avancèrent dans le bas Cheliff.
A l'Est les coteaux de Guelma se peuplèrent peu à peu. Aïn-Bénian devenue Vesoul-Bénian reçut des émigrants de la Haute Saône, Aïn-Sultan des Alsaciens et des Provençaux, Bled-Touaria des Alsaciens et des Lorrains.
On continua à faire appel aux éléments étrangers, notamment aux Allemands qui peuplèrent Sidi-Lhassen, Oued-el-Hammam, Aïn-Sidi-Chérif dans la province d'Oran, Penthièvre et Guelaat-Bou-Sba dans la province de Constantine.
On compléta la dotation des anciens centres et on agrandit leur territoire, on les pourvoyant de chemins, de fontaines, de norias, de moulins.
Au total 85 villages nouveaux sont créés et 250.000 hectares concédés de 1851 à 1860, mais l'apport nouveau n'était que de 14 à 15.000 âmes alors que dans la période précédente, pour une moindre superficie aliénée, l'accroissement de la population rurale avait atteint 40.000 habitants.
C'est que la faveur était aux grandes concessions qui se montraient inefficaces au point de vue du peuplement et le plus souvent imparfaite au point de vue de la mise en valeur.
Les procédés de la colonisation officielle subsistaient mais l'esprit qui l'avait animée au temps de Bugeaud s'est évanoui.
Cependant, comme en matière de colonisation chaque période recueille des résultats des efforts faits pendant la période précédente et que les anciens centres continuaient à se développer ; le chiffre des ruraux s'élevait à 86.000.
La colonisation libre, encouragée par de bonnes récoltes en 1852 et en 1853 progressa assez fortement, en particulier dans la Mitidja, dans le Sahel et dans la plaine de Bel-Abbès.
Bugeaud disait qu'il fallait faire marcher de front la colonisation arabe et la colonisation européenne, idée fort juste mais qui ne fut pas toujours appliquée avec discernement.
Les bureaux arabes s'attachaient surtout à fixer les indigènes au sol en leur faisant construire des maisons. De larges concessions de terres étaient aussi accordées à des chefs indigènes ; elles étaient comme les concessions européennes grevées de conditions :
- construction de fermes, plantation d'arbres,
- installation d'un nombre déterminé de familles, conditions qui, en l'absence d'un contrôle sérieux, restèrent dans presque tous les cas inexécutés.
C'est à partir de cette époque que les Européens furent définitivement acclimatés.
De 1830 à 1856, le nombre des décès l'avait emporté sur celui des naissances (87.000 contre 75.000) et si la population européenne s'était accrue c'était seulement grâce à l'émigration.
- Les travaux de défrichement,
- l'ignorance des règles de l'hygiène,
- les installations défectueuses,
- les épidémies de choléra entraînaient une mortalité très élevée.
A partir de 1856, le nombre des naissances fut toujours supérieur à celui des décès et à chaque recensement quinquennal la population européenne gagna 50.000 âmes Au total elle passa de 131.000 habitants en 1851 à 189.000 en 1858 ; Les Français qui en 1851, étaient 66.000 contre 65.000 étrangers étaient, en 1858, 107.000 contre 74.000 étrangers.
La colonie était définitivement fondée.
La situation économique tendait aussi à s'améliorer. La surface cultivée en céréales était évaluée à 750.000 hectares en 1854, à plus de 2 millions en 1861 : chiffres dans lesquels il ne faut avoir assurément qu'une confiance limitée.
Les travaux publics
En matière d'outillage économique, on a presque toujours procédé en Algérie avec beaucoup de timidité ; on n'a pas vu assez grand, on n'a pas suffisamment fait confiance au pays et à son avenir. Cependant les travaux publics reçurent sous le gouvernement de Randon une assez vive impulsion.
De nombreux projets avaient été élaborés de 1837 à1848 en vue de la création d'un port à Alger.
Aucun de ces plans ne fut exécuté avec méthode et esprit de suite. Le programme de 1848 comportait cependant 41 millions de travaux et en 1850 on avait une surface d'eau abritée de 780 hectares ; en 1854 les deux jetées étaient terminées, les quais construits. Quelques travaux avaient aussi été effectués à Oran, Cherchell et à Bône.
On comptait en 1851 3.600 kilomètres de routes qui avaient coûté 16 millions ; les principales étaient celles qui reliaient Alger à Médéa et à Miliana, Oran à Tlemcen et à Mascara, Stora à Constantine et à Biskra.
Les routes d'Alger à Constantine et d'Alger à Oran dont la nécessité était évidente furent activement poussées ; on construisit 600 kilomètres de routes nouvelles. Plusieurs de ces routes furent faites par l'armée.
- Ainsi furent achevées les routes de Sétif à Bougie, d'Aumale à Dellys par Dra-el-Mizan,
- d'Alger à Tizi-Ouzou par le col des Beni-Aïcha (Ménerville), destinées à enserrer la Kabylie et à tenir ses principales issues, puis après la campagne de Kabylie la route de Tizi-Ouzou à Fort-Napoléon,
- une route fut également faite par le génie entre Djidjelli et Constantine dans une région très difficile.
Un décret du 8 avril 1857 décida la construction des premières voies ferrées. Il prévoyait un réseau de chemin de fer embrassant les trois provinces et se composant :
1° d'un ligne parallèle à la mer d'Alger à Constantine par ou près d'Aumale et Sétif et d'Alger à Oran par ou près de Blida, Orléansville, Saint-Denis-du-Sig et Sainte-Barbe-du-Tlélat ;
2° de lignes partant des principaux ports et aboutissant à la ligne parallèle à la mer, à savoir :
- de Philippeville à Constantine,
- de Bougie à Sétif,
- de Bône à Constantine par Guelma,
- de Ténès à Orléansville,
- d'Arzew à Mostaganem et Relizane,
- d'Oran à Tlemcen par Sainte-Barbe-du-Tlélat et Sidi-Bel-Abbès.
La construction de ce réseau devait demander de longues années ; quelques-unes même des lignes qu'il prévoyait ne sont pas encore exécutées à l'heure actuelle. On trouva difficilement une compagnie qui consentit à se charger de l'entreprise.
Randon fit, sans plus tarder, commencer les terrassements par des soldats et des condamnés ; en quelques mois ils furent effectués jusqu'à Boufarik.
Les premiers grands barrages furent construits, des travaux de dessèchement furent poursuivis dans la Mitidja, des puits artésiens furent creusés dans le Sud.
La réorganisation de l'armée d'Afrique
Ce fut l'une des meilleures œuvres de Randon qu'il présida. Il proposait de donner à chaque province :
- un régime de zouaves,
- deux bataillons de tirailleurs algériens,
- un régiment de légion étrangère,
- un bataillon d'infanterie légère d'Afrique,
- un bataillon de chasseurs à pied,
- deux régiments de France,
- un escadron du train des équipages.
Conformément à ce plan, le décret du 13 février 1852 arrêta qu'il serait procédé à la formation de deux nouveaux régiments de zouaves ; chacun des bataillons de l'ancien régiment devint le noyau de celui qu'il s'agissait d'organiser dans chaque province.
Quant aux troupes indigènes qui, en 1850, comptaient seulement 6.000 hommes contre 70.000 hommes de troupes européennes, il convenait d'en accroître le nombre, d'autant plus qu'elles s'étaient fait remarquer par leur fidélité et leur bravoure ; cependant la formation de nouveaux bataillons de tirailleurs indigènes ne fut pas décrétée ; on se contenta de porter de six à huit le nombre de compagnies dans chacun des bataillons existants.
Les troupes de cavalerie avaient été à l'origine établies sur le littoral et malgré les progrès de la conquête on les y avait laissées. Randon demanda qu'elles fussent reportées dans l'intérieur où les intérêts de notre domination réclamaient leur présence.
Les spahis furent destinés à occuper les limites du Tell et à garder les frontières ; pour assurer leur bon recrutement et en faire des instruments utiles de notre domination il fallait ne pas les éloigner de leur vie habituelle et leur éviter les détails d'un service minutieux sans but comme sans utilité pour eux.
Randon proposa de les grouper en smalas, avec un bordj central, dépôt de munitions et de vivres, des terres de labour et de parcours où ils vivraient sous la tente avec leurs familles et leurs troupeaux, prêts à monter à cheval en cas d'appel. On attendait de l'établissement des smalas, outre les avantages militaires, des progrès de l'agriculture et de l'élevage du cheval.
Pendant la guerre de Crimée, l'Algérie fut presque dégarnie de troupes ; elle fournit 30.000 hommes de ses meilleurs régiments et n'en conserva que 40 à 45.000. Elle assura aussi en partie les approvisionnements de l'armée d'Orient.
" L'intervention de l'Algérie dans cette grande lutte, écrivait à Randon l'intendant général Darrican, donne la mesure de cette jeune puissance de la Méditerranée ; elle constitue un fait de guerre considérable dont on ne connaîtra toute la portée que lorsque l'on récapitulera avec impartialité la somme des efforts que vous avez produit à l'intérieur de votre commandement sans affaiblir la situation de l'Algérie, en étendant au contraire les limites de notre territoire et en créant dans l'Algérie de nouveaux éléments de puissance militaire et de colonisation. "
" Personne n'oubliera, écrivait Bosquet de son côté, que l'Afrique nous a donné nos soldats d'avant-garde, ceux de l'Alma, d'Inkerman que vous nous avez tout envoyé et que vous avez accepté la sérieuse et belle mission de maintenir et de développer notre colonie avec des conscrits dont vous ferez bientôt de vieilles troupes. "
L'instruction des jeunes soldats fut en effet très vivement poussée pour assurer la tranquillité de la colonie.
- Des travaux de routes furent entrepris,
- des détachements de cavalerie sillonnèrent le pays,
- on fit connaître aux tribus que la guerre dans laquelle nous étions engagés avait pour but de porter secours au sultan contre ses ennemis
Non seulement la tranquillité ne fut pas troublée mais la marche des affaires demeura parfaitement normale. Cette expérience témoigna que la conquête était solide. Il ne restait plus à soumettre, pour qu'elle fût complète, que le Sud et la Kabylie.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
| Le Sud, Laghouat et le M'Zab
Envoyé par M. Christian Graille
|
Ni les Romains ni les Turcs n'avaient occupé le Sahara.
Les premiers étaient restés hors des grandes steppes des provinces d'Alger et d'Oran que nos soldats appelaient le " petit désert."
Les seconds avaient fait quelques expéditions isolées et s'étaient bornés à interdire les marchés du Tell aux insoumis.
Le Tell une fois conquis, nous aurions pu, comme l'avaient fait nos prédécesseurs :
- nous désintéresser du Sud,
- resserrer les mailles de notre réseau dans le Tell,
- contrôler le ravitaillement des nomades.
Nous fûmes amenés à intervenir au Sahara pour deux raisons : L'une, excellente, était la nécessité de pacifier les régions sahariennes pour avoir la tranquillité dans le Tell, l'autre, moins bonne, était tirée des illusions qu'on se faisait à cette époque sur la valeur économique du Sahara et du commerce transsaharien.
Randon fut l'initiateur de cette politique saharienne. Au début de son gouvernement une agitation assez vive avait été provoquée dans le Sud par un indigène des environs de Tlemcen qui se faisait appeler Mohamed-Ben-Abdallah : c'était un personnage assez médiocre ; la Turquie encourageait ses intrigues. En revenant de la Mecque, il avait débarqué à Tripoli, avait gagné Rhadamès, Touggourt puis Ouargla où il s'était fait proclamer sultan.
L'agitation s'étendit assez rapidement gagnant le Sud-Oranais, le Sud-Constantinois. Un poste fut créé à Djelfa et l'occupation de Laghouat commença à se faire jour. Trois colonnes furent formées sous les ordres de Yusuf, Pélissier et Mac-Mahon pour couvrir la région de Biskra.
Laghouat fut prise le 4 décembre 1852 après des combats acharnés. Nos pertes étaient élevées ; le 2e zouave avait 60 hommes hors de combat ; le général Bouscaren, légendaire par sa bravoure et son affabilité et le commandant Morand non moins chevaleresque et héroïque moururent de leurs blessures.
La question se posait de savoir s'il fallait occuper définitivement Laghouat.
" Il y avait trois partis à prendre, dit Randon : nous établir dans la ville et en faire un poste avancé vers les régions sahariennes, l'abandonner en laissant à ses anciens habitants le soin de la relever de ses ruines, enfin, raser la ville, détruire les jardins et nous débarrasser ainsi du soin de sa conservation et de l'inquiétude que plus tard elle pourrait encore nous donner.
Le dernier de ces projets eût été un acte de vandalisme et l'abandon à toute intervention directe dans le Sud ; le second aurait permis au chérif de reprendre l'œuvre que nous avions interrompue et de s'assurer d'un point d'où il pût dominer le Sahara.
Le seul parti vraiment digne était de conserver Laghouat et d'y compléter notre installation en lui donnant le caractère de la permanence. Si nous perdions cette occasion favorable, nous revenions à ce système d'occupation restreinte condamné depuis longtemps et dont avait fait justice le maréchal Bugeaud par cet aphorisme si vrai qu'en Algérie pour être maître de quelque chose, il faut tout posséder.
Laghouat n'est pas seulement une position militaire importante, c'est aussi une station commerçante au centre du Sahara ; elle est l'entrepôt des tribus nomades qui y transportent leurs dattes et prennent en échange des chargements de blé ; Elle deviendra le grand marché de laines et celui des produits de nos manufactures qui, par l'intermédiaire des Béni-M'Zab, seront transportés à Rhadamès et à Rhat, à la limite du Soudan. "
L'opinion de Randon, appuyée sur des raisons politiques très défendables et sur des raisons économiques beaucoup moins solides finit par prévaloir. On décida l'occupation permanente. La garnison comprit 800 fantassins, un escadron de cavalerie, une section d'artillerie ; deux forts qui reçurent les noms de Bouscaren et de Morand furent construit sur l'arrête rocheuse qui domine la ville ; l'organisation du cercle fut confiée au capitaine du Barail.
Dès le début, notre établissement à Laghouat nous amena à intervenir chez les Mozabites. Ces puritains de l'Islam, derniers héritiers des Kharedjistes (adeptes d'une secte musulmane remontant aux origines de l'Islam) qui avaient émigré de Tiaret à Ouargla au huitième siècle et dans la chebka du M'Zab au douzième siècle ont toujours joué en Algérie un rôle économique important.
Leurs sept villes, situées à 200 kilomètres au Sud de Laghouat, qui compte 20.000 habitants et 180.000 palmiers, sont un entrepôt de marchandises où les nomades viennent se ravitailler, sans préjudice du commerce que beaucoup d'entre eux exercent dans les villes du Tell.
Le 24 janvier 1853, le général Randon adressait à ces sept villes une lettre indiquant les conditions qu'il leur imposait et auxquelles souscrivent les djemaâs (assemblées). Moyennant le paiement d'un tribut de 50.000 francs, les Mozabites demeuraient libres de gérer comme il leur plairait leurs affaires intérieures. Cette convention connue sous le nom de capitulation du M'Zab a réglé nos relations jusqu'en 1882.
L'oued-Rir Dans le Sud-Constantinois nous fûmes amenés à intervenir dans les oasis de l'Oued-Rir qui s'étendent entre Biskra et Touggourt ; elles étaient ensanglantées par des querelles de famille.
A la suite du combat de Meggarin (29 novembre 1854) le colonel Desvaux entra dans la ville. L'intervention de la France prépara la régénération économique des oasis qui se mouraient faute d'eau ; à mesure qu'un puits artésien se comblait, un centre de population s'éteignait ; les palmeraies dépérissaient, les puits anciennement creusés ne donnant qu'un volume d'eau de plus en plus insuffisant.
Le forage de puits artésiens vint remédier à cette décadence.
Le 13 juin 1856 on rencontra une nappe de 4.000 litres qui jaillit avec force à la surface du sol.
" En moins de deux minutes, raconte le lieutenant Rose, tout le monde accourut ; on arracha les branches de palmier qui entourait l'équipage ; tout le monde voulut voir cette eau que les Français avait su faire venir au bout de cinq semaines. On vit même des femmes de tout âge accourir ; celles qui ne pouvaient parvenir à la source se faisaient donner de l'eau dans les petits bidons de nos soldats et la buvaient avidement. Enfin le marabout, en présence des notables assemblés prononça la prière commune, sur l'œuvre des Français, appelant sur eux comme sur des frères la bénédiction du ciel. "
En quelques années les palmeraies mourantes furent reconquises, presque toutes dotées de fontaines nouvelles, les anciens puits achevés, de nouvelles oasis créées.
Les Touaregs
Randon s'efforça de nouer des relations avec eux en vue d'en faire les intermédiaires entre nos possessions méditerranéennes et le Soudan et fit part de son désir à Si-Hamza.
En 1854 celui-ci se rendit à Rhat et décida divers personnages Touaregs à l'accompagner à Alger ; ils y restèrent un mois :
" Leur attitude, dit Randon, fut digne et respectueuse. Leurs paroles révélèrent un esprit sérieux et une appréciation exacte des avantages qu'ils pourraient retirer de nos réciproques relations. Ils donnèrent l'assurance que leur concours ne nous ferait pas défaut et qu'ils se chargeraient volontiers d'escorter les caravanes partant de l'Algérie ou s'y rendant. "
En 1858 un interprète militaire, Bou-Derba, fut envoyé à Rhat.
En 1860, un jeune homme de dix-huit ans, Henri Duveyrier, doué d'une rare énergie et de remarquables qualités d'observateur accomplit avec succès une belle exploration chez les Touaregs Azdjer.
Il devait à son père Saint-Simonien, disciple d'Enfantin, des idées généreuses et aussi quelques illusions. Il se rendit d'abord à Rhadamès où il fut arrêté quelques temps par les tracasseries des autorités turques. Puis il se rendit à Tripoli d'où il revint muni de recommandations du Pacha et du consul général de France Botta.
Type accompli de l'explorateur consciencieux et modeste, Duveyrier a donné dans son ouvrage, les Touaregs du Nord, une remarquable description du Sahara central et de ses habitants.
Pour profiter des résultats obtenus par son voyage on résolut de signer un traité d'amitié et de commerce avec les Azdjers. Mais on ne fit rien pour tirer parti de ce pacte qui se trouva relégué dans les archives.
Les Touaregs n'entendant plus parler de la France la dédaignèrent : nos adversaires leur apprirent à la braver. Le Sahara, un instant entr'ouvert sur les pas de Duveyrier, se referma. Les habitants du désert se jetèrent dans les bras des Turcs à l'Est, du Maroc à l'Ouest.
L'insurrection des Ouled-Sidi-Cheikh qui commença en 1864 et dura jusqu'en 1885, la guerre de 1870, le massacre d la mission Flatters devaient amener un arrêt complet de la pénétration saharienne, arrêt qui n'a prit fin qu'au début du vingtième siècle.
La Kabylie
La soumission de cette région par le maréchal Randon est le dernier acte de la conquête. Il y aura encore des insurrections mais localisées où dues à des circonstances tout à fait exceptionnelles comme celle de 1871. Aucune ne mettra réellement en péril la domination de la France.
La Kabylie est une région très accidentée, aux pentes abruptes, au relief tourmenté. Là vit une population d'une densité extraordinaire. Les villages ou taddert se succèdent de façon presque continué le long de certaines crêtes, la ligne des maisons et des toits n'étant interrompue que par les espaces réservés aux cimetières.
Cette population ajoute à la culture des arbres à fruits, oliviers et figuiers et aux quelques ressources que lui procure une industrie rudimentaire, la pratique de l'émigration temporaire sans laquelle elle ne pourrait se suffire.
Elle est farouchement attachée à son sol où elle a trouvé un refuge contre les invasions et où elle a maintenu envers et contre tous sa langue particulière que nous qualifions de berbère ; son vieux droit coutumier qui s'écarte sur bien des points des prescriptions du Coran ; ses petites assemblées municipales, les djemaâs, composées des chefs de clan qu'on appelle en Kabylie les tamen, les répondants.
La conquête de la Kabylie
Sa soumission avait été amorcée par Bugeaud qui en 1844 avait réduit les Flissas, c'est-à-dire le massif montagneux compris entre l'Isser et le Sebaou et en 1847 soumis la vallée du Sahel.
Randon, dès son arrivée au gouvernement général avait réclamé une expédition en Kabylie ; pour lui, la question de la soumission des habitants de cette région primait toutes les autres :
" Ces peuples conservaient aux portes d'Alger une indépendance toujours fâcheuse pour la tranquillité de notre colonie et qui, si une guerre européenne éclatait, pouvait devenir un très sérieux danger, car, par leurs montagnes dont le pied baigne dans la mer, ils recevraient des agents ennemis de la poudre et des armes et feraient de leur pays le foyer d'une insurrection générale. "
En 1854 d'importantes opérations eurent lieu dans la vallée du Sebaou.
Mac-Mahon pénétra au cœur de la Kabylie ; son camp fut attaqué par plusieurs milliers d'hommes dont il obtint la soumission après de violents combats.
La campagne avait coûté 900 officiers ou soldats tués ou blessés.
L'expédition de 1854 fut après celles de 1844 et de 1847 le troisième coup porté à la région. Grâce à cet acte la tranquillité ne fut pas sérieusement troublée pendant la guerre de Crimée malgré la réduction des effectifs de l'armée d'Afrique.
Randon promu maréchal de France se rendit à Paris et réussit à convaincre l'Empereur qui ordonna l'expédition du Djurdjura pour le printemps de 1857.
Le corps expéditionnaire compris 27.000 hommes répartis en quatre divisions.
Le 24 mai les troupes parties de Tizi-Ouzou commencèrent à gravir les rudes escarpements du massif des Aït-Iraten ; profitant des obstacles naturels les ennemis y avaient ajouté une série de retranchements et défendirent énergiquement leurs villages qu'il fallut enlever à la baïonnette après des combats corps à corps. Cependant le soir les troupes occupaient les crêtes.
La lutte recommença le 25 avec le même acharnement ; le lendemain ayant perdu 1.800 hommes les Kabyles faisaient leur soumission.
- Ils reconnaissaient l'autorité de la France,
- s'engageaient à payer une contribution de guerre et à livrer des otages,
- ils consentaient à ce que l'on élevât des bordjs dans leur pays.
Dans ces conditions ils obtenaient de conserver leurs institutions municipales auxquelles ils étaient très attachés.
Randon décida d'élever à Souk-el-Arba un fort permanent auquel il donna le nom de Fort-Napoléon.
En dix-huit jours une route de 25 kilomètres fut construite de Tizi-Ouzou à Souk-el-Arba. La tribu la plus puissante avait déposé les armes ; d'autres encore restaient debout et le 24 juin les troupes se remettaient en mouvement et continuaient le combat.
A partir du 12 juillet la campagne était définitivement terminée ; elle s'était accomplie en quarante-cinq jours (19 mai-12 juillet) et avait coûté 1.500 officiers ou soldats tués ou blessés. Les Kabyles versèrent en six semaines plus de 2 millions d'indemnités de guerre.
Une fois le prestige de l'inviolabilité de leur territoire dissipé, notre volonté d'être maîtres du pays bien constatée, les Kabyles se soumirent et cette soumission fut d'autant plus sincère que la domination n'apporta pas trop de changements à leurs usages et à leurs institutions ; les amins continuèrent à être nommés par les villages, l'autorité militaire se réservant un droit de validation et d'approbation.
C'est seulement après la révolte de 1871 que l'ancienne organisation disparut.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
Un peu d'auto-dérision ..
Envoyé par Elyette
|
|
Michel a 90 ans. Il a joué au golf tous les jours depuis sa retraite il y a 25 ans.
Un jour, il rentre chez lui complètement découragé :
- C’est fini, dit-il à sa femme. J’abandonne le golf.
- Ma vue est devenue trop mauvaise… après que j’ai frappé la balle, je ne peux pas voir où elle va.
Pour le rassurer sa femme lui dit : Pourquoi n’amènes-tu pas mon frère avec toi au golf et essaie une dernière fois.
- Ton frère a 103 ans ! répond Michel. Il ne peut pas m’aider.
- Il a peut-être 103 ans, dit sa femme, mais il a une vision parfaite !
Alors, le lendemain, Michel se rend au terrain de golf avec son beau-frère.
Il place sa balle sur le tee, s’élance, frappe, puis cherche la balle au loin.
Il se tourne vers son beau-frère :
- As-tu vu où est allée ma balle ?
- Bien sûr que je l’ai vue. Ma vision est parfaite.
- Excellent ! Où est-elle ?
- M’en rappelle plus……
|
|
| La campagne contre le régime militaire
et l'affaire Doineau
Envoyé par M. Christian Graille
|
L'Algérie était entièrement pacifiée, la guerre terminée, le gouvernement général avait à s'occuper surtout désormais à l'administration de la colonisation.
L'histoire de l'Algérie sous le Second Empire fut essentiellement celle d'un long conflit entre l'élément civil et l'élément militaire.
L'affaire Doineau (1856) en fut la manifestation la plus aiguë et contribua à l'aviver. Le capitaine Doineau chef du bureau arabe de Tlemcen était, disait Barail, " un grand gaillard à l'air hardi, qui portait la tête haute et le nez en l'air, bon garçon, cordial, la main ouverte, prêt à rendre service, intelligent, rompu aux finesses de la diplomatie arabe, complètement maître de l'esprit de son général, qui ne voyait que par ses yeux ; en somme, agent précieux mais trop disposé à gagner à la main. "
Il y avait entre lui et l'Agha des Béni-Snous, Mohamed-Ben-Abdallah, une haine farouche et irréconciliable.
Le 12 septembre 1856, à trois heures du matin, l'Agha prit la diligence de Tlemcen pour se rendre à Oran. Un quart d'heure plus tard la voiture fut entourée par une douzaine de cavaliers portant le costume indigène ; les uns suivaient la diligence depuis les abords de la ville, les autres étaient sortis d'un bois d'oliviers qui longeait la route.
Des coups de feu se firent entendre, les chevaux furent arrêtés, l'Agha et son interprète Hamadi furent tués à bout portant ; un des voyageurs M. Valette fut aussi tué par une balle égarée.
L'émotion fut grande à Tlemcen. La veuve de Ben-Abdallah accusa l'Agha des Ouled-Riah, Bel-Hadj, qu'une vieille inimitié séparait du défunt, d'avoir été l'instigateur du guet-apens. Ben-Abdallah avait beaucoup d'ennemis et il y avait eu des complots contre lui.
L'enquête fit aboutit à un certain nombre d'arrestations, notamment d'un assassin de profession nommé Maamar et du kodja ou secrétaire indigène de Doineau.
Les prévenus déclarèrent qu'ils avaient été poussés au crime par le capitaine.
D'après les uns il avait seulement participé à l'organisation de l'attentat ; d'après d'autres, il avait pris part à son exécution, déguisé en arabe, le capuchon cachant son visage. Doineau, arrêté à son tour, fut renvoyé avec ses dix-huit coaccusés indigènes devant la cour d'assises d'Oran.
Des jalousies entre les femmes de généraux qui commandaient à Oran et à Tlemcen paraissent avoir envenimé l'affaire.
Le président de la cour d'assises fit preuve d'une partialité évidente. Bien qu'il fût à peu près impossible de se reconnaître au milieu des contradictions des témoignages indigènes Doineau fut condamné à mort ; sa peine fut commuée en celle de la détention perpétuelle qu'il subit à Douéra ; il fut gracié quelques années après. Ayant pris du service en Espagne pendant la guerre de cette puissance avec le Maroc, il se retira ensuite à Cannes où il participa à l'évasion de son ancien chef Bazaine lorsque celui-ci s'échappa de l'île Sainte-Marguerite.
Il mourut à Lille en 1914 âgé de quatre-vingt-dix ans.
Doineau était-il coupable ? On releva contre lui de nombreuses imprudences de langage ; en maintes circonstances il avait exprimé son désir de voir disparaître l'Agha ; les indigènes de son entourage avaient pris ces propos pour une sorte d'invitation.
On lui reprochait par ailleurs des exécutions arbitraires et des malversations ; on trouva chez lui une somme d'argent de 22.000 francs environ dont il ne put expliquer la provenance. Ce n'était sans doute pas un assassin, mais ce n'était pas non plus une conscience très délicate.
Cette cause célèbre, aujourd'hui quelque peu oubliée, passionna l'opinion publique à cette époque. Elle fut moins le procès de Doineau que celui des bureaux arabes. Dans une plaidoirie enflammée, Jules Favre défenseur de l'Agha Bel-Hadj s'en prit à cette institution et fit de l'affaire un simple épisode du système d'administration adopté dans la colonie :
" Si tous les bureaux arabes, dit-il, doivent être jugés par celui de Tlemcen il faut se hâter de les supprimer ou de les réformer profondément. "
L'orateur s'indigna contre les exécutions sans jugement, en violation du droit des gens.
La campagne contre le gouvernement militaire et les bureaux arabes trouva un aliment dans l'affaire Doineau.
Des abus s'étaient certainement introduits dans l'administration des affaires indigènes. La qualité du recrutement avait baissé et il y avait dans la nouvelle génération d'officiers des hommes comme Doineau, comme Bazaine qui ne valaient pas ceux de la génération précédente, les Margueritte, les Lapasset.
Or le choix des hommes auxquels étaient laissés de si grands pouvoirs avait une importance extrême.
Oublieux de l'arrêté de 1844 et des prescriptions de Bugeaud, les officiers des bureaux arabes s'étaient rendus indépendants du commandement. Le contact avec des chefs indigènes prévaricateurs avait parfois corrompu certains hommes de moralité médiocre. La vénalité existant, il fallait beaucoup de courage pour résister à certaines tentations.
C'est surtout l'administration de la justice par des officiers, qui n'étaient point des juges, qui donnait lieu à de vives critiques. Les crimes et délits commis en territoire militaire, même par des Européens relevaient des conseils de guerre.
Au début de l'occupation les autorités pouvaient prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité du pays. En vertu de ces pouvoirs vagues et par conséquent très étendus on frappait les indigènes d'amendes individuelles ou collectives, d'emprisonnement, d'internement, d'expulsion, de séquestre.
Une première tentative de réglementation était la circulaire de Bugeaud du 12 février 1844 qui fixait le chiffre maximum des amendes mais la prison et l'internement continuaient à être appliqués sans que la sentence eût besoin d'être motivée ni que la durée de l'internement fût limitée.
Il est clair que la justice sommaire et les pouvoirs discrétionnaires avaient leur raison d'être dans la période de la colonisation, à l'époque de la lutte contre Abd-el-Kader. L'armée, en même temps qu'elle occupait les régions où elle pénétrait, assurait tous les services, la justice comme les autres. Mais les bureaux arabes, en remplissant leur tâche, travaillaient à leur propre suppression et rapprochaient le jour où ils abdiqueraient entre les mains de l'autorité civile.
Il faut ajouter que les officiers des bureaux arabes avaient à défendre les indigènes, eux et leurs terres contre bien des convoitises. C'était une des causes profondes du conflit entre eux et les colons.
Une série de brochures, reflétant les idées courantes et jusqu'à un certain point la pensée même de l'Empereur, présentaient les colons comme des spéculateurs, des agioteurs qui demandaient le cantonnement des tribus pour spéculer sur les biens ruraux.
L'aristocratie indigène, menacée dans ses privilèges, faisait cause commune avec les adversaires de la colonisation.
Les officiers des affaires indigènes, qui au début n'étaient nullement hostiles aux colons, avaient fini par devenir leurs adversaires. On en était venu à ce point que les colons demandaient la suppression des bureaux arabes et les bureaux arabes la suppression des colons.
On exagérait lorsque l'on prétendait que les colons en territoire militaire vivaient sous le régime de l'arbitraire ; les lois civiles étaient les mêmes dans les deux zones. D'ailleurs en 1858, sur 189.000 Européens, 170.000 étaient placés sous l'autorité civile ; la zone militaire ne comptait donc que moins de 6 pour 100 d'entre eux. Il est vrai que les Européens n'avaient accès en territoire militaire que dans un but d'utilité publique et en vertu d'autorisations spéciales et personnelles. Mécontents, les colons rendaient l'autorité militaire responsable de toutes leurs déceptions et de tous leurs échecs.
La population civile réclamait :
- un gouvernement civil,
- l'assimilation politique,
- l'assimilation douanière,
- le cantonnement des Arabes,
- la constitution de la propriété privée dans les tribus,
- la vente des terres,
- la suppression de la réglementation des concessions,
- l'assimilation des indigènes,
- la suppression du régime administratif auquel ils étaient soumis.
Si quelques-unes de ces revendications étaient légitimes, d'autres étaient injustifiées, d'autres absolument impossibles à satisfaire.
Les officiers ne tenaient en aucune façon à continuer à exercer les fonctions de maire, de juge de paix, de notaire auxquels ils étaient peu préparés, là où la population européenne avait pris un développement suffisant et où la sécurité était complète. Mais ils ne pouvaient ni ne le voulaient renoncer à l'administration des indigènes, estimant que ceux-ci n'étaient pas mûrs pour échapper à leur tutelle, rude mais efficace.
Ce qui prouve qu'ils avaient raison c'est que les bureaux arabes si attaqués sous le Second Empire ont été plus tard regrettés par ceux-là même qui avaient demandé leur suppression.
A l'époque l'Algérie avait surtout à obtenir une bonne loi foncière et la prompte exécution des voies ferrées. Ce résultat pouvait être atteint tout aussi bien et plus facilement sans doute en maintenant et en fortifiant même le gouvernement général. Ce qu'il aurait fallu à la colonie, c'était une large décentralisation.
La suppression du régime militaire conduisit au contraire au rattachement à Paris et à l'assimilation avec le métropole.
Le ministère de l'Algérie (1858-1869)
Le décret du 2 juin 1858 créa un ministère de l'Algérie et des Colonies, formé de la direction des affaires de l'Algérie, détachée du ministère de la guerre et de la direction des colonies enlevée au ministère de la Marine.
Un autre décret du 29 juillet rattacha à ce ministère les services de la justice, des cultes, de l'instruction publique et des finances qui avaient été distraits du ministère de la guerre en 1848.
Le prince Jérôme Napoléon, cousin de l'Empereur, fut chargé du nouveau ministère. Les décrets de 1858 constituaient un acte de grande portée politique et une transformation radicale du gouvernement de la colonie.
Napoléon III avait d'abord songé à confier au prince Jérôme une sorte de vice-royauté, de lieutenance générale de l'Empire qui aurait comporté sa résidence obligatoire à Alger. Mais le prince déclara que sa présence à Paris pendant plusieurs mois de l'année était indispensable pour établir le budget et traiter directement avec l'Empereur les affaires importantes de sa lieutenance. On y renonça donc ; on s'arrêta à la solution d'un ministère spécial qui centraliserait le pouvoir non à Alger mais à Paris.
Le prince Jérôme avait de grandes qualités et de graves défauts. C'était un homme fort intelligent, parlant et écrivant bien, qui physiquement ressemblait beaucoup à Napoléon 1er.
Démocrate et libre penseur, violemment anticlérical. Il était violent, brutal, impérieux, brouillon ; il avait montré peu de courage, disait-on, dans la campagne de Crimée ce qui l'avait rendu impopulaire dans l'armée et n'était pas de nature à faciliter sa tâche en Algérie.
L'Empereur avait d'abord songé à conserver Randon dont il appréciait les services et le dévouement. Mais celui-ci trouva que, sous les ordres d'un ministre qui ne lui laisserait plus rien à faire et à la volonté duquel il n'aurait aucun moyen de résister, il donna sa démission qui fut acceptée.
Le prince était puissant et décidé à faire des réformes hardies. La pensée maîtresse de sa politique était l'assimilation des institutions algériennes à celles de la métropole. Ces réformes réduiraient plus encore le rôle de l'administration militaire et renforceraient les unités départementales.
Depuis 1845, l'insécurité n'avait pas cessé de régner dans les confins algéro-marocains ; il ne s'était pas passé d'année sans que quelque agitation, quelque pillage fussent venus troubler l'Oranie, lui coûter des vies humaines et des pertes matérielles.
En 1859, à la suite d'une violation de notre territoire une véritable expédition fut organisée sous le commandement du général de Martimprey.
Le corps expéditionnaire comptait 15.000 hommes et trois divisions commandées par les généraux Walsin-Esterhazy, Yusuf et Desvaux.
La concentration eut lieu à la redoute du Kiss ; elle n'était pas encore terminée lorsque éclata une terrible épidémie de choléra qui devait faire périr un cinquième de l'effectif de l'expédition, soit près de 3.000 hommes.
Le premier voyage de l'Empereur (septembre 1860)
Il fit naître chez les colons de grandes espérances qui ne se réalisèrent pas.
Ce fut surtout un voyage d'apparat qui ne dura que trois jours, l'impératrice ayant été rappelée en France par la nouvelle de la mort de sa sœur la duchesse d'Albe. Débarqué à Alger le 17 septembre du yacht impérial l'Aigle, Napoléon III reçut la visite du Bey de Tunis qu'accompagnait le consul Léon Roches.
Il posa la première pierre du boulevard de l'impératrice qui devait s'étendre sur le front de mer de la Porte de France au fort Bab-Azzoun ; à la fois dock et promenade, il devait se composer d'une large terrasse supportée par une série de hautes arcades dont chacune renfermerait un magasin.
Le lendemain une magnifique fantasia de 10.000 cavaliers, dans laquelle figuraient des Biskris déguisés en Touaregs fut organisée à Maison-Carrée par le général Yusuf. L'Empereur y prononça un discours :
" Dans nos mains la conquête ne peut être qu'une rédemption et notre premier devoir est de nous occuper des trois millions d'Arabes que le sort des armes a fait passer sous notre domination.
- Elever les Arabes à la dignité d'hommes libres,
- répandre sur eux les bienfaits de l'instruction, tout en respectant leur religion,
- améliorer leur existence en faisant sortir de cette terre tous les trésors que la Providence y a enfouis et qu'un mauvais gouvernement laisserait stériles, telle est notre mission ; nous n'y faillirons pas.
Quant à ces hardis colons qui sont venus implanter en Algérie le drapeau de la France et avec lui les arts d'un peuple civilisé, ai-je besoin de dire que la protection de la métropole ne leur manquera jamais ?
Les institutions que je leur ai données leur font déjà retrouver ici leur patrie toute entière, et en persévérant dans cette voie, nous devons espérer que leur exemple sera suivi et que de nouvelles populations viendront se fixer sur ce sol à jamais français. "
Dans une conférence tenue au Palais, les généraux et les préfets firent assaut de récriminations et se plaignirent les uns des autres.
Peu de temps après le ministère de l'Algérie disparut et le gouvernement général fut rétabli, dénouement d'ailleurs prévu depuis la démission du prince Napoléon.
L'expérience n'avait duré que deux ans, période trop courte pour pouvoir juger pleinement les résultats, mais qui laissait voir cependant que la solution des problèmes algériens devait être recherchée, non dans le rattachement au gouvernement métropolitain mais dans une plus large autonomie. Le ministère de l'Algérie n'avait pas répondu à l'attente des libéraux. Créé dans un esprit de réaction contre l'administration militaire, il n'avait pas su réaliser son programme politique et social.
Les inconvénients du régime civil firent bientôt oublier les vices et ressortir les avantages du régime militaire. Les partisans les plus déterminés du régime civil furent obligés de reconnaître que l'assimilation était une impossibilité ; les rouages qui fonctionnaient dans la mère patrie étaient inapplicables vis-à-vis d'une population de trois millions d'âmes dont moins de 200.000 Européens vis-à-vis d'une population de mœurs et de religion si différentes des nôtres.
Un décret du 26 novembre 1860 supprima le ministère de l'Algérie et des colonies ; le maréchal Pélissier, duc de Malakoff fut nommé gouverneur général de l'Algérie.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
| Pélissier gouverneur général (1860-1864)
Envoyé par M. Christian Graille
|
Cette nomination fut accueillie avec beaucoup de faveur aussi bien par l'armée, que par les fonctionnaires civils et les colons.
Il connaissait bien l'Algérie où il avait fait toute sa carrière, sauf l'intervention de la guerre de Crimée où il s'était couvert de gloire à Malakoff ; il avait été l'un des meilleurs lieutenants de Bugeaud, il était à la bataille d'Isly.
Doué d'une grande finesse d'esprit, il la dissimulait sous une extrême brutalité de langage et de formes. Il est demeuré célèbre par la hardiesse de ses propos et par son mépris des préjugés.
En obtenant le gouvernement général de l'Algérie il réalisait le rêve de sa vie.
Malheureusement si l'on en croit Barail, il avait beaucoup vieilli :
" Alourdi, empâté, somnolent, il s'en remettait au prestige de sa gloire et au souvenir de ses actes passés d'implacable rigueur pour maintenir le pays dans le calme et la soumission.
Il n'avait jamais beaucoup aimé le travail ; les occupations sérieuses le fatiguaient ; il les écartait, cueillait les roses du pouvoir et en dédaignait les épines. Mais, très jaloux de ses prérogatives, quoique ne les exerçant pas, il n'en déléguait aucune et ses subordonnées pour échapper aux éclats de ses terribles colères se gardaient bien d'imprimer aux choses de la colonie une impulsion qu'il était incapable de leur donner. "
Pélissier avait d'excellentes intentions et des idées très sages, les idées d'un élève de Bugeaud.
Quoique la récolte de 1861 eût été fort mauvaise, le commerce, l'industrie, l'agriculture prirent un certain essor.
L'Algérie figura avec honneur à l'Exposition universelle de Londres en 1862 ; on déclara que sa section était la plus intéressante avec celle de l'Australie par le nombre, la variété, la beauté des produits.
Pélissier obtint un crédit de 2.500.000 francs pour achever la construction de la voie ferrée d'Alger à Blida qui fut ouverte au trafic en 1862. Il était nettement partisan de la colonisation ; ses vues en cette matière étaient celles de Bugeaud.
Un jour on le vit donner un exemple singulier et qui touchait presque au scandale ; des pétitions circulaient contre les projets de royaume arabe qu'on prêtait à l'Empereur ; il sortit de son palais à pied, en grand uniforme, et alla rue Bab-Azzoun signer la pétition, pour montrer par un éclat public quelles étaient ses préférences.
La question foncière se posait à nouveau si l'on voulait poursuivre et développer la colonisation européenne.
Le cantonnement paraissait fournir la solution cherchée ; tout en laissant aux indigènes une quantité de terres plus que suffisantes en fixant sur les terres leurs droits jusque-là mal définis et qui les mettraient à la discrétion des chefs, en constituant que ce qui leur était laissé la propriété familiale, on en aurait prélevé une part, qui eût pu être concédée ou vendue aux Européens ; le cantonnement était pratiqué en vertu de simples instructions administratives et l'absence de toute disposition légale n'était pas sans occasionner de multiples difficultés. L'opération ne portait d'ailleurs que sur les terres collectives et laissait de côté les propriétés privées dont la consistance restait assez mal déterminée.
La lettre de l'Empereur (1863)
Une foule de brochures anonymes anticoloniales paraissaient à cette époque. Elles revendiquaient l'Algérie pour les indigènes, qualifiaient la colonisation d'erreur et de contresens politique, accusaient les colons de tous les crimes.
On les montrait comme des agioteurs qui ne demandaient à grands cris le cantonnement des tribus que pour voir s'ouvrir un vaste champ de spéculations sur les biens ruraux et vendre aux indigènes à un prix élevé les terres que l'État leur aurait données gratuitement.
Plusieurs de ces brochures, non signées ou signées d'un pseudonyme, sont dues à un personnage assez énigmatique sur lequel il convient d'insister quelque peu.
Ismaël Urbain était un mulâtre, né à Cayenne en 1812 ; il avait souffert dans son enfance du préjugé contre les hommes de couleur ; il s'était fait musulman ; Saint-Simonien il avait collaboré avec lui à une brochure intitulée Lettres sur la race noire et la race blanche ; les auteurs voyaient dans le blanc " la race mâle ", dans le noir " la race femelle ", dans leur union " la constitution définitive de la famille humaine, la forme zoologique de la fraternité universelle. "
Urbain était interprète militaire ; il avait été attaché à la direction des affaires arabes au ministère de la guerre et le général Charon en 1849, se plaignait déjà de ce qu'il contrecarrait l'action du gouverneur général ; il fut en outre correspondant du journal des Débats de 1837 à 1847, utilisant comme publiciste les documents dont il avait connaissance comme fonctionnaire ; il devint ensuite conseiller du gouvernement à Alger.
Urbain fut l'auteur d'une brochure signée Georges Voisin, intitulée l'Algérie par les Algériens et d'une autre, celle-ci anonyme qui eut un grand retentissement :
L'Algérie française, indigènes et immigrants.
Il s'efforça d'y démontrer que les indigènes musulmans pouvaient parfaitement s'assimiler à notre civilisation :
" Le vrai paysan de l'Algérie, disait-il, l'ouvrier agricole, la base la plus rationnelle et la plus solide de la propriété, c'est l'indigène.
L'expérience a prononcé et il faut fermer les yeux à la lumière pour ne pas le reconnaître.
La colonisation par les Européens présente un double anachronisme politique et économique. Si depuis trente ans, il y a un enseignement en matière de colonisation, ce n'est que dans le sens d'une humiliante négation.
La liquidation de la colonisation agricole se fera d'elle-même, on peut même dire qu'elle se continuera sans qu'il soit besoin d'intervenir. "
Ismaël Urbain fut attaché à la personne de l'Empereur comme interprète pendant son voyage en Algérie et paraît avoir exercé une grande influence sur son esprit généreux et utopique.
Dans les sphères gouvernementales, un profond découragement régnait d'ailleurs à l'égard des hommes et des choses de l'Algérie. On ne savait plus quelle politique adopter. Après trente ans d'occupation tout était remis en question. Au Sénat le général Daumas demandait :
- qu'on mît à l'étude la question de savoir s'il y avait assez de terres pour la colonisation,
- si cette dernière touchait bien à l'intérêt français et par quels points,
- enfin si elle devait être civile, militaire, mixte, européenne, française ou arabe.
Les quelques jours passés par l'Empereur à Alger en 1860 l'avaient ébloui par de dangereux mirages ; il n'avait vu que les côtés superficiels du monde indigène :
- les grands chefs,
- les diffas (réception avec repas),
- les fantasias.
Il s'était trouvé en présence d'hommes beaux, fiers, intelligents, généreux, hospitaliers. Il avait cru voir en eux les représentants d'une nation arabe qui n'existait que dans son imagination.
Enfin il était imprégné des théories des économistes, dont il avait toujours très soigneusement suivi les travaux et qui désapprouvaient la colonisation officielle et étatique. Selon son habitude, l'Empereur procéda par un coup de théâtre et fit connaître brusquement sa décision par une lettre publique adressée au maréchal Pélissier le 6 février 1843.
" On peut admettre qu'il y ait utilité à cantonner les indigènes c'est-à-dire à prendre une certaine partie de leurs terres pour accroître la part de la colonisation. Aussi est-ce d'un consentement unanime que le projet de cantonnement soumis au Conseil d'Etat a été retiré.
Aujourd'hui il faut faire davantage, convaincre les Arabes que nous ne sommes pas venus en Algérie pour les opprimer et les spolier mais pour leur apporter les bienfaits de la civilisation. Cherchons par tous les moyens à nous concilier cette race intelligente ; fière, guerrière, agricole.
La loi de 1851 avait consacré les droits de propriété et de jouissance existant au temps de la conquête ; mais la jouissance mal définie était demeurée incertaine. Le moment est venu de sortir de cette situation précaire.
Le territoire des tribus une fois reconnu, on le divisera par douars, ce qui permettra plus tard à l'initiative prudente de l'administration d'arriver à la propriété individuelle.
Maîtres incommutables de leur sol, les indigènes pourront en disposer à leur gré et de la multiplicité des transactions naîtront entre eux et les colons des rapports journaliers plus efficaces pour les amener à notre civilisation que toutes les mesures coercitives.
La terre d'Afrique est assez vaste, les ressources à y développer assez nombreuses pour que chacun y puisse y trouver place et donner un libre essor à son activité, suivant sa nature, ses mœurs et ses besoins.
Aux indigènes l'élevage des chevaux et du bétail, les cultures naturelles du sol.
A l'activité et à l'intelligence européennes :
- l'exploitation des forêts et des mines,
- les dessèchements,
- les irrigations,
- l'introduction des cultures perfectionnées,
L'importation de ces industries qui précèdent ou accompagnent toujours les progrès de l'agriculture.
Au gouvernement local le soin des intérêts généraux, le développement du bien-être moral par l'éducation, du bien-être matériel par les travaux publics.
A lui, le devoir de supprimer les réglementations inutiles et de laisser aux transactions la plus entière liberté.
En outre, il favorisera les associations de capitaux européens, en négligeant désormais de se faire entrepreneur d'émigration et de colonisation, comme de soutenir faiblement les individus sans ressources, attirés par les concessions gratuites.
Voilà Monsieur le maréchal, la voie à suivre résolument car, je le répète, l'Algérie n'est pas une colonie proprement dite mais un royaume arabe.
Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection et je suis aussi bien l'Empereur des Arabes que l'Empereur des Français. "
Cette lettre témoignait d'un état d'esprit nettement défavorable à la colonisation de peuplement. Plus de concessions gratuites, plus de colons pauvres, plus d'intervention administrative. Qu'on laisse faire les capitaux et que l'élément européen se confine dans le rôle de banquier, d'industriel, d'ingénieur ou d'initiateur de cultures spéciales ; les cultures alimentaires et le sol qui les porte devaient rester aux indigènes.
On conclut que l'Empereur voulait, comme on l'avait proposé à diverses reprises, organiser les indigènes en société indépendante, annexée politiquement à la France mais vivant en dehors d'elle.
L'expression, en tout cas, indigna les Algériens qui protestèrent énergiquement ; le gouvernement local au lieu de calmer les esprits montra qu'il partageait au fond les sentiments de la population.
Les colons répondirent par diverses brochures, celles en particulier du docteur Warnier et de Jules Duval. Warnier dressait l'inventaire de la richesse totale des indigènes d'après les statistiques officielles et montrait que le cultivateur européen à peine installé produisait six fois plus que le cultivateur indigène.
Il réfuta les assertions qui représentaient l'indigène comme le vrai paysan de l'Algérie et le colon comme une superfétation inutile :
" Si le gouvernement a le droit, disait-il, d'être libéral, ultra-libéral même envers les indigènes de l'Algérie, n'a- t-il pas des devoirs à remplir envers la France qui supporte toutes les charges de la conquête, envers les colons français surtout ?
Ne serait-il-il pas opportun d'invoquer ceux non moins sacrés des colons ?
D'où sont-ils venus ces colons qu'on trouve trop nombreux aujourd'hui ?
Qui les a appelés ?
Qu'ont-ils fait pour qu'on annonce avec une sorte de joie la liquidation de leurs entreprises comme on se réjouirait de l'élimination d'un corps étranger gênant la marche de la prospérité algérienne ? "
Le sénatus-consulte de 1863
" J'ai chargé le maréchal Randon, disait l'Empereur dans sa lettre au maréchal Pélissier de préparer un projet de Sénatus-Consulte dont l'article principal sera de rendre aux fractions de tribus propriétaires incommutables des territoires qu'elles occupent à demeure fixe et dont elles ont la jouissance traditionnelle à quelque titre que ce soit. "
Le projet fut discuté par le Sénat dès le 8 avril. Le Comte de Casabianca, rapporteur, s'attacha à rassurer les colons :
" L'avenir de la colonisation n'est point menacé par la constitution de la propriété dans la main des Arabes. Les colons la sollicitent eux-mêmes avec insistance et voudrait qu'elle fût immédiate.
L'État ne se dessaisit point des terrains qui pourraient plus tard être livrés aux colons. Les 4 à 500.000 hectares qui leur ont été concédés dans l'espace de plus de vingt ans ne sont pas encore entièrement défrichés. Le domaine en possède 900.000 autres destinés à des concessions nouvelles. "
M. Ferdinand Barrot (avocat et député), observa qu'il redoutait, sinon l'esprit véritable du sénatus-consulte, du moins celui que certains gens lui prêtaient. Il prit la défende des colons :
" A côté de ces enfants de notre adoption que vous traitez avec une si grande magnanimité et une si infinie indulgence, il y a les enfants de notre sang que la France a appelé sur cette terre.
Ceux-là vous demanderont leur part de justice et de sympathie. D'où vient qu'il est nécessaire, jusque dans cette enceinte, de protester contre l'injuste dédain dont ils ont été l'objet et contre les appréciations venues du dehors, appréciations mêlées d'erreurs si criantes que cela les fait ressembler à des calomnies ?
Le 13 avril entendit un discours de M. Michel Chevallier. Il rappela l'existence d'un marché des terres aux Etats-Unis.
" J'aurais voulu trouver dans le sénatus-consulte le germe de quelque chose de ce genre mais il n'offre rien de semblable. Je trouve une concession considérable faite aux Arabes et qui est d'une grande sollicitude, je ne dirai pas pour les colons actuels mais pour les colons à venir.
Ce qu'il faut pour faire de l'Algérie une terre française c'est une forte population européenne. Or, a-t-on fait dans le sénatus-consulte quelques réserves pour encourager cette population à venir s'établir en Afrique sous le drapeau français ? Nullement. Rien n'a été prévu dans ce but, rien n'a été préparé.
Vous avez, à ce qu'on dit, 900.000 hectares à offrir à ces colons si désirables.
Ces 900.000 hectares sont-ils bien réellement prêts à être vendus ? Je ne le pense pas.
Il n'existe pas un bureau où les colons venus des départements français ou de Suisse ou d'Allemagne ou de tout autre pays d'Europe, puissent choisir et acquérir les terres à leur convenance en disant : voici mon argent, je prends tel lot. Vous n'avez rien de pareil et c'est là ce qu'il faudrait que vous eussiez. Neuf millions d'hectares sont abandonnées aux Arabes par le sénatus-consulte ; sur ces neuf millions, il y en a deux sur lesquels il ne peut y avoir la moindre contestation, ce sont les terres actuellement cultivées par eux ; il aurait été possible, facile même, de faire entrer tout de suite dans la propriété individuelle ces deux millions d'hectares.
Quant aux sept autres millions qu'on leur abandonne, je répète qu'on a été bien généreux, qu'on aurait pu en réserver une partie."
Le sénatus-Consulte du 22 avril 1863 déclarait les tribus de l'Algérie propriétaires des territoires dont elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce fût. Il devait être procédé administrativement et dans le plus bref délai :
1° à la délimitation du territoire des tribus,
2° à leur répartition entre les différents douars de chaque tribu,
3° de l'établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars partout où cette mesure serait jugée possible et opportune.
Ce n'était pas seulement une loi sur la propriété : c'était un grand bouleversement politique et social aboutissant à la dissolution de la tribu.
Le douar-commune, unité administrative, était appelé à remplacer la tribu, unité politique et sociale.
Le but final était l'établissement de la propriété individuelle, avec comme conséquence, la disparition du pouvoir des grands chefs, de l'aristocratie indigène.
Le Sénatus-Consulte a détruit l'organisation mi-patriarcale, mi-féodalee des indigènes ; instrument de pulvérisation sociale, il nous a mis en présence, selon le mot de M. Jules Cambon, d'une poussière d'hommes, d'un troupeau sans bergers.
Tout n'est pas à blâmer dans le sénatus-consulte de 1863. Il était parfaitement légitime et utile de répartir la propriété du sol entre les tribus, entre les douars, entre les individus. Mais cet acte législatif fut appliqué dans un esprit nettement hostile à la colonisation. Sur beaucoup de points les terres attribuées aux tribus dépassaient les limites de leurs droits et de leurs besoins et la part que l'État aurait pu réserver pour le service de la colonisation fut considérablement réduite ; l'acte de 1863 réduisait les chances futures de la colonisation. Comme l'œuvre de la colonisation par voie de création de centres fut complètement abandonnée de 1864 à 1870.
Ce qu'il y avait de très grave c'est que l'opinion en France, dans les milieux officiels, était désormais systématiquement hostile à la colonisation.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
| Jules Cambon (1891-1897)
Envoyé par M. Christian Graille
|
Il est assez malaisé de juger équitablement les évènements et les hommes trop rapprochés de nous et de les mettre à leur vraie place. Le recul manque pour apprécier les faits qui n'ont pas encore produit toutes leurs conséquences.
L'histoire ne dispose ni de documents d'archives, ni de mémoires privés.
On peut bien cependant, sans crainte de se tromper, dire que l'Algérie a eu la bonne fortune, en quelques années de rencontrer quatre grands gouverneurs généraux dont le rôle fut considérable. Ce sont MM. Jules Cambon, Laferrière, Révoil et Jonnart.
Très différents de tempérament et de formation intellectuelle, ils ont travaillé avec la même ardeur à la même œuvre : la création de l'Algérie nouvelle. Ils ont trouvé dans l'administration des collaborateurs remarquables.
Parmi les hommes qui honorent le plus notre temps et notre pays, il faut faire figurer MM. Paul et Jules Cambon. Unis par une fraternelle amitié, leur carrière offre un remarquable parallélisme. Issus l'un et l'autre de l'administration préfectorale, ils ont occupé les grandes ambassades de Londres et de Berlin à une époque des plus critiques, celle qui a précédé la guerre européenne et y ont montré d'éminentes qualités.
L'un et l'autre ont joué un grand rôle dans l'Afrique du Nord ; M. Paul Cambon a organisé le protectorat tunisien, M. Jules Cambon a marqué sa place, une des premières, dans l'histoire de l'Algérie.
Né à Paris en 1845, M. Jules Cambon, élevé dans un milieu très cultivé et très libéral, se lia d'amitié avec Jules Ferry et les autres membres de l'opposition de la fin du Second Empire.
Il fit la guerre de 1870 comme officier de mobiles puis fut attaché au gouvernement de l'Algérie en 1874 ; le général Chanzy, alors gouverneur général, voulant le mettre à même de bien connaître l'administration de la colonie, le fit passer successivement par tous les bureaux.
Nommé préfet de Constantine en 1878, puis préfet à Lille et à Lyon il fut appelé en avril 1891 par M. Constans au gouvernement général de l'Algérie. Il y demeura près de sept ans. Sa rare intelligence, sa connaissance des hommes, sa clairvoyance, sa finesse lui ont permis de faire triompher ses vues qui étaient celles du bon sens et du patriotisme.
Il a déblayé le terrain pour ses successeurs, rendu possible les réformes ultérieures en restituant au gouverneur général sa légitime autorité. Il mit fin aux inconvénients du système des rattachements.
Les rapports de Burdeau et de Jonnart
De remarquables rapports parlementaires celui de Burdeau en 1891, celui de Jonnart en 1892 attirèrent l'attention sur la situation de l'Algérie dont ils firent une étude très complète.
Burdeau constatait que les crédits alloués de 23 millions à 41 entre 1871 et 1884, étaient stationnaires à partir de cette date ou avait même diminué. Il se demandait quel était le sens de cette stagnation.
- Ou bien le parlement avait des doutes sur l'efficacité des sacrifices déjà faits,
- ou bien il considérait le pays comme suffisamment pourvu des services et des travaux publics dont elle avait besoin,
- ou bien enfin il estimait que cette contrée devait poursuivre sa croissance, que son budget devait se développer, mais qu'il devait y parvenir sans surcharger la métropole et en faisant appel à ses propres ressources.
Dressant le bilan de la situation économique, administrative et sociale, il montra que les deux premières hypothèses devaient être écartées. Il conclut qu'avec une administration bien recrutée, instruite de la langue et des choses du pays, fortement contrôlée de France, rendue indépendante des mauvais politiciens, l'avenir de la colonie était désormais assuré. L'heure était venue où la colonisation allait cesser d'être une entreprise plus souvent patriotique que profitable.
L'opinion de Burdeau n'était pas favorable au budget spécial qui, disait-il, ne créerait pas de ressources nouvelles et engagerait prématurément le pays dans la voie des emprunts. Il proposait une simple unification des dépenses et des recettes permettant au Parlement de suivre avec plus de clarté le mouvement financier de la colonie.
Il critiquait assez vivement les méthodes de colonisation officielle, le réseau ferré et la manière dont avait été conçue l'administration des indigènes. Ces critiques furent reprises et accentuées l'année suivante par M. Jonnart. Il insistait sur la nécessité de maintenir et de renforcer le gouvernement général. Il établissait fortement les périls de l'assimilation administrative et de la centralisation exagérée ; il dénonça les inconvénients graves de l'organisation départementale et communale, servilement copiée sur l'organisation métropolitaine.
Réaction contre les rattachements
Le Sénat décida la nomination d'une commission de dix-huit membres chargée de rechercher, de concert avec le gouvernement, les modifications qu'il y avait lieu d'introduire dans la législation et dans l'organisation des divers services de l'Algérie. La Commission eut la bonne fortune d'avoir à sa tête Jules Ferry qui lui consacra ce qui lui restait de force et de vie.
Son œuvre fut fort importante. Après avoir arrêté son programme, elle recueillit à Paris d'intéressants témoignages. En mai et juin 1892 une délégation poursuivit en Algérie une enquête sérieuse, interrogeant les colons et les indigènes.
La Commission s'était tracée un programme assez vaste pour embrasser l'universalité des intérêts algériens. Son but était de recueillir des témoignages, d'analyser des documents et de dégager des conclusions générales.
De 1892 à 1896 furent publiés une série de rapports dont quelques-uns sont tout à fait remarquables sur :
- l'organisation et les attributions du gouverneur général,
- le régime fiscal,
- le régime forestier,
- la propriété foncière
- la colonisation,
- la justice française et musulmane,
- les offices ministériels,
- l'instruction primaire des indigènes et les medersas.
Le rapport de Jules Ferry qui fut son testament politique et demeura célèbre dans les annales parlementaires. Le système des rattachements y était condamné dans les termes les plus énergiques :
" Les inspirateurs des décrets de 1881, disait-il, se proposaient un double but : améliorer les services, annihiler ou du moins réduire l'autorité du gouvernement général. Dans ce programme seule la seconde partie a été réalisée, au grand détriment des affaires elles-mêmes.
Au lieu de concentrer entre les mains d'un grand fonctionnaire, investi de grands pouvoirs, la décision du plus grand nombre d'affaires, on l'a éparpillée à Paris entre neuf ministères. Mais les colonies, pas plus que les batailles, ne se commandent de loin, dans les bureaux d'un ministère. "
Le décret de 1896
A la suite de ces résolutions, un décret du 31 décembre 1896, abrogeant les décrets de 1881, conféra au gouverneur des pouvoirs propres qu'une formule générale définissait en ces termes : le gouvernement centralise sous son autorité le gouvernement et la haute administration de l'Algérie.
Le décret précisait en suite les attributions conférées au gouvernement du point de vue militaire, diplomatique, administratif et budgétaire.
Tous les services civils étaient placés sous sa direction à l'exception des services non musulmans de la justice et des cultes, de l'instruction publique, des services de la trésorerie et des douanes.
M. Jules Cambon avait réussi à reconquérir l'indépendance de son administration.
Le décret de 1896 fut la première victoire remportée sur le régime des rattachements, le point de départ essentiel de toute réforme. Dès lors, tout s'enchaîna logiquement ; dans les années qui suivirent, l'Algérie fut dotée d'une assemblée appelée à délibérer sur son budget, reçut son autonomie financière, les territoires du Sud furent pourvus d'une organisation appropriée.
Les successeurs de M. Cambon complétèrent son œuvre et marchèrent résolument dans la vois qu'il avait tracée.
M. Lépine (1897-1898). Les troubles antisémites
Le choix du gouvernement pour la succession de M. Cambon échut à M. Lépine qui fut nommé le 1er octobre 1897.
On a dit de lui qu'il était un homme brave et un brave homme ; payant de sa personne, plein de sang-froid au milieu du danger, il s'était fait par ses qualités une popularité par les Parisiens comme préfet de police. Mais il était peu préparé aux fonctions de gouverneur général de l'Algérie, qu'il n'avait pas sollicitées et qu'il ne conserva que quelques mois.
Un certain malaise continuait à peser dans le pays ; il se traduisait par des émeutes antijuives. Les causes de cette agitation étaient multiples : causes politiques, sociales, économiques. Il n'y avait là ni question de race ni question de religion.
Les Algériens détestaient surtout dans l'Israélite le concurrent commercial ; une question électorale venait envenimer les choses et c'est de préoccupations électorales que s'inspiraient avant tout, les campagnes antijuives qui furent menées à diverses reprises.
Le droit de vote reconnu aux Israélites leur donnait, en certain cas, le corps électoral étant fort peu nombreux, une influence prépondérante. On s'efforçait de les mêler aux luttes des partis et leurs défenseurs leur nuisaient souvent autant que leurs adversaires.
Ce n'étaient pas seulement les Juifs qui pesaient lourdement dans la balance électorale. La loi de 1898 sur la naturalisation accordait le droit de cité à un grand nombre d'étrangers ; les deux éléments encore incomplètement fusionnés s'opposaient l'un à l'autre. Tandis que les uns dénonçaient le " péril juif ", les autres signalaient le " péril étranger " et montraient les dangers de l'afflux trop rapide dans les cadres électoraux d'hommes que la loi avait déclarés Français avant qu'ils n'eussent acquis la mentalité française.
Les naturalisés, les néo-Français comme on les appelait à cette époque ont incontestablement joué un grand rôle dans le mouvement antijeu.
Depuis 1871, la question juive n'avait pas cessé d'avoir un caractère aigu.
Des troubles antisémites s'étaient produits
- à Alger en 1871,
- à Tlemcen, à Constantine, Sétif, Batna vers 1875-1878,
- à Alger Constantine Oran, Mostaganem en 1897.
En 1898, sous les excitations d'une presse extrêmement violente, des émeutes éclatèrent encore dans certaines villes ; les désordres eurent un caractère particulièrement sérieux à Alger, où, sous la conduite d'un jeune agitateur, Max Régis, les émeutiers pillèrent et saccagèrent les boutiques, se ruant à l'assaut des magasins israélites.
Régis devenu maire, Drumont élu député étaient l'objet d'un véritable culte ; l'anarchie menaçait, la vie économique était suspendue. M. Lépine qui avait essayé de tenir tête courageusement, comme il avait coutume de le faire à Paris, se heurta à une foule hurlante.
Monsieur Laferrière (1898-1900)
Vice-président du Conseil d'État, il remplaça M. Lépine en juillet 1898. Jurisconsulte éminent, homme grave et pondéré, il ne contenta pas de réprimer l'émeute il voulut en prévenir le retour en faisant les réformes nécessaires.
Il rétablit l'ordre dans la rue, dans l'administration, dans les attributions et le fonctionnement des corps administratifs.
Le maire antisémite d'Alger, Max Régis, fut suspendu ; mais Laferrière eut le grand mérite de comprendre que des mesures de répression ne suffisaient pas et que pour atteindre le mal dans ses racines, pour détourner les Algériens des agitations stériles de la rue, il fallait donner un élément de leur activité.
Il obtint du gouvernement les décrets du 23 août 1898 qui furent une sorte de constitution de l'Algérie. Le premier fortifiait et précisait les pouvoirs du gouverneur général, le second créait une assemblée élective nouvelle qui avait pour but d'apporter au gouverneur le concours d'opinions libres, d'avis éclairés et de vœux réfléchis, émis par des représentants directs des contribuables algériens sur toutes les questions d'impôts et de taxes assimilées.
Cette assemblée se composait de trois délégations :
- celle des colons (24 membres) représentant les intérêts de la colonisation et de l'agriculture,
- celle des non-colons (24 membres) représentant les intérêts des commerçants, des industriels, des ouvriers,
- celle des indigènes (21 membres dont 6 formaient la section kabyle) représentant les intérêts de la population indigène.
Les assemblées algériennes ressemblaient à première vue aux deux Chambres d'un Parlement mais elle n'avait en réalité ni pouvoir législatif, ni autorité souveraine. Elles avaient un rôle prépondérant dans l'élaboration du budget, votaient les emprunts, et autorisaient le gouverneur à accorder des concessions de chemins de fer.
De cruelles épreuves privées, la perte d'un fils, le souci de sa propre santé très ébranlée amenèrent M. Laferrière à résigner ses fonctions en octobre 1900 ; il fut nommé procureur général à la Cour de cassation et mourut l'année suivante.
Il était venu en Algérie à une époque bien tardive de sa carrière et de son existence ; soucieux de ses responsabilités, il n'était pas sans montrer quelque inquiétude sur ce terrain nouveau pour lui.
Par son tact et sa fermeté, il avait rétabli l'ordre matériel et amené les Algériens à une vue plus calme et plus raisonnable des choses.
Par la création des délégations financières, il avait contribué puissamment à l'évolution qui éloignait le pays du système de l'assimilation injuste pour les indigènes et démoralisateur pour les Français. Il avait compris qu'au moment où l'Algérie devenait majeure, il fallait se livrer à un délicat travail d'équilibre et légiférer pour chacun des groupes ethniques qu'y s'y côtoyaient sans se confondre.
Monsieur Jonnart (1900-1901)
Il fut appelé à la succession de M. Laferrière ; son gouvernement de dura que quelques mois (octobre 1900-mai 1901) ; comme son prédécesseur il dut abandonner sa tâche pour des raisons de famille et de santé. Mais il devait revenir à deux reprises au gouvernement général de 1903 à 1911 et de 1918 à 1919.
Nul n'a accompli une œuvre plus considérable que celle de M. Jonnart et n'y a laissé des traces plus durables.
Né à Fléchin (Pas de Calais) en 1857, il descendait d'une vieille famille d'agriculteurs de la région. Il avait vingt-quatre ans en 1881 lorsque M. Tirman, appelé au gouvernement général de l'Algérie par Gambetta, le choisit comme chef de cabinet. Elu député en 1889, il fut dès 1893 appelé à faire partie du ministère Casimir-Périer comme ministre des travaux publics.
Au Parlement il ne cessa de s'occuper des questions algériennes ; sa parfaite connaissance des hommes et des choses de la colonie lui permit de rédiger son rapport en 1892.
De tous les gouverneurs c'est celui qui a le plus aimé l'Algérie.
Au cours d'une carrière exceptionnellement brillante, il occupa avec distinction les postes les plus considérables. Mais c'est dans sa carrière africaine qu'il trouva l'emploi le plus fécond de ses hautes qualités. L'Algérie n'était pour lui comme pour tant d'autres une étape à franchir plus ou moins rapidement ; elle fut vraiment le centre de sa carrière et de ses préoccupations.
Il jouissait d'une véritable popularité aussi bien parmi les colons que parmi les indigènes. Peu d'hommes ont contribué autant que lui à la création d'une France nouvelle au-delà de la Méditerranée.
En octobre1900, dans les conversations qui précédèrent sa nomination il était intervenu personnellement auprès de M. Waldeck-Rousseau (ministre) et l'avait converti à l'idée d'un budget spécial.
Dans les premiers rapports qu'il adressa au président du Conseil il expliqua que les promoteurs du mouvement antijeu n'aurait jamais constitué une opposition redoutable s'ils n'avaient trouvé un terrain propice à leur propagande, une Algérie en plein malaise de croissance nerveuse, souffrant d'un régime administratif incohérent et trop souvent infécond, que les critiques du Parlement et les avertissements si pressants de M. Jules Cambon avaient à peine ébranlé.
La loi du 19 décembre 1900 conféra à l'Algérie la personnalité civile et lui donna un budget spécial.
Elle laissait à la charge de la métropole les dépenses de la guerre, de la marine, des pensions et la garantie d'intérêts des chemins de fer jusqu'en 1926 mais celle-ci conserva un contrôle et un droit de regard sur le budget algérien.
La loi de 1900 fut un acte marquant dans l'histoire de l'Algérie. Les hommes d'État qui la firent voter comprirent que ce pays ne pouvait se développer et se fortifier dans les liens qui l'enserraient, qui faisait dépendre chacun de ses mouvements d'impulsions lointaines et diverses.
Alors que tout le monde reconnaissait que l'essor de la colonie et le souci de son avenir nécessitaient de sérieux efforts, la majeure partie du produit des taxes nouvelles et le bénéfice des excédents de recettes lui échappaient. Le budget spécial mit fin à cette situation.
L'affaire de Margueritte
M. Laferrière avait attiré l'attention sur les graves inconvénients des actes de désordres dans une colonie dont la population n'était pas entièrement française. Les évènements ne devaient pas tarder à lui donner raison.
Le 26 avril 1901, le village de Margueritte, situé à neuf kilomètres de Miliana, était assailli par une bande d'insurgés appartenant à la tribu des Rirhas ; l'instigateur du mouvement était un certain Yacoub, employé d'un colon européen, qui se découvrit tout à coup une vocation de prophète et d'illuminé.
Les indigènes donnèrent aux Européens qu'ils rencontrèrent le choix entre la conversion à l'Islam et la mort ; ceux qui consentirent à coiffer la chéchia et prononcer la profession de foi musulmane furent épargnés.
Une compagnie de tirailleurs, envoyée de Miliana, mit bientôt fin aux exploits de ces fanatiques ; cinq Européens et seize indigènes avaient été tués.
L'affaire de Margueritte était grave comme symptôme. Elle montrait que la mentalité des indigènes n'avait guère changé et qu'ils étaient encore disposés à suivre le premier agitateur qui se présenterait.
Elle prouvait que les querelles des Européens étaient pour les indigènes un fâcheux exemple et que les Français d'Algérie, de même qu'en 1871, avaient été imprudents en agissant comme s'ils n'étaient pas entourés d'une population musulmane dix fois plus nombreuse qu'eux.
Elle témoignait comme les troubles antijuifs eux-mêmes des inconvénients de l'incohérence administrative, conséquence du système des rattachements. Elle nous avertissait que nous avions trop perdu de vue le problème indigène, trop négligé nos devoirs de surveillance et de tutelle.
M. Révoil (1901-1903)
M. Jonnart, en donnant sa démission au bout de quelques mois, exprimait l'espoir que son programme continuerait à être appliqué et que son successeur travaillerait, comme il l'avait fait lui-même à la fusion plus intime des races et à l'essor de l'Algérie.
Cet espoir ne fut pas déçu.
M. Revoil, ministre de la France au Maroc, qui fut choisi pour le remplacer était un diplomate accompli, un esprit souple et ingénieux qui excellait à résoudre les difficultés sans les heurter de front.
Lettré et artiste, il séduisait tous ses interlocuteurs par le charme qui émanait de sa personne et de sa conversation.
Cet homme si doux et si paisible fut d'ailleurs en matière administrative le plus audacieux de tous les gouverneurs. Il poursuivit à la fois le développement économique et l'union morale de la colonie. Il s'efforça, non sans succès, de détourner les Algériens des agitations de la rue pour les orienter vers la solution des problèmes économiques en même temps qu'il achevait la réorganisation administrative.
La réforme judiciaire et les tribunaux répressifs
Dès 1891, la Commission sénatoriale réclamait pour les indigènes une justice plus prompte, plus expéditive, mieux appropriée à leurs besoins.
Jusqu'en 1902, la justice répressive vis-à-vis des indigènes était exercée par des juridictions de droit commun :
- justices de paix,
- tribunaux correctionnels,
- Cours d'assises.
Visiblement, l'appareil compliqué de notre justice criminelle était assez mal adapté aux mœurs des musulmans qui ne comprenaient rien aux formalités et aux lenteurs de notre procédure et contribuait à entretenir la plaie de l'insécurité.
M. Revoil attacha son nom à la création de deux juridictions nouvelles : les tribunaux répressifs et les cours criminelles. Les tribunaux répressifs remplacèrent les tribunaux de première instance comme juridiction correctionnelle ; ils se composaient du juge de paix président et de deux assesseurs, un Français, un indigène, nommés pour un an par le gouverneur général. Les fonctions du ministère public étaient remplies par un administrateur ou par un administrateur-adjoint.
Les cours criminelles créées par la loi du 30 décembre 1902, furent substituées à la cour d'assises pour les crimes commis par les indigènes ; elles comprenaient trois magistrats, deux assesseurs-jurés français et deux assesseurs-jurés musulmans. Les deux juridictions furent vivement critiquées.
On prétendit qu'elles constituaient un défi aux principes les moins discutables de notre droit public ; les tribunaux répressifs surtout furent qualifiés d'odieux et monstrueux ; on déclara que c'était là une justice à la turque ; on se plaignit :
- de l'attribution du rôle de ministère public aux administrateurs,
- de la suppression du droit d'appel,
- de la citation verbale.
Le garde des sceaux promit d'apporter aux tribunaux répressifs quelques retouches qui rendirent leur fonctionnement plus satisfaisant.
La démission de M. Révoil
et le voyage du Président de la République
Victime d'incidents de politique intérieure et de basses compétitions, M. Revoil se vit obligé, le 13 avril 1903, de donner sa démission.
Il abandonnait, contraint et forcé, l'œuvre à laquelle il avait consacré son ardeur et sacrifié une partie de sa santé. Il s'était heurté à une opposition tenace et secrète contre les nouvelles institutions algériennes.
Après avoir fait du gouverneur général un très haut personnage de l'État, on le brisait comme un fonctionnaire subalterne.
L'émotion fut très vive en Algérie où M.Revoil s'était rendu populaire par son dévouement aux intérêts algériens, l'aménité de son caractère et la cordialité de ses relations.
Le départ du gouverneur général était d'autant plus regrettable qu'il se produisait à la veille du voyage du Président de la République, M. Loubet qui dura du 15 au 26 avril.
L'Espagne, l'Italie, la Russie, la Grande-Bretagne envoyèrent des navires de guerre le saluer à Alger.
Le Président recommanda l'union de tous les Français d'Afrique, l'apaisement et la concorde entre tous les peuples et toutes les races.
Il constata que les discordes étaient beaucoup plus superficielles de près qu'elles ne le paraissaient de loin et que le prétendu antagonisme entre les colons et les indigènes n'existait en aucune façon.
Le 23 avril, une magnifique revue fut passée en présence du Président dont le voyage contribua au rétablissement du calme dans la colonie.
Quelques jours après, M. Jonnart était nommé gouverneur général et reprenait l'œuvre que son état de santé ne lui avait pas permis d'achever en 1900.
Il allait, cette fois, passer près de neuf ans au gouvernement général et mettre fin à la regrettable précarité qui avait caractérisé les gouverneurs généraux depuis M. Cambon.
L'évolution politique commencée en 1896 était à ce moment achevée. Ses principales étapes avaient été :
- la restauration des pouvoirs du gouverneur en 1896,
- la création des délégations financières en 1898,
- l'institution du budget spécial en 1900,
- l'organisation des territoires du Sud en 1902.
Ces divers actes donnèrent à l'Algérie sa constitution nouvelle.
On conciliait la liberté nécessaire à la colonie et on renonçait définitivement aux erreurs de l'assimilation aussi bien que celles du royaume arabe.
Le second gouvernement de M. Jonnart (1903-1911)
Cette nouvelle constitution c'est à M. Jonnart qu'il allait appartenir de la faire fonctionner et d'en tirer le meilleur parti. La colonie était à l'âge critique.
Devant elle se dressaient les questions économiques, financières et sociales les plus graves et les plus complexes.
Comme lors de son premier gouvernement il s'appliqua à détourner les Algériens des querelles stériles ; il s'efforça :
- de les intéresser à leurs affaires,
- de donner un aliment à leur activité,
- d'élargir leur horizon,
- de leur inculquer le sentiment des réalité et des responsabilités.
Le budget spécial fut l'instrument d'indéniables progrès. Qu'il s'agisse :
- de colonisation,
- d'enseignement public,
- des œuvres de prévoyance,
- d'assistance et d'hygiène,
- de la conservation et de l'exploitation des forêts,
- de l'organisation des territoires du Sud,
- de l'exécution dans le Nord comme dans le Sud d'importants travaux publics, le nouveau régime de décentralisation provoqua d'heureuses initiatives et des solutions fécondes.
Les assemblées algériennes montrèrent une prudence et une sagesse exemplaires. Leur principale préoccupations fut de doter l'Algérie d'un budget sincère et solide ; leur gestion fut ordonnée, méthodique.
Un vaste programme de travaux publics fut mis sur pied, comportant :
- la construction de 1.000 kilomètres de chemin de fer,
- d'un important réseau de routes nationales,
- l'amélioration des ports,
- l'exécution de travaux hydrauliques.
En outre :
- de nouveaux centres furent créés,
- les anciens améliorés,
- les richesses forestières largement exploitées,
- un effort énorme consenti en faveur de l'enseignement tant européen qu'indigène,
- l'assistance publique et l'hygiène développées.
L'emprunt était le seul moyen d'exécuter les travaux publics indispensables.
Il fut autorisé par la loi du 28 février 1908.
Sur un total de 175 millions,
- 96 étaient destinés aux chemins de fer, dont 72 pour la construction de lignes nouvelles, le surplus étant attribué à l'amélioration des lignes déjà existantes,
- 32 aux routes,
- 16 aux travaux maritimes.
Les lignes algériennes étaient partagées entre cinq compagnies dont les réseaux étaient constitués d'une manière tout à fait incohérente sans soudure entre elles.
Ce morcellement entraînait des inconvénients graves au point de vue des pertes de temps et des charges financières de l'exploitation.
M. Jonnart dût se contenter de poursuivre l'unification des tarifs, leur communauté sur les divers réseaux et l'exécution du programme des travaux complémentaires en s'adressant séparément à chacun des concessionnaires.
Seule la compagnie de l'Est-Algérien, par suite des règles qui avaient présidé à la construction de son réseau déclara ne pouvoir s'engager dans la voie des abaissements de taxes.
En 1911 le rachat des lignes de la compagnie Bône-Guelma fut réalisé.
M. Lutaud (1911-1918)
Lorsque M. Jonnart quitta l'Algérie en 1911, l'évolution déterminée par la suppression des rattachements était très avancée. Les nouvelles institutions fonctionnaient de manière satisfaisante.
M. Lutaud, préfet du Rhône, qui lui succéda et qui demeura plus de sept ans au gouvernement général accomplit aussi une œuvre considérable.
Homme de parti et qui ne s'en cachait pas sut cependant faire plus et mieux que de la politique électorale et préfectorale, s'élever à des vues d'ensemble dignes de ses hautes fonctions, apporter sa contribution, à l'organisation de l'Algérie nouvelle. C'est à lui qu'incomba la tâche difficile de gouverner la colonie pendant presque toute la durée de la grande guerre.
La situation de l'Algérie en 1914 était des plus satisfaisantes tant au point de vue politique, qu'économique. Les troubles de l'antisémitisme avaient pris fin et le souvenir même en était effacé.
L'entente était demeurée parfaites entre les gouverneurs et les assemblées.
Celles-ci comptaient des hommes d'un réel mérite, sérieux, pratiques, profondément dévoués aux intérêts du pays, soucieux du bien public.
Le budget était passé de 58 millions en 1901 à 175 millions en 1914.
La dette était très faible et les réserves fiscales intactes.
Les Européens ne payaient ni la contribution foncière sur la propriété non-bâtie, ni l'impôt sur les successions.
Ces privilèges longtemps légitimes et nécessaires étaient appelés tôt ou tard à disparaître, les colons étaient les premiers à en convenir ; leurs représentants déclaraient qu'ils se rallieraient volontiers à un système qui établirait les mêmes obligations fiscales pour les Européens et les indigènes.
Dès 1911, M. Lutaud, avec une claire vision des nécessités politiques et financières, avait fait étudier la réforme du régime des impôts ; la grande guerre allait en hâter la réalisation.
Gabriel Hanotaux de l'Académie française
Alfred Martineau professeur au Collège de France
Histoire des colonies françaises
et de l'expansion de la France dans le monde.
Tome II : l'Algérie par Augustin Bernard professeur à la faculté des lettres de Paris. Édition 1930.
|
|
LES PÉPINS DE LA POIRE
Envoyé par M. Hugues
|
|
Un renard et un ragondin déjeunent à la cantine de leur société.
Au dessert, le renard, après avoir épluché sa poire, en aligne les pépins sur la table.
Le ragondin s’en étonne. Alors le renard lui explique :
Sais-tu que les pépins, mangés à part, rendent intelligent ?
Non! Je ne savais pas.. Je peux essayer ?
D'accord ! Ça te coûtera 2 € le pépin, et il y en a huit, ça fait 16 euros.
Le ragondin paie et mange les pépins.
Soudain, il fait une remarque :
Quand même, c’est de l’arnaque ! Pour 16 euros j’aurais pu acheter 4 kg de poires !
Eh bien tu vois ! dit le renard, les pépins commencent à faire leur effet !...
|
|
LES FRANÇAIS EN ALGERIE (1845)
Source Gallica : Louis Veuillot N°21
|
XXIX -
CONCLUSION
Depuis l'époque où s'arrêtent ces souvenirs, de grandes choses ont été accomplies en Algérie. Pendant la seconde marche sur Mascara, M. le général Bugeaud recevait des lettres écrites au nom des tribus les plus importantes, probablement sous la dictée d'Abd-el-Kader, dans lesquelles on étalait avec jactance la résolution de combattre éternellement les Français. L'émir comptait encore sur sa tactique : il espérait fatiguer l'intrépide armée dont il avait pu jusqu'alors éviter les coups. Ses espérances furent déjouées par des manœuvres dont l'habileté, la hardiesse, et la persévérance dépassèrent tout ce qu'on avait vu. L'occupation agissante de Mascara, de Tlemcen, de Milianah et de Médéah, établissant dans l'intérieur des terres le centre de nos opérations, qui n'avait été jusque-là que sur certains points de la côte, déconcerta les plans de l'ennemi. A force d'intrépidité, nos soldats montrèrent qu'ils sauraient mieux que les indigènes eux-mêmes, supporter les difficultés du climat ; ils pénétrèrent dans des lieux, à des distances où les Turcs ne s'étaient jamais aventurés ; il n'y eut plus de repos, plus de sécurité, plus d'agriculture possible ; les moissons furent ravagées, les silos (greniers souterrains) découverts et vidés; enfin, plusieurs fractions de tribus nous demandèrent la paix et se mirent sous notre protection. Ce fut le signal de la ruine de l'émir. Ces premières défections en entraînèrent d'autres; nous pûmes protéger nos amis. On vit ce que personne, quelques mois auparavant, n'aurait osé espérer : le pays lui-même approvisionner nos garnisons, et les Arabes qui avaient le mieux combattu pour l'émir marcher sous nos drapeaux.
A partir de ce jour, Abd-el-Kader fut vaincu. Le besoin de la paix parla plus haut que le Coran ; on avait trouvé dans le livre sacré des textes qui commandaient de nous faire la guerre ; on y en trouva qui autorisaient, qui exigeaient presque la paix et la soumission au vainqueur.
Le maréchal Bugeaud, vainqueur d'Abd-el-Kader dans l'Algérie et vainqueur de l'empereur du Maroc sur les frontières de l'empire, a pu venir en France, et toute la France l'a entendu raconter avec simplicité ce qu'il avait fait. Sa position ne lui a pas permis de dire nettement à quel point une malheureuse politique a fait avorter la victoire de l'Isly et celle de Tanger ; mais on l'a compris, et personne ne lui a imputé des torts qui n'étaient pas les siens. On s'est plu à l'entourer d'hommages.
Quelques esprits jaloux ont seuls trouvés ces hommages excessifs. Ceux qui connaissent la véritable situation des choses, et qui savent combien de difficultés de tout genre étaient à vaincre et ont été vaincues, ne penseront jamais qu'on puisse trop honorer l'homme de tête et de cœur qui a rendu si bravement de si éminents services à son pays. Oui, c'est peu de chose que la bataille de l'Isly, comparée à quelqu'une de ces grandes batailles de l'empire, qui ont à peine fait autant de bruit dans le monde.
C'est peu de chose si l'on compare le nombre des forces engagées, la valeur matérielle des trophées, les morts restés sur le terrain. Mais si l'on songe à l'audace du coup, à l'habileté des manœuvres, à la difficulté d'aller chercher si loin l'ennemi, à la difficulté de l'atteindre, cette bataille prend la glorieuse place qu'elle doit occuper au rang de nos belles journées militaires. Ce n'est pas la faute du vaillant chef qui l'a gagnée si les négociateurs ont, en quelque sorte, guéri la plaie que son épée venait de faire. Avoir forcé Abd-el-Kader de chercher un refuge dans le Maroc, avoir atteint Muley-Abderahman dans son empire, l'y avoir frappé de telle sorte que ses fanatiques sujets n'aient pas osé se ruer en masse sur le territoire français, c'était un grand résultat. On pouvait compléter ce résultat en forçant Abderahman de livrer Abd-el-Kader, dont la présence et la vie rendront toujours précaire la soumission des Arabes de l'Algérie. Abderahman, quelque respect qu'il ait pour l'iman de la guerre sainte, aurait fait les derniers efforts pour s'emparer de lui, si la paix avait été à ce prix. Il craint Abd-el-Kader autant qu'il l'admire, et l'intérêt politique aurait fait taire le sentiment religieux.
Néanmoins M. le maréchal Bugeaud a pu dire que l'Algérie était vraiment pacifiée au moment où il parlait, et pacifiée d'une manière digne de la France. Nous ne sommes pas enfermés derrière des fossés et des murailles, nous n'avons d'autres limites que celles du royaume.
Tout est à nous entre Tunis, Maroc et le désert ; et cette vaste zone, aujourd'hui parcourue en tous sens par nos armes (à l'exception de la Kabylie que nous enfermons, et qu'il faudra bien un jour réduire ), voit des établissements français naître et prospérer jusque sur ses points les plus reculés. Les garnisons de l'intérieur ne sont plus des tombeaux, mais des séjours supportables, agréables même, où règne le travail, où respire la vie.
En même temps de nombreux villages s'élèvent dans la Mitidja, les terres anciennement cultivées y recouvrent leur fertilité ; on défriche les espaces que l'apathie musulmane laissait se couvrir de broussailles séculaires ; des routes commodes et sûres sont ouvertes au commerce et à l'industrie. De l'aveu des meilleurs juges, confirmé par l'expérience, l'Algérie peut devenir une source de richesses.
Voilà l'œuvre glorieuse de nos armes, mais cette œuvre n'est pas achevée.
Lorsque j'étais en Algérie, le commandant supérieur de Philippeville écrivait : " Nous n'avons pas moins de douze cents individus à suivre du doigt et de l'œil, la nuit comme le jour. " Ces quelques mots disent assez Comment se forme la population européenne de l'Algérie.
Qui ne comprend que, même en admettant comme parfaite et durable la soumission des indigènes, ces Européens sans aveu, dont le nombre s'accroît chaque jour, et dont la vie algérienne est loin de guérir les vices, finiront par être un véritable danger !
Or, que fait-on pour moraliser ces masses perverses ? Rien, ou presque rien.
Les Arabes, quoique pacifiés, seront longtemps encore enclins à la révolte, et, dans ce moment même, une nouvelle prise d'armes d'Abd-el-Kader inspire de vives inquiétudes. Que fait-on pour s'assimiler ces populations fanatiques, assez promptes à oublier leur religion pour les avantages du trafic et du plaisir, mais plus promptes encore, lorsque les profits du commerce ont réparé leurs pertes, à courir aux armes, à la voix de celui qui représente à la fois chez eux l'indépendance et la religion ? Que fait-on pour les attacher à la France, pour changer leurs idées et leurs mœurs, pour apaiser ce fanatisme redoutable ? On ne fait rien, absolument rien ; et, qui pis est, on ne veut rien faire.
Cependant ce ne sont pas les éléments du bien qui manquent. Parmi ces Européens d'Alger il y a des chrétiens admirables, pleins de dévouement et de zèle, qui seraient prêts aux plus grands sacrifices ; dans le clergé français on trouverait en abondance des apôtres; tous nos religieux seraient heureux de donner leur vie pour la conquête chrétienne de cette terre, infidèle encore sous les drapeaux français : ils seraient hospitaliers, maîtres d'école, missionnaires, agriculteurs, savants ; il y aurait, si on l'avait voulu, même un ordre militaire. Tant de bonnes volontés n'ont point été secondées, ou même ont rencontré des entraves. A la vérité, chaque localité à peu près est pourvue d'un curé ; mais que peut un pauvre prêtre tout seul, qui n'a souvent qu'un admirable zèle, en présence de nos officiers imbus de philosophisme, ou de nos sujets arabes, dont il faut d'abord parler la langue et ensuite connaître la loi religieuse, pour les amener aux convictions chrétiennes ?
Il faudrait des moines, des corporations d'hommes et de femmes pour suffire à tant de besoins divers. Ces congrégations réussiraient, car elles ne manqueraient point de courage, et la grâce de Dieu ne leur manquerait point. On l'a vu, on le voit tous les jours par l'exemple que fournit le récent établissement des trappistes. Ces pieux solitaires luttent contre des difficultés de tous genres ; mais ni la pauvreté, ni les maladies, ni les désastres, ni la mort ne les découragent. Les chrétiens les admirent, les musulmans les aiment et les bénissent.
Mais, tandis que l'on reçoit les trappistes auprès d'Alger, le gouvernement, qui n'a point encore doté d'une église la redoutable population de Philippeville, bâtit à grands frais une belle mosquée dans cette ville, où il n'y a pas un Arabe.
J'ose le dire, tant que la population européenne inférieure de l'Algérie ne sera pas morale, c'est-à-dire chrétienne, elle sera un danger pour notre établissement ; tant que les Arabes ne seront pas chrétiens, ils ne seront pas Français, et tant qu'ils ne seront pas Français, nul gouverneur, nulle armée ne pourra garantir pour un mois la durée de la paix.
Cette conviction est si profonde, même chez ceux qui espèrent le plus de l'Algérie, que tout leur rêve est d'arriver à tenir le pays avec un effectif armé de soixante mille hommes seulement, vivant des ressources du sol ; et encore sont-ils unanimes pour dire qu'un tel idéal ne se peut réaliser qu'autant que la paix durera en Europe. Or qu'y a-t-il de plus incertain que le maintien de la paix entre la France et l'Europe, entre la France et l'Angleterre particulièrement ?
On ne peut se défendre de prévisions qui serrent le coeur, lorsque l'on songe à tout ce qui peut résulter du premier coup de canon tiré sur la Méditerranée. Le chrétien, voyant la religion négligée à dessein par ceux qui sont chargés d'établir en Algérie la puissance française, murmure avec effroi cet oracle divin, tant de fois réalisé parmi les hommes : Nisi Dominus oedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui oedificant eam.
Dieu protège la France !
 NOTE
NOTE
SUR LA DURÉE DE L'ISLAMISME
" Le prophète Daniel avait dit au roi de Babylone que la grande statue qui lui avait été montrée en songe, et qui était composée de quatre métaux successifs, l'or, l'argent, l'airain, le fer, finissait par dix doigts de pieds moitié de fer et moitié d'argile, c'est-à-dire que cet empire colossal, qui devait passer successivement à quatre dynasties ou nations, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, finirait par une dizaine de royaumes moitié romains et moitié barbares. Le prophète vit ensuite plus distinctement la quatrième nation souveraine, la quatrième bête, la bête aux dents de fer et aux ongles d'airain, ayant sur sa tête dix cornes; et il lui fut dit que ces dix cornes étaient dix rois ou royaumes qui devaient s'élever du quatrième empire, de l'empire romain. Sept siècles après Daniel, l'apôtre saint Jean, le prophète de la nouvelle alliance, vit la même bête avec dix cornes, et il lui fut également dit que ces dix cornes étaient les dix rois. Il vit de plus, assise sur cette bête, une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, enivrée du sang des saints et du sang des martyrs; et il lui fut dit que celle femme était la ville assise sur sept montagnes, la grande ville qui régnait sur les rois de la terre, et que les dix cornes ou rois, après avoir combattu pour elle, finiraient par la haïr, par la réduire à la dernier désolation, par la dépouiller, par dévorer ses chairs, et par la brûler au feu. Et nous avons vu une dizaine de rois et de peuples barbares, d'abord à la solde de Rome et de son empire, la prendre en haine, la dépouiller de sa gloire et de ses richesses, dévorer ses chairs ou ses provinces, et la livrer elle-même aux flammes.
"Le prophète Daniel avait vu quelque chose de plus. Pendant que je considérais les dix cornes, dit-il, voilà qu'une autre petite corne s'éleva parmi les autres, et trois des premières cornes furent arrachées de devant elle; et voilà que cette corne avait des yeux comme les yeux d'un homme, et une bouche qui parlait grandement. Et comme je regardais attentivement, voilà que cette corne faisait la guerre aux autres, et qu'elle prévalut contre eux. Sur quoi l'un des assistants me dit : la quatrième bête sera le quatrième empire sur la terre. Les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront de cet empire ; il s'en élèvera après eux un autre, qui différera des premiers et sera plus puissant, et il abaissera trois rois. Et il dira des discours contre le Très-Haut ; et il foulera aux pieds les saints du Très-Haut; et il s'imaginera qu'il pourra changer les temps et la loi ; et ils seront livrés en sa main jusqu'à un temps, deux temps et la moitié d'un temps Et le jugement se tiendra ; et ils lui citeront la puissance (littéralement, la sultanie), pour la détruire et l'anéantir jusqu'à la fin. Saint Jérôme dit sur cette prédiction : " Tous les écrivains ecclésiastiques ont enseigné qu'à la consommation du monde, lorsque l'empire romain sera à détruire, il y aura dix rois qui partageront entre eux l'univers romain, et qu'il s'élèvera un onzième petit roi qui vaincra trois des dix. "
"Or tout ceci, nous allons le voir s'accomplir. Nous allons voir s'élever au fond de l'Arabie, parmi les descendants d'Ismaël, un nouveau roi, un nouveau sultan, qui, faible d'abord, humiliera dans l'espace d'un siècle trois des dix rois qui se sont partagé le monde romain. Nous verrons, dans l'espace d'un siècle, l'empire naissant de Mahomet anéantir le royaume des Perses en Orient, abattre celui des Visigoths en Espagne, et humilier profondément l'empire de Constantinople, en attendant qu'il le détruise tout à fait. Cette nouvelle corne aura des yeux ; ce roi, ce sultan nouveau, fera le voyant, le prophète ; mais ses yeux ne seront que des yeux d'homme, sa prophétie sera de l'homme et non pas de Dieu. Il parlera pompeusement pour, sur et contre le Très-Haut; car l'expression originale présente ces trois sens, mais surtout le dernier. Il parlera pompeusement pour le Très-Haut, contre les idolâtres ; sur le Très-Haut, avec les Juifs ; et contre le Très-Haut, en niant la divinité de son Christ et en attaquant sur cet article fondamental la foi des chrétiens. Cette corne, cette puissance, fera la guerre aux saints du Très-Haut et prévaudra sur eux. Le mahométisme ne cessera de faire la guerre aux chrétiens, appelés saints dans le langage de l'Écriture, et prévaudra sur eux dans tout l'Orient et dans toute l'Afrique. Cette nouvelle corne, ce nouveau roi, s'imaginera pouvoir changer les temps et la loi. Le mahométisme introduira une nouvelle manière de compter les années : au lieu de célébrer, ou le samedi avec les Juifs, ou le dimanche avec les chrétiens, il célébrera le vendredi ; et à la loi de Moïse, et à la loi de Jésus-Christ, il substituera l'Alcoran. Cette corne, cet empire, aura ainsi la puissance jusqu'à un temps, deux temps et la moitié d'un temps. C'est-à-dire, dans le langage prophétique, un an, deux ans et la moitié d'une année, ou, comme dit l'apôtre saint Jean, quarante-deux mois ou douze cent soixante jours. Or, pour se retrouver dans leurs années lunaires avec les années polaires, les mahométans ont une manière de compter par mois d'années ou cycle de trente ans. Sur ce pied, les quarante-deux mois que doit durer cet empire anti-chrétien seraient donc de douze cent soixante ans, et comme il a commencé vers l'an 622, il finirait vers l'an 1882.
Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, on pourrait même, dans ces expressions de Daniel et de saint Jean : un temps, deux temps et la moitié d'un temps, découvrir, pour la puissance mahométane, comme trois périodes : une première, d'accroissement; une seconde, de lutte ; une troisième, de décadence. Pendant un temps, douze mois d'années, ou trois cent soixante ans, depuis 622 jusqu'à 982, vers la fin du dixième siècle, le mahométisme triompha presque partout sans beaucoup d'obstacles. Pendant deux temps, deux ans d'années ou sept cent vingt ans, depuis la fin du siècle dixième où les chrétiens d'Espagne commencèrent à repousser les mahométans et firent naître les croisades, jusqu'à la fin du dix-septième siècle, il y eut une lutte à peu près égale entre le mahométisme et la chrétienté. Depuis la fin du dix-septième siècle, où Charles de Lorraine, et Sobieski de Pologne, achevant ce que Pie V avait commencé à la journée de Lépante, brisèrent tout à fait la prépondérance des sultans, le mahométisme est en décadence. Enfin, il est non-seulement possible, mais très-probable, qu'à dater de cette dernière époque, le commencement du dix-huitième siècle, après la moitié d'un temps, six mois d'années, ou cent quatre-vingts ans, vers 1882, ce soit fait de cet empire anti-chrétien.
Enfin se tiendra le jugement. Déjà en Daniel nous avons vu le Très-Haut, avec ses veillants et ses saints, juger le roi de Babylone. Nous l'avons vu pareillement, dans l'Apocalypse, juger, avec les anges et les saints, Rome idolâtre et ivre du sang des martyrs. Ici nous le voyons jugeant l'empire anti-chrétien. Lorsque la sentence contre Rome idolâtre s'exécuta par les Barbares, la puissance fut donnée aux saints du Très-Haut aux chrétiens, qui formèrent dès lors de nouveaux royaumes, un nouveau genre humain nommé chrétienté. Lorsque la sentence finale s'exécutera contre l'empire anti-chrétien de Mahomet, alors seront données au peuple des saints la souveraineté, la puissance, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel, (histoire universelle de l'Église catholique, par M. l'abbé, Rorhbacher, tome X.)
|
NOS RACINES
Envoyé par M. Paul Cautres
|
Combien l'on déjà dit, chanté et ressassé,
Le lieu où l'on est naît est au fond de son cœur,
Caché tel un trésor qu'on ne veut partager,
Qu'avec ceux qui comme nous ont connu le malheur.
- Malheur de se trouver chassé comme par la foudre,
D'un orage d'été ravageur et sévère,
Banni de ce pays où a parlé la poudre,
Pour arriver enfin fatigué et amer.
- C'est la Patrie d'HUGO, de VERLAINE et bien d'autres,
Le pays de cocagne où tout portait à croire,
Qu'a l'école appris c'était aussi le nôtre.
Pauvre déraciné, nourri de faux espoir !
- Horde d'envahisseurs, gênante, taxée de meurtres
Voila plus d'un million de tes enfants qui vient
Toi pour qui nous avions de l'Amour pas un flirt
Mère Patrie nous sommes là ! Nous prends-tu en ton sein ?
Telle était la question qui a posé problème
A ton peuple peu enclin à nous faire de ta place,
Oh nous n' attendions pas que l'on nous dise je t'aime !
Mais notre coeur si chaud, tu l'as rendu de glace.
- Accueillir l' étranger, ouvrir les bras aux autres,
Ah! De ce côté là tu as la palme d'or.
Mais quand il s'agit de recueillir, les nôtres
Ton coeur aux autres ouvert s'est refermé alors
- Volta trente ans bientôt on s'est fait à nos mines,
- Les angles sont arrondis, et nous nous supportons
Mais qu'on le veuille ou non Là bas sont nos racines.
Même si nos enfants naissent dans vos maisons.
P.CAUTRES
|
|
QUELQUES PAGES D'UN VIEUX CAHIER
Source Gallica
|
Souvenirs du Général Herbillon (1794 - 1866)
Publiés par son petit-fils
CHAPITRE VIII
Le général Bugeaud est nommé gouverneur de l'Algérie (1841). - Le poste de Guelma après hésitation est conservé. - Herbillon est nommé officier de la Légion d'honneur. - Expédition contre la tribu des Sidi-Afifi. - Améliorations apportées au Cercle de Guelma. - Inspection du général Randon. - Herbillon passe au 41e puis au 61e de ligne. - Expédition contre les Ouled d'Hann (mai 1842). - Il quitte Guelma pour gagner Philippeville le 15 janvier 1843.
En 1841, le maréchal Valée qui, depuis la prise de Constantine (1837) était gouverneur de l'Algérie, rentra en France. C'est le général Bugeaud qui lui succéda. Il prit le commandement avec la ferme intention de poursuivre Abd-el-Kader sans relâche, d'abattre son pouvoir et surtout son influence sur les Arabes.
Pour arriver au but que l'on se proposait, il était essentiel de rassembler le plus de troupes possibles afin de présenter aux réguliers et irréguliers de l'entreprenant Émir une force imposante. Le général Bugeaud avant d'entrer en lice, voulut connaître par lui-même l'état des provinces. Il arriva à Guelma le 10 mars 1841, où le général de Négrier était venu à sa rencontre.
Le général Bugeaud avait manifesté son intention bien arrêtée d'abandonner tous les postes qui jalonnaient la route de Bône à Constantine : Hammam-Barda, M'Djez-Amar, Sidi-Tamtam et même Guelma. Je résolus de plaider chaleureusement la cause de ce dernier auprès du général de Négrier.
Le pays était déjà soumis, les Kabyles et les Arabes payaient leurs contributions; tous se rendaient avec empressement chez le commandant du Cercle dans lequel ils avaient la plus grande confiance. On pouvait être certain que cette soumission s'étendrait. D'ailleurs Guelma était situé de manière à servir de base d'opérations, soit qu'on allât chez les Haractas, les Ouled D'Hann ou les Hanenchas, dont les tribus nombreuses et riches étaient encore hostiles à l'autorité française.
Il était évident que l'abandon de Guelma ferait perdre entièrement les résultats déjà obtenus et reculerait pour bien des années la possession du vaste territoire dont Guelma était la clef et presque le centre. Les relations déjà établies cessant entièrement, les indigènes entraînés par leurs voisins redeviendraient hostiles et de fréquentes expéditions deviendraient nécessaires pour les contraindre à l'obéissance.
Je réussis à faire partager mon ardente conviction au général de Négrier qui intervint avec force auprès du général Bugeaud; celui-ci était trop homme de savoir et de bon sens pour ne pas saisir quel devait être l'avenir de Guelma.
Il donna l'ordre que cette ancienne cité romaine continuerait à être occupée et à être le siège du commandement du Cercle.
Il supprima seulement M'Djez-Amar, Sidi-Tamtam et Dréan.
Le coup qui faillit abattre Guelma dans son développement une fois conjuré, tout fut mis en œuvre pour faire de ce point privilégié un centre d'attractions pour les colons.
On y procéda à des aménagements nouveaux, à l'assainissement définitif et Guelma devint une grande et belle ville.
Par ordonnance du 25 avril, le Roi me nomma officier de la Légion d'honneur.
Au mois de juin, il fallut organiser une nouvelle expédition.
La suppression de quelques postes militaires, les bruits divers qui couraient sur les hostilités prochaines avec Abd-el-Kader jetaient au milieu des peuples arabes l'inquiétude et surtout leur donnaient l'espérance de secouer le joug de notre autorité. Quelques tribus du Cercle de Guelma commencèrent à se montrer récalcitrantes, entre autres celle de Si-Afifi...
Les Arabes de cette petite tribu étaient en partie Maraboutistes et profitaient de leur réputation religieuse pour recevoir les malveillants; ils s'étaient fait receleurs de tous les vols commis dans le Cercle, presque certains de voir leurs méfaits rester impunis et ne craignant pas de pousser à la révolte les tribus soumises.
Leur exemple pouvant être pernicieux, je crus qu'il était temps de châtier sévèrement cette tribu qui, placée au milieu des rochers et des ravins, se croyait à l'abri de nos coups.
Dans la nuit du 13 au 14 juin, je partis avec mon détachement de 240 hommes du 3e léger, l'escadron turc des spahis et les cinquante spahis auxiliaires, tous Kabyles.
Parfaitement guidé, je tombai sur les trois douars qui composaient la tribu et qui furent enlevés en un instant. Les Arabes se sauvèrent dans le bois voisin, laissant sur le terrain 25 cadavres. Nous ne pûmes ramener à Guelma que 40 bœufs, 10 chevaux et 30 moutons. Notre perte fut de 1 tué et 2 blessés.
En juillet, Guelma s'améliorait de jour en jour.
Des plantations eurent lieu, les constructions continuèrent; quelques colons ouvriers vinrent s'y établir et comme la sécurité aux alentours se consolidait, les voyageurs européens devenaient plus nombreux, les Arabes se rapprochèrent pour cultiver. Les crimes devinrent plus rares, les vols moins hardis. La culture étant plus répandue, le bien-être s'ensuivit chez les indigènes; les marchés enfin étant plus fréquents, l'Administration trouva plus facilement à acheter des bestiaux.
Bref, c'était le commencement d'une ère de prospérité et le long rapport qu'Herbillon adresse à ce moment au général commandant la subdivision de Bône en expose clairement tous les points essentiels. La sagesse de son administration l'engage à ce moment dans la voie de la politique de conciliation. Il se rend compte que l'époque n'est plus favorable aux grandes expéditions, pendant tout le temps du moins que l'attention générale est fixée sur ce qui se passe vers l'ouest, entre Bugeaud et Abd-el-Kader. Il remplace l'action directe par la bienveillance de ses insinuations tendancieuses, par l'impartialité pleine de tact de sa justice, par l'appât du gain susceptible aussi d'attirer l'indigène. Aussi les résultats effectifs sont immenses. Les Kabyles du Djebel-Ataïa, plusieurs fractions des Hanenchas se soumettent successivement. Herbillon règle lui-même sur place les différends existant entre les Ben-Aziz et les Beni-Kaidr d'une part (les uns dépendant du Cercle de Bône, les autres de celui de Guelma) ; entre les Beni-Salah et les N'Bail du Nador d'autre part. Il s'impose de leur fixer en personne des limites naturelles à leurs territoires. Deux tribus kabyles du Cercle, les Beni-bou-Hassen et les Beni-Foucasi, reçoivent chacune un caïd accrédité par le Gouvernement français et cela suffit à rétablir l'accord.
Tout cela fut grandement facilité par l'appui que le général Randon m'apporta. Il venait d'être nommé maréchal de camp et arrivait d'Oran où il était à la tête du 2e chasseurs.
A peine eut-il pris possession de son commandement que, le 22 octobre, cet officier général vint à Guelma, accompagné de M. le lieutenant-général d'Hautpoul, envoyé en Afrique comme inspecteur général. J'allai au devant d'eux; ils me firent des compliments flatteurs en me voyant entouré de chefs arabes et kabyles qui avaient pour moi respect et grande soumission. Le général Randon qui quittait une province où la majorité des chefs arabes étaient restés insoumis et même insolents, ne revenait pas de l'ascendant que j'avais acquis sur tous les indigènes de mon Cercle. Après avoir quitté Guelma et les environs, il me quitta le lendemain 23, pour retourner à Bône.
Dans le mois de décembre, les membres de la Commission scientifique me furent adressés, ils restèrent à Guelma environ un mois et, malgré la saison, se livrèrent à leurs études et recherches. Ils parcoururent les alentours, allèrent visiter principalement Hammam Meskoutine et les mines d'Anoussa. Le capitaine d'artillerie Delamarre, chargé de la partie du dessin s'y livra avec une ardeur et un zèle admirables. Ni pluie, ni froid, ni neige ne l'arrêtèrent.
En date du 31 décembre 1841, le lieutenant-colonel Herbillon passe au 41e de ligne, en remplacement de M. Armand, lieutenant-colonel, qui permute avec lui. Il n'en continue pas moins à commander le Cercle de Guelma. L'origine de celle permutation paraît être sensiblement la même que celle qui a amené son passage au 62e, ainsi qu'il ressort de la correspondance suivante:
Constantine, le 1er janvier 1842.
Du Général Négrier au Général Randon, à Bône.
Général,
Par une lettre du 28 décembre, vous m'exprimez le désir que M. le lieutenant-colonel Herbillon ne rentre pas en France avec le 62e auquel il appartient, attendu les services qu'il rend dans le commandement du Cercle de Guelma. Je m'empresse de vous informer qu'une demande a déjà été faite en conséquence au ministre par M. le gouverneur général et qu'il y a tout lieu d'espérer qu'elle sera favorablement accueillie. Je ne doute pas que M. Herbillon ne soit conservé dans le commandement qu'il exerce d'une manière si satisfaisante.
Recevez, mon Général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.
Signé : NÉGRIER.
Bône, le 6 janvier 1842.
Du Général Randon au Lieutenant-Colonel Herbillon, à Guelma.
Colonel,
Je vous adresse copie de la lettre que je viens de recevoir de M. le général de Négrier. Je le fais avec d'autant plus de plaisir qu'elle me donne l'espérance à laquelle je tiens essentiellement pour le bien du pays et la continuation de la prospérité de Guelma.
Recevez, mon Colonel, l'expression de ma considération la plus distinguée.
Le Général commandant la subdivision de Bône,
RANDON.
Au point de vue géographique et historique, il n'est pas sans intérêt de suivre l'évolution progressive du développement de Guelma, car comme le dit Herbillon à un point de vue particulier, en parlant des Européens qui plus tard se sont installés dans ces régions prospères :
L'oubli serait la destinée de tout si quelques acteurs ne prenaient pas note des événements auxquels ils ont assisté et ne les reproduisaient pas.
Les colons aujourd'hui indifférents, ne s'informent même pas de la manière dont le pays a été occupé, car peu leur importe quels sont les généraux, les régiments, les braves officiers et soldats qui les ont rendus propriétaires de la maison qu'ils habitent, du champ et du jardin qu'ils cultivent. Que leur a fait à eux, le sang qui a été répandu, que peut leur servir la connaissance des colonnes qui ont foulé le territoire que leurs charrues sillonnent ?
Quelques détails compléteront les notions déjà acquises sur l'impulsion irrésistible imprimée à la création définitive d'un véritable centre d'activité colonisatrice : Guelma.
Des ordres furent donnés (par le général Randon) pour donner des terrains aux troupes composant la garnison de Guelma pour la culture de la pomme de terre et pour l'agrandissement des jardins; des mûriers furent envoyés et de nombreuses plantations commencèrent.
Les colons qui jusqu'à ce moment n'avaient été que des débitants furent forcés de cultiver des jardins en attendant que des terrains leur fussent concédés pour le labour.
Des reconnaissances furent faites le long de l'Oued Skroun, pour s'assurer s'il n'y aurait pas possibilité d'établir un moulin, chose de la plus grande nécessité, car le blé provenant de l'Achour était envoyé à Bône pour revenir en farine, ce qui occasionnait de fortes dépenses de transport.
La prairie qui était située près de Guelma ne donnait pas autant de foin qu'elle pouvait en fournir ; la grande quantité de pierres qui y étaient répandues, non seulement la rendait en partie stérile, mais nuisait encore à la fenaison; des hommes de corvée y furent employés, elle fut nettoyée et par suite devint plus productive.
Enfin, le Gouvernement comprenant l'importance de ce point avait pris définitivement le parti d'y faire construire des établissements. Un hôpital fut commencé, un nouveau village fut tracé et quelques concessions furent données, mais avec la plus grande prudence, pour ne pas blesser les indigènes dans leurs intérêts.
Une seule note discordante dans l'ensemble, dans l'accord qui paraît vouloir s'établir :
La tribu des Ouled d'Hann était restée récalcitrante et hostile. C'étaient journellement des plaintes qui me parvenaient sur des attaques imprévues, sur des vols à main armée. Il était devenu impossible d'endurer les déprédations commises par cette tribu de montagnards. Aussi, M. le général Randon décida-t-il que le moment était arrivé d'aller avec une colonne sur leur territoire pour les châtier. C'était d'autant plus nécessaire que par surcroît les Ouled d'Hann donnaient asile aux déserteurs de la Légion étrangère dont un bataillon tenait garnison à Guelma.
M. le général Randon arriva à Guelma le 9 mai 1842. Sa colonne était forte de 1.800 hommes (infanterie, cavalerie, artillerie, tout compris).
Il n'y a guère et retenir du récit complet de la course que les événements qui marquèrent les journées du 11 et du 14 mai.
Le 11, à 4 heures du matin, le camp fut levé. Des dispositions bien entendues furent prises pour le passage du défilé d'Akbett-El-Trabb qui s'effectua sans difficultés. Malheureusement, aucun ordre d'ensemble n'ayant été donné, les troupes, au lieu de s'arrêter après le passage et de prendre position, agirent chacune pour leur compte. Le bataillon de zouaves se porta en avant sans direction assuré; la Légion étrangère et les bataillons de tirailleurs indigènes se dirigèrent à droite et à gauche à l'aventure.
Le sous-lieutenant Gay des spahis irréguliers de Guelma, qui n'avait reçu que l'ordre de flanquer la colonne, se précipita sur un groupe d'Arabes sans prévoyance aucune, sans être suivi de ses spahis. Il tomba dans une embuscade où il fut tué, dépouillé et son cadavre allait être mutilé lorsque l'on arriva pour le retirer des mains des Arabes.
Les Ouled d'Hann, s'apercevant du peu d'ensemble de l'attaque, se réunirent... L'artillerie lança quelques obus sans résultat. Le général voyant enfin que chacun agissait sans ordre et qu'une fusillade sans but consommait inutilement les cartouches, réunit les différentes troupes de la colonne et se dirigea sur Aïn-Sounda où l'on devait camper.
Le 14, de grand matin, une reconnaissance fut poussée par les zouaves et par deux escadrons de spahis...
Les zouaves qui s'étaient portés en avant sans être guidés, ayant aperçu dans un ravin un douar composé d'une vingtaine de tentes, se précipitèrent pour l'enlever. Les Ouled d'Hann abandonnèrent leur campement, mais ayant remarqué que les zouaves n'étaient point nombreux, ils revinrent en foule, les attaquèrent vigoureusement de tous côtés; les zouaves se voyant presque entourés n'eurent d'autre ressource que de se réfugier sur la cime du Djebel Zouara où ils se défendirent à outrance. Il ne leur restait presque plus de cartouches et ils se trouvaient dans une position fort critique quand le général Randon les dégagea au moment où ils allaient payer bien cher leur témérité. Les zouaves étaient au nombre de 250, sous les ordres du commandant Frémy. Ils se conduisirent admirablement, eurent 12 hommes tués dont il purent enlever les corps, 35 blessés, deux mulets chargés de cacolets tombèrent dans des ravins profonds; 4 officiers furent aussi blessés.
Cette reconnaissance malencontreuse détermina le général Randon à abandonner l'idée de pousser de l'avant et le 15, à 6 heures, la colonne rentrait à Guelma.
Cette course chez les Ouled d'Hann fit un très mauvais effet. Cette retraite pour une reconnaissance manquée enhardit les Arabes et retarda la soumission de plusieurs tribus.
Le général Randon se rendant compte de cette impression, m'envoya auprès du général de Négrier pour lui demander d'agir de concert avec lui, mais le Commandant de la province, en ce moment occupé autre part à Tébessa, à Morris, ne put participer à la reprise des hostilités. On abandonna définitivement les opérations contre les Ouled d'Hann.
Une proposition pour colonel fut appuyée par une lettre du 10 août 1842 de Bugeaud au ministre, où cette nomination est demandée à cause de : " L'influence salutaire qu'Herbillon a su prendre et exercer sur les Arabes. "Bugeaud a même ajouté de sa main la note suivante :
"C'est un officier qu'il faut maintenir en Afrique, parce qu'il a fait tout ce qu'il faut pour exercer un commandement sur les Arabes. "
Promu au grade de colonel, le 12 octobre 1842, j'adressai au général de Négrier une lettre de remerciements à laquelle il me répondit en ces termes :
Constantine, le 16 novembre 1842.
Colonel,
Je suis sensible aux remerciements que vous m'adressez par votre lettre du 12 de ce mois. Vous pouvez compter que j'ai vu avec le plus grand plaisir votre avancement et je ne puis que m'estimer heureux d'y avoir contribué. Mais je vous félicite surtout d'y avoir eu vous-même la plus grosse part par la manière dont vous avez rempli la tâche qui vous a été confiée.
Recevez, Colonel, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Lieutenant-général commandant la province,
NÉGRIER.
Je quittai Guelma le 15 janvier 1843, pour gagner Philippeville, ma nouvelle résidence. En abandonnant mes fonctions de commandant du Cercle, je puis dire que j'ai laissé Guelma dans une parfaite sécurité, entièrement organisé et promettant pour l'avenir une des ressources principales de la province de Constantine. Je fus remplacé par M. le chef d'escadron Tourville, qui arriva le 11 janvier et à qui je remis le commandement.
En décembre 1842, le général de Négrier était remplacé à Constantine par le général Baraguay d'Hilliers, en même temps que le général Randon quittait momentanément Bône.
A SUIVRE
|
|
CITATIONS
Effort Algérien
|
|
Ne fais rien, ne dis rien qui puisse blesser la croyance d'un autre homme ; c'est chose intime de la conscience humaine, si délicate qu'on la froisse en l'effleurant.
Paul DOUMER
Un peuple sans Dieu ne se gouverne pas : on le mitraille.
NAPOLEON
Il ne serait pas possible que les hommes se fussent imaginés tant de fausses religions, s'il n'y en avait une véritable.
PASCAL
Jamais l'homme n'est impartial vis-à-vis du divin. S'il n'ouvre pas la porte avec l'enthousiasme de l'hospitalité, il la ferme avec la rigueur de la haine. On ne reçoit pas Dieu à moitié : on l'adore ou on le chasse.
HELLO
Il est permis de n'avoir pas d'espoir ; mais il est défendu de faire comme si l'on n'en avait pas.
FAGUET
La politique des sectaires est celle de la main sur le cœur et du poing sur la gorge
Quand on se donne le droit de tout dire, on s'expose à tout entendre.
ROYER-COLLARD
Autant la France était portée autrefois aux illusions généreuses, autant elle se défie aujourd'hui des tentatives les plus modestes.
PREVOST-PARADOL
Le monde étant fini n'existe pas par lui-même ; il existe par l'opération de l'infini
V. BUSCAILLE
Seuls les hommes de métiers feront demain leur métier d'homme.
V. BUSCAILLE
Il faut s'appuyer sur l'épreuve comme le cheval sur le mors.
H. BORDEAUX
Ce n'est pas en multipliant nos raisons de douter que l'on fortifiera nos raisons de croire.
BAUDRILLART
Le bien qu'on fait, le ciel le rend.
Le bien qu'on a, la mort le prend
INCONNU
|
|
|
LES CRIMES DE L’EPURATION
Par M.José CASTANO,
|
6 JUIN 1944 : APRÈS LE DÉBARQUEMENT, LE DÉBUT DE LA FIN COMMENCE PAR LES CRIMES DE L’ÉPURATION
« Il y a deux histoires, l’une que l’on enseigne et qui ment, l’autre que l’on tait parce qu’elle recèle l’inavouable » (Honoré de Balzac)
Si l’on en croit l’historien Henri Amouroux, les Français étaient majoritairement pétainistes jusqu’au débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Mais l’histoire d’après-guerre, écrite et enjolivée par les gaullistes et les communistes, a scindé le pays, de façon assez caricaturale, en deux camps : les résistants et les « collabos », ce qui permettait de minimiser les crimes commis à la libération : une période appelée « l’épuration » et qui, hélas, justifie bien son nom !
Qu’on le veuille ou non, la France de 1940 à 1944 a été pétainiste et passive à 90 ou 95%. Il y a bien eu une poignée, une faible proportion de la population, pour fournir les « résistants de la première heure ».
Le 22 juin 1941 l’armée allemande attaqua l’URSS scellant ainsi la rupture du pacte germano-soviétique. C’est seulement à partir de ce moment là que les communistes basculèrent dans la résistance. En mars 1942, l'instauration du STO poussa plus massivement des jeunes vers les maquis mais la résistance restera cependant marginale jusqu'au débarquement allié du 6 juin 1944.
Dans les clichés de cette époque trouble, on a retenu des résistants -gaullistes, communistes, socialistes- et une droite « maréchaliste » voire collaborationniste, ce qui relève des « mensonges de l’Histoire ».
La droite d’avant-guerre était, dans son immense majorité fortement antiallemande. Deux partis, exclusivement, se déclaraient fascistes : le « Faisceau » de Georges Valois –arrêté pour « faits de résistance » à l'Hôtel Dardières, aux Ardillats par la Gestapo, le 18 mai 1944, il mourra du typhus, en déportation, à Bergen-Belsen, en février 1945- et le « Franscisme » de Marcel Bucard.
Seul le premier avait des accointances avec l'Italie fasciste. Le chantre de la collaboration fut Pierre Laval, ancien député socialiste. Les partis les plus collaborationnistes furent le « Parti Populaire Français » créé et dirigé par Jacques Doriot, ancien député-maire communiste de Saint-Denis qui mourra sous l'uniforme allemand et le « Rassemblement National Populaire » du député socialiste Marcel Déat, éphémère ministre de l'aviation en 1936.
La droite nationaliste, souvent favorable au maréchal Pétain, va s'impliquer massivement dans la résistance. Son premier martyr connu fut l'officier de la « Royale », Honoré d'Estienne d'Orves, fusillé au Mont-Valérien, le 29 août 1941. L'amiral Darlan était sur le point d'obtenir sa grâce quand, le 21 août, le Communiste Pierre Georges, futur « colonel Fabien » -qui ne sera qu’un pseudonyme que les communistes s’empresseront de sacraliser- tira dans le dos d'un officier allemand, l'aspirant Moser, au métro « Barbès ». L'histoire officielle n'a pas retenu ce détail, ni le fait que l'aspirant Moser attendait le métro sans arme, quand Pierre Georges lui a (héroïquement) tiré dans le dos. En représailles, cent otages sont exécutés dont Honoré d'Estienne d'Orves.
Hélas trop souvent, tels les ouvriers de la dernière heure, certains résistants tardifs se montreront les pires épurateurs (parfois pour faire oublier un passé de « collabo » ou une fortune bâtie en faisant du marché noir.)
C’est une époque où l’armée française, qui veut se persuader qu'elle a gagné la guerre, reconstitue ses effectifs en régularisant des FFI et des FTP communistes. Heureusement, avant d'en faire des militaires d'active, on envoie ces cadres au rabais tester leur niveau de connaissance à l'école des officiers de Cherchell, en Algérie. L'ancien député Marcel Bouyer, lieutenant FFI, ex-agent de liaison dans la poche de Royan, racontait en riant :
« Cherchell, c'était impayable ! Des gens y rentraient avec des galons de colonels et en ressortaient... sergents. ». Il est vrai que l'inflation aux galons était monnaie courante à l'époque : Jacques Delmas (Chaban dans la résistance), futur maire de Bordeaux, aspirant en 1939, sera... général en 1944, à 27 ans. Malgré des états de service honorables, on n'avait plus vu ça depuis Bonaparte ! Mais, en ces temps troublés, tout est permis, il suffit d'oser ! On a même vu, chez les FTP, des « colonels à 6 galons » (un colonel en porte 5) dont un qui avait échoué à son peloton de… caporal en 1939.
De Gaulle, décorant à Bordeaux une rangée d'une douzaine de « colonels » FFI ou FTP trouve, en bout de file, un simple capitaine auquel il déclare en souriant : « Vous ne savez pas coudre ? »
Tout ceci pourrait prêter à sourire, mais la France de la libération, c'est aussi celle des crimes de l'épuration qui demeureront une honte et entachera à jamais notre Histoire…
A la libération, en métropole, commencera une kyrielle de procès, plus ou moins bâclés, plus ou moins expéditifs, mais avec une apparence de légalité.
Intransigeance d’une justice partisane et injuste : le 27 janvier 1945, la cour de justice de Lyon rend son verdict : Charles Maurras, 76 ans, l'un des écrivains les plus influents de son temps, est condamné à la réclusion perpétuelle et à la dégradation nationale pour « intelligence avec l'ennemi ».
Si quelqu'un n'avait jamais eu d'« intelligence » avec l'Allemagne, c'était bien Maurras. Lutter contre le germanisme avait été l'un des buts de sa vie. Mais nous étions en 1945 et le seul fait d'être proche de Pétain valait d'être taxé aussitôt du crime de collaboration… donc de traître.
Durant la même période s’ouvre le procès de Robert Brasillach, directeur du journal « Je suis partout ». Condamné à mort, il a bénéficié d'un soutien massif des intellectuels -gaullistes et communistes, entre autres- qui ont signé une pétition pour demander sa grâce à De Gaulle. Le « premier résistant de France » refusa son recours en grâce et Brasillach fut fusillé le 6 février 1945 au fort de Montrouge.
De Gaulle justifiera sa décision, plus tard, par « son indignation d'avoir vu Brasillach posant en uniforme allemand sur la couverture d'un magazine ... ». Oui mais voilà, Robert Brasillach n'a jamais porté l'uniforme allemand. De Gaulle l'a simplement confondu avec Jacques Doriot. Un « détail » peu glorieux qui entache la « belle histoire » du gaullisme…
Le 15 août 1945, en plein été, la cour rend son verdict au procès Pétain : la peine de mort.
Ce vieux maréchal, qui, en juin 1940 avait « fait don de sa personne à la France pour atténuer ses malheurs » paie pour la lâcheté de tout un peuple.
En effet, arrêtons de faire croire que ce vieillard aurait fait, avec la complicité de Pierre Laval, une sorte de coup de force pour s'emparer du pouvoir. Rappelons les faits : les parlementaires français ont accordé les pleins pouvoirs à Pétain par 569 voix pour et 80 contre, soit, en gros, 85% des suffrages exprimés. Ce vote eut lieu le 10 juillet 1940. Comment ose-t-on écrire que la France et ses représentants légaux ne pardonnaient pas au maréchal d'avoir demandé les conditions d'un armistice le...18 juin ? Ils ont eu le temps de la réflexion et ont donc voté en leur âme et conscience.
Dans un entretien à Valeurs actuelles en date du 13 décembre 1993, l’historien, Henri Amouroux, déclarait : « Le gaullisme a imposé l'idée qu'il ne fallait pas signer cet armistice et que Vichy était illégitime. C'est fabuleux ! Mais, ce n'est pas sérieux ! ».
L'épuration a été sanglante dans presque toute la France. Citons, par exemple, les « purges » et règlements de compte effectués, en toute impunité, par les FTP du Limousin. Des comportements monstrueux qui finiront par irriter puis indigner Georges Guingouin, commandant le « régiment de marche du Limousin » (FTP), bien qu'il s'agisse de ses propres troupes. Guingouin, maire de Limoges à la libération, sera exclu du PCF après un long procès « stalinien » ; il avait osé écorner le mythe d'une France combattante pure, incarnée par les communistes !
L'épuration, c'est aussi cet exploitant agricole en Charente, Paul de M...., qui a vu son père et son frère fusillés sous ses yeux parce qu'ils étaient aristocrates, catholiques et châtelains. L'enquête prouvera qu'ils aidaient la résistance non-communiste.
Robert Aron, historien de la période de l’épuration, note : « C’est un véritable armorial, un annuaire des châteaux ou un bottin mondain de province que l’on pourrait constituer avec les victimes. D’autant que beaucoup d’entre elles ont eu le tort inexpiable, tout en étant antiallemandes, de faire confiance à Pétain, ou bien d’être, dans la résistance, d’un camp différent de celui de leur assassin… ».
C'est aussi, cette jeune fille, catholique et cheftaine des guides de France, qu'on viendra chercher le jour de son mariage pour la fusiller devant ses proches au motif que sa famille -mais pas elle !- aurait été « collabo...
C'est cet amiral en retraite, proche du maréchal Pétain, que les épurateurs vont écarteler entre deux camions en le brûlant à la lampe à souder...
C'est le comte Christian de Lorgeril, parent de d'Estienne d'Orves, mais à qui on reproche son château et ses idées monarchistes. Il est arrêté le 22 août 1944 : « Complètement nu, le malheureux dut s'asseoir sur une baïonnette. Puis il eut les espaces métacarpiens sectionnés, les pieds et les mains broyés. Les bourreaux lui transpercèrent le thorax et le dos avec une baïonnette rougie au feu. Le martyr fut ensuite plongé dans une baignoire pleine d'essence à laquelle les sadiques mirent le feu. Leur victime s'étant évanouie, ils le ranimèrent pour répandre ensuite sur ses plaies du pétrole enflammé. Le malheureux vivait encore. Il devait mourir, 55 jours plus tard, dans les souffrances d'un damné... ».
Ce récit, d’un sadisme écœurant, est paru dans le quotidien « L'Aube » en novembre 1950. Nous étions revenus aux pires heures de la Révolution de 1789 !
Parmi la faune de barbares « résistants » de l’époque, figurait un certain Henrot, responsable, entre autres, du massacre de la famille de Buffières et du pillage de leurs propriétés de Dolomieu et Milliassière, près de Grenoble. Le rapport d’enquête établit que :
« Le 16 août 1944 au matin, une équipe d’une dizaine d’hommes fut désignée et placée sous la responsabilité d’Henrot, pour se rendre au château de Dolomieu afin de ramener au maquis le comte et la comtesse signalés comme collaborateurs… Lourdement armés, ils enfoncèrent la porte et abattirent philibert venu à leur rencontre les bras levés. Il fut abattu d’une rafale de mitraillette… Son épouse, qui protégeait leur petit garçon Michel, resta au premier étage… Marcelle et son fils Michel furent emmenés au camp du Châtelard… Arrivée au camp, Marcelle fut soumise aux pires tortures… une nuit d’orgies, devant son fils… Marcelle fut exécutée par ordre ainsi que son fils, sans qu’il soit question de la mise en jugement ou d’une décision de condamnation… ».
Ce rapport d’enquête stipule que l’enfant de 5 ans reçut une balle dans la tête, allongé sur le corps de sa mère.
Philibert de Buffières avait un frère en camp de concentration. Il y mourra. Son fils Bernard était sous-officier dans l’armée de Lattre.
Quelques jours plus tard, le 22 août, toujours sous les ordres du « lieutenant » Henrot, la bande investit le domaine de Milliassière : « Elisabeth de Buffières nota dans son livre de messe, une phrase prémonitoire : « Aimer c’est se donner jusqu’au sacrifice. 22/08/1944 ». Les FTP pillent et saccagent le château. Puis, vers 22h30 ils repartent vers d’autres forfaits : « Elisabeth ne réapparaissait pas… Etendue sur son lit, elle avait reçu trois balles de revolver dont une dans la tempe, après avoir été violée… »
Le « lieutenant » Henrot, lui, ne rendra jamais de compte à la justice : tué d’une balle en pleine tête (sans doute tirée par un de ses hommes), le 3 septembre, place des Terreaux, à Lyon, durant la libération de la ville. Le nom de ce « grand résistant » figure quelque part, sur un monument aux morts « pour la France ».
Pour les « épurateurs », le fait de coucher avec l’occupant était sanctionné, à minima, par la tonte des cheveux. Ces femmes tondues étaient accusées de « collaboration horizontale », un acte qui n'est pas incriminé dans le code pénal et qui n’a donc rien d’illégal. Certaines ont été lynchées, violées, torturées ou tuées. Le compte de ces victimes est difficile à établir. On parle de 20 ou 30 000, peut-être plus ?
Au nom de l’épuration, on a martyrisé et tondu des femmes amoureuses (celles, par exemple, qui refusèrent de quitter leur concubin ou leur mari allemand, lors des évacuations de civils des bases de sous-marins de Saint-Nazaire, Lorient et Dunkerque), puis celles qui, après tout, n’ont fait que leur métier (entraineuses, prostituées…). On se souvient de la tirade de la comédienne Arletty à qui on reprochait un amant allemand et qui répondit de sa voix gouailleuse et nasillarde : « Et alors ? Mon cœur est français mais mon cul est international ! ».
Après-guerre, des femmes tondues, battues, violées ont tenté des actions en justice contre leurs bourreaux mais leur action a été disqualifiée, elles n’étaient pas considérées comme des victimes.
Le chiffre officiel de l'épuration, communiqué par Adrien Tixier, alors ministre de l'intérieur, au « colonel Passy » (le capitaine Dewavrin) est de 105 000 victimes. Ce chiffre émanait des rapports des préfets. Il n'a jamais trouvé de démentis sérieusement étayés.
On a toujours tendance, pour minorer voire légitimer les crimes de l’épuration, à les mettre en parallèle avec ceux de la Milice, de sinistre mémoire. Mais les exactions barbares de la Milice, dans les derniers mois de la guerre, représentent entre 2 000 et 5 000 victimes. C’est odieux et énorme (sur une courte période et avec des effectifs armés d’environ 10 à 15 000 hommes à peine) mais cela représente de 2 à 5% maximum des crimes commis par les FTP et/ou d’autres (vrais ou faux) résistants…
Durant la seconde guerre mondiale, sur le sol de France, les « purges » de la libération et les bombardements anglo-américains firent, officiellement, 3 à 4 fois plus de victimes civiles que celles attribuées aux nazis.
« C'est la mémoire qui fait toute la profondeur de l'homme » soutenait Peguy. Dans le but de promouvoir une vérité historique par trop malmenée, Eric de Verdelhan –avec la sagacité qu’on lui connaît- a réussi la prouesse de transmettre dans son livre « Les massacres oubliés » (1), cette mémoire si maltraitée de nos jours.
Jusqu’ici, l’Histoire n’a été qu’un recueil de mensonges, d’ironies, de bouffonneries, un amoncellement de massacres et de cris de douleur. C’est ce qui est lassant chez elle : cette trame toujours semblable sous l’infini variété des motifs, cette lutte constante pour un chimérique pouvoir, ces victoires perdues, ces espoirs trahis, ces décadences, ces chutes, ces reniements, ces efforts vers un avenir qui se dérobe sans fin et qui ne relâche rien de ses exigences sanguinaires, donne une image de l’homme dont on ne saura jamais si elle exprime sa grandeur ou au contraire sa misère.
Albert Camus soutenait que « seule la vérité peut affronter l’injustice. La vérité ou bien l’amour ». Un homme qui écrit a charge d’âme, tout livre est un plaidoyer. Eric de Verdelhan, nous livre, ici, une étude réaliste à base de faits et de vérités vraies à l’histoire morale du XXème siècle.
« »
(1) - Dans cet ouvrage qui relate bon nombre de « massacres oubliés », tels ceux de la Vendée ou de Katyn (entre autres), un grand chapitre est consacré à la guerre d’Algérie. Le génocide des harkis est fidèlement retranscrit ainsi que les massacres perpétrés sur la communauté européenne d’Oran, le 5 juillet 1962… d’où le titre de l’ouvrage : « Oran, 5 juillet 1962 (et d’autres massacres oubliés) »
Adresser commande à : Eric de Verdelhan - 132 avenue de Nivelles, 17100 Saintes
|
|
|
Le mot « Race » est devenu un mot à géométrie variable selon la personne qui l'emploie.
RACE nom féminin du XVe siècle, rasse. Emprunté de l'italien razza, de même sens, lui-même probablement issu, par aphérèse, du latin generatio, " génération, reproduction ".
I. En parlant des animaux, notamment des animaux domestiques. Désigne, au sein d'une espèce, certaines catégories d'animaux distinguées par des caractéristiques communes, notamment morphologiques, qui sont constantes au cours des générations et souvent obtenues par des méthodes de sélection génétique. Les diverses races de chiens, de poules. Un bœuf de race charolaise. Les vaches normandes, hollandaises sont des races laitières. Cette race a été obtenue par croisements, est issue de divers croisements. Un cheval de pure race, de bonne race ou, simplement, de race. S'emploie parfois aussi, plus largement, au sens de Famille, Genre ou Espèce. La race chevaline, bovine, porcine. Loc. vieillies. Avoir de la race, se disait parfois, par référence aux qualités qu'on prête aux animaux de race, d'une personne distinguée, raffinée. De race, de grande qualité. Un écrivain de race. Prov. Bon chien chasse de race, les enfants possèdent en général les mêmes qualités, les mêmes inclinations que leurs parents.
II. En parlant des êtres humains.
1. Lignée, ensemble des ascendants et descendants d'une même personne, d'une même famille. La race d'Abraham, de David. Il vient d'une race illustre, d'une race ancienne. Être de race noble, de race royale.
Une race éteinte. Spécialt. HIST. Chacune des différentes familles royales qui ont tour à tour occupé le trône de France. La première race, les Mérovingiens. La deuxième race, la troisième race, les Carolingiens, les Capétiens.
Locution adjective Péjorative : Fin de race, se dit d'une personne qui, dans ses manières ou son apparence, donne une impression d'affaiblissement des caractères héréditaires.
Littérature : Pour désigner un ensemble de personnes descendant d'une même origine. La race humaine, la race mortelle, les hommes. Les races futures, les races à venir.
Par analogie : Catégorie particulière d'individus apparentés par des qualités, des inclinations, des habitudes communes. Il est de la race des grands conquérants, de la race des seigneurs. Souvent en mauvaise part. La race des pédants est insupportable.
ECRITURE SAINTE. Race de vipères, expression par laquelle le Christ désigne les pharisiens dans l'Évangile de saint Matthieu.
2. Chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine d'après les caractères physiques distinctifs qui se sont maintenus ou sont apparus chez les uns et les autres, du fait de leur isolement géographique pendant des périodes prolongées. Un homme de race noire, de race blanche, de race jaune. Le mélange, le métissage des races.
S'emploie, abusivement, dans le sens d'Ethnie.
Titres célèbres : Essai sur l'inégalité des races humaines, d'Arthur de Gobineau (1853) ; Race et histoire, de Claude Lévi-Strauss (1952).
|
2018. Ce nouveau monde de la commedia dell'arte.
Par M. Robert Charles PUIG
|
|
Il est évident que la politique nouvelle du macronisme ne pouvait pas demeurer aussi lisse que le laissait croire le sourire du président de la République...
Je n'évoquerais plus son élection et le mystère qui en fait depuis un an un président de notre République. Je n'en reviens toujours pas de ces suites de magouilles, révélations diverses, coups d'arnaques qui l'on fait élire avec si peu de voix. Il est là, bien là avec sa philosophie qui accolade à droite et à gauche, a ramassé large dans des camps aussi multiples qui lui permet sa place à l'Élysée.
Pourtant après un an de fonction, voilà que les langues se délient et que des journalistes, ceux qu'il ne voulait plus fréquenter, sans doute par vengeance, fouillent dans le no-man-land de son élection et trouvent !
Ils trouvent certaines choses qui sentent le roussi et qui semblent vite étouffées, plus vite que l'affaire Fillon c'est évident, mais c'est normal lorsque l'on a les rênes de l'attelage avec une justice qui sent la main mise de l'ancienne ministre Christiane Taubira, dont l'ombre reste présente dans tous les tribunaux gérés à sa manière et que le macronisme approuve.
Quelques " histoires " traînent... Avant son élection, le voyage à Las Vegas sous couvert de Mme Muriel Pénicaud, qui en faisant financer l'escapade par Havas à un prix faramineux a gagné son titre de Ministre du travail... Un travail bien fait pour Emmanuel Macron, quasi 400.000 euros pour une petite journée aux USA !
Une autre socialiste bon teint Florence Parly a aussi gagné son poste de Ministre socialiste des armées. Connaît-elle quelque chose aux armées ? Elle est une image, le président règne en chef sur les troupes, et elle obéit. Sans mal d'ailleurs après son passage à Air France où à son départ elle toucha un pactole, puis ses émoluments à la SNCF, très largement au-dessus du salaire moyen d'un cheminot. Avec les quelques cadres SNCF qui se nourrissent sur " la bête humaine ", tellement inoubliable avec Jean Gabin dans le film de Jean Renoir, c'est normal de passer aux ordres de l'Élysée. Elle a de la marge pour vivre.
Voilà à son tour que le Secrétaire général de l'Élysée, bras droit du président Alexis Kohler, se met lui aussi à attirer des journalistes sur son cas. Rien de grave si ne n'est que dans un autre domaine il est considéré avoir des liens familiaux avec un important armateur, la MSC italo-suisse... Des liens non avoués, semble-t-il.
Dans l'ensemble, ces " affaires " qui touchent le macronisme sont envoyées à la poubelle. C'est normal car elles appartiennent au pouvoir. Alors ne soyons pas impatients... attendons les suites... un jour.
Pendant ce temps les grèves continuent ! La SNCF se déglingue et Air France remet ça.
Le chômage ne baisse pas et l'économie malgré une embellie demeure sous l'épée de Damoclès des USA et des nouvelles mesures drastiques de taxes sur les produits importés d'Europe, du Canada, de Chine ou du Japon
Malgré ces avatars, sur le plan international l'Élysée fait feu de tous bois. Des palabres avec l'Iran, la Russie, et ça chauffe avec Trump au G 7. Le macronisme joue dans ce cas encore la voix de la sagesse et se veut le grand conciliateur de l'union contre le Grand Satan " trumpiste ".
Pédale douce avec l'Iran où de nombreuses sociétés françaises se sont précipitées et coup de gueule face aux USA. Ce Donald Trump dérange les petits arrangements européens avec les taxes et il faut lui rentrer dans le lard, le décoiffer ! Alors au Canada c'est la fronde des six contre l'Amérique. Le chef de la LREM en vedette américaine joue Jacques la Menace ! C'est l'hallali contre le protectionnisme USA et Emmanuel Macron qui vise la présidence d'une Europe des mous et la place de Merkel, tente le coup de force contre Trump. Il l'attend de pieds fermes, mais ce n'est pas sûr qu'une victoire européenne sorte de cette confrontation.
Trump est un animal de scène et les frappes " amicales " sur le dos de Macron ne sont que gestes de comédien... Le maître illusionniste face à l'apprenti sorcier. Ce n'est pas demain que les USA se plieront au commandement macroniste qui semble pourtant plaire au vieux renard américain pour ses soubresauts de cabri... Nous sommes loin de l'Olympe et de Jupiter d'autant plus que la tenue de la réunion prochaine entre Donald Trump et Kim Jong Un est une première qui met en lumière la méthode de la Maison Blanche pour relancer une paix certes précaire mais qui en a besoin pour éloigner une guerre en sommeil au Levant, alors qu'au Moyen-Orient deux mondes s'affrontent : l'Iran contre l'Arabie saoudite finalement alliée à Israël. L'alliance du loup et de l'agneau... ?
Robert Charles PUIG / Juin 2018
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens d'ajouter Petit, Clauzel, Guelât Bou Sba, Héliopolis, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Duvivier, Duzerville, Herbillon, Kellermann, Milesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Penthièvre, Randon, Kellermann et Millesimo, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
|
Algérie: Ouyahia fait sauter un tabou en appelant les «pieds noirs» à la rescousse
Envoyé par aNNIE
http://m.le360.ma/afrique/algerie/economie/2018/06/02/21204-video-algerie-ouyahia-fait-sauter-un-tabou-en-appelant-les-pieds-noirs-la-rescousse-21204
Par M.360.MA / 02/06/ 2018 l Par M. Karim Zeidane
Ahmed Ouyahia ne rechigne devant rien. Face à l’échec des opérateurs économiques algériens à développer leurs activités export, le Premier ministre algérien leur demande d’imiter «les voisins» et, surtout, de s’appuyer sur les «pieds noirs». Une première en Algérie depuis l'indépendance.
Comment les exportateurs algériens peuvent-ils conquérir l’Afrique? Le Premier ministre Ahmed Ouyahia vient de donner des pistes aux opérateurs économiques algériens pour dynamiser leurs exportations vers l’Afrique.
Dans un discours prononcé lors de la cérémonie du «Trophée export 2017», récompensant la meilleure entreprise export du pays, hors hydrocarbures, le Premier ministre algérien a souligné qu’il était nécessaire que les opérateurs suivent les exemples des «pays voisins», sous-entendu le Maroc et la Tunisie, sans les citer bien évidemment. «Nos voisins ont senti le besoin d’exporter il y a plusieurs décennies», a-t-il souligné.
Mais la nouveauté du discours du dirigeant algérien réside en l’appel à la rescousse fait aux «Pieds noirs» ou «Anciens d’Algérie», les descendants des colons français, pour aider les opérateurs économiques algériens à conquérir les marchés africains. «Je vous invite à regarder vers des communautés d’anciens d’Algérie qui peuvent vous ouvrir des portes», dixit Ouyahia.
C’est la première fois depuis 56 ans et le départ forcé de la communauté des pieds noirs qu’un très haut responsable algérien appelle cette communauté à «aider l’Algérie». Ainsi, cette communauté vouée longtemps aux gémonies devient subitement un levier sur lequel il faut s’appuyer pour dynamiser les exportations des opérateurs algériens. Ainsi, hanté par la baisse continue des réserves de change du pays, tous les moyens sont bons pour sortir de cette, y compris renoncer aux tabous.
Et pour les marchés, les débouchés sont toutes trouvées: les pays africains. «J’ai consacré presque 20 ans de ma carrière à l’Afrique. Je sais ce que pèsent nos compatriotes comme capacités d’ouvertures de portes en Afrique, et ce que pèsent aussi d’anciens d’Algérie, la communauté des pieds noirs pour approcher des marchés».
Seulement, est-ce que le fait de s’appuyer sur les pieds noirs, ce qui est une reconnaissance d’un aveu d’incompétence des opérateurs algériens à conquérir seuls les marchés africains, est suffisant pour faire de l’Algérie un exportateur important à l’image de son voisin marocain. En effet, pour exporter il faut d’abord disposer de produits en quantité et qualité suffisantes et de banques qui accompagnent les opérateurs économiques aussi bien en Algérie que dans les pays africains. Ce qui est loin d’être le cas.
En effet, les hydrocarbures représentent plus de 95% des recettes des exportations algériennes. Le reste est constitué essentiellement de quelques produits agroalimentaires, d’électroménager et tout récemment du ciment. Des produits qui sont loin d’être compétitifs sans le parapluie de l’Etat. Quant aux banques algériennes, surprotégées au niveau local, elles sont absentes au niveau continental.
En plus, la stratégie algérienne reste incohérente. Comment vouloir fermer son marché aux importations et vouloir en même temps conquérir les marchés des pays africains? Dernièrement, les opérateurs ivoiriens du café –producteurs et négociants- avaient bloqué les chargements du café robusta ivoirien à destination de l’Algérie parce que le pays de Bouteflika, qui absorbe 70% du café ivoirien, avait décidé de mettre en place des mesures draconiennes pour freiner les importations de café ivoirien.
Outre les restrictions à l’importation, l’Algérie avait aussi imposé une caution de 120% des cargaisons pour le café, poussant les opérateurs ivoiriens à bloquer les chargements de café à destination de l’Algérie en mars dernier au port de San Pedro.
Bref, même en s’appuyant sur les pieds noirs, Algérie aura du mal à devenir un exportateur à l’instar de ses voisins tant que son marché sera fermé aux investisseurs étrangers et aux produits étrangers.
Le Maroc et la Tunisie, qui s’appuient sur leurs propres opérateurs économiques, ont développé des courants d’affaires avec le continent en ouvrant leur marché à la concurrence, ce qui a permis aux entreprises locales d’améliorer leur compétitivité et d’offrir des produits de qualité. Les deux pays disposent aussi de marchés financiers relativement développés et de banques fortement présentes en Afrique, notamment pour le Maroc, et qui accompagnent les opérateurs aussi bien du Maroc que des pays d’Afrique subsaharienne.
Karim Zeidane
GUELMA
Envoyé par Gregory
https://www.liberte-algerie.com/est/ain-larbi-nouveau-pole-touristique-295540
Liberté-Algérie l Par M. HAMID BAALI- 28/06/ 2018
Aïn Larbi, nouveau pôle touristique
Les autorités locales ont saisi l'opportunité de la célébration de la Journée mondiale du tourisme pour dévoiler la stratégie envisagée dans le cadre de l'expansion des zones touristiques à l'image de celles de Hammam-Debagh et Hammam-Ouled Ali.
Dans ce contexte, des études ont été réalisées dans la région de Aïn Larbi, à une trentaine de kilomètres de Guelma, réputée pour son relief montagneux, boisé et surtout ses potentialités naturelles. En effet, cette région s'illustre par son climat rigoureux en hiver, vivifiant en été, ses sources thermales, son air pur et son environnement vierge.
Un appel à manifestation d'investissement a été lancé cette semaine sur les ondes de la régionale pour attirer le maximum d'hommes d'affaires à même de concrétiser des projets touristiques, en l'occurrence des stations thermales, des complexes hôteliers, des aires de jeux, espaces verts récréatifs, des chalets, des centres commerciaux, des auberges et autres. Selon les services de la wilaya, la zone de Gaâr El-Djemaâ pourrait abriter ces projets car elle offre tous les critères exigés pour accueillir les investisseurs potentiels. De toute évidence, tous les ingrédients sont réunis pour permettre à la wilaya de Guelma d'assurer sa relance économique en mettant en valeur ses ressources naturelles afin d'attirer les touristes, vacanciers et familles avides de détente, de loisirs et bien-être.
HAMID BAALI
Le cours de la Révolution
Envoyé par André
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/9009389-la-fierte-des-annabis
Liberté-Algérie Par - Nejmedine Zérou 27 Mai 2018
La fierté des Annabis
« L’espace réservé aux amoureux de la promenade sur le cours de la Révolution s’est rétréci comme une peau de chagrin depuis que certains kiosquiers ont fait des extensions de leurs terrasses », a fait savoir un ancien avocat connu sur la place annabie. Comble de l’ironie, a-t-il poursuivi, les propriétaires de ces kiosques ne servent que les glaces aux clients pendant l’été. « Je me rappelle durans une soirée d’été, un monsieur d’un certain âge vivant à l’étranger accompagne de sa femme et de ses enfants a été contraint lui et sa petite famille de quitter la table puisqu’il avait envie de prendre un café, chose que le kiosque ne sert pas pendant cette période estivale», a-t-il encore ajouté. Et cette façon de faire ne se passe que dans notre pays où le client n’est plus roi. Comme on dit «A prendre ou à laisser». Alors que dans tous les pays du monde, le client est maître de ses choix. On ne lui impose rien du tout. Pour ce qui est de l’espace réservé à la promenade, les gens préfèrent s’asseoir sur les bancs publics dont quelques uns ont été intégrés par certains kiosquiers à leur espace. Par ailleurs, le cours de la Révolution, cette célèbre place publique unique en son genre en Algérie et très fréquentée aussi bien par les Annabis que par les touristes nationaux et étrangers risque de devenir une place quelconque si elle n’est pas bien entretenue en ce qui concerne ses espaces verts, les travaux d’élagage de ses arbres, l’éclairage public qui laisse à désirer et surtout le mauvais état du carrelage. « Il faut que le promeneur d’où qu’il vienne, retrouve la splendeur qui régnait jadis sur le cours de la Révolution, du temps du café de la Paix, le Sélect, l’Hôtel d’Orient, le Maxéville, Le Maghreb où le client était roi et prenait ce qu’il désirait sans qu’on lui impose quoi que ce soit », a déclaré le camarde de l’avocat qui participait à cette discussion engagée à bâtons rompus.
Nejmedine Zérou
Bataille rangée à la CCI
Envoyé par Eugene
http://www.lestrepublicain.com/index.php/regions/item/9009390-bataille-rangee-a-la-cci
Est républicain Par Zarrougui Abdelhak - 24/05/ 2018
Annaba: Elle dévoile l’importance des enjeux
Fini le mythe des hommes d’affaires discrets et tranquilles. Hier, les observateurs ont mesuré la fausseté de cette idée devant le chaos déclenché lors des élections-renouvellement des organes de la Chambre de Commerce et d’Industrie « Seybouse ».
Les adhérents de la CCI se sont offerts en spectacle durant toute une journée pleine d’affrontements et de scandales. C’est dire si l’effet du jeûne n’est pas à incriminer dans les bagarres déclenchées lors des élections de l’Assemblée générale de la CCI « Seybouse ».
Le début du processus était des plus caractéristiques. Arrivée tôt le matin des organisateurs que sont le corps administratif de la Chambre. Suivis des principaux candidats composant les deux listes concurrentes à savoir le président sortant Djouadi Azzedine, et l’industriel Mansouri Farid Mohamed Riad, accompagnés de leurs colistiers.
C’est vers dix heures que des réserves ont été soulevées par certains candidats concernant les procurations. Contrairement aux scrutins précédents, l’usage des procurations a été cette fois plus ou moins massif. « La collecte des procuration n’a pas obéi à la réglementation. Il y a eu abus d’usage de cette voie de vote autorisée par la loi organique de la Chambre.
Surtout que certains participants n’ont pas justifié le paiement des cotisations annuelles », déplore un candidat. Le débarquement de nouvelles vagues de votants a suscité une levée de boucliers par d’autres candidats. Les nouveaux venus ont été taxés « d’inconnus » et « d’étrangers » et accusés d’avoir été « payés par certains pour semer la pagaille au sein du processus électoral ».
Ce qui n’a pas manqué d’entraîner un affrontement entre les deux camps ainsi que le retrait de certains adhérents dissuadés par le chaos qui s’y est installé. « Je suis venu pour renouveler l’Assemblée générale et non pour participer à une mascarade », ont répété plus d’un parmi les membres de la Chambre ayant choisi de se retirer.
Le sauve qui peut n’a pas épargné des candidats qui, choqués par les scènes de violence et d’incivisme, sont rentrés chez eux en dépit des argumentations de leurs colistiers. Jamais un renouvellement d’Assemblée générale ou même un vote de bureau exécutif de la CCI « Seybouse » n’a été aussi consternant ni plus barbare. La communauté des industriels, entrepreneurs, commerçants et autres adhérents de la Chambre, connus pour leur discrétion pour ne pas dire leur effacement, ont été envahis, hier, par une vague de violence et de bruit assourdissants. La mobilisation par des candidats, pas encore démasqués, de personnes tout à fait étrangères à l’institution et à la corporation, afin d’intimider ses concurrents, en dit long sur les enjeux en question.
L’explication de cet acharnement par le seul vote, dans quinze jours, du bureau exécutif à partir de l’Assemblée générale, n’est pas suffisante pour rendre compte du degré inégalé de la violence mise en route lors de cette journée sinistre. L’accès au sommet de la CCI « Seybouse » n’est plus un poste ingrat où la monotonie et le manque d’intérêt finissent par le rendre indésirable. L’importance acquise de la Chambre via ses attaches officielles et ses contacts aussi bien économiques et diplomatiques, est de plus en plus renforcée. Les avantages attendus de cette institution sont d’autant plus énormes qu’un passage en force est devenu nécessaire. Au moment où nous mettions sous presse, la débandade règnait toujours sur les lieux et l’on parle d’une annulation du scrutin.
Zarrougui Abdelhak
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci-dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la Seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
|
De M.
Mon adresse est, (cliquez sur) :
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Mai 2018
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
http://piednoir.fr/guelma
|
|
Un mille-pattes et une fourmi
Envoyé par Fabien
|
Un mille-pattes se promène tranquillement avec une fourmi.
Celle-ci tout à coup s'arrête et lui demande: “Comment fais-tu, mon ami, pour marcher avec toutes ces pattes ?”.
Le mille-pattes penche alors la tête pour se regarder. Il ne s'était jamais posé la question, tant le fait de marcher lui était naturel.
En voulant décortiquer le mouvement pour l'expliquer; il se prend les pattes les unes dans les autres et se retrouve sur le dos, impuissant et fragile.
“Désolée”, dit la fourmi, “c'était une simple question ! "
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
|
|