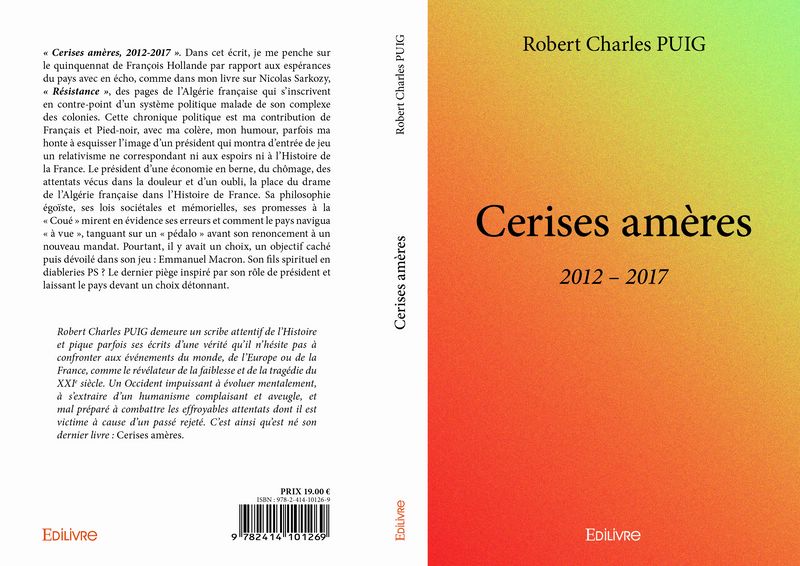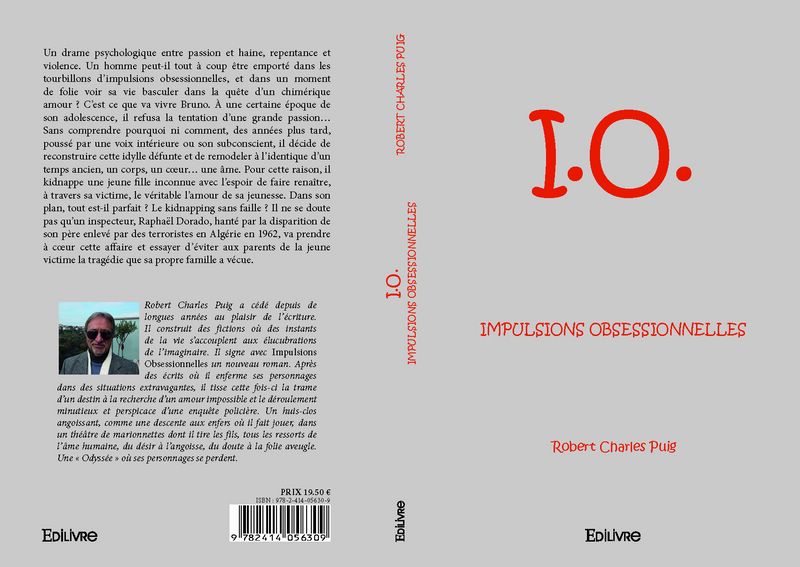|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
166, 167,
168, 169, 170,
171, 172, 173,
174, 175,
| |
|
EDITO
L'automne du partage
Chers Amis,
Avec les derniers rayons de l'été, nous sommes rentrés de plein fouet dans l'automne. Pendant que rougissent les feuilles des arbres avant de se faner et de tomber, les feuilles de la Seybouse sont encore vivantes. Elles regorgent de mémoire et de souvenirs.
Parce que cette mémoire et ces souvenirs ne valent d'être vécus que s'ils sont partagés. Le Journal " La Seybouse " demeure depuis plus de seize ans comme le guide qui vous invite mensuellement à le suivre sur des chemins de retour vers un passé qui doit continuer à vivre. Ce passé dont beaucoup ignorent l'importance, sollicite l'imaginaire et ravive des plaisirs de l'inattendu, du raisonnement, et du questionnement sur l'avenir.
Alors sans plus attendre, nous je vous invite à lire la suite de ce Numéro de la Seybouse pour oublier l'actualité morose.
Bonne lecture, JPB
Diobône,
A tchao.
|
|
| FAMILLE, JE VOUS AIME
De M. Lionel Vives Diaz
Envoyé Par M. Maurice Villard
|
Dans le collège où Lionel Vives Diaz, fils de PN né en France, est professeur, une nouvelle collègue lui demande : « Ce n’est pas trop dur d'avoir des parents PN avec tout ce qu'ils ont sur la conscience... ? »
En réponse il a écrit ce texte qu’il a affiché dans la salle des professeurs :
Aux miens.
On aurait voulu que j'écrive "Famille, je vous hais".
L'école aurait voulu que je vous condamne.
Les politiques auraient voulu que je vous maudisse.
L'opinion, dans sa grande majorité, aurait voulu que je vous rejette.
Les intellectuels auraient voulu que je vous désavoue.
Les historiens auraient voulu que je vous désapprouve.
La France aurait voulu que je vous méprise.
Et nombreux sont malheureusement les enfants de Pieds-Noirs qui se sont laissés convaincre par ces discours culpabilisants.
Moi, je condamne, je maudis, je rejette, je désavoue, je désapprouve et je méprise tout ce joli monde.
Et, au contraire, j'écris en lettres d'or "Famille,
je vous aime".
Vous avez été les victimes d'une trahison d’État, d'un abandon honteux, d'un exil douloureux, d'un "accueil" indigne.
Vous avez enduré quotidiennement, durant des années, les massacres, les enlèvements.
Vous avez dû abandonner le peu que vous possédiez pour sauver votre vie en rejoignant une patrie qui ne voulait pas de vous.
On vous a présentés, pour vous dénigrer, comme des nantis, vous dont la seule richesse était l'amour que vous portiez à vos familles.
Et ceux-là mêmes qui vous traitaient de "bougnoules" ou de "rats pas triés" ont essayé de vous faire passer pour des racistes.
Mais vous avez relevé la tête et vous avez construit une nouvelle vie, loin de votre ciel bleu, loin de vos amis, séparés pour toujours de vos disparus, exilés à jamais sur une terre étrangère, blessés depuis 55 ans.
Cette blessure vous me l'avez transmise, sans le vouloir, en essayant au contraire de me préserver de cette douleur indélébile.
Mais je suis fier d'être issu de vous.
Alors, encore une fois, "Famille,
je vous aime".
Merci de m'avoir permis d'être un gosse de Pieds-Noirs.
Merci à Lionel Vivès-Diaz pour ce cri du cœur que nous faisons notre et que nous publions avec son autorisation, car ces racistes, qui ne connaissent pas la vraie histoire de l'Algérie Française, nous haïront jusqu’au dernier …... Ils connaîtront le chatiment par les nouveaux-venus. Le temps fait son oeuvre.
|
|
|
PHOTOS DE BÔNE
Envois par Mrs Bussola et Léon
|
|

Eglise Sainte-Anne, début de la démolition en 1980

Mosquée à la place de l'église en 2010

Echatt route de La Calle le coin des tellines en 2017

Dégustation de tellines à 1 euro la bouteille
|
|
| Fables Bônoises
De M. Edmond Brua
Envoyé Par M. Carpy Dominique
|
|
LE COIFFEUR ET LA GUENON
Deux coiffeurs de Bablouette,
Les deux vec le magasin,
Un jobasse et un louette,
I's étoient pas bons oisins.
Quoi faire, des coiffeurs ? Y se fésoient la tête,
I' s'arrégardoient en travers,
Mâ le louette il étoit gonfe
Comme un qu'on sle porte en triomphe
Et le jobasse i' venoit vert.
Oilà pourquoi comment : le salon d'ia coiffure
A le premier c'étoit la bonne affure,
A rapport qu'au lieur d'un garçon
Pour servir à la clientèle.
Il avoit un singe fumelle,
Mettons un' singesse, aussinon
Je me l'appelle une guenon.
Et la boutique elle étoit pleine !
Le louette i' fésoit fortune et pendant c'temps
Le jobasse i' fésoit faillite.
I' s'attrapoit la miningite.
I' juroit des morts dans les dents.
- C'est-t-honteux, i' disoit, qu'on fait salir le linge
Par un animal dégoûtant !
Manque i' vient du Ruisseau-des-Singes.
Sûr que c'est un Oran-goutan !
Vec tous ces étrangers, leurs necs et pis leurs bloffes,
N's allons tous à la stacastrophe !
La France aux François, la pitain !
Un jour - c'étoit le bon matin -
Qu'est-c' qu'i' oit ? I' oit la singesse
Qui vient rouvrer le magasin.
Attrape un' mouche ou deux ! Mont' sur le tiroir-caisse
Gratte un peu la poussière et gratte un peu les fesses !
On se croirait un être humain.
Quâ mêm' que le jobasse i' n'en avoit un' couche,
Une idée i' lui vient : i' va prendre un rasoir,
I' sort dihiors d'sur le trottoir
Et pis i' fait pstt vec la bouche.
Oilà la guenon d'I'aut' côté
Qu'ell' sort vec le rasoir de pareill' qualité.
I ' s'attrap' son sien par la lame,
I ' fait semblant de s'l'affûter.
C'est ici qu'ça commente' le drame.
Y avoit pas des témoins, y avoit pas des agents,
Y avoit que lui et la singesse
Qu'ell' fésoit ses gest' en singeant.
Entention les maladresses !
D'un seul coup
F se prend la peau du cou,
I ' fait couic ! et vec le manche
I' s'le tranche...
A de rire, on m'a compris.
Mâ le truc il a pas pris.
Et mon coiffeur, le jobasse,
Au lieur de oir un malheur,
I' oit la singesse en face
Qui s'iui tape un bras d'honneur !
Edmond Brua
|
|
|
|
LE MUTILE N° 43, du 6 janvier 1918 (Gallica)
|
|
UN CURIEUX DOCUMENT
On a beaucoup ergoté sur la répugnance qu'éprouvaient les Turcs à combattre les troupes européennes et notamment du regret qu'ils manifestaient d'être opposées aux troupes françaises ; on a été tout près de les comparer à des moutons que des chefs au cœur dur, conduisaient à la boucherie, oubliant la sauvagerie dont ils ont fait preuve à l'égard des pauvres arméniens désarmés et les sentiments nettement germanophiles qui les animent.
Un curieux document que nous avons sous les yeux et qui a été; fidèlement traduit, met les choses au point et nous donne un aperçu de leur étal d'esprit, du moins à l'époque de la déplorable expédition des Dardanelles. Il a été trouvé par la brigade métropolitaine sur un officier turc, tué dans la nuit du 1er au 2 Mai 1915 à la presqu'île de Gallipoli. Voici ce qu'il dit textuellement :
Article I. - Cette nuit il faut se préparer à attaquer l'ennemi. Nous devons le repousser sans pitié malgré son feu meurtrier et le poursuivre ferme. Il faut combattre corps à corps. Les troupes peuvent être sûres que de cette façon les ennemis ne pourront pas nous résister.
Article II. - A 10 heures ce soir toutes les troupes attaqueront pour rejeter l'ennemi à la mer et de la sorte gagner la victoire.
Article III. - Pour celle attaque les sacs seront laissés. Les troupes porteront la capote et devront, afin de gagner du terrain, ramper et se dissimuler le plus possible.
Article IV. - Il faut vouloir, pour pouvoir repousser l'ennemi cl si même il y a des revers ne pas se laisser abattre et toujours aller de l'avant quand môme.
Article V. - Avant l'attaque corps à corps bien repérer les tranchées à l'avance et tendre par précaution, des réseaux de fil de fer barbelés.
Article VI. - Au retour des patrouilles, pour revenir dans son secteur, on se servira du mot d'ordre " Sultan " puis comme signal de départ du mot "Osman ". Toutes les troupes doivent être au courant de cette manière de procéder.
Article VII. - Afin d'anéantir les troupes ennemies, son matériel et ses pontons de débarquement, on emploiera le pétrole.
Article VIII. - Si nos pointes d'avant garde aperçoivent la position des batteries ennemies elles les signaleront à l'aide de deux coups de revolver : si l'avant-garde lance deux feux rouges, il faudra cesser le combat immédiatement.
Article IX. - Pour donner du courage aux troupes el favoriser la victoire finale, les aumôniers militaires musulmans de chaque bataillon, marcheront en avant.
Article X. - Il n'est pas nécessaire d'envoyer les prisonniers à l'arrière ; il faut tout exterminer et tuer. Les armes des prisonniers seront mises à part.
Article XI. - Tous ceux qui reculeront ou auront peur seront fusillés. Les troupes seront autorisées à tirer sur les défaillants sans pitié.
Signé : Illisible.
Gallipoli, 1er Mai 1915
Voilà les agneaux que nous avons combattus, que nous avons bien traités comme prisonniers et qui pourtant avalent l'ordre d'exterminer el de tuer les nôtres. Il est fort heureux que la vaillance de nos troupes les ait empêchés de faire des prisonniers, mais c'est égal, ces gens là ont beau avoir comme dirigeants des membres du Comité Union et Progrès, ils sont en retard sur la civilisation.
Jean SANPEUR,
Réformé de Guerre
|
|
Marion et Alice
ECHO D'ORANIE - N°265
|
Ce fut notre passé, ce sera notre histoire,
A mes petits enfants, je leur dirai un jour
Qu'avant d'être Française, je suis d'abord "Pied-noir"
Mon pays, où est-il ?... au loin, perdu pour toujours.
Là où la mer immense a des reflets nacrés de turquoise
Là où les maisons aux murs blancs n'ont pas de toit d'ardoise
Où les soirs d'été, on frôle des doigts le ciel
Où scintillent par milliers les étoiles en fête.
Là-bas, le soleil donne aux villes des couleurs de miel.
Non, je ne reverrai pas, plus jamais, je regrette
Ce pays de lumière, de joies et de félicité.
Mais ces bonheurs perdus, je les ai retrouvés
En vous voyant naître et grandir près de moi,
Car, dans vos jeux d'enfant, je retrouve mon passé,
Mon enfance, vos jeux étaient les miens, et aussi vos émois.
Ici, le ciel est gris et l'air est différent
Qu'importe!... si c'est dans votre tendresse et vos sourires
Que je retrouve un nouveau printemps!
Chantal Rouayrous Eymard
De Mostaganem
|
|
|
| Bulletin - Oeuvre de saint Augustin et de sainte
Monique, patronne des mères chrétiennes
1875 - Brochure trouvée à la BNF
|
|
VOYAGE DE MÉTLILI A EL-GOLÉA.
Lettre du R. P. Paulmier, missionnaire d'Afrique (d'Alger)
A un Père de la même Société.
Mon Très-Révérend Père,
J'ai déjà eu l'honneur de vous entretenir des résultats obtenus dans notre dernier voyage à El-Goléa. Je l'ai fait avec la brièveté qui sied à un simple rapport, mais je me propose d'entrer ici dans quelques détails et je crois ne pouvoir mieux faire que de transcrire mes notes de voyage.
Je ne vous parlerai pas, mon Révérend Père, des préliminaires obligés de tant de voyages en pays musulman, des marchés dix fois conclus et dix fois rompus, des mille agaceries de chameliers rivaux. Une grande patience et beaucoup de douceur sont les seuls remèdes qu'un missionnaire puisse opposer à ce mal du pays, si je puis m'exprimer ainsi. Cependant, notre départ que nous avions fixé au 18 mars ne devait pas être retardé, et après les adieux et les souhaits de nos charitables confrères, vers onze heures du matin, le P. Kermabou et moi nous nous dirigions de Métlili vers El-Goléa.
Le 18 mars. On aime volontiers à revenir des pays dangereux et de l'estomac des anthropophages, a dit un spirituel auteur, et c'est bien là en effet une des mille formes de la vanité humaine. Mais le missionnaire ne saurait être accessible à de pareils sentiments, lui qui est à sa place au milieu des dangers, et qui triomphe dans la mort. Je rapporterai donc comme simple épisode de notre voyage-les paroles qui me furent dites au moment du départ et sous forme d'avis par un de nos arabes " Sur la route d'El-Goléa, il ne faut compter que sur deux choses, Dieu et un bon fusil !" Nous nous étions mis, mon compagnon et moi, entre les mains de Dieu, mais guides et chameliers, malgré leur fatalisme, s'étaient bien gardés d'oublier leurs armes.
Les Arabes donnent des noms aux moindres accidents de terrain, précaution utile dans le désert, mais qui serait ici fastidieuse. Je me contenterai donc, mon Révérend Père, de vous signaler nos campements.
A peine sortis de Métlili, nous sommes en vue d'un petit monument élevé en l'honneur de Sidi Cheikh, marabout que les Chaâmbas ont en grande vénération, aussi nos arabes se font-ils un devoir de s'y arrêter pour se recommander à sa protection. L'un d'entre eux formule une série de vœux auxquels tous répondent avec ferveur. Amin! Amin!
Hélas, me disais-je, pourquoi nos chrétiens n'en feraient-ils pas autant pour les héros de notre sainte religion dont la puissance auprès de Dieu nous est assurée, tandis que ces Arabes s'adressant le plus souvent au vice déjà puni dans l'autre monde ? Cette rencontre du marabout fut pour nous l'occasion de nous recommander une fois encore à Dieu ainsi que nos pauvres égarés.
Jusqu'à cinq heures et 1/2, nul autre incident ne vient troubler la tranquille allure de nos chameaux. Arrivés à Bel Groninat, grande plaine entourée de collines arides, nous dressons notre tente, le feu brille au milieu d'une fumée de bois vert et bientôt notre marmite chante la flammé. Nous achevons le bréviaire, je saigne notre pauvre Roussin toujours souffrant et aussi le Caïd notre guide qui est légèrement indisposé ce soir puis vient le souper auquel cependant tout le monde fait honneur. Pour égayer la soirée tout en édifiant notre entourage, le P. Kermabou et moi nous entonnons ensemble ou tour à tour quelques-uns de nos beaux chants d'église. Mais comme tout a sa fin en ce bas monde, nos chants aussi se perdent dans un dernier écho et le sommeil s'empare de nos membres peu fatigués du reste par une petite journée de marche, car vous vous rappelez, mon Révérend Père, que nous ne sommes sortis de Métlili que vers onze heures du matin.
Le 19 mars. - Fête de saint Joseph, à deux heures et demie, nous sommes sur pied pour dire la sainte messe. Pour nous la solennité est absente, je veux parler des cérémonies de l'Église, car, dans nos cœurs, il y a fête et nous prions en union avec vous, mon Révérend Père, avec tous nos frères. Nous demandons à saint Joseph qu'il veuille bien être notre guide dans ce voyage comme il le fut de Notre-Seigneur et de la Très Sainte Vierge fuyant en Égypte.
A cinq heures et demie nos chameaux sont chargés et nous repartons avec l'ardeur du second jour. Mais bientôt une chaleur accablante se fait sentir et le silence n'est interrompu que par les cris intermittents de nos chameliers. Après une légère collation, quelques dattes et deux ou trois gorgées d'eau échauffée par la peau de bouc, nous franchissons une côte assez ardue, pour descendre dans une plaine en partie sablonneuse. Nous y trouvons un puits et nous prenons de l'eau pour deux jours. Ce puits est une simple excavation à peu près circulaire, profonde de deux mètres environ, sans margelle qui protége l'eau contre les envahissements du sable. Vers six heures, fatigués par la traversée des dunes, nous nous arrêtons à un endroit nommé par notre guide Tmaïl-Ilins. Impossible de dresser la tente sur le lit de sable et de cailloux qui s'étend à nos pieds. Tout se passe à peu près comme hier, mais plus fatigués, la conversation peu animée du reste dégénère bientôt en sommeil.
Le 20 mars. Dès l'aube nos chameliers s'éveillent et chargent notre bagage. Une heure après, nos chameaux agenouillés se redressaient et nous reprenions notre route. Vers dix heures, nous -nous arrêtâmes près du puits Sidi-Hamza. Ce puits muni de ses deux montants et d'une margelle est comblé depuis longtemps. Priver ses ennemis de l'eau qui leur est nécessaire est une tactique très-souvent employée entre combattants dans le Sahara, et notre guide nous raconta que tout un parti fut réduit par ce stratagème auprès du puits que nous apercevons.
Notre guide est venu jusqu'ici à pied, et c'est dans les environs qu'il doit trouver son chameau confié la garde des Châambas qui le font paître avec leurs troupeaux. Nous ne voyons toutefois qu'une trentaine de chèvres gardées par un jeune arabe. Le pauvre enfant paraît peu rassuré à la vue de notre petite caravane et non sans raison, car le caïd nous offre déjà une de ses chèvres, nous n'avons qu'à parler pour être servis sans bourse délier. Vous pensez bien, mon Révérend Père, que nous nous empressâmes de décliner une offre si généreuse, tout en admirant la force de l'arbitraire au pays des sables. Le petit pâtre s'empressa de pousser ses chèvres devant lui et disparut pendant que nous déchargions nos chameaux. Le caïd parti à la recherche de sa monture, devait être de retour dans un quart d'heure au plus, et nous l'avait du moins assuré. Mais quatre longues heures s'écoulèrent avant que nous le vîmes reparaître. A la vérité je n'avais pas été dupe de ses paroles, je savais depuis longtemps que les Arabes sont généralement au désert les complices du mirage. Tel puits, tel campement est là. Vous le voyez. encore quelques pas. Et des heures entières se passent à la poursuite d'un but naguère si rapproché. Il est certain que dans le Sahara surtout, les Arabes n'ont aucune notion de la mesure du temps ni de l'espace et qu'une vue très-perçante leur permet de distinguer des points que l'œil européen ne soupçonne pas. Aussi le plus simple est-il de ne pas questionner les guides et de les suivre docilement. Il semble qu'on arrive plus vite. Vers midi et demi nous reprenons notre route. Nous passons à Mehasser Elmelh.
C'est un lac, ou plutôt une immense cuvette dont toute la surface est couverte d'un sel aux prismes étincelants. A quelques pas de là nous rencontrons une petite caravane composée de quatre arabes et autant de chameaux. Les nouveaux venus n'ont rien de plus pressé que d'armer et -de visiter leurs fusils, mais notre guide qui s'est acheminé vers eux leur fait rengainer leur compliment et met fin à de si dangereuses manœuvres. Ils voient de suite en effet qu'ils ont à faire à des gens parfaitement inoffensifs et après quelques paroles échangées comme pour achever la reconnaissance, les deux caravanes continuent pacifiquement leur route. Enfin à cinq heures et demie nous arrivons non loin des collines nommées Chaak Fatma, dans une plaine de sable ondulée comme une mer légèrement agitée. Pour la seconde et dernière fois, nous pouvons dresser notre tente, cependant il faut toute l'industrie du Père Kermabou, et nos piquets ne tiennent qu'à force de pierres et de sables amoncelés. Tandis que s'élève notre fragile édifice, je panse le bon Roussin, le feu pétille, quelques minutes encore et le souper sera prêt. Mais à peine avons-nous fait taire la faim que le sommeil nous réclame, et sans trop de résistance nous nous livrons à sa bienfaisante action.
Le 21 mars.- Dimanche des Hameaux, nous nous levons, le P. Kermabou et moi à deux heures et demie pour dire la Sainte Messe. Aujourd'hui, pour la première fois de notre vie, pas de rameaux bénis, et par le souvenir seulement nous pouvons jouir des belles et touchantes cérémonies de l'Eglise. Entourés d'Infidèles, nous sommes portés à entonner le cantique des Hébreux Super flumina Babylonis, expression si touchante et si vraie des douleurs de l'exilé. Cependant, plus heureux que les Hébreux, en quelque lieu de la terre que nous soyons, nous pouvons jouir de la présence immédiate de notre Dieu dans la Très-Sainte Eucharistie, et nous écrier avec l'élan de la reconnaissance Non fecit taliter ômni nationi.
Pendant que nous nous livrons à ces pensées, nos Chameliers plient bagages et nous invitent à nous remettre en route. Le vent est un peu frais, il pleut. Arrivés à Chaâbet-el-Mekh, nous collationnons avec quelques dattes. La pluie, qui n'a pas cessé de tomber, traverse nos burnous, un froid humide nous pénètre. Notre pauvre Houssin surtout est éprouvé par ce mauvais temps et souffre en vrai musulman. Mais cette résignation stérile aux arrêts du destin ne vaut pas la patience chrétienne qui rend parfois les peines si douces et toujours si fructueuses pour l'âme unie au Dieu crucifié.
Dans l'après-midi, le temps s'éclaircit un peu, mais le vent continue à souffler violemment et ne nous présage rien de bon pour la nuit.
C'est à Chebika, au milieu des sables, que notre guide fait arrêter la caravane. Il ne faut pas songer à planter la tente, nous avons assez de peine, d'abord à allumer du feu, ensuite à faire notre cuisine que nous mangeons en grinçant des dents, car le sable fait une concurrence déplorable aux autres condiments. - Après ce triste souper, vrai souper de carême, chacun se cherche une place aussi abritée que possible et se blottit dans ses burnous.
Peine perdue Vainement on essayerait de dormir. Le ciel se couvre de nuages, la pluie tombe, le vent redouble de fureur, bref, une véritable tempête se déchaîne dans les immenses steppes qui nous environnent. Le sable, comme pour ajouter un charme de plus à notre position, nous envahit, nous pénètre. les yeux, les oreilles, la bouche ne s'auraient trouver grâce devant ce subtil élément. Inutile de chercher un refuge auprès du feu, le vent l'a dispersé. Quelle nuit !. Pour moi, l'imagination s'en mêle, et nouveau Tantale, la pensée me poursuit de ces bons appartements " Qui recèlent le printemps au milieu des hivers, " au sein de la famille.
22 mars. Le jour trop longtemps appelé paraît enfin. Nous sommes au 22 mars. A six heures du matin, nous décampons, pressés d'oublier cette triste étape. Nous marchons poussés par une petite bise acérée, dernière avanie du mauvais temps; quelques détours encore dans une inextricable chebka, et nous apercevons le puits de Zirara. Nous, nous y arrêtons pour prendre de l'eau.
Nous sommes arrivés au point le plus dangereux et aussi le plus intéressant de notre route. Notre guide fidèle à une coutume qu'on peut observer dans le Sahara partout où on redoute un danger, nous avait fait passer la nuit à une certaine distance du puits, car, dit M. Duveyrier, " les puits sont forcément des points de rendez-vous pour les brigands en course aussi bien que pour les voyageurs pacifiques."
Le puits de Zirara situé au centre d'une vaste plaine entourée de collines est en effet très-fréquenté, et là se sont bien souvent rencontrés des partis ennemis. Les Arabes ne tarissent pas en histoires plus ou moins effrayantes dont ce puits fut le théâtre sanglant, et ils vous montrent à quelques pas, deux cimetières assez bien garnis, peuplés de victimes ou d'agresseurs malheureux que Dieu a réunis dans la mort. Il est certain que pour être silencieux, ces témoins n'en parlent pas moins très éloquemment.
Parfaitement bâti en pierres sèches, ce puits est dû à une femme Berbère nommée bent El Khass bent Sâad Zenati. Il a 20 mètres de profondeur. A l'intérieur, on a creusé dans les parois une petite excavation que le P. Kermabou a visitée, trois ou quatre personnes pourraient y trouver place. Rien de mieux sans doute pour des voleurs ou des ennemis acharnés. Aussi la légende raconte-t-elle qu'un seul arabe tint en échec et fit périr de soif un grand nombre de Touaregs, en coupant à mesure qu'elles descendaient, les cordes que ces derniers essayaient d'y plonger munies de leurs appareils. Je rapporte ce fait d'après notre guide, mais je n'oserais en garantir l'authenticité. Au moins est-il vraisemblable, qualité dont manquent trop souvent les récits arabes.
A côté des deux cimetières dont j'ai parlé, s'élève une petite colline garnie d'un mur circulaire au tiers extrême de sa hauteur. Cette enceinte élevée sert au besoin de fort ou de refuge. Je l'ai visitée avec soin et je n'y ai remarqué aucun trou d'habitations. De Zirara, nous allons coucher à Saheb-Lafran.
Le 23 mars. - Nous traversons d'immenses dunes, ennuyeuses et fatigantes. Nous aurions pu arriver aujourd'hui à El-Goléa, mais nous nous sommes arrêtés trop longtemps hier au puits de Zirara. A quatre heures et demie nous couchons à Taguint.
Le 24 mars - A quatre heures du matin, nous quittons notre dernier campement. Dans quelques heures nous serons à El-Goléa, but de notre voyage, limite extrême de la conquête française dans le sud. Nous suivons pendant trois heures une interminable chaîne de montagnes situées à notre gauche, tandis qu'à droite s'étend à perte de vue la région des sables.
Il est dix heures du matin lorsque nous entrons à El-Goléa. Descendus sur une grande place au bas du Bordj, nous nous y établissons sous un palmier en attendant que la maison du Caïd soit disposée pour nous recevoir.
Le Ksar est presque désert à cette époque de l'année, aussi les visiteurs ne sont-ils pas très-nombreux. Quelques arabes suivis de plusieurs nègres esclaves viennent gravement nous souhaiter la bienvenue et nous répondons à leurs politesses. Trois quarts d'heure se passent à l'abri du palmier hospitalier et nous sommes introduits dans une maison en pisé, d'assez bonne apparence pour le pays. Nos premiers visiteurs nous ont suivi, d'autres se joignent à eux, et une franche cordialité vient bientôt remplacer la gravité cérémonieuse qui nous avait accueillis.
Nous n'avons plus maintenant à craindre que l'indiscrétion dont aucun arabe ne paraît apprécier les inconvénients, du moins à l'égard de ses hôtes. Car vous savez, mon Révérend Père, combien les musulmans sont réservés, même défiants dans leurs rapports mutuels, et que la vie privée est chez eux toujours enveloppée d'un voile impénétrable.
Je me trouve jusqu'à un certain point en pays de connaissances, et je suis invité à visiter un pauvre homme que j'ai soigné l'année passée, à Laghouat, sans espoir, hélas! de guérir. Dévoré par un cancer hideux qui, à l'époque de sa première visite, lui avait déjà emporté la lèvre supérieure et une partie du nez, je le trouvai cette fois dans un état véritablement affreux. Son visage, presque entièrement dévoré par l'horrible mal, lui donnait l'aspect d'un homme depuis plusieurs jours la proie du tombeau. Un œil lui restait cependant dont l'orbite entrait en décomposition et cet homme voulait vivre! Il me demandait des remèdes. Je ne pus que lui laisser un peu de camphre dont chaque jour je saupoudrais sa plaie.
Le musulman pouvait encore articuler quelques mots et ne savait comment m'exprimer sa reconnaissance. C'est qu'il était abandonné même de ses enfants, qui le négligeaient au point de laisser littéralement pourrir, avec sa chair, les linges qui couvraient son visage. Un de ses fils et sa femme assistaient aux visites que nous lui faisions, et je ne pus m'empêcher de leur faire quelques reproches, mais le langage de la charité leur était étranger, ils ne me comprenaient pas.
Alors, mon Révérend Père, je sentais bien vivement la nécessité d'aimer ces pauvres Infidèles, et par nos exemples, de leur apprendre à aimer, c'est-à-dire d'implanter dans leurs cœurs cette vertu divine de Charité, dont ils ignorent même le nom. N'est-ce pas, en effet, la charité, la douce bonté de notre aimable Sauveur qui a soulevé le monde jusqu'à Dieu? N'est-ce pas aussi en imitant le divin Missionnaire que nous arracherons les musulmans à leur égoïsme, au froid et implacable destin, à Allah du Coran, pour les rendre à notre bon Dieu, au Dieu de l'Évangile ?
D'autres malades vinrent me voir, que je contentai. de mon mieux. Je vis à El-Goléa, comme partout chez les Arabes, que le médecin ne visite pas, beaucoup de maladies chroniques, qui s'étaient invétérées et aggravées par dix, quinze et vingt ans d'un libre développement. Assurément, rien ne serait plus désespérant, même pour le plus habile médecin, à plus forte raison sommes-nous embarrassés, nous, pauvres Missionnaires, dont le dévouement ne saurait entièrement remplacer la science. Pour comble d'embarras, nous avons affaire dans la plupart des Arabes, à des gens simples à l'excès et surtout superstitieux, qui demandent imperturbablement aux remèdes des résultats visibles, palpables, instantanés, presque un miracle. C'est alors qu'il faut s'armer de patience, car les explications sont rarement comprises.
Je ne voudrais pas terminer cette lettre, mon Révérend Père, sans vous dire quelques mots d'El-Goléa, de l'origine et de l'aspect de ce Ksar si curieux à différents égards.
El-Goléa nommé encore El-Menea, par les habitants eux-mêmes est bâti sur le versant ouest d'une petite montagne de forme conique, dont le sommet entouré de murs forme une enceinte fortifiée (1).
(1) La tradition raconte que Goléa était habitée autrefois par des gens de sang mêlé, comme ceux du Tauât, et qui parlaient le zenatia, idiome berbère, mais actuellement cette ville est le centre d'une des trois confédérations des Chambas, les Chambas El-Madhy.
Ces murs dans la partie qui a été réparée par le général de Galifet, sont garnis de meurtrières dans le système français. Trois énormes constructions dont les flancs s'échelonnent en se soutenant, donnent au premier abord à ce Ksar, surtout du côté du nord, l'apparence d'une immense château-fort, assez semblable à nos antiques manoirs. Un style sévère et une solidité à l'épreuve des siècles lui permettent, je crois, de soutenir la comparaison(2).
(2) On prétend, dit M. le général Daumas, que Goléa a été assiégé pendant sept ans par les Touaregs, qui s'obstinaient à vouloir la prendre par la famine. Les provisions commençaient à s'épuiser, mais une ruse sauva les assiégés. Un matin les Touaregs virent les murailles de la place tapissées de burnous blancs fraîchement lavés qui séchaient au soleil donc elle ne manquait pas d'eau. La nuit suivante, de grands feux allumés sur plusieurs points, l'éclairaient tout entière donc elle ne manquait pas de bois. Le lendemain, les Touaregs trouvèrent sous les murailles, et jusqu'auprès de leur camp, des galettes de basse farine, des dattes, du kouskoussou, dernières ressources que les assiégés avaient sacrifiés pour faire croire à leur abondance; les assiégeants y crurent et se retirèrent. Dans une note M. le général Daumas a soin d'ajouter, il y a sans doute exagération dans ce conte, dont le véritable sens doit se réduire à ce fait, que, par sa position et les provisions qu'elle peut faire, Goléa est à peu près imprenable pour des Arabes,
Ce Ksar n'était pas le seul, dit-on, sur le territoire d'El-Goléa, il y aurait eu jusqu'à 70 ksours bâtis comme ce dernier par les Berbères, et dont on attribue la destruction à un empereur du Maroc. Du haut de la forteresse, la vue s'étend sur une belle plaine parsemée de petites oasis, que l'on a déjà comparée avec beaucoup de justesse à une immense peau de panthère. Sur la face ouest du Ksar, entre les tours dont je viens de parler et l'enceinte fortifiée du haut, se trouvent les magasins où les habitants conservent leurs dattes. Ces magasins sont en fort mauvais état et présentent l'aspect d'une ruine. Les jardins de palmiers qui sont en bas d'El-Goléa sont ordinairement habités, mais si quelque bruit de guerre vient à troubler le pays, tout le monde se réfugie dans la forteresse où les dattes sont en abondance et l'eau à discrétion, grâce au soin qu'ont eu les premiers maîtres de ce Ksar d'y creuser un puits.
Mes notes se terminent là, mon Révérend Père, et je n'ajouterai rien car notre retour à Métlili par le même chemin n'offre aucune particularité digne de votre attention.
J'ai pensé que ces nouveaux détails vous intéresseraient, et cela devait me suffire pour m'engager à vous en faire part.
Veuillez agréer, mon Très-Révérend Père, l'expression de mes sentiments dévoués et respectueusement affectueux en Notre-Seigneur.
A. P.
P. Miss.
Métlili, le 25 août 1875.
|
|
Le Renard et le Corbeau
Papa-Louette N°49 du 10 novembre 1907. Source Gallica
Envoy par M. Lagarde Jérémy
|
Un grand borgeois avait sur sa pantcha
Une joulie montre vec la chaine
Un goréro que juste y se passe par là
Sans faire ensemblant y s'amène
Et bonjour mosieur Ie borgeois
Madone ! qué joulie chaine ! laissez-moi que je vois.
Blague à part, si dans votre poche
La montre aussi elle est pas moche
J'a pas vu dans ma vie de plus joulis bijoux
A ces mots le borgeois y devient fou de gout
Et enchanté de la rencontre
Pour qui voit bien, y lui met dans la main la montre.
Le goréro y se la prend et dit en s'ensauvant
Encore plus vite que le vent.
Tout embrouilloun y vit sur celuilà qui se l'écoute
La leçon y se vaut bien un montre, sans doute !
Le borgeois qui se reste confus
Y s'a juré un peu trop tard, qu'on ne celui mets plus.
Laïn.
|
|
|
ANNALES ALGERIENNES
Tome 1
|
|
LIVRE PREMIER.
Aperçu géographique, historique et politique sur la régence d'Alger. - Cause de la guerre de la France contre Alger. - Blocus. - Préparatifs de l'expédition. - Départ de l'armée d'expédition.
La partie de la Barbarie qui formait l'ancienne régence d'Alger occupe, au nord de l'Afrique, une longueur de côte d'environ deux cents lieues, depuis les frontières du Maroc jusqu'à celles de Tunis. La largeur du nord au midi en est assez indéterminée ; les géographes la poussent jusqu'au grand désert, quoique toute cette étendue de pays ne reconnut pas la domination des deys d'Alger. Cette contrée est sillonnée longitudinalement de l'ouest à l'est par deux chaînes de montagnes bordant, au nord et au sud, une série de plateaux élevés qui en forme la zone centrale. Ces chaînes se détachent du mythologique Atlas, que l'inhospitalière terre du Maroc, où il est situé, soustrait aux études européennes. Nos géographes paraissent avoir voulu se consoler de la pénurie de données positives sur ce mont mystérieux, en décorant de son nota ses deux ramifications algériennes ; ils ont appelé petit Atlas celle du nord, et grand Atlas celle du sud : dénominations défectueuses, car c'est précisément ce qu'ils appellent le petit Atlas qui présente les pentes les plus abruptes et les sommets les plus élevés.
Quelques chaînons transversaux vont çà et là d'une chaîne à l'autre, en coupant les plateaux du centre qu'ils partagent en diverses régions, tantôt ridées par des ondulations de terrain, tantôt planes et en partie couvertes par de vastes amas d'eau salée, connus sous le nom de sebkhas, et qui ne méritent celui de lac que dans la saison des pluies; car, aux autres époques de l'année, l'eau s'évaporant ne laisse sur le sol qu'une nappe de sel cristallisé. Ces sebkhas sont les récipients des torrents qui n'ont pu s'ouvrir une issue à travers les chaînes, soit que leur peu de puissance ne leur ait pas permis de s'y creuser des vallées d'érosion, soit que les combinaisons du soulèvement des masses rocheuses aient opposé à leurs efforts d'invincibles obstacles.
Les plaines qui se déroulent aux pieds de la chaîne septentrionale, vers les points où elle est le moins éloignée du littoral, sont généralement séparées de la mer par des collines terreuses dont les pentes fécondes couronnent le rivage d'un feston de verdure et réjouissent les regards du navigateur. Ces collines forment ce que l'on appelle généralement le Sahel (rivage), en le subdivisant par localités, comme le Sahel d'Alger, le Sahel de Cherchell, le Sahel de Bône, etc. Le pays qui vient après, jusqu'à la chaîne méridionale, est assez souvent désigné, dans l'ouest surtout, sous la dénomination générique de Tell. Quelques personnes ont cru voir dans ce mot un dérivé du mot latin Tellus, comme si l'on avait voulu indiquer par-là la terre par excellence, la terre à céréales, par opposition ais Sahara qui n'en produit point ; mais c'est une erreur : cette expression est purement arabe, et signifie haut pays, pays élevé.
Le Sahara, que nous venons de nommer, s'étend au-delà de la chaîne méridionale. C'est une vaste zone de plaines sablonneuses, du sein desquelles s'élèvent de loin en loin, comme des îles, de belles oasis de palmiers. Au-delà règnent le désert et ses mystères.
L'Algérie est arrosée par beaucoup de petits cours d'eau, mais il n'y a pas de rivières considérables, la constitution géologique du pays ne le comportant point. Le climat est assez généralement sain et tempéré ; le sol est presque partout fertile et se prête à une grande variété de culture; il est, sur plusieurs points, d'une admirable beauté. Cette féconde contrée produit ou est susceptible de produire tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins matériels et sociaux de l'homme. Il n'est pas de pays peut-être qui eût moins à demander à ses voisins s'il était bien exploit par les peuples qui l'habitent.
Ces peuples appartiennent à des races diverses d'origine et de langage. La plus répandue est la race arabe qui, dans le 7e siècle de notre ère, fit la conquête de ce beau pays sur les faibles empereurs d'Orient. Elle occupe les plaines, et plus les lieux qu'elle habite sont éloignés de la mer, plus elle conserve avec pureté son type originel. Les Arabes que l'on rencontre entre la mer et la première chaîne ont des demeures fixes, ou pour le moins un territoire déterminé. Ceux des plaines sont plus enclins à la vie nomade, qui est l'existence ordinaire des Arabes du sud. Ces derniers, libres et fiers, n'ont jamais complètement courbé la tête sous le joug étranger ; ils ont été quelquefois les alliés, mais jamais véritablement les sujets des Turcs. Les autres, au contraire, étaient soumis au gouvernement du dey d'Alger, et reconnaissaient l'autorité de kaïds turcs qui leur étaient imposés. Mais il ne faut pas croire cependant que le despotisme oriental pesât sur eux de tout son poids ; les Turcs avaient de grands ménagements pour ces peuples. Il est vrai que de temps à autres, lorsque le Gouvernement avait trop à se plaindre d'une tribu, une expédition de guerre était dirigée contre elle, et que le châtiment était alors prompt et terrible ; mais, dans les rapports ordinaires et journaliers, le joug se faisait peu sentir. Cependant les peuplades les plus rapprochées des villes, qui étaient naturellement les centres d'action des Turcs, avaient bien quelques avanies à supporter.
Après les Arabes, viennent les Kbaïles que l'on regarde, en général, comme les descendants des anciens Numides. Pour moi, je ne pense pas qu'on doive leur donner cette seule origine. Je suis disposé à les considérer comme le résidu et le mélange de toutes les races qui ont successivement résisté aux invasions punique, romaine, vandale, grecque et arabe. Leur organisation physique se prête à cette supposition, car ils n'ont pas de type bien déterminé; les traits caractéristiques des races du midi s'y trouvent à côté de ceux des races du nord. Il existe même une tribu kbaïle qui, par tradition, a conservé le souvenir d'une origine européenne.
Le nom de Berbères, que dans plusieurs ouvrages on donne aux Kbailes, n'est point connu dans la régence d'Alger. Il n'est employé que dans la partie de la Barbarie qui touche à l'Egypte.
Les Kbaïles habitent les montagnes, où ils jouissent de la plus grande somme de liberté qu'il soit donné à l'homme de posséder. Ils sont laborieux et adroits, braves et indomptables, mais point envahissants. Ce que je dis ici des Kbaïles s'applique plus particulièrement à ceux de Bougie, où les montagnes, plus rapprochées et plus épaisses, ont offert un asile plus sûr aux restes des anciennes populations. C'est là qu'ils forment véritablement une nation que ni les Arabes ni les Turcs n'ont pu entamer. Ailleurs ils ne présentent que des agglomérations d'individus, tantôt soumis tantôt rebelles à la race dominante.
On donne en général la dénomination de Maures aux habitants des villes. Les Maures ont été les premiers habitants connus de la partie occidentale de la Barbarie. Quelques auteurs croient que leur origine, qui se perd du reste dans la nuit des temps, remonte aux Arabes. On sait que, dans les siècles les plus reculés, ceux-ci envahirent l'Égypte, et l'occupèrent en maîtres fort longtemps. Il est possible que de là de nombreux émigrants de cette nation soient venus s'établir dans cette contrée que les Romains ont appelée Mauritanie. Cette supposition est même donnée comme un fait par plusieurs écrivains de l'Orient. Lorsque les Arabes de la génération du grand Mohammed vinrent, deux ou trois mille ans après, conquérir ce même pays, ils s'établirent peu dans les villes, d'où leurs mœurs les éloignaient ; les Maures, au contraire, ainsi que les Gréco-romains qui n'émigrèrent pas, s'y concentrèrent, par cela même qu'ils ne devaient pas y trouver les Arabes; et de là, sans doute, l'habitude de donner le nom de Maures à tous les habitants des villes, quoiqu'à la longue bien des familles arabes se soient mêlées à eux. Malgré ces fusions partielles, les purs Arabes regardent encore avec dédain les Maures habitants des villes, et les mettent dans leur estime très-peu au-dessus des Juifs.
Ces derniers sont très-répandus dans l'Algérie, mais dans les villes seulement. Leur existence est là ce qu'elle est partout.
Les Turcs s'établirent à Alger dans le seizième siècle ; voici à quelle occasion: lorsque le vaste empire des Califes commença à se désorganiser, l'Espagne et l'Afrique s'en séparèrent successivement. Dans cette dernière contrée, la domination arabe se fractionnant encore, deux nouveaux empires se formèrent l'un à Fez et l'autre en Égypte, laissant entre eux un vaste espace où surgirent de petits États indépendants. Alger forma un de ces petits États, où il parait que quelques princes sages firent fleurir l'industrie et l'agriculture, en étant un asile aux Musulmans que les conquêtes des Chrétiens chassaient d'Espagne. Mais après l'entière destruction de la puissance arabe en Espagne, les Espagnols poursuivirent jusqu'en Afrique les restes de leurs anciens conquérants. Ils s'emparèrent d'Oran, de Bougie et d'autres places, et vinrent s'établir sur un rocher situé en mer en face d'Alger. L'émir de cette ville, fatigué de cet importun voisinage, appela à son secours le fameux renégat Haroudj Barberousse. Mais un allié trop puissant est souvent pire qu'un ennemi déclaré; l'émir mourut assassiné, et Barberousse s'empara du pouvoir. Après sa mort, son frère Khair-Eddine fut nommé pacha d'Alger par la Porte Ottomane, et ce pays fit dès lors partie du vaste empire des Turcs ; mais Khair-Eddine, quoique satrape du Sultan de Constantinople, fut de fait le fondateur d'un État qui ne tarda pas à devenir indépendant.
Cet État était une république militaire, dont le chef était électif, et dont les membres devaient être Turcs. Les indigènes étaient sujets ou alliés, selon le plus où le moins d'action que les Turcs avaient sur eux; mais ils ne pouvaient exercer aucune fonction politique en dehors de la race à laquelle ils appartenaient. Les fils de Turcs ou Koulouglis étaient considérés, à cet égard, comme indigènes, et ne pouvaient, en conséquence, prétendre à aucun emploi gouvernemental. La république, qui n'était qu'un corps de troupe, se perpétuait par le recrutement qui se faisait à Constantinople, et surtout à Smyrne. Tout individu turc transporté de cette manière à Alger devenait membre de l'État, et pouvait parvenir à la position la plus élevée.
La milice turque était divisée en compagnies ou odas commandées par des officiers supérieurs appelés boulcabachys, ayant sous leurs ordres un certain nombre d'officiers subalternes. Les règles de l'avancement étaient établies de manière à assurer les droits de l'ancienneté, sans nuire à ceux du mérite. Les membres de la milice recevaient par jour deux livres de pain, et une modique solde qui variait selon l'ancienneté, mais dont le maximum ne dépassait pas 30 cent. par jour. C'étaient là de faibles moyens d'existence; mais comme ils pouvaient disposer de leur temps et de leurs actions, lorsqu'ils n'étaient pas de service, il leur était facile de s'en créer d'autres en se livrant à divers genres d'industrie. Les jeunes Turcs étaient casernés et soumis à une discipline très-sévère. Ils ne sortaient que le jeudi, sous la surveillance d'un officier; mais après cette sorte de noviciat, rien n'était moins assujettissant que les règlements de la milice turque. Un membre de cette milice pouvait vivre tranquillement au sein de sa famille, se livrer au commerce, ou occuper quelque emploi civil, sans que les exigences de la discipline s'y opposassent. On ne lui demandait autre chose que d'être toujours prêt à marcher lorsqu'il en recevait l'ordre.
L'administration avait beaucoup de condescendance pour les soldats mariés: on les laissait, autant que possible, dans les mêmes garnisons, s'ils le désiraient. et l'on cherchait en tout à améliorer leur position. Beaucoup de Turcs faisaient des fortunes considérables, soit dans les emplois publics, soit par leur industrie, soit par des mariages avec de riches héritières indigènes.
L'obligation du service cessait à l'âge de cinquante ans.
Les Koulouglis étaient admis dans la milice, mais ils ne pouvaient parvenir aux grades élevés. Ils furent traités sur le même pied que les Turcs, jusqu'en 1650. A cette époque une conspiration qu'ils firent pour expulser les Turcs du pays, et qui fut découverte, les fit exclure eux-mêmes de tous les emplois de quelque importance. Ils furent dès lors soumis à une surveillance qui pesait assez durement sur eux; cependant quelques Koulouglis sont parvenus, par exception, aux plus grands emplois : le dernier bey de Constantine était Koulougli.
Le dey et les beys avaient auprès d'eux des soldats, tous Turcs qui formaient leur garde. C'était ce qu'on appelait les janissaires. Ils jouissaient de plusieurs avantages et d'une très-grande considération.
Les forces militaires du Gouvernement algérien ne se bornaient pas à la milice turque : il existait dans les tribus arabes qui lui étaient soumises un certain nombre de cavaliers toujours à sa disposition. Il avait aussi établi sur plusieurs points des espèces de colonies militaires, composées d'aventuriers de toutes les races, dont il tirait un bon service. Nous entrerons plus loin dans des détails assez curieux à ce sujet.
Telle était l'organisation militaire des Turcs.
Voici maintenant leur constitution politique.
La haute direction gouvernementale et le pouvoir législatif appartenaient à un conseil supérieur ou Divan, composé de soixante boulcabachys et des grands fonctionnaires. Ce divan nommait et déposait les deys. La déposition d'un dey était presque toujours suivie de sa mise à mort. La nomination d'un nouveau dey était annoncée par une ambassade à la Porte Ottomane, qui ne manquait jamais de la confirmer, en envoyant à l'élu du divan un firman et un kaftan d'honneur. Dans ces occasions, l'État algérien faisait quelques présents au Sultan, qui les rendait ordinairement en armes et en munitions de guerre. Le titre officiel du dey était celui de pacha; le mot dey était à peine connu à Alger, dans ces derniers temps.
Le dey ou pacha avait le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude ; il l'exerçait au moyen de ses ministres qui étaient:
Le Khasnadji ou ministre des finances et de l'intérieur;
L'Agha ou ministre de la guerre;
Le Khodja-et-Tiril ou ministre des domaines nationaux;
L'Oukil-eI-Hardj ou ministre de la marine et des affaires étrangères ;
Le Makatadji ou chef des secrétaires;
Le Beit-el-Maldji ou procureur aux successions;
Le Cheikh-el-Islam ou Muphti-el-Hanephi, ministre du culte et de la justice.
Le lecteur comprendra facilement qu'en assimilant ces fonctionnaires à ceux qui, parmi nous, sont à la tète des grandes divisions administratives, je n'ai en vue que de lui donner une idée approximative de leurs attributions, et non d'en indiquer les limites d'une manière positive et absolue. Ainsi il ne faudrait pas croire que le kbasnadji, par exemple, fût exactement ce qu'est chez nous le ministre des finances ; la comptabilité générale de l'Etat n'était pas entre ses mains: elle appartenait au makatadji.
L'administration de la justice criminelle n'appartenait qu'au dey, qui l'exerçait ou par lui-même ou par ses ministres; les peines étaient la mort, la mutilation, les travaux publics, la bastonnade et l'amende.
La justice civile était administrée dans chaque grand centre d'administration par deux cadis , l'un dit el-Hanephi pour les Turcs, et l'autre dit el-Haleki pour les indigènes. Les hanephis et les malekis forment deux sectes musulmanes qui diffèrent sur quelques pratiques assez insignifiantes du culte, et sur quelques points de jurisprudence. Du reste, elles vivent en bonne intelligence, et sont loin de s'anathématiser l'une l'autre, comme le font les catholiques et les protestants. Les Turcs sont de la secte des hanephis; les naturels de l'Afrique sont au contraire malekis. Au-dessus des cadis existaient deux muphtis, l'un hanephi et l'autre maleki. Le premier, qui, comme nous l'avons dit, portait le titre de Cheikh-el-Islam ( chef de l'islamisme), était un fort grand personnage; il recevait les appels des jugements rendus par les cadis, dans une Cour appelée le Midjelés qu'il présidait, et qui se composait des deux muphtis, et des deux cadis. Une affaire ci-vile pouvait être portée par les parties, soit à Tunis, soit à Fez, où se trouvent les plus célébrées légistes de l'Afrique.
Le beit-el-maldji, ou procureur aux successions, était chargé de l'ouverture des testaments et de tous les litiges que pouvait en entraîner l'exécution. Il était le représentant né de tous les héritiers absents. Il devait faire rentrer au domaine, après les prélèvements faits pour les pauvres et pour quelques autres dépenses spéciales, les successions vacantes, et la partie des biens qui revenaient à l'Etat dans toutes celles où il n'y avait pas d'héritier mâle direct, partie qui était quelquefois fort considérable. Il était aussi chargé de la police des inhumations. Il avait sous lui un cadi et plusieurs agents.
C'était au moyen de ces divers fonctionnaires que le dey dirigeait les rouages de son gouvernement; mais comme son action ne pouvait s'étendre directement sur les points éloignés, il avait établi dans les provinces des gouverneurs qui, sous le titre de Beys, y exerçaient la souveraineté en son nom. Ces gouverneurs étaient obligés de venir tous les trois ans à Alger rendre compte de leur administration. Les beyliks ou provinces étaient au nombre de trois, Constantine à l'est, Oran à l'ouest, et Titteri au midi. Nous en parlerons successivement, à mesure que notre narration nous y conduira. L'arrondissement d'Alger était directement administré par le dey et ses ministres.
Tel était le gouvernement turc d'Alger dans sa pureté constitutionnelle; mais les formes en furent plus d'une fois altérées par la licence de la milice. L'élection du Dey, au lieu d'être le résultat paisible d'une délibération du divan, n'était le plus souvent que le produit d'une émeute soldatesque. Ce conseil lui-même n'existait plus que de nom, lorsque nous nous emparâmes d'Alger. Hussein pacha, qui ne l'a pas appelé une seule fois dans toute la durée de son règne, ne lui avait laissé que des attributions tout à fait insignifiantes; de sorte que les principes fondamentaux de ce gouvernement étaient en pleine dissolution, lorsque la domination turque s'écroula sous les coups des Français.
La facilité avec laquelle elle s'établit dans le nord de l'Afrique n'a rien qui doive étonner, si l'on se reporte à l'époque où elle prit naissance; c'était dans un temps où les malheurs des Maures d'Espagne avaient porté à son comble la haine du nom chrétien. Les Turcs se présentèrent comme les vengeurs de l'Islamisme, ce qui, joint à la gloire dont brillait alors l'empire des Osmanlis, dut les faire accueillir plutôt comme des protecteurs que comme des maîtres incommodes. Leurs premiers succès contre les Chrétiens, le système de piraterie qu'ils organisèrent avec autant d'audace que de bonheur, justifièrent la bonne opinion que les indigènes avaient conçue d'eux, et leur domination s'établit sur la double base de la reconnaissance et de l'estime. La dignité de leurs manières, la régularité de leur conduite, imprimèrent à tous les esprits un sentiment si profond de leur supériorité, que chacun les considérait comme nés pour commander. Aussi, avec sept ou huit mille hommes répandus sur plusieurs points, contenaient-ils dans le devoir de vastes contrées. Lorsque, dans un des livres suivants, nous étudierons leur politique envers les Arabes, nous verrons qu'elle était très-habile pour le maintien de leur autorité, mais déplorable pour la prospérité du pays qu'elle tendait sans cesse à étouffer. Il en sera toujours de même de celle d'un peuple conquérant qui ne cherchera pas à se mêler complètement au peuple conquis. Nous avons vu qu'à Alger, cet esprit d'isolement, qui est dans le caractère des Turcs, était poussé si loin, qu'ils regardaient leurs propres enfants tomme étrangers, parce qu'ils naissaient de mères indigènes. Au reste, ils avaient su ménager à toutes les ambitions un peu actives un débouché qui, tout en les éloignant des hautes fonctions politiques, pouvait, jusqu'à un certain point, les satisfaire, car il était en même temps le chemin de la fortune; je veux parler de ces bâtiments armés en course, qui furent pendant si longtemps la terreur de la Chrétienté, et au commandement desquels chacun pouvait prétendre selon sa valeur, son habileté, et la confiance qu'il inspirait aux armateurs.
La marine offrait à tous les indigènes, sans exception, des chances d'avancement que leur refusait la milice. Raïs-Hamida, qui commandait la flotte algérienne en 1815, était kbaïle.
Quoique les corsaires algériens fussent en général peu scrupuleux, les instructions qu'ils recevaient de leur Gouvernement étaient ordinairement basées sur les principes du droit des gens. Ils ne pouvaient capturer légalement que les bâtiments des nations avec lesquelles la Régence était en guerre. Il est vrai qu'il ne fallait que de bien faibles prétextes pour que le dey d'Alger se déclarât en état de guerre contre les puissances chrétiennes. Il est même arrivé plus d'une fois que, sans en chercher, il commençait les hostilités en avouant qu'il n'avait d'autre motif d'en agir ainsi que le besoin de faire des prises. C'est ainsi que la Régence était parvenue à rendre tributaires plusieurs puissances maritimes, qui, pour se soustraire à ses déprédations, lui payaient des subsides annuels; ce qui n'empêchait pas qu'au moindre sujet de mécontentement, soit réel, soit imaginaire, la guerre ne leur fût déclarée par les Algériens. En principe, le Gouvernement d'Alger regardait la guerre avec les Chrétiens comme son état normal. Il se croyait le droit de les réduire en servitude partout où il les trouvait, et il fallait, pour qu'il s'abstint d'en user, qu'un traité positif lui fit un devoir de respecter ceux de telle ou telle nation. Ainsi, aussitôt après que l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique eut été reconnue, les Algériens attaquèrent leur pavillon, parce qu'aucun traité ne les liait encore à cette nouvelle puissance. Les Américains, tout froissés de la longue et sanglante lutte qu'ils venaient de soutenir contre l'Angleterre, furent obligés d'acheter la paix à prix d'argent ; ils s'engagèrent à payer à la Régence un tribut annuel de 24,000 dollars, et ne s'en affranchirent qu'en 1815.
Les deys d'Alger reçurent, plusieurs fois, d'assez vigoureuses corrections des grandes puissances. Louis XIV, comme tout le monde le sait, fit bombarder trois fois leur capitale, ce qui, joint à l'influence que nous exercions depuis longtemps en Barbarie par nos établissements de La Galle, nous mit dans une fort bonne position à l'égard de la régence d'Alger. En 1815, les Américains envoyèrent contre elle une flotte, qui, chemin faisant, captura plusieurs bâtiments algériens, et qui, s'étant présentée devant Alger dans un moment où rien n'était disposé pour repousser une attaque, arracha au dey Omar pacha, qui régnait alors, un traité avantageux. Enfin, en 1816, une flotte anglaise commandée par lord Exmouth, après un bombardement de neuf heures, força le même Omar pacha à souscrire à la délivrance de tous les esclaves chrétiens qui étaient dans ses États, et à renoncer pour l'avenir au droit abusif de mettre en vente les prisonniers européens. On a dit qu'il aurait été facile à la France et à l'Angleterre de détruire de fond en comble la puissance algérienne; mais qu'elles se bornèrent, dans les deux circonstances que nous venons de citer, à assurer la suprématie de leurs pavillons, voulant d'ailleurs laisser subsister la piraterie algérienne comme un obstacle à la prospérité commerciale des petits États. Je ne sais si ce reproche a jamais été fondé; dans tous les cas, depuis 1830, la France a cessé de le mériter.
L'Espagne, dont la politique cruelle envers les Maures de l'Andalousie avait été cause en grande partie de l'établissement de la piraterie barbaresque, fit aussi des efforts pour la réprimer; mais, en général, ses entreprises ne furent pas heureuses. Tout le monde tonnait les détails de la funeste expédition de Charles-Quint. En 1775, O'Iieilly, Irlandais au service de Charles III, se fit battre par les Algériens avec une armée de débarquement de plus de 50,000 hommes. En 1785 et en 1784, quelques tentatives de bombardement furent dirigées contre Alger; mais elles furent sans résultat. En 1785, la paix fut rétablie, entre les deux puissances, à des conditions qui augmentèrent prodigieusement l'insolence des Algériens.
L'expédition de lord Exmouth, en 1816, rabattit un peu leur orgueil; mais, Omar pacha, qui était un prince actif et habile, répara leurs pertes avec tant de rapidité que, deux ans après, ils purent braver une flotte combinée anglaise et française, qui vint les sommer, au nom du congrès d'Aix-la-Chapelle, de s'abstenir, à l'avenir, de toute hostilité contre les États chrétiens. Cette bravade n'ayant pas été punie, ils oublièrent bien vite l'humiliation de 1816 ; quelques succès qu'obtinrent leurs navires dans la guerre de l'insurrection de la Grèce accrurent encore leur orgueil, qu'ils poussèrent jusqu'à insulter à deux reprises différentes le pavillon du Grand-Seigneur leur suzerain. Mais ce fut principalement contre la France qu'ils dirigèrent leurs outrages.
Le traité qui, en 1817, nous remit en jouissance de nos possessions de La Calle et du monopole de la pèche du corail, stipulait une redevance de 60,000 fr. ; trois ans après elle fut arbitrairement portée à 200,000 fr., et pour prévenir la perte totale de nos établissements nous fûmes obligés d'en passer par ce que voulut le Gouvernement d'Alger.
En 1818, un brick français fut pillé par les habitants de Bône, et nous ne pûmes obtenir aucune espèce de réparation.
En 1825, la maison de l'agent consulaire de France à Bône fut violée par les autorités algériennes, sous prétexte de contrebande ; quoique le résultat de la visite eût prouvé la fausseté de l'accusation, le Dey ne donna aucune satisfaction de cette offense.
Des bâtiments romains, portant pavillon français en vertu de la protection accordée au Saint-Siége par la France, furent capturés, et des marchandises françaises furent saisis à bord de bâtiments espagnols, malgré la teneur des traités existant avec la Régence, qui établissaient que le pavillon français couvrait la marchandise, et que la marchandise française était inviolable sous quelque pavillon qu'elle fût.
Enfin, 1827, une insulte grossière faite à M. Deval, notre consul à Alger, par le dey Hussein pacha, vint mettre le comble aux outrages que nous avions reçus du Gouvernement algérien : voici comment elle fut amenée.
Deux riches négociants juifs d'Alger, les sieurs Busnack et Bacri, avaient fourni à la France, lorsqu'elle était constituée en république, une quantité considérable de blé, et devinrent créanciers de l'État pour une assez forte somme. Les embarras financiers dans lesquels se trouva longtemps la France, firent ajourner la liquidation de cette créance. En 1816 seulement, une commission fut nommée pour cet objet : la somme due, y compris les intérêts, fut reconnue s'élever à 14 millions; mais, par suite d'une transaction qui eut lieu le 28 octobre 1819, elle fut réduite à 7 millions, et il fut stipulé que les créanciers que Bacri pouvait avoir en France seraient appelés à la discuter. En vertu de cette convention, plusieurs paiements furent faits en France aux créanciers français de Bacri. Mais ce Juif en avait d'autres en Afrique, dont le principal était le Gouvernement algérien lui-même, qui lui avait vendu des laines et autres objets. Le Dey, qui s'était habitué à considérer la créance de Bacri sur la France comme le meilleur gage de celle de son Gouvernement sur ce négociant, fut contrarié de voir ce gage diminuer chaque jour par les paiements opérés au profit des créanciers français. Il crut, ou affecta de croire, que tous n'avaient pas eu lieu de bonne foi. Cette opinion a été partagée par d'autres personnes en France comme en Afrique. Il était donc possible que les nombreuses réclamations, que le Dey éleva contre le mode de liquidation de la créance Bacri, ne fussent pas sans fondement. Comme ce prince voyait que bien des intrigues particulières étaient mêlées à cette affaire, il crut devoir en écrire directement au Roi de France, pensant que de cette manière il pourrait la ramener sur un autre terrain. Sa lettre resta sans réponse. Sur ces entrefaites le consul de France s'étant présenté chez lui, selon l'usage, à l'occasion de la fête du Beiram, le Dey lui demanda quelle était la cause de ce silence. M. Deval répondit par une phrase dont le sens était qu'il n'était pas de la dignité d'un roi de France d'entrer en correspondance avec un dey d'Alger sur une pareille matière. Il y avait mille manière de dire la chose; mais il paraît que M. Deval choisit la plus offensante pour le Dey.
Ce prince, quoique circonspect et poli, ne put maîtriser un mouvement de colère, et il frappa M. Deval d'un chasse-mouches en plumes de paon qu'il avait à la main. Pour son malheur, il accompagna cette action de propos injurieux pour le Roi de France, et qui étaient de nature à ne pouvoir être tolérés, quand même notre Gouvernement aurait été disposé à passer sous silence l'insulte faite au consul, en considération de la provocation déplacée de cet agent.
M. de Villèle était alors à la tête des affaires de notre pays. Ses ennemis, qui étaient nombreux, lui reprochaient avec raison une politique corruptrice dans l'intérieur, et sans dignité au dehors. Il crut voir dans l'outrage que venait de nous faire le Dey d'Alger un moyen de déployer de la fermeté diplomatique sans danger, et de s'attirer sous ce rapport un peu de considération. En conséquence, il fit sonner bien haut les torts du Dey d'Alger, et il annonça que le Roi saurait en tirer une éclatante vengeance. Il s'était persuadé qu'il suffirait de quelques menaces pour intimider Hussein pacha; ses espérances furent déçues; alors, au lieu de se déterminer à frapper fort, il ne prit qu'une demi-mesure: le blocus du port fut ordonné; le Dey se moqua du blocus comme il s'était moqué des menaces. Aussi cette affaire, sont M. de Villèle comptait profiter pour ramener à lui l'opinion publique, ne servit qu'à la lui aliéner encore l'avantage. On crut y voir l'influence de l'Angleterre, et la haine et le mépris qu'il inspirait s'en accrurent. Il tomba; une administration sage, mais trop faible pour les graves circonstances dans lesquelles se trouvait la France, prit sa place. Ce nouveau ministère, qui, à l'intérieur, déplut à la cour, sans satisfaire pleinement l'opinion publique, se conduisit dans sa politique extérieure avec peu d'habileté. Le blocus d'Alger fut continué, et l'on remit à un autre temps l'emploi des seuls moyens qui pouvaient amener la soumission entière des barbares.
Il était réservé au ministère présidé par le prince de Polignac de prendre un parti décisif dans cette affaire. On a dit qu'il y fut surtout poussé par la pensée de donner un certain éclat guerrier à la couronne dans un moment où celle-ci songeait à accroître ses prérogatives en s'appuyant plus sur la force que sur le droit; mais les Algériens, en tirant sur un bâtiment parlementaire, avaient tellement augmenté Ies motifs avouables que l'on avait de porter les choses à l'extrême contre eux, qu'il n'est peut-être pas nécessaire de chercher des causes secrètes à une conduite qui s'explique d'elle-même. D'ailleurs, ce ne fut pas de prime-abord que le Gouvernement royal se décida à envoyer une expédition à Alger : il avait un instant pensé à faire occuper les trois régences d'Alger, de Tunis et Tripoli, par le pacha d'Egypte, dont le Gouvernement aurait offert à l'Europe plus de garantie que ce-lui des puissances barbaresques. Méhémet Ali, à qui de forts subsides étaient offerts, prêta d'abord l'oreille aux propositions de la France; mais, intimidé par les menaces de l'Angleterre, qui se jeta à travers cette négociation, il finit par refuser. Ce fut alors que le cabinet français se détermina à agir lui-même. Dès que sa résolution fut connue, elle excita dans celui de Londres un de ces accès de fureur diplomatique, où la jalousie en délire et la crudité de l'égoïsme breton poussent jusqu'à l'absurde l'énormité des exigences : on voulait arracher à la France la promesse qu'elle ne formerait point d'établissement à Alger, et l'on n'épargna pas pour l'obtenir les insinuations menaçantes. M. de Polignac repoussa ces insolentes prétentions, et poursuivit son entreprise sans s'embarrasser des menaces. Une attitude vis-à-vis de l'Angleterre fut en tout noble et convenable. Cette puissance affectait surtout de vouloir défendre l'intégrité de l'Empire turc, dont Alger faisait nominalement partie; mais la Porte prit la chose bien moins à cœur, et déclara à notre ambassadeur que, sans approuver ouvertement l'entreprise, elle n'entendait y mettre aucun obstacle, soit diplomatique, soit réel. Il ne restait plus à l'Angleterre, battue sur le terrain des négociations, qu'à tirer le canon, mais elle ne le tira pas.
A peine la résolution prise par le Gouvernement fut-elle connue du public, que les journaux, qui jusqu'alors s'étaient plaints de la mollesse avec laquelle cette affaire avait été conduite, commencèrent à déclamer contre l'expédition qui se préparait. Ils en exagéraient les dangers à l'envi l'un de l'autre, et en niaient la nécessité. Cette insigne mauvaise foi fait peu d'honneur aux publicistes de celte époque.
La saine partie du public vit les choses sous leur véritable point de vue. Comme l'expédition en elle-même était commandée par l'honneur national, qu'elle pouvait être utile pour le commerce et glorieuse pour nos armes, les hommes impartiaux y applaudirent généralement, tout en se préparant à combattre à outrance l'administration qui la dirigeait, si les droits de la France venaient à être attaqués. Le choix que l'on fit du comte de Bourmont pour commander cette expédition était fâcheux. Des souverains peu honorables s'attachaient au nom de ce général. Néanmoins les vœux de la France l'accompagnèrent; car la nation comprit que son plus puissant intérêt est que l'étendard de la France, déployé contre l'étranger, sorte victorieux de la lutte, quelle qu'en soit la couleur, quelle que soit la main qui le porte.
M. de Bourmont, qui faisait de cette guerre une affaire tout à fait personnelle, ne négligea rien pour s'assurer du succès. Une commission, présidée par le général Loverdo, fut chargée de réunir tous les documents existants sur Alger. Le commandement du génie et celui de l'artillerie furent confiés à des hommes habiles. Le premier échut au général Valazé, dont les talents étaient incontestables, et dont la brillante valeur fut la moindre qualité; le second fut donné au général Lahitte, officier du plus haut mérite sous tous les rapports.
Le choix des officiers généraux d'infanterie fut également bon en général. Cependant quelques-uns furent imposés à M. de Bourmont par des intrigues et des exigences de cour.
L'infanterie se composa de trois divisions, de trois brigades chacune. Chaque brigade était composée de deux régiments, et chaque régiment de deux bataillons.
La première division était commandée par le lieutenant général Berthezène. La première brigade de cette division, commandée par le maréchal de camp Poret de Morvan, était composée du premier régiment de marche, formé des 2ème et 4ème léger, et du 3ème de ligne; la deuxième brigade, commandée par le maréchal de camp Achard, était composée du 14ème et du 37ème de ligne; la troisième brigade, composée des 20ème et 28ème de ligne, était sous les ordres du maréchal de camp Clouet.
La deuxième division avait pour chef le lieutenant général Loverdo. La première brigade de cette division, composée du 6ème et du 49ème de ligne, était commandée par le maréchal de camp Denis de Damrémont ; la deuxième brigade, formée du 15ème et du 40ème de ligne, était sous les ordres du maréchal de camp Munch d'Uzer ; la troisième brigade, formée du 21ème et du 29ème de ligne, était commandée par le maréchal de camp Colomb d'Arcine.
La troisième division avait à sa tète le duc d'Escars. La première brigade de cette division, composée du 2ème régiment de marche, formé lui-même du 1er et du 9ème léger, et du 55ème de ligne, avait pour général le maréchal de camp Berthier de Sauvigny ; la deuxième brigade était commandée par le maréchal de camp Hurel, et composée du 17ème et du 50ème de ligne ; la troisième brigade, composée du 25ème et du 24ème de ligne, était sous les ordres du maréchal de camp Montlivault.
Les deux régiments de marche n'avaient chacun qu'un bataillon de chacun des régiments qui avaient concouru à leur formation.
Les bataillons étaient à huit compagnies de 94 hommes, non compris les officiers ; les compagnies d'élite avaient été portées à 120 hommes ; ainsi, la force de chaque division était de 10,000 hommes environ.
Deux escadrons du 17ème de chasseurs et un du 15ème régiment de la même arme composaient toute la cavalerie. Ces trois escadrons, réunis sous la dénomination de chasseurs d'Afrique, présentaient un effectif de 500 chevaux, commandés par le colonel Bontemps du Barry.
Les troupes de l'artillerie se composaient de quatre batteries montées, dix batteries non montées, une batterie de montagne, une compagnie d'ouvriers, une de pontonniers, quatre du train des parcs. La force totale de l'artillerie était de 2,268 hommes (non compris les officiers), et 1,380 chevaux.
Les troupes du génie consistaient en deux compagnies de mineurs, six de sapeurs, et une demi-compagnie du train, et présentait une force totale de 1.260 hommes et 118 chevaux.
L'état-major se composait d'un lieutenant général chef d'état-major général, d'un maréchal de camp sous-chef d'état-major, de trois colonels chefs des états-majors divisionnaires, de trente-quatre aides de camp de tout grade, de vingt-huit officiers employés à l'état-major général et aux états-majors divisionnaires, un commandant du quartier général, un vaguemestre général et trois ingénieurs géographes.
L'état-major de l'artillerie se composait ainsi qu'il suit : un maréchal de camp commandant l'artillerie, un colonel chef d'état-major, un directeur du parc, deux aides de camp, sept chefs de bataillon, six capitaines, quatorze gardes.
L'état-major du génie comprenait : un maréchal de camp commandant le génie, un lieutenant-colonel chef d'état-major, un chef de bataillon directeur du parc, un aide de camp, deux chefs de bataillon, quinze capitaines, trois lieutenants, sept gardes.
Le nombre des combattants s'élevait en tout à 344.181 hommes (officiers compris).
Le personnel non combattant se composait ainsi qu'il suit : un intendant en chef, dix-huit sous-intendants ou adjoints ; un payeur général, quatre payeurs particuliers (un au quartier général et un dans chaque division) ; un médecin en chef et un médecin principal, un chirurgien en chef et un chirurgien principal, un pharmacien en chef et un pharmacien principal, douze médecins de différents grades, cent cinquante chirurgiens, quatre-vingt-treize pharmaciens: en:tout, deux cent soixante et onze officiers de santé, non compris ceux des régiments; quatre-vingt-trois employés aux vivres et fourrages, vingt-trois aux hôpitaux, dix-huit au
Campement; un commandant des équipages, deux brigades de mulets de bât de 394 hommes et 656 mulets; une compagnie du train d'administration conduisant 128 caissons à deux roues, forte de 195 hommes et de 515 chevaux ; une autre compagnie forte de 9.08 hommes et de 518 chevaux, conduisant 199 caissons à quatre roues; une demi compagnie, provisoire du train d'administration, forte de 28 hommes et de 34 chevaux; un bataillon d'ouvriers d'administration, fort de 780 hommes ; quarante guides et interprètes ; enfin un grand-prévôt et 123 gendarmes tant à pied qu'à cheval : en tout, 5.389 individus non combattants.
Le nombre des chevaux et mulets s'élevait à 3.423, non compris ceux des officiers.
L'armée traînait à sa suite un immense matériel. Celui de l'artillerie était composé ainsi qu'il suit:
Pièces de 21 ……………………30
Pièces de 16 ……………………20
Pièces de 12 ……………………12
Mortiers de 10 pouces …………..8
Obusiers de 8 pouces …………11
Total …………………………... 81 bouches à feu.
Les canons étaient approvisionnés à mille coups, les mortiers à trois cents et les obusiers à huit cents.
ARTILLERIE Pièces de 8 16
De Obusiers de 24 8
CAMPAGNE. Obusiers de montagne.. 6
TOTAL. . . . 30 bouches à feu.
Les canons et obusiers de campagne étaient approvisionnés à cinq cents coups; les obusiers de montagne l'étaient à deux cents cours. Quarante-six mulets suffisaient pour porter les six pièces de montagne, leurs affûts et leur approvisionnement.
On avait, de plus, cent cinquante fusils de rempart, approvisionnés à trois cents coups, deux mille fusils de rechange pour l'infanterie, et un grand nombre de fusées incendiaires. L'approvisionnement en cartouches était de 5,000,000.
Il y avait en tout 556 voitures d'artillerie, affûts, caissons, forges, etc., etc.
Le matériel du génie comprenait 6 blockhaus à deux étages, 600 lances pour former des chevaux de frise portatifs, 190.000 piquets, 5,000 palissades, plusieurs milliers de fagots pour gabions et saucissons, 506,000 sacs à terre (tout cela pour les travaux du siége dans un pays où l'on craignait de manquer de bois); 9.7,000 outils de pionniers; enfin, du fer et de l'acier non travaillés pour les besoins imprévus : 26 caissons étaient destinés au transport des outils et des objets les plus indispensables.
Les approvisionnements en vivres et fourrages avaient le largement calculés et disposés de manière à présenter le moins de volume possible, et à pouvoir être à l'abri le toute détérioration. Le biscuit fut mis dans des caisses recouvertes d'une forte toile goudronnée ; le foin fut dressé par des machines destinées à cet usage, et connues depuis peu en France, quoiqu'elles le soient depuis longtemps en Angleterre.
Des fours en tôle furent mis à la suite de l'armée, afin de remplacer, le plus tôt possible, le biscuit par le pain. On embarqua plus de mille bœufs, et du vin en grande quantité. Enfin, rien ne fut négligé pour assurer le bien-être du soldat dans un pays que l'on présumait ne devoir offrir aucune ressource.
Les divers corps qui devaient composer l'armée se réunirent, pendant le mois d'avril, dans les départements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Var. La flotte, qui devait la transporter en Afrique, se rassemblait en même temps dans les ports de Marseille et de Toulon. M. de Bourmont arriva dans cette dernière ville le 27 avril, et y établit son quartier général ; celui de la division Berthezène s'y trouvait également; le quartier général de la deuxième division fut établi à Marseille ; et celui de la troisième à Aix.
Pendant le temps qui s'écoula depuis la réunion de l'armée jusqu'à son départ, les troupes furent exercées aux grandes manœuvres, et surtout à la formation des carrés. La première division fut exercée, en outre, aux opérations du débarquement; des chalands ou bateaux plats étaient destinés à cet usage. Il y en avait pour toutes les armes. Ceux qui étaient destinés à l'artillerie de siége pouvaient porter des pièces démontées. Les canons étaient placés transversalement sur de grosses poutres fixées dans le sens de la longueur, à un pied au-dessus du fond du chaland. Ceux qui étaient destinés à l'artillerie de campagne pouvaient contenir deux pièces sur leurs affûts, avec les canonniers nécessaires. Chaque pièce portait sur trois coulisses, une pour la queue du flasque, et les deux autres pour Ies roues. Ces coulisses étaient légèrement inclinées pour atténuer l'effet du recul; de cette manière, les pièces pouvaient tirer du chaland même, et protéger le débarquement des troupes. Les chalands destinés aux troupes pouvaient contenir chacun 16 chevaux ou 130 hommes. Les plats-bords de l'avant et de l'arrière de tous ces bateaux s'abaissaient à la manière des ponts-levis, soit pour passer d'un bateau à l'autre, soit pour débarquer.
On fit plusieurs essais de débarquement à Toulon, et tous eurent les plus heureux résultats. Le 2 mai, quatre chalands, remorqués par des canots, se dirigèrent du côté de la grosse tour, à l'entrée de la rade ; lorsque les canots manquèrent d'eau, les marins se jetèrent à la mer et remorquèrent eux-mêmes les chalands jusqu'à ce qu'ils touchassent. Le premier chaland était chargé de pièces de siége, le deuxième de deux pièces de campagne et d'un obusier de montagne, le troisième portait des sapeurs armés de ces sortes de lances dont nous avons parlé plus haut, le quatrième était chargé de soldats d'infanterie. En moins de cinq minutes, depuis le moment où les chalands eurent touché, l'artillerie de campagne et l'infanterie furent à terre. En moins d'un quart d'heure, les pièces de siége furent roulées sur la plage, un espace d'environ cinq cents mètres de pourtour fut entouré des lances des sapeurs, et l'infanterie, placée derrière ce retranchement mobile, eut commencé son feu.
Ce retranchement consistait en une ligue de faisceaux de trois lances, semblables à ceux que forment les troupes avec leurs fusils; les trois lances de chaque faisceau étaient liées par une courroie ; un long câble passant dans des anneaux unissait tout le système.
A tous ces préparatifs belliqueux que nous venons de décrire, on crut devoir joindre les secours de la diplomatie. Des négociations furent entamées avec Tunis et avec Maroc. M. de Lesseps, notre consul à Tunis, fut chargé de sonder les dispositions du bey de Constantine, et de lui faire entendre que, loin de soutenir le dey d'Alger dans sa guerre contre la France, il devait profiter de la circonstance pour se rendre indépendant.
Mrs. Girardin et d'Aubignosc, qui avaient déjà rempli des missions au Sénégal et dans le Levant, furent envoyés à Tunis vers la fin de mars ; ils en revinrent le 2 mai, et firent connaitre que le chef de cette Régence était dans des dispositions favorables, mais qu'il désirait ne point choquer les préjugés religieux de ses sujets en se déclarant trop ouvertement pour nous. On apprit en même temps que le bey de Constantine devait partir pour Alger le 20 ou le 25 mai. On pensa que si l'on ne pouvait empêcher ce voyage, il fallait du moins tacher de le prévenir, et cette circonstance fit hâter le départ, quoique tous les navires de l'expédition ne fussent pas encore réunis. On en attendait quelques-uns qui devaient venir des ports de l'Océan. On se décida à partir sans eux, et même à laisser à Toulon les troupes qu'ils devaient porter; mais ils arrivèrent avant que l'embarquement fût terminé.
M. Girardin repartit pour Tunis le 11 mai. Il était porteur d'une lettre qu'il devait faire tenir au bey de Constantine, dans le cas où celui-ci ne serait point encore en route pour Alger. Un commis du munitionnaire général partit avec M. Girardin pour aller faire des achats de bestiaux à Tabarka.
L'embarquement du matériel s'était opéré dans le courant du mois d'avril, et dans les premiers jours du !vois de mai; celui des troupes commença le 11 mai, et ne fut terminé que le 18, le mauvais temps l'ayant souvent interrompu.
La flotte se composait de 11 vaisseaux, 24 frégates, 14 corvettes, 25 bricks, 9 gabares, 8 bombardes, 4 goélettes, 7 bateaux à vapeur; en tout 100 bâtiments de guerre ; 557 transports nolisés, dont 119 français et 258 étrangers ; une flottille composée de gros bateaux, destinés à servir d'intermédiaires entre les navires et les chalands au moment du débarquement ; 12 chalands pour l'artillerie de siége. 11 pour l'artillerie de campagne et 50 pour les troupes. Ces embarcations, qui n'étaient pas de nature à tenir la mer, furent hissées à bord des gros navires pendant la traversée ; au débarquement, elles devaient être remorquées par les canots. On avait construit, en outre, plus de 50 radeaux de tonneaux, recouverts de poutres et de madriers, qui pouvaient se monter et se démonter en moins de six heures, et porter 70 hommes chacun.
Le vice-amiral Duperré était à la tête de cet armement, le plus considérable qu'eût fait la France depuis longues années. Cet officier général jouissait d'une belle réputation parmi les marins ; les journaux exaltaient son mérite aux dépens de celui de M. de Bourmont, circonstance qui ne contribua pas peu, sans doute, à celte froideur qui exista constamment entre les deux généraux.
L'armée navale fut partagée en trois escadres : la première prit le nom d'escadre de combat, et fut destinée à l'attaque des forts et des batteries, pendant que la seconde, dite escadre de débarquement, mettrait les troupes à terre. La troisième fut celle de réserve.
La première escadre portait la seconde division de l'armée de terre et 450 artilleurs.
La seconde portait la première division, 500 artilleurs et 500 hommes du génie.
La troisième portait six bataillons de la troisième division, beaucoup de matériel, et une partie du personnel de l'artillerie et du génie.
Le convoi était divisé en trois escadrilles; il portait le reste des troupes et du matériel, et tous les chevaux.
Après avoir attendu plus de huit jours un vent favorable, la flotte mit à la voile le 25 mai et sortit majestueusement de la rade de Toulon. Les collines voisines étaient couvertes d'une foule de curieux, accourus de tous les points de la France, pour jouir de ce magnifique spectacle. En voyant cet immense déploiement de la puissance d'un grand peuple, on se sentait heureux d'être Français ; mais en reportant les regards sur notre situation intérieure, on ne pouvait se défendre d'un sentiment de tristesse, bien justifié par les événements qui se préparaient, et dont il n'était donné à personne de prévoir exactement l'issue.
|
|
ANECDOTE
Sur l'Effort Algérien de 1827
|
Terrorisme intellectuel en 1927 ???

NDLR : Remarquez la Torpédo qui était "indispensable" aux colons d'Algérie, alors que la plupart avait la "Torpédo" à deux roues et deux chevaux.
Ce n'était pas la plus chère, ni la plus luxueuse, mais alors à qui était "réservée" l'indispensable Torpédo de Luxe ? Aux "colonisateurs" de France ou d'ailleurs ?
|
|
L'aïeule des Basiliques
L'Effort Algérien N°30 du 15 octobre 1927.
|
Le Figaro, samedi 1927
Il ne s'agit pas ici d'une de ces triomphantes cathédrales, d'un de ces sanctuaires célèbres, qui en même temps que les lieux saints, sont des monuments et des merveilles de l'art qui attirent, avec les pèlerins, les curieux et les amateurs du monde entier : ni Sainte-Sophie de Constantinople, ni Saint-Pierre de Rome, ni Saint-Vital de Ravenne, ni Saint Ambroise de Milan... C'est à une pauvre église d'Algérie que je fais allusion, la basilique de Reparatus, à Orléansville, qui, en dépit de son nom pompeux - du moins pour nos oreilles modernes - n'a jamais été un édifice bien magnifique, mais qui a l'insigne honneur d'être la plus ancienne de toutes les églises chrétiennes connues jusqu'à ce jour.
Cette aïeule, ou cette doyenne de toutes les églises de la chrétienté, est depuis longtemps en ruines, probablement depuis les invasions arabes. L'actuel curé d'Orléansville, M. l'abbé Castéra, après beaucoup d'Africains et en particulier Mgr Dupuch, premier évêque d'Alger, au lendemain de la conquête française, a conçu le généreux projet de relever ce vénérable sanctuaire. Il a intéressé à cette belle entreprise non seulement son archevêque, Mgr Leynaud, le Souverain Pontife lui-même, qui a daigné s'inscrire en tête des souscripteurs pour une somme de 20.000 francs. Et voici qu'il me prie de faire appel à la générosité des lecteurs du Figaro et de leurs amis. Que dis-je ? Il voudrait associer à cette oeuvre de résurrection tout l'univers chrétien et cela pour les raisons que je vais essayer de dire.
Mais ce serait déjà bien beau si je pouvais persuader les catholiques de la France de l'intérêt à la fois national et religieux qu'il y aurait à ne pas laisser périr les derniers vestiges d'un des plus vieux sanctuaires de l'Afrique chrétienne.
Toutes les anciennes églises d'Afrique, même les plus humbles et les plus exiguës, s'appellent des basiliques, en souvenir des basiliques judiciaires dont elles ne sont qu'une adaptation. Que l'imagination ne travaille plus inutilement sur ce mot d'apparat : elle serait déçue. Lorsqu'elle était dans son intégrité la basilique de Reparatus n'offrait rien au voyageur qui pu l'étonner ou l'enchanter.
Aujourd'hui, telle qu'elle se manifeste à nous, elle apparaît comme fort inférieure aux grandes églises carthaginoises, ou à celle de Tigzirt, ou encore à la grande basilique de Théveste, qui forme un ensemble architectural véritablement unique.
Sa seule singularité peut-être, c'est d'avoir deux absides, une à chaque extrémité de la nef. Celle qui est tournée vers l'Orient renfermait l'autel et, selon l'usage, le siège épiscopal. L'autre, la " memor? " de l'évêque Reparatus, dont on a retrouvé, d'ailleurs, sous le pavement, le cercueil en bois de noyer, avec les ossements parfaitement intacts, La " memor? " dans l'ancienne Eglise d'Afrique, était le tombeau ou le reliquaire où l'on conservait soit le corps tout entier, soit une simple parcelle du corps d'un martyr ou d'un pieux personnage: c'est la première ébauche du marabout musulman. Notre basilique contenait, probablement plusieurs " mémoir? ". Dans les terrains avoisinant ses ruines, on a retrouvé, notamment, une grande brique avec cette inscription : " mémoire des apôtres Pierre et Paul. " Et, plus loin, sur une tablette de marbre : aux bienheureux apôtres Pierre et Paul ".
Et, comme la plupart des basiliques africaines, celle de Castrum Tingitanum (le nom romain d'Orléansville) était entièrement pavée en mosaïque. La mosaïque de l'Eglise de Reparatus n'a rien d'extraordinaire, sauf peut-être la décoration de l'abside proprement dite, qui représente des poissons dans un filet, et celle du pavé de l'autel, où l'on voit entrelacés des épis et des pampres chargés de raisins : symboles des espèces eucharistiques...
Peut-être n'a-t-on pas fait suffisamment attention à cette symbolique des premiers siècles chrétiens, surtout dans nos églises africaines. Les symboles eucharistiques sont d'une fréquence qui appelle la réflexion. De toute évidence, on veut rappeler aux fidèles que l'Eucharistie est d'abord une nourriture et un breuvage mystiques, et non une simple commémoration de la Cène.
Enfin, une inscription également en mosaïque rappelle que la première pierre de la basilique fut posée en l'an 325 de l'ère chrétienne : ce qui, au témoignage du célèbre de Rossi, fait de cette obscure église mauritanienne la plus ancienne de l'univers chrétien.
Pour cette raison et quelques autres, la petite basilique de l'évêque Reparatus ne saurait être indifférente au reste de la chrétienté, au moins de la chrétienté occidentale. Protestants el catholiques peuvent fraterniser dans une commune vénération pour cette relique d'un temps ou ils n'étaient pas encore séparés. Certes chaque confession peut interpréter dans un sens différent cette symbolique ou cette épigraphie des premiers siècles chrétiens, ce culte des saints ou des Espèces eucharistiques. Il n'en est pas moins vrai que cette basilique restaurée serait aux yeux des uns et des autres la plus antique et la plus vivante image du Temple où leurs ancêtres spirituels ont commencé à se réunir pour prier.
Rebâtir la basilique de Reparatus, ce serait aussi une façon éclatante et touchante, pour tous les chrétiens occidentaux de témoigner leur reconnaissance à cette Eglise d'Afrique qui a été la mère de leurs églises nationales et qui a rendu de tels services à l'Eglise universelle. Assurément, Rome, à toutes les époques, est toujours restée la chaire spirituelle et le siège de la primauté. Mais pendant plus de deux siècles, l'Afrique a été le pays des grands docteurs et des grands théologiens. Avec, ses Tertullien, ses Cyprien, ses Augustin, elle a été la Lumière et le Foyer religieux de l'Occident. Là était le mouvement, la vie, l'organisation. Le monachisme occidental est sorti des couvents d'Hippone et de Thagaste. J'ajoute qu'au lendemain des invasions barbares, le catholicisme africain a sauvé pour nous les restes de la civilisation gréco-latine. C'est par saint Augustin que te moyen âge a connu Virgile et Platon, et c'est par les derniers grammairiens et métriciens de Carthage qu'une partie de la pédagogie antique s'est transmise aux universités de la nouvelle Europe.
Ces services sont à peu près oubliés. Quelle belle occasion de témoigner que l'oubli n'est qu'apparent en montrant une filiale sollicitude pour un de ces vieux sanctuaires africains, d'où est sortie la civilisation neuve sur laquelle nous vivons encore !
Reconstruire la basilique d'Orléansville ne serait pas une fantaisie d'archéologue. Ce serait payer une dette de gratitude et, en même temps, accomplir un acte de charité, car la basilique reconstruite servirait au culte qui en a grand besoin. Depuis 1840, c'est-à-dire depuis la fondation de la ville moderne par le maréchal Bugeaud, les catholiques d'Orléansville ont pour église " provisoire " une ancienne écurie de gendarmerie.
Cela ne fait pas honneur à la France indépendamment de toute considération confessionnelle. Cela semble prouver que la France officielle n'a aucun souci de sauvegarder les traditions qui peuvent légitimer ou ennoblir sa présence sur le sol africain. Dans quelque temps, on va célébrer le centenaire de la conquête de l'Algérie. Je crois savoir que nos gouvernants, oublieux des raisons qui font de la conquête d'Alger une grande date dans l'histoire de la civilisation - à commencer par la répression d'un révoltant brigandage - oublieux surtout de tout le sang français qui a été versé sur cette terre d'Afrique - veulent considérer dans cette date glorieuse uniquement la libération pour les Barbaresques, du joug ottoman. Je ne sais comment les indigènes algériens vont prendre cette façon hypocrite de colorer notre occupation. Je ne crois pas que ce pauvre expédient puisse diminuer en quoi que ce soit les motifs qu'ils croient avoir de nous haïr, nous et notre domination. Et je ne crois pas davantage que nous puissions les séduire par le mirage d'une prétendue collaboration fraternelle, ou par l'offre d'une civilisation dont ils ne veulent, pas.
Mais je crois qu'il n'est pas indifférent pour notre prestige et aussi pour notre bonne conscience, de nous présenter là-bas comme les héritiers et les continuateurs de la plus ancienne tradition du pays - tradition religieuse, politique, intellectuelle, morale. En particulier, il n'est pas mauvais, ne fût-ce que pour affaiblir la fureur de certains fanatismes, d'apprendre aux Français qui l'ignorent et aux Africains eux-mêmes que l'Afrique a été un des pays les plus chrétiens du monde. Reconstruire la basilique de Reparatus et l'inaugurer au moment du centenaire, en même temps que la basilique de Saint-Augustin de Thagaste - ce serait une magnifique occasion de rappeler des vérités on ne peut plus honorables pour nous.
Louis BERTRAND,
de l'Académie française.
NDLR : Ce texte pourrait, sans problème, s'interpréter à l'heure actuelle au rythme où va la France.
|
LES ŒUVRES DE MUSETTE
LE MARIAGE DE CAGAYOUS
|

CHAPITRE III
A le Concert de Bablouette
Ce soir après manger, j'a été pour voir à mes camarades à la place ousqu'avant y a les Arènes Ça c'est la place du Gouvernement de nous autes, et la rue de la Boudzaria, ça représente les arcades Bab-Azoun. Chaque soir qui fait beau temps, on va par là pour promener et pour rigoler. C'est pourri du monde. Ceuss-là qui fréquentent, y font rendez-vous en côté le marché neuf que c'est plein des endroits bons pour parler. Les autes y marchent dedans la rue de la Boudzaria et un peu par en bas pour broumitcher et caler les palangres, pourquoi y a boucoup des cigarières et pis des bonnes. Y en a qui z' ont la guitare et la mandoline ; y en a rien que la peau.
On s'a fait beaucoup des maisons neuves, grandes, vec le balcon et tout, et chaque y se tient des magasins : un c'est pour I'épicerie et l'aute c'est pour le café. A aucun endroit d'Alger, y a pluss des épiciers et des cafés que à Bablouette. Les coiffeurs aussi y en a des charibotee. Les épiciers, qu'y a rien que à la Cantère, ma parole, on se fait un régiment ! Tous on vend la soubressade, les olives et les botifarros, pourquoi le pays y veut comme ça. Le poivre y commande l'amour et le sel y fait venir vieux, y parlent les anciens. A cause de ça qui mangent les Cantérois, chaque coup que un y s'en va à la cafétéra Y fait le rouski à cause que sa boumarole elle y brûle.
Les cafés c'est bourr du monde quon joue les cartes, le billard et qu'on chante. A le café de la placette, qu'en face y se tient le marchand de la loubia que tous le femmes elles s'en vont sercher la portion dedans le bol, deux sous et quate sous, qu'on fait la queue comme à le tréâte, chaque soir le concert on fait ! Un junhomme petit qui ressembe ç un chien bouledogue, il a la voix ténor qui s'envoye des ut de potrine tant qu'on veut. Tous les opéras y connaît. Quand, y chante, y se pose une main dessur sa figure comme font les marcands des oursins pour que la voix elle sort fort. Moi je me pense que le patron à le café il y fait payer aucun verre à le ténor pour qui vient tout le temps, et que les clients y s'amènent comme les mouches. L'eldorado de Bablouette on se l'appelle à le café, pour ça.
Un aute café il a voulu faire la concurrence à cuilà là en s'embauchant un qui chante la basse vec la guitare ; seurement, à cause qui s'a éclairé la salle vec les lampes du pétrole et que la basse y sembe qui dég.. et qui rote y s'envoye la Juive tout le temps, on s'a f… le camp à peu à peu pour venir vec le ténor qui chante, vec les becs du gaz véritabes, un tas des morceaux joulis et tout.
Dehiors, c'est plein des chaises qu'on s'assit les filles pour faire le goût.
Oilà nous s'amenons dedans le café que je dis moi. Cuilà qu'il a la Calotte jaune, Ugène la louette et gasparette. Moment que je rentre, le ténor y fait un œil vec la Calotte jaune qui se f… à faire un boniment à le public dessur une tabe, qu'on se pisse de rire.
Déjà ti es plein ? j'y dis.
Laisse, ho ! Ce soir y a la surprise, grand gala. Cuiià qu'il est pas content, c'est un c. . On va se chanter une chanson à la mode dessur un mecieu qui va se marier. Ceuss qul z'ont fait cette chanson, c'est des camarades de nous autes qui veut pas quon dit son nom. Assis-toi, bois le café et gare qu'on t'attache pas si jamais tu remues. Défense qu'on bouge. Oilà.
Allez. Félisque y crie La Calotte jaune à le ténor. Donne-z-y de l'orge. Quatorze mesures pour rien. Faisez un peu le silence, Messieurs et Dames. Mecieu Félisque c'est le premier fort tnor lger dimi caractère de le tréâte toyal de Alphonse XIII, de Madrid, que même y s'a chante Viens Poupoule et la Marseillaise en devant M. Loubet et le Pape, la fois qu'on s'a fait le mariage de le fils à le roi de Prusse vec la fille à le roi des Anglais. Mille francs chaque soir on li donne, nourri, couché, habillé, chauffé, blanchi, vec la récommandation qui fait pas le service mélitaire. Chaque note qui sort lui, ça coûte cinq francs la pièce ; un douro, comme on parIe les nouveaux débarqués. Çuilà qui peut s'en attraper une en l'air, on li fait la monnaie à le comptoir. C'est pas défendu qu'on prend l'échelle qui travaillent les peintres pour s'arrêter à les ut de poitrine. Ceuss là qui qui z' ont rien que un oeil bon qu'on li dit borgnes y payent dimi place ; ceuss-là qui sont sourds, on li donne la photographie de l'artisse. Allez, Félisque, les guitares elles sont chaudes, envoyez-y à tous ces aristos le morceau vec ta bouche !
Après, Çuilà a la Calotte jaune, y s'a assit en m'arrégardant comme un qui s'arrait ch… un formage d'Hollande sans respirer, sérieux, hein.
Le monde, dehiors, on se bouchait les portes : des hommes, des femmes, des gens, de tout.
OiIà le ténor Félisque y se met debout, y se suye la bouche, et y s'annonce ça :
LA MATTCHICHE DE CAGAYOUS
1er COUPLET
Quand Cagayous y trape
Un sacatrape
Qui veut li fair' la peau
Vec le couteau,
Il y fout deux castagnes,
Sans faire des magnes;
Il sert un asting, il y colle un atout
Qu'il est antitout !
C'est pas pour sanger
Que Cagayous y vient Alger..
REFRAIN
Y reste à la Cantère,
Fant de sa mère !
Le roi des fourachaux
Et des patchos,
Aucun y peut li mettre
Un centimètre ;
Y voit clair dans son dos,
Sans la sousto.
Taïba, gousto !
C'est un typ' rigolo ;
Le pluss costo ;
Après lui, c'est ouallo !
2ème COUPLET
Y mange des patates douces
Et des tramousses
Du riz, des escargots,
Des z'haricots ;
Des rougets de la roche,
De la bidoche.
Comme un homme naturel, y garnit sa pantcha
De tout ça qu'y a..
Alors pour… chauffer
Vous croyez qui faut pas bouffer ?
REFRAIN
3ème COUPLET
S'y march' vec un' chiquette,
Viv' l'anisette !
S'y march' vec la vicente,
Un verr' l'absinthe !
Si l'amour il a pas sous le lit le tonneau.
C'est macach' bono !
Faut s'rincer l'garga
Si vous voulez pas fair' figa.
REFRAIN
4ème COUPLET
C'est fini le collage ;
Du mariage
Y s'a venu le goût
Aï qué sal' coup !
Y restera par force
Jusqu'à le divorce.
Arrégardez-moi ça si c'est pas malheureux
Qui se sang' de jeu !
S'il est pas foutu,
Ma parol' nous tombons de... (dos)
REFRAIN
Tout le monde on se chantait ensemble à le réfrain. Ça fallu que Félisque y récommence tout pour qu'on se l'apprend bien. Et après, vinga de taper les mains dedans le café et dehiors la rue.
Moi, pour pas faire voir que le manche y me tient, j'a fait semblant rigoler. Mais, quand même, ça me fait marronner qu'on parle que je vais me marier, pourquoi aucun y le sait. Sûr que cette chanson c'est Bacora qui se la sortie avec Çuilà qu'il a la Calotte jaune que d'un peu je me le calfe en sortant dehiors à rapport qui se fait tout le temps le rassemblement vec la blague de chouarri qui se tient.
A présent, tous, à Bablouette, on se chante cette chanson rédicule. Manque plus que Méva Jésus-Christ qui bouffe les papas-carottes y se la chante en se levant sa kchabia qu'il a pas même le caneçon par en Dessous !
Pantience.
(A suivre......)
|
|
Histoire de Bône
Envoyé par M. Graille
|
|
Par René Bouyac
Contrôleur civil suppléant
Interprète militaire hors cadre
Membre correspondant
de l’Académie d’Hippone.
Edition 1891
Deuxième partie
Bône depuis 1830.
(Extraits)
Prise d'Alger en 1830. - Expédition du général Damrémont
Et première occupation de Bône. - Abandon de Bône.
Le 5 Juillet 1830, Alger ouvrait ses portes au maréchal de Bourmont. La piraterie, cette odieuse institution qui, durant trois siècles, avait courbé le monde chrétien sous le joug de l'épouvante et de la honte, était anéantie. La France venait enfin d'arborer son drapeau victorieux sur le repaire des redoutables forbans qui, fiers de leurs longue impunité, n'avaient pas craint d'insulter notre représentant. La marine, à qui revenait en cette occasion une large part de gloire, n'avait pas encore terminé sa mission, et l'amiral Duperré reçut l'ordre d'envoyer une division navale devant Tripoli pour imposer au bey de cette ville l'obligation de ne plus armer de corsaires, d'interdire l'esclavage des chrétiens dans ses Etats et, enfin de donner réparation d'une insulte dont le consul de France avait été victime au mois de Septembre 1829.
L'impression produite dans le monde musulman par la chute d'Alger avait été profonde. A peine la nouvelle du succès de nos armées était-elle parvenue en France que de nombreuses sollicitations assaillirent le gouvernement en vue d'obtenir le rétablissement des pêcheries de corail et des comptoirs de commerce de la Calle et de Bône, ruinés au moment de la rupture de nos relations avec la Régence d'Alger. L'ancien agent de la Compagnie d'Afrique, Raimbert auquel un long séjour à Bône et une connaissance approfondie des mœurs et de la langue du pays permettaient de fournir de précieux renseignements, s'efforçait de faire valoir les sérieux avantages que procurerait au commerce français l'occupation de nos anciens établissements. Un traité conclu le 8 Août avec la Régence de Tunis vint donner un commencement de satisfaction aux solliciteurs.
Raimbert avait été, en 1795, agent au comptoir de Collo pour le compte de la Compagnie d'Afrique dont le siège était à la Calle. Forcé de fuir avec tout le personnel pour éviter la captivité, il se retira à Marseille. Mais il n'avait pas abandonné l'espoir de revenir en Afrique. Aussi accourut-il avec joie dès les premiers jours de la conquête se mettre à la disposition du général en chef. Il obtint de précéder l'expédition du commandant Huder à Bône où il avait laissé d'excellents souvenirs. Son influence eut une grande part dans l'accueil sympathique qui fut fait au commandant de l'expédition. Raimbert fut ensuite admis dans le corps des interprètes militaires et ne consentit à prendre sa retraite dignement acquise qu'à l'âge de soixante-treize ans.
" Le bey de Tunis restituait à la France le droit de pêcher exclusivement le corail depuis la limite des possessions françaises jusqu'au Cap Nègre, ainsi qu'elle le possédait avant la guerre de 1799. La France n'avait à payer aucune redevance pour la jouissance ce droit ".
Bône, à notre arrivée en Afrique, bien que déchue de son ancienne prospérité, n'en était pas moins le seul port de la province de Constantine ouvert au commerce européen ; c'est là que venaient s'entasser les riches produits de l'intérieur, les cuirs, les laines et surtout les grains qui, tant de fois, avaient sauvé de la famine les populations méridionales de la France. L'Europe y apportait ses marchandises et principalement les armes et munitions nécessaires aux troupes des beys et aux contingents des tribus. Bône pouvait donc à juste titre être considérée, sinon comme la clef, du moins comme une des portes du beylik de l'Est. Si l'occupation de cette ville était jugée par le maréchal de Bourmont d'une importance extrême au point de vue de l'extension future de notre domination dans la province de Constantine, les Bônois envisageaient avec joie la perspective de notre arrivée. Leurs relations presque ininterrompues depuis le moyen âge avec les nations de l'Europe méridionale, et plus particulièrement avec la France , le séjour prolongé de nos compatriotes à la Calle et, parmi eux, la présence constante dans leur port de tous les pavillons du commerce européen, en un mot, une longue habitude des chrétiens et de leurs mœurs avaient en quelque sorte inspiré aux Bônois des idées de tolérance et de progrès, si toutefois ce mot peut être employé à propos des musulmans de 1830.
Mais plus encore que leur sympathie, l'intérêt personnel leur faisait une loi de nous accueillir en amis. Aux richesses que procuraient aux Bônois les relations de commerce étaient venus se joindre les bénéfices dont nos comptoirs étaient la source. Cette situation avait été même la cause de leur ruine, car elle n'avait pas tardé à éveiller les instincts cupides des beys de Constantine. Ceux-ci auraient pu se contenter des droits prélevés sur les échanges mais ils préférèrent traiter directement les affaires avec les Européens. Le gouvernement beylical s'était donc emparé du monopole du commerce, et, pour empêcher toute fraude, avait installé à Bône un agent spécialement chargé des transactions. Cet agent appelé " mercanti " avait acquis bientôt une autorité au moins égale à celle du gouverneur de Bône. Ce fut un coup funeste pour la coquette cité. Privée des sources principales de ses revenus, elle avait vu sa fortune décroître rapidement, et, en 1830 Bône comptait à peine quinze cents habitants.
L'espoir de reconquérir la liberté de commerce, source de leur richesse passée, le désir de secouer le joug odieux du bey Ahmed décidèrent les Bônois dès que la nouvelle de la chute du gouvernement leur fut parvenue à se déclarer indépendants. Une sorte de comité fut organisé et chargé de solliciter du général en chef l'appui de nos armes. Ce comité était composé de quatre hommes les plus influents de la cité. Quelques jours avant notre arrivée à Bône un agent du bey s'était présenté en son nom pour prendre le commandement de la ville, mais le comité ayant refusé de le recevoir, il se contenta de demander livraison des poudres, ce qui lui fut également refusé. C'est une rupture qui ne déguisait même pas un semblant de prétexte.
Dès les premiers jours de la conquête, le maréchal de Bourmont avait résolu, pressé par l'opinion publique, d'occuper les principaux ports de la Régence. Il était convaincu de ne rencontrer aucune résistance. " La prise d'Alger, écrivait-il, parait devoir assurer la soumission de toutes les parties de la Régence. Plus la milice turque était redoutée, plus sa prompt destruction a révélé dans l'esprit des Africains la force de l'armée française. Le bey de Tittery a reconnu le premier l'impossibilité de prolonger la lutte, et les Arabes paraissent convaincus que les beys d'Oran et de Constantine ne tarderont pas à suivre cet exemple. Tout nous porte à croire que la tâche de l'armée est remplie ". Illusion que les évènements se chargeront bientôt de dissiper.
Le 26 Juillet, une escadre sous les ordres du contre-amiral de Rosamel sortait d'Alger. Elle était composée de huit navires. Le Trident, vaisseau portant le pavillon du contre-amiral , deux frégates de premier rang : la Guerrière et la Surveillante ; deux bombardes : le Vulcain et le Vésuve ; un brick de vingt canons : l'Action ; un vaisseau armé en flûte (bâtiment servant de magasin ou d'hôpital à la suite d'une armée navale ou qui était employé comme transport de troupe.) : le Superbe. Elle emportait deux régiments d'infanterie formant un effectif de deux mille cinq cents hommes, une compagnie du génie et une batterie de campagne. Damrémont, un de nos meilleurs généraux avait reçu le commandement de l'expédition.
La division navale arriva en vue de Bône le 2 Août. Le débarquement favorisé par une mer très calme commença aussitôt. Les habitants parmi lesquels se trouvait Raimbert, arrivé quelques jours avant, accoururent sur le môle et confirmèrent leurs bonnes intentions en apportant à nos soldats des vivres frais. Le général Damrémont malgré ces démonstrations amicales ne crut pas devoir s'endormir dans une fausse sécurité et, aussitôt que le débarquement fut terminé, il fit occuper les principales positions. La casbah reçut un bataillon du 6e de ligne ; le 2e bataillon et le 49e de ligne, chargés de surveiller la plaine qui s'étendait jusqu'à la Boudjima, prirent d'abord position sur la route de Constantine ; mais la crainte de voir la santé des troupes compromise par les exhalaisons d'un terrain marécageux obligea le général Damrémont à les faire rentrer ; elles furent logées en ville. Deux redoutes élevées à la hâte en avant de la porte de Constantine furent confiées à la garde d'un bataillon. Bien lui en prit, car de toutes parts les tribus couraient aux armes et dès le 3 leurs cavaliers vinrent caracoler à portée de fusil des remparts. Le nombre de ces éclaireurs ne vint qu'augmenter dans les journées qui suivirent et bientôt des masses assez considérables de cavalerie défilèrent sous les yeux de nos soldats qu'elles espéraient attirer en rase campagne. Le général Damrémont, pour éclairer les abords de la place, autant que pour sortir d'une inaction qui, interprétée par l'ennemi comme une preuve de faiblesse, pouvait augmenter son audace, ordonna une sortie. Les ruines d'Hippone, à cette époque bien autrement considérables qu'aujourd'hui, offraient un abri naturel aux hordes qui nous assiégeaient.
Le 6 au matin, une compagnie de voltigeurs fut lancée en avant ; en quelques instants, elle eut gravi les pentes de la colline et délogé les Arabes. Nos soldats, pour la première fois, apparaissaient au sommet du mamelon qui domina si longtemps la célèbre cité de Saint Augustin.
L'importance stratégique de la position frappa le général Damrémont mais la difficulté d'y mener l'artillerie le fit renoncer au projet d'occuper ce point. Les Arabes embusqués dans les ruines, n'opposèrent à nos grenadiers qu'une résistance suffisante pour permettre à d'autres bandes de contourner la plaine et de se jeter à l'improviste sur les travailleurs occupés à achever la redoute Nord. Un combat assez vit s'engagea dans lequel quatre hommes du 6e furent tués.
Le 7 un renfort assez considérable vint encourager les assaillants ; une attaque échoua et le découragement commençait à se glisser dans les rangs de l'ennemi lorsque dans l'après-midi apparut le cheik de la Calle suivi d'une assez grosse troupe.
Le soir même, à onze heures et demie, eut lieu une attaque furieuse mais le général Damrémont avait été prévenu par les habitants de Bône et nos soldats étaient sur leur garde. Malgré la fusillade et la mitraille les Arabes s'avancèrent jusqu'au bord des fossés des redoutes et firent preuve d'un véritable courage ; ils se retirèrent qu'à la pointe du jour après sept heures d'un combat acharné. Nos pertes étaient peu considérables car nos soldats couverts par des retranchements étaient moins exposés que les assaillants. L'habitude d'enlever leurs morts nous empêchait d'en évaluer le nombre ; mais leurs pertes avaient dues être sérieuses car ils restèrent dans l'inaction pendant deux jours.
Le 10, au matin, eut lieu une nouvelle attaque contre les redoutes, objet de tous les efforts de l'ennemi ; nous eûmes deux tués. Mais toutes ces attaques étaient le prélude d'un assaut plus sérieux. Les Arabes de la plaine décimés par les derniers combats s'étaient décidés à faire appel aux habitants de l'Edough et on vit bientôt les files de ces rudes montagnards déboucher dans la vallée.
Le 11, le général Damrémont s'aperçut, au grand mouvement qui régnait parmi les Arabes, dont le nombre était plus considérable qu'à l'ordinaire, qu'une attaque sérieuse se préparait ; il se porta en personne à la redoute qui, par sa position, paraissait la plus menacée et se disposa à une vigoureuse défense.
L'attaque prévue eut lieu à onze heures du soir ; les Arabes se précipitèrent sur nos ouvrages avec une admirable intrépidité ; repoussés, non sans peine, ils revinrent à la charge à une heure du matin ; plusieurs d'entre eux franchirent les fossés, escaladèrent les parapets et combattirent à l'arme blanche dans l'intérieur des redoutes où ils périrent glorieusement. Après un combat acharné, le courage, aidé de la discipline, triompha du courage seul.
Les Arabes furent repoussés. Quatre-vingt-cinq cadavres, qu'ils laissèrent dans les fossés et sur les parapets des redoutes, dénotent avec quelle fureur ils combattirent ; ils firent preuve en la circonstance d'une ténacité qui semble appartenir plus particulièrement à la race berbère et, en effet, tous les agresseurs étaient des montagnards de l'Edough et des environs de Stora.
Cette chaude attaque fut la dernière. De notre côté nous avions à regretter la mort de quatre hommes.
Le général Danrémont, à partir de ce moment, ne songea plus qu'à rétablir l'ordre dans la ville, en mettant l'ancien service administratif en harmonie avec la pensée de l'occupation. Il se garda bien de changer les autorités qu'il avait trouvées en débarquant ; il institua même un conseil des notables, véritable conseil municipal, qui lui présentait les vœux de la population. Son grand esprit de sagesse et de conciliation, sa justice et sa modération lui attirèrent l'affection des habitants.
L'occupation de Bône était donc désormais un fait acquis et nous étions en droit de nous enorgueillir d'une conquête effectuée presque sans lutte.
Le général Damrémont, par sa sage politique, eut sans doute consolidé la domination française dans la province si, malheureusement les évènements de Juillet n'étaient pas venus détruire le résultat obtenu. La déchéance de Charles X fut bientôt connue à Alger ; elle frappa de stupeur le maréchal de Bourmont. Ignorant les intentions du nouveau gouvernement, il crut nécessaire de réunir sous sa main toutes les troupes de l'armée d'Afrique pour parer aux éventualités en rappelant les corps expéditionnaires de Bône et d'Oran, l'intention du maréchal ont dit les uns, était de faire intervenir l'armée d'Afrique pour assurer l'élection du duc de Bordeaux, d'autres qu'il ne voulait que réunir toutes les forces dont il disposait pour les tenir prêtes à être embarquées en prévision d'un conflit européen.
Quoi qu'il en soit, il fallut abandonner Bône et ce ne fut pas sans un sentiment de tristesse, je dirais presque de honte, que le général Damrémont obéit à l'ordre qui lui avait été envoyé.
Ce départ pouvait être considéré par les Bônois comme une sorte de trahison. En occupant leur ville, nous assumions la responsabilité de leur sécurité future et notre départ les livrait, réduits à leurs propres forces, à la vengeance inexorable du bey Ahmed.
L'ordre de départ était arrivé le 18 et le même jour l'escadre du contre-amiral de Rosamel, qui revenait de Tripoli, jetait l'encre devant Bône.
Les troupes ne commencèrent leur embarquement que le 20 au soir. Le colonel Magnan, qui commandait les compagnies d'élite, dut repousser jusqu'au dernier moment les attaques des Arabes qui occupaient nos positions au fur et à mesure que nous les abandonnions.
Ibrahim, maître de la Casbah. - siège de Bône.
Yussuf et d'Armandy à Bône. - occupation définitive de Bône.
Cet évènement eut un grand retentissement en France, l'opinion publique s'en émut. Le général Berthezène céda son poste au général Savary, duc de Rovigo qui arriva en Algérie avec des instructions précises au sujet de la province de l'Est. Il devait essayer de conclure avec Ahmed bey un traité par lequel ce dernier reconnaîtrait la suzeraineté de la France, paierait un tribut annuel et consentirait à la cession de Bône.
Le bey devait, en outre, interdire tout commerce d'exportation ou d'importation avec Tunis, au profit de Bône. En échange, la France lui accordait sa protection, se chargeait de l'entretien et de l'armement de ses troupes etc. Ahmed eût peut-être accepté les autres conditions mais refusa obstinément de céder Bône et les choses en restèrent en l'état.
Ibrahim (avait été trois ans bey de Constantine) s'était solidement établi dans la Casbah. Il n'avait au début, pour toute garnison, que les Turcs déserteurs ; mais peu confiant dans la fidélité et le dévouement des habitants de Bône qu'il écrasait d'impôts et de contributions de toutes sortes, il fit appel aux Turcs que le maréchal de Bourmont avait, après la prise d'Alger, fait transporter en Asie mineure.
Environ quatre cents de ces bandits accoururent, alléchés par l'espoir de voir renaître les beaux jours de la piraterie. Les Bônois, n'ayant point de pitié à attendre du bey, s'ils tombaient en son pouvoir, se virent bien à regret de faire cause commune avec Ibrahim et de soutenir son attaque.
Ce fut le 5 Janvier 1832 qu'eut lieu la rencontre des deux adversaires sur l'ancienne route de Constantine, au-delà du pont du même nom. Ben Zagouta avait, il est vrai, l'avantage du nombre, car presque toutes les tribus de la plaine et avait pendant longtemps exercé les fonctions de représentant du bey.
Ils lui avaient envoyé des contingents ; mais les Turcs avaient pour eux un semblant de discipline. Le combat dura deux grands jours avec des alternatives de succès et de défaites et les deux armées se retirèrent sans résultat définitif.
Cependant Ben Zagouta traînait avec lui 250 prisonniers qui, sur ordre du bey, furent égorgés ; il n'épargna que les Turcs pris dans la lutte et dont il espérait pouvoir se servir pour entraîner ceux qui, après le combat, s'étaient retirés dans la Casbah avec Ibrahim. En outre, exaspéré de ce qu'il considérait comme une défaite, il fit mettre à mort Ben Zagouta.
Ali Ben Aïssa lui succéda et arriva devant Bône avec environ 1.800 hommes de renfort. Pour ôter aux Bônois leurs dernières ressources, il bloqua le port avec une grande felouque. Il priva aussi la population des provisions qu'elle se procurait chez les Kabyles du Cap de Fer. En même temps il réussit, soit par ses promesses, soit par ses menaces à faire déserter une grande partie des Turcs d'Ibrahim. La Casbah, bien que sa garnison fut réduite par cette désertion n'en demeurait pas moins imprenable. La résistance de la ville aurait pu être facilement domptée, mais les batteries de la citadelle en rendaient l'occupation impossible.
Ali Ben Aïssa eut alors, tour à tour, recours aux promesses et aux menaces. Les unes et les autres demeurèrent sans effet sur les défenseurs de la Casbah. Quant à ceux de la ville, l'horreur inspirée par le nom d'Ahmed les empêcha seule d'accepter les propositions de Ben Aïssa.
Alors commença une guerre de Vandales ; tout ennemi pris, de part et d'autre, eut la tête tranchée. Les jardins, véritable forêt d'arbres fruitiers qui couvraient les espaces de terrain dont nous avons fait le Cours National et la nouvelle ville furent dévastés et détruits, et cette plaine, jadis si riche, ne fut bientôt plus qu'un vaste marais. " Bône, a dit M. l'interprète principal Féraud dans la Revue Algérienne de 1873, avant les sièges qu'en fit Ben Aïssa, n'était pas cette ville où peu d'années après des régiments presque entiers se fondaient sous les exhalaisons pestilentielles des marécages. La plaine à partir de l'enceinte de la ville jusqu'au pied de l'Edough, s'étendait couverte de jardins cultivés et de quinconces de jujubiers, d'où provenait le nom de Annaba, la Jujubière, par lequel les Arabes désignaient depuis le moyen âge la ville de Bône ; des eaux abondantes favorisaient la plus riche végétation abritée contre les ardeurs du soleil par de nombreuses plantations qui donnaient l'aspect le plus riant des environs de la ville, tout en assurant sa salubrité. Loin d'être un foyer d'infection, Bône était renommée alors par la pureté de son eau, la beauté de son climat et le charme de ses campagnes. Les gens de Constantine venaient y rétablir leur santé épuisée. "
Six mois s'écoulèrent. La population décimée par la famine sentait faiblir sa résolution. Trois notables se dévouèrent et purent à la faveur de la nuit, franchir l'enceinte des remparts et gagner la montagne d'où ils se dirigèrent vers Alger ; admis en présence du duc de Rovigo, ils le supplièrent de venir à leur secours.
Bien que résolu à mettre à profit l'occasion qui lui était offerte, le général en chef ne voulut point s'engager au hasard. Il ne crut pas devoir les décourager par un refus absolu et leur donna donc quelque espérance d'être secourus lorsqu'il se serait assuré de leurs véritables sentiments. Tel fut le motif qui décida le premier envoi de la Béarnaise à Bône le 2 Février avec à son bord Yussuf en qualité de négociateur.
Telle était la situation de cette ville lors de l'arrivée du duc de Rovigo à Alger. Revenant, en raison de l'urgence et du puissant intérêt politique que présentait pour la France l'occupation de Bône, sur sa précédente détermination, le commandant en chef avait décidé de faire une nouvelle tentative pour entrer dans une place qui était une des clés de Constantine.
Arrivé à Bône le 9, Yussuf ne se laissa pas intimider par Ibrahim. L'entretien fut grave et solennel. Le représentant français en profita pour dire la vérité aux Turcs de la garnison et de les éclairer sur leur position. La situation était en effet fort difficile pour eux : ils avaient peu de vivres et ils étaient bloqués du côté de la terre mais recevaient encore des secours par mer ; mais nous pouvions facilement leur fermer cette porte ; dès lors, ils en étaient réduits à mourir de faim ou à se rendre, c'est-à-dire tomber sous le yatagan (sabre à lame recourbée).
Yussuf leur fit entendre que s'ils remettaient la Casbah à la France ils obtiendraient son plein pardon ; aucun engagement ne fut pris mais l'offre ne fut pas repoussée.
Les otages, qui connaissaient la barbarie d'Ibrahim, étaient très peu rassurés sur leur propre sort même si ce dernier s'engageait à faire la paix.
Le général en chef était convaincu de la nécessité d'occuper Bône mais il n'avait pas de troupes disponibles et il était impossible d'organiser un corps expéditionnaire en l'espace de quelques jours.
La Béarnaise sortit d'Alger le 23 Février, avec à son bord les capitaines Yussuf et d'Armandy, traînant à sa remorque une felouque, la Casauba, chargée de provisions et de vivres. Arrivés à Bône le 3 Mars malgré le mauvais temps l'on débarqua de la felouque 90 sacs de blé et de riz.
Les deux capitaines entrèrent dans la citadelle à la tête de 30 marins de la Béarnaise, ayant pour auxiliaires 130 Turcs et pour ennemis les 5.000 hommes de Ben Aïssa.
Ce dernier avait compris que Bône était à jamais perdue pour lui et se décida de rentrer à Constantine ; mais il allait laisser à la ville rebelle de terribles témoignages de sa vengeance. Il commença par donner l'ordre à tous les habitants, sans exception d'âge et de sexe, de se rendre dans son camp et déclara que quiconque serait pris en ville serait puni de mort ; et quand cet ordre eut été exécuté, il fit mettre le feu aux différents quartiers dont il avait d'abord fait démolir les principales maisons.
Le 29 Mars, au coucher du soleil, des tourbillons de fumée s'élevèrent de la ville enflammée. Des cris douloureux se firent entendre au milieu d'une confusion immense ; toute la malheureuse population de Bône était amenée en esclavage. Beaucoup de Turcs de la Casbah, qui avaient là leurs familles, pleuraient de rage à la vue de la brutalité des Arabes.
Arrivée de corps d'occupation à Bône.
- Description de Bône en 1832.
Mauvaises conditions d'installation des troupes.
Les maladies se déclarent.
Le corps expéditionnaire, destiné à l'occupation de Bône, fut formé à Toulon. Le général Monk d'Uzer, désigné pour en prendre la direction, ne voulut pas attendre que la concentration des troupes fut terminée ; il prit les devants avec un bataillon. Le 16 Mai 1832, il débarqua à Bône.
Six cents hommes environ se trouvaient déjà réunis à Bône, et, bien que, dès leur arrivée, le capitaine d'Armandy se fut activement occupé des travaux d'amélioration les plus urgents, la ville n'était encore qu'un monceau de ruines, absolument dénué de ressources et où tout était à créer.
Sur le bord occidental du large golfe qui porte son nom, Bône s'élève en amphithéâtre le long des pentes fortement inclinées d'une colline, dont les revers sont battus par les flots de la Méditerranée.
A l'époque où nos troupes en prenaient possession, Bône était bien déchue de son ancienne prospérité. Ses ruelles, étroites et tortueuses, ne renfermaient aucun monument digne d'être cité, à l'exception de trois mosquées, dont l'une, celle de Sidi Bou Mérouane, fut, dès les premiers jours de l'occupation, transformée en hôpital militaire.
Au centre de la ville se trouvait un carrefour, seul espace un peu vaste, dont nous avons fait la place d'armes en démolissant les anciennes masures et en donnant aux nouvelles constructions un alignement régulier. Le côté oriental de cette petite place, aujourd'hui si fraîche et si gracieuse, était occupé par une mosquée.
Dans la rue Damrémont qui n'était, à cette époque, qu'un boyau tortueux et étroit, se trouvait une mosquée, dite des Romanets (grenadier), simple mesedjed (oratoire) qui, tombée dans le domaine privé, servit d'abord de brasserie.
Achetée par la ville, cette construction fut démolie, et, sur l'emplacement qu'elle occupait jadis, s'élève aujourd'hui un bâtiment renfermant la justice de paix et la bibliothèque de la ville. Citons encore la synagogue.
A l'exception des trois mosquées qu'entretenaient les soins pieux des habitants, les rues de Bône n'offraient aux regards des nouveaux venus qu'un spectacle lamentable.
" La ville, dit un contemporain, est fort sale, il est difficile de ne pas rencontrer dans chaque rue des quantités de rats morts, des immondices de toute espèces ; beaucoup d'égouts sont obstrués ; le défaut de latrines communes obligent les militaires à déposer leurs excréments autour des maisons et il y a ainsi dans la ville cinq ou six foyers d'infection qui n'existaient même pas quand les barbares étaient maîtres du pays ".
Si la ville n'était qu'un amas de décombres et de maisons en ruines, la vieille enceinte délabrée, que nous léguaient les Turcs était, elle-même en piteux état. Elle enfermait Bône dans un quadrilatère irrégulier de 1.650 mètres de développement dont deux côtés faisaient face à la mer. Le premier, bâti sur la plage même, s'étendait de l'extrémité de la rue du quatre-Septembre au Fort-Cigogne. Cette face existe encore ; elle est en partie cachée par les bureaux de la Compagnie Transatlantique, de la douane et sert de limite à l'arsenal, à la manutention et à l'hôtel de la subdivision.
Durant les effroyables tempêtes qui ont dévasté souvent le golfe de Bône, les vagues venaient déferler jusque sur les remparts qu'elle couvrait d'écume. La plage sur laquelle était construite cette face s'étendait depuis le Fort-Cigogne jusqu'à l'embouchure de la Boudjima, et la mer venait expirer à l'endroit même où se voit aujourd'hui la rue Prosper Dubourg.
Le deuxième côté se détachant du Fort-Cigogne remontait la pente de la rue d'Uzer, puis, tournant brusquement au Nord-Ouest, couronnait une ligne de rochers escarpés d'un accès difficile, dont la mer venait baigner la base. Au pied de la falaise que domine maintenant l'hôpital militaire, la rue d'Armandy et l'hôtel des ponts et chaussées, se trouvait le mouillage des Cazarins (en arabe, Ksarin : les deux forts.) que défendait un fort situé à l'embouchure même où on a créé depuis la porte des Caroubiers. Le Fort-Cigogne, sous lequel on a ouvert un tunnel en 1869, formait l'extrémité sud de ce dangereux mouillage que les navires abandonnaient l'hiver pour aller se réfugier au Fort-Génois.
Au pied de cette même falaise se déroule aujourd'hui une magnifique route en corniche qui, après avoir suivi les sinuosités de la côte, aboutit au cap de Garde. La troisième face, partant du bastion où a été ouvert depuis l'escalier qui descend sur la route de la Grenouillère, suivait le boulevard Victor Hugo et aboutissait à l'extrémité nord de la rue du quatre-Septembre. Elle longeait donc parallèlement à la mer, les hauteurs de la Casbah. A partir de ce point, le rempart suivait une ligne droite représentée aujourd'hui par le côté ouest de la rue du quatre-Septembre et venait rejoindre la première face à la hauteur du palais Calvin.
Cette enceinte était percée de quatre portes. La première, dite porte de la Marine, s'ouvrait sur la plage ; elle fut bouchée plus tard (1838) et reportée à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui.
La seconde, dite porte de la Casbah, était située au point le plus élevé de la ligne des remparts, sur la place actuelle de la Casbah, à l'extrémité de la rue d'Armandy. La troisième était ouverte dans la partie des remparts qui courait au pied de la colline. On lui donna le nom de porte Damrémont au lieu de bab el Mekaber, qu'elle portait auparavant. Enfin la quatrième donnait accès sur la plaine marécageuse dans laquelle serpentait la route de Constantine. Elle était située à l'extrémité de la rue de l'Arsenal, à l'endroit où se trouve aujourd'hui une petite construction d'utilité publique. En avant de cette dernière porte et de l'autre côté d'un canal, qui s'étendait de la mer à l'extrémité nord du Cours National, se trouvait un vieux caravansérail. Au-delà du canal, c'est-à-dire au sud de la ville, s'étendait une plaine marécageuse dont les eaux croupissantes, véritable foyer pestilentiel, étaient entretenues par les flots de la mer et les eaux de la Boudjima et du Ruisseau d'Or.
Au sommet d'un des derniers contreforts de l'Edough, dominant la ville d'une centaine de mètres environ, s'élevait la Casbah, forteresse construite par les rois de Tunis. Ses murs, solidement restaurés par les Turcs, après le départ des Espagnols en 1541 avaient résisté d'eux-mêmes aux injures du temps, mais ils ne renfermaient plus que les débris des constructions que les Janissaires, dans leur indifférence orientale, avaient laissé tomber en ruines. Les terrasses effondrées n'amenaient plus l'eau aux citernes que nous trouvâmes à notre arrivée complètement vides. La Casbah, comme la ville, ne pouvait même pas offrir l'abri à nos troupes. De cet amoncellement de ruines, de ces cloaques malsains, il fallait faire surgir une ville nouvelle. Il importait en premier lieu de mettre la ville à l'abri d'une attaque que l'on était en droit de prévoir à bref délai, et pour cela de réparer les nombreuses brèches de l'enceinte. Il fallut enlever les décombres qui, obstruaient en maints endroits et démolir les maisons voisines pour créer une voie de circulation longeant l'intérieur du rempart. A l'intérieur de la ville tout était à créer, hôpital pour les malades dont le nombre, déjà considérable, croissait chaque jour, et pour les blessés que ramènera chacune de nos colonnes de sortie.
On affecta à cet usage la grande mosquée de Sidi Bou Mérouane, mais comme on y pouvait loger que 106 hommes, sept maisons voisines furent aménagées le plus confortablement possible. L'absence de médicaments et de literie pour les malades vint encore compliquer les défectuosités d'une pareille installation. On les divisa par îlots formant chacun une sorte de caserne, renfermant quelques chambres où furent parquées les troupes.
" Des chambres au rez-de-chaussée, a dit le docteur Hutin, alors médecin à l'hôpital militaire de Bône, sombres, étroites, humides, sans un seul plancher, beaucoup même sans toiture, incapables de mettre à l'abri de la pluie, où vivent des milliers de rats, de lézards et d'autres animaux qui, par leur bruit, empêchent le soldat de se livrer au sommeil : tel est l'état du casernement. Dans chaque maison il y a un puits ou une citerne, mais ils sont généralement impropres et par conséquent l'eau en est peu salubre ".
Il est évident qu'un tel état de chose ne pouvait avoir qu'une influence désastreuse sur la santé des troupes déjà si compromise. Le manque d'eau propre fut d'abord une des principales causes de l'intensité des maladies.
Aux difficultés matérielles d'installation venait encore se joindre la pénurie des vivres. Les approvisionnements destinés au corps expéditionnaire avaient été calculés sur une courte durée, dans l'assurance qu'on était d'utiliser les ressources du pays. On était convaincu que les Arabes du dehors ne tarderaient pas à apporter leurs produits sur nos marchés ; mais sauf les habitants qui, échappés de Constantine, revenaient à Bône dans un tel état de dénuement et de misère qu'il fallait encore les nourrir, personne ne s'approcha de la place.
C'était une situation à laquelle il importait de remédier le plus tôt possible. Il fallut élargir la zone de sécurité autour de Bône ; il fallut aussi ramener dans les environs les tribus qui, de gré ou de force, s'étaient enfoncées vers l'intérieur à la suite de Ben Aïssa, en leur faisant comprendre que, dans le cas où elles se rallieraient franchement à notre cause, notre protection saurait les préserver de tout retour offensif de leur terrible maître.
Peu à peu la confiance revint et les Beni-Urgine, campés entre la Mafrag et le Seybouse virent les premiers faire acte de soumission et ne cessèrent, par la suite, d'approvisionner notre marché de bestiaux et de vivres.
L'année 1833 s'ouvrait sous d'heureux auspices. L'état sanitaire s'était amélioré grâce aux travaux d'assainissement qui avaient été exécutés en quelques mois. Les fêtes du Ramadan furent particulièrement brillantes et elles réunirent, ce qui ne s'était jamais vu, 3.000 Arabes dans la plaine de Bône qui, sous les yeux de la garnison, de la population et des notables indigènes, exécutèrent leurs bruyantes fantasias. Les tribus qui, rentrées sous notre autorité, étaient venues camper aux environs de Bône, formaient donc cette première ligne de défense à laquelle le général d'Uzer avait si souvent pensé. Il songea alors à renforcer la deuxième ligne de travaux fortifiés qu'il avait fait commencer et que les maladies et les attaques incessantes l'avaient empêché de continuer. Ces travaux étaient destinés à garder les défilés qui débouchent dans la plaine de Bône et les hauteurs qui la dominent.
Il voulait ainsi permettre à la garnison et aux habitants de circuler librement et sans danger autour de la ville, de cultiver quelques parties de la plaine et de jouir de ses productions Il décida donc la création de postes ou blockhaus sur certains points qu'il avait remarqués et qui devaient compléter la ligne de défense. Le Fort Génois, situé à environs sept kilomètres au Nord-Ouest devait être occupé un des premiers mais il n'existait pas de route.
Le général résolut d'en ouvrir une et, tant pour protéger les travailleurs que pour défendre le lazaret, il fit placer un blockhaus entre la Casbah et la mer. Ce lazaret destiné à recevoir les passagers des navires suspects, avait été construit au-dessus de la route actuelle de la Grenouillère, sur la hauteur qui fait face aux constructions élevées par l'entreprise du port.
Malheureusement, si la situation politique s'était améliorée, on ne pouvait pas en dire autant de l'état sanitaire des troupes. A peine arrivé, c'est-à-dire vers la fin de 1832, le corps expéditionnaire avait été déjà éprouvé par une épidémie cruelle revêtant les symptômes du vomito negro. Les froids de l'hiver en avaient diminué l'intensité, mais le mal éclata au milieu de l'été de 1833 avec une nouvelle violence. La garnison de Bône, forte à ce moment de 5.500 hommes avait plus d'un tiers de son effectif à l'hôpital.
Les conditions déplorables du casernement, la malpropreté des rues de la ville, l'insuffisance d'eau salubre et de vivres frais n'étaient pas les seules causes de la recrudescence des maladies et des décès. Les nombreuses sorties de nos troupes à la poursuite d'un ennemi souvent insaisissable, à travers de longues plaines brûlées par un soleil ardent avaient fini par épuiser le soldat. Rentré à Bône, au lieu de goûter un repos si justement mérité, il lui fallait reprendre la pioche et la pelle pour travailler la plupart du temps dans des endroits marécageux.
Pour reconquérir une force factice, il buvait alors des alcools sans nom, qui, dans un corps affaibli par les privations et les fatigues, achevaient l'œuvre de destruction entamée par les fièvres.
La nostalgie venait encore aggraver la situation de ces malheureux. L'espoir souvent déçu d'une prompte rentrée en France, l'aspect des nombreux vides qui dépeuplaient les rangs autour d'eux, les livraient à une sorte de découragement qui ne leur permettait plus de lutter contre les progrès du mal. Enfin, dernière et principale cause, les marécages qui s'étendaient autour de la ville jusqu'au pied des remparts, remplissaient l'air de leurs miasmes pestilentiels.
Quelles tristes réflexions ne dût pas faire la commission d'enquête, lorsqu'elle débarqua à Bône, le 15 Septembre, à l'aspect de ces misérables baraques qui, sous le nom de caserne ou d'hôpital, abritaient si mal des centaines de malheureux. Elle put au moins constater de visu l'insuffisance des moyens et signaler les améliorations urgentes qui s'imposaient.
Du 1er Juin au 30 Septembre, 4.097 hommes dont 36 officiers étaient entrés à l'hôpital ; 830 y étaient morts. L'hiver vint heureusement diminuer l'intensité de l'épidémie.
Cependant, après les fortes chaleurs, les émissaires de bey s'étaient remis en campagne et cherchaient à réveiller chez les Indigènes le fanatisme endormi.
Situation de Bône en 1838.
Ralentissement momentané des progrès de la colonisation.
Organisation politique et administrative de la province de Bône.
Au commencement de l'année 1858, la population européenne de Bône était de 2.622 âmes, répartie ainsi : Français 954, étrangers 1.668. Les deux années qui venaient de s'écouler, fertiles en évènements militaires, n'avaient pas permis au général Trézel de poursuivre l'œuvre si bien commencée par d'Uzer. Il y avait eu un temps d'arrêt dans l'essor de la colonie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. La malpropreté des rues, que le général d'Uzer avait réussi à faire disparaître après bien des efforts, était revenue et avec elle le cortège des maladies.
La police s'était relâchée de sa surveillance ; à la suite des troupes envoyées de France pour prendre part aux deux expéditions de Constantine, on avait vu débarquer des gens qui, sous le nom de colons, débitaient aux soldats des alcools sans nom. La santé et la discipline s'en ressentaient. " Une mesure non moins importante, écrivait un officier de cette époque (17 Février 1838) et, aussi pressée à prendre, c'est l'établissement d'une bonne police civile et militaire.
L'ivrognerie, le vol et les tapages nocturnes sont extrêmement fréquents. Il serait temps enfin de sortir de cet état de barbarie en envoyant à Bône des administrateurs à santé forte, à volonté ferme et à grande persévérance. Que l'on ne craigne pas de les récompenser et de les soutenir mêmes dans des actes qui paraîtraient arbitraires en France et qui sont ici nécessaires pour organiser l'ordre au milieu des Maltais, des Indigènes, des fainéants et des voleurs. Que l'on admette dans la colonie, si on le juge convenable, les repris de justice, les condamnés au boulet ou aux travaux, le rebut de la nation française mais que l'on y envoie des hommes forts pour diriger les administrations et des troupes bien disciplinées pour les protéger ".
Il est certain qu'un tel état de choses ne pouvait favoriser les progrès de la colonisation.
" La culture à la charrue n'a pas été mise en usage dans la plaine de Bône, dit le même officier ; c'est un genre d'industrie et de spéculation qui demande trop de travail et de persévérance et qui ne produit pas assez pour les colons avides et paresseux. On sera forcé d'organiser des colonies militaires si l'on veut coloniser.
Le service des eaux n'a pas encore été régularisé. Nous avons des marais pendant six mois et une sécheresse absolue pendant six autres. Tels sont les résultats du désordre dans lequel on se bat depuis six ans à Bône pour ne pas avoir eu d'idées fixes sur la position à occuper et un plan de conduite invariable ".
Le maréchal Valée arriva à Bône le 21 Septembre pour étudier sur place la question de l'organisation définitive de notre conquête.
La province tout entière fut divisée en deux parties : La France se réservait l'administration entière du territoire de la première. C'est la province de Bône. La seconde reçut le nom de province de Constantine et fut divisée en arrondissements inégaux, dans la formation desquels les traditions, les coutumes étaient ménagées et consultées avec soin. Le commandement supérieur du territoire des deux provinces était confié à un officier général.
Nous n'avons à nous occuper dans ce travail que de la province de Bône, dont la banlieue politique, jusque-là limitée à la zone de protection de nos camps, on le sait, allait s'agrandir.
L'arrêté du 1er Novembre 1838, reproduit ci-après, en fixa de façon définitive l'organisation administrative et territoriale :
" Arrêté du 1er Novembre 1838 qui pourvoit aux gouvernements des populations arabes et kabyles comprises dans la partie de la province de Constantine, dont la France conserve l'administration directe ".
Article premier. - Le territoire de l'arrondissement de Bône sera partagé en quatre cercles qui porteront les noms de cercle de Bône, cercle de la Calle, cercle de Guelma et cercle de l'Edough.
Art.2 - Le commandement et l'administration de ces cercles seront confiés à un chef français qui exercera son pouvoir sous l'autorité de l'officier général commandant l'arrondissement de Bône.
Le commandant de l'arrondissement de Bône relèvera du commandant supérieur de la province de Constantine dont il recevra directement les ordres.
L'autorité des fonctionnaires civils français sera successivement étendue sur tous les cercles avec les réserves que les circonstances rendront nécessaires.
Lorsqu'une ordonnance du roi ou un arrêté du gouverneur général aura placé une partie du territoire sous l'autorité des fonctionnaires de l'ordre civil et la juridiction des tribunaux, le commandant supérieur de la province ne pourra s'immiscer dans les affaires administratives et judiciaires qu'en vertu d'ordres spéciaux du gouverneur général ou sa responsabilité personnelle, dans des circonstances intéressant la sûreté du pays.
Les commandants des cercles, soumis à l'administration civile, n'auront d'autorité que sur des populations indigènes.
Art.3 - Les commandants de cercle, toutes les fois que des dispositions spéciales n'auront pas décidé le contraire, réuniront tous les pouvoirs militaires, civils et judiciaires. Des arrêtés spéciaux règleront les formes suivant lesquelles ils devront exercer ces différentes attributions.
Art.4 - Les populations indigènes seront placées, dans chacun des cercles de Bône, de la Calle et de l'Edough, sous les ordres d'un caïd, qui restera dans la dépendance du commandant du cercle.
Dans le cercle de Guelma, il y aura deux caïds, l'un arabe et l'autre kabyle ; ils seront indépendants l'un de l'autre et relèveront directement du commandant du cercle.
Art.5 - L'achour (taxe basée sur les récoltes, ) et le hockor (droit supplémentaire payé sur les terres collectives. ) seront livrés sur toutes les tribus qui habitant le territoire administré par les autorités françaises.
Le tiers du hockor sera abandonné aux caïds du cercle, pour appointements, frais de représentation et de perception.
Les caïds paieront l'impôt au commandant du cercle qui sera assisté pour la perception du hockor d'un employé de l'administration des finances, et pour la perception de l'achour d'un membre de l'intendance militaire.
Les versements seront faits à Bône dans la caserne du payeur, en présence du conseil d'administration de l'arrondissement organisé par arrêté de ce jour.
Des reçus provisoires seront remis aux caïds par les commandants de cercle. Ces reçus deviendront définitifs lorsqu'ils auront été approuvés par le conseil d'administration d'arrondissement.
Art.6 - Les propriétés du beylick et celles sous le séquestre seront régies par le conseil d'administration de l'arrondissement de Bône ; elles seront affermées par adjudication publique et les revenus seront versés au Trésor.
Art.7 - Les cavaliers irréguliers et auxiliaires aux tribus seront placés sous les ordres du commandant du cercle. Ils ne pourront se réunir qu'avec son approbation et rentreront dans leur tribu dès qu'ils en auront reçu l'ordre. (8) taxe basée sur les récoltes.
Art.8 - Dans chaque cercle, il pourra être nommé un caïd musulman qui jugera les différends intervenus entre les Indigènes. Lorsque des Européens seront en cause, les conseils de guerre et la justice militaire, pour les parties du territoire soumises à son autorité, seront chargés de la poursuite des crimes.
Art.9 - Les caïds de cercle et les cadis seront nommés par le commandant supérieur de la province de Constantine, sur la proposition de l'officier général Commandant l'arrondissement de Bône. Les cheiks seront nommés par le commandant de l'arrondissement, sur la proposition du commandant du cercle. Les chefs indigènes, quel que soit leur titre, pourront être révoqués par le gouverneur général sur la proposition du commandant supérieur de la province qui, en cas d'urgence, les suspendra provisoirement de leurs fonctions.
Art.10 - Les caïds du cercle recevront la gandoura au moment de leur investiture ; ils prêteront, sur le Coran, serment de fidélité au roi et d'obéissance au commandant du cercle. Ils seront dispensés de tout droit d'investiture. Le commandant supérieur de la province de Constantine est chargé de l'exécution du présent décret.
Au quartier général, etc., etc. (signé) : Comte Valée.
La nouvelle province ainsi divisée était limitée à l'est par la régence de Tunis, dont la frontière n'était pas déterminée, ce qui sera pour nous pendant de longues années une cause de difficultés ; à l'Ouest par les montagnes inaccessibles de la Kabylie et de Philippeville et le khalifat du Sahel ; au sud par la partie du territoire de la province de Constantine, dont la France ne se réservait pas l'administration directe.
De nombreux travaux ou d'embellissement étaient en projet. Le général Randon mettait les soldats à la disposition de la colonisation. Les corps créaient des jardins et des pépinières sur une surface de dix hectares autour des établissements militaires. A Bône même on ne restait pas inactif. Un hôtel s'élevait sous la direction du génie pour le commandant de la subdivision. Un caravansérail, sorte de marché couvert destiné aux Arabes était construit sur les ruines de l'ancien.
Enfin, le gouverneur général, longuement sollicité par le général Randon, venait d'accorder l'autorisation d'ouvrir une route dans l'Edough. Les travaux, à la grande joie de tous, civils et militaire, commencèrent le 17 Janvier 1842 et se continuèrent jusqu'au 18 Avril jour où les travailleurs arrivèrent sur le plateau du Bou-Zizi. Elle fut complètement terminée le 14 Mai.
Les troupes, en moins de trois mois, avaient achevé la route et l'avaient conduite au cœur des montagnes et des forêts, à quatre myriamètres de Bône. Les obstacles de la nature étaient vaincus. L'Arabe de ces contrées vint au-devant du général, non comme un ennemi, mais pressentant que toute la force de sa position était désormais anéantie, il ne cédait plus alors devant une armée destructrice, abîmée du sentiment de la guerre, mais devant une œuvre prodigieuse, miraculeusement établie.
La remise des forêts de l'Edough à l'administration forestière eut lieu le 3 Juillet. Au mois de Septembre 1844, Bône avait fait d'énormes progrès dans la voie de colonisation et surtout de son propre développement. La ville offrait alors des rues larges et carrossables, d'élégantes et solides constructions qui s'élevaient de toute part. Déjà on songeait à son agrandissement et le projet de la nouvelle enceinte fut dressé. La culture du tabac avait pris une certaine extension, l'industrie séricicole implantée dans le pays implantée dans le pays par M. Moreau semblait devoir prospérer. Des plantations de coton étaient encouragées par l'administration. Enfin des études étaient faites en vue d'exploiter les nombreuses mines de fer qui se trouvaient à proximité de Bône. Une société d'agriculture avait été fondée.
Le premier plan de Bône, dressé par M. Dupin, inspecteur de la voirie, fut exposé au mois de Juin 1845 dans une salle de la mairie. Il contenait, outre la ville déjà existante, le projet de la nouvelle cité qu'on se proposait de bâtir. Au printemps de 1846, la subdivision de Bône jouissait d'une paix profonde. Guelma prenait une extension considérable, grâce à la route qui reliait ce centre important à Bône et qui avait été mise en fort bonne état.
Le cercle de La Calle était dans d'excellentes conditions : de grandes concessions forestières avaient été faites à des hommes considérables, qui y avaient établi des exploitations de liège.
La tranquillité était bien un peu troublée sur la frontière, mais l'administration y avait l'œil et les désordres qui s'y produisaient n'arrivaient jamais à compromettre les intérêts européens ; c'étaient des discussions se terminant par quelques coups de fusils échangés entre nos tribus et celles de la régence de Tunis.
Même prospérité dans le cercle de l'Edough. Le général avait pénétré jusqu'au centre des forêts en y pratiquant des routes qui contournaient les pentes les plus abruptes de la montagne et assuraient l'exploitation forestière.
A quelques lieues de Bône et aussi tout près de la ville, la compagnie Talabot exploitait les riches minerais de Mokta el Hadid et les hauts fourneaux qu'elle avait construits pour la fabrication de la fonte sur la Seybouse.
Evènements de 1852. - Création des milices.
Evènements de 1871. - Bône de nos jours.
La Révolution de 1848 causa quelque émotion à Bône. Ce fut le 2 mars qu'on apprit le renversement de la royauté. La République fut aussitôt proclamée au milieu d'une effervescence qui ne tarda pas à inspirer de vives inquiétudes à la population indigène. Les journées des 16 et 17 Avril firent voir éclater des troubles plus graves au sujet des élections municipales. On dut faire des exemples, six personnes arrêtées furent embarquées et expulsées du territoire de la colonie.
Quelques mois après, le 2 Juillet, un complot, ourdi par les condamnés de l'atelier n° 4 campés aux baraquements de la Seybouse et aux Caroubiers, fut heureusement découvert. Le programme des rebelles était de s'emparer la nuit des armes des surveillants, des gendarmes du poste et du poste des tirailleurs commis à leur garde, de marcher en deux groupes sur Bône, d'occuper l'arsenal et la casbah. Fort heureusement un des conjurés prévint le colonel Dumontet qui fit arrêter 21 condamnés.
Vers cette époque, un mouvement de l'opinion publique se produisait en faveur de notre colonie. Le gouvernement décida que des essais de colonisation se feraient sous son patronage. Un premier convoi de 840 colons débarqua à Bône le 8 Décembre 1848. Ils furent reçus avec un enthousiasme indescriptible qui devait par la suite être l'origine pour ceux qui en étaient l'objet de bien des désillusions ; un deuxième arrivage de 744 eut lieu le 15 Décembre. Envois trop nombreux, composés de gens qui n'avaient jamais connu les travaux des champs et qui, bientôt découragés, malades vont faire retomber sur le gouvernement la responsabilité de leur déception. Rentrés en France, leurs plaintes, leurs récriminations vont inspirer à l'égard de notre colonie naissante une méfiance qui subsistera longtemps encore dans les esprits.
Le décret du 9 Décembre était venu donner à l'Algérie une nouvelle organisation plus harmonieuse avec les besoins crées par l'augmentation de la population. Le territoire de la colonie fut divisé en trois départements comprenant eux-mêmes un territoire civil ayant un préfet à sa tête et un territoire militaire de commandement administré par le général commandant la division. Les régions du territoire civil, dont la population européenne n'était pas suffisante pour constituer des communes, furent divisées en commissariats civils.
Les années 1848 et 1849 furent fertiles pour Bône en créations et en améliorations. Siège d'une subdivision comprenant quatre cercles militaires, elle devint le chef-lieu d'une sous-préfecture.
La chambre de commerce fut constituée en Juin 1849 sous la présidence de M. Casimir Bronde.
La Seybouse fait son apparition. (1843)
Les forêts de l'Edough furent données en concession à M. Lecoq qui en commença immédiatement l'exploitation. Le colonel Eynard fut remplacé le 12 Novembre 1851 par le colonel de Tourville qui, comme chef d'état-major du général Guingret, avait laissé d'excellents souvenirs dans la population de Bône. Quelques jours après M. Tremblaire prenait également possession de la sous-préfecture.
Le 31 Janvier 1852 eut lieu la promulgation de la Constitution du prince président, bientôt suivie de la prestation de serment des fonctionnaires. Le général d'Autemane avait été envoyé dans la subdivision de Bône pour protéger les points menacés par une révolte que rien ne laisser prévoir.
En effet, les tribus de la province de Constantine jouissaient depuis douze ans d'une paix profonde. Aucun signe précurseur de mécontentement, aucun acte de désobéissance n'avaient pu nous mettre en éveil. Peu de jours avant que ce mouvement éclatât, le gouverneur général, dans le voyage qu'il avait fait dans la province, avait entendu les caïds et les cheiks des tribus du cercle de Guelma, réunis autour de lui, protester de leur fidélité et énumérer avec reconnaissance les avantages que leur offrait la domination française. Des travaux importants étaient entrepris pour améliorer les voies de communication. Les Indigènes semblaient comprendre le profit qu'ils devaient en tirer et y prenaient eux-mêmes une part active.
Cependant, dans la nuit du 1er au 2 Juin, dix hommes du 10e de ligne, chargés de protéger les travaux d'un caravansérail qu'on élevait à Aïn-Saïda, à quelques lieues de Guelma, furent subitement attaqués et obligés de se retirer en toute hâte, abandonnant leur camp, leurs outils de travail et laissant sur le terrain deux des leurs mortellement frappés par les insurgés. Ce fut le signal de l'insurrection. Immédiatement après, toute la population de ces montagnes courut aux armes et se répandit dans la plaine, menaçant les colonnes de Millesimo et de Petit qui ne sont éloignées de Guelma que de huit kilomètres.
La subdivision était presque dégarnie de troupes, et les instigateurs de la révolte avaient compté sur cette circonstance pour le succès de leur entreprise. Le colonel de Tourville, commandant de la subdivision, fit partir de Guelma le peu de monde dont il pouvait disposer, tandis que de Constantine un demi-bataillon de zouaves et une centaine de cavaliers étaient dirigés vers le même point. Mais ces détachements, présentant à peine un millier d'hommes, étaient insuffisants pour contenir une insurrection où étaient entrées déjà toutes les tribus de l'Est et qui se propageaient d'heure en heure.
La nouvelle de ce mouvement inattendu arriva le 5 Juin, dans la soirée, par voie télégraphique. La frégate, l'Orénoque, ancrée dans le port, reçut l'ordre d'appareiller. Quatre compagnies du 12e de ligne montèrent à bord ; le lendemain, la frégate prenait encore à Dellys, le 1er bataillon de chasseurs et deux jours après, 1.200 soldats d'élite débarquaient à Bône ; le lendemain,9 Juin, ils étaient en route vers Guelma et le 11, le colonel de Tourville entrait en campagne à la tête d'une colonne de 2.400 baïonnettes.
Il trouva le pays désert, mais ayant appris que les insurgés, avec la plus grande partie de leurs troupeaux, s'étaient réfugiés sur le Kef-el-Aks, espèce de forteresse naturelle vers laquelle on ne pouvait arriver que par une vallée fort étroite, il résolut de les y attaquer.
Le 14, on donna l'escalade ; tous les obstacles furent franchis, les Arabes chassés de leur position, les troupeaux enlevés.
Le colonel resta quelques jours sur le terrain et le 18, il se relit en route pour le Fedj-Mekta où des dispositions hostiles se manifestaient. L'insurrection menaçait de s'étendre à tout le pays.
Les Beni-Salah, établis dans le cercle de Bône, profitant de la concentration des troupes dans le cercle de Guelma, venaient d'attaquer un poste de vingt soldats, occupés à tracer une route dans la forêt ; ils en avaient tué quelques-uns, puis s'étaient réunis en nombre et se disposaient, ainsi qu'ils l'avaient fait dans les environs de Guelma, à attaquer les villages et établissements européens situés au débouché de la vallée de la Seybouse .
Le capitaine Mesmer, chef du bureau arabe de la subdivision de Bône rassembla en toute hâte quelques spahis et des cavaliers du caïd Karézi, avec lesquels il se porta au village de Barral. Mais dans un engagement au bord de la rivière, ce brave officier trouva la mort. Il avait, par ce mouvement offensif, préservé d'un grand danger beaucoup de colons qui, pleins de confiance dans la sécurité dont on jouissait depuis longtemps dans la plaine de Bône, y avaient fondé de nombreux établissements agricoles.
Le général de Mac-Mahon qui opérait avec le général Autemene, en apprenant la catastrophe qui venait de coûter da vie au capitaine Mesmer, se dirigea, le 14 Juillet, vers les Béni-Salah pour les châtier mais ils s'étaient réfugiés chez les Ouchtetas, tribu tunisienne ; le général les y poursuivit, pénétra dans les forêts où ils s'étaient réfugiés et leur infligea une sanglante leçon qui mit fin à l'insurrection.
On en profita pour organiser sur une nouvelle base la milice de Bône. Cette ville était en effet demeurée pendant toute l'expédition dégarnie de troupe, et bien qu'elle n'eût pas à craindre d'attaque, il fallait, le cas échéant, pouvoir protéger d'une descente les plaines avoisinantes. Le 16 Septembre, un décret créa trois compagnies d'infanterie à l'effectif de 100 hommes, une de pompier au même effectif et une subdivision d'escadron de cavalerie.
Le 21 et 22 Novembre eut lieu le vote pour le rétablissement de l'Empire. A Bône, c'est à une écrasante majorité que la proclamation de l'Empire fut approuvée. Un an après les hauts fourneaux de l'Allélik allumèrent leur premier feu.
Le 8 Juillet vit la constitution définitive de la municipalité de Bône qui comprit un maire et deux adjoints nommés par l'Empereur ; 10 conseillers dont 6 Français, 2 étrangers, 1 Indigène et 1 israélite, nommés par le gouverneur général.
Le 18 Janvier 1855 eut lieu la première séance de la Cour d'Assises. Pendant ce temps, les créations et les améliorations suivaient leur cours. 75.000 francs étaient accordés pour l'assainissement de la petite plaine. La construction du théâtre était commencée.
L'Empereur approuvait la création d'un port de commerce.
Une caisse d'épargne était ouverte au public en Avril 1855.
Enfin la ville prenait part à l'Exposition et plusieurs de ses habitants obtenaient des prix.
Depuis longtemps les habitants de Bône réclamaient l'ouverture d'une porte dans le rempart. La présence d'un nouveau théâtre rendait ce besoin plus impérieux. L'autorisation fut accordée par le général Chabaud-Latour, et la porte Saint-Augustin fut ouverte à la population le 12 Avril 1856.
A partir de cette époque jusqu'en 1870 l'histoire de Bône n'a plus de faits saillants à enregistrer, mais la ville prend son essor, elle se trouve bientôt dans sa ceinture de pierre ; on édifie la mosquée de la place d'Armes, l'église actuelle ; la mosquée des Romanets est démolie et fait place à l'établissement occupé actuellement par la justice de paix et la bibliothèque communale.
Dès cette époque fut sérieusement agitée la question du transfert du chef-lieu de la province de Constantine à Bône. Cette idée, abandonnée par la suite, devait être reprise plus tard avec une modification, le projet de création d'un département de la Seybouse.
Le bruit de nos premiers désastres eut un douloureux retentissement à Bône. On vit alors, dans un commun élan et sans distinction de nationalité, tous les gens valides se faire inscrire sur les rôles de la milice. La création d'un corps spécial de francs-tireurs fut décidée. Les Indigènes eux-mêmes demandèrent à être incorporés dans la milice où ils formèrent une compagnie spéciale.
Le 22 Novembre 1870, la compagne des volontaires de Bône s'embarquait sous le commandement du capitaine Genova et, le 1er Décembre elle faisait le coup de feu avec l'ennemi.
Nous arrivons à l'insurrection de 1871.
Les escadrons de spahis, cantonnés à la smala d'Aïn Guettar avaient reçu l'ordre de s'embarquer ; il n'en fallut pas davantage pour faire éclater une révolte que des émissaires avait déjà préparée.
Le 23 Janvier on apprenait à Souk-Ahras que les spahis de la smala avaient massacré un brigadier français et tenaient bloqués les cadres français et ceux des spahis qui n'avaient pas fait cause commune avec eux.
Un groupe d'ouvriers européens qui travaillaient à la construction de la route avaient été brusquement assaillis et ne durent la vie qu'à une fuite précipitée. Ils arrivèrent épouvantés à Souk-Ahras où ils apportèrent les premiers la nouvelle de l'insurrection. Le soir même une compagnie de francs-tireurs et un peloton de cavalerie firent une reconnaissance jusque sur le pont de la Medjerda.
Le 26, vers 6 heures du matin, les quelques Arabes qui étaient venus au marché, en général bandits de la pire espèce, commencèrent à se remuer ; criant et courant dans l'espérance d'un coup de main prochain dans la ville.
Vers le soir on apprit la nouvelle du premier assassinat, celui de M. Choiselot, géomètre, tué à un kilomètre environ de la ville, en revenant du moulin Deyron.
Vers quatre heures la ville fut attaquée du côté Ouest par les spahis et les Arabes.
L'affaire dura une heure environ. La nuit fut dure à passer pour tout le monde : les femmes et les enfants réfugiés au bordj, la milice garnissant les deux côtés de la ville et la compagnie des mobiles gardant les deux autres côtés.
Le vendredi matin, le soleil levant éclairait les scènes de pillage et d'assassinat qui se commettaient tout autour de nous. De tous côtés on voyait les spahis et les Arabes emmenant les bestiaux des fermes, incendiant les meules et les maisons. Le vendredi et le samedi la ville fut attaquée à coup de fusil, sans cependant que les Arabes fissent une tentative sérieuse.
A partir du samedi commencèrent à arriver les cadavres des victimes ; il faut les avoir vu brûlés, coupés en morceaux pour comprendre ce qui se passait en nous dans ce moment-là. Deux reconnaissances faites dans la direction de Bône, avec les quelques spahis ou Arabes de goums qui se trouvaient à Souk-Ahras et avec une section de la compagnie des mobiles, nous donnèrent la conviction que nous avions en face de nous 5 à 600 Arabes révoltés.
Le dimanche nous fûmes assez tranquilles et l'on put ramener en ville les derniers cadavres connus.
Le lundi soir enfin, après une journée passée dans le calme mais aussi dans l'anxiété, nous vîmes arriver la colonne que nous attendions avec tant d'impatience. Ce fut avec joie que nous démolîmes, pour la faire passer, les barricades que nous avions dressées.
La nouvelle de la révolte des spahis était parvenue à Bône le 26 janvier ; le même jour le général Pouget, commandant la subdivision, mettait en marche 200 mobiles et quelques tirailleurs. Le 27, le général quittait Bône avec 400 zouaves, deux obusiers et un escadron de chasseurs et arrivait le même jour à Barral où avait lieu la concentration de la colonne forte d'environ 1.000 hommes.
Le lendemain 28, à travers un pays hérissé de difficultés, par un temps affreux, cette colonne composée d'éléments si divers et de jeunes soldats exécutait une marche de 45 kilomètres et venait camper en plein pays insurgé, à Aïn-Tahamimine. Le 30, la colonne arriva à Souk-Ahras.
L'insurrection qui avait été brisée dès le début dans la subdivision de Bône avait eu pour résultat de rejeter en Tunisie un des principaux meneurs, Kablouti. Le 24, il poussa l'audace jusqu'à franchir la frontière, suivi de 500 fantassins et 300 cavaliers à quelques kilomètres de Bou-Hadjar. Vigoureusement chargés par nos troupes, ses contingents s'enfuirent laissant de nombreux morts. Le 30 Août, Kablouti faisait une nouvelle tentative mais fut complètement défait. Ce fut le dernier tressaillement de l'insurrection à l'agonie.
Bône est aujourd'hui, après Alger, sinon la plus grande, du moins la plus coquette cité de l'Algérie. Elle était appelée à un grand développement et l'espoir tant caressé des Bônois de voir leur ville devenir le chef-lieu d'un nouveau département serait peut-être devenu une réalité sans l'entrée de nos troupes en Tunisie. Bône marchait à l'avenir à pas de géant et serait devenue dans quelles années la rivale d'Oran, si une partie du courant commercial ne s'était dirigé vers la Tunisie. Néanmoins malgré cette sensible déperdition de force, la cité bônoise n'en a pas moins conservé la plus grande partie de sa vivacité ; elle s'agrandit plus lentement il est vrai mais à coup sûr ; d'immenses travaux y sont en cours d'exécution ; les riches vignobles ont envahi ses plaines et les marchandises s'amoncèlent encore sur ses quais. Bône sera toujours la coquette cité aux édifices somptueux, aux avenues larges et ombragées. Sa ceinture de feuillage que troue çà et là la blancheur des élégantes villas, laisseront au voyageur même d'un jour un ineffaçable souvenir.
FIN
Noms des maires qui se sont succédé à Bône depuis 1838
Avant la création de la commune
MM. Dussert, 1838.
Fenech, 1838-1840.
Pepin, 1840-1843.
Fisson, 1843-1844.
Fenech, 1844-1848.
Création de la commune (31 Janvier 1848)
MM. Lacombe, 1848-1854.
Mazauric, 1854-1857.
Lacombe, 1857-1870.
Bourgoin, 1870.
Dubourg, 1870-1888
Bertagna, 1888-18..
Pour mémoire, rappelons les durées
de colonisation de l'Algérie :
- Carthaginoise 714 ans,
- Romaine 584 ans,
- Vandale 100 ans,
- Byzantine 112 ans,
- Arabe 865 ans,
- Française 132 ans.
Malheureusement les analyses et critiques négatives se sont faites quasiment exclusivement sur la présence française dont l'apport dans de multiples domaines fut très important … peut-être parce que ce fut la plus récente ; mais, dans bien des domaines, ne fut-elle pas la plus riche ?
|
|
D : comme Départ, Drame, Désespoir.
Par Mme Jocelyne Mas
|
Alger, sur les quais envahis de soleil, une foule se presse.
Une colonne de personnes chargées, fatiguées, hagardes, avance vers la passerelle d'un grand paquebot.
Un homme, René, porte deux lourdes valises, sa femme Josette, suit. A son bras un grand et gros sac, qui paraît trop lourd pour ses bras frêles.
Deux enfants, Aline 8 ans et Marc 10 ans tenant serrés leurs jouets, semblent épuisés. Ils montent à leur tour sur la passerelle et arrivent sur le pont. Josette sanglote, les petits pleurent aussi. Ils pleurent de voir leur mère pleurer, ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Pourquoi ils doivent quitter leur maison, leurs amis, leur pays ? Ils vont en France.
" - C'est où la France ?
- Chez qui allons-nous ?
- en France !
- mais chez qui ? Maman ?
- Je ne sais pas ! En France. "
Laissant les enfants et leurs bagages à côté des deux chaises longues qui leur sont réservées, les parents se frayent un passage à travers la foule, pour arriver au bastingage. Là, appuyés à la rambarde, ils regardent avec intensité la ville blanche qui s'éloigne tout doucement, ils pleurent sans retenue, avec de gros sanglots qui montent de leurs cœurs meurtris. Insidieusement le rivage disparaît lentement. Les quais, les immeubles disparaissent aussi.
Josette se penche, veut voir encore son pays, sa terre. Sa tête tourne, ses pensées s'emmêlent, elle se penche encore et encore pour apercevoir une dernière fois sa vie qui s'efface. Son buste est perpendiculaire à la rambarde. Soudain, un cri déchire l'air, Josette bascule, hurle le nom de son mari : " René !! René !! ". Son corps disparaît dans le remous des vagues.
Les passagers se mettent à hurler.
René, sans réfléchir, enjambe le bastingage, se tourne un instant vers ses enfants et comme pour s'excuser : " Elle m'appelle " et saute à son tour dans le tourbillon mousseux que trace le sillage du navire.
Leurs corps disparaissent. Engloutis à jamais, dans cette Méditerranée qui a bercé leur enfance. Appuyés, plaqués contre les cabines, deux enfants hagards. Aline la bouche grande ouverte sur un cri silencieux, les yeux horrifiés, ne réalise pas ce qui vient d'arriver.
Marc hurle son effroi " Non ! Non ! Papa ! Maman ! au secours !
Qui viendra au secours de ces enfants dont l'enfance est fauchée, l'adolescence meurtrie, la vie saccagée ?
Josette est-elle tombée accidentellement ? ou a-t-elle voulu mourir, ne supportant pas l'idée de partir, de laisser sa terre, ses parents enterrés dans le petit cimetière de leur village ?
Et René ? a-t-il pensé une seconde qu'il pouvait sauver sa femme des flots ? a-t-il pensé qu'il ne lui serait pas possible de vivre sans elle ? peut-on réfléchir dans ces cas extrêmes ?
Longtemps la petite fille n'a pu prononcer une parole. Son cœur s'est refermé sur les images de ses parents. Elle n'a jamais pu raconter à personne son arrivée en France. Une vague cousine les a recueillis son frère et elle. Une femme déjà âgée, n'ayant jamais eu d'enfants, se trouvant en quelque sorte, forcée de garder ces deux là. Elle ne leur prodiguera ni chaleur, ni tendresse, ni mauvais traitement. Elle les élèvera, les nourrira sans plus.
Le frère et la sœur deviendront indissociables. Toujours ensemble, se protégeant l'un, l'autre. Se nourrissant de leurs faibles souvenirs, revivant sans cesse leur enfance heureuse avec papa et maman, avant que n'apparaisse le gros paquebot.
Quarante ans ont passé. Marc et Aline sont instituteurs tous des deux ; ils ne sont pas mariés, ils habitent tous deux, un petit pavillon dans la banlieue parisienne. Les élèves sont leur famille.
Un jour, chez une amie, devant un ordinateur, ils regardent un CD sur Alger et ses environs. Soudain, fébrilement, ils cliquent sur la souris, ils regardent de tous leurs yeux, ils reviennent plusieurs fois sur la même image. Ils revoient leur pays, les quartiers qu'ils ont connus, leurs écoles. Leurs mains tremblent, ils se regardent et leurs yeux s'embuent de larmes. Si longtemps contenu, leur chagrin remonte à la surface, libère l'étau de leur cœur.
Et les larmes coulent, coulent. Aline, maintenant sanglote. Elle ne voit plus rien sur l'écran, mais enfin, elle peut parler de ce drame qu'ils ont vécu.
Jamais, elle n'a pu en parler à qui que ce soit. Et là, elle raconte, parle, délivre son cœur de cette immense chape qui l'enserrait.
Son amie lui apporte des mouchoirs, une tasse de thé, la réconforte du mieux qu'elle peut, émue aussi aux larmes.
Peut-être que ces deux êtres meurtris par la vie, retrouveront à partir de cet instant, un peu de sérénité.
Que le fait de parler de cette tragédie soit une réconciliation avec la vie, et qu'ils pourront penser à être heureux, à leur tour, avant qu'il ne soit trop tard.
Extrait de " De la Côte Turquoise à la Côte d'Azur " Médaille de Bronze des Arts et Lettres de France, Mention d'excellence.
|
|
LES FRANÇAIS EN ALGERIE (1845)
Source Gallica : Louis Veuillot N°13
|
L'EVEQUE ET LE CLERGE.
XXI -
MONSIEUR DUPUCH avait été destiné par sa famille à la magistrature. Ses études achevées, on le laissa à Paris pour faire son droit. Il employa saintement sa jeunesse, uni à des amis de son âge qu'animait un zèle admirable, et dont plusieurs sont entrés depuis dans les ordres sacrés et sont devenus évêques, entre autres Mgr l'évêque actuel de Langres, Mgr de Blanquart, archevêque de Rouen, etc. Tous s'occupaient gaiement de bonnes oeuvres. Ils priaient en commun, allaient en commun visiter les malades, exhorter les prisonniers, faisaient ensemble des pèlerinages, l'hiver, à pied, surtout pendant le carnaval. Au nombre de cent et plus, le chapelet à la main, ils se rendaient jusqu'au mont Valérien, où ils priaient pour Paris plongé dans ses saturnales. Après avoir passé une partie de la journée devant l'autel, ils faisaient un modeste repas composé des provisions emportées dans les poches. Au milieu de tout cela un geste, un mot provoquaient des rires sans fin, et en vérité quelle raison avaient ces âmes innocentes d'être tristes ! La gaieté allait parfois jusqu'à l'espièglerie. Les réunions se tenaient chez de bons missionnaires qu'on s'amusait à réveiller en se pendant à la clochette du monastère, ou à effrayer en descendant du cénacle à cheval sur la rampe de l'escalier. Ces beaux coups se faisaient le lendemain du jour où l'on avait été entendre deux ou trois prédicateurs, et quelquefois le jour même : ce qui n'empêchait pas qu'on ne fût chaste, sobre, dévoué, et qu'on ne donnât aux pauvres la plus grande partie de la petite rente que la famille accordait pour les menus plaisirs et même pour les strictes nécessités.
Dès ce temps-là le jeune Dupuch se sentit une commisération infinie pour les pauvres enfants abandonnés, particulièrement pour les petits Savoyards, en faveur desquels il fit depuis de si belles oeuvres. Il les recueillait, formait des associations pour venir à leur aide, s'engageait à tout, acceptait tout, et ne savait plus comment sortir des embarras qu'il s'était créés. Mais l'aspect d'un de ces malheureux enfants était plus fort sur lui que tous les conseils de la raison, et, déjà chargé outre mesure, il prenait encore celui-là, et celui qui venait ensuite.
Cette tendresse pour les Savoyards lui inspira le désir d'aller vénérer à Annecy les reliques de saint François de Sales. Il voulait en même temps, par l'intercession de ce grand saint, obtenir quelques lumières sur sa vocation encore obscure. Son dessein était bien d'entrer dans les ordres, mais tantôt il le désirait plus, tantôt il le désirait moins. Sa famille lui demandait de rester dans le monde.
Arrivé à Genève, toujours si solitaire pour le voyageur et l'étranger, il s'y enferma pour réfléchir plus sérieusement sur l'emploi qu'il ferait de sa vie. Ainsi ce fut dans une chambre d'auberge, au milieu de la ville de Calvin, que le jeune homme qui devait être plus tard et bientôt même évêque d'Alger (qui pouvait alors penser qu'Alger allait avoir un évêque !) commença à regarder en face les redoutables obligations du ministère sacerdotal.
Après quelques jours donnés à ces méditations, dirigées par les conseils de l'illustre curé de Genève, M. l'abbé Vuarin, instrument d'une résurrection plus difficile peut-être que celle de l'Algérie, le jeune voyageur se rendit à Annecy. Par je ne sais quelle erreur, assez justifiée alors, la police sarde le prit pour un commis voyageur chargé de répandre les idées libérales. A peine arrivé, il reçut l'ordre de partir, s'il ne voulait être reconduit à la frontière par la gendarmerie. Il y avait dans cette rigueur de quoi faire peur à un bon et naïf jeune homme.
M. Dupuch ne manqua pas de s'effrayer, il promit de s'en aller sur l'heure. Pourtant il lui paraissait bien dur de ne pas voir le tombeau du saint : il courut remettre au curé d'Annecy des lettres de recommandation dont il était chargé. Nouvel embarras : ce curé, par une méprise plus étrange que celle de la police, le prit à son tour pour un aventurier, le reçut fort mal, et finalement, refusant de l'écouter, le mit à la porte. Le pauvre jeune pèlerin, le cœur gros, comme on pense, se hasarda néanmoins jusqu'à franchir le seuil de l'église, et, n'osant plus parler à personne, chercha tout seul le tombeau de saint François. Hélas ! il ne le put trouver ! Alors il perdit patience, et, voyant qu'il faudrait s'enfuir, non-seulement sans avoir entendu la sainte messe comme il se l'était proposé, mais encore sans pouvoir se prosterner devant les reliques bienheureuses qu'il était venu voir de si loin, il se laissa tomber à genoux dans un coin obscur de l'église, fondant en larmes. En ce moment passa un prêtre qui lui demanda ce qu'il avait à pleurer ainsi. M. Dupuch conta son aventure. Touché du chagrin qu'il laissait voir, ce prêtre le conduisit aux reliques de saint François, et le laissa les vénérer tout à son aise. Après quoi, le coeur bien remis, notre pèlerin reprit en hâte le chemin de Genève, croyant avoir à ses trousses le corps entier de la gendarmerie sarde.
Cependant les doutes de M. Dupuch n'étaient pas dissipés, ou du moins il ne sentait pas qu'ils le fussent. Il avait besoin, pour se décider, de l'autorité du prêtre qui gouvernait sa conscience. C'était feu M. Borderies, depuis évêque de Versailles. Il alla le trouver, la veille d'une grande fête, et l'entretint plus longtemps encore que de coutume de ses anciens désirs. M. Borderies le renvoya à un an. Ce long terme assigné à la décision d'un point si important désola le fervent jeune homme. Sa vocation, si incertaine encore la veille, se manifestait maintenant de manière à ne plus lui laisser de repos. Il alla, pour se calmer, entendre à Saint-Etienne-du-Mont un pieux et illustre missionnaire, M. Rozan.
Au moment où M. Dupuch entrait dans l'église, le prédicateur prononçait ces mots : " Lorsque les saints arriveront au ciel, ils pousseront un cri d'étonnement, d'admiration et d'ivresse, " et ce sera toujours ainsi! " il n'écouta pas davantage; il revint troublé de regrets, de désirs et d'attente ; il craignait que dans l'intervalle d'un an ses parents ne lui fissent faire vers le monde un pas qui serait décisif. Il passa la nuit dans ces angoisses, et ne retrouva que le lendemain, à la sainte table, un peu de calme, qui fut de courte durée, car, étant allé ensuite à la grand messe à Saint-Sulpice, une émotion si vive le saisit, que, s'agenouillant à l'entrée de l'église, sous l'orgue, il fut obligé de couvrir son visage de ses deux mains pour cacher ses larmes et contenir ses sanglots. Oubliant tout au monde dans cette effusion d'amour, il ne s'aperçut que l'office était fini que quand la plus grande partie du jour fut écoulée. O grâce de la prière et des larmes ! là où la force de l'homme s'épuise, grandit la force de l'amour. Le jeune chrétien alla retrouver son confesseur : " Non, lui dit-il, mon père, je ne dois pas attendre une année encore !"
Et, tout ému de son espérance, tout baigné de ses inépuisables larmes, il fit une vive peinture de ce qui se passait en lui. M. Borderies le regarda un moment en silence ; puis tout à coup : " A genoux, mon fils, lui dit-il, et souviens-toi ! L'autre jour je t'ai renvoyé, je devais le faire alors. Maintenant je ne t'arrête plus. Va où Dieu t'appelle ; va en paix." Le surlendemain M. Dupuch entra au séminaire d'Issy. Il y retrouva ses confrères, ses camarades de l'école de droit et des réunions de charité : l'un d'eux était M. de Ravignan. C'était en 1822, un mois après le voyage d'Annecy.
Un jour, dans une de ces récréations du séminaire qui sont si franches et si gaies, on se renvoyait mutuellement des accusations bouffonnes. " Dupuch, dit quelqu'un, veut être pape. - Non, répondit-il, évêque d'Alger." C'est qu'en effet il voulait être missionnaire, et quelle est la terre si funeste, si meurtrière et si bien défendue où le missionnaire ne puisse être appelé à souffrir et à mourir.
La vie sacerdotale de l'abbé Dupuch fut celle d'un bon prêtre, c'est assez dire. Missionnaire, il apprit ce que Dieu peut faire, et veut faire, et fait souvent pour sauver les hommes. Si l'impiété savait (mais que sait-elle?) ce qu'est la vie d'un missionnaire, elle ne s'étonnerait plus d'en voir toujours, d'en voir partout, malgré les fatigues qu'ils s'imposent, malgré les déboires dont on les abreuve, malgré les supplices par où l'on veut les épouvanter et les détruire. Des événements miraculeux les entourent; les coups multipliés de la grâce frappent autour d'eux la multitude des âmes ; ils sont habitués à voir les pécheurs les plus endurcis sortir de leur endurcissement, et les populations les plus féroces s'adoucir sous leur main qui bénit. Ils bravent les difficultés pour les avoir toujours vues disparaître, car c'est les faire disparaître que d'en triompher ; ils bravent les menaces, parce qu'ils ne craignent point la mort, ou la désirent comme un succès. Ainsi s'entretient et s'anime en eux cette foi qui transporte les montagnes.
Ce fut par une lettre de Mgr Garibaldi, internonce du saint-siége, que Mgr Dupuch apprit à Bordeaux son élection ; bien étonné surtout du siège où on l'appelait, car il n'avait pas encore été question d'un évêché à Alger.
On le pressait d'accepter ; il se hâta de consulter son archevêque, Mgr Donnet, et le sur lendemain, à la nuit, dans une pauvre maison de campagne où il s'était réfugié pendant un orage, en proie à des émotions écrasantes, il écrivit, à genoux, au saint-père, qu'il obéissait. A peine était-il de retour à Bordeaux, qu'une dépêche télégraphique le demande sur-le-champ à Paris. Il part, arrive chez l'internonce, qui le conduit aussitôt à M. Molé, président du conseil, à M. Barthe, ministre des cultes ; lui fait ensuite chercher des témoins pour ses informations, écrire la profession de foi, prêter serment à l'Église, et ne le laisse partir qu'après l'accomplissement de ces formalités. Les informations furent promptement adressées à Rome, un consistoire tenu, Mgr Dupuch préconisé, et les bulles expédiées de Rome à Paris avec la même célérité (1).
(1) Voici un passage de la bulle d'institution canonique adressée à l'évêque d'Alger. Les enfants de l'Église entendront avec joie la douce majesté de son langage.
"GRÉGOIRE, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre cher fils Antoine-Adolphe Dupuch, élu évêque de l'église de Julia-Césaréeou d'Alger, salut et bénédiction apostolique.
" ...Après avoir attentivement délibéré avec nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, sur les moyens de préposer à cette Église de Julia-Césarée ou d'Alger une personne utile et capable de produire des fruits de salut, nous avons enfin tourné les yeux de notre âme. vers vous. Né dans la ville de Bordeaux de parents catholiques et honorables, parvenu à la trente-neuvième année de votre âge, depuis longtemps prêtre et vicaire-général au spirituel de. notre vénérable frère l'archevêque de Bordeaux, vous avez ouvertement professé la foi catholique, conformément aux articles depuis longtemps définis par le siège apostolique; Louis-Philippe, roi, vous a présenté à nous par ses lettres pour occuper ce siège, et des témoignages dignes de foi nous ont fait connaître votre gravité, votre prudence, votre science, vos habitudes vertueuses et votre expérience éclairée des fonctions ecclésiastiques.
"Toutes ces choses étant pesées avec l'attention qu'elles méritaient, nous vous avons agréé, nous et nos frères les cardinaux de la sainte Église romaine, à cause de votre mérite, qui nous en faisait un devoir; et, d'après le conseil de ces mêmes frères, par notre autorité apostolique, nous pourvoyons à l'Église de Julia-Césarée ou d'Alger, nous vous proposons à elle comme évêque et pasteur, et nous vous remettons pleinement le soin, le gouvernement et l'administration de cette Eglise de Julia-Césarée ou d'Alger, tant au spirituel qu'au temporel. Nous confiant en celui qui donne la grâce et accorde la récompense, nous espérons que, le Seigneur dirigeant vos actes, l'Eglise de Julia-Césarée ou d'Alger sera utilement conduite sous votre heureux gouvernement, et que, dirigée avec bonheur, elle prendra d'heureux accroissements au spirituel et au temporel.
Recevez donc avec une dévotion empressée le joug du Seigneur qui est mis sur vos épaules, et efforcez-vous de vous acquitter de cette administration et de ce gouvernement avec tant de sollicitude, de fidélité et de prudence, que l'Eglise de Julia-Césarée ou d'Alger puisse se réjouir de la prévoyance de son chef et de son administration féconde en heureux résultats, et que vous-même vous méritiez de plus en plus, outre l'éternelle récompense, notre bénédiction, notre bienveillance, et la reconnaissance de votre Eglise.
Lorsque ce nouvel évêque de l'Afrique, ce premier évêque de l'Algérie, ayant reçu à Rome les plus amples bénédictions du père commun des fidèles, qui le chargea de pieux présents, aperçut de loin les minarets de sa ville épiscopale; lorsqu'au bruit du canon (l'église d'Alger n'avait pas de cloches encore) il toucha le sol de son diocèse; lorsque entouré des flots de ce peuple étrange, qui était son peuple, il franchit le seuil de la mosquée où l'on adorait Jésus-Christ, quels impétueux mouvements d'amour, de crainte, de foi, d'espérance, durent envahir son âme ! Il me disait tout à l'heure, causant avec moi sur la terrasse de son palais, dans le frais silence d'une de ces belles soirées d'Afrique, en face de cette mer soumise à la France, en face de cette même église dont le minaret, maintenant surmonté d'une croix, se montrait à nos yeux à la lueur des étoiles, il me disait qu'il avait pensé à tout cela avec un mélange de sentiments inexprimables : qu'il était à Alger, qu'il y était dans sa cathédrale, qu'il succédait à saint Augustin, que le premier, comme évêque, il revenait sur cette terre après quatorze siècles ; et que, répétant cette parole du psaume : Qui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum loetantem, il avait béni Dieu et pleuré de tout son coeur. Hélas ! que d'autres larmes il a dû verser !
Évêque sans clergé, au milieu d'un peuple infidèle ou incrédule, un des premiers actes de son autorité épiscopale dut être d'interdire deux des rares prêtres dont il pouvait disposer. Appuyé par les autorités les plus hautes, à Paris, par le roi, par la reine, par le ministre; à Alger, par le gouverneur-général, mais ayant contre lui une bureaucratie intraitable, qui, soit à Alger, soit à Paris, est la même partout ; repoussé par l'indifférence des riches ; trop pauvre, malgré les dons nombreux dès fidèles de France, pour pouvoir assister tant de pauvres qui venaient frapper à sa porte ; soigneusement tenu en dehors de tout conseil administratif, et n'étant lui-même que le plus tracassé des administrés ; séparé des soldats, comme nous l'avons vu ; bientôt suspect de nuire à nos progrès auprès des musulmans, à qui l'on veut absolument que sa mission fasse ombrage, il ne tarda pas à s'apercevoir que l'évêque d'Alger n'était que le curé d'une de ces paroisses de France où le conseil municipal, regardant le culte comme une charge inutile du budget, ne veut jamais ni rebâtir le presbytère, ni réparer l'église, ni surtout permettre que le pasteur paraisse hors de la sacristie, dans laquelle on se réserve d'aller le tourmenter à plaisir.
Cependant, M. le maréchal Valée avait compris que la religion était appelée à faire quelque chose en Afrique, et que là où la France planterait une croix, elle resterait plus longtemps que là où elle porterait seulement un drapeau. C'est lui qui a fait mettre des croix sur la cathédrale ; c'est lui qui a donné l'église de Blidah, et qui l'a fait surmonter d'une croix. Sans lui le croissant dominerait peut-être encore ces édifices (2).
(2) Le 4 novembre 1840 M. le maréchal comte Valée écrivit, de Blidah, à Mgr l'évêque d'Alger la lettre suivante, qui a été rendue publique : Monseigneur, Je me suis empressé à mon retour de Médeah de m'occuper de la nouvelle colonie de Blidah. J'ai pensé, comme je le devais, à donner à ses habitants les moyens généralement désirés de pouvoir remplir les devoirs de leur religion, et j'ai affecté au culte catholique une mosquée, la plus belle de la ville et heureusement placée dans la limite de la ville française. Celte mosquée, employée en ce moment comme magasin, a reçu sa nouvelle destination, à la grande satisfaction des indigènes. Je donne des ordres pour que le minaret soit immédiatement surmonté d'une croix, qui, annonçant le règne de la religion chrétienne, constatera mieux que toute autre chose l'occupation définitive.-"
" Vous aurez, Monseigneur, à désigner un ecclésiastique pour desservir " celte nouvelle église, et à pourvoir aux objets nécessaires à l'exercice du culte.
"Un petit bâtiment faisant partie de la mosquée sera un logement commode pour le curé, et un autre bâtiment également dépendant et aliénant sera affecté à une école d'enfants."
Quartier-général, Blida, 4 novembre 1840. VALEE."
M. le général Bugeaud, gouverneur actuel, semble vouloir entrer dans la même voie : il ne s'est pas opposé à ce que l'on élevât une croix sur la petite église de la Casbah, et il a permis que des prêtres suivissent nos colonnes expéditionnaires, ce qui n'avait pas encore été autorisé jusqu'ici. Mais que peuvent l'intelligence et la bonne volonté du chef, occupé de tant d'autres soins plus importants à ses yeux, contre les étroites passions des sous-ordres et les rébellions sourdes de la bureaucratie? Après deux ans, et malgré des fonds accordés dans ce but, l'évêque n'a pu obtenir encore qu'on agrandit sa cathédrale, ni qu'on lui donnât une autre église. Vainement la population européenne et catholique augmente tous les jours, vainement la population musulmane va décroissant : il faut, le dimanche et les jours de fête, prêcher en cinq langues différentes, multiplier les catéchismes en ces diverses langues, faire tout ensemble offices de paroisse et de cathédrale, offices publics et particuliers dans un édifice beaucoup trop étroit. Les réclamations de l'évêque n'y servent de rien, pas plus que les fonds alloués, pas plus que la volonté royale ou ministérielle.
J'ai déjà dit qu'il n'est d'aucune commission ni pour les prisons ni pour les hôpitaux. Il avait soumis des plans pour certaines œuvres de charité que la générosité des fidèles l'aurait mis à même d'accomplir presque sans frais : on ne l'a pas honoré d'une réponse ; mais en même temps qu'on l'éloignait de la sorte, toute son administration à lui, toutes ses actions ecclésiastiques sont sévèrement contrôlées, et souvent bouleversées : l'inspecteur de l'Université vient compter les enfants de la maîtrise, et l'accuse d'ouvrir illégalement une école. Demande-t-il au ministre de la guerre, duquel il relève, quelque chose pour le bas-chœur en lui expliquant ce que c'est, le ministre lui répond gravement qu'il se trompe, et qu'il faut par bas-chœur entendre telle chose : discussion où l'évêque, pour en finir, se résigne à avoir le dessous. Quelquefois on lui a tracé le texte de ses sermons, indiqué à quels saints il devrait dédier des églises en projet, etc. Ou nomme des desservants pour des cures dont le curé est déjà en fonctions, et puis, là où il n'y a pas de curé, on nomme un vicaire. A Blidah, le sacristain est reconnu, il exerce, on paye les menus frais du culte, il y a une église: le curé seul n'est pas agréé.
Cherchell a un curé nommé par le gouvernement, et pas d'église. Pendant longtemps le curé de Philippeville n'a rien reçu du gouvernement, ni traitement, ni vivres.
Arrivé dans la cure le 15 octobre 1839, sept mois après le digne général Galbôis le recommandait à la charité du gouverneur, sollicitant pour lui au moins une ration de vivres. Ce curé payait de sa poche cent francs par mois pour le loyer de la baraque qui lui servait d'église, et trente francs par mois pour le galetas où il se réfugiait. Tous les habitants le voyaient faire, sans se plaindre, son unique repas d'un morceau de pain. Pendant ce temps on projetait de construire à Philippeville, où il n'y a pas un Maure, une mosquée, et d'y appeler un imam. Il est à croire que la mosquée sera bâtie avant l'église, dont on a posé la première pierre, et dont il n'est plus question.
Dans une autre ville, le commissaire civil exigea qu'un frère des écoles, envoyé par l'évêque pour aider le curé et instruire des enfants pauvres, abandonnés dans les rues comme des pourceaux, fût porteur d'un certificat de moralité. C'était probablement le premier habitant de la colonie à qui l'on eût demandé une pièce de ce genre.
Il faut subir ces avanies, et bien d'autres ! Faites donc comprendre les plus simples exigences du culte à des gens qui ne le connaissent point, et qui ne le veulent point connaître! Certain fonctionnaire élevé, entendant dire qu'on allait confirmer une petite fille dont il venait d'être le parrain, demanda ce que c'était que la confirmation. Il s'était toujours contenté de croire qu'il savait à peu près ce que c'est que le baptême.
Aux tracasseries des bureaux se joignent les tracasseries de la loi, mais d'une façon particulière. Quand l'évêque invoque quelque droit, la loi n'existe pas ; s'il demande une faveur, la loi s'y oppose. En vertu de la loi de germinal, on prétend viser ses mandements ; en vertu de la loi de germinal, il réclame alors un grand et un petit séminaire : la loi de germinal est abrogée. Veut-il faire une procession, la loi de germinal reparaît, et défend la procession. Le jour de la Saint-Philippe, on avait fait dire une messe en plein air ; il semblait donc que le jour de la Fête-Dieu le saint sacrement pût sortir : on fit quelques pas hors de l'église, le ministère s'en alarma. On craignit que cette cérémonie n'eût blessé les musulmans, les juifs, les Turcs Eh ! si vous craignez tant de blesser les musulmans, retirez votre drapeau, votre flotte, votre armée, et allez-vous-en, car c'est là ce qui les blesse.
Dans le fait, les musulmans avaient seulement trouvé la cérémonie fort belle, fort touchante, et y avaient applaudi. Qui donc s'en était blessé ? quelques malheureux esprits qui, n'ayant point de Dieu, voudraient qu'il n'y en eût pas. Un commis important s'était mis en tète d'établir à Paris un collège arabe, et d'y avoir une quinzaine de jeunes gens des principales familles de Constantine et d'Oran. - Le projet le plus impolitique, pour le dire en passant, la dépense la plus folle qu'on pût imaginer.
On répandit des annonces qui semèrent partout l'inquiétude : elles étaient mal faites, eu mauvais arabe, bon pour l'Egypte, disaient les indigènes, et qu'on n'entendait pas bien. Les familles crurent qu'on voulait enlever leurs enfants pour les garder en otage; enfin le projet tomba complètement. Pas un mot, dans les correspondances de Constantine et de Bône, seuls arrondissements où l'on pût se procurer des élèves pour le collège arabe, pas un mot qui fasse mention de l'évêque, et attribue à des craintes pour la foi musulmane la panique occasionnée par ces ridicules annonces. N'importe, on trouva commode de mettre cet échec sur le compte des prédications et du zèle exagéré de l'évêque, et on l'avertit d'être plus réservé.
Nous avons cru en France que la religion catholique, depuis la nomination d'un évêque, était entourée d'honneurs par les Français, qu'on aidait cet évêque, qu'on lui rendait sa mission facile. C'est tout le contraire; et la vérité à cet égard est d'autant plus navrante, qu'on voit le bien qui pourrait se faire et qui ne se fait pas. L'évêque a été accueilli par les indigènes avec une véritable tendresse. Les riches lui ont ouvert leurs maisons, les pauvres ont bientôt connu le chemin de la sienne ; les muftis, les imams, les rabbins sont avec lui dans d'excellents rapports ; Abd-el-Kader et ses khalifats lui ont donné des témoignages de respect ; tout ce qui a le coeur brisé, tout ce qui souffre, tout ce qui n'a plus d'espérance vient à cette main épiscopale, toujours ouverte, toujours vide, et qui trouve moyen de donner toujours. Mais quelques employés français ont eu peur de sa mission, et nous n'en retirons pas les fruits !
S'il était vrai, ce qui n'est pas, que la prépondérance de la religion catholique offusquât les Maures, quel meilleur moyen aurait-elle de se faire pardonner cette prépondérance nécessaire, qu'en répandant parmi les Maures beaucoup de bienfaits? Quoi ! ils lui reprocheraient de recueillir les orphelins, de soigner les pauvres, de protéger les opprimés, et de leur dire à eux vaincus, dans leur langue, qu'ils sont comme nous les enfants de Dieu !...
Au milieu des épines de sa situation, Mgr Dupuch garde le silence, ou se loue de tout le monde ; et, reconnaissant du peu de bien qu'on lui permet de faire, il attend qu'on lui permette d'en faire davantage. Il a raison : que lui servirait de se plaindre ? Il faudra bien qu'on s'aperçoive à la fin que la religion est une force dont il n'est pas possible de se passer, à moins qu'on ne veuille laisser toujours l'Afrique aussi barbare qu'on l'a trouvée. Au sein de cette population mêlée, que d'hommes il faudra donner au prêtre, si on ne veut les donner au bourreau !
Les événements seront plus forts que les paperassiers : tout passe, l'Église et la vertu demeurent. L'évêque, puisqu'on le regarde comme un fonctionnaire, est au moins le seul fonctionnaire de l'Algérie qu'on ne puisse arracher de son siège. Il y restera, il y mourra, et il y sera remplacé par un autre qui priera, qui agira comme lui. On peut donc retarder son oeuvre, on ne peut l'étouffer ; on n'empêchera pas, si c'est à quoi l'on vise, que les musulmans ne finissent par savoir ce que c'est qu'un évêque ; déjà ils savent et disent de celui-ci qu'il est vraiment un homme de Dieu, parce que sa charité est sans bornes, et que, suivant le proverbe arabe, le morceau même qu'il a dans la bouche n'est pas à lui. Quelques-uns ajoutent, à la vérité : " Comment peut-il être chrétien ! "
Ils en diront autant de son successeur, et déjà ils s'étonneront moins d'apprendre qu'il est des vertus chrétiennes.
L'évêque a autour de lui quelques prêtres excellents. J'ai entendu souvent louer les talents et le zèle de M. Montera, de M. Daidou, de M. Crozat, curé d'Oran, de M. le curé de Bône. Je connais plus particulièrement ceux qui demeurent auprès du pieux pontife: M. Pelletan, doyen du chapitre, prêtre de Bordeaux, venu en Algérie avec Monseigneur et que j'ai vu pour la première fois s'occupant de recherches sur l'antiquité chrétienne de l'Afrique, dans une petite chambre de ce palais qui était, il y a dix ans, le palais des beys; M. G'Stalter est accouru du fond de l'Alsace pour évangéliser les Allemands qui abondent dans la colonie, et qui souffrent extrêmement, dans les villes un peu éloignées, de la privation des secours religieux (3).
(3) M. G'Stalter est un jeune homme plein de courage, qui, dans la campagne de Tagdempt et de. Mascara, se uni toujours à l'arrière-garde.
M. Suchet, le premier curé de Constantine, est un de ces dignes missionnaires qui unissent la charité du prêtre au courage du soldat(4).
(4) Les lecteurs de la bibliothèque éditée par MM. Marne connaissent les Lettres édifiantes et curieuses sur l'Algérie publiées par M. Suchet, et savent avec quelle intrépidité ce bon prêtre, accompagné de M de Toustain, qu'avait bien voulu se joindre à lui comme interprète, s'est rendu pendant la guerre au camp de l'émir pour réclamer les prisonniers français.
Avant de quitter Bordeaux et la France, Mgr Dupuch alla faire un pèlerinage à Notre-Dame de Verdelais. Après avoir prié devant la vénérable image, il demanda au curé, en plaisantant, s'il ne pourrait pas lui donner cette précieuse statue. "Non, répondit celui-ci, mais je puis vous donner le curé." Mgr Dupuch accepta, et l'excellent M. Dagret, faisant ses adieux à ses ouailles, à ses enfants dont il était chéri, partit aussitôt. Eamus et nos! Il est aujourd'hui vicaire général d'Alger, et travaille au grand catéchisme du diocèse, que, par une inspiration de piété filiale envers l'illustre patron de l'Afrique régénérée, il a voulu tirer tout entier des œuvres de saint Augustin.
C'est la chère occupation de ses journées. Je vais le voir dans ce même palais des beys, réservé à de si étranges hôtes, et je le trouve plongé dans les in-folios du saint docteur, qu'il compulse et traduit avec amour. Il veut bien m'en lire quelques passages, et nous admirons ensemble cette profonde sagesse qui sait si bien appliquer à la conduite de âme humaine la science de Dieu. Ce sera un beau livre, plein de solutions, surtout pour ce temps-ci, car Augustin vivait au milieu d'une époque agitée comme la nôtre; toutes les erreurs que la foi rencontre maintenant à combattre, il les a combattues et vaincues. Puisse le catéchisme d'Alger être lu du peuple flottant qui vient lutter et souffrir sur cette terre ensanglantée !
Dans ces pages inspirées par une foi sublime, nos braves officiers apprendraient à connaître un héroïsme plus grand et plus vivifiant que le leur, et au lieu de souhaiter d'éteindre leur raison, comme la fatigue et l'ennui les y poussent quelquefois, ils élèveraient leur âme à la hauteur de tous les sacrifices qu'on exige d'eux (5).
(5) Le Catéchisme du diocèse d'Alger, expliqué par saint Augustin, a paru. Il forme trois volumes in-8°. C'est un des meilleurs livres de religion et de philosophie qu'on ait mis depuis longtemps entre les mains des simples fidèles. Il serait à souhaiter qu'il fût plus connu.
Peu de jours après mon arrivée, je vis à l'évêché un prêtre que je ne connaissais pas ; mais dans son air, dans son langage, je croyais saisir ce je ne sais quoi de plus doux, de plus patient, de plus recueilli, qui distingue le religieux parmi les prêtres. Nuance imperceptible que l'œil chrétien s'habitue à deviner et qui est comme la marque du cloître, le pli mieux marqué de l'obéissance et du renoncement. " Cet abbé, dis-je, lorsqu'il fut sorti, ressemble à un jésuite. - On se ressemblerait de plus loin, me répondit l'un des grands vicaires; c'est un jésuite en personne. - Quoi! m'écriai-je, il y a des jésuites à Alger ? - Où voudriez-vous, me dit-on, qu'il y en eût ? C'est ici la terre du travail et du sacrifice. - Mais, ajoutai-je en souriant, si quelque jour on sait cela, le clergé algérien y perdra sa popularité.
Le clergé algérien, poursuivit mon interlocuteur, voudrait faire beaucoup de bien, et n'a pas autant de mains et de cœurs que de désirs. Ce qu'on dira, de lui n'importe guère, pourvu que quelques bons ouvriers de plus l'aident à remplir sa tâche immense. Il y a ici trois jésuites ; nous voyons combien de malades ils visitent et consolent chaque jour; à combien d'œuvres on peut les appliquer sans que leur courage et leur dévouement s'épuisent, sans que leur vertu, qui se fortifie dans le labeur, faiblisse un seul instant... Du reste, les pères ménagent la délicatesse publique ; ils n'affichent point un nom odieux, et nous-mêmes nous n'écrivons pas sur nos chapeaux que nous employons des jésuites; personne, par conséquent, n'est blessé de tant d'audace. Les malades eux-mêmes, à qui l'on ouvre le ciel au moment de la mort, apprennent seulement, lorsqu'ils sont là-haut, qu'un jésuite les y a fait entrer. Je ne pense pas qu'ils s'en offensent, et demandent à redescendre."
Je m'informai de l'adresse des jésuites, et je ne tardai point à les aller voir. La rue Salluste, où ils demeurent, est un de ces innombrables corridors percés dans l'immense pâté de bâtiments qui formait l'ancien Alger, dont la physionomie commence à changer. Leur maison, tout à fait mauresque, offre, par conséquent, la véritable image d'un cloître, moins la chapelle et le jardin. Les pères ont pourvu à la chapelle, je vous dirai comment ; quant au jardin, il n'en est point question. L'homme qui m'ouvrit la porte me regarda d'un oeil étonné. Je reconnus qu'il n'était pas accoutumé à recevoir beaucoup de visiteurs laïques ; mais moi, je ne pouvais me tromper, à la simple inspection de sa personne : ses vieux habits si râpés et si propres, son air de déférence, mêlé de fermeté, caractère qui accompagne l'homme de devoir dans les actions les plus communes de la vie, me révélaient assez qu'à cet humble poste je voyais un religieux, c'est-à-dire un homme à qui je devais le respect comme étant attaché de beaucoup plus près que moi au service de mon souverain Maître et Seigneur. "
"Mon bon frère, lui dis-je, je suis un ami; je viens visiter nos pères, peuvent-ils me recevoir? "Il me conduisit avec empressement au petit parloir disposé dans une des salles du rez-de-chaussée. Un humble crucifix de cuivre en faisait le plus riche ornement. Les autres chambres qu'on me fit ensuite visiter sont encore moins parées : un pauvre lit, deux pauvres chaises, qui seraient quelquefois bien embarrassées de montrer leurs huit pieds, une table boiteuse forment le mobilier des cellules; mais partout règne l'image de CELUI qui naquit dans une étable, et n'eut pas une pierre où reposer sa tète. Je félicitai le supérieur de cette pauvreté. " Oh ! me dit-il, nous avons ce qu'il faut. D'ailleurs nous n'habitons guère nos chambres." En effet, les digues religieux ne s'épargnent pas, et on ne les épargne pas. Lorsqu'ils ont par hasard un instant de loisir, l'étude le remplit.
La maison se termine, comme toutes les maisons d'Alger, par une terrasse entourée de parapets. Les femmes qui habitaient jadis cette demeure y venaient prendre le frais et se récréer. Les hommes n'y montaient jamais qu'à la nuit close : c'était une loi que les mœurs et les coutumes du pays rendaient nécessaire. Les Européens l'enfreignent, mais beaucoup de Maures la respectent encore scrupuleusement. Grâce à la terrasse, les pauvres femmes pouvaient respirer le grand air sans conserver leur voile.
Elles s'appelaient et causaient d'une maison à l'autre et se faisaient des signes. Celles qui attendaient le retour d'un mari livré aux hasards de la mer, doublement dangereuse pour un Algérien, puisqu'il y bravait les hommes et les flots, cherchaient à deviner si le petit bâtiment qu'elles apercevaient au loin, luttant contre les ondes, était celui qu'appelaient leurs vœux. L'aspect de ce vaste escalier de terrasses, orné çà et là de myrtes et de jasmin, animé par toutes ces femmes vêtues de couleurs éclatantes, égayé par tous ces babils, était fort pittoresque et présentait une ressource importante contre l'ennui de la vie de prison à laquelle les musulmanes sont condamnées, sans savoir se distraire par la prière ou par le travail. Aujourd'hui les terrasses, beaucoup moins nombreuses, sont aussi beaucoup moins animées à cause de l'indiscrétion des Européens logés dans le cœur de la ville. Quant à nos jésuites, ils ne gênent personne.
L'ancien propriétaire du couvent, plus jaloux peut-être que les autres, avait élevé les murs de sa terrasse à une telle hauteur, qu'ils empêchent absolument de voir et d'être vu.
C'est un cloître extérieur ajouté au cloître intérieur. Seulement quelques larges trous percés dans cette muraille permettaient de regarder chez le voisin et sur la mer. On les a bouchés, la terrasse est devenue un cabinet pour lire le bréviaire.
J'ai vu aussi la chapelle, tout nouvellement bénite. Un iconoclaste en serait content : il n'y a pas la moindre peinture. C'est un corridor qui peut bien tenir trois ou quatre personnes, outre le prêtre et son clerc. J'ai admiré le bénitier, formé d'un verre posé sur une planche,... et c'est tout ce qui mérite d'être décrit dans ce temple où, parmi les sectateurs vaincus de Mahomet, quelques prêtres à demi proscrits adorent presque en secret le Dieu des vainqueurs.
|
| Bône la coquette
Par M. Didona
Envoyé Par plusieurs correspondants
|
Tout prés du port et de la Méditerranée,
Au pied de Bugeaud domine la cité
Embaumée de jardins et d'odeurs épicées,
Elle s'appelait la rue Sadi Carnot, c'était mon quartier.
A l'ombre de ces rues le soleil s'affichait
Colorant les murs de rires et d'amitié
Quelle que soit la saison, hiver, automne, été,
Elle s'appelait la colonne et c'était mon quartier.
Elle était le domaine des filles et des garçons
Jouant à la toupie, à la marelle et au ballon,
Au noyau d'abricot, à la course au bouchon,
Ces bruits, cas exclamations, c'était notre maison.
D'la rue Sadi Carnot à la colonne Randon
Le passant solitaire trouvait un compagnon,
Qµelle que soit sa couleur, sa race, sa religion,
Il était le bienvenu dans moue maison.
Sur les bancs de l'école l'amitié fleurissait
Entre français, juifs, arabes, italiens et maltais
Et prenant son envol durait l'éternité,
C'était mon quartier où régnait l'amitié
Le rire en bandoulière, le tape cinq ravageur,
Le salut mon frère et le fier bras d'honneur,
L'enfant de mon quartier respire le bonheur,
Elle s'appelait la maison du bon dieu, c'était ma demeure.
De la place d'armes au cours Bertagna
Cafés et brasseries vous offraient la kémia
Le ricard, l'anisette et le bon kaoua,
Elle s'appelait Cordina, Mustapha, Didona, Chemama, et c'était ma casbah.
Le Forum, l'Alhambra, l'Olympia, le Majestic,
Les Variétés, le Colisée, le Jardin botanique,
Avec la basilique, le bijou maléfique,
Elle s'appelait la cité, c'était mon amérique.
Une vieille dame en blanc protégeant nos enfants,
Qu'ils fussent israélites, catholiques, musulmans,
Sainte Anne de Bône notre dame aux sentiments
Elle régnait sur la place et c'était mes quinze ans.
Le Cours Bertagna, rue Sadi Carnot, rue Garibaldi
Ont gravé leurs empreintes sur mon cœur et ma vie,
Afin que dans mes yeux ne se lise l'oubli,
Elle s'appelait Bône la Coquette, c'était mon pays.
|
|
|
PHOTOS de BÔNE
Envoi de M. R. Bussola
|
AVANT - APRES

Kiosque de la station d'essence avant 1962, rue Bugeaud

Kiosque de journaux avant 1962, rue Bugeaud

Bône vue de Bugeaud en 2007

Bône vue de Bugeaud en 2017

Place du Monument aux morts avant 1962

Place du Monument aux morts en 2017
|
|
| La femme Corse.....
Envoyé Par Hugues
|
La liberté de la femme Corse,... quel tempérament !...
Ca ne doit pas rigoler tous les jours dans les foyers là-bas !...
Deux gendarmes appellent leur quartier général et demandent à parler à l'officier de garde :
« Nous avons un problème ici, une femme vient d'abattre son mari d'un coup de fusil de chasse
parce que celui-ci a marché sur le carrelage frais lavé.»
« Vous avez arrêté la femme ? » demande l’officier.
"Non Chef.... c'est pas encore sec..."
|
|
|
LES INDIGENES ET NOUS
Par M. D. ClANFARANI.
Envoyé par M. Jérémy Lagarde
|
Le Travailleur, N° 316, du 21 mars 1925
Les socialistes algériens n'ont pas attendu les mois d'ordre de l'Etat russe pour découvrir la question indigène, en rechercher les solutions équitables et préconiser, soutenir, réclamer les améliorations immédiatement possibles à l'administration des autochtones coloniaux.
Nous n'avons cessé, de nous employer à cette tache, souvent avec courage, toujours avec une ténacité que n'ont réussi à lasser ni les injures de presse, ni les calomnies, ni les tracasseries administratives, ni les ingratitudes, que l'ignorance n'a pas manqué de multiplier, hélas !...
Les socialistes algériens peuvent revendiquer leur large part dans les réformes indigènes de ces derniers lustres: ils auront été aussi, par eux-mêmes et leurs amis du groupe parlementaire socialiste, les précurseurs et les bons ouvriers de celles qui s'élaborent. Ce n'est pas nous qui compromettrons jamais l'œuvre d'émancipation des indigènes par des violences de langage qui "expriment disait Jaurès, la révolte débile et convulsive plus que la liberté de la raison ", plus que le souci de l'avenir des masses dont on se fait le défenseur.
Ce ne sont pas les socialistes qui feront jamais litière des intérêts immédiats des populations indigènes, pour essayer de mêler ces dernières à des luttes politiques dont elles ne peuvent encore comprendre la portée et à des conflits sociaux dont elles seraient les premières victimes. Nous considérons surtout comme une malhonnêteté envers les indigènes et une trahison au socialisme l'action de fermenter l'irrédentisme colonial, d'encourager un mouvement xénophobe dans l'Afrique du nord, moins pour servir les intérêts des indigènes que pour seconder la politique extérieure de la Russie.
Car, nous l'avons dit et nous le répétons : l'agitation que les Moscovites tentent de créer dans les colonies est ordonnée dans l'unique intérêt de l'Etat russe, au mépris de toute doctrine internationaliste. C'est, d'ailleurs, un secrétaire fédéral communiste algérien qui en faisait l'aveu, le 10 février 1921 dans le journal de son parti : "Traqué par la France et l'Angleterre, l'état russe, qui sait que ces Etats puisent leurs forces dans leurs colonies, cherchent à soulever les peuples colonisés coutre les peuples colonisateurs."
Nous nous plaisons à déclarer, d'ailleurs, qu'après cet aveu de la politique imposée par Moscou, le secrétaire fédéral communiste parlait comme un vulgaire socialiste en ajoutant : " Nous pensons, nous, que le socialisme ne peut être apporté au peuple colonisé que par le peuple colonisateur", et, écœuré il a quitté le parti bolchevik.
Dans une déclaration publiée par la fédération communiste de Constantine, nous lisons aussi : " La colonisation de l'Algérie est un fait historique accompli que nous constatons... Appréciée du point de vue marxiste, la colonisation nous apparaît comme la forme nécessaire sous laquelle des nations arriérées doivent accéder à la phase d'organisation capitaliste d'où naît le communisme..."
Cela, c'est de la doctrine et c'est de la logique : mais, cela ne sert pas Moscou. Alors, nous assistons à toute cette campagne malhonnête, anti-française, anti-socialiste, contraire à toute doctrine internationaliste, qui veut faire accroire aux Indigènes que le communisme, devenu partageux (!) comme en Russie, leur partagera les bonnes terres des colons : que la France est une marâtre qui n'a rien fait pour le relèvement des indigènes et qu'il est temps que quelque Abdelkrim la boute hors de ce pays : que les ignorants marabouts et vautours de grande tente (genre Khaled) leur assureront la paix, le bien-être et la liberté: que le nationalisme musulman, enfin, est la propre voie de l'internationalisme et de la fraternité universelle... Tristes gens et pauvres victimes !
Nous autres, socialistes, nous disons aux Indigènes de ce pays : On vous trompe ! La France colonisatrice a plus fait pour votre bonheur que n'auraient jamais fait les grands seigneurs qui vous oppressaient avant 1830.
Les famines périodiques ne déciment plus les douars, ceux qui le disent mentent sciemment, le secours français assiste partout où il est besoin les populations laborieuses privées de récolte par la sécheresse et autres calamités, et non par la faute de l'Administration française. Le pays assaini a livré à la culture des étendues naguère désolées et ravagées par la malaria. La population indigène est passée de 1.500.000 âmes à 5 millions et sur 7.301.000 hectares de terres cultivées. 5000 appartiennent aux Indigènes. L'élevage, autant que l'agriculture, enrichit aujourd'hui les indigènes. Le recensement de 1920 a montré que sur 67.137 unités de l'espèce chevaline, 55.000 appartiennent aux Indigènes: il en est de même des trois quarts de l'espèce mulassière, des neuf dixièmes de l'espèce asine, et sur 427.300 têtes bovines, 302.453 sont aux Indigènes, de même la quasi-totalité de l'espèce ovine (2.636.770 têtes) et de l'espèce caprine (1.500.000 têtes). Nous pourrions aligner encore bien des chiffres édifiants...
Les échanges commerciaux, qui constituent un indice certain de la prospérité coloniale, ne dépassaient pas 6.500.000 francs à l'importation et 1.500.000 francs à l'exportation en 1830. Grâce à la paix française, grâce à la nation colonisatrice, la progression du commerce algérien s'est affirmée au fur et à mesure du développement des cultures et de I'élevage et, en 1923, l'Algérie a exporté pour un milliard et demi et importé pour deux milliards de francs de marchandises.
De huit millions qu'ils étaient en 1830, les échanges se sont élevés à près de quatre milliards en 1924.
Le Sahara même a vu revivre les vieilles oasis desséchées et naître sur des centaines de kilomètres la frondaison verte des palmiers-dattiers, l'arbre à pain des Sahariens, grâce aux nombreux puits artésiens creusés dans les sables.
La population des oasis a triplé depuis 1880 et l'exportation des dattes, presque nulle à cette époque et seulement de 20.000 quintaux en 1901, a dépassé 100.000 quintaux en 1921. Partout, la paix française a créé le bien-être et développé la vie.
Sans doute des abus furent commis et le sont encore dans bien des cas ; certes, tout n'est point selon nos désirs et selon les principes d'égalité, de fraternité et de justice qui sont les nôtres, et nul ne travaille avec plus d'ardeur, plus de foi que nous à introduire ces principes dans les lois et les mœurs de notre pays.
Mais il n'est pas vrai que ce pays et ses habitants auraient eu le même avenir, abandonnés au désordre, à l'insécurité, à l'anarchie. Il n'est pas honnête d'affirmer qu'ils auraient plus de liberté et de bien-être s'ils étaient livrés à eux-mêmes.
Et nous disons encore aux Indigènes : La France républicaine a supprimé le pouvoir des grands féodaux de jadis, ce n'est plus que votre ignorance qui leur accorde encore quelque puissance. La République instruit les fils des fellahs, les appelle dans son administration et dans les assemblées électives où ils supplantent peu à peu les seigneurs de grande tente.
La démocratie française élève les masses en savoir, en conscience et en dignité. Elle leur donne avec la liberté, leur part de pouvoir. Demain, la République accueillera dans son Parlement les représentants élus des Indigènes algériens.
Ainsi, d'étape en étape, lentement sans doute, mais sûrement, méthodiquement, les Indigènes s'élèvent à la plénitude de la vie sociale et politique française, au droit commun français. Ce ne sont pas les accidents de la route qui diminuent la beauté du paysage ; ce ne sont pas les erreurs ou les fautes administratives qui diminuent la grandeur de l'ensemble du grand œuvre français. C'est donc par la France, c'est dans l'ensemble de la nation française, forte de ses cent millions d'âmes, que les Indigènes d'Algérie et des colonies entreront dans l'Internationale des peuples libres, dont la Société des nations de Genève annonce l'avènement proche.
C'est par la République et la démocratie française que les Indigènes iront aux Temps Nouveaux, où le socialisme triomphant assurera la vie heureuse à tous les hommes, libérés des haines de races et de classes, à tous les travailleurs unis dans le labeur, affranchis des exploitations et des servitudes du présent.
D. ClANFARANI.
|
Le Prêtre, le Banquier et le Politicien
Envoyé Par M. Rémy
|
Un prêtre, sentant sa mort proche, dans un hôpital ……
Demande au médecin d'appeler un banquier et un politicien.
En quelques minutes, les deux apparurent.
Le prêtre leur demanda de s'asseoir de chaque côté du lit.
Le prêtre tenait les mains et restait silencieux.
Le banquier et le politicien étaient tellement touchés et, en même temps,
Se sentaient très importants pour être convoqués par un prêtre dans son moment de mort.
Par angoisse, l'homme politique demande :
- Mais pourquoi vous nous avez demandé de venir à vos côtés ici ?
Le prêtre rassembla toutes ses forces et dit :
- Jésus est mort entre deux voleurs. . . . . Je voudrais mourir de la même façon !!!
|
|
|
LA BATAILLE DE BAZEILLES
Par M.José CASTANO,
|
« L’arme de tous les héroïsmes et de toutes les abnégations, j’ai nommé l’Infanterie de Marine » (Maréchal LYAUTEY – 1854 – 1934)
Après l’héroïque sacrifice de la Légion étrangère à Camerone, le 30 avril 1863, où les soixante hommes du capitaine Danjou avaient tenu jusqu’au bout leur serment « de se défendre jusqu’à la mort » face à deux mille mexicains, sept ans et quatre mois plus tard, les 31 août et 1er septembre 1870, l’infanterie de marine allait écrire à son tour, à Bazeilles, sa plus glorieuse page d’Histoire.
La guerre franco-allemande oppose, du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871, la France de Napoléon III à la Prusse de Guillaume Ier. Commencée en Alsace et en Lorraine, elle voit l’armée allemande prendre l’avantage sur l’armée française du Rhin qui, commandée par le Maréchal Bazaine, est refoulée et assiégée dans la ville de Metz. Une deuxième Armée (12ème Corps d’Armée), sous les ordres du Maréchal Mac-Mahon -comprenant la Division d’Infanterie de Marine- est aussitôt formée pour lui porter secours et dégager la ville. Cependant, lors de sa difficile progression vers Metz, elle se heurte au gros des forces allemandes et doit se replier en direction de Sedan qu’elle atteint le 31 août. C’est alors que le général de Vassoigne, qui commande la division d’infanterie de Marine dite « Division Bleue », reçoit l’ordre d’attaquer, de conquérir et de tenir avec la 2ème brigade le village de Bazeilles, occupé par les Allemands, situé dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne, qui verrouille les accès sud-est de Sedan,
La « Division Bleue » avait la particularité de réunir, pour la première fois dans l'histoire des troupes de marine, des Marsouins (quatre régiments de marche) et des Bigors (un régiment d’artillerie). Elle était composée de :
- La 1ère brigade du général Reboul, formée du 1er Régiment d'Infanterie de Marine de Cherbourg et du 4e de Toulon,
- La 2ème brigade du général Martin des Pallières, formée du 2e Régiment d'Infanterie de Marine de Brest, du 3e de Rochefort et du 1er Régiment d'Artillerie de Marine de Lorient qui fournissait 3 batteries.
Le 31 août vers midi, c'est l'attaque. Le général Martin des Pallières commande l’assaut. L'ennemi est refoulé, mais sa supériorité en nombre et en artillerie lui permet, en multipliant ses attaques, de reprendre pied dans la localité. La mêlée est acharnée ; les pertes sont sévères des deux côtés ; le général Martin des Pallières est blessé et le village en feu. Néanmoins, au prix de multiples assauts héroïques et de sacrifices, les Troupes de Marine reprennent le contrôle d’une partie de la localité, sur la frontière nord. La 1ère brigade arrivée en renfort en fin de journée permet la reprise totale de Bazeilles à la tombée de la nuit.
Le 1er septembre, les forces bavaroises du général Von der Tann investissent à l’aube la localité désertée par les Français. Ce n’était qu’un piège tendu par le Commandant Lambert, sous-chef d'état-major de la division, qui ordonna aussitôt une contre-attaque victorieuse menée par 150 marsouins survoltés. Bazeilles est de nouveau française.
À ce moment survient un coup de théâtre. Le général Ducrot, qui vient de remplacer Mac Mahon blessé, veut regrouper l'armée et l'ordre est donné d'abandonner Bazeilles. Ce que l'ennemi n'a pas réussi, la discipline et la bêtise l'obtiennent : Bazeilles est évacué. Mais le général de Wimpffen, porteur d'une lettre de service, revendique le commandement et, prenant le contrepied des dispositions de son prédécesseur, ordonne que soient réoccupées les positions abandonnées.
Il faut donc reprendre Bazeilles dont les Bavarois n'ont pas manqué de s'emparer entretemps. De Vassoigne n'hésite pas et, en dépit de la colère et de la rancœur légitime de ses hommes, sa division, bien que fourbue et meurtrie, s'empare une nouvelle fois du village malgré la défense acharnée de l'adversaire.
Le 1er Corps d'armée Bavarois, renforcé d'une division supplémentaire et appuyé par une artillerie de plus en plus nombreuse, reprend son pilonnage intensif et ses attaques meurtrières qu'il combine avec des manœuvres d'encerclement, tandis que dans le village se multiplient les incendies.
Luttant à un contre dix, les soldats français, malgré les obus qui les écrasent, les incendies qui les brûlent et les suffoquent, la faim et la soif, défendent pied à pied chaque rue, chaque maison et chaque pan de mur. Ils ne cèdent le terrain que peu à peu infligeant à l'ennemi des pertes sévères. Cependant, cette résistance acharnée, cette action désespérée ne peuvent que réduire de minute en minute leur effectif… aggravé par le fait que les munitions commencent à manquer cruellement.
Vers 11 heures, la 2ème Brigade de la « Division Bleue », submergée par l’adversaire, doit se replier sur les hauteurs de la Moncelle. Pour protéger leur repli, des Marsouins au nombre d’une centaine se regroupent à la sortie nord du village, dans l’auberge de la Bourgerie que le Commandant Lambert a commencé à transformer en fortin. Comme leurs camarades légionnaires, à Camérone, ils jurent de ne pas faillir à leur mission et résistent pendant plus de trois heures à un ennemi supérieur en nombre. Les munitions venant désormais à faire défaut, c’est à la baïonnette qu’ils défendent âprement leur position. Vers 15h, les officiers encore en vie estimant que le sacrifice de ces quelques hommes d’exception serait vain, ils ordonnent l’arrêt des combats et revendiquent par la voix du Capitaine Aubert, de tirer les onze dernières cartouches, d'où le nom de « Maison des dernières cartouches », qui fit l'objet d'une popularisation comme un des hauts-faits de la guerre.
La bataille est terminée. Les Bavarois, impressionnés par le courage de ces quelques hommes fourbus, épuisés mais vaillants ne peuvent que les épargner et laissent aux Officiers leur sabre, ultime marque de respect et d’admiration. La « Division Bleue » a perdu 2655 hommes au cours de ce seul affrontement. Quarante civils Bazeillais trouvèrent la mort au cours des combats des 31 août et 1er septembre. Cent cinquante autres moururent des suites de leurs blessures dans les six mois qui suivirent la bataille. L'ennemi, pour sa part, avait laissé sur le terrain 7 000 tués dont plus de 200 officiers Ce moment d'histoire a été illustré par le célèbre tableau d’Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville, peint en 1873, représentant la défense de l'auberge Bourgerie : « Les dernières cartouches » et conservé à Bazeilles à la Maison de la dernière cartouche.
Bazeilles est resté depuis, un haut-lieu et un symbole des troupes de marine. L’anniversaire de cette bataille est commémoré chaque année dans tous les corps de troupe de France et d’Outre-mer et sur les lieux mêmes où se produisit cet événement.
Le 2 septembre 1870, Napoléon III signa la capitulation de Sedan. Cette reddition se solda par la perte des territoires d’Alsace et de Lorraine, entraîna la chute du Second Empire, l’exil de Napoléon III, l’avènement de la Troisième République et pérennisa l’établissement définitif du régime républicain en France.
« Il y a une sublimation du sens de la discipline où la contrainte devient acceptation où la soumission devient don […] qui libère l’homme, le grandit et le mène aux portes de l’héroïsme » - (Général d’armée Olié – discours à l’occasion du baptême de la promotion de l’Ecole spéciale militaire de Saint Cyr)
|
|
Souvenons-nous... C'était un 22 avril, en 1961...
22 avril 2017, par Manuel Gomez
Envoyé par M. Maurice Villard
|
ALGER-AVRIL 1961 :
Le putsch des généraux contre De Gaulle.

ALGER AVRIL 1961 :
après le « putsch » l’OAS.
Le « putsch » des généraux, comme cela était prévisible, a échoué après quatre jours d’espoir.
De Gaulle purge aussitôt l’armée :
220 officiers sont relevés de leur commandement.
114 traduits en justice.
3 régiments ayant pris part active au « putsch » sont dissous, (le 1er REP, les 14 et 18e RCP) ainsi que le groupement des commandos de l’air.
Plus de 1000 officiers démissionnent par hostilité à la politique du chef de l’état.
Les généraux Challe et Zeller sont condamnés à 15 ans de réclusion (Ils seront par la suite amnistiés et réintégrés).
Les généraux Salan et Jouhaux disparaissent et entrent en clandestinité.
Pendant ce temps-là, Georges Pompidou rencontre en Suisse, sur l’ordre du chef de l’état, des représentants du FLN afin d’entamer des négociations.
Il ne reste plus qu’un seul recours, contre la politique d’abandon mise en place par De Gaulle : l’OAS (Organisation Armée Secrète).
Dès lors le destin de l’Algérie, notre destin, est entre nos mains.
Officieusement l’OAS avait fait son apparition, à Alger, dès février 1961, organisée par le Colonel Godard et les premiers sigles font leur apparition peu de temps après.
Une partie de l’armée a suivi ses chefs ainsi que la majorité des Français d’Algérie.
Or, dans cette majorité, la proportion de la population de gauche (communiste et socialiste) était la plus importante, notamment à Bab-el-Oued.
Le docteur Jean-Claude Pérez se voyait confier l’O.R.O., branche dure, avec comme adjoint le Lieutenant Degueldre, ancien officier du 1er REP, responsable de la formation et de la direction opérationnelle des futurs commandos deltas.
Le Capitaine Pierre Sergent était envoyé en Métropole pour organiser l’O.A.S. Métro.
A Madrid l’organigramme définitif est mis en place.
Le général Salan en prend le commandement.
Il estime en son âme et conscience que les décisions du gouvernement français en ce qui concerne UNIQUEMENT l’indépendance de l’Algérie sont contraires à l’intérêt de la Nation. (Tout comme l’avait fait en 1940 le « général » De Gaulle après la décision de signer l’armistice par le gouvernement de Philippe Pétain).
Il estime également que, contrairement au général De Gaulle, il y va de son honneur, et de l’honneur de tous les officiers qui l’ont rejoint, de respecter la parole donnée, par De Gaulle, de conserver l’Algérie à la France.
De très nombreux résistants de la grande guerre et des compagnons de la Libération rejoignent l’OAS :
Georges Bidault (Président du dernier Conseil National de la Résistance (CNR), après la disparition de Jean Moulin, et qui succèdera au général Salan, dès son arrestation, à la tête de l’OAS) les colonels Château-Jobert, Savelli, Ceccaldi, et bien d’autres.
Alain Peyrefitte, ministre, très proche de De Gaulle, n’hésite pas à affirmer que l’OAS « c’est le sursaut d’un peuple qui ne veut pas mourir ».
Dans son livre « C’était De Gaulle » il fait part de cette confidence du « général » : « Les gens de l’OAS me haïssent parce qu’ils sont aveuglés par leur amour de la France. Mais si ceux qui soutiennent le FLN (les Français) me haïssent tout autant c’est parce qu’ils sont aveuglés par leur haine de la France ».
C’est donc pour « amour de la France » que le général Salan sera jugé et condamné à perpétuité et le général Jouhaux, sans doute parce qu’il était « Pieds-Noirs », à la peine de mort (commuée par la suite).
Les généraux Salan, Jouhaux, Bigot, Faure, Gouraud, Mentré, Nicot et Petit, ainsi que les centaines d’officiers qui avaient rejoints l’OAS, seront réintégrés dans l’armée par la loi d’amnistie de novembre 1982, sous la présidence de François Mitterrand.
Le général de Pouilly, un fidèle parmi les fidèles à De Gaulle, n’hésitera pas à écrire : « J’ai choisi la discipline mais choisissant la discipline, j’ai également choisi avec mes concitoyens et la Nation Française la honte d’un abandon et, pour ceux qui n’ayant pas supporté cette honte et se sont révoltés contre elle, l’Histoire dira peut-être que leur crime est moins grand que le nôtre. »
|
|
| Le plaisir d'essence.
Envoyé par Elyette
| |
Dans ce monde de brut
De moins en moins raffiné
Nous passons Leclerc de notre temps
A faire l'Esso sur des routes, pour,
Au Total, quel Mobil ?
On se plaint d'être à sec,
Tandis que le moteur économique,
En ce temps peu ordinaire,
Est au bord de l'explosion,
Dans un avenir qui semble citerne.
Il conviendrait de rester sur sa réserve,
Voire, jauger de l'indécence de ces bouchons
Qu'on pousse un peu trop loin.
Il y a des coups de pompes
Ou des coûts de pompes
Qui se perdent.
La vérité de tout cela sortira-t-elle du puits de pétrole ?
Qu'en pensent nos huiles ?
Peut-on choisir entre L'éthanol et l'État nul,
Voilà qui est super inquiétant!
C'est en dégainant le pistolet de la pompe
Qu'on prend un fameux coup de fusil.
Je vous laisse réfléchir sur cet axe-là ou sur ces taxes-là.
Auteur inconnu.
|
|
|
Lettre des Volontaires
Envoyé par M. Rémy Lafranque
|
Communiqué du Général Christian Piquemal, radié disciplinairement des cadres, par décret du 23 août 2016 du Président de la République
J'ai appris par la presse ce matin le rejet de mon recours devant le Conseil d 'Etat alors que je n'avais même pas été informé personnellement, auparavant, de la décision.
1/ Sur la forme, je tiens à souligner le manque de respect d'une élémentaire courtoisie du Conseil d'Etat qui s'est permis de publier un communiqué de presse mentionnant un manquement au devoir de loyauté alors que le principal intéressé n'a même pas été informé du sens de la décision. Ce procédé, venant de la plus Haute juridiction administrative française me semble proprement scandaleux et inqualifiable !
2/ Sur le fond, je dénonce le manque de loyauté de la procédure devant le Conseil d'Etat qui n'a pas répondu à l'argumentation précise invoquant une violation directe du principe d'égalité garanti par la déclaration des droits de l''homme de 1789.En effet, les officiers généraux sont comme les conseillers d' Etat des fonctionnaires nommés par le Président de la République en vertu de I'article 13 de la Constitution et soumis les uns comme les autres au devoir de réserve. Un officier général en deuxième section ou un conseiller d'Etat en disponibilité - comme par exemple M . Wauquiez - sont dans des situations tout à fait comparables au regard du devoir de réserve lorsqu'ils font de la politique. Pourtant personne n'imagine reprocher aux conseillers d'Etat engagés en politique un manquement au devoir de réserve ou encore moins à un devoir de loyauté.Au contraire le Conseil d'Etat va même jusqu'à valider le système qui permet à ses membres d'avancer en grade pendant qu'ils font de la politique : à cet égard ils sont dans une situation comparable à celle dans l'armée d'un militaire s'engageant en politique au grade de lieutenant, qui obtiendrait ensuite une retraite de général sans avoir ou presque servi dans l'armée.Cela ne pose aucun problème à la Haute juridiction, qui en revanche n'accepte pas qu'un général, ayant servi pendant 39 années au service de la France, puisse s'engager en politique alors même que le statut général des militaires tel qu'il a été révisée en 2005 à l'instigation de Renaud Denoix de Saint Marc lorsqu'il était Vice Président du Conseil d'Etat, le permet.
On constate même que le Conseil d'Etat refuse même jusqu'à répondre à l'évocation de la comparaison entre un officier général et un de ses membres.
Le Conseil d'Etat a également balayé d'un revers de main l'invocation de l'atteinte à la liberté d'expression garantie par la convention européenne des droits de l'homme à un seul motif que le but poursuivi par la sanction était légitime. Il se trouve que normalement lorsqu'une atteinte à une liberté fondamentale est portée, le juge vérifie la proportionnalité de l'atteinte à l'intérêt public en jeu. Nulle trace d'une telle balance ici : pour le Conseil d'Etat, toute privation de liberté d'un officier général est légale dès lors qu'elle est utile aux autorités politiques Le Conseil d'Etat approuve la sanction de radiation appliquée en indiquant qu'elle est justifiée par le fait que je n'exerçais plus de fonctions militaires. Or, en admettant cela il reconnaît lui-même que je ne pouvais pas manquer au devoir de réserve envers des autorités militaires avec lesquelles je n'avais pas de liens. Le Conseil d'Etat ayant décidé d 'apporter par un communiqué une publicité spéciale autour de cette décision empreinte de contradictions, qui ne prend pas la peine de répondre à mes arguments ou de justifier les raisons pour lesquelles il les écarte, j'ai décidé de défendre mon honneur par la voie d'un communiqué de presse, en me réservant la possibilité d'obtenir la reconnaissance de mes droits devant la Cour européenne des droits de l'homme. Général (2S) Christian PIQUEMALLe samedi 23 septembre 2017.
Volontaires-France - Christian-PIQUEMAL
Général Christian Piquemal,
|
| COMMEMORATIONS
Journée du 25 septembre
Envoi de M. Nicolas Duchene
|
|
Deux photos, prises lors de la commémoration de la journée des Harkis, hier à MOUANS SARTOUX(06).
Il est à noter que MOUANS choisi sur le plan départemental, a été exemplaire en 1964 qaunt le village de 2000 habitants recevait 500 harkis. Comme partout, ils ont été parkés dans un camp de préfabriqués à l'extérieur de la commune au coeur d'un site forestier.
Le Maire de l'époque a jugé cette situation intolérable et leur a construit des logements sociaux au coeur du village.
Reconnaissants, les harkis se sont fondus dans la population et l'on rretrouve aujourd'hui des fils et filles de harkis, directeur des sports, conseiller municipa, responsable des installations sportives etc....
La cérémonie, il est vrai, n'a pas été suivie par des jeunes de 3° génération ! par contre des lycérns ont lu un texte afin de perpétuer le souvenir de cette page de notre histoire.
| |
LIVRES
Envoyé Par M. Robert Puig
|
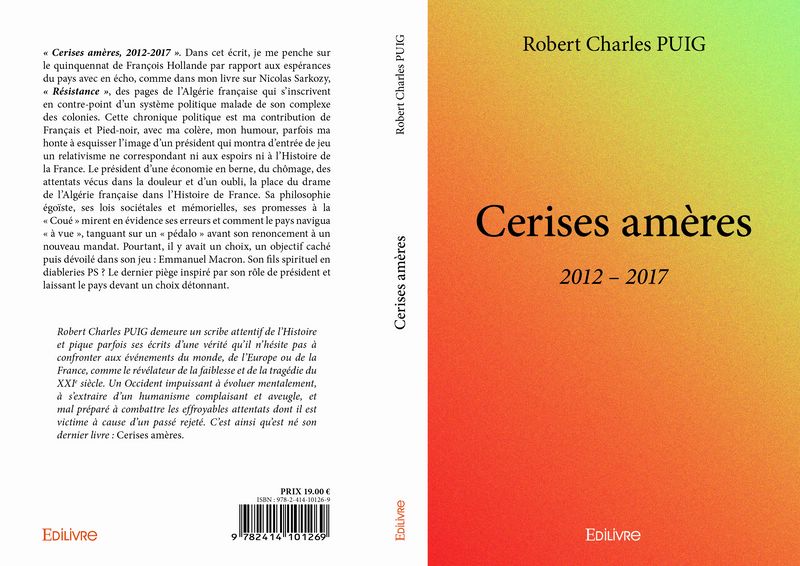
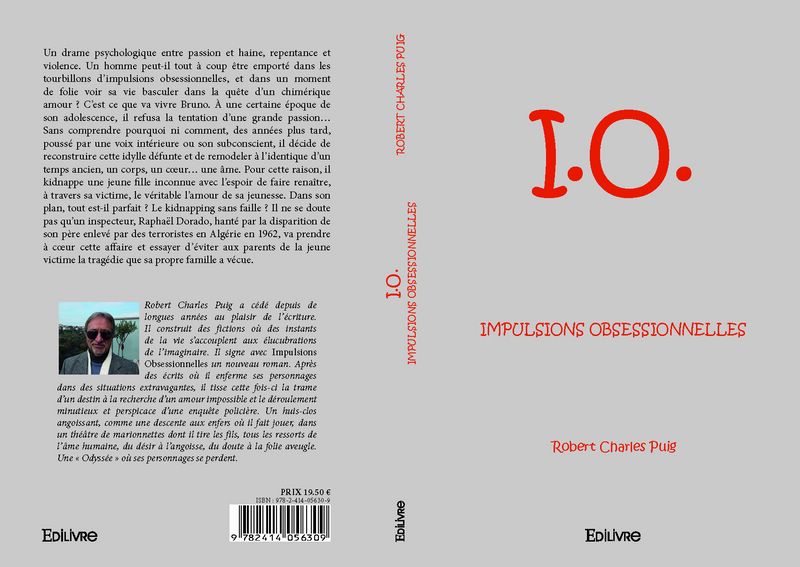
Chers Compatriotes,
Après I.O. ,Impulsions obsessionnelles, que vous trouvez chez Edilivre (tel 01 4162 14 41) ou en commande à la FNAC et les sites en lignes, voilà mon nouveau dernier né : Cerises amères.
C'est un essai sur le quinquennat de F. Hollande.
Toujours le même éditeur, mêmes lieux de commande, pour votre plaisir.
Bien entendu, je note les travers des 5 ans de PS et hélas, une élection en 2017 qui n'est pas conforme à ce que nous étions nombreux à espérer.
Bonne lecture et cordialement. Robert C. PUIG
|
Un Extrait
Impulsions obsessionnelles
L'inspecteur Dorado
Ce qu'il appréciait par-dessus tout, l'inspecteur Dorado, c'était son action en indépendant. Il avait un caractère renfermé, solitaire… Personne ne se doutait que sa vocation de policier avait une raison d'être. Il l'avait embrassée très jeune pour répondre à un vœu de sa mère… C'était loin ce souvenir ! Maintenant, il était à quelques mois de la retraite, mais il se rappelait bien le contexte de cette décision… Il avait demandé à sa maman comment son papa avait disparu à Alger, en 1962 ? Il était né quelques mois après à Paris, mais hanté par l'image d'un père qu'il n'avait pas connu, il souhaitait que sa mère lui rappelle son départ d'Alger sur le " Ville d'Alger " dont il conservait une photo… elle était quelque part dans un classeur… Sa mère, au milieu de larmes toujours vivaces à ce rappel du passé, lui répondait que son père avait été enlevé par des terroristes sur les hauteurs de la capitale alors qu'il rencontrait un client. Depuis ce jour, elle l'avait attendu, longtemps… penchée au balcon de l'immeuble au 15 des Tournants Rovigo, puis elle avait remué ciel et terre pour avoir de ses nouvelles.
Pas un seul service de l'État français ou un organisme de l'administration ne lui apporta le moindre soutien… Un mur de silence couvrait les transactions secrètes se poursuivant entre le gouvernement français et le camp des terroristes à Évian… pour aboutir à l'indépendance et l'Exode des Pieds-noirs.
Aucun drame, même le plus sordide, ne devait influencer les discussions de l'Exécutif parisien avec les tueurs de FLN.
Pour cette raison, son père était devenu un corps sans sépulture, un néant. Juste un nom sur un bout de papier, lorsque sa maman décida de rejoindre la Métropole... Elle était étreinte par l'émotion au rappel de ces souvenirs et lui expliquait : " Sur le " Ville d'Alger ", j'étais restée sur le pont arrière et je voyais s'estomper la ville tandis que dans mon ventre tu bougeais comme si tu voulais assister à ce spectacle d'Alger la Blanche disparaissant dans la brume du matin... pour un départ sans retour et sans plus savoir ce que ton père sera devenu. "
Ces mots, ce désarroi de sa maman marquèrent à jamais Raphaël Dorado qui se posait un tas de questions sur cette disparition.
Comment avait-il vécu sa séquestration, l'angoisse d'une cellule, la torture ? Sa mort lente, insidieuse, progressive, jusqu'au douk-douk qui tranche la gorge ! Ce scénario, Raphaël l'avait construit au fil de ses lectures sur les événements d'Algérie… plus tard, à son adolescence. Combien de femmes, d'enfants, d'hommes, civils et militaires disparurent sans laisser de trace durant ces années terribles ? Ils étaient cendre, poussière sur une terre abandonnée ! Né après le drame, Raphaël pleurait ce père inconnu. Il ne comprit que tardivement, après le lycée, le tragique destin de ce bout de France et la collusion entre l'État français et les terroristes, vers les derniers mois de la présence pied-noire sur cette terre de soleil. Un abandon du gaullisme mensonger, fallacieux mais programmé !
Pour cette raison, à cause de ce drame familial, il avait fait le serment à sa maman de défendre le droit et l'innocence ; de s'opposer au désordre et aux criminels et de toujours mener ses enquêtes à leurs termes.
Robert C. PUIG
|
|
VIEILLIR EN BEAUTE
Envoyé par Hugues
|
Voici un très beau texte plein de philosophie, dont on ne connaît pas l'auteur, pas facile à appliquer tous les jours, mais plein d'espérance.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur;
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens d'ajouter Petit, Clauzel, Guelât Bou Sba, Héliopolis, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Duvivier, Duzerville, Herbillon, Kellermann, Milesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Penthièvre, Randon, Kellermann et Millesimo, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
|
Le projet accuse 10 ans de retard
Envoyé par Pierre
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/9003349-le-projet-accuse-10-nas-de-retard
Par Est Républicain 17 Sep 2017 l Par M. B. Salah-Eddine
Dédoublement de la voie ferrée Annaba-Ramdane Djamel
Parfois la fiction rejoint la réalité. Alors comment expliquer qu’un projet, ayant fait de nombreuses prospections approuvées en haut lieu et prises en charge par des bureaux d’études qualifiés une fois son budget également arrêté et dégagé, et dont les travaux ont été accordés à une entreprise étrangère (Espagnole) pour un délai déterminé de 38 mois, soit toujours en souffrance une décennie après ?
En effet, plus d’une décennie après son lancement le projet du dédoublement de la voie ferrée Annaba-Ramdane Djamel, sur une distance de 78,3 km, souffre encore. Il est l’unique projet à l’échelle nationale dans ce domaine qui soit toujours à la traine. Les raisons : les travaux du tracé n’avancent pas entre les communes d’Azzaba et de Ramdane Djamel dans la wilaya de Skikda, pour des problèmes ayant surgi, au lendemain de leur lancement avec des propriétaires terriens et les habitants des bidonvilles implantés sur le tracé.
Si du côté de la partie relevant de la wilaya d’Annaba, les travaux du tracé et de pose des rails ont été achevés, voire livrés même si cependant avec quelques années de retard, pour le lot de la wilaya de Skikda c’est toujours la pagaille. Comble de l’absurdité, aujourd’hui même les travaux du tracé exécutés au début du lancement du projet par l’entreprise espagnole en charge sont à refaire. En réalité, l’infrastructure routière en général a été privilégiée par l’Etat à Annaba comme à Skikda ou ailleurs. Pour les experts, c’est surtout l’incompétence qui est la cause de cette situation scabreuse. Les menaces faites publiquement par plusieurs ministres ayant succédé à la tête du secteur, lors de visites, se sont avérées lettre mortes. En attendant une prise de conscience des commis de l’Etat pour mettre définitivement sur rail ce projet, il est utile de rappeler qu’une fois le dédoublement de la voie mis en service, il permettra de sécuriser davantage le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, et d’offrir un gain de temps puisque la vitesse de ligne pourra atteindre les 200 km/h.
B. Salah-Eddine
Annaba : Promenade de la Corniche
Envoyé par Alain
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/9003348-une-amelioration-remarquable
Est Républicain l Par Ammar Nadir - 17 Septembre 2017
Une amélioration remarquable
Avec la morosité ambiante il est bon de constater qu’en matière d’amélioration urbaine, des résultats probants peuvent être constatés, notamment en voyant le changement radical de la promenade de la Corniche qui va du Lever de l’Aurore jusqu’à la plage Fellah Rachid ex Saint-Cloud. A L’exception des balustrades, certaines en métal et d’autres en maçonnerie, certaines parties de cette promenade, en plus d’être dépareillées, agrégat, béton, carreaux ou simple ciment, remontaient au colonialisme.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, tout a été refait en béton estampé et actuellement c’est le caniveau qui est en train d’être aménagé, pour l’écoulement des eaux. Des palmiers ont été plantés tout le long du parcours et des poubelles posées ainsi que des bancs publics sur la partie la plus large. Toute la balustrade a été refaite uniformément ainsi que l’éclairage public. L’autre côté de la route n’a pas été oublié et le trottoir en certaines parties inexistant avant est maintenant refait à neuf, entièrement.
Cette promenade a été citée en premier par Gérard Depardieu, lors de sa dernière visite à Annaba comme remarquable. Le comédien habitué aux grandes villes ne parlait pas en l’air en préjugeant des potentialités qu’elle pouvait offrir alors qu’à ce moment, son réaménagement venait à peine de commencer. C’est le cas aujourd’hui où la phase des finitions est en passe d’être achevée. Elle offre au promeneur ou marcheur tout ce qu’il peut désirer, une marche aisée, des espaces pour se reposer et une vue imprenable sur la mer, avec le son du ressac et une senteur iodée qui couvrent largement les sonorités et les odeurs de la circulation automobile. Certes, ce réaménagement n’est pas l’unique amélioration urbaine à Annaba mais c’est remarquable parce que reflétant la vocation balnéaire de la ville, d’abord et impressionnant ensuite. En effet, ceux qui visitaient la ville et empruntaient cette promenade auparavant étaient séduits mais aussi désolés en voyant son piteux état. Ce qu’ils ne manquaient pas de signaler. Plus maintenant !
Ammar Nadir
LA MONNAIE EUROPÉENNE SE FAIT DE PLUS EN PLUS RARE SUR LE MARCHÉ l
Envoyé par Gérard
http://www.liberte-algerie.com/actualite/leuro-franchit-la-barre-des-200-da-277984
Liberté Algerie Par B. Khris - 25 septembre 2017
L’euro franchit la barre des 200 DA
Des cambistes exhibent leurs billets.
Cette diminution subite de l’offre est essentiellement due au grand rush des citoyens pour changer leurs dinars.
Les premiers méfaits de la décision prise par le gouvernement de recourir à la planche à billets pour tenter de juguler la crise financière, commencent à se faire sentir sur la scène socio-économique du pays. L’impact est tellement foudroyant et direct qu’il a engendré aussitôt une flambée inédite sur le marché noir des devises du square Port-Saïd d’Alger. Hier, l’euro a dépassé pour la première fois, la barre symbolique des 200 DA ! La monnaie européenne s’échangeait dans cet espace financier informel à 230 DA.
Pour acquérir 100 euros, l’acheteur doit donc débourser 23 000 DA ! Un seuil jamais atteint depuis le début de l’histoire de cette “bourse parallèle” très active au cœur de la capitale. Personne parmi les cambistes ne voulait s’exprimer au sujet de cette hausse impromptue de l’euro. “Je ne suis qu’un simple employé. Je n’ai pas d’explication à vous donner”, déclare Mohamed, la cinquantaine révolue, rencontré en face du café qui sert de lieu de négoce et de transactions. Par sa façon de parler, notre interlocuteur veut incarner le rôle de cet agent qui discute avec sérieux et aisance de son métier derrière son bureau. “Nous n’y sommes pour rien, nous. Nous serons les premiers à subir l’inflation qui découlera de cette importante hausse de l’euro. Ainsi, la boîte de Doliprane que nous achetions jusque-là à 100 DA, nous sera proposée à 200 DA”, indique-t-il.
Ce courtier informel précise que l’euro était vendu samedi dernier à 193 DA. En l’espace d’une journée, sa cotation a augmenté. Son collègue Nassim, un autre revendeur, n’en dit pas plus. Les traits de son visage cachent mal sa méfiance à notre égard. En dépit des présentations faites, il semble ne pas être convaincu et les quelques furtifs mots qu’il prononce en guise de réponse confirment son appréhension par rapport à notre présence sur les lieux. “Je ne suis pas en mesure de vous donner les origines de cette flambée”, se contente-t-il de dire, une manière de mettre un terme à la discussion. Les autres cambistes tiennent le même langage. Hier, comme à l’accoutumée, en plein jour et devant des policiers, sans être aucunement gênés ou inquiétés, de nombreux cambistes, au vu et au su de tous, vendent et achètent des devises.
À vrai dire, ces derniers composent la catégorie de personnes, des habitués de cette place financière informelle, qui rachètent les devises en troisième main et les revendent en fixant des marges bénéficiaires. Ils sont approvisionnés en devises tôt le matin par des “patrons” qui leur fixent le taux de change en toute liberté et de manière unilatérale. Ces gens font partie d’un réseau puissant qui a accaparé le marché noir des devises à travers tout le territoire national, depuis de longues décennies. Leur présence au square est très courte. Ils quittent la place à 11 heures, après avoir alimenté le marché. Ce sont les revendeurs en deuxième main qui prennent le relais ensuite. Ces barons profitent de cette période de doute qui caractérise actuellement la situation financière du pays pour imposer leur diktat et gérer comme bon leur semble le marché noir des devises. L’euro a franchi le seuil des 200% car il est constaté ces derniers jours, une raréfaction de cette monnaie sur les places boursières parallèles, implantées à l’échelle nationale. Cette diminution subite de l’offre est essentiellement due au grand rush des citoyens pour changer leurs dinars en monnaie européenne, à la recherche d’une valeur refuge. La dévaluation que continuera à subir davantage le dinar algérien, sous l’effet négatif de la planche à billets, a provoqué un vent de panique au sein des Algériens qui ont amassé quelques économies. Le discours comminatoire du Premier ministre a créé en eux une certaine crainte. Ils ont tout simplement peur pour leur argent. Il a suffi d’une simple intervention orale de M. Ouyahia devant les députés, pour que des citoyens cherchent d’autres placements refuges à leurs capitaux. L’on s’interroge d’ores et déjà sur les répercussions, voire les chocs que connaitra la scène économique du pays une fois la réglementation relative à ce financement non conventionnel entrée en vigueur…Cette plongée du dinar a créé une forte demande de l’euro au square. Cependant, certains observateurs pensent que ce pic atteint par l’euro ne peut aller au-delà des 300 DA sinon, il n’y aura pas assez d’argent à échanger.
B. Khris.
ANNABA
Envoyé par Claude
http://www.liberte-algerie.com/est/enfin-un-marche-des-fruits-et-legumes-pour-berrahal-277913
Liberté Algérie Par BADIS B - 24 septembre 2017
Enfin un marché des fruits et légumes pour Berrahal
Le nouveau marché de Berrahal, mettra-t-il fin au commerce illicite des fruits et légumes ?
Fort de plus de 40 locaux de différentes superficies, celui-ci était en souffrance depuis plus d’une décennie.
Est-ce le début de la fin du commerce illicite des fruits et légumes à Berrahal, point noir depuis des années, et dont l’activité anarchique en plein centre-ville donne à la cité une image d’une autre époque ? Tout porte à le croire, après la réception d’un marché digne de ce nom, après plus d’un demi-siècle d’indépendance. Tout le monde le dit d’ailleurs : une fois ouvert, ce marché sera certainement une bouffée d’oxygène pour la ville, totalement prise en otage par les tenants du commerce informel, lequel a causé à l’environnement de sérieuses entraves. Fort de plus de 40 locaux de différentes superficies, doté entre autres d’un bureau d’hygiène et de sécurité, ce marché à étages était en souffrance depuis plus d’une décennie. Les travaux de réalisation de cet édifice ont été relancés grâce aux efforts consentis par le P/APC. À rappeler que durant la nuit du 4 au 5 août dernier, une catastrophe a été évitée de justesse à la cité des 400-Logements, après un incendie qui s’est déclaré au site abritant le commerce informel, engendrant la destruction de 19 étalages de fortune, 3 magasins et 3 appartements partiellement incendiés.
Cet incendie était pour les habitants une aubaine pour mettre définitivement un terme au commerce informel qui s’est installé depuis des années déjà aux portes de leurs maisons. Ainsi, les habitants ont fait échouer toutes les tentatives de certains commerçants illicites qui veulent réinvestir les lieux.
Il est vrai que, livrée aux activités illicites, la cité 400-Logements, située en plein centre-ville de Berrahal, se dégrade davantage, au grand regret des locataires. Les habitants se plaignent de la détérioration non-stop de leur quartier et ne cachent pas leur amertume. Au même titre que les commerçants implantés dans la cité en question se disent très mécontents de leurs élus, qui seraient restés insensibles aux conditions de vie qui leur sont imposées depuis quelque temps, en appelant pour la circonstance le chef de l’exécutif à une prise en charge réelle de leurs récriminations. Enfin, le maire a tenu à souligner dans ce cadre que “de multiples opérations de recensement ont été exécutées par des équipes mixtes et ayant ciblé les commerçants des fruits et légumes, dont certains ambulants et d’autres activant à l’aide de charrettes à bras ou d’étalages de fortune érigés sur les trottoirs. C’est à travers ces actions qu’une commission installée pour la circonstance a établi une liste provisoire des commerçants devant bénéficier de ces stands commerciaux”.
BADIS B
L’Algérie dans les filets de la crise financière
Envoyé par Eliane
http://www.liberte-algerie.com/actualite/lalgerie-dans-les-filets-de-la-crise-financiere-277110
Liberté Algérie Par K. Remouche ; 11 septembre 2017
EN DÉPIT DE 531 MILLIARDS DE DOLLARS DÉPENSÉS ENTRE 2000 ET 2017
La manne injectée principalement dans la réalisation des infrastructures n’a pas permis de construire une économie moins dépendante des prix des hydrocarbures.
Le plan d’action du gouvernement Ouyahia énumère les réalisations durant la période 2000-2017. Pour seulement les quatre dernières années, l’Algérie enregistre des progrès significatifs dans le développement humain. Le texte cite la livraison de près d’un million de logements, l’augmentation de la population scolaire de 700 000 élèves supplémentaires, la réception de 26 hôpitaux et de 89 polycliniques, le raccordement de près de 900 000 foyers au gaz et d’un nombre équivalent à l’électricité.
e document note qu’en près de deux décennies le pays a enregistré d’importants progrès en matière d’infrastructures de base : 37 nouveaux barrages, plus de 22 000 kilomètres de nouveaux réseaux routiers,1 100 kilomètres de liaisons autoroutières et près de 3 400 kilomètres de rocades et voies express, 2 200 kilomètres de voies ferrées nouvelles…
Le texte cite également le triplement de la population estudiantine passée de 500 000 à 2 000 à plus de 1,6 million d’étudiants, le doublement du nombre des établissements de l’enseignement supérieur au nombre de 106 aujourd’hui, le passage de l’effectif des enseignants universitaires de 18 000 en 2000 à près de 70 000 en 2017. Le taux de raccordement de la population à l’eau est de 98%, celui au réseau d’assainissement atteint 91%. L’État au titre des programmes de soutien à la relance économique de 2001 à 2009, du programme quinquennal de développement 2010-2014 et des budgets de 2015, 2016 et 2017, a réalisé 101 hôpitaux, 1 235 polycliniques, 3,5 millions de logements, 27 maisons de culture, 44 stades omnisports et 605 complexes sportifs de proximité, 3,9 millions de foyers raccordés au gaz, 5,3 millions raccordés à l’électricité, 3 300 kilomètres de rocades et voies express.
Tous ces chiffres semblent vouloir montrer que le bilan du chef de l’État depuis son investiture reste positif. Pour preuve, les avancées précitées entre autres en matière de développement humain. On aura dépensé 531 milliards de dollars durant cette période pour parvenir à ces résultats. Mais ce qu’occulte ce satisfecit, c’est qu’en dépit de cette importante manne investie, l’Algérie est aujourd’hui gravement affectée par la crise financière faute d’avoir construit, grâce à cette manne, une industrie hors hydrocarbures, une économie plus intégrée moins dépendante de l’étranger. Résultat des courses : la facture importations atteint près de 60 milliards de dollars (chiffre cité dans le plan d’action), pour des exportations de l’ordre d’environ 30 milliards de dollars, à l’origine de l’important déficit de la balance des paiements. Dans ses importations globales, la facture importations de services dépasse les 10 milliards de dollars. Ce qui dénote la forte dépendance à l’égard de l’étranger, pour les études, l’ingénierie, voire dans la réalisation. Ainsi, peu de progrès ont été effectués durant toute cette période pour renforcer les capacités d’études, d’ingénierie et les moyens de réalisation nationaux en vue de réduire les énormes transferts de devises à l’étranger au titre de ces activités.
Comme à l’accoutumée, on est beaucoup plus dans une approche quantitative que qualitative. On a réalisé certes 78 stades omnisports et 648 complexes sportifs de proximité, mais sans pouvoir disposer aujourd’hui d’un nouveau stade de football gazonné, une nouvelle piscine olympique ou une nouvelle salle omnisports digne de ce nom. Pour la première infrastructure, le Maroc est plus avancé que l’Algérie.
Autre exemple : la réalisation de l’autoroute Est-Ouest sur 1 100 kilomètres s’est, en outre, effectuée avec d’énormes surcoûts et un énorme retard. Aujourd’hui, plus de dix ans après le lancement des travaux, cette voie n’est pas achevée dans sa partie la reliant à la wilaya d’El-Tarf, soit environ 70 kilomètres. Selon un spécialiste, les surcoûts représentent au total 20% des montants investis dans les infrastructures durant cette période. Une partie de l’argent devant être injectée dans ces infrastructures a été dépensée dans les surcoûts ou au titre de la corruption, avancent plusieurs experts. Un gaspillage d’argent qui, s’il avait été évité, aurait pu servir à construire une économie solide et donc à préserver l’Algérie de la crise financière actuelle.
K. Remouche
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci-dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la Seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
|
De M.
Mon adresse est :
--------------------
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Septembre 2017
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
http://piednoir.fr/guelma
| |
J’aime ça ! Je me sens tellement mieux maintenant.
Envoyé par Gilles
|
Si le cerveau des personnes âgées est lent, c'est parce qu'ils savent déjà tellement de choses.
La mémoire des gens ne diminue pas avec l'âge, si cela leur prend plus de temps à se rappeler des faits, c'est, d'après les scientifiques, parce qu'ils ont plus d'informations dans leur cerveau.
Tout comme un ordinateur rame quand le disque dur est trop plein, les humains prennent plus de temps pour accéder aux informations lorsque leur cerveau est plein.
Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement n’est pas le même que le déclin cognitif. Le cerveau humain fonctionne plus lentement à l’âge avancé, a déclaré leDr Michael Ramscar, seulement parce que nous avons stocké plus d'informations au fil du temps.
Le cerveau des personnes âgées n'est pas faible, bien au contraire, ils en savent tout simplement plus...
Lorsqu'une personne âgée va dans une autre pièce pour y chercher quelque chose, qu'elle y arrive et se demande ce qu'elle est venue chercher, ce n’est pas un problème de mémoire, c’est un moyen naturel pour l'obliger à faire plus d'exercice.
ALORS, maintenant, quand je cherche un mot ou un nom, je me dis: "Mon disque est plein!"
J'ai probablement d'autres amis à qui je devrais envoyer ce message, mais en ce moment je ne me souviens pas de leurs noms.... Aussi, s'il-vous-plaît, faites-le suivre à vos amis, il se pourrait qu'ils soient aussi les miens ...
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
|
|