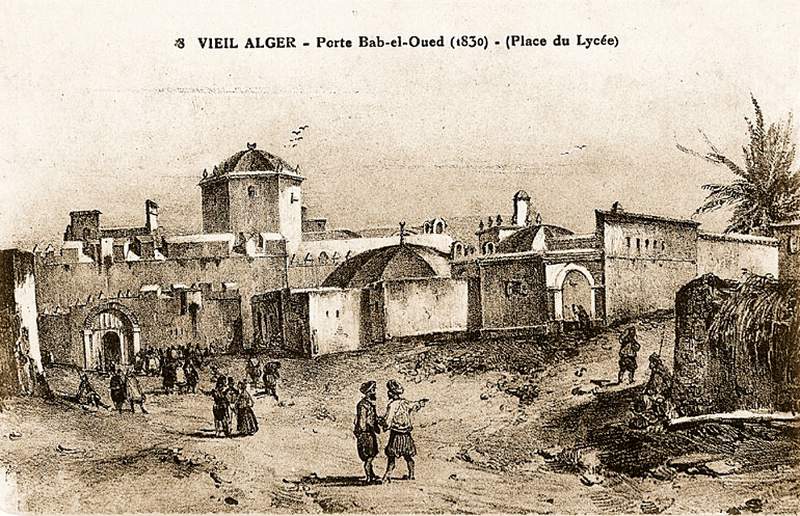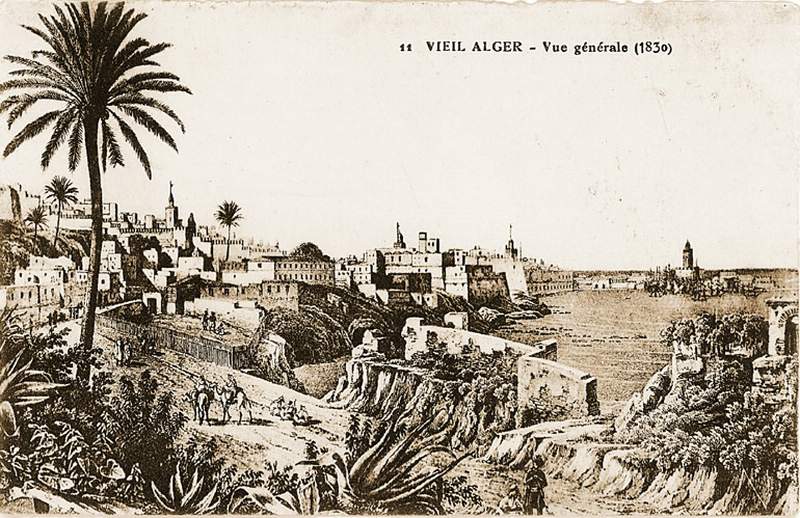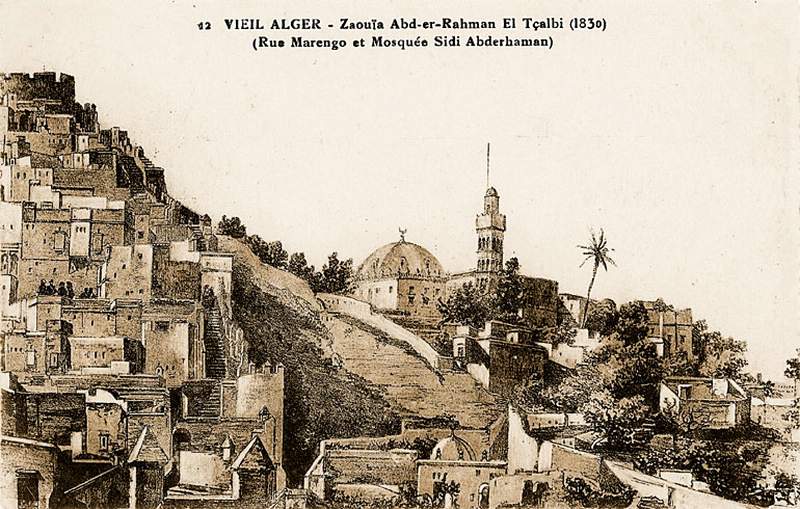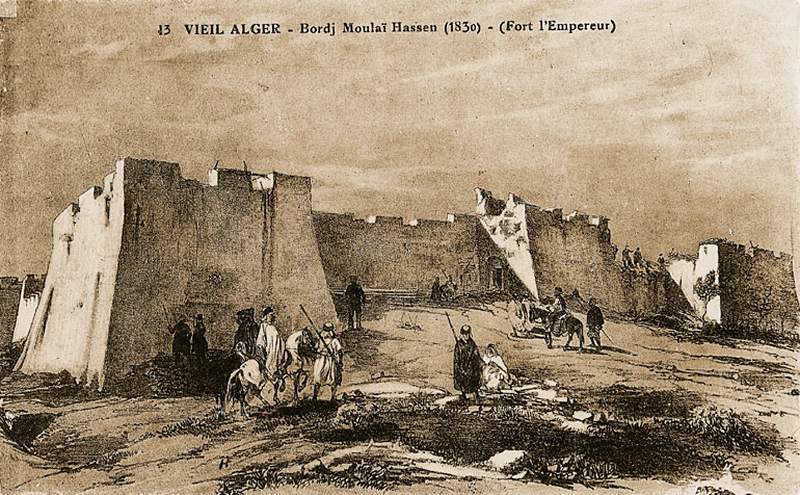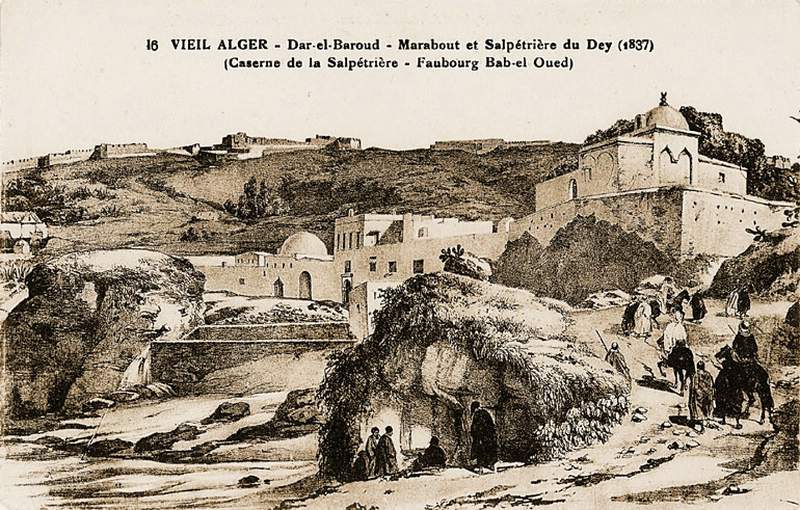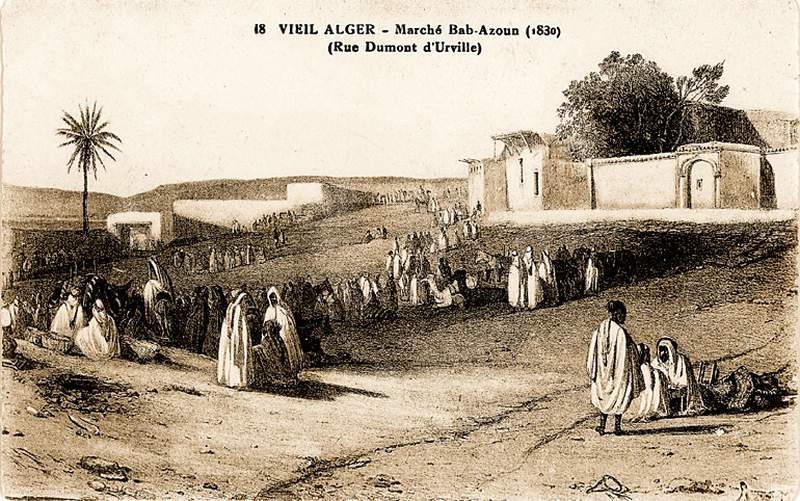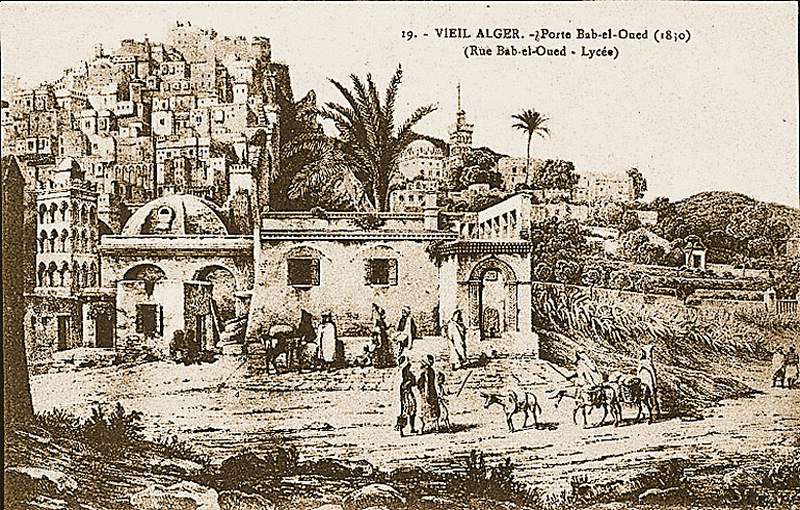|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
223, 224,
225, 226, 227,
228, 229, 230,
231, 232,
| |
PAPA NOËL
Cher Père Noël,
Je me permets de vous écrire, cher Père Noël, en souhaitant que cet édito soit lu par vous… Une fois n'est pas coutume,
Nous allons entrer dans le temps de l'Avent et dans celui des fêtes, Saint Nicolas, la nativité avec Noël et pour finir la nuit de la Saint Sylvestre. Souhaitons que ces journées s'écoulent dans la joie et l'allégresse afin d'oublier les malheurs de 2022.
La si triste année 2022 touche à sa fin. Elle laissera indéniablement dans nos mémoires, le souvenir de bouleversements économiques et sociaux important avec beaucoup de détresse.
Je vous demande Cher Père Noël, de nous apporter le bien-être avec plus de moyens financiers car l'inflation avec les restrictions imposées montrent que cela était bien prévu par les spéculateurs. Bien sur que je parle argent car dans ces temps-ci, c'est là, le " nerf de la guerre " surtout avec les desseins de l'Etat.
Voilà pourquoi décembre était tant attendu. Car nous ressentons tous le besoin de retrouver nos proches pour vivre quelques parenthèses heureuses autour du sapin ou des agapes qui seront restreintes.
Je terminerai ma requête, en vous priant, Père Noël, de souhaiter aux enfants du monde et plus particulièrement à ceux de nos communautés, le bonheur et la paix ainsi que de joyeuses fêtes de fin d'année en famille.
Merci Père Noël.
Chers Amis, Joyeux Noël et belles fêtes, en attendant d'avoir le plaisir de nous retrouver début janvier pour une année 2023 que nous espérons plus légère.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
CUISINE DE NOEL...
CUISINE NOSTALGIE
Par G.A.
Par ACEP-Ensemble N° 302, décembre 2016
|
Notre cuisine est une riche combinaison des cuisines des trois communautés qui se côtoyaient en Algérie Française. Musulmane, juive et chrétienne. On y retrouve des apports de la cuisine maghrébine (arabe et berbère), orientale (turque), juive berbère et séfarade, européenne latine (française, maltaise, espagnole et italienne). Des plats simples et typiques existaient pour la région d'Oran, celle de la côte avec Philippeville et Bône, l'Algérois, le Constantinois, la Kabylie et les territoires du Sud.
Tout dépendait de l'origine des premiers colons ainsi que des immigrants venus d'Europe à leur suite, même si la présence espagnole à Oran était bien antérieure à 1830. Cette gastronomie peut s'étendre à l'ensemble des autres Français d'Afrique du Nord, venus du Maroc et de la Tunisie.
Pour beaucoup de pieds noirs, beaucoup d'entre nous, elle reste le seul lien inextinguible avec le soleil et les senteurs de notre terroir d'origine, représentative d'un " régionalisme sans terre ", au contraire de celle des autres Français. C'est l'exode massif de 1962 qui a fait connaître cette cuisine à l'ex métropole, la table restant un lieu de convivialité, d'hospitalité. de joie de vivre où la famille méditerranéenne se retrouve.
Cette tradition culinaire, fixée par les grands-mères et leur tour de main et sans cesse transformée et améliorée dans les familles, risque de disparaître quand les derniers pieds-noirs seront décédés. Il existe quelques livres dédiés à cette cuisine même si beaucoup de recettes continuent à se transmettre de façon orale. De nombreux plats (briks, merguez, couscous, tajines...) sont originaires de la cuisine du Maghreb qui est la composante principale de cette cuisine.
La cuisine pied-noir " latine " (chrétienne) est un mélange de cuisine française méridionale, catalane et espagnole en grande partie (la longanisse, les pelotas, les cocas, le gazpacho pied-noir, les migas, le cocido, le potaje viudo, les albondigas, la frita, l'arroz caldos, le vin d'orange, les rollicos, les pastisos, les pasteles de monatos...) avec un apport évident de la cuisine italienne du sud (pizza napolitaine, timbale de macaronis, cannellonis aux herbes...).
La cuisine juive pied-noir a aussi des origines espagnoles (car si certains juifs d'Afrique du Nord ont des origines berbères, beaucoup ont aussi des origines séfarades espagnoles qui remontent au XVème siècle, quand ils furent expulsés en masse en 1492, à la suite du décret de l'Alhambra).
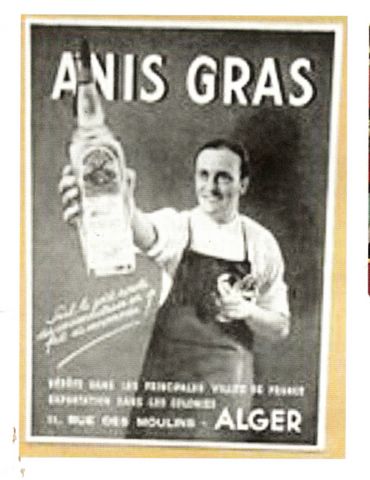
On s'en aperçoit dans ces spécialités, comme les recettes de " poyo i gayna " (poulet et poule) , les " pichkados " (poissons), les " salatas " (salades), tous les plats avec " uevos " (oeufs) et les plats dit " al orno " (au four) et bien d'autres.
Avant l'indépendance, la vie quotidienne a permis les échanges culinaires entre communautés, pendant les fêtes religieuses (Ramadan, Pâques juives ou chrétiennes, Noël) ... Les plats et desserts s'échangeaient entre voisins, symboles d'hospitalité, parfois aussi pour services rendus. La minorité de Pieds Noirs, parlant l'arabe dialectal car nés et ayant vécu dans le bled en Algérie, souvent dans des fermes, s'est imprégnée des cuisines arabes et kabyle.
Le marché, les mozabites, restaient le lieu privilégié d'échanges Tous ces plats se consommaient à la maison, dans la rue, en pique-nique à la campagne (à la Saint Couffin pour la Pâques), à la sortie de la messe ou à la plage le dimanche, dans des restaurants, dans des gargotes ou dans les cafés maures pour le café du même nom et pour le thé à la menthe.
Incontournable à l'apéritif, à base d'anis vert et d'autres plantes, l'anisette.
Dont les marques les plus connues sont l'anisette Gras, Phénix (anisette kasher), Cristal Liminana ou le Super Anis Galiana.
Elle composait la mauresque avec le sirop d'orgeat, la tomate avec la grenadine, le poivron ou le perroquet avec le sirop de menthe.
L'anisette est accompagnée de la Kémia (petite dose en arabe).
Autre boisson à l'apéritif : le Picon ou l'Amer-Picon, élaboré en 1837 par Gaétan Picon, soldat de l'armée d'Afrique, avec l'installation d'une distillerie à Philippeville.
Les jus de fruits : l'Orangina créé par Léon Beton à Boufarik en 1936, l'agualemon, l'antésite, la citronnade, le coco, le jus de pastèque, la limonade, le sélecto, le soda judor. Les sirops : menthe, grenadine, citron, citron vert (Tchina).
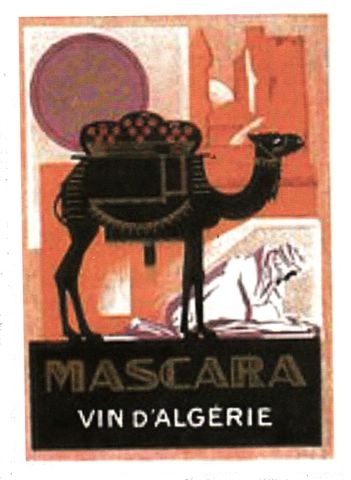 Issus de cépages importés de la métropole au XIXème siècle, la culture de la vigne était très importante avant l'indépendance de l'Algérie et était présente surtout dans l'Algérois et l'Oranie. Issus de cépages importés de la métropole au XIXème siècle, la culture de la vigne était très importante avant l'indépendance de l'Algérie et était présente surtout dans l'Algérois et l'Oranie.
On buvait des vins rouges, blancs, rosés, muscats, le taux d'alcool étant compris entre 13 et 17 degrés. Les vins les plus connus étaient le Boulaouane, le Guébar, le Mascara, le Royal Kebir, le Sidi Brahim.
Il demeure encore quelques vignobles en Algérie. D'autres vins continuent à être produits au Maroc (une variété de Sidi Brahim) ou le Guébar en Tunisie.
La bière : des brasseries malteries existaient avant l'indépendance à Oran, Philippeville et Alger.
La plus ancienne était la brasserie Wolf créée en 1868 à Constantine. La bière la plus célèbre était la 33 Export.
Malgré l'interdit religieux, une forte minorité de musulmans consommait cette boisson.
L'eau, denrée rare en Algérie, était gardée au frais dans des gargoulettes.
Le champoreau : à base de café noir ou au lait auquel on ajoute du vin, de la liqueur ou autre alcool fort.
Le vin d'oranges : à base de peaux d'oranges macérées.
Le petit lait : leben, boisson accompagnant les bradges ou le couscous dans le bled. C'est le résidu aigre du lait qui reste après la transformation de la crème en beurre dans une baratte. Le lait de poule....
Les épices... On retrouve l'anis, le cumin, la coriandre, le basilic, la ciboulette, le clou de girofle, le fel-fel (piment rouge), l'ail, l'oignon, le safran, la menthe verte, la noix de muscade, le ras-al-hanout (mélange de cumin, paprika, cannelle, grains de fenouil). Les sauces sont : la harissa, l'escabèche, l'aïoli, la béchamel, la dersa sauce piquante), la sauce tomate. La semoule de blé est aussi une base de l'alimentation : fine, moyenne ou grosse (Smid). L'Algérie de l'Antiquité à l'indépendance a toujours été un grenier à blé. La marque la plus célèbre de cette même semoule avant 1962, était Ferrero Ricci, créée à Alger en 1907. Il existe aussi différentes sortes de pain : fougasse, kesra, pain arabe, pain juif (azyme), pain de semoule à la levure, petits pains aux dattes et aux noix. Le plat le plus frugal : une tranche de pain avec de l'huile d'olive et grattée avec de l'ail...
Le couscous... au mouton, à l'agneau, au poulet, aux boulettes de viande, au poisson, aux tripes de mouton (barboucha). Il est garni de différents légumes suivant l'origine géographique des familles : aubergines, cœurs d'artichauts (rorchas), cardes, carottes, chou, courgettes, petites fèves, navets et pois chiches (Hamous), piments rouges ou verts (fel-fel).
Les entrées : salade aux aubergines, salade d'œufs aux anchois, salade de poivrons (passés au four ou sur un kanoun ce qui les rend plus digestes car on les épluche) et de tomates, salade de pois chiches, salade orientale, salade juive, salade de fèves au cumin, oeufs mimosa. Les soupes : chorba, potaje, soupe à la semoule, soupe aux fèves, soupe de poissons, soupe à la tomate. La charcuterie : boutifarre, jambon cru, longanisse, merguez, saucisses, soubressade (chorizo), pieds de porc au persil. Les plats de résistance autres que le couscous : Les légumes sans viande : avec pâte à pain ou pâte feuilletée ou encore pâte brisée. Artichauts aux petits pois et fèves ou aux pommes de terre, aubergines frites, briks, calentita cardes, carottes au cumin, chou-fleur gratiné, coca (petits chaussons) ou coca familiale, courgettes frites, frita, fenouil au cumin, gratin de pommes de terre, migas, oignons frits, poivrons (passés sur le kanoun ou au four), pizza à pâte épaisse (fougasse) (pizz' pour les Constantinois), ratatouille, tchouktchouka (avec un oeuf au plat dessus).
Les beignets et omelettes : beignets (aux aubergines, à la cervelle, aux courgettes, à la morue, aux sardines). Omelettes à la soubressade, aux champignons, aux courgettes, aux pommes de terre ou aux tomates. Pâtes et semoule : cannellonis, macaronis, gratin de macaronis, migas, tagliatelles, pâtes constantinoises, poulinte (la semoule de blé a remplacé la semoule de maïs de la polenta), raviolis, semoule frite. Les poissons, mollusques et crustacés : anchois marinés, barbot farci, bonite, calamars farcis, caldero (comparable à la bouillabaisse), crevettes, dorade à l'oignon, maquereaux grillés ou en escabèche, moules en escabèche, morue, mulet grillé, oursins, poulpe à la pistarelle, ragoût de morue, riz aux crevettes, rouget en papillotes, sardines grillées ou en escabèche, sépia (seiche) à l'encre, thon à la tomate, turbot. Les escargots : à l'aïoli, au cumin, à la sauce piquante, (petits ou grands blancs). Les viandes : Les abats : tête de mouton au four (bousoulouf), brochette de cœur ou de foie d'agneau ou de mouton, cervelle de mouton au four, pieds de mouton aux haricots. Les viandes classiques seules, avec légumes ou en croûtes : aubergines farcies, barakis, blanquette de veau, boulettes à la viande, chou farci, civet de marcassin, courgettes farcies, couscous au mouton, daube, épaule d'agneau au four, gaspacho oranais, loubia, méchoui, quiche, ragoût de mouton, riz au mouton, tajines, tfina, tourtes. Les volailles : bastela, couscous au poulet, lapin aux trois poivrons, perdreaux aux raisins secs, poulet au citron, poulet à la coriandre, poulet aux olives noires ou vertes, poulet au paprika, riz au poulet, vol au vent. La paella : plat hybride, souvent unique, mélangeant riz au safran, poulet et crustacés
Les desserts Fruits frais : abricots, agrumes (citron vert ou jaune), clémentine (créée par hybridation par le frère Clément à Misserghin en 1892, entre un mandarinier et un bigaradier)
La société algéroise d'agriculture décida de le nommer "clémentine" en son honneur (appellation approuvée dès 1902 par la Société algéroise d'agriculture). La clémentine est un fruit vert (qui devient orange sous l'effet de la baisse de température en hiver), qui n'a pas de pépins contrairement à la mandarine.
Les premières descriptions du clémentinier sont dues au Docteur Louis Trabut (1853 - 1929) qui les publia en 1902 dans la Revue Horticole Française N°10 et en 1926 dans le Bulletin agricole de l'Algérie, Tunisie et Maroc. À noter que le Traité pratique d'agriculture pour le nord de l'Afrique, paru en 1929, ne parle pas de clémentine mais seulement de " mandarine sans pépin ".
La clémentine sera introduite en Corse avec succès par les pieds noirs. Quant à la production algérienne, jadis florissante, elle périclite peu à peu au profit de l'Espagne à partir des accords d'Evian en 1962.
... mandarine, orange, orange amère ou sanguine, pamplemousse, arbouse, figue, coing, figue de Barbarie, grenade, jujube, melons (cantaloup, jaunes ou verts), mûres, nèfle, pastèque, plaquemine (kaki), raisin. Clémentines
Fruits secs : abricots, amandes, cacahuètes, dattes (deglet nour de la région de Biskra, très réputée), figues, marrons, noix, pistache, pruneaux, raisins secs, tramousses.
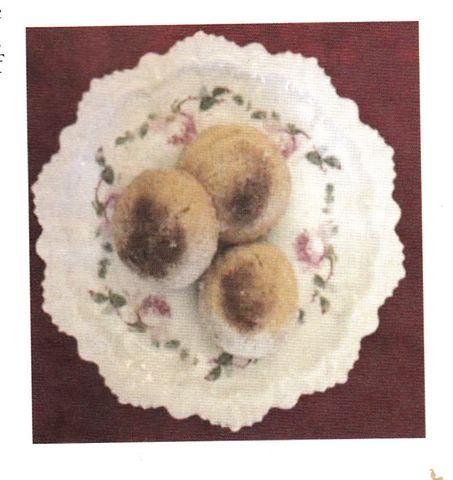 Confiserie, gâteaux, glaces : baklava, beignets sucrés, boule de Moscou, bradges, bûche de Noël, cigare aux amandes, cornes de gazelles, confiture (orange, orange amère, coings, figue, nèfle, pastèque, raisin), couronnes à l'anis, couscous sucré aux raisins secs, crêpes, créponé, dattes fourrées à la pâte d'amande, délices d'Alger, doigts de la mariée, flan à l'orange, ftahir (beignet tunisien), galettes sucrées, gâteau napolitain, gelée d'arbouses, glace italienne, halva (aux amandes, à la vanille, à la pistache, ou au chocolat), makroud au miel, mandarines confites, montecaos, mouna (brioche pour Pâques à l'huile d'olive ou au beurre et à la fleur d'oranger, se mange aussi au petit déjeuner ; jusqu'à l'arrivée dans les foyers des premières cuisinières, la pâte était apportée au four du boulanger qui la cuisait), nougat turon, oreillettes, oublies, pain perdu, pâte de fruits, riz au lait à la pistache, rollicos, patates douces frites et sucrées, pruneaux ... Confiserie, gâteaux, glaces : baklava, beignets sucrés, boule de Moscou, bradges, bûche de Noël, cigare aux amandes, cornes de gazelles, confiture (orange, orange amère, coings, figue, nèfle, pastèque, raisin), couronnes à l'anis, couscous sucré aux raisins secs, crêpes, créponé, dattes fourrées à la pâte d'amande, délices d'Alger, doigts de la mariée, flan à l'orange, ftahir (beignet tunisien), galettes sucrées, gâteau napolitain, gelée d'arbouses, glace italienne, halva (aux amandes, à la vanille, à la pistache, ou au chocolat), makroud au miel, mandarines confites, montecaos, mouna (brioche pour Pâques à l'huile d'olive ou au beurre et à la fleur d'oranger, se mange aussi au petit déjeuner ; jusqu'à l'arrivée dans les foyers des premières cuisinières, la pâte était apportée au four du boulanger qui la cuisait), nougat turon, oreillettes, oublies, pain perdu, pâte de fruits, riz au lait à la pistache, rollicos, patates douces frites et sucrées, pruneaux ...
Bons souvenirs... bon appétit.. et pour compléter cette petite révision avant les repas de tin d'année, souvenez-vous des chants de Noël, des artistes, que nous écoutions là-bas, en 62 : Armand Mestral, John Williams, Jhonny Mathis, Francis Linel, Elvis Presley, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, François Mallory, Paul Anka, André Claveau, Lucienne Delisle, Mathé Altéry, Tino Rossi.
Et à Noël du moment où petit et grands ouvriront leurs paquets, peut-être, sûrement, un petit coup de blouse va vous tomber dessus et vous voilà reparti là-bas. François Valéry, chanteur de chez nous, prendra sûrement dans votre tête, !a place de Tino Rossi et de son Petit Papa Noël avec ses paroles: " Noël à Oran me acuerdéré de ti toda mi vida, Noël à Oran, cuando mi Madré cantaba para no llorar."
G.A.


|
|
JOYEUX NOEL
Envoyé par M. Georges Barbara
|
 -" " Mamamille, Ouille M'an ! Agads moi çà Mémé, fais un peu entention, la madone de toi, pourquoi te viens de me marcher t'sur mon pied ! Mais où c'est que t'ya appris à danser toi ? On dirait un camion de chez Kaouki ! Et tout à l'heure combien j'avais raison, quand j' voulais pas me faire ce Bolero avec toi, mieux si je m'étais cassé une jambe. Et toi bouche en cœur pour faire le Dandalon te me disais que tu dansais mieux que Fred La Stère ! Pour un Fred La stère comme toi j'en chie un tous les jours !
-" " Mamamille, Ouille M'an ! Agads moi çà Mémé, fais un peu entention, la madone de toi, pourquoi te viens de me marcher t'sur mon pied ! Mais où c'est que t'ya appris à danser toi ? On dirait un camion de chez Kaouki ! Et tout à l'heure combien j'avais raison, quand j' voulais pas me faire ce Bolero avec toi, mieux si je m'étais cassé une jambe. Et toi bouche en cœur pour faire le Dandalon te me disais que tu dansais mieux que Fred La Stère ! Pour un Fred La stère comme toi j'en chie un tous les jours !
- " Arogards un peu là ô Fifine, si ya pas trop des boules t'sur le coté de l'arbre ?
- " Arogards ici ! Arogards là ! Tu te crois pas que je serai mieux dans la cuisine entrain de mettre les pâtes pour la macarronade que ça fait un moment que l'eau elle bout dans le faitout ? A la place que tu me fais jouer à l'électricien de l'EGA depuis une heure mai'nan ? Alors fais vite,,,, Ouais c'est bon comme ça ! Et pis d'abord main'nan pisque te me parles des boules, te connais la différence qu'y a entre les boules que t'ya où je pense et celles qu'elles sont dessur ton arbre de noel à la six quatre deux…. qu'on se croirait que c'est le mandarinier qu'ya dans le jardin d'Anunciate ?
- " Et ben non à sa'oir ? Mais comme j'te connais, te vas surement m'en sortir une de derriere la fabrique des carrelages de la cité Aux Z'as où t'ya été élevée.
- " Et ben meeeeussieur Freddy, toi qu'y sais tout et qu'y sais rien du tout, y'a pas de différence, parcequ'a debon les deux a servent que pour la décoration !….Et Dinezek…. A l'est pas bonne celle la…. Non ?
- " Ca y'esssss t'la placé ton Iskimo glacé à l'entrac du ciléma ? T'yes contente main'nan ? Rogards un peu de m'aider ça ira mieux, va.
- " Bon ô Tanoude d'en bas la grounouillere, te crois pas que j'vais me rester coincée pendant deux heures comme ça, juste pour assoupir ton caprice de vieux, quand jamais t'ya cru à Papa Noël toi ? Moi ça qu'je sais c'est que ma colonne vertébrale a va pas tenir longtemps !
- " Te ferais pas un p'tit sacrifice pour tes p'tits enfants qu'y vont venir madone, c'est pour eux qu'on fait ça, O Fifine !
- " e sais y faut qu'j'te dise Freddy, je me suis mangé le sang, quand je pense que toi te regardes à vingt francs quand je dois aller à chez Robert au salon de coiffure pour me faire l'indéfrisable, et que toi t'ya été acheter ce madonne de vieil escabot d'occasion chez Morali, le marchand de meubles d'la rue Bugeaud ! Laisse tomber qu'il est plein de vers mais ça qu'je sais, c'est que ce strounze y va pas attendre qu'il arrive le Bone St Charles pour se casser la gueule te vas 'oir ! Comme te l'as rentré à la maison et ben j'ai tout'suite vu qu'il était a moitié Tsope ce catafalque !
- " e veux que j'te dise Fifine, toi que tu me cherche depuis un moment ? Y'a longtemps que j't'ai analysée. Et ben tu vas a'oir la franche vérité entre 4 z'yeux ...T'y'es une grand jalouse pourquoi te 'ois que c'est moi que je suis le roi de la Ménadia pour te faire les z'arbres de noel !
- " Alors là entention les 'oitures, le mec quand y te roule ses micaniques, enlévez-vous du milleux. Et ouais si c'est pas pour les petits enfants te peux croire que ton arbre j'en ai rien à foutre ! Et l'année prochaine t'iras chercher ta boniche à la place d'armes dans ce quartier des chats noirs où t'ya passé ta jeunesse. Chikeur t'ya été et chikeur te resteras toute ta vie. Et métenan moi je vais te lacher la ceinture et arrive ça qu'il arrive …...!
- " Ouais t'ya raison c'est mieux que tu me laisses pour aller cancaner a'c ta copine Lucie, et pendant que je jette le sang moi, vous aurez le temps d'habiller tout le quartier. Aller va de là ...Va ! Et joyeux Noel.
Georges Barbara août 2022
|
|
| Ne pleure pas si tu m'aimes
Selon Saint-Augustin
|
Je suis seulement passé de l'autre côté.
Je suis moi. Tu es toi.
Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours.
Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné.
Parle-moi comme tu l'as toujours fait.
N'emploie pas un ton différent.
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Pris, souris, pense à moi, prie avec moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été
sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre.
La vie signifie toujours ce qu'elle a toujours signifié.
Elle est ce qu'elle a toujours été : le fil n'est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée ?
Simplement parce que je suis hors de ta vue ?
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin...
Tu vois, tout est bien.
Ne pleure pas si tu m'aimes.
SI tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le ciel.
Si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges et me voir au milieu d'eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les horizons
et les champs éternels, les nouveaux sentiers où je marche !
Si un instant tu pouvais contempler comme moi la Beauté
devant laquelle toutes les beautés pâlissent !
Quoi ! Tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres
et tu ne pourrais ni me revoir,
ni m'aimer encore dans le pays des immuables réalités ?
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens
comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient,
et quand un jour que Dieu connaît et qu'il a fixé
ton âme viendra dans le ciel où l'a précédée la mienne,
ce jour-là tu reverras celui qui t'aimait et qui t'aime encore,
tu retrouveras son coeur, tu en retrouveras les tendresses épurées.
Essuie tes larmes et ne pleure pas si tu m'aimes.
envoyé par Jean-Claude PUGLISI.
de La Calle de France
83400 - HYERES.
|
|
|
PHOTOS d'ALGER
Par M. Latkowski
|
REMPART DE LA CASBAH

MOSQUEE DE LA PÉCHERIE 1830
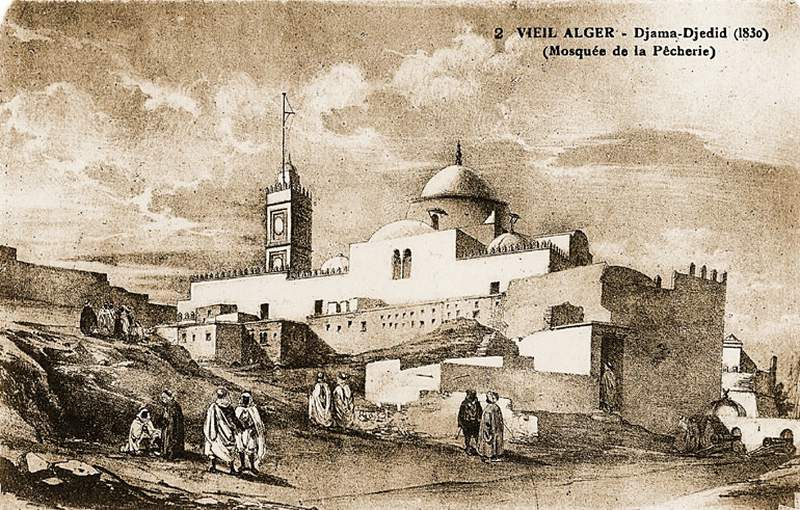
PLACE DU GOUVERNEMENT

VUE DE LA VILLE ET DE LA RADE XVIème SIECLE

DJAMA DJEDID 1830
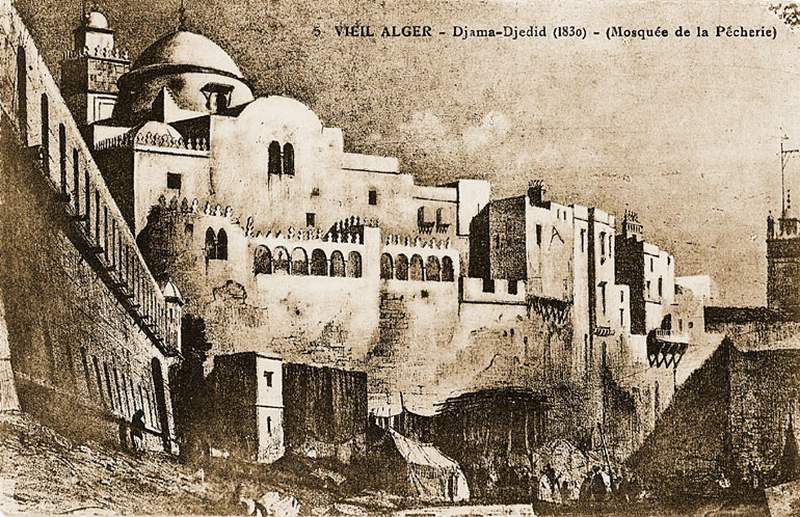
PORTE BÂB AZOUM

|
|
|
MUTILE N° 154, 16 août 1920
|
LA VAGUE D'EGOÏSME
Après la vague de paresse et la vague de baisse, voici la vague d'égoïsme qui s'étale - et celle-là n'est pas une, blague. Elle sévit chaque jour davantage au point de soulever l'indignation des honnêtes gens, et vous savez quand les moutons deviennent enragés de quoi ils sont capables.
Beaucoup de Français revenus du front avec des idées nouvelles, semblent avoir oublié que les principales qualités de notre race sont la bienséance, le savoir-vivre et la politesse qui faisaient de nous, autrefois, le peuple le plus policé de la terre.
Où sont ces belles vertus qui nous plaçaient au premier rang dans l'esprit de l'étranger ? Nous craignons beaucoup qu'elles ne disparaissent, complètement, annihilés par l'affreux Egoïsme - car on ne peut plus le dissimuler - c'est lui, ce maudit vice qui domine aujourd'hui même les meilleurs naturels.
On parle fréquemment, depuis le retour à la vie soi-disant normale, d'une certaine vague de paresse qui aurait déferlé, sur notre pays. Il serait plus juste de dire qu'une vague d'égoïsme nous a quasi submergés.
Nous la voyons pénétrer journellement dans toutes les classes de la Société. Nous l'apercevons redressant insolemment la tête. - entre parents, amis, camarades, commerçants, colons - menaçant de nous engloutir tous. Les souffrances du temps de guerre, les restrictions, la vie chère, les difficultés journalières de l'existence, sont les causes principales qui engendrèrent ce fléau.
Que deviennent maintenant toutes ces belles devises que nous lisons sur la plupart des statuts de nos sociétés corporatives, et autres, de même but. Ces mêmes brodées sur les bannières que nous vîmes circuler les jours de grand événement. Même au 1er mai, s'étreignant, dans un geste de loyale fraternité. Enfin cette parole du Christ : " Aimez-vous les uns les autres " Tout cela, est du passé ; le présent, se résume dans la devise : " Moi " d'abord.
Les nouveaux riches surtout ; les ventres dorés - les Gros - aujourd'hui se cantonnent superbement, dans leur "Moi" ne veulent pas en sortir : - tiennent le haut du pavé - ainsi que la dragée haute aux pauvres gueux qui n'ont pu ou su réussir dans la chasse, aux écus. C'est chez ceux-là, d'abord, que l'égoïsme tient la....plus grande place. Leur cœur s'est endurci, racorni, devant les souffrances des autres.
L'égoïsme a également pénétré, sous uniforme moins féroce, c'est vrai, mais aussi profondément, dans les familles, les groupements, les usines et ateliers. On a moins de pitié, maintenant pour les malheureux. Une indifférence criminelle vous porte qu'à ne penser qu'à " SOI".
N'y aurait-il vraiment d'esprit de solidarité et de générosité que dans l'adversité ! Pauvreté serait-il synonyme de vertu et fortune "de guerre, de richesse, d'enfer !! "
Est-ce parce que la guerre nous en a fait voir de plus terribles ? N'importe. Où sont ces grands élans de pitié, provoqués par la guerre ? On n'en aperçoit plus, la guerre est finie… que chacun se débrouille. Et cela est tellement exact, que chaque pas nous fait découvrir des faits nouveaux qui nous déconcertent et nous révoltent.
Vous vous abreuvez, MM. les richards, dans les délices payés avec le sang de nos 1.500.000 morts, le jour n'est pas loin où vous regretterez voire odieux égoïsme, mais il sera trop tard.
Haut les cœurs, tout de suite, il est encore temps. Pénétrons-nous de l'idée qu'ayant été les maîtres de l'esprit, comme du génie dans le monde, nous tenons et nous voulons le rester. Travaillons, donnons-nous la main, sans aucune arrière-pensée.
Soutenons-nous et, aimons-nous les uns les autres et redevenons ce que nous devons être : des Français.
Rouïna. Le 31 juillet 1920.
BILLIET
|
|
SILHOUETES ORANAISES
ECHO D'ORANIE - N° 215
Textes et illustrations de Gilbert Espinal
|
|
 Qui se souvient encore de ces personnages qui ont hanté les rues de notre ville du temps de notre jeunesse ? Nous les voyions passer sans trop y porter attention car ils étaient quotidiens et qu'il suffisait de se promener dans le centre de la cité ou dans le quartier qu'ils affectionnaient pour les retrouver égaux à eux-mêmes avec leur charge de pittoresque ou de dérision, seuls ou entourés d'une multitude de gamins qui ne se rassasiaient pas de leur originalité, qui les regardaient, comme moi gravement, parce qu'ils dissonaient dans l'univers ambiant ou qui les poursuivaient d'invectives et de quolibets et leur lançaient parfois des cailloux. Qui se souvient encore de ces personnages qui ont hanté les rues de notre ville du temps de notre jeunesse ? Nous les voyions passer sans trop y porter attention car ils étaient quotidiens et qu'il suffisait de se promener dans le centre de la cité ou dans le quartier qu'ils affectionnaient pour les retrouver égaux à eux-mêmes avec leur charge de pittoresque ou de dérision, seuls ou entourés d'une multitude de gamins qui ne se rassasiaient pas de leur originalité, qui les regardaient, comme moi gravement, parce qu'ils dissonaient dans l'univers ambiant ou qui les poursuivaient d'invectives et de quolibets et leur lançaient parfois des cailloux.
La Catchavera, fantôme fardé et pathétique qui s'est dissipé au début des années 30 et qui errait d'un quartier à l'autre revêtu de plusieurs épaisseurs de robes voyantes, en voile de préférence, qui avaient dû êtres belles et que le temps avait effiloché, juchée sur de hauts talons éculés et le chef couronné d'une immense capeline peuplée de fleurs,  d'oiseaux et de tulle. Elle s'enveloppait parfois d'un grand châle de soie bordé de cygne. On disait qu'il s'agissait d'une personne du monde, qui avait été frappée par le goût de l'extravagance et avait sombré dans une sorte de folie douce. En tous cas, l'expression "être vêtue comme la Catchavera" est passée dans le folklore oranais. d'oiseaux et de tulle. Elle s'enveloppait parfois d'un grand châle de soie bordé de cygne. On disait qu'il s'agissait d'une personne du monde, qui avait été frappée par le goût de l'extravagance et avait sombré dans une sorte de folie douce. En tous cas, l'expression "être vêtue comme la Catchavera" est passée dans le folklore oranais.
Différente en tous points de la Catchavera était Maria Trapos une femme vieille, mal soignée, habillée de haillons rapiécés et chaussée de charentaises avachies qui parcourait le Plateau Saint-Michel avec, au bras, un filet de toile cirée noire, éculé dans lequel elle recueillait tout ce qui pouvait contribuer à sa subsistance: quignons de pain, légumes abandonnés à la fin des marchés, vêtements et chiffons récupérés dans les poubelles. Les gosses surtout lorsque son passage coïncidait avec la sortie des écoles la suivaient en se moquant et s'approchaient d'elle jusqu'à la faire trébucher. Elle ne protestait pas et poursuivait son chemin, un peu égarée, un peu indécise, tout à fait innocente. Elle traversait le Boulevard Lescure, prenait la rue de Stora et se diluait après le Boulevard Fulton aux alentours du village nègre. "Ressembler à Maria Trapos" est aussi une expression oranaise.
Qui se souvient de la prunelle malicieuse de ce vieil harratin revêtu d'une gandoura sans couleur, un peu cuivrée par la crasse, la tête surmontée d'un fez à gland qui avait établi, je ne dirai pas ses quartiers car il devait venir d'ailleurs, mais son itinéraire place Villebois-Mareuil et Boulevard Charlemagne et qui se dandinait en s'accompagnant d'une sorte de mandole faite de peau de chèvre en chantant "Y a Madame Bono"; suivaient en une langue imprécise quelques vers qui évoquaient cette Madame Bono ; le second couplet était consacré à une Madame Pépé : l'air été le même et je pense que les paroles aussi. Il dansottait un moment en raclant sur sa derbouka et en tournant sur lui-même avant de tendre sa sébile de cuivre cabossée aux clients attablés à la terrasse du Café Riche ou du petit Guillaume Tell. Il précédait quelquefois un camelot qui agitait des éventails au manche de bois noir et à la pale de sparterie dont il vantait l'efficacité en évoquant le "vent du nord".
 Et le marchand de piroulis, planté à la porte des écoles, coiffé d'une casquette de marinier, tenant d'une main un petit garçon de huit ou neuf ans et de l'autre une hallebarde qui soutenait un cône de carton sur lequel se fichait une forêt de piroulis multicolores, à la menthe, à l'anis, au citron, ou à la fraise. La friandise valait deux sous et le commerçant était toujours entouré d'une foule d'enfants braillards qui désignaient du doigt la sucette convoitée. Le jeune garçon, sérieux comme un pape à côté de son père encaissait et rendait la monnaie. Le marchand de piroulis a longtemps profilé sa silhouette digne à la porte du collège du Sacré Cœur, rue Saintes, mais je l'ai retrouvé bien plus tard, toujours aussi majestueux, seul ces fois-là, son garçon avait grandi et fait sa vie autrement et ailleurs. Et le marchand de piroulis, planté à la porte des écoles, coiffé d'une casquette de marinier, tenant d'une main un petit garçon de huit ou neuf ans et de l'autre une hallebarde qui soutenait un cône de carton sur lequel se fichait une forêt de piroulis multicolores, à la menthe, à l'anis, au citron, ou à la fraise. La friandise valait deux sous et le commerçant était toujours entouré d'une foule d'enfants braillards qui désignaient du doigt la sucette convoitée. Le jeune garçon, sérieux comme un pape à côté de son père encaissait et rendait la monnaie. Le marchand de piroulis a longtemps profilé sa silhouette digne à la porte du collège du Sacré Cœur, rue Saintes, mais je l'ai retrouvé bien plus tard, toujours aussi majestueux, seul ces fois-là, son garçon avait grandi et fait sa vie autrement et ailleurs.
Silhouette aussi, le marchand de tramoussos, de chuffas et de torraïcos qui siégeait sur un banc de pierre à l'entrée de la Promenade de Létang, encaqué dans un étalage de cornets qu'il délivrait consciencieusement, silencieusement comme du bonheur aux promeneurs moyennant une pièce de monnaie. Son négoce était discret, son image anonyme mais ils se rattachaient au soleil et à l'air du large.
 Passait dans les rues d'Oran, avec comme port d'attache le Petit Vichy le vendeur de bonbons des Vosges, accompagné de son petit âne fanfreluché de rubans, de pompons et de grelots, baté de deux paniers remplis à raz-bord de ces friandises qui ressemblaient à des cailloux multicolores et translucides au goût profond de résine. Il manipulait dans une bouteille pleine d'eau un ludion, une petite poupée de celluloïd noir qu'il appelait Mademoiselle Tapioca. Les enfants accourraient à l'appel d'une flûte de pan pour assister aux acrobaties du baigneur dans son récipient et chacun était enthousiasmé de voir Mademoiselle Tapioca plonger puis remonter à la surface presque miraculeusement. Le commerçant devait faire ses affaires car, dans les dernières années, son bourricot était attelé à une petite carriole blanche et pimpante recouverte d'un toit festonné auquel étaient accrochées des grappes de sucres d'orge de tailles différentes pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses. Passait dans les rues d'Oran, avec comme port d'attache le Petit Vichy le vendeur de bonbons des Vosges, accompagné de son petit âne fanfreluché de rubans, de pompons et de grelots, baté de deux paniers remplis à raz-bord de ces friandises qui ressemblaient à des cailloux multicolores et translucides au goût profond de résine. Il manipulait dans une bouteille pleine d'eau un ludion, une petite poupée de celluloïd noir qu'il appelait Mademoiselle Tapioca. Les enfants accourraient à l'appel d'une flûte de pan pour assister aux acrobaties du baigneur dans son récipient et chacun était enthousiasmé de voir Mademoiselle Tapioca plonger puis remonter à la surface presque miraculeusement. Le commerçant devait faire ses affaires car, dans les dernières années, son bourricot était attelé à une petite carriole blanche et pimpante recouverte d'un toit festonné auquel étaient accrochées des grappes de sucres d'orge de tailles différentes pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses.
Les bonbons des Vosges étaient alors entassés non plus dans les paniers de l'âne mais dans des bocaux de toutes teintes calés précautionneusement sur l'étal.
Il ne faudrait pas que j'oublie, dans cette pittoresque nomenklatura, le marchand de calentica qui tenait un stand accolé au bâtiment du marché Karguentah juste en face de la Maison du Colon. L'établissement était tenu par un frère et une sœur d'un certain âge déjà que l'on disait indéfectiblement liés. Ils délivraient pour quelques centimes, enveloppées dans un rectangle de papier blanc ou dans un sandwich bourru, des portions de ce flan à la farine de pois-chiches onctueux, doré, moelleux à souhait, salé à gros grains et dont la recette s'est peut-être irrémédiablement perdue. Ces commerçants constituaient à eux deux, comme dirait l'affreux Hussein, la Mère de la Calentica car ils dépêchaient à partir de leur fabrique et de leur four qui devaient se situer dans les profondeurs de la rue de Tlemcen ou du Boulevard de Mascara, toute une série de revendeurs, chacun loti d'une petite charrette à bras, aux roues exiguës et bruyantes, qui se partageaient les quartiers et siégeaient aux carrefours. Une horde de gamins piaillards les assiégeaient et la grande tôle de métal noir qui servaient de moule à cette succulente galette marbrée était très rapidement vidée de son contenu. Toute la ville était donc irriguée de calentica par ces petits caricos brinquebalants qui finissaient par faire partie du mobilier urbain comme aujourd'hui mais avec moins de poésie les abris-bus de nos cités métropolitaines écartelées et inhumaines.
Qui a encore en mémoire Camembert, ce clochard sympathique et rigolard qui circulait entre Delmonte et le Plateau Saint-Michel , vêtu pauvrement mais assez proprement et portant un feutre cabossé dans le ruban duquel il glissait un géranium ou une fleur en papier, une plume quelquefois. Il n'était pas idiot et répondait avec malice aux questions qu'on lui posait et aux invectives qu'on lui adressait. Il allait, suivi d'un groupe de jeunes qui provoquait ses reparties. On se moquait de lui mais il savait se moquer des autres. Son oeil clair étincelait et chacun riait de ses boutades qui dénotaient chez lui un esprit vit et une certaine culture.
Pauvre Camembert, comme il n'avait pas sa langue dans sa poche, il prenait à partie les fauteurs de troubles du F.L.N. dans cette trouble période qui a précédé notre départ d'Algérie. Il partait dans de longues diatribes et des déclarations enflammées. Il fut assassiné, à ce qui a été raconté, en pleine rue par ceux que son attitude et ses propos défiaient. L'époque n'était pas tendre, cet innocent fut une innocente victime parmi tant d'autres.
Une ombre encore : cette volumineuse et volubile personne, vendeuse de billets de la Loterie Nationale qu'on appelait "La Bombe Atomique" au prétexte qu'elle passait sur les zones protubérantes et hétérogènes de son individu, pour les électriser et porter chance affirmait-elle les billets qu'elle cédait à sa clientèle. Elle avait un discours de corps de garde et, je dois dire, que les saillies de ses interlocuteurs se situaient souvent à la hauteur des énormités qu'elle proférait ; suivie d'une quarteron toujours renouvelé de ricaneurs qui s'efforçait de lui en faire dire de plus gros et plus grossier (dans ce domaine elle était illimitée), elle sévissait Boulevard Séguin et rue d'Arzew.
Images nettes et précises, confuses ou diffuses sur lesquelles mon oeil ne se portera plus jamais. Les évènements, les années ont passé. Si de ces cendres quelques-uns uns de mes lecteurs gardent encore un brandon ou même une étincelle, qu'ils m'en fassent part à l'adresse du journal de manière à ce que je puisse, peut-être à l'occasion d'un autre article, repréciser dans les mémoires, des souvenirs qui s'estompent dans les brumes du temps.
|
|
| Mon oncle " l'Amiral."
par Jean Claude PUGLISI, année 2000
|
L'évocation de ces souvenirs familiaux, n'a rien à laisser penser, à de quelconques moqueries de ma part, à l'endroit de mon oncle Antoine, qui fut aussi mon parrain. Bien au contraire, car, ce que je vais raconter dans ce récit, va me permettre de me remémorer chemin faisant, un sacré personnage bien particulier que j'ai beaucoup aimé et pour lequel, j'ai toujours des pensées remplies d'affection et le regret qu'aujourd'hui il ne soit plus de ce monde.
Tonton Antoine, c'était pour moi un personnage d'une gentillesse extraordinaire, avec lequel j'étais très lié de cœur et d'esprit toutes les fois où, nous avions l'occasion de nous retrouver ensemble. Il était grand de taille, mince de corpulence, blond avec de beaux yeux bleus. Avec lui, je pouvais parler de tout et de rien, sans qu'il ne daigne un seul instant faire semblant de m'écouter ou, de me répondre n'importe quoi. Il était d'une grande honnêteté et restait très attaché à sa famille, en particulier, à ses enfants, qui comptaient un garçon, suivies de trois filles en bas âges qu'il adorait.
Mon tonton avait également une passion, c'était la mer, car, il est vrai que ses ancêtres venaient de la lointaines île de Ischia et qu'ils étaient tous des gens rompus au métier de la mer. Il avait hérité des anciens de cet amour de la pêche et des bateaux, dont il occupait tous ces loisirs des fins de WE. Durant la guerre 40/45 il avait été mobilisé dans la marine et il devait alors se retrouver sur un des fleuron de la marine Française : "le Richelieu" où, il fut affecté au poste de canonnier. Ce grand cuirassier qui comptait 2000 hommes d'équipage, devait lui permettre d'aller jusqu'aux Indes et de bombarder le Japon. Ayant fait partie de l'équipage de ce fameux croiseur, dont il me comptait très souvent ses souvenirs, c'est avec beaucoup d'affection et pour ne jamais l'oublier, que je le nommais un jour " l'Amiral ".
A la libération il revint à Bône et repris ses fonctions de menuisier au Chemin de Fer Algérien où, il devait passer une grande partie de sa vie, jusqu'à l'heure de l'indépendance de l'Algérie. Rapatrié en France, il exerça son métier dans les ateliers de la SNCF à Oullins ( Lyon ) durant plusieurs années, mais, lorsque sonna pour lui l'heure de la retraite, il décida de se fixer à Toulon, afin de pouvoir profiter de la mer et de son petit bateau, qu'il avait construit de ses propres mains. Puis, plusieurs années sont passées, sans qu'aucun nuages ne viennent troubler son existence, mais, hélas, il devait décéder à l'âge de 78 ans des suites d'une intervention chirurgicale.
Maintenant qu'il est parti je me décide à raconter, quelques-unes des anecdotes que j'ai pu vivre avec lui, lorsque nous étions encore à Bône et que je n'avais alors que 17 ou 18 ans. La première que je considère comme la meilleure, remonte bien loin dans le temps et concerne une course de bateau à voile, qui était organisée chaque année à la belle saison, par la direction du Sport Nautique de Bône où, mon oncle avait la garde d'un pointu qui appartenait à ses cousins Maïsto. C'est très régulièrement qu'il sortait avec " l'Andréa ", pour aller à la pêche dans le golfe de Bône, mais, mon oncle, rêvait depuis toujours de gagner cette course et tous les ans il ne manquait pas une seule fois d'y participer.
Nous étions en été et cette année là au Sport Nautiques, chaque concurrent préparait fébrilement leur bateau en vue de la fameuse course à la voile, que chacun dans leur for intérieur désirait gagner et qui ce jour-là attirait il faut le dire une foule de curieux. Le règlement était stricte et pour pouvoir participer à la course, il était obligatoire que chaque équipage soit pourvu de deux hommes. Mon oncle qui ordinairement était toujours seul sur son pointu, se vit dans l'obligation de trouver un co-équipier ce qui n'était pas du tout facile. Enfin il dénicha, je ne sais comment, un jeune-homme qui faisait le métier de facteur à la poste de la cité, mais, qui n'avait pratiquement aucune expérience de la mer et des bateaux. Arriva le moment où, mon oncle récupéra les voiles, qui étaient rangées depuis toujours dans le petit local qui lui était attribué. Ces voiles ne lui avaient jamais servies, puisque, son pointu, avait un excellent moteur qui lui permettait de naviguer en toute sécurité. Cependant, ce jour-là, en dépliant les voiles mon oncle se rendit compte, qu'elles étaient trop grandes pour le bateau et que manifestement elle faisaient partie de l'équipement d'un autre navire. Alors qu'il se désolait, à l'idée de renoncer à cette course, qu'il espérait gagner depuis des années, le petit facteur devait lui dire avec beaucoup d'assurance, qu'il n'était pas interdit de mettre des voiles plus grandes et que bien au contraire, elles devraient permettre au bateau d'aller plus vite et par cela même de gagner la course. Mon oncle qui n'avait à aucun moment pensé à cela trouva l'idée géniale et avec l'aide de son co-équipier il se mit installer les voiles, en se disant qu'effectivement avec des voiles plus grandes, le bateaux ne pourrait que filer davantage sur la mer.
Arriva le jour de la course et mon oncle à la barre, attendit impatiemment le signal du départ pour faire déplier ses immense voiles. Au milieu de toute une flottille de pointus avec un vent très favorable, " l'Andréa " pris de la vitesse et le port fut vite traversé. Mais dés la passe franchie alors que le vent soufflait fort, " l'Andréa " commença à prendre de la gîte sur l'un de ses côté et plus le bateau s'éloignait du port, plus l'instabilité devenait manifeste. Au bout d'un moment, il devait doucement se remplir d'eau et pencher dangereusement pour enfin se retourner, précipitant mon oncle et son matelot à la mer. Au bout d'un moment, hélas ! le petit navire coula, laissant son équipage barboter dans l'eau. Bien heureusement, le remorqueur " Hippone " qui se trouvait sur les lieux, devait repêcher rapidement les deux rescapés.
Dans les suites de cette affaires mon oncle et sa femme furent bien ennuyés, car, le bateau ne leur appartenant pas, comment faire pour tenter de le récupérer, alors qu'il gisait à plusieurs dizaines de mètres de fond. En compagnie d'un ami du Sport Nautique, qui mit son bateau à sa disposition et à l'aide d'un grappin il finit par accrocher quelque chose, en espérant que s'était son pointu. Il fut alors fait appel à un scaphandrier, qui voulu bien plonger pour remonter le bateau, mais, il demandait une somme rondelette pour faire ce travail, somme qui n'était pas dans les moyens de mon oncle. Il faut dire que le jour du naufrage, mon oncle n'avait pas été le seul puisque non loin de lui, un autre pointu s'était retourné pratiquement au même endroit. Avec l'autre infortuné naufragé mon oncle devait s'entretenir, afin de décider de partager les frais demandés par le scaphandrier, mais, ne sachant pas, ce que le grappin avait accroché et si l'autre bateau allait être localisé, ils devaient convenir de payer chacun la moitié de la somme. Finalement l'autre naufragé qui devait être plus argenté que mon oncle, lui proposa de payer la totalité de la somme, si le premier bateau remis à flot n'était pas le sien. C'est ainsi, que le scaphandrier plongea sur le lieu exact où, le grappin avait saisi quelque chose, qui ne pouvait être qu'un des deux pointus. Après une attente qui paru bien longue au deux rescapés, enfin devait apparaître sur l'eau la silhouette de l'Andréa couvert d'algues et un peu plus tard le deuxième navire fut repêché. Fidèle à sa promesse le propriétaire accepta de régler la totalité des dépenses revenant au scaphandrier.
Voilà comment devait se terminer cette aventure où, mon oncle avait cru, en la parole d'un garçon bien naïf au demeurant, mais, qui l'avait convaincu qu'avec une voile plus grande, le bateau irait bien plus vite et risquait fort de gagner la course. Tout cela devait se terminer par le chavirage du pointu dés la sortie du port et encore bien heureusement, que le remorqueur " l'Hippone " était à proximité pour les repêcher prestement, ce qui évita un drame de la mer en ce jour de course à la voile. Je ne pense pas qu'il se porta volontaire pour participer aux courses ultérieure, préférant de se rendre tranquillement à la pêche, mais par précaution au moteur et sans trop s'éloigner du port.
Autre anecdote qui m'amuse toujours autant, malgré que bien des années soit depuis lors passées :
Comme je l'ai dit précédemment, mon oncle ne vivait que par la mer et la pêche. Ainsi tous les WE, il ne manquait jamais de se rendre à Joinonville où, il avait son petit bateau : une plate de 3,500 mètres de long qu'il avait construit lui-même. Tous les vendredi soir après le souper, il veillait un long moment pour préparer consciencieusement son matériel de pêche, en rêvant déjà aux nombreux poissons qu'il attraperait. Le lendemain matin, il se levait très tôt et partait sur sa mobylette, alors que le jour commençait à peine à poindre. Arrivé presque à destination, il avait l'habitude de s'arrêter chez le marchand de beignet arabe, qui en plus servait des cafés noirs. Là, il passait un moment à déguster un bon beignet tout chaud et boire un petit noir bouillant avec délice. Puis, il partait, retrouver avec bonheur son petit bateau tiré sur la plage, qu'il devait sans tarder mettre à l'eau, en embarquant sa cartale remplie de lignes de toutes sortes. De là, c'est à la rame, qu'il devait s'éloigner pas très loin du rivage dans un endroit où, il était sensé trouver du poisson. D'ailleurs j'ai le souvenir qu'il scrutait toujours avec attention la côte et quand je lui demandais ce qu'il observait ainsi, il me répondait discrètement et sous le sceau du secret : les amers ! autrement dit, les points de repère sur la côte, des endroits poissonneux qu'il avait repéré.
De temps à autre, il devait m'inviter à me joindre à lui et c'était pour moi un véritable enchantement de le voir pêcher avec autant de passion. Mais un dimanche, il tira de sa cartale une ligne faite d'un crin assez gros bardé de deux énormes hameçons, en me disant qu'il avait monté cette ligne exprès pour moi, afin que je puisse également pêcher en sa compagnie. Je remarquais que sa ligne était bien différente de la mienne, avec un crin bien plus fin et de hameçons de taille modeste. Cependant, nous nous mimes à pêcher, lui à l'arrière de la plate et moi à l'avant. Le bateau était bien situé par rapport au rivage et manifestement les amers avaient été respectés et il ne nous restait plus qu'à attendre patiemment, que le poisson veuille bien toucher à nos appâts.
Soudain au bout de ma ligne, je sentis une touche que je ferais vigoureusement et je montais sur le pont un énorme poisson cochon. Mon oncle était très heureux de ma prise, mais, je le sentais un peu gêné car de son côté, les poissons ne daignaient pas un seul instant de toucher à sa ligne... Au bout d'un petit moment, j'eus une nouvelle touche et je remontais un second poisson cochon, alors que de son côté les appâts de mon oncle restaient en l'état. La chance me souriait ce jour-là, puisque, coup sur coup je n'arrêtais pas de monter des poissons cochon au bout de ma ligne. Combien en ai-je pris ? 7 ou 8, peut-être même plus. De son côté, mon oncle se désespérait de constater que sa ligne restait toujours muette et désertée par le poisson. Alors au bout d'un moment et après avoir réfléchi, il me dit d'un air très détaché : " Eh ! Jean-Claude, viens te mettre à l'arrière, car à l'avant tu fais du poids." Il se leva et me demanda de prendre sa place à l'arrière du bateau, alors qu'il devait gagner la place que j'occupais c'est à dire l'avant. Dans son esprit, il pensait pouvoir pêcher autant de poissons que je ne l'avais fait. Pensez-donc, 3 mètres nous séparait et le fait de changer de place ne lui a pas été plus favorable. Il ne pris que du menu fretin, mais, pour ma part, les poissons cochon me faussèrent compagnie en abandonnant définitivement ma ligne.
Ce jour-là, le tonton Antoine était un peu frustré, de voir son jeune neveu faire une si belle pêche, alors que lui qui avait la réputation d'être " un grand pêcheur ", n'avait pris que du menu fretin. Mais ce que j'ai pu retenir de cette anecdote, c'est le " eh ! Jean-Claude, vient te mettre à l'arrière, car à l'avant tu fais du poids "
Brave tonton Antoine, comment pourrais-je t'oublier.
Docteur Jean-Claude PUGLISI, Octobre 2022
de La Calle de France
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
|
|
|
Les sœurs missionnaires
de Notre-Dame d'Afrique
Bibliothéque Gallica
|
Les Sœurs Blanches du Cardinal Lavigerie

Le T. R. P. Voillard, écrivant une préface pour la vie de la Révérende Mère Marie-Salomé, première supérieure générale des Sœurs Blanches, la termine par ces mots : "...Il y aura dans cette vie une nouvelle démonstration par les faits, que le signe le plus certain qu'une œuvre d'apostolat vient de Dieu, c'est la présence de la Croix de Jésus dans sa naissance et dans sa croissance".
En effet, les débuts de cette Congrégation furent profondément marqués de ce signe divin de fécondité, la Croix : ils furent non seulement humbles, mais particulièrement durs et la petite société, ploya parfois si fort sous le coup de l'épreuve qu'on put la croire sur le point de périr. C'est pourtant au sortir d'une de ces heures tragiques qu'elle prit son élan définitif pour ne plus cesser de croître.
L'essor d'une Congrégation
Monseigneur Lavigerie jeta dès 1869 les bases d'une Congrégation à laquelle il voulait confier les orphelines arabes ou kabyles arrachées par ses soins à la famine. Dans sa pensée, les Sœurs de ce nouvel institut, dénommé par lui : "Institut des Sœurs Agricoles et Hospitalières du Vénérable Géronimo", devaient donner une large part de leur activité aux durs travaux des champs, tant afin de pourvoir à leur subsistance et à celle de leurs orphelines, que d'initier ces dernières à un genre de vie qui devait être le leur dans l'avenir.
Par la suite, Monseigneur Lavigerie donna à la petite Congrégation une orientation plus nettement apostolique, et, dès 1876, elle adopta le titre de "Religieuses Missionnaires de N.-D. des missions d'Afrique", qui fit place en 1889 à celui de "Sœurs Missionnaires de N.-D. d'Afrique".
Les premières Sœurs professeurs de l'Institut prononcèrent leurs vœux en l'année 1871. Monseigneur Lavigerie ne devait pas tarder à les employer à l'éducation des enfants, au soin des malades, à toutes les œuvres charitables auprès des indigènes, sur divers points d'Algérie et de Kabylie.
Il ne cessa pas ensuite d'élargir le champ apostolique des Sœurs, voulant les faire coopérer aux travaux de ses missionnaires, jusque dans les lointaines contrées de l'Afrique équatoriale.
Ce désir vit sa première réalisation deux ans après la mort du fondateur, en 1894, lorsque six Sœurs s'embarquèrent à destination de la mission de l'Ounyanyembé. L'année suivante, une autre caravane prit la direction du Lac Tanganyika. Le mouvement donné ne s'arrêta plus et d'année en année, les caravanes se succédèrent, ouvrant des postes sur les deux rives du Tanganyika, puis à partir de 1899 dans l'Ouganda et l'une après l'autre dans toutes les régions déjà évangélisées par les Pères Missionnaires.
Dans l'intervalle, les Sœurs avaient abordé à d'autres rivages : la pensée et les plans d'avenir de Monseigneur Lavigerie avaient depuis longtemps ouvert au zèle apostolique de ses missionnaires, par delà le Sahara, jalonné de plusieurs postes, les territoires du Soudan français. Quelques années après les Pères, les Sœurs, dès 1897, y ouvrirent à leur tour deux postes. Si l'accroissement des œuvres fut moins rapide au Soudan qu'en Afrique équatoriale, il fut pourtant continu.
L'apostolat des Sœurs missionnaires de N.-D. d'Afrique s'exerce donc sur un champ immense, à la mesure du zèle et de la charité débordante de leur fondateur. Humbles auxiliaires des Pères Blancs, elles collaborent avec eux pour la même œuvre d'évangélisation. Dans 104 postes, 801 Sœurs se trouvent en contact avec des populations très diverses : Arabes ou Berbères de l'Afrique du Nord et du Sahara, tribus innombrables et variées des Noirs de l'A.-O.-F. ou de l'Afrique équatoriale.
Leurs œuvres, toujours à base d'esprit apostolique, se présentent soit comme œuvres sanitaires : dispensaires, hôpitaux et hospices, soins des malades à domicile, assistance maternelle ; soit comme œuvres d'éducation : asiles, orphelinats, ouvroirs, écoles primaires ou supérieures, cours d'apprentissage professionnel ou ménager. Il faut donner une mention particulière aux postulats et noviciats pour la formation des religieuses indigènes en pays noirs.
Ces différentes œuvres se retrouvent plus ou moins, sous toutes les latitudes où se déploie l'activité des Sœurs Blanches ; mais l'adaptation au milieu en différencie la physionomie suivant les pays ; du reste elles naissent et se développent au fur et à mesure des possibilités et des besoins ; dans tel centre, les Sœurs se dévouent surtout au soin des malades, ailleurs l'ouvroir est l'œuvre principale ; ici se juxtaposent ouvroir et école, là, dispensaire et école ménagère.
Il serait intéressant de trouver un certain ensemble de ces différents modes d'apostolat : au diocèse de Constantine, Biskra nous en fournit une excellente occasion.
L'Hôpital Lavigerie
Les Sœurs missionnaires desservent l'hôpital de Biskra depuis le mois de décembre 1895. Cette station leur est chère car elles y retrouvent le souvenir de leur vénéré fondateur. Le Cardinal Lavigerie aimait Biskra : sans doute à cause de la fraîcheur et du charme de son oasis, à laquelle il venait demander parfois un peu de calme et de repos ; mais surtout à cause de la situation de cette "sentinelle avancée du désert".
Ne serait-ce pas à Biskra que, son regard plongeant, par delà l'immensité du Sahara, jusqu'au cœur des pays noirs, il aurait mûri ses vastes desseins de conquête spirituelle ?
Le monument de Falguière est là pour rappeler que si le Cardinal Lavigerie avait voulu prendre possession de cette terre, elle n'était qu'un point de départ pour aller plus avant planter la croix du Christ. A Biskra, il avait établi ses "Frères armés du Sahara".
Par la suite, les constructions destinées à cette œuvre se trouvèrent libres et l'" Hôpital Lavigerie " y fut créé. Depuis plus de quarante ans, les Sœurs Blanches y accueillent toutes les misères physiques, et elles sont nombreuses chez les 200.000 indigènes de la commune de Biskra.
Les malades hospitalisés atteignent parfois le chiffre de 150, mais l'on peut enregistrer une moyenne d'environ 120 présences.
Différents services, qui vont progressant, se partagent le soin des hospitalisés ; aux services plus généraux, s'en rattachent un de chirurgie et un de radiographie.
Les malades dont l'état ne nécessite pas un traitement prolongé reçoivent des soins au dispensaire ; celui-ci comprend à son tour plusieurs services ; deux d'entre eux présentent un particulier intérêt :
D'abord, l'assistance aux mères et nourrissons, qui ne vise pas seulement une distribution quotidienne de lait, mais une aide bien comprise aux mères de famille.
La surveillance du Docteur et des réunions, périodiques permettent de suivre les enfants et de donner des conseils utiles aux mères.
Un dispensaire ophtalmologique, ouvert depuis un an, était bien nécessaire à Biskra où les maux des yeux sont nombreux, le trachome en particulier la moitié des nourrissons régulièrement visités en sont atteints ; aussi, les malades affluent au dispensaire, heureux de trouver un soulagement efficace à leurs maux.
A Biskra, les Sœurs Blanches forment au soin des malades quelques jeunes filles indigènes : aides précieuses déjà, elles pourront devenir de bonnes infirmières ; les femmes arabes témoignent leur satisfaction d'être soignées par ces enfants de leur race, elles leur parlent volontiers, sûres d'être comprises.
Il faut ajouter que les Sœurs visitent régulièrement plusieurs villages environnants : partout on les accueille avec plaisir, on reçoit volontiers leurs conseils ; et cela les anime à continuer leur tâche parfois ingrate : car, si les Sœurs missionnaires désirent soulager les misères physiques, leur ambition est de gagner les cœurs par leur charité désintéressée et de mettre leur influence au service du relèvement moral des indigènes qui les entourent.
L'ouvroir indigène
Une autre œuvre avait depuis 1909 grandi et prospéré à l'ombre de l'" Hôpital Lavigerie" : un ouvroir de fillettes indigènes ; son accroissement a nécessité en 1924 la création d'un nouveau poste de Sœurs. L'ouvroir groupe environ 130 enfants arabes, berbères et négresses ; toutes fraternisent dans le même amour du travail, s'asseyant avec plaisir devant les grands métiers à tisser ou s'élaborent les arabesques des tapis haute-laine.
Par groupes, les fillettes interrompent le tissage pour une leçon de couture où elles apprennent à entretenir leurs vêtements. Un moment est aussi réservé à la leçon de morale ; celle-ci n'est pas la moins appréciée et la maîtresse en constate avec joie les résultats : le vol est pour ainsi dire inconnu à l'ouvroir, on ne s'y querelle pas, et l'on fait des efforts pour ne plus mentir. Les parents sont les heureux témoins de la transformation de leurs enfants ; ils apprécient sans doute l'aide pécuniaire qu'est le petit salaire de leurs filles, mais ils savent estimer le profit moral qu'elles retirent de l'ouvroir.
Depuis l'âge de trois ou quatre ans, les enfants viennent à l'ouvroir jusqu'à 16 ou même 18 ans ; de plus, chaque jeudi est réservé aux anciennes élèves qui viennent se perfectionner en couture ; les jeunes femmes elles-mêmes assistent à ces réunions hebdomadaires où les Sœurs peuvent exercer sur elles une heureuse influence.
A leur tour, les Sœurs se rendent souvent dans les foyers de leurs élèves et de leurs anciennes élèves et constatent avec joie que les bonnes habitudes prises à l'ouvroir se conservent à la maison et influent même sur l'entourage des jeunes filles.
L'Ecole
Depuis 1933, une école primaire est adjointe à l'ouvroir : quatre-vingts fillettes indigènes en suivent régulièrement les cours. Cette œuvre s'est développée facilement : les indigènes apprécient de plus en plus le bienfait de l'instruction, même pour leurs filles, surtout lorsqu'on y joint une solide éducation morale et la formation aux travaux domestiques. Les femmes qui n'en voient pas le profit immédiat sont parfois tentées de garder leurs fillettes à la maison, mais presque toujours le père intervient, faisant valoir ses droits à donner une instruction à sa fille. Quant aux enfants, elles aiment l'école, leurs maîtresses et leurs compagnes, et s'unissent à l'occasion pour les mêmes jeux à leurs sœurs de l'ouvroir.
A cinq ans, elles sont assises sur les bancs de l'école, s'appliquant sérieusement à la lecture, à l'écriture, à l'étude du français. En général, une année leur suffit pour s'initier aux difficultés de la lecture et les retardataires sont peu nombreuses. D'une intelligence éveillée, ces petites Arabes arrivent facilement à parler le français et à l'écrire. Si l'arithmétique les rebute davantage, les résultats répondent pourtant à leurs efforts. Ici aussi une large place est réservée aux cours de morale.
Le meilleur esprit règne dans les classes et l'on est étonné des bons sentiments que manifestent parfois les réflexions de ces petites indigènes ; on sent leur reconnaissance prête à se traduire en dévouement. A la question posée à l'une d'elles : "Pourquoi veux-tu continuer tes études ?" "Pour aider la Sœur", répondit-elle aussitôt. Des monitrices indigènes seraient en effet pour la Sœur Blanche une aide précieuse.
A l'école comme à l'ouvroir, l'éducation ouvre les cœurs, élève les âmes. Il y a là pour les Sœurs Blanches motif de joie et de confiance.
 ALGERIE CATHOLIQUE N° 3 de juillet 1936
|
|
PHOTOS de RANDON
Par M. A. Buffoni
|
LE CIMETIERE






Comme on peut le constater, ce cimetière est bien entretenu et propre. Pas de saccage ou destruction. C’est plutôt rassurant.
|
|
C'EST LA RENTRÉE…….
…A VACCARO AUSSI !.
Envoyé par M. Georges Barbara
|
 - " Et Zotch, arogards moi ça, ce matin, O man... C'est Ninette qu'a l'est venue a'c sa sœur, me chercher pour aller à l'école que c'est ojord'hui qu'on rentre ! Et ben si je m'attendais que tu me fais une chose pareille, ma Fi ! T'yes trop genti tu sais !
- " Et Zotch, arogards moi ça, ce matin, O man... C'est Ninette qu'a l'est venue a'c sa sœur, me chercher pour aller à l'école que c'est ojord'hui qu'on rentre ! Et ben si je m'attendais que tu me fais une chose pareille, ma Fi ! T'yes trop genti tu sais !
- " Ah ouais, c'est vrai Rosette, on a fini les vacances et 'oila, dommage ! Mais c'est bien qu'a même cette année tu vas 'oir parce que nous allons rentrer à l'école Vaccaro chez les grandes. On va avoir tous les mêmes tabliers !
- " Mais pas Ninette ta sœur ? Ta sœur, elle va pas venir avec nous elle ? Elle est encore chez les petites. Elle va t'aller en face à lécole des cheres sœurs, oui... Mais attends avant qu'on s'en va rogards un peu que je t'ouvre ma bouche… tu 'ois rien ?
- " Fais 'oir ? Ah oui attends je 'ois, on te dirait, comme…. ouille.. tu sais ces notes du piano qu'elles sont mal raccordées, tout tordues…. Et ya des blanches et ya des noires !
- " Va de la vieille gougoutse, de bon matin, t'yes mal réveillée ou quoi ? Alors toi on peut dire que t ya pas les yeux en face des trous. A debon t'yes tcheugade ? Tu vois pas qu'y me manque une dent t'sur le devant. Ca crève les yeux, et toi te vas chercher le piano, les blanches les noires. Y vient faire quoi ton piano a'c ma bouche ? Aller va, va delà !
- " Te la prends pa mal ô Rosette, pour un oui et un non te fais vite le mauvais temps toi …. Ah oui c'est vrai ça que tu dis, main'nan je 'ois. Mais Dieu préserve, tu me dis pas que tu l'as envalée non ?
- " Ca s'envale pas les dents qu'es'ce tu racontes là o babalouke mais si a l'est plus là, ç'est qu'ça veut dire que main'nan moi je vais être une grande ! Oilà !
- " Ah ouais, 'a debon moi j'savais pas qu'y fallait s'enlever une dent pour etre une grande comme tu dis ? Et ben alors, ça c'est nouveau, moi je 'ois pas, splique moi bien !
- " Mais non ma mere a m' a dit que quand les dents y te tombent c'est qu'on commence à etre majeuse ! C'est ça qu'ça s'appelle la Pub Berté !
- " Mais comme j'te dis, t'ya de la chance toi qu 'elle est pas tombée en mangeant, sinon là pour du bon tu t'l' aurais envalée
- " Attends que je te splique, a debon je crois que les vacances elles a t'ont pas arrangée, ou alors c'est que t'ya la chcague que tu dois rentrer à la grande ecole ! Et ben tu sais, c'était l'autre jour quand on est rentrées d'la plage de Chapuis, j'ai vu qu'la dent elle me bougeait trop beaucoup, et j'l'ai dit à ma mère. . Alors elle tu sais pas ça quelle a fait ? Et ben elle a attaché la dent avec du fil à coudre DMC, qu'elle a pris dans sa boite de couture ,,,,,, et après elle a attaché l autre bout à la poignée du cabinet qu'elle était ouverte et elle m'a assis t'sur une chaise. Après elle m'a dit de fermer les yeux que j'allais avoir une madonne de surprise. Et tout d'un coup elle t'a fermé la porte de ce madone de cabinet…ET BANG. !!!!
..Alors j'sais pas pourquoi la dent a l'est partie avec le fil, et moi j'te dis pas comment que me suis sauvée dans la cuisine en criant tellement que j'avais mal, et que j'savais pas ça qu'y l'était arrivé ! A debon c'était la fin du monde ma Fi ! Ma mère laisse la qu'elle me courait darrière en rigolant, mais moi je m'suis jetée dans les bras de ma grand-mère qu'elle faisait le manger. Et tellement que je criais fort, que le chien de ma mémé y l'a sauté par la fenetre. Si t'yavais vu les deux combien elles m'ont embrassée ! Et ma mère qu'a faisait que me dire ; " t'yes une grande main'nant, t'yes une grande ma Fi !
Mais moi ma bouche elle était à bloc de sang. C'est sur que j'avais mal mais comme j'étais devenue une grande j'ai fait courage et j'ai pas pleuré beaucoup, surtout que ma grand mère qu'elle me serrait fort dans ses bras, a m'a dit que ce soir j'devais mettre ma dent en d'sous l'oreiller pour que dans la nuit la petite souris elle vient la chercher et à la place a me met un bonbon !
- " Et Zek... Et ben si c'est vrai ça qu'tu dis Rosette, et ben moi c'est pas un bonbon que je vais a'oir mais au moins une demi-livre, parce que si c'est comme ça ce soir quand ma mamie a va dormir je vais t'lui prendre son dentier qu'elle te met dans le bol a'c la carbonate, avant de se coucher et je le mets en t'sous mon oreiller, pour que quand la souris a va venir elle s'le trouve. Mais tu sais comme ya au moins plusque de dix dents t'sur le dentier de ma mamie, qu'est ce que je dis dix, plusque de vingt au moins, et ben quand la souris a va 'oir ça, elle va t'être obligée de mettre une valise des bonbons !
- " Atso Chounette je 'ois que toi te prends tout à la rigolade, aller y vaut mieux qu'on s'en va atroment on va t'être en rotard c'est sur ! Et pis va s'aoir cette année qui y vont nous coller comme maitresse ? Que madame Grauby qu'elle faisait la sixieme avant et qu'elle était trop gentie, a l'est partie à la rotraite !
- " Et ouais dommage !
- " Mais ça que ma sœur a m'a dit aussi c'est que main'nan on va te faire la gymastique dans la salle de la JSH derriere la cathédrale... Et que là on va t'être mélangées a'c les garçons te t'rends compte !
- " Et oui Ninette 'oila ça qu'c'est l'école des grandes….!
Georges Barbara, Août 2022
|
|
VISIONS DE SAINT-CLOUD
BONJOUR N° 3 du 20 octobre 1932, journal satyrique bônois.
|
|
" Variété diocanesque"
Maintenant que la saison elle est finie, je vas vous exposer sur ce Bonjour les impressions de la saison estivale à St-Cloud.
Comme à Deauville, Biarritz ou Juan-les-Pins, St-Cloud y te leur fait l'attaque.
Dans ces plages, ainsi qu'a Dinard y vont ceuss'là qui z'ont des " dinares " en pagaille. Ma ceuss qui z'en ont pas des tas y vont à St-Cloud pour se faire voir le maillot dernier modèle moulant le joli cucu.
St-Cloud, c'est la perle de l'Afrique du nord, l'endroit rêvé pour attraper, des coups de soleil aux cuisses. Bônois, vous devez z'en être fier de St-Cloud comme y faut. Sable blanc, fin, dessur lequel les "arrières-trains" y sont exposés aux rayons infra-rouges du soleil du midi.
La tombe de mes morts! je vous jure que c'est plus mieux voir cette exposition de " pastèques " multicolores ! que l'exposition coloniale de Paris.
Ba ! ba ! ba !. ça oui ! ya de quoi se rincer les lanternes diocane !
Vous voyez de ces morceaux" bien viandés qu'a de bon on te réveille tous les gantches de la création. Que le bon Dieu y protège le plus joli poulailler du monde, que c'est à Bône, le pays des plus belles " poules. "
Dans ce coin là, y en a qui sont cent fois mieux que Greta Garbo et Marlène Dietrich du cinéma qui te leur fait la réclame.
Poutana misère ! à St-Cloud, vous voyez de ces couffins à qui y manque rien que la parole.
C'est à midi le plus beau coup d'œil.
Elles s'la font à l'américaine, comme sur les plages de Floride, maillots collants qui cachent presque rien. On voit d'la bidoche à la Joséphine Baker.
Demoiselles et garçons on jouait à se faire des " mayonades " faire les " nejfss" et pincer les fesses ; y z'appellent ça, le sex-appeal…
Si les mères de l'ancien temps y verraient ça, sûr ! que, Diocane ! y tomberaient des attaques sur le sable.
Ceuss'là qui zont pas du pèze pour aller en prendre de l'air à Bugeaud ou même en France, y z'ont qu'à aller en été à St-Cloud s'allonger en d'sous un cabanon, ils seront satisfaits et y comprendront que si Bône c'est la République des mouches et le Royaume des moustiques, c'est en revanche le paradis des jolis tendrons.
VIDESSE.
|
|
Le discours de François Mitterrand
quelques jours après l’insurrection en Algérie
Par Antoine MARTINEZ
|
 " François Mitterand, pourtant chantre de la décolonisation et de l’émancipation des peuple dans d’autres contextes, fut à la fin de l’année 1954 et au début de l’année 1955, l’un des plus zélés défenseurs de « l’Algérie française ».
Ancien ministre de la France d’Outre-Mer ( 12 juillet 1950 – 11 août 1951 ).
Ministre de l’Intérieur dans le gouvernement de Pierre Mendès France, François Mitterand agit sans état d’âme pour « rétablir l’ordre » par la force après avoir prononcé, dès le 12 novembre 1954, juste après le lancement de l’insurrection armée par le FLN, son célèbre « l’Algérie, c’est la France ! ».
Lors de son retour au pouvoir, au début de 1956, comme garde des Sceaux du cabinet Guy Mollet, François Mitterand, soutint une impitoyable répression et ferma les yeux sur les pires pratiques policières, notamment lors de la bataille d’Alger.
Discours du ministre de l’intérieur François Mitterrand :
« M. le président. La parole est à M. le ministre de l’Intérieur. M. François Mitterrand, ministre de l’Intérieur. » (12 novembre 1954, même séance)
« Mesdames, messieurs, je pense que l’Assemblée nationale, à la fin de ce débat, voudrait connaître le plus exactement possible le déroulement des faits dont nous parlons.
C’est ainsi que, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, des attaques à main armée, des attentats à la bombe, des sabotages de lignes et de voies de communication, des incendies enfin ont eu lieu sur l’ensemble du territoire algérien , de Constantine à Alger et d’Alger à Oran.
Dans le département de Constantine, vous le savez, se produisirent les événements les plus graves. Là, cinq personnes furent tuées : un officier, deux soldats qui remplissaient leur devoir, un caïd et un instituteur, dans les conditions qui furent rappelées à cette tribune et dont personne ne dira suffisamment le caractère symbolique.
De jeunes instituteurs sont venus accomplir – et c’était le premier jour – la tâche qu’ils avaient choisie. Et voilà qu’ils sont frappés. Sauront-ils pourquoi ? Sans doute non, les choses sont vite faites. Assassinés, ils ont quand même le temps d’apercevoir le frère musulman qui tente de les défendre et qui meurt le premier.
Je prétends qu’actuellement certains doivent cruellement méditer sur le déclenchement hâtif de l’émeute, qui les a précipités dans une aventure qui les conduira à leur perte. Voilà donc qu’un peu partout, d’un seul coup, se répand le bruit que l’Algérie est à feu et à sang.
De même que le Maroc et la Tunisie ont connus ce phénomène du terrorisme individuel dans les villes et dans les campagnes, faut-il que l’Algérie ferme la boucle de cette ceinture du monde en révolte depuis quinze ans contre les nations qui prétendaient les tenir en tutelle ?
Eh bien ! non, cela ne sera pas, parce qu’il se trouve que l’Algérie, c’est la France, parce qu’il se trouve que les départements de l’Algérie sont des départements de la République française.
Des Flandres jusqu’au Congo, s’il y a quelque différence dans l’application de nos lois, partout la loi s’impose et cette loi est la loi française ; c’est celle que vous votez parce qu’il n’y a qu’un seul Parlement et qu’une seule nation dans les territoires d’outre-mer comme dans les départements d’Algérie comme dans la métropole.
Telle est notre règle, non seulement parce que la Constitution nous l’impose, mais parce que cela est conforme à nos volontés.
Personne ici n’a le droit de dire que le Gouvernement de la République a pu hésiter un seul instant sur son devoir car l’action qu’il a menée correspond à l’essentiel même de sa politique.
M. le Président du Conseil l’a déclaré cet après-midi : comment pourrait-on expliquer, autrement qu’avec beaucoup de vilenie, le règlement des affaires françaises que nous avons été contraints de conclure en Asie si l’on n’admettait pas que nous avons agi alors conformément aux principes que nous avons les uns et les autres définis, écrits et proclamés, afin de préserver le domaine français, ce domaine qui s’étend fondamentalement – je viens de le dire – des Flandres au Congo ?
C’est là notre vérité, l’axe de notre politique. C’est pourquoi il n’est certes pas contradictoire qu’on traite, lorsque cela paraît nécessaire, à Genève, et qu’on se batte parce que cela est également nécessaire dans l’Aurès ou en tout lieu où on tentera d’abattre, de détruire, de s’attaquer à l’unité de la patrie.
Les mesures que nous avons prises ont été immédiates. On me permettra, je suppose, de ne pas les énumérer.
Mais, je ne vois vraiment aucun inconvénient à indiquer à l’Assemblée nationale, comme je l’ai fait à la commission de l’intérieur, qu’en l’espace de trois jours, seize compagnies républicaines de sécurité ont été transportées en Algérie, ce qui a porté à vingt le nombre total de ces compagnies sur le territoire algérien.
En trois jours tout a été mis en place. On a dit : Est-ce pour maintenir l’ordre ?
Non pas seulement. Mais pour affirmer la force française et marquer notre volonté. Il ne s’agissait pas seulement de réprimer, de passer à la contre-offensive de caractère militaire afin de reconquérir un territoire qui n’était point perdu ! Il s’agissait d’affirmer, à l’intention des populations qui pouvaient s’inquiéter, qu’à tout moment, à chaque instant, elles seraient défendues. »
Discours tiré de :
« Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours. », rassemblés et commentés par Michel Mopin – Notes et études documentaires – La Documentation française – Paris, 1988
https://nouvellesduglobe.wordpress.com/2015/12/18/
le-discours-de-francois-mitterrand-quelques-jours-apres-linsurrection-en-algerie/
Transmis par J.L.G
et qu'ils meurent tous… enfin !
Mis en ligne le 23 décembre 2015
sur le Site de l'EXODE -
|
|
Retour sur la genèse de la " Toussaint rouge " (1er novembre 1954)
Dr Jean-Claude Perez - Ecrit et diffusé en 2012
|
Il me tarde de vieillir d'un an. De doubler le cap maudit du 50ème anniversaire. Le cinquantenaire de la plus grande défaite historique subie par une nation européenne, notre Patrie la France, devant l'ennemi moderne ou plutôt actuel de l'Occident chrétien : " l'arabo-islamisme fondamentaliste conquérant " qu'il ne faut pas confondre avec la religion musulmane.
Un cinquantenaire qui remet à l'ordre du jour des interrogations auxquelles n'ont été apportées que des réponses insuffisantes, voire évasives ou dilatoires : " par quelles manœuvres sataniques la conjuration permanente contre l'Occident chrétien, est-elle parvenue à tuer la France en Algérie française ? "
Dans l'espoir d'apporter des éléments de réponse sérieux à cette question qui relève d'une stratégie anti-occidentale majeure, il faut revenir sur l'évènement théoriquement déclencheur de la guerre d'Algérie : la Toussaint Rouge, le 1er novembre 1954.
Un rappel me paraît absolument nécessaire cependant. Le 23 octobre 1954, naît le FLN.
Celui-ci se dote d'une armée, l'ALN, Armée de Libération Nationale. Elle entre en action le 1er novembre 1954.
Le FLN est né du CRUA, le Comité Révolutionnaire pour l'Unité d'Action, composé de 5 membres : Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Larbi Ben M'hidi, Mostefa Ben Boulaïd, Rabah Bitat.
Ce CRUA fut constitué durant le mois de mars 1954. En réalité, nous sommes en guerre depuis ce mois de mars 1954 au plus tard. La police des renseignements généraux est informée. La direction de la sécurité du territoire est informée. Les services spéciaux français sont informés. Le gouverneur général en Algérie, Léonard, est informé, lui aussi. Tout le monde se tait. Tout le monde capitule en réalité avant le déclenchement des hostilités.
Pardon. Ce n'est pas tout à fait exact. Durant l'été 1954, deux notables de la révolution algérienne vont connaître des ennuis douloureux.
Hocine Lahouel, membre du bureau directeur du MTLD, révolutionnaire algérien très connu, originaire du Constantinois, est " ramassé " par la police, durant l'été 1954. Il avait été roué de coups par des inconnus qui l'avaient laissé pour mort. C'était rue de la Lyre, à proximité du siège du MTLD, place de Chartres, à Alger. Ses agresseurs, non identifiés, pensaient certainement l'avoir tué. Pour des raisons inconnues, ils n'ont pas apporté, de toute évidence, un soin extrême à l'exécution de leur travail.
Hocine Lahouel est donc un révolutionnaire algérien. Il est important de préciser que c'est un élu TRES connu. Il siège au conseil municipal de la ville d'Alger. Il y exerce les fonctions d'adjoint du maire Jacques Chevallier.
A cette époque, celui-ci occupe à Paris le poste de secrétaire d'Etat de la Défense Nationale dans le gouvernement de Pierre Mendès-France.
Lahouel, avec la complicité de Jacques Chevallier, avait dirigé la réunion préparatoire au cours de laquelle fut décidé le déclenchement de la guerre d'Algérie. C'était très précisément le premier dimanche de juillet 1954, à Hornu, dans le Brabant, dans une salle de cinéma. En Belgique donc.
Lors de cette réunion d'Hornu, il était accompagné de Mohamed Khidder, un autre cadre supérieur du MTLD.
Ainsi, d'une manière historiquement incontestable, Jacques Chevallier est confirmé dans ce qu'il est avant tout : un complice majeur, ou plutôt un ordonnateur de la Révolution Algérienne. Il intervient en tant que correspondant, très honorable et particulièrement bien placé à Paris et à Alger, des services secrets américains. Il avait fait partie de ces services en 1943, en tant que militaire mobilisé, car il jouissait d'une double nationalité française et américaine, puisque sa mère était Texane.
Insistons encore sur cette vérité : dans la genèse du 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, Jacques Chevallier intervient comme un agent de décision majeur dans le déclenchement de la Révolution Algérienne.
Mohamed Boudiaf, lui aussi cadre supérieur du MTLD, durant le même été 1954, donc très peu de temps après la constitution du CRUA, est ramassé à son tour, laissé pour mort, rue de la Lyre à Alger. Il guérira de cette énorme raclée, grâce aux soins de nos médecins français.
Qui se trouve à l'origine de ces agressions sauvages ? Manifestement " incomplètes " ?
Agissements des services spéciaux français ? Initiatives de policiers français, ulcérés de constater que leurs enquêtes et découvertes ne servent à rien ? Avertissements donnés violemment par des officiers du SR militaire dirigé par le colonel de Schaken ? En tout cas, ces deux hommes victimes l'un et l'autre d'une raclée trop expéditive, pourront poursuivre leur carrière d'ennemis de la France avec vigueur, constance et succès. En particulier Hocine Lahouel, sous l'autorité de Jacques Chevallier, nous l'avons vu.
Au moment de son agression de l'été 1954, il œuvrera à la Mairie d'Alger en tant que complice opérationnel très offensif de la Révolution Algérienne. Il combattra la France et contribuera à faire tuer des Français. Grâce à Lebjaoui, un fonctionnaire municipal. Celui-ci deviendra plus tard le premier chef du FLN-Métro. Mais à Alger, à la mairie, grâce à un complice Rabah Adjaoui, appariteur sous ses ordres, il alimentera les tueurs de la ZAA (Zone Autonome d'Alger) en fausses cartes d'identité. Grâce à Ouamri, un fonctionnaire très actif, il fera établir une liste de policiers français à abattre. Hocine Lahoued put agir ainsi grâce à un effectif mis à sa disposition, avec la complicité du maire certes, mais aussi avec la complicité très active des promoteurs de la mort de dizaines de Français. Promoteurs qui portent les noms de Gallice, Chaulet, et autres encore.
Jacques Chevallier, par sa participation active au combat contre la France, mettait en pratique ses convictions rooseveltiennes telles que celles-ci avaient été exprimées en 1943 à Casablanca par le président américain. Le général Giraud avait claqué la porte. Le général De Gaulle s'était soumis lors de cette célèbre rencontre de 1943 à Casablanca.
Jacques Chevallier, engagé volontaire et convaincu dans la guerre contre la France, engagé dans la guerre pour la naissance de " sa " jeune patrie, l'Algérie connut l'énorme privilège, en octobre 1961, de bénéficier du concours clandestin et efficace d'un " chef " de l'OAS, dont on veut nous faire croire qu'il était l'homme de Salan. Au mois de mai 1962, Jacques Chevallier et son nouveau complice, réussirent à convaincre les " Deltas " de l'OAS algéroise, de cesser le combat.
Ce jour du " cessez le feu " des Deltas correspond historiquement à la date effective de la mort de l'Algérie française. Au triomphe de l'idéologie rooseveltienne. Ce qui signifie que c'est bien ce jour-là que le pompidolisme, état-major rothschildien qui orientait et dirigeait De Gaulle, a triomphé.
Les Rothschild ont tenu, indiscutablement, un rôle majeur dans l'élaboration et la mise sous protection d'un énorme capital culturel et artistique européen et occidental. Cette grande famille, comparable à un Laurent de Médicis des 19e, 20e et 21e siècles, accompagna ce mécénat artistique d'une adhésion à une volonté politique qui s'est confirmée au cours des décennies.
En particulier, elle adhéra à la théorie, formulée par les techniciens du capitalisme financier moderne, du délestage économique du débouché colonial : favoriser les pseudo-libérations des peuples colonisés, c'est-à-dire se libérer en réalité de la charge énorme qu'exigeaient leur promotion, leur accession à la modernité et au progrès. Grâce à cet allègement économique, les investissements devenaient producteurs d'une valeur ajoutée augmentée. Il était évoqué le prétexte imprudemment affirmé et non vérifié, aujourd'hui encore, de promouvoir secondairement une accession au bien-être moderne des peuples décolonisés. Des peuples " libérés " dit-on encore. Peuples dont le sort s'exprime aujourd'hui, comme on le constate à chaque minute, par des drames et des génocides périodiques. En Afrique. Au Proche et au Moyen-Orient. Par des tueries en Afghanistan.
En 1942, vers la fin de l'année, aux USA, par voie de presse, les Rothschild ont pris position contre le général Giraud parce que celui-ci tardait, semblait-il, à abroger l'abrogation du décret Crémieux. C'était effectivement une mesure à prendre, nécessaire à la réintégration des juifs d'Algérie dans la citoyenneté française. Cette condamnation implicite du général Giraud provoqua indirectement, mais avec une efficacité redoutable et recherchée, la promotion de De Gaulle, qui avait été recruté depuis bien longtemps par les chasseurs de tête de la Synarchie. C'est le " pompidolisme " de Georges Pompidou, celui-ci étant un collaborateur éminent de la banque Rothschild, qui eut à manœuvrer De Gaulle à partir de 1956 et à l'engager dans la dynamique roosveltienne telle qu'elle s'était exprimée à Casablanca en 1943. Nous l'avons vu. Il ne nous paraît pas inutile de le rappeler.
Revenons à 1954, en Algérie, la Toussaint Rouge. Le ministre de l'Intérieur français de la IVe République, François Mitterrand, séjourne à Alger le 22 octobre de cette année-là. Il est averti au plus tard le 23 octobre, de la naissance du FLN.
Cependant, des traîtres de l'OS, Organisation Secrète du MTLD, ont parlé. Monsieur Vaujour, directeur de la Sûreté Nationale en Algérie, rend compte à sa hiérarchie de ce que lui propose de vendre un membre de l'OS : toute l'implantation du CRUA, donc du FLN, dans les Aurès. Soulignons qu'au sein de ce maquis opère déjà un évadé de prison, Zighout, futur responsable le 20 août 1955, des massacres de Philippeville, d'El Alia, et d'Aïn Abid.
Monsieur Vaujour, pour détruire ce maquis, doit obtenir le feu vert de son ministre Mitterrand, afin de disposer du million d'anciens francs que demande le traître de l'OS pour lui livrer toute cette implantation ennemie.
"Encore un canular !" va s'exclamer Mitterrand en substance.
Pourtant, c'est ce même Mitterrand, celui qui oppose un net refus au paiement nécessaire pour conduire une opération préventive, qui déclarera quelques jours plus tard, le 12 novembre 1954 : "Il faut que la force de la nation l'emporte, quelles que soient les cruautés de la tâche ".
Le paiement d'un million d'anciens francs aurait permis peut-être et sûrement, d'éviter la mise en œuvre de ces cruautés qu'avait prédites Mitterrand.
Qui ose affirmer aujourd'hui encore, que les hommes politiques sont tous des parangons d'intelligence et de savoir ? Qui peut affirmer encore aujourd'hui, que les hommes politiques s'expriment en toute liberté ?
Il est facile de répondre à ces interrogations quand on observe le comportement stérile, soumis et pervers des sacristains et des oblats qui fréquentent les monastères du gaullisme résiduel.
Leurs références sont des références de désastre, de mort et de reniement. Car ils ont accepté en esprit le génocide éventuel du peuple français d'Algérie.
Nous arrivons au 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge.
Mostefa Ben Boulaïd, le déclencheur, nous le savons, est un des cinq fondateurs du CRUA, le futur FLN, à partir du 23 octobre 1954. C'est un Chaouïa, ainsi que tous les habitants des Aurès-Nementcha. Dans cette région, la Juive d'origine berbère, la Kahena, a résisté les armes à la main contre les Berbères récemment convertis à l'islam. Les néophytes musulmans algériens, arabisés à outrance, exigeaient la soumission par la force de ceux de leur race qui s'obstinaient à ne pas adhérer au message du Prophète de la Mecque et de Médine, qu'ils fussent juifs ou chrétiens.
Sur ce même territoire donc, Ben Boulaïd confie à des rebelles une mission bien précise : intercepter un autobus dans la région de M'Chounèche. Cette opération s'inscrit parmi d'autres qui vont se déclencher sur des sites différents du territoire algérien. Ils tuent un instituteur et blessent sa femme. Auparavant ils avaient abattu Hadj Saddok, le caïd de M'Chounèche, qui, a-t-on prétendu, voulait s'opposer à l'assassinat du maître d'école français.
Cette interprétation officielle de l'attentat de M'Chounèche, n'a qu'un but : occulter son identité réelle. Car, pour Ben Boulaïd, pour l'anti-France, celui qu'il fallait tuer de toute urgence et avant tout c'était Hadj Saddok.
Pourquoi ?
Ben Boulaïd connaît les Aurès comme sa poche. Il jouit du prestige d'évadé d'une prison française, ainsi que l'un de ses subordonnés, Zigout. Ben Boulaïd est conscient d'une réalité : une insurrection dans les Aurès n'aurait aucune chance de réussir si on ne la fait pas précéder de l'élimination physique de Hadj Saddok. Celui-ci, en effet, jouit d'une grande audience dans les Aurès. Il est connu comme un partisan total de la France. Un homme courageux au passé militaire élogieux. Mais ce n'est pas suffisant pour l'abattre. Car à cette date, du 1er novembre 1954, s'il fallait tuer tous les partisans de la France en Algérie, il faudrait tuer 80 % de la population algérienne au moins.
Hadj Saddok est néanmoins tué de toute urgence. Sa mort, en effet, est nécessaire à l'opération déclenchée contre la France.
Pourquoi ?
Il faut revenir, pour répondre à cette question, au 8 mai 1945. En y allant " sur la pointe des pieds ". Avec une prudence trouillarde. Car "le 8 mai 1945", en Algérie, est frappé du sceau d'une malédiction entretenue et même nourrie par le refus de " voir " la réalité. C'est-à-dire la signification historique réelle de ce drame. C'est un entêtement qui conduit certains interlocuteurs à se satisfaire d'une relation incomplète de l'identité fondamentale de cet évènement.
Le 8 mai 1945, c'est le jour d'une insurrection dans les Hauts Plateaux sétifiens, dans la Petite Kabylie. Et à Guelma, dans l'Est-Constantinois. Personne ne veut répondre encore aujourd'hui à la double question :
Pourquoi le 8 mai 1945 ?
Pourquoi dans cette région ?
Personne ne veut s'attarder sur la responsabilité de l'émir libanais Chékib Arslan, agent hitlérien connu pendant la guerre de 1939/1945, échappé providentiel en avril 1945 du lieu de sa détention en tant que prisonnier français, pour rejoindre Genève. Il pourra donner, à partir de cette ville, conformément aux instructions anglo-saxonnes, l'ordre de djihad contre la France.
Personne ne veut retenir que son transmetteur d'ordre n'est personne d'autre que le président en fonction de l'association des Oulémas en Algérie, El Bachir el Ibrahimi, assigné à résidence à Aflou. Il est précisément originaire de Tocqueville, Ras-el-Oued, en plein centre des Hauts-Plateaux-Sétifiens. Personne ne veut se souvenir que ce déclenchement opérationnel est en conformité avec la volonté manifestée à Casablanca en 1943 par le président Roosevelt. C'était une opération contre la France, ouverte simultanément sur deux sites opérationnels précis.
Un site algérien : le Constantinois, à Sétif et à Guelma en particulier.
Un site syrien, à Damas, où nos troupes sont attaquées le 8 mai 1945 par des Palestiniens.
Nos soldats résistent, mais vont être désarmés par les forces britanniques du général Spears.
Tout cela, personne ne veut s'y attarder.
L'étude fragmentaire que je vous adresse aujourd'hui, n'a pas pour objet de revenir sur les évènements du 8 mai 1945, à Sétif, Guelma, Kerrata et d'autres localités du Constantinois.
Ce que l'on ne relève pas habituellement, c'est l'information suivante : Hadj Saddok, la future victime du FLN à M'Chounèche en 1954, était sous-officier en 1945. Il était adjudant dans une unité de tirailleurs stationnée en Tunisie. Pas loin de la frontière algérienne. Pas loin des Aurès Némentcha. C'est un Chaouia. Un de ses officiers lui demande d'être volontaire, le 8 mai 1945, pour une mission délicate et urgente. Parce que Hadj Saddok est un Chaouia, il lui est commandé de se rendre sur le territoire de ces montagnards du Sud-Est constantinois et d'y convaincre le peuple Chaouia de ne pas s'incorporer à l'insurrection. N'oublions pas que nos forces militaires sont réduites sur ce territoire, le 8 mai 1945. Notre armée est dispersée en Europe, pour y terminer la guerre.
Elle fournit l'effectif des garnisons sur les territoires qui à cette époque sont encore les territoires de l'empire français.
Saddok accepte la mission. Il se fera connaître sur sa terre, comme ce qu'il était. Un soldat français. Il connaîtra, plus tard, les honneurs, en récompense du succès qu'il remportera.
Pour Ben Boulaïd, Hadj Saddok est l'homme à abattre de toute urgence, car celui-ci avait l'oreille des Chaouias et aurait, peut-être, entraîné son peuple des Aurès dans une contre-rébellion, sur le chemin de la France.
Mais, la France, c'est justement elle qu'il fallait tuer au sud de la Méditerranée. Et, en même temps, éliminer en les tuant, ceux qui s'affirmaient publiquement Français, malgré les tueurs et les menaces.
C'est pour cela, pour atteindre ce but, que le Cheik des Oulémas, Ibrahim Bacchir, toujours lui, déclara à partir du Caire, le 1er novembre 1954, que le combat est engagé pour " le triomphe de l'arabisme et de l'islam ".
C'est dans le but de contrecarrer " le triomphe de l'arabisme et de l'islam " que François Mitterrand déclare le 12 novembre 1954 : " il faut que la force de la Nation l'emporte quelles que soient les cruautés de la tâche ". Il donne en apparence un blanc-seing aux forces de l'ordre pour que la force de la Nation puisse s'exprimer et l'emporter. Mais, très vite, il sera repris en mains par les promoteurs capitalistes de l'abandon de l'Algérie. Par les tenants rothschildiens, secondairement et tactiquement gaullistes du " délestage économique du débouché algérien ". Il fallait se défaire des peuples à gérer et à développer. Des peuples à promouvoir. Dans le but exclusif d'augmenter la valeur ajoutée des investissements. La décolonisation c'est une décision et un accomplissement capitalistes.
"Libérer la France du peuple algérien", telle est encore aujourd'hui la formulation tactique majeure et ouvertement exprimée de ceux qui s'incorporent au racisme gaulliste. Celui-ci a pris la responsabilité de la mise en chantier de la plus grande défaite subie par notre pays, depuis qu'il existe.
Aujourd'hui, nous " crevons " en France des séquelles de cette défaite. Malgré les péroraisons ridicules, je l'ai déjà dit, permettez-moi de l'affirmer encore, de tous ces sacristains et oblats qui peuplent les chapelles du gaullisme résiduel, l'on doit faire un constat : la France guérira de cette défaite quand elle guérira du gaullisme, gangrène encore active et involutive de la droite française.
Lors du dernier combat, celui de l'OAS, nous avons été contraints, pour survivre et espérer, de recourir à une technique de guerre terroriste. On prétend nous accabler encore pour cela.
On oublie de préciser que notre guerre terroriste, que nous n'évoquons pas sans douleur, n'a duré que 4 mois. 4 mois seulement.
Mais on omet de rappeler que le peuple pied-noir, fraction vivante de la Nation française, a subi, quant à lui, 94 mois de guerre terroriste.
Une guerre terroriste illustrée des crimes les plus horribles, que nous, nous n'avons jamais commis : femmes, enfants vieillards, massacrés, viols collectifs de femmes enlevées, soldats prisonniers, émasculés, éventrés après avoir eu les yeux crevés. Des dizaines de milliers de Harkis lynchés avec leur famille. Les disparus d'Oran. Les prisonniers de guerre escamotés.
Ne rougissez pas de l'OAS.
Priez le ciel que ne soit pas nécessaire un jour, l'entrée en action d'une OAS européenne et occidentale pour sauver ce que nous avons espéré défendre en Algérie : l'Occident chrétien.
Dr Jean-Claude Perez - 2012
|
|
ASSASSINATS DE PRETRES
EN ALGERIE -1945/1962
Par (récit, extrait)
Par ACEP-Ensemble N° 302, décembre 2016
|
Dès 1945, nous ne comptons plus le nombre de Prêtres assassinés de façon la plus odieuse, par les Djihadistes, précurseurs des égorgeurs du FLN, en 1954....
La revendication principale n'étant pas tant l'Indépendance, mais le souci de tuer des Chrétiens (verset 9-29 du Coran, entre autres)
24 décembre 1954 :
L'église de Dahroussa est mise à sac et brûlée, un symbole de la liberté de culte de la future Algérie Nouvelle, et un message clair à l'approche de Noël.
25 Avril 1955 :
Prêche de la guerre sainte à la mosquée de Constantine par les cheikhs Khereïdine et El Hocine.
Dans un prêche remarqué, ils prônent la guerre sainte (le djihad) contre la France et les incroyants (les juifs et les chrétiens). Ils sont immédiatement arrêtés. Le journal qu'Abane Ramdane inspire, El-Moujahid, transmet ses idées à la population. Les premiers numéros de ce journal, qui va devenir celui du F.L.N., sont tirés sur la ronéo de l'abbé Bertal que les appels au meurtre qu'ils contiennent ne semblent pas beaucoup troubler. L'amie de ce prêtre d'avant-garde se rend à Oran où, avec la complicité d'un autre prêtre, l'abbé Sacher, s'imprime l'édition oranaise d'El-Moujahid. Ainsi patronné, Abane Ramdane devient une personnalité à peine clandestine. Il suffit de frapper à la bonne porte pour le rencontrer.
5 juillet 1955 :
Le grand rabbin de Batna laissé pour mort dans un attentat individuel.
7 Avril 1956 :
Opération dans la région de Medromah (sud Oranais).
Un père blanc assassiné à Ain Sefra. 2 Juin 1956 :
Une synagogue d'Orléansville est l'objet d'une grenade suivie d'un incendie criminel
19 Juin 1956:
Guy Mollet casse le décret de Lacoste, expulsant du département d'Oran l'abbé Berenguer, pour aide au F.L.N. L'abbé ira comme ambassadeur du F.L.N. en Amérique latine récolter de l'argent pour payer les armes et les munitions, il rentrera en Algérie après l'indépendance, sera nommé député, démissionnera dès 63 quand l'assemblée votera la loi sur la nationalité algérienne qui définit la religion musulmane comme nécessaire à cette nationalité et rejoindra la France. Mais dit-il dans ses souvenirs, il ne regrette rien.
20 Août 1956 :
Égorgement du père blanc Tabart, à Geryville.
6 octobre 1956 :
Un père blanc enlevé en Kabylie
19 Octobre 1956:
Des deux religieuses enlevées à Igjhil-Ali une (sœur Pierre Fournier) a été égorgée, l'autre (soeur Françoise Solano) est retrouvée hébétée, toutes deux ont été abondamment violées. Il lui est demandé de ne jamais parler de ses tortures, et elle est mutée en Afrique.
En retraite à Montréal, le gouvernement français lui a attribué en 2012 la légion d'honneur. Mais la supérieure lui interdit de l'accepter, car cette acceptation pourrait mettre en danger les religieuses qui survivent en Algérie. Lâche chantage des autorités FLN.
22 octobre 1956
Un père blanc suisse égorgé près d'Azazga.
30 Novembre 1956 :
A Nedromah, deux graves attentats ciblent la communauté israélite de la petite ville, dans le but (atteint) de la contraindre à l'exil. Deux bombes sont posées dans la synagogue et dans un lieu de réunion communautaire, faisant 23 morts dont le rabbin et une trentaine de blessés
30 Décembre 1956 :
Quatre bombes dans quatre églises catholiques d'Alger, dont la cathédrale. Dégâts matériels
15 Janvier 1957 :
Le grand rabbin de Guelma, grièvement blessé.
18 Mars 1957 :
Le curé de Saint- Aimé est assassiné près d'Ammi-Moussa, alors qu'il rendait visite à un paroissien.
28 Mars 1957 :
Le grand rabbin Choukroun victime d'un attentat à Médéa succombe à ses blessures.
1er Avril 1957 :
Un aumônier assassiné à Bougie.
3 juin 1957 :
Le vicaire (en soutane, pas d'erreur possible) de Sainte Marcienne à Mostaganem, grièvement blessé à l'arme blanche.
1er juillet 1957 :
Argoud reçoit la visite d'un Père blanc de Maison-Carrée, qui vient s'enquérir du sort réservé à son chauffeur, arrêté pour aide à la rébellion. Il a vécu vingt ans au Sahara, dans la région de Beni-Abbès, seul Européen au milieu des musulmans. Il me félicite de la manière dont je rends la justice, puis me déclare.
" Out, les musulmans respectent la force, surtout quand elle est injuste. "Je reste interloqué. Cette affirmation est en contradiction formelle avec tout ce que je crois savoir de l'âme musulmane. Or la tenue du père, son maintien excluent toute plaisanterie. Son assurance tranquille, les exemples qu'il me cite sur les réactions de ces hommes, qu'il connaît mieux que personne, jettent le trouble dans mon esprit. Depuis, je suis arrivé à la conviction qu'il avait raison, et que son hypothèse expliquerait, mieux que toute autre, le comportement des musulmans. Ils respectent viscéralement l'autorité, la force. Or la force à l'état pur est la force injuste. S'ils feignent de s'insurger contre l'injustice, c'est que, connaissant notre éthique occidentale, ils espèrent en obtenir réparation.
24 juillet 1958 :
Un missionnaire américain enlevé en Kabylie.
15 Août 1958 :
Quatre attentats à Constantine, un mort, Moïse Chemia, rabbin, et 35 blessés.
12 Septembre 1958 :
Grenade dans la synagogue de Boghari
18 Septembre 1958:
Un père blanc, le père Juquet assassiné sur la route entre Sétif et Kerrata.
19 Octobre 1958:
A Lyon un abbé accusé d'être le responsable logistique du FLN local, se livre spectaculairement à la police. Il s'agit de l'affaire du Prado, les responsables du séminaire récoltaient les fonds des collectes FLN et les distribuaient aux détenus et à leurs familles, en fonction de critères basés sur leur grade dans le FLN.
25 Février 1959 :
L'armée libère l'abbé Rieser, qui avait été enlevé par le FLN.
Le tribunal des armées condamne l'abbé Berenguer, actuellement ambassadeur du F.L.N. en Amérique latine, par contumace à dix ans de prison.
11 octobre 1959 :
Grenade dans la synagogue de Bou Saada, deux morts dont une enfant de 5 ans, 5 blessés.
7 Janvier 1960 :
Un abbé arrêté à Alger pour servir de boite aux lettres aux réseaux terroristes
24 Mai 1960 :
L'abbé Kerlan, breton qui avait caché et aidé des terroristes est condamné à cinq ans de prison avec sursis.
18 Août 1960 :
Monseigneur Duval, évêque d'Alger refuse que l'on célèbre dans sa cathédrale une messe à la mémoire des deux soldats du contingent, Le Gall et Castera fusillés à Tunis par le FLN.
17 janvier 1961 :
Un aumônier tué dans une embuscade, égorgé et sa croix volée. Quatre jeunes filles de l'équipe EMSI, mesdemoiselles Djamila, M'barka, Christiane et Sadia ont également été égorgées.
30 Janvier 1961 :
Arrestation à Lyon de l'abbé Davezies, qui était en fuite.
3 décembre 1961
A Sétif, l'abbé Segalen curé de Tocqueville est tué par erreur par l'Aimée Française.
8 Mars 1962 :
38 attentats, 20 morts, 58 blessés. Parmi les plus représentatifs, le rabbin de la communauté juive à Mascara
9 Mai 1962 :
L'abbé Jacques Cerda, curé de Sidi-Moussa, a été enlevé le 9 mai 1962 par le FLN, considéré comme disparu par l'État français, jamais retrouvé par cet État, mais selon la Croix-Rouge longtemps après, supplicié, martyrisé, traîné de camp en camp et assassiné
13 mai 1962 :
Enlèvement dans le bled d'un instituteur, trois prêtres et trois colons.
10 novembre 1962 :
A Saint Cyprien des Attafs, les pères blancs PY et Chassine, sont retrouvés au bord du Cheliff, abattus d'une rafale de pistolet mitrailleur, retenus au bord de l'eau par des pierres, par un troisième père qui a pu se cacher.
..Et nous passerons sous silence, les Moines de Thibirine
DISCOURS DE ROBERT MÉNARD :
HOMMAGE AU PÈRE HAMEL
Le 26 juillet dernier; quelques jours à peine après l'attentat de Nice, la France basculait à nouveau dans l'horreur. Alors qu'il célébrait la messe, le père Jacques Hamel, 85 ans, était assassiné, non, était égorgé. Encore une fois par des islamistes. Nous n'étions pas à Mossoul, nous n 'étions pas à Alep, mais bien en Normandie, dans la petite paroisse de Saint-Étienne de Rouvray.
Oui, en France, chez nous. L'égorgement, ce rituel de l État islamique, faisait irruption au cœur de notre pays C'est vrai, on a du mal à imaginer la scène. Comment des jeunes gens, prétendument Tançais, ont-ils pu commettre un tel acte, dans un tel lieu ? Il nous a fallu prendre la mesure de l'horreur. On venait de mettre à mort un prêtre, dans une église, en pleine messe. Chrétiens ou pas, pratiquants ou non, chacun était visé, dans son coeur, dans son être.
On s'en était pris au sacré. La maison de Dieu avait été profanée. Ils avaient martyrisé un simple curé. Ils avaient martyrisé la France. On me répondra fraternité, ouverture à l'autre, vivre ensemble. Je vous avoue que j'ai du mal à y croire. On m'explique qu'il faut dialoguer; ne pas stigmatiser Mais dialoguer avec qui ? Avec ces islamistes qui égorgent ici quand leurs amis crucifient des chrétiens en Syrie ? Non, je tiens trop à ce pays, à ses clochers, à cette chrétienté qui a façonné notre histoire, nos paysages, tout notre imaginaire. je ne suis pas prêt à tendre l'autre joue, à me laisser faire. Je ne suis pas prêt à abdiquer devant la mort. Ironie de l'histoire, à Saint-Etienne de Rouvray, la paroisse avait offert, pour un euro symbolique, le terrain sur lequel la mosquée voisine a été construite... Quelle récompense !
À Béziers, modestement, il nous a semblé important d'honorer le père Jacques Hamel. Un vieil homme assassiné parce qu'il était catholique, parce qu'il était prêtre, parce qu'il était français. Quelle réponse, me direz-vous. La fermeté, bien sûr Le courage d'appeler par leur nom les assassins et la religion dévoyée dont ils se réclament. L'affirmation de ce que nous sommes. Mais aussi, un questionnement : et si, face à cette barbarie, nous étions un peu plus nombreux le dimanche à l'église, rassemblés autour de notre foi de notre culture, de nos racines ? Et si nous avions besoin d'un peu plus de sens, de transcendance ? Le père Hamel est un martyr. Il y a longtemps que nous n 'avons pas eu de martyr en France, la fille aînée de l'Église. Alors, chaque fois que vous emprunterez cette petite promenade, souvenez-vous de son visage, de son humanité, de sa grâce. Et priez pour son âme. Et pour l'âme de la France.
Béziers le 23 octobre 2016,
Robert Ménard inauguré
la promenade Jacques Hamel.
Sur la plaque on peut lire " Promenade Jacques Hamel, prêtre et martyr, assassiné par des islamistes, le 26 juillet 2016 par des islamistes dans l'église de Saint Etienne du Rouvray "
Ce soir j'ai mal, profondément mal. Après l'horreur de Nice, c'est un homme paisible de plus de quatre-vingt ans, un prêtre, un homme doux, un homme désintéressé, un homme de foi, qui a été lâchement et brutalement assassiné par un barbare de tout juste vingt ans, presqu'un enfant.
Une Vie, un symbole, un film de série B. Ces hommes ne peuvent se revendiquer d'aucune religion, ils sont les tristes marionnettes d'une sinistre mascarade, d'une vulgaire et odieuse pantomime qui n'a de sacré que ses oripeaux. Je me refuse à utiliser le terme d'islam à leur égard, ils sont bien autre chose, le religieux n'est chez leurs commanditaires que prétexte à manipuler les esprits faibles et désespérés pour semer chaos, détresse et conflits fratricides au sein de nos démocraties.
Nous devons lutter sans concession pour défendre la liberté, l'égalité et la fraternité qui unissent le peuple de France. La France est un grand pays reconnu depuis des siècles pour son intelligence et son courage. Notre cour saigne mais la force est en nous.
Rester dans la lumière du cour et de l'esprit nous permettra la victoire.
SOPHIE JOISSAINS
|
|
Des Vérités à rappeler
PUBLIÉ PAR MANUEL GOMEZ, LE 13 NOVEMBRE 2022
Envoi de Mme Saurel.
|
| Ce qu’on ne vous dit jamais sur les 132 années de la colonisation française de l’Algérie
Voici tout ce que les jeunes Algériens et Français devraient savoir sur ce qu’était «l’Algérie Française» et ses 132 années de colonisation, qui furent, selon le président de la République Emmanuel Macron, et tous les dirigeants de l’Algérie depuis 1962, une succession de «crimes contre l’humanité».
Le pays qui se nomme aujourd’hui « Algérie » n’était pas, avant 1830, un Etat constitué comme l’étaient la Tunisie et le Maroc. Ce vaste territoire était habité par un ensemble de tribus animées les unes envers les autres d’une hostilité que l’occupant turc entretenait afin de mieux régner.
Le sentiment de « Patrie » y était totalement ignoré.
Il convient d’ajouter :
Que la peste, la variole, le typhus, le paludisme, la tuberculose, le trachome, et d’autres maladies y régnaient à l’état endémique.
Qu’avant l’arrivée des Français, les plaines étaient pratiquement inhabitées car les cultivateurs ne pouvaient se mettre à l’abri des pillards, les nomades, éternels ennemis des sédentaires, qu’en se réfugiant dans les montagnes.
Que sur 220 millions d’hectares, l’Algérie n’avait que 11 millions d’hectares de terres cultivables, soit une proportion de 5%, et que c’est une grave erreur de croire que ces terres cultivables auraient été « réquisitionnées » par l’armée française pour les « offrir » aux colons car, sur ces 11 millions d’hectares, 9 millions, donc plus des trois-quarts, appartenaient à la population musulmane et seulement deux millions d’hectares aux colons européens.
Que la plus grande partie de ces deux millions d’hectares avaient été gagnés sur des terres incultes ou des marais mortellement insalubres. (A Boufarik, 30 kms d’Alger, de 1837 à 1840 on a comptabilisé 335 décès sur 450 colons installés.)
Que le vignoble algérien, créé par les colons européens, qui occupait 372.000 hectares, distribuait chaque année, entre 1950 et 1960, plus de vingt milliards de francs de salaires, et la plus grande partie à la main-d’œuvre musulmane.
Qu’il n’y avait qu’environ 20.000 « colons » sur les plus de un million d’européens qui peuplaient l’Algérie et que, sur ces 20.000 colons, un peu plus d’une centaine possédaient des propriétés de plus de 200 hectares, et environ 7000 pas plus de dix hectares.
Elle est bien loin l’image que l’Algérie était une terre d’une richesse fabuleuse (avant la découverte du pétrole) où des dizaines de milliers de colons tenaient en esclavage une population indigène dans une misère noire, comme la presse et les politiciens de gauche le faisaient croire aux « métropolitains » !
En raison de leurs méthodes archaïques, les agriculteurs musulmans n’obtenaient, au cours du premier siècle de la colonisation, dans la culture des céréales, que des rendements très inférieurs à ceux enregistrés par les agriculteurs européens. Quatre quintaux et demi à l’hectare au lieu de neuf.
Ce chiffre de 9 quintaux à l’hectare était très inférieur lui-même, à cause de la pauvreté du sol, aux rendements de la métropole, qui atteignaient de 23 à 25 quintaux à l’hectare.
Dès lors furent organisées des formations techniques des agriculteurs musulmans sur une grande échelle, par la création d’organismes nommés Secteurs d’Amélioration Rurale (SAR), en grand nombre dans le bled. Ils mettaient à la disposition des fellahs du matériel moderne et leur enseigner les méthodes rationnelles du travail de la terre.
Plus de 700 centres furent créés et aménagés, devenus ensuite des villages et même des villes, comme Sidi-bel-Abbès, Boufarik, Tizi-Ouzou, Bordj-bou-Arréridj, etc.
Outre les milliers de forages pratiqués dans les régions dépourvues d’eau, onze grands barrages furent construits, permettant d’irriguer plus de 140.000 hectares.
Il y avait en Algérie 1.180.000 européens qui n’étaient pas des colons mais des artisans, des employés, des ouvriers, des fonctionnaires, des commerçants, des médecins, des professions libérales, tout comme en métropole et, en dehors d’une classe privilégiée, tout comme en métropole, soit environ 15.000 personnes, le revenu moyen des Européens d’Algérie était inférieur de 20% à celui des Français de métropole.
L’enseignement primaire comptait, en Algérie, 12.000 classes, fréquentées par 523.000 enfants, dont 350.000 enfants musulmans.
L’enseignement secondaire était donné dans 51 lycées et collèges à 35.000 élèves, tant européens que musulmans.
L’université d’Alger, la troisième de France, comptait 5200 étudiants, dont 550 musulmans.
La formation professionnelle était offerte à plus de 12.000 élèves, composés des deux groupes ethniques.
Un décret de mars 1956, tenant compte du fait que les jeunes musulmans éprouvaient, en raison de certaines coutumes familiales, un retard dans leurs études, a reculé la limite d’âge les concernant dans tous les examens et concours.
Dans toutes les écoles, les enfants musulmans et européens étaient reçus sans aucune distinction.
La nationalité française avait été offerte à tous les musulmans algériens par un sénatus-consulte de 1865.
Une loi du 20 septembre 1947 proclamait l’égalité absolue des droits entre Français d’origine métropolitaine et Français-musulmans.
Cette loi de 1947 ordonnait que toutes les fonctions dans les administrations, les services publics, les armées et la magistrature soient également accessibles aux deux éléments ethniques.
Les Français européens payaient, à eux seuls, 80% des impôts directs, lesquels étaient consacrés pour 90% à l’amélioration des conditions de vie des populations musulmanes.
Les salaires agricoles étaient identiques pour les Européens et les musulmans, et cinq fois supérieurs aux salaires des musulmans des autres pays arabes. (Il n’y avait, en Algérie, que 9000 ouvriers agricoles européens, les dizaines de milliers autres étaient musulmans.
L’Algérie était, à l’époque, le principal client mais également le principal fournisseur de la France métropolitaine.
La France colonisatrice, c’était 150 hôpitaux avec plus de 30.000 lits (qu’occupaient neuf musulmans pour un Européen.), Un Institut Pasteur, et plus de 2000 médecins.
Un réseau routier de 80.000 kilomètres.
Un réseau ferroviaire de 4350 kilomètres.
32 aérodromes, 14 ports modernes, 16.000 kilomètres de lignes téléphoniques et une production électrique d’un million de kilowatts-heures.
Et il serait trop long de développer l’avenir qui était programmé pour l’Algérie par la colonisation française, par l’industrialisation du Sud et les découvertes, au Sahara, des poches de gaz naturel, l’existence de très importants gisements de fer, de cuivre, de plomb, de potasse, de tungstène, de nickel, d’étain, de chrome, d’uranium.
Le seul gisement de fer de Tindouf pouvait fournir dix millions de tonnes annuellement, ce qui dépassait largement les besoins de l’industrie française.
Les réserves en pétrole du Sahara étaient de même importance que celle du Vénézuéla, mais le sous-sol saharien avait bien d’autres richesses : ses nappes d’eau artésienne (l’une d’elles, dite de l’Albien, était d’une capacité de dix mille milliards de mètres cubes, à une profondeur d’environ quatorze cents mètres et une superficie supérieure à celle de la France ; plus le gaz de schiste, encore inexploité.
Le gouverneur M.E. Naegelen, devant l’Académie des sciences morales et politiques déclara :
«Le Sahara peut devenir demain une prodigieuse oasis qui étonnera le monde».
Depuis soixante années, le monde attend toujours que l’Algérie l’étonne !
Voilà donc «les crimes contre l’humanité commis par la colonisation française», pour le président Français Emmanuel Macron.
Moins de deux millions d’habitants en 1830, plus de dix millions en 1962, avec environ 230.000 naissances annuelles. Comme génocide, on peut faire mieux, n’est-ce pas le Turc Recep Tayyip Erdogan ?
|
|
| L'hiver
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
" Voici venir l'hiver haï des malheureux,
Qu'a chanté Richepin, le poète des gueux,
Un jour de mauvais temps et de mélancolie
Dans une lamentable et funeste élégie
" Me disais-je, en marchant sur le trottoir de fer
Du pont d'El-Kantara, dans la nuit d'avant hier,
Lorsque minuit sonnait.. Vrai. l'hiver me disais-je,
Avec sa fine pluie et son manteau de neige
N'est pas fait pour celui-là qui n'a pas de bois
En réserve, à brûler pour se chauffer les doigts
Tout gercés ou le dos tout bleu par la bise
Qui vous force à serrer le col de la chemise,
Tant ses baisers sont froids tant ils sont douloureux.
L'hiver décidément n'est pas fait pour les gueux !
Mais pour ceux qui sont dans une chambre chaude,
Close au vent furieux qui gémit et qui rôde
Comme un voleur vulgaire autour de la maison
L'hiver a bien son prix. C'est la chère saison
Où l'amour près du feu qui pétille et flamboie,
Fait entendre les cris étonnés de sa joie,
En voyant à travers les vitres, les flocons
De neige plus légers que les blancs papillons,
Tomber et s'amasser en formant sur la terre
Les immobiles plis du funeste suaire
C'est encore la saison où chaque soir, l'aïeul,
Que le poids des ans tient cloué sur un fauteuil,
A ses petits-enfants rayonnant d'innocence
Raconte les malheurs de notre pauvre France.
Et c'est encore le temps où pour tromper l'ennui,
Que se traîne, morose, aux pas lents de la nuit,
L'on s'attable gaîment autour d'un punch en flammes,
Et l'on cause des jours d'autrefois où les dames,
Belles aimaient d'amour le troubadour chantant
Et l'écolier ! Mais où sont les neiges d'antan ?
Où ma jeunesse ? Hélas ! Comme toi neige blanche,
Fondue ! Et maintenant courbé sous l'avalanche
Des jours, le front ridé, battu par l'aquilon
Je voudrais me coucher sur le mol édredon
Que tu fais en tombant lentement et sans trêve
O neige ! Et m'endormir dans un sommeil sans rêve !
M. Bonnell.
Les clochettes algériennes et tunisiennes (08-02-1903)
|
|
| De l'éducation des jeunes filles arabes
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Nous venons de lire, avec tout l'intérêt qui s'attache aux actes de persévérance de courage et de foi un Mémoire adressé à M. le Ministre de la guerre, par une femme dont le nom seul nous est connu, mais qui a éveillé toutes nos sympathies pour l'œuvre sainte dont elle poursuit la réalisation.
Avant tout nous éprouvons le besoin bien sincère d'appeler la sollicitude de l'administration centrale sur les faits et les vœux que forment l'objet du Mémoire de Mme Allix.
Jamais question d'un intérêt plus social ni plus fécond ne fut soumis à l'initiative du ministre. Peu de mots suffiront pour faire partager notre conviction à cet égard.
Mme Allix habite l'Algérie depuis quatorze ans, et il y en a dix au moins que l'idée lui vint pour la première fois, ainsi qu'elle le dit elle-même de consacrer ses connaissances spéciales et son habitude de la langue arabe à l'éducation des jeunes filles musulmanes.
C'était là une noble et grande tâche, et Mme Allix, sentant bien que dans cette voie où une main providentielle semblait l'entraîner, elle pouvait contribuer plus efficacement qu'une armée toute entière, non à la fusion, comme on l'a dit trop souvent, mais à l'association des deux races que la conquête avait mises en présence, Mme Allix se mit bravement à l'œuvre avec la conviction que l'aide du pouvoir ne lui ferait pas défaut dans l'accomplissement de ses projets.
De cruelles déceptions l'attendaient.
Espérer que l'administration algérienne exclusivement préoccupée de guerres de bulletins d'expéditions ruineuses comprendrait l'action lente mais assurée et irrésistible, que l'éducation des jeunes filles musulmanes devait exercer sur les sentiments les mœurs les usages des populations indigènes, c'était espérer l'impossible. L'évènement ne l'a que trop prouvé.
Mais laissons parler Mme Allix elle-même : " Vouée toute ma vie, dit-elle à l'enseignement, et admise dans l'intimité de nombreuses familles mauresques, j'étais plus à même que d'autres femmes européennes de tenter cet essai périlleux.
J'avais d'ailleurs cette conviction intime, bien justifiée depuis par nos guerres interminables que la civilisation serait sans effet tant qu'elle n'atteindrait pas l'intérieur de la famille, et je me sentais assez de courage pour vouloir rendre un grand service à mon pays, même au prix de quelques sacrifices. "
En effet Mme Allix n'hésite pas ; elle se consacre toute entière à la mission qu'elle se croit appelée à remplir. Elle a à sa disposition de faibles ressources péniblement et honorablement acquises, elle les emploie à poser les premiers jalons de l'établissement qu'elle rêve.
A force de caresses, de cadeaux, de visites, elle parvient à décider quatre pauvres familles à lui confier leurs filles. Elle prend ces enfants chez elle les habille, les nourrit, les instruit et continue avec un courage d'apôtre à visiter les famille mauresques, en accompagnant toujours ces visites d'une aumône ou d'une gracieuseté généreuse, en protestant surtout de son respect pour la religion musulmane.
De jour en jour, la confiance grandissait les défiances se taisaient devant cette conviction courageuse et profonde, et, peu de temps après l'établissement comptait treize élèves et les promesses de plusieurs familles permettaient d'espérer que ce nombre allait s'accroître dans une proportion considérable. Des personnes haut placées s'émeuvent de ce fait nouveau.
L'évêque d'Alger encourage Mme Allix, mais il se borne à des encouragements ; M. le comte Guyot, directeur de l'intérieur, prend un arrêté par lequel il permet à Mme Allix d'ouvrir son école à ses risques et périls.
Comme on le pense bien, avec des encouragements aussi immatériels et des autorisations si restrictives, la pauvre femme vit bientôt s'évanouir les faibles ressources financières avec lesquelles elle avait entrepris sa lourde tâche.
Et cela se comprend ; au lieu d'être payée de ses élèves, comme c'est partout l'usage, Mme Allix payait les siens c'est-à-dire qu'elle : les nourrissait, les habillait, les instruisait gratuitement et en outre payait de ses deniers à chaque famille la rétribution mensuelle de 2 francs que l'autorité locale à Alger alloue à chaque petit garçon qui fréquente l'école française.
Seulement l'autorité locale prélève cette allocation sur les fonds de la Mecque et Médine, et elle a trouvé fort jusque que Mme Allix l'aie prélevée sur sa bourse.
Le succès même des efforts tentés par la courageuse institutrice, rendait de jour en jour sa situation plus difficile, ses sacrifices plus considérables ; bientôt elle ne put qu'à l'aide d'emprunts usuraires subvenir aux besoins de ses élèves.
Elle écrit à monsieur le directeur de l'intérieur une lettre pressante, pleine de noblesse et de dignité.
Le lendemain même, le nombre des jeunes filles maures s'élevait à vingt-et-un le surlendemain à vingt-six et peu de jour après à trente.
Convaincue qu'en présence de pareils résultats si concluants si inattendus, l'autorité centrale ne pourrait hésiter à soutenir un établissement d'une utilité sociale si incontestable, Mme Allix use ses dernière ressources et son crédit ; elle prend un local plus vaste le meuble convenablement, s'adjoint pour sous-maîtresse, à un prix élevé, une des femmes les plus savantes de l'Algérie, la même qui fut autrefois l'institutrice d'Hussein-Dey.
Le 15 janvier dernier, M. Lepescheux et M. le comte Guyot vont eux-mêmes visiter l'établissement de Mme Allix ; ils y sont reçus par les deux sous-maîtresses arabes et quarante-deux élèves, à visage découvert, ce qui n'était pas la moindre conquête de l'institutrice. On admire : la tenue de l'établissement, la propreté des élèves, l'ordre la discipline ; on félicite, on complimente, on promet monts et merveilles et voilà la pauvre femme plus confiante et plus remplie d'espoir que jamais, surtout, quand peu de jours après, M. Lepescheux lui fait officiellement demander la note de ses dépenses.
Elles s'élevaient à 5.089 francs, et comment l'Etat qui nourrit annuellement 5 à 6.000 prisonniers arabes dont la moralité se pervertit dont les haines s'irritent dans la captivité comment l'administration, qui, en ce moment même, avait au bureau arabe, une somme de 16.000 francs sans emploi, auraient-ils pu hésiter à encourager une création qui, habilement développée, pourrait, dans les vingt ans d'ici, rendre toute armée inutile ?
Plus confiance que jamais Mme Allix attend et redouble d'efforts.
Le 23 janvier, huit jours après la visite officielle de M. le directeur de l'intérieur et M. l'inspecteur de l'instruction publique, ce dernier écrit à Mme Allix qu'on tient à sa disposition une somme de cent-cinquante francs ... quand la note de ses frais s'élevait à 5.089 francs !
Elle ne se découragea pas pourtant.
Elle refuse ce misérable et dérisoire secours qu'on avait eu le triste courage de lui offrir, et continue ses démarches plus activement que jamais.
Elle répond à M. Lepescheux, écrit longuement à M Foucher, directeur général par intérim, adresse notes sur notes, prières sur prières ; si nul secours ne lui arrive elle sera : obligée de fermer sa maison, de renvoyer ses élèves, de perdre en un jour de longs efforts de courageux travaux.
Ce n'est pas sans émotion que nous avons lu dans l'une de ses lettres à M. le comte Guyot ces mots partis de l'âme : " Dans l'espoir que quelques avances me seraient faites en attendant la décision du ministre, j'ai contracté des obligations ruineuses ; ces obligations ne peuvent plus se renouveler sans compromettre le bien de mes enfants, et c'est là un dernier sacrifice qu'il serait trop cruel d'exiger d'une mère. "
Elle écrivit cela le 28 janvier ; elle demandait 2.000 francs, sans lesquels elle était obligée de fermer sa maison le 1er février, et notez bien qu'il y avait 1600 francs oisifs et sans emploi au bureau arabe. Ni réponse, ni argent.
Le conseil d'administration doit se réunir le 1er février. Elle remet au président du conseil une protestation pleine de dignité, d'énergie, de concision.
M. Lepescheux devait ce jour-là faire son rapport au conseil sur la demande de Mme Allix. Par une fatalité trop explicable peut-être, le conseil n'est pas saisi de l'affaire. Trois jours plus tard M. le comte Guyot fait écrire à Mme Allix " qu'il lui est pénible d'avoir à annoncer qu'il lui est de toute impossibilité de disposer de la somme qu'elle demande, sans une autorisation expresse de monsieur le ministre de la guerre ; qu'il a appris avec un vif sentiment de regret sa subite détermination ; qu'il trouvait en effet dans son école naissante le germe d'un précieux établissement, etc., etc.
Pauvre courageuse femme ! Elle n'a pas désespéré, pourtant : ce qu'elle n'a pu obtenir à Alger, elle est venue tâcher de l'obtenir à Paris ; elle a adressé au ministre un mémoire plein de sens, plein d'une sainte et noble passion.
Nous avons confiance que le ministre, s'il lit ce rapide exposé, demeurera convaincu de l'utilité de l'importance sociale d'un établissement tel que Mme Allix l'a fondé, lui qui n'a pas hésité dans un but analogue, mais, à coup sûr moins fécond et moins pratique, à faire supporter à l'Etat les frais d'un collège arabe à Paris, création demeurée sans résultat.
Elever des jeunes filles arabes en faire des femmes musulmanes par la foi française par le cœur pénétrer par elles dans le sanctuaire de la famille, préparer ainsi l'association des deux éléments musulmans et chrétiens ; anoblir, grandir à ses propres yeux la femme orientale, attaquer ainsi dans leurs sources les fléaux désolants qui, dans ces malheureux pays, corrompent ou arrêtent violemment les germes même de la vie : c'est là une œuvre plus grande à nos yeux, que tout ce qui a été tenté jusqu'ici en Algérie.
L'intelligence administrative ira-t-elle jusque-là ?
Nous le souhaitons de tout notre cœur, mais quoi qu'il doive résulter des démarches de Mme Allix, nous sommes heureux de témoigner ici toutes nos sympathies à cette fervente apôtre pour la cause qu'elle a si généreusement embrassée.
L. J. L'Algérie courrier d'Afrique,
d'Orient et de la Méditerranée ( 02-03-1846)
|
|
LA REALITE
Envoyé par Eliane
|
La vie peut changer très rapidement ...
Ce matin, j’étais assis sur un banc à côté d'un clochard,
il me dit :
la semaine passée ,j'avais encore tout !
Un cuisinier faisait mes repas,
ma chambre était nettoyée, mes vêtements étaient tous lavés,
j'avais un toit au-dessus de ma tête, la TV-HD, l'internet,
j'allais à la salle de sport, à la piscine, à la bibliothèque,
je pouvais faire encore des études, du foot, du karting!!!..
Je lui demande :
Que s'est-il passé ? Drogue ? Alcool ? Femmes ? Jeux ?
Il me répondit :
Non, non... Je suis sorti de prison.
|
|
| Alger, Arabes et Mauresques
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Alger, assis en amphithéâtre sur le bord de la mer, présente trois villes ou trois aspects bien différents qui, selon moi, font son originalité et sa beauté.
Au centre est la ville française, à gauche s'échelonne sur la hauteur le quartier entièrement arabe, à droite sont le port et le quartier de la marine qui offrent tout le spectacle et le mouvement d'une ville maritime.
Au milieu de ces quartiers distincts circulent une population très variée : de types, de costumes et de couleur.
Ce sont : des Français militaires et civils, des Espagnols, des Allemands, des Mahonnais, des Nègres, des Négresses, des Juifs des Juives et surtout des Arabes et des Mauresques.
Je ne vous dépeindrai que ces trois parties féminines de la population, car vous vous ferez aisément l'idée des autres.
Les Négresses d'Alger, qui viennent généralement de Tombouctou, ont les traits grossiers. Elles portent toutes une pièce d'étoffe de couleur sur la poitrine, retenue par une ceinture, une jupe étroite ordinairement bleue et garnie d'une large rayure jaune et rouge enfin une longue draperie bleue sur la tête et le dos avec les bras et les jambes nus.
Les Juives ont ici comme à Constantine un corsage bordé, à l'emmanchure et au cou, par un galon d'or qui s'élargit en forme de cœur sur la poitrine ; leur jupe est tantôt de la couleur du corsage, tantôt d'une couleur différente ; et elles ont invariablement pour chaussure de petites pantoufles quelquefois en velours brodé d'or, toujours pointues et sans quartiers, avec lesquelles il faut une grande habitude pour marcher. Leur coiffure est un mouchoir de soie qui maintient les cheveux noués sur le derrière de la tête et dont les deux bouts, tissés d'or ou d'argent, retombent sur le dos. Et souvent, un morceau de tulle ou de gaze est censé leur cacher le bas de la figure.
Malheureusement pour le voyageur, les Juives d'Alger se francisent et elles portent presque toutes : un châle, des bas et des gants.
Les jeunes filles sont mises de même ; seulement leur coiffure, tant qu'elles ne sont pas mariées, est une petite calotte pointue, coquettement placée sur un côté de la tête, et formé par des galons d'or ou des rangs de sequins, avec un gros gland en or ou en soie.
Les Mauresques d'Alger, qu'il est plus juste d'appeler les Mauresses ont des habitudes et un costume différent des autres femmes arabes.
Elles se promènent seules et continuellement par la ville ; mais, comme la religion musulmane prescrit à la femme de se conserver entièrement à son mari, lorsqu'elles sortent, elles s'affublent toutes d'un large pantalon blanc descendant jusqu'au-dessous du mollet.
Elles recouvrent leur tête, jusqu'à moitié front, d'un long voile également blanc (foutah) que leur main retient croisé sur la poitrine et une pièce d'étoffe (rdjar), attachée au-dessus des oreilles, leur cache le bas de la figure jusqu'aux yeux que l'on voit briller sous leurs grands sourcils noirs. A ces yeux, seuls visibles, il faut reconnaître si la femme est jolie ou ne l'est pas ...
Du reste, ces dominos blancs ou ces petits fantômes, que l'on rencontre à chaque pas, se laissent assez complaisamment examiner tout en vous examinant curieusement vous-même.
Si vous voulez visiter la métropole avec moi, nous allons d'abord grimper au quartier arabe. Il y a derrière le théâtre un escalier monumental qui y monte en zigzags ; mais je préfère suivre les rues pour voir leur caractère.
La transition entre la ville française et la ville arabe est occupée par des boutiques juives garnies : de cotonnades de couleur et de babouches, de savates et de souliers plus ou moins brodés pour les indigènes ou bien par des boutiques de boulangers arabes.
Ces derniers embarrassent souvent le chemin avec des planches sur lesquelles ils placent leurs petits pains ronds et leurs galettes qu'ils font cuire dans un four toujours ouvert, car à peine ont-ils fini d'enfourner qu'ils retirent les premiers mis.
Ils les jettent alors en tas par côté où de petits Arabes de bonne figure les prennent et les alignent sur une planche qu'ils portent très adroitement sur leurs têtes dans les boulangeries ou par la ville.
Ensuite, on monte continuellement par des rues étroites et en pente, qui sont pavées de petits grès noirâtres très glissants sur lesquels les Arabes seuls courent pieds nus et sans danger.
Les quartiers qui ont le plus conservé le caractère étranger sont ceux : de Sidi-Abdallah, de Sidi-Mohamed-Chérif et la rue de la Casbah ainsi que celles qui y aboutissent.
Là toutes les maisons ont l'étage supérieur avançant en saillie sur la rue et supporté par des travons et de grosses perches rondes, plus ou moins régulièrement fichées dans le mur en manière de consoles ; et tout cela est recouvert d'un blanc et hygiénique lait de chaux.
En certains endroits, soit pour intercepter entièrement l'ardeur du soleil soit parce que les consoles ont fléchi, les maisons se joignent par le haut s'appuient les unes contre les autres et forment une voûte sombre où percent seulement quelques rayons de lumière.
Cette demi-obscurité abrite de nombreuses toiles d'araignées en même temps qu'elle favorise la trame des intrigues amoureuses, comme vous allez le voir avec moi tout à- l'heure.
Je m'étais assis pour dessiner dans une petite rue qui aboutit à celle de la Casbah. Elle est solitaire comme la plupart des rues de ce quartier, car là, il n'y a : ni boutiques, ni fenêtres mais des portes presque toujours closes ; et les femmes mauresses qui sortent pour se promener ou faire des emplettes descendent toute la ville française. Seulement, à de longs intervalles, il avait passé, longtemps précédée par une voix perçante, une Négresse portant sur sa tête une corbeille de petits pains sans levain, et s'arrêtant par moment en criant : " Sordi ! Sordi ! (Un sou ! Un sou !) "
Alors une des portes s'était entrebâillée ; deux petits Arabes avaient paru ; le plus jeune était aussitôt rentré en m'apercevant ; mais l'autre s'était curieusement assis devant moi, puis, sans que j'en comprisse la raison, s'était brusquement enfui.
Ensuite, j'avais vu sortir d'une autre maison une jeune Mauresse, suivie d'une vieille femme aussi laide que la première semblait jolie.
Celle-ci en me voyant dessiner, s'approcha, et me montrant sa figure avec un gracieux geste de la main, elle me dit, en riant, quelques mots que je ne compris pas mais qui probablement me demandait si je voulais faire son portrait.
Je lui fit signe que oui ; mais la duègne qui l'accompagnait : la bourra, la poussa et lui fit continuer son chemin avec tant d'effroi et d'insistance, qu'elle n'eut pas le temps de me répondre. Puis la rue demeura déserte et silencieuse un très long temps.
Plus tard il survint un Arabe assez simplement mis qui paraît être un serviteur, il suit et inspecte attentivement la rue, il m'amine avec une sorte d'inquiétude, puis il s'engage dans la partie sombre formée par le surplomb des maisons ; là il s'arrête regarde ou écoute et revient sur ses pas.
Un moment après je le vois revenir avec un grand Nègre et avec un Arabe enveloppé dans un burnous brun à glands rouges et à ganses d'or qui semble être le maître des deux premiers.
L'Arabe ralentit sa marche le Nègre le précède et va jusqu'à une petite porte qui a une grosse pierre pour escalier ; il frappe dans ses mains d'une certaine manière, la porte s'ouvre, et alors le chef resté en arrière avance à grands pas, entre seul et la porte se referme.
Je ne sais pas si je me trompai, mais je crus voir là un rendez-vous d'amour pendant l'absence d'un mari ...
Maintenant que je vous ai montré l'aspect des rues et l'extérieur des maisons mauresques, si vous êtes accompagné par une personne assez puissante pour vous faire pénétrer dans l'intérieur des habitations et des familles, ce qui n'est pas très facile, vous verrez ceci :
Dans une petite cour à ciel ouvert, carrée et entourée de plusieurs étages de galeries à arcades supportées les unes au-dessus des autres par des colonnes de marbre plus ou moins sculptées et luxueuses ; il y a ordinairement, ou une fontaine jaillissante ou un palmier ou un bananier dont l'épais feuillage amortit l'ardeur du soleil.
Sous l'ombre ou sous la fraîcheur de l'arbre ou de la fontaine, des femmes mauresses sont couchées ou assises sur un tapis : Causant, recevant des visites ou prenant des sorbets.
Elles ont alors la figure découverte et portent leur beau costume, qui se compose de vêtements de soie de satin et de gaze brodée d'or, avec de nombreux colliers et bracelets.
Dans la cour sous les galeries et autour des colonnes, courent et jouent les enfants de tous âges ; tandis que le mari arabe, ou plutôt le maître qui cependant est moins maître dans sa maison qu'on ne le croit, car il entre rarement dans l'appartement de ses femmes sans les faire prévenir et sans leur en demander, en quelque sorte, la permission, tandis que le mari, dis-je, se tient accroupi dans une de ces niches cintrées qui sont ici ménagés dans les murs. Là, il fume à l'ombre son narghilé, en promenant sur sa famille ses yeux calmes satisfaits ou jaloux, suivant la disposition morale de ses pensées. Tel est l'intérieur des habitations mauresques.
Mais, lorsque le mari arabe consent à y vois laisser pénétrer, quatre fois sur cinq ses femmes auront revêtu leur domino blanc ; et encore, en sa présence, cacheront-elles devant vous leurs yeux avec un coin de leur voile.
Après avoir exploré ainsi le quartier arabe, je monte au haut de la ville par une rue rapide glissante et souvent coupée par des voûtes ; puis, en dehors d'une espèce de porte autrefois fortifiée, je me trouve aux pieds de hautes murailles de la Casbah, l'ancienne citadelle du Dey.
C'est un épais massif de maçonnerie en briques et en terre irrégulier immense percé de nombreuses meurtrières et couronné de créneaux.
J'y pénètre par une large porte voûtée ; et en circulant dans ces vastes constructions, occupées militairement mais ouvertes à tout le monde pendant le jour, je rencontre un chemin planté d'arbres ; je passe : devant une fontaine mauresque, devant des masures en terre, des casernes, des cantines ; je traverse une place encombrée de canons ; et en suivant une espèce de rue montante et sinueuse, j'arrive au donjon au point culminant de la casbah.
Sur cette haute terrasse je ne trouve qu'un poste d'artilleurs qui s'amusent à contrarier un singe enchaîné au mur et de longues pièces de canons qui garnissent les embrasures. Mais par ces embrasures je découvre une vue magnifique. J'ai au loin bien au-dessous de moi, la pleine mer avec son immensité imposante, sur laquelle quelques grands navires apparaissent comme des points blancs ; et, à mes pieds, le port et la ville tout entière avec : ses toits ses terrasses en gradins et ses éblouissantes murailles blanches.
Lorsque j'ai promené mes regards sur ce beau panorama, je descends, et je fais le tour d'Alger en suivant en dehors de son ancienne enceinte, qui est, ou plutôt était car on l'a récemment démolie, une suite de hautes et épaisses murailles en briques et en terre, descendant de la Casbah jusqu'à la mer en formant une longue ligne de créneaux en escaliers.
De ce côté l'aspect change sans cesse d'être joli : l'on découvre la campagne, et elle présente de riches vallées formées par de grandes ondulations de terrain sillonnées par de nombreuses routes et animées par de nombreuses maisons de campagne.
A gauche est : derrière le Fort l'Empereur le Village d'El-Biar à droite sur le bord de la mer celui de Saint Eugène et, de l'autre côté de la montagne Sidi-Ferruch où les Français débarquèrent en 1830.
Tout en descendant avec la pente de la ville par un sentier très rapide, je vois une petite mosquée très jolie : elle est toute incrustée de carreaux bleus vernis et son minaret est formé par des colonnettes sculptées ; puis, je rencontre et je traverse le jardin Marengo. C'est une pittoresque et agréable promenade publique, garnie de dattiers d'arbustes et de toute sorte de fleurs des sentiers escarpés des jets d'eau de terrasses et de kiosques rustiques.
Je me repose quelques instants au pied d'une colonne dédiée à l'Empereur avec les noms gravés de ses victoires ; puis, je descends toujours, et après avoir passé devant un grand pavillon destiné aux concerts des dimanches, je sors du côté de la cité Bugeaud et je rentre dans la ville par la rue Bab-el-Oued.
Ici je dois vous dire qu'Alger est traversé d'un bout à l'autre, ou plutôt d'une porte à l'autre, par une rue centrale garnie d'arcades couvertes et de magasins français ; Cette rue s'appelle du côté du Nord Bab-el-Oued et du côté Sud Bab-Azoun.
Dans son milieu cette route rencontre la place du gouvernement, où se voient une promenade de grands orangers en pleine terre et une statue équestre du duc d'Orléans : du côté de la mer il n'y a pas de maisons, la place forme terrasse sur le port et il y a, sans cesse accoudés sur la balustrade de pierre, de nombreux flâneurs qui regardent partir ou arriver les navires.
Pour moi, en continuant mon chemin dans la direction du théâtre je rencontre de larges escaliers ; je monte et j'arrive à la place de Chartres, moins belle que la première mais également orné de portiques et d'une fontaine jaillissante. Et c'est la dernière chose que je visite ce jour-là.
3 juillet
Le matin, je descends au port par un escalier qui conduit sur le bord de la mer et je suis un très large quai qui règne au bas des maisons d'Alger et qui est encombré de filets de pêcheurs et de marchandises.
Plus loin est la magnifique terrasse appelée boulevard de l'Impératrice.
Au Nord le port est fermé par une épaisse et haute muraille, et à l'Est, par un retour de rochers sur lesquels sont construits les bâtiments et magasins de la marine.
C'était là l'ancien port des Turcs ; mais depuis l'occupation française, sa grandeur a considérablement augmenté par des jetées qui s'étendent en face de la ville et dont l'une, en demi-cercle pour briser les lames et faciliter l'entrée du port, n'a pas produit tout le résultat attendu.
Quoi qu'il en soit, le port est très vaste et très bien défendu par trois fortes batteries : celle de Bab-Azoun, celle du Centre et celle de l'Amirauté.
En suivant toujours le large quai bordé de barques de bateaux à vapeur et de vaisseaux à voiles je rencontre le bâtiment de la Santé établi sur le port le logement et le pavillon de l'Amiral et le quartier de la marine : quartier où je ne vois que des canons turcs réformés et fichés en terre en guise de bornes d'amarre des matelots au travail ou en promenade des chantiers de construction et des officiers de marine.
Après, je passe sous de basses et larges voûtes que forment une galerie sombre au-dessus de laquelle sont construits les bâtiments de l'Amirauté ; et ensuite, j'arrive au phare, haute et massive tour qui s'élève au-dessus des magasins à poudre et d'une formidable batterie.
Je monte par un escalier intérieur, à la plate-forme du phare où je ne rencontre qu'un vent très violent et des poules, celles-ci vivant en compagnie du matelot de garde qui signale l'arrivée ou la vue en mer des gros navires et vapeurs.
D'ici, Alger s'aperçoit en entier et c'est, selon moi, son plus joli côté.
A gauche sur les hauteurs sont le Fort l'empereur et la Casbah qui couronne l'amphithéâtre de maisons blanches du quartier arabe ; au bas, la ville française la terrasse de la place du gouvernement les coupoles et les minarets des mosquées.
Puis s'étendent à droite la cité Bugeaud le fort neuf, baignant la mer et au loin le village de Saint-Eugène ; enfin en face de la ville le port avec toutes ses batteries et ses navires.
Après avoir vu et dessiné tout cela, je reviens au centre de la ville par la rue de la Marine, et après avoir traversé la place du gouvernement, je visite l'église la cathédrale, qui est grande mais n'a rien de remarquable, et j'entre à l'Archevêché qui est en face d'elle.
C'est une construction entièrement arabe, sans apparence extérieure, mais très belle intérieurement. La cour, recouverte par un grand vitrage, est tout en marbre blanc richement sculptée, piliers colonnes et escaliers ; et les balustrades des galeries supérieures sont des boiseries, je crois en ébène, très finement et adroitement découpées.
Comme le palais du gouvernement est à côté de l'église, je ne passerai pas sans vous le faire connaître en quelques mots.
Extérieurement, il a une façade arabe, avec des fenêtres ogivales peinturées d'une bordure de couleur ainsi que les guérites des factionnaires ; intérieurement un large escalier conduit à la cour centrale, très jolie et très riche en colonnes de marbre doré et en boiseries sculptées ; ce qui contraste avec les balustrades supérieures qui sont peintes en rouge en bleu en vert et en jaune.
Au rez-de-chaussée de cette cour luxueuse sont les salons de réception, joignant une longue galerie dont le plafond est une suite d'arabesques dorées et en saillie, et dont le meuble et les tentures sont en damas algérien avec les portraits en pied de l'Empereur et de l'Impératrice encadrés dans les draperies soyeuses.
Il est facile de se faire l'idée de la beauté et de l'originalité d'une fête de nuit dans ces appartements orientaux éblouissants de marbre de dorures et de couleurs variées et pittoresques.
Au premier étage se voit encore l'ancien salon du Dey précédé d'une anti-chambre toute en vitrage et donnant sur la cour. L'on entre dans ce salon par une large arcade ogivale ornée en dessous de peintures de fleurs d'oiseaux et d'arabesques ; le plafond est tout en dorure le plancher en carreaux vernis les meubles sont à panneaux arabes sculptés en zigzags et dorés et sous des espèces de voûtes ou de niches ogivales très gracieuses règnent des divans de satins, surmontés de belles glaces de Venise. Les appartements particuliers notamment la petite salle à manger sont tout arabe et conservent un caractère assez curieux.
De la place où donnent : l'église, l'évêché et le palais du gouverneur, l'on peut entrer dans le bazar algérien où se vendent tous les objets du luxe indigène.
C'est un long passage : garni de boutiques de soieries rayées et brochées d'or ou d'argent, de burnous de toutes les couleurs, de savates, de pantoufles, de babouches brodées d'essences orientales, de plats et de brûle-parfums en métal ciselé, de bijoux, de bracelets de colliers pour les femmes mauresses enfin d'œufs d'autruche, d'éventails et d'étagères algériennes de tabacs étrangers, de blagues en maroquin parfumé, de pipes en racines de caroubier, de toutes sortes d'armes arabes et de double bottes rouges pour les cavaliers.
Au centre du bazar est une rotonde (le Bezeistein) qui est occupé en grande partie par les tailleurs qui confectionnent ces riches vêtements brodés avec des soutaches d'or ou de soie de couleur ; et c'est là que se fait, à certaines heures, la vente à l'enchère des objets arabes en promenant la marchandise au milieu des groupes d'acheteurs.
Inutile de dire que les marchands sont Juifs, car l'on doit se rappeler que les Arabes méprisent autant le commerce qu'ils méprisent ce peuple commerçant.
Mais néanmoins, depuis l'occupation française ils sont forcés - à leur grand regret - de traiter équitablement les Juifs et de compter avec eux comme avec tout autre, car ils sont devenus leurs égaux devant nos lois ; et c'est là je crois, la seule chose que les Arabes regrettent de la domination des Turcs.
Avant de retourner à l'hôtel, je visite un café maure. Ces cafés sont fréquentés à Alger comme en France par les oisifs qui passent leur temps à causer à jouer au riddez ou bien à ne rien faire que prendre à de fréquents intervalles la liqueur noire, sans sucre et dans de petites tasses sans soucoupes.
Quelques-uns de ces établissements sont décorés d'arabesques et assez luxueux ; tous ont autour des murs un large rayon, plus ou moins garni de nattes et de tapis sur lequel les clients montent après avoir quitté leurs chaussures - et se tiennent assis les bras croisées.
Là ils fument, ils causent entre eux ou le plus souvent restent toute la journée sans rien faire et sans penser : absorbant silencieusement de nombreuses tasses de café, que leur apportent un Nègre ou un jeune Arabe dans de petites cafetières à long manche qui contiennent chacune la mesure d'une tasse.
Les Arabes auxquels la loi de Mahomet défend expressément l'usage des liqueurs sont très heureux d'avoir trouvé dans l'infusion de moka une défaite pour satisfaire leur gourmandise, car ils ne voient pas là une boisson enivrante.
Au commencement quelques disciples fervents de l'Islamisme désapprouvèrent la liqueur nouvelle ; mais bientôt les goûts sensuels des Musulmans l'emportèrent sur l'esprit religieux, et la liqueur fut admise comme n'étant pas fermentée...
Aussi on doit se rappeler que le café fut introduit en France par un ambassadeur turc, Soliman, Aga en 1669 et qu'il était en usage dans l'Orient (bien avant Mahomet) depuis 1258, époque à laquelle un muphti arabe de Moka, voulant prolonger ses prières et ses veilles plus que les Derviches les plus dévots, imagina de boire des infusions des fruits du caféier dont il connaissait l'effet irritant sur les chèvres qui en mangeaient dans la montagne.
Puis, il fit religieusement part de sa découverte à ses disciples.
Mais le pieux expédient du saint homme fut dénaturé ; car, le goût de cette boisson était trouvé bon, l'usage s'en répandit bien vite chez : les Turcs, les Persans, les Arméniens dans un but uniquement profane ...
Ici, je ferai une remarque, c'est que les Arabes d'Alger conservent au physique la trace évidente du séjour prolongé des Turcs parmi eux.
Ils ne ressemblent pas aux Arabes des autres localités.
Ils ne portent plus sur la tête le haïk serré avec une corde et formant la coiffe bédouine, mais généralement le turban et la veste turc.
Ils ont plus d'embonpoint, sont moins grands et moins nerveux ; ils ont la figure grasse, souvent boursouflée et sans barbe comme les Osmanlis ou bien hâve, avec des yeux fixes ronds et une barbe hérissée comme les anciens pirates du Riff.
Charles Carteron. Voyage en Algérie (1866)
|
|
| Les Berbères en Algérie
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Les vrais indigènes de l'Afrique du Nord, ce sont les Berbères. Mais en Algérie la plupart ont oublié leur langue et leurs origines.
Tous ceux qui n'étaient pas cantonnés dans les montagnes ou perdus dans le Sahara lointain tous ceux que n'isolait pas leur position géographique ou un plus âpre amour de l'indépendance, se sont mélangés et confondus avec l'envahisseur arabe.
En 1859, les idiomes berbères n'étaient plus parlés que par 850.000 hommes, (Voir Hanoteau, grammaire temacheq) et depuis ils ont encore perdu du terrain.
Pour retrouver cette race, qui n'a plus conscience d'elle-même, il faut aller la chercher dans ses derniers refuges, dans la Kabylie, si longtemps impénétrable, dans les massifs de l'Aurès dans la Chebkha du Mzab.
Il existe deux types de Kabyles ( parmi les nombreux ouvrages concernant les Kabyles on consultera surtout avec fruit le livre de MM. Letourneau et Hanoteau, devenu classique, et l'étude intéressante de M. Devaux, les Kabaïles du Djurdjura) : l'un blond ou roux avec un teint blanc et des yeux clairs, l'autre à peau noire, la barbe et les cheveux noirs ; on remarque davantage le premier qui fait travailler les imaginations ; le second est de beaucoup le plus fréquent.
En général les formes sont : Massives, la tête carrée, les traits gros. Ces paysans n'ont pas la finesse de race des Arabes, mais leurs allures sont plus naturelles et leur physionomie plus vivante. Nulle prétention à l'élégance : une méchante chemise d'étoffe commune, le thadjellabt, constitue à peu près le costume ordinaire ; en voyage, ils endossent le commode burnous, à la fois : manteau, couverture et garde-manger.
Pour la guerre ils se plastronnent du tabenta, le tablier de cuir qui leur valait, avec les plaisanteries de nos soldats, le surnom de cordonniers.
D'ailleurs ils ne tiennent pas à leurs habitudes ; dans nos villes ils adoptent volontiers le pantalon et la blouse de l'ouvrier européen. Ils ne cherchent pas à se draper ou à prendre des pauses ; la propreté même leur est indifférente.
Même absence de recherche dans leur alimentation ; les Arabes se moquent de leurs couscous noir apprêté avec de l'huile rance ; ils mangent peu de viande, beaucoup de légumes et de fruits ; cela coûte moins cher ; les pauvres gens de la haute montagne ne se nourrissent guère que de farine de glands.
Dans ce pays tourmenté, aux hivers prolongés et rigoureux, la vie nomade ne serait pas possible.
Le Kabyle n'habite pas sous la tente, il se bâtit des maisons en pierre. Sur les crêtes rocheuses où on les a perchés pour ménager la bonne terre et défier les surprises, leurs villages se détachent tout blanc dans le bleu profond du ciel ou le gris sombre des nuages.
De loin l'aspect est pittoresque ; mais si l'on s'approche, on retrouve là toute la malpropreté des douars de la plaine.
Pas de rues, des ruelles étroites encombrées de débris de fumier les maisons ne sont que des huttes mal couvertes par des toits en chaume pourri ; ce sont aussi des étables :
Les bestiaux y habitent avec la famille, à peine séparés par un mur d'un mètre ; en hiver quand tout est clos on se demande comment la vie est possible dans cet air vicié où la fumée du foyer se mêle à l'odeur des bêtes et des gens.
Aussi se tient-on le plus possible au dehors.
Les femmes elles-mêmes ne sont pas condamnées à toujours rester au logis ; plus libres d'allure que les femmes arabes ; elles mangent en présence du mari ; elles se montrent à visage découvert, elles vont et viennent par le village ; une partie de leur temps se passe à la fontaine, qui est leur lieu de réunion, leur salon de conversation.
Mais elles ne méritent pas le reproche d'oisiveté : outre les soins du ménage, elles mettent la main à la grosse besogne, cultivent les jardins potagers.
Hommes et femmes, les Kabyles n'épargnent pas leur peine ; ils ont affaire à un sol ingrat qui demande beaucoup et donne peu.
Mais rien ne rebute ces durs travailleurs : quand les terrains sont trop déclivés pour qu'on puisse s'y tenir d'aplomb, ils s'attachent à des cordes et, suspendus par la ceinture, labourent à la pioche.
Ce sont de pauvres récoltes que celles qu'ils gagnent ainsi, ils ne vendent pas de céréales, à peine en ont-ils assez pour eux.
Les arbres, la vigne et surtout l'olivier leur donnent davantage. Ils s'arrangent pour avoir peu de besoins, fabriquent eux-mêmes : leurs étoffes, leurs poteries, leurs bijoux, leurs armes, leur poudre.
Ils s'ingénient à trouver des ressources : élèvent des abeilles, font du miel, de la cire, de l'huile.
Autrefois ils faisaient de la fausse monnaie, qu'ils écoulaient ensuite en pays arabe.
Ils s'entendent au commerce et aux échanges avantageux ; ils vont par caravanes ou isolément trafiquer dans les marchés du Tell.
Les iataren, les colporteurs, forment chez eux une corporation nombreuse qui vit gaiement de ses profits de hasard.
Tous les ans ils descendent par milliers, louent leurs bras pour la moisson, s'emploient dans les fermes et les exploitations européennes.
Comme nos Auvergnats et nos Savoyards, ils rapportent au pays le petit pécule amassé dans la plaine. A première vue l'organisation ressemble assez avec celle des Arabes. La kharouba, la famille, est un groupe assez étendu d'hommes du même sang ; plusieurs kharoubas forment le touffik ou hameau ; la réunion des touffiks constituent le village, thaddart.
Chaque tribu comprend plusieurs villages et s'associent avec d'autres en confédération, takebilt. Mais cette ressemblance est toute extérieure ; la tribu kabyle n'a qu'une existence factice, purement politique ; elle ne constitue pas un ensemble compact ; les parties qui la composent conservent leur existence propre et ne se laissent pas absorber.
La véritable unité, c'est le thaddart, la commune kabyle ayant, comme les petites cités anciennes : son esprit exclusif, son patriotisme de clocher et ses orages intérieurs.
Avant 1871 quand la Kabylie possédait encore ses institutions municipales, la vie publique y était très intense. Chaque village avait son forum où s'assemblaient dans les comices armés tous les hommes valides ; là se discutaient : les affaires d'intérêt local ou général, les alliances, les traités, les déclarations de guerre.
Des élections tumultueuses désignaient : l'amin chargé d'administrer le thaddart en temps de paix de conduire les contingents si l'on avait à combattre.
Tous ces débats étaient suivis avec une ardeur passionnée, les arguments s'assaisonnaient d'injures, et bien souvent les séances finissaient à coup de fusil.
Les partis étaient constitués, la majorité allait de l'un à l'autre suivant l'occasion ; le plus faible pour n'être pas écrasé, prenait des points d'appui au dehors.
Il se formait ainsi des ligues dans la tribu dans la confédération ; la Kabylie toute entière se trouvait ainsi divisée en cofs. Les membres d'un même cof se devaient un mutuel appui se soutenaient réciproquement avec un dévouement aveugle. " Aide les tiens, dit un adage kabyle, qu'ils aient tort ou raison ! "
Les Kabyles sont musulmans, mais non pas tout à fait à la manière arabe.
En matière civile, le droit coutumier des Kanoun a plus d'autorité que le Coran ; ils avaient aussi au temps de leur indépendance toute une législation pénale absolument distincte.
Ils se soumettent aux prescriptions de la loi religieuse, non sans se permettre un peu de contrebande.
Il y a beaucoup de sangliers dans leurs montagnes, mais le Coran défend comme impure la chair de cet animal. Voici le subterfuge qu'ils ont imaginé : " L'interdiction, disent-ils, ne s'applique pas à l'animal entier mais seulement à une partie. Laquelle ? C'est ce que le législateur n'a pas précisé. "
Quand ils dépouillent un sanglier ils coupent un morceau de viande et le jettent au loin, en priant Dieu de leur pardonner s'ils n'ont pas mis la main sur la partie défendue. Cela fait ils mangent le reste en toute tranquillité.
Ce ne sont pas là des plaisanteries de libres penseurs ; les peuples les plus croyants ont de ces compromis entre leurs appétits et leur conscience.
Les Kabyles n'en sont pas moins très attachés à l'islamisme : ils le prouvent bien en nourrissant dans leur pauvre pays tout un clergé régulier, les marabouts, comparables à des moines, mais à des moines qui feraient souche.
Dans ces familles privilégiées, la sainteté est héréditaire et aussi tous les avantages temporels qu'elle comporte.
Au temps de l'indépendance, les marabouts n'étaient pas tenus de porter les armes ; ils étaient exemptés de presque toutes les contributions.
Maintenant encore, rien d'important ne se décide sans leur avis ; quand ils daignent parler, on les écoute avec déférence.
Epars dans les villages ou groupés dans leurs zaouïas, ils vivent grassement d'aumônes et d'offrandes. Le Kabyle, si intéressé d'ordinaire, ne compte pas avec eux ; il a trop peur de les offenser et d'attirer sur sa tête leur malédiction.
Son avarice est grande, mais sa superstition est la plus forte. Le pauvre diable croit à tout : aux amulettes, aux maléfices, aux sortilèges.
Aussi se laisse-t-il facilement fanatiser ; les prétendus chérifs, Bou-Baghla et les autres, n'ont pas eu besoin de jongleries bien compliquées pour frapper les esprits et attester par des miracles la vérité de leur mission.
Les montagnards de l'Aurès sont les frères des Kabyles. (Voyage sur l'Aurès et ses habitants les études de M. Masqueray publiées dans la revue africaine et la notice des Aoulad-Daoud du même auteur).
Leur idiome le tamzira et le zenatia, sonnent à peu près comme celui du Djudjura ; ce sont bien les dialectes d'une même langue.
La conformation physique est semblable : les types blonds se rencontrent en grand nombre. Là aussi les envahisseurs étrangers : Romains, Arabes, Turcs se sont heurtés à d'énergiques résistances ; à part un seul groupe, celui des Ouled-Zeian, toutes les tribus : Oudjana, Ouled-Daoud, Ouled-Abdi, Achèches, Beni-Bou-Slimane ont une filiation berbère bien établie.
La conquête française en introduisant avec la langue arabe la législation musulmane, a effacé les institutions locales ; mais elle ne les a pas entièrement abolies, et ce qui en subsiste, ce que nous en connaissons rappelle les lois les mœurs l'état social de la Kabylie.
L'Aurès avait : ses communes et ses djemâas ses tribus administrées par des conseils d'imokhrane, ses confédérations divisées en cofs, toujours en lutte les unes contre les autres.
Des kanouns particuliers réglaient : la vie civile, les mariages, les divorces, les successions.
Le droit pénal était un droit coutumier, admettant presque toujours des compensations pécuniaires ; chaque délit était tarifé ; dans quelques localités, le meurtre même était puni d'une simple amende, analogue à la dia kabyle.
L'islamisme n'allait pas sans un cortège de cérémonies et de superstitions locales, plus anciennes que lui.
Aujourd'hui encore, les Aurasiens célèbrent aussi solennellement que les grandes fêtes musulmanes : le Bou-Ini ou bonne année le Innar (janvier), la fête du printemps, la fête de l'automne, usages romains juifs chrétiens souvenirs persistants des cultes oubliés.
Comme en Kabylie les villages sont bâtis sur les crêtes dans des positions dominantes qui surveillent tout le bas du pays.
Des tours encore debout, observatoires où les vedettes interrogeaient l'horizon, révèlent la préoccupation de la défense ; les maisons se groupent autour de la guelâa, sorte d'acropole rustique, à la fois forteresse et entrepôt.
Le sol de l'Aurès est plus pauvre encore que celui de la Kabylie ; la culture ne suffirait pas à nourrir les habitants, mais les pâturages se trouvent en abondance et selon les saisons, tantôt le long des oueds tantôt sur les croupes et les sommets ; les troupeaux sont donc d'élevage facile, ils constituent la vraie et presque la seule ressource.
Aussi les maîtres n'abandonnent-ils pas à d'autres le soin de les conduire, eux-mêmes dirigent les pérégrinations et les déplacements fréquents.
Pendant une bonne partie de l'année, les villages sont désertés ; chaque maison n'est plus qu'un magasin où l'on enferme les provisions.
Les nécessités de la vie obligent les habitants de l'Aurès à n'être pas tout à fait sédentaires ; il y a longtemps qu'il en est ainsi. Le nom de chaouïa qu'on leur donne signifie les pasteurs, les bergers nomades.
Marmol parle des " chaviens errant sous la tente comme des Arabes." Il suffit de voir un Mozabite pour reconnaître que cette population n'est pas arabe.
Ces formes ramassées, cette figure aplatie d'un brun pâle et mât, ce gros nez, ces grosses lèvres sont les traits caractéristiques de la race berbère.
Ceux-là n'ont subi ni altérations ni mélanges.
Ils descendent en droite ligne des Zenata ibâdites ; plutôt que de renoncer à leurs croyances, leurs ancêtres se sont retirés au désert, d'abord dans les bas-fonds d'Ouargla, puis sur les plateaux arides de la Chebkha. A force de persévérance et de travail ils ont transformé cet affreux pays. Ils ont construit des digues pour barrer les vallées, creusé des puits dont l'eau se déverse de tous côtés dans des rigoles. Ces irrigations permettent la culture de quelques céréales et l'entretien de magnifiques jardins, où les arbres fruitiers ombragent les plants de légumes, et qu'abritent sous leurs voûtes immenses 180.000 palmiers.
Les Mozabites sont aussi d'actifs commerçants ; ils ont des marchés dans chacune de leurs villes eux-mêmes fréquentent ceux : d'Ouargla, de Metlili, de Touggourt, du Souf et de la Tunisie.
Un bon tiers de la population émigre dans le Tell ; ils s'établissent dans les villes comme : Epiciers, bouchers, marchands de paniers de cordes de sparte, vendeurs de légumes, baigneurs.
L'échoppe d'un "moutchou " est un petit bazar où se vendent avec les denrées tous les menus objets de ménage ; il se tient là toute la journée immobile grave sans paraître se douter qu'il existe au monde des distractions et des plaisirs.
Il a peu de besoins, s'habille une fois pour toute de sa gandoura multicolore, se nourrit à peine, couche n'importe où ; il se contente aisément d'un faible bénéfice.
Instruit avec cela sachant : Lire, écrire, tenir ses comptes, régulier et probe il fait bien ses affaires.
Quelques-uns réalisent des fortunes assez rondes.
Ce qui a conduit les Mozabites dans l'extrême Sud, ce qui les a empêchés de se confondre avec les autres populations, c'est la religion. Elle domine encore toutes leurs institutions civiles et politiques.
Chaque ville du M'zab nomme une djemâa qui : répartit et perçoit l'impôt, fait la police, juge les crimes les délits et les contraventions.
Toutes les villes ensemble forment la confédération ; des délégués de toutes les djemâas réunis en conseil administrent les intérêts généraux.
En apparence rien n'est plus simple et plus démocratique que ce gouvernement ; mais la réalité du pouvoir appartient au clergé ; la puissante corporation des tolbas est maîtresse partout : c'est le cheick des tolbas qui dans chaque ville préside la djemâa, c'est le cheikh Baba ou grand pontife qui préside le conseil de la fédération ; aucune décision n'est valable si le tolba président ne l'a approuvée comme conforme à la doctrine.
Les tolbas ont leurs biens de main-morte, les habbous ou propriétés des mosquées, entretenues par des dotations spéciales ou des donations pieuses.
Ils vivent des revenus de ces fonds inaliénables
Ils n'exercent pas de profession manuelle
Leur métier est d'étudier et
De maintenir le dogme et la tradition ibâdite.
Ils l'enseignent dans leurs écoles
ils l'appliquent dans les jugements qu'ils rendent en matière civile.
Ils sont chargés de faire respecter la religion et les mœurs.
Une censure sévère est exercée sur la vie de chacun ; les femmes sont séquestrées, quand elles sortent elle doivent s'envelopper soigneusement du haïk ; il leur est interdit de quitter le territoire de la confédération l'adultère est punie des peines les plus rigoureuses.
La famille est fortement constituée, le père a toute autorité sur ses enfants, un fils ne peut posséder en propre du vivant de son père s'il n'a pas été affranchi par lui. Quand la conduite d'un Mozabite paraît répréhensible, il est frappé de la tébria, qui le prive à la fois de la communion religieuse et de ses droits civils.
C'est encore aux tolbas qu'il appartient de prononcer ou de lever la tébria.
Ce despotisme théocratique ne semble plus destiné à subsister longtemps.
Jusqu'à présent le M'zab a seulement reconnu la suzeraineté de la France, à laquelle il paye un tribut d'environ 50.000 francs.
Mais un parti toujours plus nombreux travaille à préparer une annexion : c'est le parti des Haouam ou laïques dont beaucoup ont vécu parmi nous, qui veulent être libres de leurs allures et prétendent jouir à leur guise des biens qu'ils ont acquis.
Pour le moment les deux influences, l'ancienne et la nouvelle, sont en lutte et leur conflit se traduit fréquemment par des collisions sanglantes.
Il n'y a pas si longtemps que l'Arabe, poétisé par toutes les " orientales " était l'objet de notre admiration ; on commence à en rabattre ; c'est aujourd'hui le Berbère qui est à la mode.
On convient que l'Arabe, par les influences d'hérédité et de milieu, par tous ses instincts et toutes ses croyances, est réfractaire à notre civilisation, mais en même temps on affirme que le Berbère n'a avec nous que des affinités et des ressemblances : l'un est nomade, polygame, fanatique, aristocratique, inintelligent, farouche, paresseux.
L'autre est : Sédentaire, Monogame, presque indifférent en matière de religion, il a des institutions démocratiques, son esprit est ouvert, ses habitudes laborieuses.
C'est un homme moderne peut-être notre consanguin pour sûr notre pareil et presque notre égal.
Voici l'opinion courante, formulée d'abord timidement comme un paradoxe, admise aujourd'hui comme une vérité reconnue. Elle pourrait produire, elle a déjà produit des méprises dangereuses.
Malgré l'autorité considérable de quelques-uns de ceux qui l'admettent, elle nous paraît reposer sinon sur des erreurs, du moins sur un examen superficiel et une interprétation forcée de la réalité.
Que le Berbère soit sédentaire, cela n'est pas exact d'une manière absolue ; avant l'invasion musulmane, à toutes les époques de l'antiquité, il y avait dans l'Afrique du Nord des populations nomades ; ces populations étaient des Berbères.
De nos jours nous voyons les Kabyles et les Mozabites avoir des demeures fixes ; mais en est-il ainsi des Chaouïa, dont le nom même est bien significatif ?
En dehors de l'Algérie est-ce le cas des Touareg ? Et pourtant nul ne conteste que les Chaouïas et les Touareg soient des Berbères.
Cette division en nomade et en sédentaires, aussi ancienne que l'histoire même, ne se retrouve-t-elle pas également chez les Arabes ?
Les influences de race y sont pour peu de chose, elle est déterminée par les nécessités géographiques les plus évidentes, elle résulte de la nature même du pays. Quel que soit leur origine, les pasteurs du Sahara et des plateaux se déplacent toujours avec leurs troupeaux ; les laboureurs du Tell s'attachent toujours au sol qu'ils cultivent.
La polygamie admise par les Arabes n'existe cependant chez eux qu'à titre d'exception ; d'autre part on pourrait en trouver des exemples dans le M'zab et même, en cherchant bien, parmi les Kabyles.
Mais l'important n'est pas d'établir la proportion plus ou moins grande des ménages multiples chez les deux peuples, c'est de savoir si la condition faite à la femme par chacun d'eux se présente avec des différences essentielles.
La femme mozabite est aussi rigoureusement cloîtrée que la femme arabe ; pendant le voyage que fit au M'zab M. Coÿne, deux curieuses étaient montées sur la terrasse pour voir comment étaient faits des Français.
" Quelques instants après j'entendis des cris perçants et j'appris qu'elles avaient été arrêtées séance tenante et conduites à la mosquée, où elles avaient été fustigées. "
En pays kabyle la femme n'est pas tenue de se couvrir le visage, elle a plus de liberté apparente ; mais la place qu'on lui donne dans la famille et dans la société est bien infime.
Sa naissance est accueillie froidement, tandis que le venue d'un enfant mâle se célèbre par des fêtes. Fille, sa famille n'attend pas toujours qu'elle soit nubile pour la vendre après marché débattu à un homme vieux ou jeune.
Le mari est pour elle un maître, il peut la maltraiter ; d'après les kanouns, il a le droit de la tuer en cas d'adultère.
S'il est fatigué d'elle ou qu'il ait envie de changer, une simple déclaration de divorce suffit ; il n'est pas nécessaire de fournir des raisons ou d'alléguer des prétextes ; bien entendu la réciprocité n'existe pas.
La femme divorcée ne peut contracter un nouveau mariage que si la dot versée à ses parents est remboursée par eux ou par elle.
Les kanouns de la Kabylie et de l'Aurès ne reconnaissent pas à la femme la capacité d'hériter ; elle n'a droit qu'à la subsistance, qui lui est fournie, tant bien que ma : fille ou répudiée par sa famille, orpheline ou veuve par les héritiers mâles de ses parents ou de son mari.
Il ne semble pas que la femme arabe ait grand chose à envier au sort de la femme berbère comme elle, dédaignée et asservie, comme elle, sans fortune propre, comme elle, atteinte dans ses intérêts, dans sa dignité, dans sa sécurité même, par les peurs et par les lois d'une société brutale.
C'est méconnaître les Berbères que parler de leur tiédeur religieuse ; aucune race n'a versé aussi abondamment son sang pour des querelles de secte ; donatistes et kharadjites, sofristes et circoncellions ont fait preuve de la même ardeur fanatique.
Il y actuellement en Algérie une société qui est une pure théocratie, et c'est une société berbère.
Dira-t-on que les Mozabites ne sont pas de vrais musulmans parce qu'ils se séparent de l'orthodoxie ?
C'est comme l'on disait que les Genevois de Calvin n'étaient pas des chrétiens.
Quant aux Kabyles on ne sait que penser de leur prétendue indifférence : leur crédule enthousiasme pour les faux chérifs leur affluence dans les confréries des Khouans en donnent l'exacte mesure.
A voir les zaouïas semées dans les montagnes, les marabouts pullulants et révérés, on se croirait dans une Espagne islamique.
Il ne faut pas s'y tromper : les Berbères ont un penchant naturel à l'hétérodoxie, ils sont tous portés à n'être pas musulman de la même façon que les autres, mais ils n'en sont que plus passionnés dans leurs croyances, plus acharnés dans leurs superstitions, plus enfoncés dans leurs préjugés.
On s'émerveille devant leurs institutions politiques, comme si elles dénotaient une aptitude toute particulière à la civilisation ; mais les peuples les plus voisins de la barbarie, dès qu'ils ont été sédentaires, se sont naturellement groupés d'après l'emplacement de leurs demeures et organisés en villages.
Les Germains dans leur vicus, les Italiens dans la civitas primitive même les Peaux-Rouges de l'Amérique avaient des djemaâs.
Chez les Mozabites, nous savons que l'influence cléricale domine tout ; en pays kabyle ou chaouïa les influences aristocratiques existaient plus qu'on ne le pense. Les personnages importants descendants des grandes familles ou possesseurs d'une richesse relative, étaient plus écoutés dans les délibérations ; c'est parmi eux qu'on choisissait les amins et les imokhranen ; jamais un cof n'aurait mis à sa tête un inconnu ni surtout un pauvre ; ne fallait-il pas des largesses faite par le chef pour amener des recrues et empêcher des défections ?
Ce qu'on a appelé " un régime parlementaire " les discussions furibondes à main armée les débats tumultueux dégénérant en batailles sanglantes qu'était-ce autre chose qu'une perpétuelle anarchie ? Jamais les sociétés berbères ne se sont élevées à une conception générale jamais elles n'ont été capables de former une nation ; elles ont vécu divisées enfermées dans le cercle étroit des petits intérêts des mesquines passions des agitations stériles se démenant sur place n'avançant ne progressant pas. Prétendre que ces groupes haineux et turbulent ressemblent à nos grandes démocraties, c'est faire de celles-ci la satire la plus violente. Elles ne méritent pas l'injure d'un tel rapprochement.
Les fameuses vertus berbères dont des auteurs bienveillants avaient fait la découverte ne sont pas bon teint ; elle ne résiste pas à l'épreuve des faits. Demandez à nos officiers et à nos magistrats ce qu'ils pensent de la franchise kabyle ; sur cent témoins interrogés dans une affaire, cinquante affirment, cinquante nient avec le même aplomb. Ils sont aussi violents que les Arabes, mais plus sournois et plus vindicatifs.
En 1871, les Kabyles tant vantés ont montré quel fond on pouvait faire sur leur fidélité. L'Arabe est violent et tue, le Berbère est féroce et raffine sa cruauté. Les horreurs de Palestro ont été accomplies par des Kabyles.
Quand on parle de tortures et de mutilations commises sur des blessés ou des prisonniers, soyez sûrs que cela se passent dans les montagnes, c'est-à-dire en pays berbère.
Ce sont des Berbères aussi ces Touareg, ces prétendus chevaliers du désert qui viennent de se révéler comme des maîtres dans l'art de trahir.
Ils sont venus chercher Flatters jusqu'à Alger, lui ont prodigué les avances, les promesses, les protestations ; quand ils l'ont eu attiré dans leur guet-apens, les guides dévoués sont devenus des assassins ; la tuerie était restée incomplète, le poison a achevé l'œuvre. Des élèves de Machiavel n'auraient pas fait mieux.
Pour être vrai, reconnaissons au Berbère, particulièrement au Mozabite et au Kabyle, les qualités qu'il possède réellement : l'énergie, la patience, l'habitude et le goût du travail.
Sa supériorité sur l'Arabe consiste dans la tournure plus pratique de son esprit dans une intelligence plus souple dans une remarquable aptitude à comprendre où est son intérêt.
Dans les premiers jours de la conquête quand les autres s'écartaient moroses et raides, ceux-ci s'approchaient curieusement essayaient de baragouiner notre langue. Ce n'était pas chez eux sympathie mais calcul : il pouvait y avoir quelque chose à gagner avec les Roumis.
Quand ils se seront aperçus que l'instruction est une force toute puissante, ils chercheront à s'instruire, beaucoup y sont déjà tout disposés.
C'est par-là que nous avons prise sur cette race : dure difficile à manier mais positive portée à transiger avec les réalités de la vie.
Qu'il soit possible de les amener à nous dans un temps relativement court, que le rapprochement soit moins malaisé à opérer avec eux qu'avec les autres indigènes, on ne le conteste pas. Mais comme il serait puéril de se payer d'illusions, il faut reconnaître que la tâche est ardue et que ces gens-là, pour différents qu'ils soient Arabes, sont presque aussi indifférents de nous que les Arabes eux-mêmes.
L'Algérie par Maurice Wahl 1882
|
|
Lettres de mon moulin 1879
Alphonse Daudet
Envoyé par M. Louis Aymés ;
|
À MILIANAH.
Editeur Alphonse Lemerre
 Cette fois, je vous emmène passer la journée dans une jolie petite ville d'Algérie, à deux ou trois cents lieues du moulin… Cela nous changera un peu des tambourins et des cigales… Cette fois, je vous emmène passer la journée dans une jolie petite ville d'Algérie, à deux ou trois cents lieues du moulin… Cela nous changera un peu des tambourins et des cigales…
… Il va pleuvoir ; le ciel est gris, les crêtes du mont Zaccar s'enveloppent de brume. Dimanche triste… Dans ma petite chambre d'hôtel, la fenêtre ouverte sur les remparts arabes, j'essaye de me distraire en allumant des cigarettes… On a mis à ma disposition toute la bibliothèque de l'hôtel ; entre une histoire très détaillée de l'enregistrement et quelques romans de Paul de Kock je découvre un volume dépareillé de Montaigne… Ouvert le livre au hasard, relu l'admirable lettre sur la mort de La Boétie… Me voilà plus rêveur et plus sombre que jamais… Quelques gouttes de pluie tombent déjà. Chaque goutte, en tombant sur le rebord de la croisée, fait une large étoile dans la poussière entassée là depuis les pluies de l'an dernier… Mon livre me glisse des mains, et je passe de longs instants à regarder, cette étoile mélancolique…
Deux heures sonnent à l'horloge de la ville, un ancien marabout dont j'aperçois d'ici les grêles murailles blanches… Pauvre diable de marabout ! Qui lui aurait dit cela, il y a trente ans, qu'un jour il porterait au milieu de la poitrine un gros cadran municipal, et que, tous les dimanches, sur le coup de deux heures, il donnerait aux églises de Milianah le signal de sonner les vêpres ?… Ding ! dong ! voilà les cloches parties !… Nous en avons pour longtemps… Décidément, cette chambre est triste. Les grosses araignées du matin, qu'on appelle pensées philosophiques, ont tissé leurs toiles dans tous les coins… Allons dehors.
J'arrive sur la grande place. La musique du 3ème de ligne, qu'un peu de pluie n'épouvante pas, vient de se ranger autour de son chef. À une des fenêtres de la division, le général paraît, entouré de ses demoiselles ; sur la place le sous-préfet se promène de long en large au bras du juge de paix. Une demi-douzaine de petits Arabes, à moitié nus, jouent aux billes dans un coin avec des cris féroces. Là-bas, un vieux juif en guenilles vient chercher un rayon de soleil qu'il avait laissé hier à cet endroit et qu'il s'étonne de ne plus trouver… " Une, deux, trois, partez ! " La musique entonne une ancienne mazurka de Talexy, que les orgues de Barbarie jouaient l'hiver dernier sous mes fenêtres. Cette mazurka m'ennuyait autrefois ; aujourd'hui elle m'émeut jusqu'aux larmes.
Oh ! comme ils sont heureux les musiciens du 3ème ! L'œil fixé sur les doubles croches, ivres de rythme et de tapage, ils ne songent à rien qu'à compter leurs mesures. Leur âme, toute leur âme tient dans ce carré de papier large comme la main, - qui tremble au bout de l'instrument entre deux dents de cuivre. " Une, deux, trois, partez ! " Tout est là pour ces braves gens ; jamais les airs nationaux qu'ils jouent ne leur ont donné le mal du pays… Hélas ! moi qui ne suis pas de la musique, cette musique me fait peine, et je m'éloigne…
Où pourrais-je bien la passer, cette grise après-midi de dimanche ? Bon ! la boutique de Sid'Omar est ouverte… Entrons chez Sid'Omar.
Quoiqu'il ait une boutique, Sid'Omar n'est point un boutiquier. C'est un prince du sang, le fils d'un ancien dey d'Alger qui mourut étranglé par les janissaires… À la mort de son père, Sid'Omar se réfugia dans Milianah avec sa mère qu'il adorait, et vécut là quelques années comme un grand seigneur philosophe parmi ses lévriers, ses faucons, ses chevaux et ses femmes, dans de jolis palais très frais, pleins d'orangers et de fontaines. Vinrent les Français. Sid'Omar, d'abord notre ennemi et l'allié d'Abd-el-Kader, finit par se brouiller avec l'émir et fit sa soumission. L'émir, pour se venger, entra dans Milianah en l'absence de Sid'Omar, pilla ses palais, rasa ses orangers, emmena ses chevaux et ses femmes, et fit écraser la gorge de sa mère sous le couvercle d'un grand coffre… La colère de Sid'Omar fut terrible : sur l'heure même il se mit au service de la France, et nous n'eûmes pas de meilleur ni de plus féroce soldat que lui tant que dura notre guerre contre l'émir. La guerre finie, Sid'Omar revint à Milianah ; mais encore aujourd'hui, quand on parle d'Abd-el-Kader devant lui, il devient pâle et ses yeux s'allument.
Sid'Omar a soixante ans. En dépit de l'âge et de la petite vérole, son visage est resté beau : de grands cils, un regard de femme, un sourire charmant, l'air d'un prince. Ruiné par la guerre, il ne lui reste de son ancienne opulence qu'une ferme dans la plaine du Chélif et une maison à Milianah, où il vit bourgeoisement avec ses trois fils élevés sous ses yeux. Les chefs indigènes l'ont en grande vénération. Quand une discussion s'élève, on le prend volontiers pour arbitre, et son jugement fait loi presque toujours. Il sort peu : on le trouve toutes les après-midi dans une boutique attenant à sa maison et qui ouvre sur la rue. Le mobilier de cette pièce n'est pas riche : - des murs blancs peints à la chaux, un banc de bois circulaire, des coussins, de longues pipes, deux braseros… C'est là que Sid'Omar donne audience et rend la justice. Un Salomon en boutique.
Aujourd'hui dimanche, l'assistance est nombreuse. Une douzaine de chefs sont accroupis, dans leurs burnous, tout autour de la salle. Chacun d'eux a près de lui une grande pipe, et une petite tasse de café dans un fin coquetier de filigrane. J'entre, personne ne bouge… De sa place, Sid'Omar envoie à ma rencontre son plus charmant sourire et m'invite de la main à m'asseoir près de lui, sur un grand coussin de soie jaune ; puis, un doigt sur les lèvres, il me fait signe d'écouter.
Voici le cas : - Le caïd des Beni-Zougzougs ayant eu quelque contestation avec un juif de Milianah au sujet d'un lopin de terre, les deux parties sont convenues de porter le différend devant Sid'Omar et de s'en remettre à son jugement. Rendez-vous est pris pour le jour même, les témoins sont convoqués ; tout à coup voilà mon juif qui se ravise, et vient, seul, sans témoins, déclarer qu'il aime mieux s'en rapporter au juge de paix des Français qu'à Sid'Omar… L'affaire en est là à mon arrivée.
Le juif - vieux, barbe terreuse, veste marron, bas bleus, casquette en velours - lève le nez au ciel, roule des yeux suppliants, baise les babouches de Sid'Omar, penche la tête, s'agenouille, joint les mains… Je ne comprends pas l'arabe, mais à la pantomime du juif, au mot : Zouge de paix, zouge de paix, qui revient à chaque instant, je devine tout ce beau discours :
- Nous ne doutons pas de Sid'Omar, Sid'Omar est sage, Sid'Omar est juste… Toutefois le zouge de paix fera bien mieux notre affaire.
L'auditoire, indigné, demeure impassible comme un Arabe qu'il est… Allongé sur son coussin, l'œil noyé, le bouquin d'ambre aux lèvres, Sid'Omar - dieu de l'ironie - sourit en écoutant. Soudain, au milieu de sa plus belle période, le juif est interrompu par un énergique caramba ! qui l'arrête net ; en même temps un colon espagnol, venu là comme témoin du caïd, quitte sa place et, s'approchant d'Iscariote, lui verse sur la tête un plein panier d'imprécations de toutes langues, de toutes couleurs, - entre autres certain vocable français trop gros monsieur pour qu'on le répète ici… Le fils de Sid'Omar, qui comprend le français, rougit d'entendre un mot pareil en présence de son père et sort de la salle. - Retenir ce trait de l'éducation arabe. - L'auditoire est toujours impassible, Sid'Omar toujours souriant. Le juif s'est relevé et gagne la porte à reculons, tremblant de peur, mais gazouillant de plus belle son éternel zouge de paix, zouge de paix… Il sort.
L'Espagnol, furieux, se précipite derrière lui, le rejoint dans la rue et par deux fois - vli ! vlan ! - le frappe en plein visage… Iscariote tombe à genoux, les bras en croix… L'Espagnol, un peu honteux, rentre dans la boutique… Dès qu'il est rentré, - le juif se relève et promène un regard sournois sur la foule bariolée qui l'entoure. Il y a là des gens de tout cuir, - Maltais, Mahonnais, nègres, Arabes, tous unis dans la haine du juif et joyeux d'en voir maltraiter un… Iscariote hésite un instant, puis, prenant un Arabe par le pan de son burnous :
- Tu l'as vu, Achmed, tu l'as vu… tu étais là… Le chrétien m'a frappé… Tu seras témoin… bien… bien… tu seras témoin.
L'Arabe dégage son burnous et repousse le juif… Il ne sait rien, il n'a rien vu : juste au moment, il tournait la tête…
- Mais toi, Kaddour, tu l'as vu… tu as vu le chrétien me battre… crie le malheureux Iscariote à un gros nègre en train d'éplucher une figue de Barbarie…
Le nègre crache en signe de mépris et s'éloigne, il n'a rien vu… Il n'a rien vu non plus, ce petit Maltais dont les yeux de charbon luisent méchamment derrière sa barrette ; elle n'a rien vu, cette Mahonnaise au teint de brique qui se sauve en riant, son panier de grenades sur la tête…
Le juif a beau crier, prier, se démener… pas de témoin ! personne n'a rien vu… Par bonheur deux de ses coreligionnaires passent dans la rue à ce moment, l'oreille basse, rasant les murailles. Le juif les avise :
- Vite, vite, mes frères ! Vite à l'homme d'affaires ! Vite au zouge de paix !… Vous l'avez vu, vous autres… vous avez vu qu'on a battu le vieux !
S'ils l'ont vu !… Je crois bien.
… Grand émoi dans la boutique de Sid'Omar… Le cafetier remplit les tasses, rallume les pipes. On cause, on rit à belles dents. C'est si amusant de voir rosser un juif !… Au milieu du brouhaha et de la fumée, je gagne la porte doucement ; j'ai envie d'aller rôder un peu du côté d'Israël pour savoir comment les coreligionnaires d'Iscariote ont pris l'affront fait à leur frère…
- Viens dîner ce soir, moussiou, me crie le bon Sid'Omar…
J'accepte, je remercie. Me voilà dehors.
Au quartier juif, tout le monde est sur pied. L'affaire fait déjà grand bruit. Personne aux échoppes. Brodeurs, tailleurs, bourreliers, - tout Israël est dans la rue… Les hommes - en casquette de velours, en bas de laine bleue - gesticulant bruyamment, par groupes… Les femmes, pâles, bouffies, raides comme des idoles de bois dans leurs robes plates à plastron d'or, le visage entouré de bandelettes noires, vont d'un groupe à l'autre en miaulant… Au moment où j'arrive, un grand mouvement se fait dans la foule. On s'empresse, on se précipite… Appuyé sur ses témoins, le juif - héros de l'aventure - passe entre deux haies de casquettes, sous une pluie d'exhortations :
- Venge-toi, frère, venge-nous, venge le peuple juif. Ne crains rien ; tu as la loi pour toi.
Un affreux nain, puant la poix et le vieux cuir, s'approche de moi d'un air piteux, avec de gros soupirs :
- Tu vois ! me dit-il. Les pauvres juifs, comme on nous traite ! C'est un vieillard ! regarde. Ils l'ont presque tué.
De vrai, le pauvre Iscariote a l'air plus mort que vif. Il passe devant moi, - l'œil éteint, le visage défait ; ne marchant pas, se traînant… Une forte indemnité est seule capable de le guérir ; aussi ne le mène-t-on pas chez le médecin, mais chez l'agent d'affaires.
Il y a beaucoup d'agents d'affaires en Algérie, presque autant que de sauterelles. Le métier est bon, paraît-il. Dans tous les cas, il a cet avantage qu'on y peut entrer de plain-pied, sans examens, ni cautionnement, ni stage. Comme à Paris nous nous faisons hommes de lettres, on se fait agent d'affaires en Algérie. Il suffit pour cela de savoir un peu de français, d'espagnol, d'arabe, d'avoir toujours un code dans ses fontes, et sur toute chose le tempérament du métier.
Les fonctions de l'agent sont très variées : tour à tour avocat, avoué, courtier, expert, interprète, teneur de livres, commissionnaire, écrivain public, c'est le maître Jacques de la colonie. Seulement Harpagon n'en avait qu'un, de maître Jacques, et la colonie en a plus qu'il ne lui en faut. Rien qu'à Milianah, on les compte par douzaines. En général, pour éviter les frais de bureau, ces messieurs reçoivent leurs clients au café de la grand'place et donnent leurs consultations - les donnent-ils ? - entre l'absinthe et le champoreau.
C'est vers le café de la grand'place que le digne Iscariote s'achemine, flanqué de ses deux témoins. Ne les suivons pas.
La cour qui précède le bureau est encombrée d'Arabes en guenilles. Ils sont là une cinquantaine à faire antichambre, accroupis, le long du mur, dans leurs burnous. Cette antichambre bédouine exhale - quoique en plein air - une forte odeur de cuir humain. Passons vite… Dans le bureau, je trouve l'interprète aux prises avec deux grands braillards entièrement nus sous de longues couvertures crasseuses, et racontant d'une mimique enragée je ne sais quelle histoire de chapelet volé. Je m'assieds sur une natte dans un coin, et je regarde… Un joli costume, ce costume d'interprète ; et comme l'interprète de Milianah le porte bien ! Ils ont l'air taillés l'un pour l'autre. Le costume est bleu de ciel avec des brandebourgs noirs et des boutons d'or qui reluisent. L'interprète est blond, rose, tout frisé ; un joli hussard bleu plein d'humour et de fantaisie ; un peu bavard, - il parle tant de langues ! un peu sceptique, il a connu Renan à l'école orientaliste ! - grand amateur de sport, à l'aise au bivouac arabe comme aux soirées de la sous-préfète, mazurkant mieux que personne, et faisant le couscous comme pas un. Parisien, pour tout dire ; voilà mon homme, et ne vous étonnez pas que les dames en raffolent… Comme dandysme, il n'a qu'un rival : le sergent du bureau arabe. Celui-ci - avec sa tunique de drap fin et ses guêtres à boutons de nacre - fait le désespoir et l'envie de toute la garnison. Détaché au bureau arabe, il est dispensé des corvées, et toujours se montre par les rues, ganté de blanc, frisé de frais, avec de grands registres sous le bras. On l'admire et on le redoute. C'est une autorité.
Décidément, cette histoire de chapelet volé menace d'être fort longue. Bonsoir ! je n'attends pas la fin.
En m'en allant je trouve l'antichambre en émoi. La foule se presse autour d'un indigène de haute taille, pâle, fier, drapé dans un burnous noir. Cet homme, il y a huit jours, s'est battu dans le Zaccar avec une panthère. La panthère est morte ; mais l'homme a eu la moitié du bras mangée. Soir et matin il vient se faire panser au bureau arabe, et chaque fois on l'arrête dans la cour pour lui entendre raconter son histoire. Il parle lentement, d'une belle voix gutturale. De temps en temps, il écarte son burnous et montre, attaché contre sa poitrine, son bras gauche entouré de linges sanglants.
À peine suis-je dans la rue, voilà un violent orage qui éclate. Pluie, tonnerre, éclairs, sirocco… Vite, abritons-nous. J'enfile une porte au hasard, et je tombe au milieu d'une nichée de bohémiens, empilés sous les arceaux d'une cour moresque. Cette cour tient à la mosquée de Milianah ; c'est le refuge habituel de la pouillerie musulmane, on l'appelle la cour des pauvres.
De grands lévriers maigres, tout couverts de vermine, viennent rôder autour de moi d'un air méchant. Adossé contre un des piliers de la galerie, je tâche de faire bonne contenance, et, sans parler à personne, je regarde la pluie qui ricoche sur les dalles coloriées de la cour. Les bohémiens sont à terre, couchés par tas. Près de moi, une jeune femme, presque belle, la gorge et les jambes découvertes, de gros bracelets de fer aux poignets et aux chevilles, chante un air bizarre à trois notes mélancoliques et nasillardes. En chantant, elle allaite un petit enfant tout nu en bronze rouge, et, du bras resté libre, elle pile de l'orge dans un mortier de pierre. La pluie, chassée par un vent cruel, inonde parfois les jambes de la nourrice et le corps de son nourrisson. La bohémienne n'y prend point garde et continue à chanter, sous la rafale, en pilant l'orge et donnant le sein.
L'orage diminue. Profitant d'une embellie, je me hâte de quitter cette cour des Miracles et je me dirige vers le dîner de Sid'Omar ; il est temps… En traversant la grand'place, j'ai encore rencontré mon vieux juif de tantôt. Il s'appuie sur son agent d'affaires ; ses témoins marchent joyeusement derrière lui ; une bande de vilains petits juifs gambade à l'entour… Tous les visages rayonnent. L'agent se charge de l'affaire : Il demandera au tribunal deux mille francs d'indemnité.
Chez Sid'Omar, dîner somptueux. - La salle à manger ouvre sur une élégante cour moresque, où chantent deux ou trois fontaines… Excellent repas turc, recommandé au baron Brisse. Entre autres plats, je remarque un poulet aux amandes, un couscous à la vanille, une tortue à la viande, - un peu lourde mais du plus haut goût, - et des biscuits au miel qu'on appelle bouchées du kadi… Comme vin, rien que du champagne. Malgré la loi musulmane Sid'Omar en boit un peu, - quand les serviteurs ont le dos tourné… Après dîner, nous passons dans la chambre de notre hôte, où l'on nous apporte des confitures, des pipes et du café… L'ameublement de cette chambre est des plus simples : un divan, quelques nattes ; dans le fond, un grand lit très haut sur lequel flânent de petits coussins rouges brodés d'or… À la muraille est accrochée une vieille peinture turque représentant les exploits d'un certain amiral Hamadi. Il paraît qu'en Turquie les peintres n'emploient qu'une couleur par tableau : ce tableau-ci est voué au vert. La mer, le ciel, les navires, l'amiral Hamadi lui-même, tout est vert, et de quel vert !…
L'usage arabe veut qu'on se retire de bonne heure. Le café pris, les pipes fumées, je souhaite la bonne nuit à mon hôte et je le laisse avec ses femmes.
Où finirai-je ma soirée ? Il est trop tôt pour me coucher, les clairons des spahis n'ont pas encore sonné la retraite. D'ailleurs, les coussinets d'or de Sid'Omar dansent autour de moi des farandoles fantastiques qui m'empêcheraient de dormir… Me voici devant le théâtre, entrons un moment.
Le théâtre de Milianah est un ancien magasin de fourrages, tant bien que mal déguisé en salle de spectacle. De gros quinquets, qu'on remplit d'huile pendant l'entr'acte font l'office de lustres. Le parterre est debout, l'orchestre sur des bancs. Les galeries sont très fières parce qu'elles ont des chaises de paille… Tout autour de la salle, un long couloir, obscur, sans parquet… On se croirait dans la rue, rien n'y manque… La pièce est déjà commencée quand j'arrive. À ma grande surprise, les acteurs ne sont pas mauvais, je parle des hommes ; ils ont de l'entrain, de la vie… Ce sont presque tous des amateurs, des soldats du 3e ; le régiment en est fier et vient les applaudir tous les soirs.
Quant aux femmes, hélas !… c'est encore et toujours cet éternel féminin des petits théâtres de province, prétentieux, exagéré et faux… Il y en a deux pourtant qui m'intéressent parmi ces dames, deux juives de Milianah, toutes jeunes, qui débutent au théâtre… Les parents sont dans la salle et paraissent enchantés. Ils ont la conviction que leurs filles vont gagner des milliers de douros à ce commerce-là. La légende de Rachel, israélite, millionnaire et comédienne, est déjà répandue chez les juifs d'Orient.
Rien de comique et d'attendrissant comme ces deux petites juives sur les planches… Elles se tiennent timidement dans un coin de la scène, poudrées, fardées, décolletées et toutes raides. Elles ont froid, elles ont honte. De temps en temps elles baragouinent une phrase sans la comprendre, et, pendant qu'elles parlent, leurs grands yeux hébraïques regardent dans la salle avec stupeur.
Je sors du théâtre… Au milieu de l'ombre qui m'environne, j'entends des cris dans un coin de la place… Quelques Maltais sans doute en train de s'expliquer à coups de couteau…
Je reviens à l'hôtel, lentement, le long des remparts. D'adorables senteurs d'orangers et de thuyas montent de la plaine. L'air est doux, le ciel presque pur… Là-bas, au bout du chemin, se dresse un vieux fantôme de muraille, débris de quelque ancien temple. Ce mur est sacré : tous les jours les femmes arabes viennent y suspendre des ex-voto, fragments de haïks et de foutas, longues tresses de cheveux roux liés par des fils d'argent, pans de burnous… Tout cela va flottant sous un mince rayon de lune, au souffle tiède de la nuit…
LES SAUTERELLES
Pages 201 à 216

Pas une feuille ne bougeait, et dans ces beaux jardins que j'avais sous les yeux, les vignes espacées sur les pentes au grand soleil qui fait les vins sucrés, les fruits d'Europe abrités dans un coin d'ombre, les petits orangers, les mandariniers en longues files microscopiques, tout gardait le même aspect morne, cette immobilité des feuilles attendant l'orage. Les bananiers eux-mêmes, ces grands roseaux vert tendre, toujours agités par quelque souffle qui emmêle leur fine chevelure si légère, se dressaient silencieux et droits, en panaches réguliers.
 Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes-lièges, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante ; et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades moresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a vingt ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. À chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'inexpérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d'efforts ! Que de fatigues ! Quelle surveillance incessante ! Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes-lièges, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante ; et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades moresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a vingt ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. À chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'inexpérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d'efforts ! Que de fatigues ! Quelle surveillance incessante !
Encore maintenant, malgré les mauvais temps finis et la fortune si chèrement gagnée, tous deux, l'homme et la femme, étaient les premiers levés à la ferme. À cette heure matinale je les entendais aller et venir dans les grandes cuisines du rez-de-chaussée, surveillant le café des travailleurs.
Bientôt une cloche sonna, et au bout d'un moment les ouvriers défilèrent sur la route. Des vignerons de Bourgogne ; des laboureurs kabyles en guenilles, coiffés d'une chéchia rouge ; des terrassiers mahonnais, les jambes nues ; des Maltais ; des Lucquois ; tout un peuple disparate, difficile à conduire.
À chacun d'eux le fermier, devant la porte, distribuait sa tâche de la journée d'une voix brève, un peu rude. Quand il eut fini, le brave homme leva la tête, scruta le ciel d'un air inquiet ; puis m'apercevant à la fenêtre :
- Mauvais temps pour la culture, me dit-il… voilà le sirocco.
En effet, à mesure que le soleil se levait, des bouffées d'air, brûlantes, suffocantes, nous arrivaient du sud comme de la porte d'un four ouverte et refermée. On ne savait où se mettre, que devenir. Toute la matinée se passa ainsi. Nous prîmes du café sur les nattes de la galerie, sans avoir le courage de parler ni de bouger.
Les chiens allongés, cherchant la fraîcheur des dalles, s'étendaient dans des poses accablées. Le déjeuner nous remit un peu, un déjeuner plantureux et singulier où il y avait des carpes, des truites, du sanglier, du hérisson, le beurre de Staouëli, les vins de Crescia, des goyaves, des bananes, tout un dépaysement de mets qui ressemblait bien à la nature si complexe dont nous étions entourés…
On allait se lever de table. Tout à coup, à la porte-fenêtre fermée pour nous garantir de la chaleur du jardin en fournaise, de grands cris retentirent :
Les criquets ! les criquets !
 Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l'agitation d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage. D'autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominaient d'une note suraiguë les " You ! you ! you ! " des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre. Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l'agitation d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage. D'autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominaient d'une note suraiguë les " You ! you ! you ! " des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre.
Mais où étaient-elles donc, ces terribles bêtes ? Dans le ciel vibrant de chaleur, je ne voyais rien qu'un nuage venant à l'horizon, cuivré, compact, comme un nuage de grêle, avec le bruit d'un vent d'orage dans les mille rameaux d'une forêt. C'étaient les sauterelles. Soutenues entre elles par leurs ailes sèches étendues, elles volaient en masse, et malgré nos cris, nos efforts, le nuage s'avançait toujours, projetant dans la plaine une ombre immense. Bientôt il arriva au-dessus de nos têtes ; sur les bords on vit pendant une seconde un effrangement, une déchirure. Comme les premiers grains d'une giboulée, quelques-unes se détachèrent, distinctes, roussâtres ; ensuite toute la nuée creva, et cette grêle d'insectes tomba drue et bruyante. À perte de vue les champs étaient couverts de criquets, de criquets énormes, gros comme le doigt.
Alors le massacre commença. Hideux murmure d'écrasement, de paille broyée. Avec les herses, les pioches, les charrues, on remuait ce sol mouvant ; et plus on en tuait, plus il y en avait. Elles grouillaient par couches, leurs hautes pattes enchevêtrées ; celles du dessus faisant des bonds de détresse, sautant au nez des chevaux attelés pour cet étrange labour. Les chiens de la ferme, ceux du douar, lancés à travers champs, se ruaient sur elles, les broyaient avec fureur. À ce moment, deux compagnies de turcos, clairons en tête, arrivèrent au secours des malheureux colons, et la tuerie changea d'aspect.
 Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues tracées de poudre. Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues tracées de poudre.
Fatigué de tuer, écœuré par l'odeur infecte, je rentrai. À l'intérieur de la ferme, il y en avait presque autant que dehors. Elles étaient entrées par les ouvertures des portes, des fenêtres, la baie des cheminées. Au bord des boiseries, dans les rideaux déjà tout mangés, elles se traînaient, tombaient, volaient, grimpaient aux murs blancs avec une ombre gigantesque qui doublait leur laideur. Et toujours cette odeur épouvantable.
À dîner, il fallut se passer d'eau. Les citernes, les bassins, les puits, les viviers, tout était infecté. Le soir, dans ma chambre, où l'on en avait pourtant tué des quantités, j'entendis encore des grouillements sous les meubles, et ce craquement d'élytres semblable au pétillement des gousses qui éclatent à la grande chaleur. Cette nuit-là non plus je ne pus pas dormir. D'ailleurs autour de la ferme tout restait éveillé. Des flammes couraient au ras du sol d'un bout à l'autre de la plaine. Les turcos en tuaient toujours.
Le lendemain, quand j'ouvris ma fenêtre comme la veille, les sauterelles étaient parties ; mais quelle ruine elles avaient laissée derrière elles ! Plus une fleur, plus un brin d'herbe : tout était noir, rongé, calciné. Les bananiers, les abricotiers, les pêchers, les mandariniers, se reconnaissaient seulement à l'allure de leurs branches dépouillées, sans le charme, le flottant de la feuille qui est la vie de l'arbre. On nettoyait les pièces d'eau, les citernes. Partout des laboureurs creusaient la terre pour tuer les œufs laissés par les insectes. Chaque motte était retournée, brisée soigneusement. Et le cœur se serrait de voir les mille racines blanches, pleines de sève, qui apparaissaient dans ces écroulements de terre fertile…
Envoyé par Louis Aymes
|
Ouverte la nuit
Source Gallica
|
ALGER ETUDIANT
N° 141, 1932
Pour MARCEL GIANAZZA.
O Bonne-Garde ! Escale ouverte
aux chalands du dimanche soir...
Chaque vitrine est un musoir
avec sa flamme rouge ou verte.
Jette du plus loin que tu peux
à la foule éparse qui rentre
- mal à la tête et mal au ventre ! -
L'appel de tes yeux sirupeux,
L'Appel à quoi nul ne se trompe
- mal à la gorge et mal aux pieds ! -
et dont pâlissent les pompiers
qui n'ont que la pompe et la trompe.
Vends-lui sans crainte et sans remords
de la gomme et de la réglisse,
du tilleul et de la mélisse
et des remèdes pour les morts...
Là misérable espèce humaine
qu'a vidée un jour de loisir,
grâce à toi pourra s'endormir
et recommencer la semaine.
Moi, je jalouse en son bocal
le fabuleux Ver solitaire
dont la longueur est un mystère
pour ce public dominical...
Les tons des sulfates de cuivre,
des soufres, des arsenicaux,
parent combien d'autres bocaux
Où je serais heureux de vivre !
Et j'attends le dimanche soir
Comme les Hébreux le Messie
pour aller voir La Pharmacie
flamboyer au bord du trottoir !
EDMOND BRUA.
|
|
PHOTOS d'ALGER
Par DIVERS
|
DJENINA ET PLACE DU MARCHE 1832

PORTE BÂB EL OUED 1830
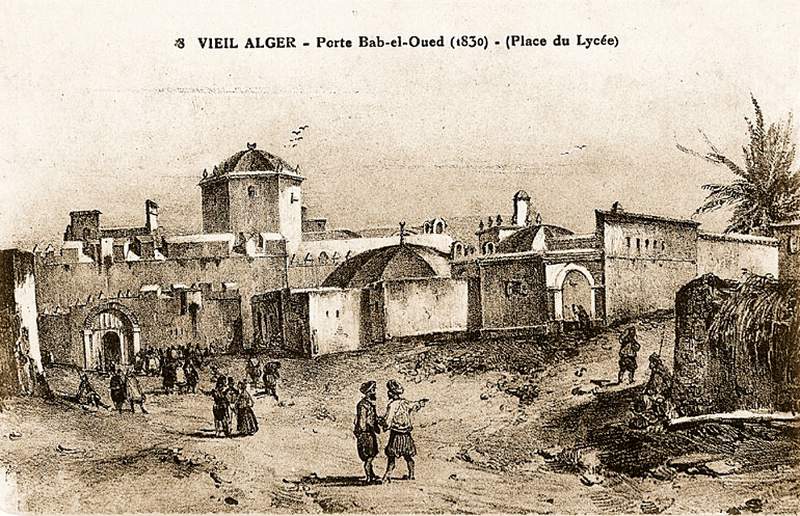
LE VIEUX PORT

VU GENERALE 1830
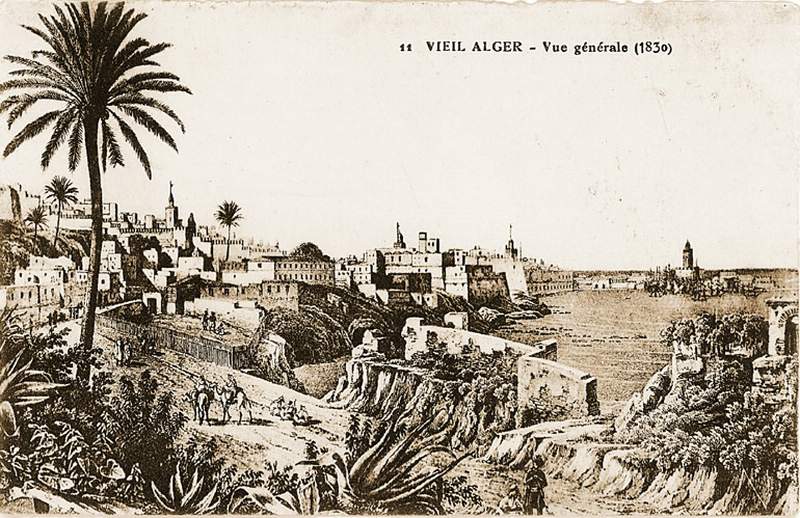
RUE MARENGO ET MOSQUEE SIDI ABDERHAMANE
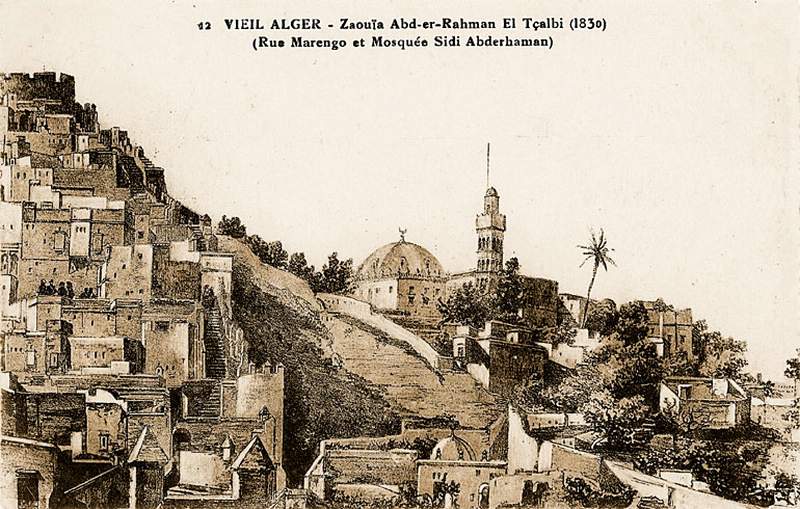
BORG MOULAÏ HASSAN 1830 FORT L'EMPEREUR
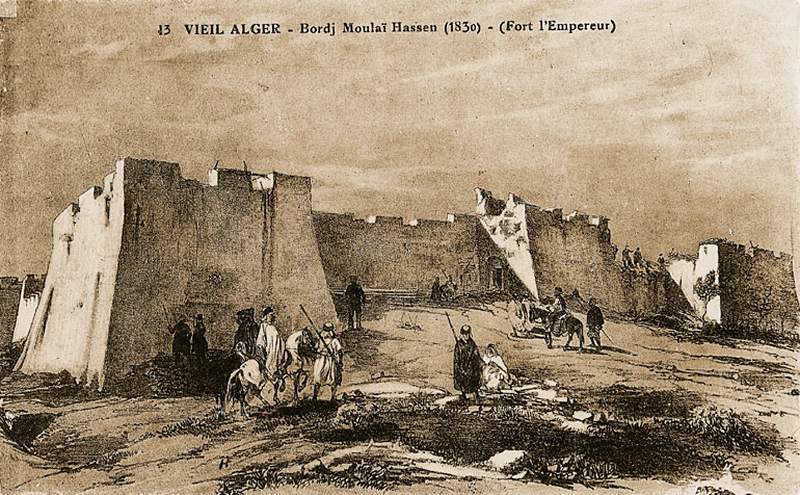
|
|
| CHAUDS ET FROIDS
De Jacques Grieu
| |
L'approche de l'hiver rend les Français inquiets
Qui craignent des coupures en électricité.
Le trop " d'eau dans le gaz ", nous pose des questions
Et le " chauffe qui peut " relance le charbon :
" Lumière ou bien chauffage ", il faudrait faire un choix ?
Le manque de chaleur fait perdre son sang froid…
Faudra-t-il " vivre en couple "... avec son radiateur ?
Des grosses calories devrons-nous avoir peur ?
C'est quand il fait bien chaud qu'il faut battre le fer ?
Mais alors, en janvier que faudra-t-il donc faire ?
Contre les engelures aurons-nous bien des gants ?
Et de passe-montagnes serons-nous gros clients ?
Ceux qui ont les mains froides ont souvent le cœur chaud ;
Mais est-ce pertinent pour rhume de cerveau ?
Jamais avec autrui ne serons plus " en froid "
Sous peine de bronchite en devenir la proie.
Irons-nous en enfer pour être moins gelés ?
Expiant en même temps tous nos plus gros péchés ?
A force de souffler et le chaud et le froid,
Poutine, avec son gaz, sème partout l'effroi.
De ses rodomontades on est tous… échaudés.
Là-bas, dans ses bunkers, est-il trop échauffé ?
De sordides épargnes chacun nous persuade :
L'eau chaude n'oublie pas qu'un jour elle fut froide...
S'il faut juger à froid, il faut agir à chaud
Et nos gouvernements il faudrait prendre au mot.
Faut-il des douches froides pour être patriote ?
Et passer nos veillées à avoir la tremblote ?
Peu me chaut que ces vers puissent jeter un froid,
Car je ne suis pas chaud pour en changer l'aloi…
Jacques Grieu
|
|
|
L'IMPARTIAL DJIDJELLI 8 juin 1923
Envoyé par M. Louis Aymés ;
|
La DESUNION ALGERIENNE
Le coup du troisième larron
Les tiraillements qui viennent de se produire aux Délégations financières entre algéro-oranais et constantinois, semant la division au sein des assemblées algériennes, ont éveillé les convoitises de nos voisins. La désunion des délégués algériens a fait naître un troisième larron qui se félicite de la gravité du conflit existant.
Ce troisième larron, c'est la Tunisie. Elle attend, de la rupture du front économique algérien, un résultat très avantageux pour sa prospérité, et voici comment le journal de Tunisie, précise ces espoirs :
Le conflit écrit-il, nous intéresse au plus haut point, car de sa solution dépend pour nous une ère de prospérité remarquable.
Pourquoi, demandera-t-on ?
Parce que nous aurons construit avant la guerre, vers la frontière algérienne, une série de voies ferrées d'un prix inestimable, qui aujourd'hui deviennent nécessaires pour l'écoulement des produits miniers et phosphatiers échelonnés de Souk-Ahras au Djebel Onk et qui ne pourront être utilement dirigés sur Bône, qui les réclame, sans une dépense fantastique de millions.
…… Et plus loin, en final :
Laissons - les donc se battre. . . et si le sort nous avantage, nous chanterons victoire.
Ces quelques lignes sont suffisamment éloquentes pour constituer à nos yeux un sérieux avertissement que nous devons retenir.
La menace doit faire réfléchir les délégués financiers. Sa réalisation est subordonnée à la prolongation de nos divisions. L'Algérie doit passer avant les questions de personnalités. Son intérêt exige que l'union se fasse sans tarder.
Que ceux qui ont des torts n'hésitent pas à faire les premières avances et que tous soient animés du même désir d'apaisement. Qu'une loyale et franche explication dissipe à jamais les élus des trois départements.
Trêve de mesquines querelles et que rapidement soit cimenté dans la paix, le bloc compact de l'unité algérienne pour la prospérité de la colonie.
|
Tirailleur Algérien,
N° 518, 6 janvier 1901
Source Gallica
|
|
BRAVO PAPA FILLE !
Notre sympathique confiseur de la rue Bab-Azoun vient de donner une fière leçon à la police d'Alger que nous payons si cher et qui nous sert si mal.
Se transformant lui-même en policeman-chef et secondé par le personnel de la maison, il ne tarda pas à mettre la main au collet de quatre jeunes hiverneurs smarts, arrivés récemment de Bruxelles et de Buenos Aires, qui avaient soulagé de 1,300 francs le portefeuille du jeune Norbert allant faire un paiement au Crédit Lyonnais.
Décidément, Alger devient tout à fait grande capitale. Aussi, engageons-nous nos maisons de banque à suivre l'exemple des Postes et Télégraphes, qui ont mis au-dessus de tous leurs bureaux, des pancartes ainsi conçues :
Faites votre police vous-même.
Prenez garde aux pickpockets !
Et si nos renseignements sont exacts, la Municipalité songerait à supprimer purement et si et simplement la police d'Alger, puisque les contribuables eux-mêmes en démontrent l'inutilité.
Que d'économie, Messeigneurs !
Le brave papa Fille serait chargé de distribuer des marrons glacés aux pickpockets pris en flagrant délit.
M. Schwartz serait nommé chef-cantonnier ; les commissaires, chauffeurs des rouleaux automobiles, pour routes départementales, et les agents, balayeurs de rue.
Ainsi ! tout le monde se rendrait utile dans la Nouvelle République Algérienne dont M. Jonnart est le président et le chef incontesté.
Taïba
|
|
L'esprit public à Bône et l'association.
Source Gallica
EST ALGERIEN du 22 décembre 1868, N° 12
|
|
Deux idées réalisent à nos yeux le progrès de l'esprit public : le sentiment de notre valeur propre, qui correspond à l'émancipation individuelle et au principe d'égalité ; le sentiment de la solidarité commune, qui correspond aux intérêts de l'association et au principe de fraternité.
Pris à ce point de vue, l'esprit public ne nous parait pas avoir dans notre ville tout le ressort qu'on pourrait lui souhaiter. Il nous semble que la bourgeoisie de Bône est à la fois trop méfiante et trop conservatrice, qu'absorbée par les intérêts isolés, elle se préoccupe trop peu du rapport de ces intérêts avec le bien commun.
Nous ne lui en faisons certes qu'un demi-reproche. On tient à garder ce qu'on a acquis ; au prix d'un intelligent labeur. Et, d'ailleurs, comment l'esprit public aurait-il pu se former ? Comme partout ailleurs, assouplis à un régime énervant, nous avons presque perdu la conscience de notre torpeur. Mais bien plus qu'ailleurs nous nous sommes habitués à nous taire ; aucune voix ne s'est élevée pour nous éclairer, pour nous fortifier ; et nous savons tous comment fut accueilli le décret qui nous rendait une mince parcelle de nos droits.
Or, notre pays est celui-là où il importe le plus que l'esprit public s'élève à la hauteur des besoins et de l'intérêt commun. L'esprit de solidarité est peut-être moins nécessaire en France que dans notre pays : un sol admirablement aménagé, toutes les richesses mises en exploitation, les voies de communication appropriées aux besoins locaux, tout cela peut faire oublier à chacun l'insuffisance individuelle.
Mais dans notre pays, où tout manque, où tout est encore à faire, il faut que tous et chacun nous comprenions la puissance de l'association. Elle a son principe, nous l'avons dit, dans la réciprocité du besoin ; nul, à notre sens, ne doit s'imaginer qu'il est de son intérêt de s'isoler dans une orgueilleuse indépendance. L'intérêt des villes se lie étroitement ici à la prospérité des campagnes ; les productions industrielles sont loin d'être suffisantes pour alimenter le pays. Plus d'une ville en Algérie a considérablement décru, parce qu'elle a trop compté sur des éléments de richesse transitoires, parce qu'elle n'est pas assez attachée aux intérêts de l'agriculture. Sans nul doute, il nous importe au premier chef de constituer l'agrégation politique : il est certain que c'est par-là qu'on devrait commencer, par-là que l'on pourrait utiliser de la façon la plus efficace le concours des forces individuelles et de la richesse publique.
Mais, en attendant, faut-il que, seuls en Algérie, nous laissions dans l'inertie le puissant levier de l'association civile ? Nous sommes les seuls, peut-être, qui n'ayons pas encore songé à utiliser cette force : des banques agricoles, des sociétés diverses ayant pour but l'intérêt de la propriété rurale existent sur divers points de l'Algérie ; si elles n'ont pas atteint partout leur but, au moins est-il que l'expérience en a été faite dans toutes les villes importantes. Nous seuls, peut-être, restons ; étrangers à ce travail de progression.
Pourquoi cette indifférence ? N'y a-t-il donc rien à faire ici, et des travaux importants, d'une incontestable utilité, n'appellent-ils pas : depuis longtemps les capitaux ! N'y a-t-il pas aux environs de la ville, dans l'aménagement des eaux, une opération essentiellement utile au bien commun et aux intérêts de ceux qui l'entreprendraient ? Ne peut-on pas pallier, dans une certaine mesure, l'insuffisance des budgets ? Et l'autorité centrale, à laquelle on reproche l'absorption des divers pouvoirs, n'est-elle pas en droit elle-même de nous reprocher notre propre inertie ? Notre ville ne saurait certainement rester étrangère au mouvement qui s'opère. Elle doit se montrer à la hauteur de l'avenir qui lui est réservé.
Ainsi, que l'a fait observer un publiciste distingué, notre ville doit être nécessairement un des points d'intersection de l'ancien et du vieux continent, lorsque l'isthme de Suez servira de passage au commerce européen ; le magnifique port, dont les travaux sont en pleine activité, sont une preuve de l'importance que l'administration attache à notre ville. Il faut donc que nous nous mettions à la hauteur de la situation, que notre ville soit l'entrepôt d'une vaste exportation. Nous y arriverons par l'association.
L. DUBARBlER.
Bône, le 22 décembre 1868.
|
|
PHOTOS D'ALGER
Par DIVERS
|
BORDG - FORT DES 24 HEURES, 1835

TOMBEAUX JUIFS, 1830

CASERNE DE LA SALPETRIERE, 1837
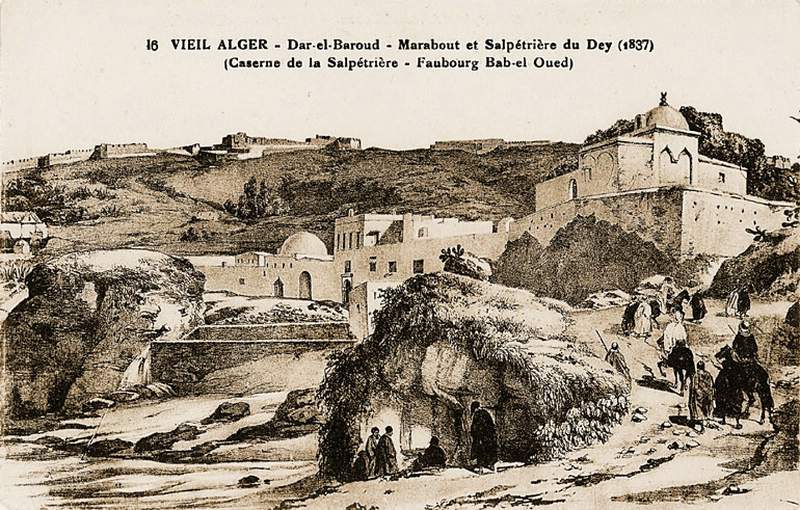
RUE DUMONT D'URVILLE, 1830
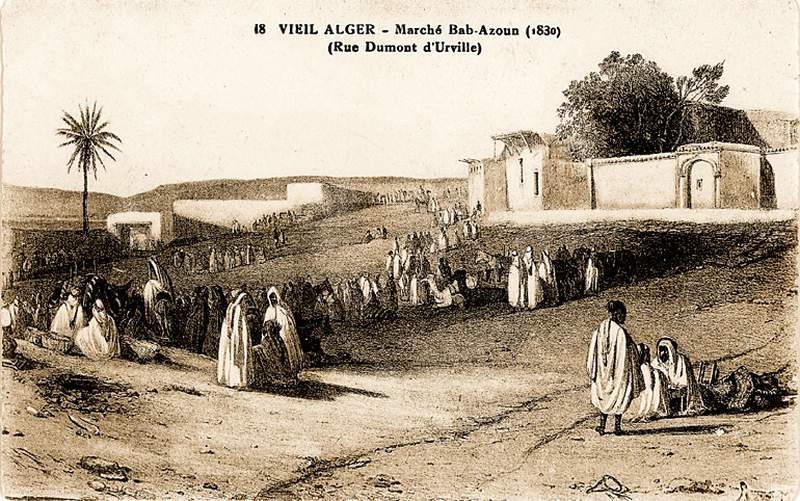
PORTE BÂB EL OUED,1830
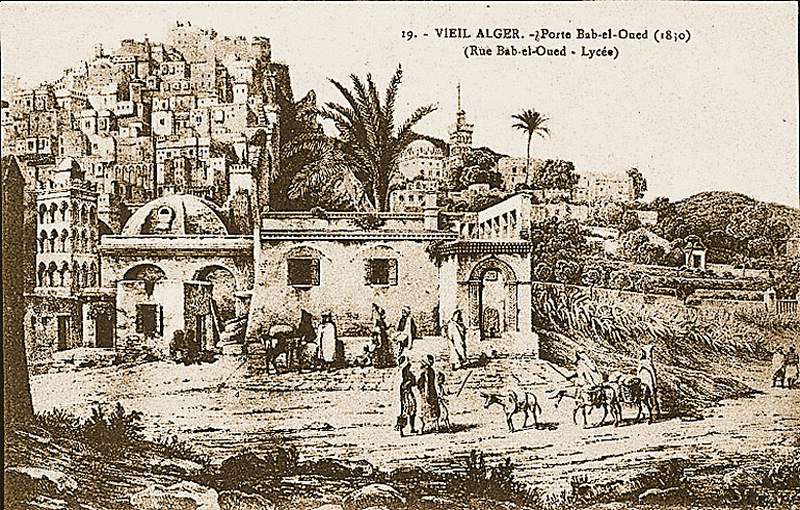
PORT ET MÔLE

|
|
| LE SANG DES RACES
Par LOUIS BERTRAND
Source Gallica
|
IV
TANIT
pages 44 à 53
L'aube se levait sur le golfe, et, dans la grande lueur de nacre qui s'étendait à l'Orient, les feux lointains des phares commençaient à pâlir. Derrière les montagnes de Kabylie, par delà les brumes de la mer, on sentait la montée irrésistible du soleil émergeant des abîmes. Puis, une fraîcheur émut les verdures, un flot de lumière pâle s'épandit, gagna tout l'horizon. et ce fut un premier jour crépusculaire, d'une blancheur morte. Les montagnes sans une ombre se dressèrent, avec la netteté d'une image, peinte au-dessus du miroir des eaux, immobile et gris comme un lac de plomb. I'atmosphère était si diaphane qu'on voyait trembler à la surface les filets des pêcheurs. Les voiles triangulaires de barques, planant sur la mer, semblaient de grands oiseaux arrêtés dans leur vol.
L'Orient, de plus en plus limpide, baigna d'une clarté douce les crêtes du Sahel, puis il se fonça d'une couleur de saphir. Les fronts blancs des villas luisaient dans la mousse tendre des feuilles. Les maisons de la haute ville resplendissaient comme une neige au soleil levant. Du côté d'El-Biar, les cloches du Carmel tintèrent, et un clair Angélus descendit sur Alger, les montagnes et la mer.
Tout a coup, un bruit de grelots se tit entendre dans la côte de Birmandreis. Des claquements de fouet, des jurements lancés à pleins poumons réveillèrent les échos de la tranchée et un grand tumulte de chariot, en marche fit sortir le cabaretier de la Colonne. C'était Rafael et les équipages de Pierangélo.
Quand il fut au sommet de la côte, et quand il vit à ses pieds Alger et la mer, dans la fraîcheur matinale de ce jour d'automne, il fut pris d'allégresse. La ville le ressaisissait avec les ondulations féminines de ses rivages.
Depuis longtemps il se réjouissait de ce retour. Il avait passé tout un mois à l'hôpital de Djelfa, ayant reçu un coup de pied de mulet, qui lui avait fendu le menton et brisé les dents. Pour fêter sa guérison, il avait projeté toute une journée de plaisir avec son ami Pépico, qui, sur ses conseils, avait pris, l'année d'avant, la succession de Victor le Marseillais. Pépico, plus attaché à sa ville et la regrettant toujours, l'excitait par le flux de ses paroles. Tous deux, d'ailleurs, venaient de subir un rude été et, chose étrange. surtout chez Rafael, si épris de sa route de Laghouat et de son équipage, ils sentaient l'un et l'autre un profond dégoût de leur métier, avec une irrésistible envie de tout planter là.
La fatigue et le labeur écrasant avaient mûri précocement leurs visages. Bien qu'ils n'eussent que vingt ans, ils paraissaient maintenant des hommes faits. Les petits yeux malicieux de Rafael s'étaient enfoncés profondément ; la peau brûlée par les coups de soleil était devenue presque noire, et, avec ses moustaches incultes et son menton fendu par la cicatrice récente, il avait l'air d'un ancien de la route. Ses membres s'étaient épaissis. Il avait déjà les bras et la poitrine de son père, et, comme lui, il aurait semblé trapu, sans la hauteur de sa taille.
Quant à Pépico, immense et disloqué, il était devenu encore plus maigre. Sa petite tête aux moustaches énormes, oscillante au bout de son grand corps, était sèche et hérissée comme un chardon, si bien que Rafael l'appelait à tout propos " tête de marron ", un mot qu'il avait entendu dire à des soldats du train.
Les chariots entrèrent par la porte d'Isly avec un grand fracas. Rafael et Pépico firent claquer leurs fouets pour s'annoncer. Des camarades du Faubourg, qui passaient sur des camions, leur envoyèrent des saluts. La joie de l'arrivée était complète.
Ils étaient occupés à dégarnir les bêtes avec l'homme de peine, lorsque Pierangélo arriva, suivi du patron de l'auberge. Des commandes pressées avaient été faites avant leur retour :
- Vous savez, vous autres ?... On charge l'après-midi, et nous repartons ce soir...
- Comment, ce soir ! dit Pépico, les bras ballants de stupeur.
- Oui ! Tâchez d'être ici sitôt déjeuné...
Pierangélo tourna les talons, pressé d'aller en ville chercher les lettres de voiture.
- Nous repartons ce soir ! répétait Pépico furieux... Celui-là qui veut partir, qu'il parte ! moi, je ne pars pas !
Rafael n'avait rien dit. La colère lui montait peu à peu :
- Eh bien ! tiens, va te promener... Moi non plus, je ne travaille pas !...
Il jeta violemment le collier qu'il avait sur la tête.
Immédiatement ils décidèrent de s'habiller. Ils tirèrent leur sac à linge du chariot, et, quand ils se furent changés, ils le confièrent au garçon d'écurie. De là, ils allèrent au café voisin, où, tout en prenant l'absinthe, ils se firent cirer les bottines par deux petits Arabes. Ensuite ils se complurent entre les mains du coiffeur, qui les rasa, les peigna, les parfuma.
Rafraîchis, débarbouillés de la poussière de la route, marchant à petits pas sur la pointe de leurs bottines à talons hauts, balançant les plis de leurs blouses, ils descendirent vers la rue Bab-Azoun, et, chemin faisant, ils décidèrent d'aller déjeuner à la Pêcherie.
C'était la grande débauche des charretiers. Manger des choses fraîches, surtout du poisson, leur semblait une volupté au prix des salaisons et des conserves qu'ils avaient l'habitude de manger en route.
Rafael et Pépico s'installèrent au restaurant des Pancas, sous les voûtes du boulevard. Ils s'allongèrent paresseusement sur leurs chaises, le visage en fête. Tout les surprenait et les ravissait : le garçon avec son tablier blanc, la, pénombre de la salle voûtée, où se reposaient leurs yeux, et, tout à côté, le ruissellement de l'eau qui coulait sans cesse sur les étals de marbre de la poissonnerie.
En gobant ses praires et ses clovis, Rafael ne put s'empêcher de dire :
- Tout de même, ce n'est pas bien de quitter Pierre comme ça...
- Quelle musique est-ce que tu nous sonnes?... Est-ce qu'il n'en trouvera pas trente mille pour nous remplacer ? Ce n'est pas ça qui manque, non ! Le vin blanc acheva de les étourdir.
Quand ils sortirent du restaurant, Pépico, en gaîté, apostropha les marchandes d'oranges, qui se tiennent sous des parasols dans la montée de la Pêcherie : ce qui fit un cercle autour d'eux. Rafael commençait à se fatiguer de ses sottises.
En haut de l'escalier, ils se heurtèrent à Pierangélo qui les cherchait.
- Eh bien ! quoi ? on ne travaille plus ? interrogea celui-ci, en affectant un ton détaché.
- On ne travaille plus ! reprit Pépico avec son rire de fou.
- Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ?... On donne une raison, au moins !...
- Pour rien !... Parce que je ne travaille plus !
- Voyons ! toi, Rafaelète, qui es sérieux, pourquoi est-ce que tu quittes l'équipage ?...
- Est-ce que je sais, moi ? une idée qui m'a pris !...
- Mais tu dois avoir un motif !...
- Qué, un motif ?... Mon motif, c'est que je ne travaille plus, voilà !
Rafael dit cela très tranquillement, mais sans regarder Pierangélo, car il était un peu gêné. Pierangélo, qui n'en était pas à sa première expérience, vit tout de suite qu'il n'y avait rien à faire. Cependant, comme il regrettait Rafael, il répondit sans se fâcher :
- Alors, à ton idée, mon ami !
Il ajouta, en s'en allant, avec un petit rire dans la voix :
- Quand vous serez disposés, vous viendrez m'avertir...
Il partit, de sa démarche placide, comme si de rien n'était.
Rafael et Pépico restèrent à se consulter sous l'horloge de la mosquée. Au fond, ils étaient fort embarrassés, et ne savaient ni où aller, ni quoi faire pour tuer le temps.
Alors Rafaël, qui fouillait au fond de ses poches, finit par dire à son ami :
- Moi, je m'en vas au Faubourg : j'ai de l'argent à porter à la vieille...
Pépico se récria :
- Si tu vas chez ta mère, adieu le plaisir ! Pour sûr, tu ne reviens plus...
Au même moment une voiture découverte passait au trot, venant de la rue de la Marine. Le cocher se tourna vers eux en agitant son fouet :
- Hé Chico!
C'était Pascualète le Borrégo, qui, s'étant brouillé avec son patron de la minoterie, s'était décidé à prendre une voiture de place. Il se renversa en tirant sur les rênes pour faire arrêter le véhicule, tandis que Rafael et Pépico s'approchaient, puis, ayant sauté à bas de son siège, il embrassa paternellement Rafaël : il y avait si longtemps qu'il ne l'avait vu ! Il l'appelait Rafaelète, avec des intonations câlines.
Et le Borrégo tournait autour de Rafaël pour l'examiner en détail. Celui-ci rayonnait : il était fier de ces compliments d'un ancien, et puis Pascualète lui rappelait le temps de son père et ses folies d'autrefois.
- Et où est-ce que vous allez comme ça ? demanda le Borrégo ?
- Est-ce qu'on sait ? dit Pépico.
- On s'embête ! dit Rafael.
- Montez dans ma voiture ! Je vous emmène près du Jardin d'Essai, à l'Oasis des Palmiers. Il y a toujours des Mauresques par là...
Il clignait de l'œil d'un air malin, et il les poussa dans la voiture.
Ce Pascualète, c'était toujours le même que Rafael avait connu, aussi enragé de plaisir que du temps de Ramon, resté jeune comme à vingt ans ! Quoique devenu cocher, il avait conservé son costume de roulier, et, sur le siège, sa grande blouse flottait au vent :
- En voilà un métier ! disait-il à Rafaël, tout en gesticulant avec son fouet.
Servir les gens riches, moi, ça ne me va pas ! Un jour ou l'autre, vois-tu, je vas partir avec toi pour Laghouat... Ah ! cette route-là, il faut que je la revoie, il faut que je retourne, là-bas !...
- Pascualète tendait son fouet vers le Sud. Et comme Rafael riait :
- Tu es jeune, toi, Chico ! Tu ne sais pas ce que c'est l'amour qui vous prend pour une route !...
Ils traversèrent ainsi Alger et Mustapha,
- Rafael et Pépico tout heureux de se carrer au fond de la voiture.
A l'Oasis des Palmiers, on prit cérémonieusement une absinthe, mais on ne trouva pas les Mauresques promises. L'ennui commençait à peser, malgré les efforts de conversation du Borrégo.
Alors, on remonta en voiture, et l'on se mit à battre les cafés de Belcourt. Ce fut une promenade lamentable : ou bien les cafés étaient vides, ou bien l'on tombait sur des tablées de Piémontais et de Provençaux. On ne se connaissait pas, on ne se comprenait qu'à moitié, et les amusements n'étaient pas les mêmes.
Finalement, Pascualète décida d'aller chez un ancien charretier de la Route, qui tenait un débit à l'autre bout du Champ-de-Manœuvres. Ils trouvèrent le Salvador, le Grand-Philippe et le Papas, en compagnie de deux Piémontais, qu'ils avaient connus autrefois à Philippeville.
L'un des Piémontais, Cecco, fit asseoir Rafael à côté de lui. Il prétendait l'avoir rencontré autrefois dans la province de Constantine, bien que celui-ci n'en eût gardé aucun souvenir. C'était un type de Gaulois, courtaud et trapu, aux fortes moustaches blondes. Il gesticulait et parlait sans cesse. Des plaisanteries et des couplets banals sortaient intarissablement de ses lèvres ; mais le rouge de son sang semblait faire un rayonnement autour de lui, la gaîté s'épanchait de ses yeux, refluait avec les mouvements de son corps, comme la chaleur autour d'un brasier. Effacé, perdu dans la vie exubérante de son frère, l'autre, Mini, avec sa face rose et ses yeux bleus d'enfant, ne quittait pas son maintien taciturne et regardait son aîné d'un air d'admiration craintive. Quelquefois il ouvrait la bouche, mais les mots s'embarrassaient, et il achevait la phrase ébauchée, en dessinant des gestes avec sa pipe.
Quand il sut que Rafael et ses compagnons venaient de l'Oasis des palmiers, Cecco, qui connaissait le patron, proposa d'y retourner et d'y dîner tous ensemble, Pascualète fit avancer sa voiture, où l'on s'empila. Pendant ce temps Cecco dit quelques mots à l'oreille de son frère, qui fit un signe d'assentiment et qui disparut sans que personne l'eût seulement remarqué.
Ils dînèrent à une grande table, devant la mer. Sur la fraîcheur des eaux, dans la lumière froide du couchant, Alger déployait devant eux ses maisons blanches et les voiles de mauves de son ciel.
Il y eut d'abord un moment de gêne et de silence parmi les hommes attablés, sans doute à cause de l'inaccoutumance des lieux et de la beauté du spectacle. Mais les plaisanteries et les rires de Cecco revenant à la charge emportèrent le nuage. Sa joie de vivre gagnait les autres et faisait circuler comme une trépidation dé plaisir.
Par bravade, il se gorgeait de nourriture et buvait à même les bouteilles. Il renversa son verre et donna un coup de poing dans son assiette pleine pour le plaisir d'inonder la nappe et les pantalons de ses voisins. Il lançait des morceaux de pain aux singes, qui s'agitaient au bout de leurs chaînes dans les branches des palmiers : les grimaces et les contorsions de ces bêtes les faisaient tous rire aux larmes.
La joie s'exalta. On but davantage. Les gageures commencèrent. Au bord du ciel, la lune apparut en un cerne de cristal, comme le matin quand elle s'amincit dans l'Orient lumineux. Pendant un instant très court, une clarté d'aube flotta sous les branches, les formes des choses s'allégèrent, comme si elles fussent devenues incorporelles, des reflets d'une lumière fluide et blonde se posèrent sur la table et sur les visages. Rafael regarda la tête rouge de Cecco, dont les cheveux s'embrasaient dans le miroitement doré de la lune. Il se souvint de l'arrivée triomphante de la pointe du jour, et, confusément, dans les profondeurs de sa mémoire, il revit des levers d'aube tout pareils, là-bas, au milieu des sables, sur la route de Laghouat, quand, aux côtés du chariot, après la nuit étouffante, il se sentait baigné de fraîcheur et de lumière. Sa joie déborda, tandis que les paroles et les rires exultaient autour de lui. Salvador chantait une chanson de son pays. Alors, excités par le chant, soulevés par les flots de clarté douce de la lune, qui maintenant resplendissait, ils décidèrent tous ensemble de monter " en bombe " à la Casbah.
On s'entassa de nouveau dans la voiture du Borrégo, et l'on partit à fond de train vers Alger. En passant devant un champ de roses, Salvador fit arrêter les chevaux, et, aidés du Papas, il se mit à arracher les fleurs à poignées. Ils en plantèrent entre les oreilles des chevaux, ils en décorèrent les lanternes de la voiture, des brassées s'amoncelèrent dans la capote rabattue comme une corbeille. Ils se disputèrent les plus belles, dont ils fleurirent leurs, chapeaux et les poches de leurs blouses.
Puis l'attelage, avec ses fleurs, ses rires et ses cris, fila plus vite dans la poussière.
Quand ils furent en ville, le Borrégo poussa ses chevaux au milieu de la cohue des voitures, des tramways et des corricolos, faisant au passage des paris de vitesse avec les cochers, ses camarades. Et ainsi la fièvre de la course exaspérait la folie de plaisir. Les rues étaient pleines de promeneurs, poussés dehors par la douceur de la nuit : à mesure qu'on avançait vers les portes, ils devenaient une foule. Par les fenêtres des hautes maisons violemment éclairées, des pianos, d'étage en étage, déversaient à flots des musiques vulgaires.
De temps en temps, des voix de femmes, chantant des airs d'opéra, dominaient le bruit. La lumière de la lune était si claire que les maisons et les passants semblaient se réfléchir dans la poussière de la rue, comme des images sur une glace.
En arrivant aux Tournants Rovigo, Pascualète fut obligé de laisser souffler ses bêtes à cause de la montée. Les promeneurs devinrent plus rares. De loin en loin, l'éclairage violent des bars faisait une tache lumineuse, sur le trottoir ; et, des étages des hautes maisons, les ritournelles des pianos s'épanchaient encore.
Un bruit d'orgue arriva par la porte d'une boutique basse, que masquait un rideau de couleur sombre. A l'entrée, une salutiste en chapeau-cabriolet distribuait des brochures.
Des voix chantaient : Redites-nous, redites-nous l'histoire, L'histoire de Jésus ! et la bande ivre des charretiers entendit soudain le refrain du cantique qui s'élevait avec ferveur, comme si la molle influence de la nuit eût exalté aussi les misérables entassés dans ce taudis.
Cecco lui-même se tut un instant. Une lassitude sembla peser sur l'émoi des chairs et le tumulte des pensées. Les façades des bâtisses neuves déployaient leurs rangées plus sombres. Les grelots des chevaux et le frottement des roues s'entendaient seuls.
Devant un café, des zouaves étaient attablés. Une voix de femme, qui chantait une romance populaire, traversa la rue, s'exaltant à mesure, avec une sorte de rage.
Celle-ci était assise sur le seuil, les cheveux épars sur les épaules. C'était la patronne de l'estaminet. Cecco, qui s'y arrêtait souvent, en descendant de Staouëli, la reconnut.
- Qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à chanter comme ça ?... dit Rafael.
- Ah ? dit Cecco, avec son gros rire, son mari l'a lâchée : c'est le regret qui la pique !...
La voiture fila, emportant les jeunes gens en habits de fête. Aussitôt la voix s'infléchit en modulations plus hautes, et, comme si elle voulait atteindre l'équipage en fuite, elle bondit vers eux, les soulevant à leur tour et les enveloppant de son chant de folie. Alors, tous ensemble, ils reprirent le refrain en chœur. Pascualète, fouettant ses chevaux, les lança au galop. Ils émergèrent au dernier tournant, en face de la coulée lumineuse du boulevard en étages, d'où l'on voit jusqu'à la mer et jusqu'au promontoire.
Le ciel libre se déploya au-dessus de leurs têtes. Pascualète, le bras levé, lança l'attelage sur le boulevard de la Victoire, tandis que, sur les portes des cabarets, des voix d'ouvriers répondaient au refrain de la femme, repris sans cesse par Salvador, et qui, se répandant d'un bout à l'autre de la rue, semblait grandir avec l'élan de la course. Au tournant de la route, la mer apparut de nouveau au bout de l'avenue toute droite qui s'enfonce vers les anciens remparts. La grande surface miroitante semblait s'élargir au pied d'une roche à pic, et l'on eût dit que la voiture, emportée par le Borrégo, allait s'abîmer dans la mer.
La garde de la voiture fut confiée à un petit Arabe en guenilles. Puis la bande, fleurie de roses, descendit le long des vieux remparts turcs vers la plate-forme de la rue Catarouggil.
Par une brèche largement ouverte, mer se déploya encore, la colline de Notre-Dame d'Afrique dressa son ombre au-dessus des maisons de Bab-el-Oued, et, vers Saint-Eugène, un triangle lumineux scintilla.
Rafael s'arrêta devant la brèche pour regarder le Faubourg. Il songea à sa mère et, avec le remords de ne pas l'avoir encore vue, une tristesse confuse le prit devant ces toits et ces chemins encore tout pleins de son enfance.
Il fut obligé de se hâter pour rejoindre ses camarades. Ceux-ci, suivant la coutume, firent une pose sur la plate-forme. Une foule hurlante de marins s'y pressait. C'étaient des Américains du Nord arrivés de la veille. Les charretiers trouèrent la cohue, en se carrant dans leurs blouses, et, tandis que le Papas et le Grand-Philippe s'accoudaient sur le parapet, Salvador et Cecco, tendant le ventre et lâchant des plaisanteries grossières, se campèrent insolemment devant ces étrangers. Rafaël, assis sur le parapet, roulait une cigarette, un peu gêné par deux matelots à visages d'enfants qui, assis comme lui, regardaient la ville et la mer, en faisant des gestes et en parlant très haut. Les bras levés, ils ouvraient des yeux éblouis vers l'espace.
La lune épandait sur le golfe de grands voiles d'ombre transparente ; et, descendant de terrasse en terrasse, jusqu'aux plages endormies, les maisons de la ville resplendissaient comme des blocs de diamant.
Depuis la mosquée de Sidi-Abd-er-Rhaman jusqu'aux feux de la côte, les vastes ondes sidérales semblaient rouler comme des moires à travers l'étendue et submerger les choses avec le mouvement doux des vagues par les temps calmes.
Le long des vieilles rues en ruines, un flot d'hommes montait au milieu de la clameur des voix. Les galons blancs des marins se distinguaient dès le tournant des escaliers. Il en venait sans cesse, comme si la mer eût bondi vers la colline. Des jeunes gens en chemises de couleur claire traversaient la masse d'ombre des uniformes.
Précédés d'un joueur de guitare, ils se tenaient par le bras, et, se renversant la tête, d'un air enivré, ils lançaient à plein gosier la chanson du Toréador. Eux aussi ils montaient vers la maison d'amour, en quête de joie et d'exaltation, et, leurs voix tremblantes, unies aux cris des matelots, aux appels des enfants et des femmes sur les terrasses, ils exhalaient tout le chant de la ville vers la beauté de la nuit.
Un remous se fit sur la plate-forme. Des marins en foule compacte envahirent l'étroit espace, bousculant Rafael et ses compagnons, et le flot se précipita dans la rue Catarouggil. Les charretiers entraînés suivirent, sentant leur colère monter contre ces gens en uniforme qui venaient leur disputer le plaisir et qui faisaient les maîtres.
On s'étouffait dans l'étroit boyau de la petite rue arabe. Toutes les portes étaient fermées, comme aux jours de grand branle-bas, quand les artilleurs ou les marins de la flotte se répandent dans, la haute ville.
Des attroupements se formaient, les matelots se disputant avec les femmes et se fâchant de n'être pas compris. Salvador indigné voulait fendre la presse, excitait ses camarades contre les marins. La colère s'amassait lentement.
La salle où ils entrèrent était formée par le patio d'une ancienne maison mauresque. Des femmes, en costumes extravagants, étaient assises devant le comptoir où trônait la patronne. Dans le fond, des quartiers-maîtres et des gabiers du bateau américain buvaient et jouaient avec des filles.
Par prudence, la patronne voulut faire entrer les nouveaux arrivants dans une salle latérale. Mais ils s'obstinèrent à rester là et s'installèrent à une table voisine des Américains. Les femmes, s'empressant autour de ceux-ci, leur faisaient dire des obscénités en anglais qu'elles s'efforçaient de répéter en poussant de grands éclats de rire étudiés. Au milieu des groupes, posant pour elles et pour ses camarades, un gabier, un grand jeune homme pâle et blond, exténué comme un fumeur de kif, se raidissait dans son ivresse pour se tenir debout. Il étalait une énorme rose blanche à sa vareuse. Avec des gestes énervés et une ondulation continue des hanches, il entonna sur un ton ridiculement sentimental, une romance allemande.
Aussitôt une femme se leva de son tabouret, et, passant son bras autour de la taille mince du marin qui chancelait, elle se mit à l'accompagner d'une belle voix claire. C'était une Allemande de Kustrin, qui se donnait pour Alsacienne. Rendue sérieuse tout à coup par ce chant du pays natal, ses yeux s'illuminaient. Elle fit taire impérieusement ses camarades, qui agaçaient les matelots et, enlacée au marin frêle, elle modula le refrain, la gorge renversée, comme une chanteuse sur un théâtre.
Cette pompe déplut aux charretiers. Ils s'irritaient de ne pas comprendre les paroles, et cette tristesse du Nord pesait sur leur joie et les choquait comme un défi. Mais surtout ils en voulaient aux Américains de leur prendre les plus belles femmes. Ils ricanaient sous les yeux indignés de la Prussienne, et leurs regards, croisant ceux des matelots, les insultaient de loin.
Alors celle-ci, sans quitter la taille du gabier, lança tout à coup le premier couplet de la Wacht am Rhein. Ses yeux et ceux du matelot se rencontrèrent et se comprirent. Fiers de parler une langue incomprise des autres, ils unirent plus étroitement leurs mains et, devant la haine grondante qu'ils sentaient autour d'eux, ils redoublèrent l'ardeur belliqueuse de leur chant.
Cecco, que les Américains exaspéraient davantage, demanda brusquement à une grosse fille assise à côté de lui :
- Qu'est-ce qu'ils chantent ceux-là ?... ils nous embêtent !
- Tu ne vois pas ça ! dit la fille avec un air de supériorité, c'est des Allemands !
- Des Allemands ! reprit Cecco... Ah ! Sauta Madonna ! J'en ai trop vu, quand je travaillais au tunnel du Gothard..., je te le dis, moi, il n'y a pas de plus sales bêtes !...
Cecco se rappelait une bataille entre Allemands et Piémontais. d'où son frère était sorti avec une côte brisée. Il s'irrita davantage en voyant sa préférée prendre entre ses mains les joues d'un matelot pour s'amuser de la grimace de son visage ainsi déformé. Il lui cria, sans égard pour les deux chanteurs :
- Dis donc, toi !... Si tu venais ici un peu !...
Le Grand-Philippe, qui, le coude sur la table, écoutait avec beaucoup d'attention, lui dit vivement : - Tais-toi, Cecco! Tu vas attirer du scandale...
- Mais le matelot caressé par. la fille s'était levé, les yeux en fureur. C'était un quartier-maître tout fier de ses galons. Il empoigna son tabouret et le lança contre Cecco. Celui-ci, se baissant, esquiva le coup.
Tous les charretiers se levèrent au milieu des clameurs des femmes. La patronne se précipitant du comptoir, essaya de s'interposer. Mais Pascualète le Borrégo la poussa dans l'escalier avec la cohue des filles. Affolées, elles grimpèrent les marches quatre à quatre et coururent se barricader dans leurs cellules.
Cependant le patron, attiré par le bruit, était descendu. Dans la crainte qu'il n'allât chercher la police, le Grand-Philippe le prit par les épaules et l'enferma dans la cuisine. Un épouvantable tumulte emplissait la salle.
Les Américains avaient tiré de leurs poches des couteaux et des coups de poing. Les tabourets de bois volaient sur eux, mais faisaient moins de mal que de bruit. On s'observait de part et d'autre.
Le Papas indécis frôlait les murs et épiait la bataille, se demandant s'il devait s'esquiver. Soudain Pépico, qui avait guetté l'instant, se retourna et détacha un violent coup de savate au joli chanteur à la rose blanche. Celui-ci, atteint au ventre, tomba de tout son long. Au même moment, Rafael prit un siphon sur le comptoir, le lança de toutes ses forces à la tête d'un gros matelot roux qui fonçait sur les charretiers, le couteau levé.
Cette idée de Rafael fut pour le Grand-Philippe la révélation de toute une tactique.
Il fit se serrer ses camarades autour du comptoir, où s'alignaient des rangées de siphons. Le Papas, barricadé derrière le fauteuil de la patronne, en faisait passer au combattant. Un dans chaque main, Pascualète se rua contre les matelots. Sans prendre garde aux couteaux, il se mit à assommer à droite et à gauche. Appuyé par Cecco, qui brandissait aussi des siphons, il abattit les plus robustes. Pépico, d'un coup de savate, faisait sauter les couteaux des mains de ceux qui résistaient encore, tandis que le Papas, se coulant entre leurs jambes, les renversait d'un mouvement d'échine.
Rafaël maintenait sous lui le quartier-maître qui avait attaqué Cecco. Il finit par s'asseoir sur sa poitrine.
- Attache-le ! cria Salvador, qui n'osait pas trop s'engager.
Il tira de sa poche des mèches de fouet et les tendit à Rafael.
Mais Pascualète et Cecco avaient acculé les trois derniers dans un angle de la salle. Ils étaient furieux l'un et l'autre. Cecco se prit corps à corps avec un des matelots, une espèce d'hercule beaucoup plus grand que lui. Il réussit à lui emprisonner les bras entre les siens et, plongeant dans les yeux hagards de l'Américain ses yeux fous de haine, il lui mordit l'oreille comme un chien et, d'un coup sec, il la déchira.
Exaspéré par la douleur, le matelot se renversa sur Cecco, qu'il aurait étouffé, si le Papas ne fût venu au secours de son camarade. Cecco, dégagé, lui ficela les poignets avec des mèches, à lui couper les veines. Pendant ce temps les autres entassaient des tables et des tabourets, de manière à former une barrière entre eux et les Américains.
- Maintenant, filons, dit le Grand-Philippe, avant que la police arrive !...
Les charretiers s'engouffrèrent dans le vestibule. Le Grand-Philippe tourna prestement la clef dans l'énorme serrure. Ils franchirent le seuil en avalanche. Après quoi Philippe referma la porte et jeta la clef dans une ruelle en cul-de-sac. Tout était plus calme maintenant. Minuit venait de sonner, et les matelots étaient redescendus vers le port. De loin en loin des zouaves permissionnaires erraient encore et des groupes de jeunes gens à mandolines.
Les charretiers étaient les maîtres de la rue. Encore frémissants de l'émoi de la bataille, ils parlaient très haut et gesticulaient, se racontant les coups donnés et se montrant leurs blessures. Cecco avait une légère éraflure sous l'œil droit et une forte entaille au pouce. Comme il saignait beaucoup, il dut se laver à une fontaine et s'envelopper la main dans son mouchoir. L'admiration des autres l'entourait ; mais on se pressait surtout autour de Pascualète, on lui frappait sur l'épaule en signe de reconnaissance. Salvador, par ostentation, lui passait le bras autour du cou et redisait en paroles abondantes et magnifiques la bravoure du vieux.
Cette attitude choqua Rafael, qui se rappelait le rôle un peu mince de Salvador pendant la bagarre. Son admiration pour lui en fut ébranlée. Mais ce ne fut qu'une impression très rapide. L'ardeur de son sang l'emportait. Des images de bataille et de volupté grandissaient dans sa tête, Cecco lui prit le bras violemment et cria aux autres :
-Allez L.. aux Espagnoles maintenant !
La voix ivre de Cecco passa sur la bande comme un vent de luxure. Un grand cri farouche répondit. Les charretiers s'ébranlèrent ; ils remontèrent la rue enlacés. soulevés par les mêmes visions et la même force, comme un régiment en marche. Des Mauresques les arrêtèrent, des bras se nouèrent à leurs cous, se pendirent à leurs blouses, des mains les poussèrent. Ils montèrent précipitamment les petits escaliers en colimaçon, butant aux angles des marches, jusqu'à ce qu'ils émergèrent à la clarté épanouie de la terrasse.
Emues par le sang qui souillait leurs visages et leurs mains, les femmes les tirèrent brutalement vers les cellules. Des couples se formèrent. Ils s'éparpillèrent peu à peu dans la maison obscure et, le tumulte s'éteignant tout à coup, il y eut une minute de grand silence.
Puis, quand ils reparurent, se retrouvant face à face, ils furent repris par leur besoin de crier, de se répandre et de détruire. Ils salirent avec leurs souliers les tapis des femmes. ils se vautrèrent sur leurs coussins. Cecco ayant pris sur une étagère une petite tasse en verre doré la lança violemment contre le dallage. Aussitôt une robuste fille aux bras cerclés de bracelets se précipita sur lui, en poussant des cris aigus et en ameutant les autres femmes. Des voix glapirent, des injures arabes déchirèrent les gosiers. Une vieille, la gorge tremblante, parut sur le seuil. Elle faisait des gestes tragiques et des hurlements. Elle menaçait les charretiers de la police. leur reprochait leur brutalité. Cecco, par dérision, se mit à la lutiner. Alors elle saisit dans un coin une bouteille de pétrole et elle la brandit maladroitement au-dessus de sa tête, cherchant à le frapper. Cecco la désarma. la repoussa avec les femmes sur la terrasse et ferma vivement la porte en entraînant ses camarades.
Ils redescendirent l'escalier, se cognant aux murs étroits. Mais la porte se rouvrit aussitôt. des bouteilles se mirent à pleuvoir derrière eux avec des malédictions et des cris. Quand ils furent dehors, - par les lucarnes de la maison, les femmes exaspérées leur jetèrent de nouvelles injures. Le Papas, se retournant, agita avec un geste de moquerie un mouchoir de soie qu'il leur avait volé.
On était à deux pas des Espagnoles. Rafael se précipita dans le vestibule, suivi de toute la bande. Les femmes, en les voyant, avaient poussé des cris et les conviaient à entrer.
Ils entrèrent tout d'un coup. Elles allèrent à eux cérémonieusement, quelques-unes prenant la main de ceux qu'elles connaissaient. Puis chacune flanquant un des hommes, le bras appuyé sur son épaule, elles descendirent avec lenteur l'escalier du sous-sol, en cambrant leurs tailles et en espaçant de marche en marche leurs jupons de ballerines.
Salvador, reconnu par deux femmes, se pavanait au milieu des caresses.
- Tu fais danser ? dit l'une d'elles, en l'embrassant.
Salvador, avec ses idées de grandeur, proposa tout de suite de " faire danser les Espagnoles ". Le Borrégo l'appuya, et les autres acceptèrent par orgueil, bien que cette fantaisie coûtât cher.
On les introduisit dans un salon décoré de façon prétentieuse et criarde. Un lustre en verroterie pendait au milieu. Dans le fond. s'ouvrait un petit théâtre.
Bientôt les danseuses parurent en file indienne, dans la nudité de leurs corps grêles qu'exagéraient encore de longs bas de soie noire cerclés au-dessus du genou de jarretières éclatantes. Elles montèrent sur l'étroite scène, où se tenait un musicien coiffé d une casquette de jockey et cachant sous des lunettes bleues ses yeux malades. Le musicien tira un accord de sa guitare. Une grande fille maigre, élevant ses bras nus, fit claquer ses castagnettes et se mit à tourner sur la pointe des pieds. Elle s'accompagnait d'une chanson rauque à la mode arabe. Les quatre autres, élevant les bras à leur tour reprirent le refrain en une clameur aiguë :
La veina de las flores
Por alla mas se va,
Marinera, despliega la vela !
La reine de fleurs
- s'en va vers la haute-mer ;
- marin, largue la voile... .
Orgueilleux de ce spectacle, qui se déployait pour eux seuls, de ces poses et de ces attitudes, qui étaient un perpétuel hommage. les charretiers s'étendaient insolemment sur les divans et sur les tapis. Cecco s'était installé à côté de. Rafaël, qui s'étonnait un peu de l'impétuosité de sa soudaine amitié. Des femmes les tenaient embrassés, les excitaient par leurs baisers et les frôlement sinueux de leur corps. Les jasmins qui se dressaient à la pointe de leurs chevelures, comme le cimier d'un casque, tombaient en neige sur les épaules, et I'odeur molle des fleurs semblait flotter autour des danses.
Tout à coup une grande, vêtue de blanc, avec des cheveux dénoués d'Ophélie, s'avança droit vers Rafaël. Sous son diadème de perles fausses, elle marchait impétueusement, à pas saccadés. comme une reine d'opéra. S'étant assise auprès de lui, elle le baisa longuement sur la bouche et, a voix basse, comme s'il se fût agi d'un mystère, elle lui dit durement à l'oreille :
- Monte !
Mais il l'écarta sans rien dire.
En ce moment les danseuses, ayant quitté la scène s'étaient répandues dans la salle et, glissant sur la sciure humide du dallage, elles continuaient leurs chansons et leurs poses au son de la guitare et des castagnettes. Celle du milieu s'était arrêtée.
Plus maigre et plus brûlée qu'une cigale, elle offrait son corps tout entier, les bras arrondis au-dessus de sa tête, et son ventre onduleux roulait doucement sur ses hanches.
Cependant la femme aux cheveux dénoués ne cessait de baiser Rafael. Il se laissait aller entre ses bras. Ce n'était pas tant un appétit de volupté qui soulevait tout son être que l'essor impétueux de ses pensées. La bataille de tout à l'heure et l'assaut des Mauresques avaient calmé son sang ; mais ses nerfs vibraient toujours et son imagination en fête bondissait vers des choses inconnues.
La femme n'en était plus aux baisers :
- Monte ! dit-elle encore, de sa voix impérieuse et dure.
Il se leva. Sitôt qu'il furent dans la chambre, elle se jeta au cou de Rafaël, et elle recommença à le baiser avec une sorte de frénésie, comme si elle eût voulu aspirer toute sa jeunesse entre ses lèvres. A chacun de ses mouvements, il sentait l'odeur énervante des jasmins qu'elle avait dans sa chevelure.
Puis, avec un élan de joie, elle dénoua tout à coup ses bras et se mit à se dévêtir précipitamment. Son profil, d'une finesse presque immatérielle, semblait luire dans l'ombre, comme le cercle nacré de la lune. Ses joues un peu creuses se coloraient de rose aux pommettes, et son nez busqué se recourbait joliment à l'andalouse.
Rafael, tout en défaisant les tours de sa ceinture, considérait avec attention sur la commode des fruits en cire qui s'élevaient en pyramide sous un globe. Il y vit aussi, dans un cadre de peluche, la photographie d'un homme rasé, qui ressemblait à un valet de cuadrilla. Au milieu, une veilleuse brûlait devant un chromo représentant la Mère des Sept-Douleurs, le cœur saignant sous les épines et la couronne de glaives.
- Regarde ! dit la femme, en le tirant par le bout de la ceinture.
Rafael se retourna. Elle appuyait sur une chaise, son pied chaussé d'un soulier de satin blanc à talon haut, et elle raidissait sa jambe que moulait un grand bas de soie blanche, luisant et lisse comme un ivoire.
C'est joli ! dit-elle. En même temps, elle caressait la cambrure de son pied, Rafaël, ébloui, affecta un grand dédain.
Alors, sautant comme une enfant espiègle, elle fit mille folies. Elle l'embrassa sur les joues, elle écarta le col de sa chemise pour lire le chiffre marqué à son tricot ; ensuite elle le conduisit à la commode et prenant un œillet rouge, qui trempait dans un verre à pied plein d'eau :
- Sens ! dit-elle. Elle approcha l'œillet rouge des narines du jeune homme, puis, avec un geste emphatique, elle le remit précieusement dans le verre.
Les prévenances de cette femme et le luxe de sa personne ravissaient Rafael.
Mais, au fond, ces délicatesses inconnues le gênaient un peu. Il prenait un air impassible et s'abandonnait aux caresses avec une hauteur feinte. La femme, le saisissant à bras le corps, l'entraîna vers le lit que dominait un rideau rouge masquant une fenêtre. Elle se jeta sur lui d'une si violente étreinte et d'un tel emportement de passion que celui-ci en eut presque peur.
Cependant des coups retentissaient à la porte : c'étaient Salvador et le Borrégo qui s'impatientaient. Rafael leur cria des jurons. On entendit la bande s'en aller au milieu d'un vacarme de tabourets remués.
Les castagnettes claquaient toujours, et les femmes, excitées par la danse, répétaient de leurs voix perçantes jusqu'au malaise ..
Marinero, despliega la vela !
Quand ils furent las de plaisir, Rafaël s'allongea contre la muraille, sous la fenêtre rouge, et il sentit la tête de sa compagne s'appuyer sur sa poitrine. Les joues brûlantes de fièvre, elle ne pouvait dormir. De temps en temps elle se soulevait pour regarder le jeune homme qui fermait les yeux.
- Comment t'appelles-tu ? lui demanda-t-elle tout à coup, sans doute pour l'empêcher de s'assoupir.
Quand Rafael lui eut dit son nom
- Moi, je m'appelle Gitana... Puis approchant sa bouche de son oreille ; Veux-tu que je te dise mon vrai nom ?... Juana ! Ma mère aussi s'appelait Tuana - Mon pays, c'est Cadix !... Et elle ajouta, comme se parlant à elle-même :
- Ils sont beaux, les hommes de mon pays !...
Rafael piqué par cette phrase, dont il ne saisit pas bien le sens, la repoussa de sa poitrine, et, comme il faisait très chaud dans la chambre, il tira le rideau rouge, qui masquait la fenêtre entr'ouverte. Le spectacle était si merveilleux qu'il se dressa sur son séant pour mieux voir. Il ouvrit la fenêtre au large. La ville apparut tout entière dans la clarté pâlissante de la lune.
L'horizon semblait immense. Tout au bout du port, Rafael reconnut le navire des Américains qui élevait ses deux cheminées gigantesques et les mille feux de ses sabords au-dessus des eaux miroitantes. Vers les montagnes, à travers les brumes lointaines, les lumières des phares tournaient doucement. Sur les terres voisines, des Arabes étendus dormaient.
Rafael s'ingéniait à suivre les méandres des rues en étages. Mais la Gitana, se pendant à son cou, le fit coucher sur l'oreiller, et, ramenant le drap jusqu'à ses épaules :
-Tu aurais froid ! dit-elle.
Elle poussa la fenêtre et se rejeta sur lui, en l'étreignant. Les bruits de la rue et les chansons des femmes s'éteignaient.
Ils s'endormirent d'un sommeil accablé...
A cinq heures, une horloge qui sonnait en bas réveilla Rafael. Il compta les coups du timbre, puis il tira le rideau rouge. Le jour commençait à poindre, le rebord de la fenêtre était mouillé et l'air matinal était si vif qu'il eut un frisson.
Aussitôt une toux déchirante secoua la Gitana. Rafael, se retournant vers elle, perçut une odeur de créosote et de phénol.
- Ça sent l'hôpital par ici ! En voilà une odeur de choléra !...
La Gitana étouffa sa toux.
- Ça n'est rien ! dit-elle.
Pour qu'il ne vît pas ses yeux en larmes et ses joues blêmes, elle lui baisa le cou avec Un redoublement de ferveur. A ce moment, les Arabes éveillés sur les terrasses se mettaient en prières, et, levant les bras sous leurs burnous, ils se prosternaient vers le soleil.
La Gitana tremblait que Rafaël ne voulût partir. Elle tira le rideau rouge et le prit de nouveau entre ses bras. Puis ils se rendormirent.
Toute la journée, ne sachant que faire, il erra dans les bars et les petits cafés, et finit par s'accouder aux rampes du Boulevard en regardant les bateaux et les camions du port, comme font les ouvriers désœuvrés. Il y retrouva Pépico et Salvador, qui s'étaient fait rosser par les matelots en descendant de la Casbah. On but ensemble, en se racontant les coups, et, parce qu'il était un peu ivre, Rafael n'osa pas aller au Faubourg, voir sa mère. Il retourna le soir chez la Gitana. Le lendemain, avec Pépico, il recommença à traîner par la ville. Il fit des achats extravagants dans les magasins de la rue Bab-Azoun et revint à l'auberge avec deux pantalons de velours et une demi-douzaine de ces chemises de couleur que portent les Maltais et les Napolitains.
Le jour suivant, il était si bien écœuré de cette vie de fainéantise, qu'il s'engagea avec son ami chez Bacanète, dont les équipages venaient d'arriver. Il donna au Borrégo les quatre-vingts francs qui lui restaient pour les remettre à sa mère, et, quand, à deux heures du matin, il reprit la montée de la Colonne, repassant dans son esprit toutes ses aventures depuis son retour, il lui sembla qu'il avait fait un mauvais rêve.
 Louis Bertrand
Louis Bertrand
|
|
| VOYAGE
Par M. Bernard Donville
|
|
Chers amis, Bonjour à tous.
Il était devenu obligatoire pour notre ami hiverneur de pénétrer dans l'antre touristique d'Alger : la casbah.
Nous allons le suivre dans ces cheminements tortueux et exigus à la découverte de ce quartier peu "colonisé". Pour ceux, pas si rares qui n'y ont jamais mis les pieds je vous souhaite une bonne visite (aux autres aussi biensûr!).
Dubouville va s'éloigner de la mer en balade vers le sud. Au départ après la Mitidja il va s'aventurer à Chrea puis les gorges de la chiffa puis...(mais je vais pas tout vous raconter, mettez vos lunettes et participez au voyage!)
Cette fois ci dans un contexte bien connu des algérois mais qui était plus sauvage lors de la visite de l'ami Dubouville. Surtout les hauteurs d'Alger étaient plus sauvages .
Le jardin d'essai était déjà une petite merveille méditerranéenne surplombé par la villa Abd el Tiff.
Bonnes lectures et à bientot
Amitiés, Bernard
Cliquer CI-DESSOUS pour voir les fichiers
5-casbah
6-capausud
7-autour-dalger
A SUIVRE
|
|
| CHAPEAUX POINTUS
De Jacques Grieu
|
|
TURLUTUTU
Le chapeau, pour les dames, est du plus bel effet :
D'ailleurs, " un bon chapeau vaut mieux que cent bonnets " !
Est-ce pour ce doux trait qu'on leur prête des maux,
De " porter la culotte ou porter le chapeau " ?
C'est plutôt chapeau bas qu'on doit les remercier,
Et tirer nos chapeaux, plutôt que les tancer :
Car sous certains chapeaux, des sourires entrevus,
Peuvent faire rêver de mondes inconnus…
Qu'il soit claque ou melon ou à plume ou de paille,
L'essentiel, en chapeaux, est surtout qu'il vous aille.
Son prix est sans rapport avec ce qu'il abrite :
La casquette d'Hitler était presque gratuite.
Bien des écervelées dépensent des fortunes
Pour des chapeaux divers sans inventer la lune.
La reine d'Angleterre en a des collections
Pour choisir sa couleur " collant " à l'occasion...
Pour être bon ministre et être à la manœuvre,
Avaler son chapeau et manger des couleuvres,
Sont les grandes mamelles en savoir politique.
Sur les chapeaux de roues, vire la république…
Ils ne travaillent pas forcément du chapeau,
Modiste ou chapelier allant payer l'impôt !
" Un trou dans le chapeau, un chat dans le troupeau " :
Voilà où peut mener le soleil sans chapeau !
Jacques Grieu
|
|
|
On s'fait un copié collé ?
Par M. Marc Donato
|
En 1959, Louis Arnaud, historien de la ville de Bône, écrivait dans son ouvrage " Bône, son histoire… ses histoires " :
"
Il est certain que, dès la fin de la première guerre mondiale, on a pu assister à une déchéance de la conscience morale… Un désir excessif et urgent de richesse, un trop grand engouement pour une vie extérieure et tapageuse et un trop vif amour de l'argent sont devenus les véritables impératifs des mœurs. Les honneurs et les mandats publics n'ont plus été pour certains, que des degrés qui leur permettaient d'accéder à la fortune, tandis que l'intérêt général et le Bien public devenaient des expressions vides de sens réel peut-être, mais pleines de possibilités ou de promesses de profits personnels. Il y eut, pour l'homme de la rue, des affairistes partout et des affaires louches dans tous les marchés d'entreprise ou de fournitures publiques. Aucun de ces marchés, pour lui, n'était sans dessous de table, bien entendu, sans ristournes, ni pourcentages, ni tantièmes ".
Sans commentaires.
Bien sûr, c'était il y a longtemps. Dieu merci, les choses ont changé.
Et si pour le fun, on s'ferait un p'tit copié-collé ?
Novembre 2022 - Marc DONATO
|
|
ALGÉRIE.
Gallica : Revue de l'Orient 1850(1) pages 180 à 184
|
COLONIES FRANÇAISES.
De la production des huiles en Algérie.
L'huile est un corps gras, dont l'emploi est excessivement multiplié dans l'alimentation de l'homme et dans l'industrie. La production des huiles comestibles est circonscrite dans une localité de peu d'étendue, qui occupe la partie moyenne de notre hémisphère, sous un climat tempéré ou de transition, et qui se trouve comprise entre les 26° et 43e degrés de latitude nord. De chaque côté de cette bande, les huiles que le sol produit rancissent plus ou moins facilement et ont une saveur plus ou moins forte et désagréable ; telles sont, au sud, les huiles que l'on retire des fruits de différentes espèces de palmiers, et au nord celles dites de noix, d'œillette, de caméline, etc., etc.
L'olivier, qui est le végétal qui produit la meilleure huile comestible connue, n'est cultivé que sur la limite nord de la bande que nous avons indiquée plus haut.
Ainsi, le sud de l'Italie, la Provence et l'Espagne sont les seules localités où la culture de l'olivier ait lieu. Mais il faut convenir que cette production est bien loin de suffire aux besoins de la consommation. L'Espagne exporte peu d'huile, et, dans la Provence, la culture de l'olivier est précaire. Cet arbre étant maintenu par la volonté de l'homme sur la limite extrême nord de sa station naturelle, reste chétif et est presque périodiquement détruit par les abaissements de la température.
Par son excessive rareté, l'huile d'olive est toujours chère, et n'est accessible que pour un très petit nombre d'individus. Il est évident que les populations qui sont condamnées à consommer les huiles âcres que le sol produit, y renonceraient bientôt si on leur apportait des huiles d'olive dont le prix ne serait pas plus élevé.
Ce résultat serait infailliblement atteint du moment où l'éducation de l'olivier serait reportée dans la station qui lui est propre. Nos possessions françaises dans le nord de l'Afrique occupent une grande partie de cette station, qui s'étend en longueur, sur notre hémisphère, depuis Ténériffe jusqu'en Syrie. Là, l'olivier croît partout à l'état sauvage ; il est l'essence prédominante du pays, il atteint des proportions gigantesques, que l'on ne peut supposer en voyant les individus souffreteux du midi de la France. En Algérie, on rencontre des oliviers que cinq hommes embrassent à grand peine et qui, chaque année, produisent d'abondantes récoltes.
La culture de l'olivier est déjà avancée en Algérie dans la portion montagneuse que l'on conne sous le nom de Kabylie. Les Kabyles font annuellement des récoltes considérables d'olives, mais ils ignorent l'art de les détriter et ne produisent que des huiles à odeur forte qui ne sont pas comestibles pour nous. Ils laissent fermenter en tas leurs olives ; la plupart du temps ils n'ont aucune machine pour faciliter la fabrication, ou ils n'en ont que de très imparfaites ; ils se bornent à écraser les olives entre deux pierres et à en opérer le pressurage au moyen d'une large dalle ou d'un madrier chargé de pierres. Malgré ces procédés imparfaits qui laissent au moins la moitié de l'huile dans les tourteaux, la Kabylie en produit une immense quantité qui s'écoule au sud et au nord. Une partie est exportée vers l'intérieur de l'Afrique par les caravanes ; l'autre partie se traite dans nos ports algériens et est exportée pour l' Europe.
Il est bon de remarquer en passant que la production de l'huile pourrait augmenter du double dès à présent, seulement par l'introduction de bons moulins à huile qui permettraient l'extraction complète du produit. Des usines qui s'établiraient à Collo, à Bougie, à Dellys, où l'on achèterait les olives aux kabyles, auraient un succès assuré. Les indigènes préféreraient vendre leurs olives plutôt que de les détriter eux-mêmes si cette vente leur rapportait autant, car ils auraient la main d'œuvre en moins ; de son côté, la fabrication européenne aurait juste la moitié du produit que contiennent les olives, pour se défrayer.
Toutefois, il faut remarquer que ce genre de fabrication ne produirait pas d'huile fine, parce que les Arabes ne soignent pas la cueillette, et qu'ils apporteront toujours les olives au moulin trop mûres et en état de fermentation ; on ne produirait que des huiles pour l'industrie, mais on aurait obtenu un résultat immense en augmentant cette production de moitié.
Quant à la production de l'huile fine, c'est l'affaire du colon européen. Autrement que les Arabes, il saura cueillir les olives à point, les traiter et les mettre au moulin au moment opportun. Aux Arabes la production des huiles lampantes et de fabrique ; aux colons algériens, celle des huiles comestibles, qui trouveront toujours un placement lucratif.
La croissance de l'olivier en Algérie est telle qu'un jeune arbre, au bout de 4 ans de greffe, peut donner un demi-litre d'huile ; qu'à 12 ans il en donne trois litres, et à 25 ou 30 ans, douze litres, Ces récoltes sont assurées chaque année, et l'arbre n'est pas là, comme en Provence, exposé à des maladies, à des impressions du froid, qui compromettent les récoltes.
Du moment qu'il existe dans une contrée de grands végétaux qui durent des siècles, qui ne demandent pas ces renouvellements de cultures coûteuses qu'exigent les oléagineux annuels, qui se couvrent chaque année d'abondantes récoltes, il est rationnel d'y concentrer insensiblement toute la production de l'huile et de l'abandonner dans les contrées où, relativement, elle est précaire, et dont le résultat final est de tenir cette denrée (huile d'olive fine) dans un état de cherté qui en prive les neuf dixièmes de la population, C'est d'ailleurs ce qui arrivera un jour pour toutes les productions agricoles lorsque chaque culture sera concentrée dans sa région naturelle, et qu'on ne s'efforcera plus de faire fructifier des végétaux du midi dans le nord et des végétaux du nord dans le midi.
L'Algérie n'est pas seulement propre à la production des huiles d'olive, elle comporte encore la culture des végétaux oléagineux les plus riches en huile de bonne qualité ; tant il est vrai que la nature n'opère jamais en mode simple, et que, quand elle a assigné une production spéciale à une contrée, elle sait multiplier les sources de cette production ; les plantes suivantes donnent en Algérie les meilleurs résultats :
1° Sésame. - Le sésame tient le premier rang parmi les oléagineux annuels; son rendement par hectare arrosé a été de 44 à 1,500 kilos, et par hectare non arrosé de 6 à 700 kilos. Cette graine rend en huile 50 pour 100 ; cette huile est très limpide ; elle a une saveur très douce : c'est assurément la meilleure, la plus agréable après celle d'olive. Aussi la majeure partie de l'huile d'olive que les Provençaux expédient aujourd'hui contient la moitié d'huile de sésame. Jusqu'à ce jour, l'Egypte seule a eu le privilège de cette production, qui s'écoule entièrement sur Marseille.
2° Arachide ou pistache de terre, cacahuète des Espagnols. -- L'arachide aime une Faute température et ne peut venir en Algérie sans irrigation. Elle produit 2,000 à 2,800 kilos de graine par hectare. Cette graine renferme 42 pour 400 d'huile ; cette huile est comestible, mais elle est moins agréable que celle de sésame. Elle est parfaite pour la lampe. Le commerce de Marseille importe de grandes quantités d'arachides du Sénégal ; cette culture est faite par les Yoloffs.
Ces deux espèces de plantes oléagineuses ne sont point cultivées en grand en Europe; elles sont originaires de pays très chauds, et leur culture ne peut être avantageuse que dans le sud de la région des oliviers. C'est encore une production spéciale à l'Algérie.
3° Madia sativa. -Cette plante est originaire du Chili ; elle constitue pour l'Algérie une culture hivernale, ce qui la rend presque aussi avantageuse à cultiver que les deux précédentes. Son rendement par hectare est de 2,250 kilos de graine, qui contient 40 pour 100 de son poids d'huile.
4° Pavot blanc, ou à opium. --- Après l'extraction de l'opium, le pavot blanc donne encore, par hectare semé â l'automne, 8 à 900 kilos de graine, qui contient 40 â 42 pour 100 d'huile semblable à celle que l'on connaît dans le nord sous le nom d'huile d'œillette. L'huile extraite de la graine du pavot blanc n'a aucune propriété narcotique. Cette double production de l'opium et de l'huile fait de la culture du pavot blanc une exploitation avantageuse.
5° Navette. - La navette croit partout à l'état sauvage, les champs cultivés en sont remplis à la fin de la saison des pluies. Cultivée, elle donne le même rendement en grain et en huile que le colza.
6° Cotonniers. - La graine du cotonnier contient 25 pour 100 d'huile; le rendement par hectare est de 900 kilos. Cette huile, épurée, est bonne pour la conservation des cuirs et l'entretien des machines.
7° Lin. -Nous ne parlerons ici du lin que pour mémoire, parce qu'il est l'objet d'une industrie agricole très importante dans certaines contrées de la France.
Mais, dans le cas où ces contrées viendraient à ne pas suffire à la consommation, on pourrait se rappeler que le lin vient admirablement en Algérie, qu'il y produit de belle graine et d'excellente filasse. Il croit en Algérie, à l'état sauvage, quatre à cinq espèces de lin ; on pourrait tirer un parti avantageux de la filasse et de la graine ; le lin usuel se trouve en abondance.
Nous ne parlerons pas non plus du tournesol, de la caméline, du colza, de l'oeillette, bien que toutes ces plantes prospérant parfaitement en Algérie ; mais, tout en obtenant un rendement égal à celui qu'elles donnent dans les pays du nord où on les cultive, elles offrent moins d'avantage en Algérie que les trois premières que nous avons citées.
L'Algérie est bien certainement le pays du Monde qui comporte la culture du plus grand nombre d'espèces de végétaux oléagineux. C'est sans emphase que l'on pourrait qualifier cette vaste contrée de région des huiles.
|
|
J'accuse !
par M. Robert Charles PUIG.
|
Cette accusation d'Emile Zola , je veux la reprendre en ce temps trouble ou je vois "Renaissance", les LR et la Nupes faire un front commun gauchiste pour profiter d'une erreur de langage et déclarer "coupable" un député NR qui gène parce qu'il fait parti d'un groupe dont on ne veut plus. Il a été élu par le peuple ce groupe et il est bien la représentation du peuple. Est-il "extrême droite" ou simplement cette droite qui veut une France indépendante, orgueilleuse de son passé, fière de défendre une vraie liberté au sein de la communauté européenne?
Comment à partir de là entendre le message du député NR ? Un dérapage, un manque de clarté ? Il voit se dresser contre lui, toute une partie de l'assemblée en fureur. Cela part de l'Élysée et des ouailles qui l'accompagne, les LR de Ciotti et Retailleau et toutes les gauches. Un raz de marée, un tsunami, un déferlement de mauvaises pensées pour non seulement accuser mais condamner à mort.
Un mauvais mot et la méthode choisie pour assassiner prend toute sa vigueur tragique. C'est le tam-tam, la haine sans prendre la précaution d'une analyse intelligente.
Cela me rappelle un autre temps, une autre phrase à l'assemblée nationale qui n'a jamais soulevé d'opposition, de contestation. C'était en 1962 lorsque le ministre de l'Intérieure, Gaston Defferre voulait renvoyer les Pieds-Noirs au pays de leurs ancêtres au lieu de savoir les recevoir en France.
Je ne pense pas à l'époque qu'il y eut une contestation à ces propos minables. Le parlement s'est incliné. Pourtant la faute était plus grave que cette fois-ci où la phrase n'avait pas le bon timing. Ce n'était pas le "tribun" de la Nupes qui était visé, mais simplement un bateau qu'il fallait renvoyer en Afrique mais l'occasion était trop belle pour des partis en perte de vitesse. Une Nupes qui se désagrège, une Renaissance à l'agonie et plus de LR. Tous unis pour accuser.
Personne se pose la question de savoir que faire de ces migrants partis des côtes africaines et très vite recueillis par des associations progressistes ? Ne fallait il pas que ces bateaux retournent vers les pays de départ pour restituer ces gens, au lieu d'imposer à l'Europe de les recevoir ?
Le mal est là. Nous ne savons plus être des nations responsables mais juste des terres d'accueil en aveugle des conséquence que nous analysons chaque jour avec des individus assassins. R C PUIG
Robert Charles Puig / novembre 2022
|
|
Un paysan est mort
Par Jean-Paul Pelras
Envoyé par M. Barisain le 08/11/2022
|
Nous sommes dans l'Oise, le 3 octobre 2022. Un agriculteur vient de se suicider. Quelques jours plus tôt, il avait été convoqué par la justice consécutivement à une enquête menée par l'OFB (Office français de la biodiversité). Dans le journal Le Betteravier Français, Régis Desrumaux, président de la FDSEA de l'Oise explique : "Il était accusé d'avoir entraîné le jaunissement de l'herbe sur une ligne d'une longueur d'environ 600 mètres, sur un chemin qui longe une de ces parcelles", avant de rajouter : "Les agents de l'OFB ont épluché toutes les données de traçabilité de l'exploitation sous le regard méfiant de Linda Monnier, directrice de la FDSEA de l'Oise. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve permettant d'accuser l'agriculteur…" Et pourtant, lorsque le directeur de l'OFB est interrogé par les journalistes du Betteravier, il répond : "Nous avions toutes les raisons de penser que l'agriculteur était coupable."
Coupable ! Mais, putain, coupable de quoi ? Où se situe, sur l'échelle de la culpabilité, entre celui qui assassine un vieillard, celui qui détourne des milliards, celui qui revend de la drogue et celui qui viole des enfants, "le crime" commis par celui qui a (peut-être) osé désherber le bord de son champ ?
Le 3 avril 2022, Géraldine Woessner, journaliste au Point, évoquait l'acharnement dont l'OFB fait preuve à l'encontre des agriculteurs. Elle cite cet exemple où, à Grenoble, le zèle de cette administration est soutenu par le procureur du parquet spécialisé (créé par la réforme du 1er avril 2021) qui déclare : "Il faut nourrir le tribunal et faire un exemple". Un exemple, des exemples… Et les langues se délient un peu partout sur le territoire avec des agriculteurs qui préfèrent garder l'anonymat car ils redoutent les contrôles et la descente impromptue des agents de l'OFB dans les cours de fermes, dans les parcelles, sur les exploitations, en uniforme, arme à la ceinture comme s'il s'agissait d'interpeller des meurtriers.
Alertés du drame par Luc Smessaert et Christiane Lambert, respectivement vice-président et présidente de la FNSEA, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et celui de l'Écologie, Christophe Bréchu, ont été "sensibles à la situation et ont pris cela au sérieux". Circulez, il n'y a donc plus rien à voir derrière cette coalition où l'on ne sait plus qui, du ministère de l'Agriculture ou de celui de l'Environnement, détient désormais le plus de pouvoirs. La question étant de savoir ce que pèse le monde paysan face au lobby écologiste. Comment, en effet, en moins de deux décennies, le dogme verdoyant a-t-il pu, à ce point, impacter, inquiéter et intimider les producteurs, les éleveurs, les cultivateurs ? Et bien, tout simplement, car les environnementalistes bénéficient du soutien d'une population conditionnée par les émissions et les reportages à charge régulièrement diffusés à la télévision et sur les ondes. Ces reportages où le glyphosate (classé en juin dernier par l'Agence européenne des produits chimiques comme non cancérigène) est systématiquement cité dès qu'il s'agit, pour capter l'audimat, d'obtenir un effet anxiogène.
Pathétiques inquisitions
Nous en sommes là, dans cette société, à minorer le rôle nourricier de l'agriculture en lui préférant la démonstration de quelques activistes qui saccagent les cultures, les transports alimentaires, les retenues d'eau ou qui jettent des bols de soupe sur les tableaux parce que la plupart du temps ils n'ont, tout simplement, rien d'autre à faire. L'hystérie de certains responsables politiques présents aux côtés des activistes comme Rousseau et Jadot dans les Deux Sèvres samedi, questionne sur la légitimité de ces "législateurs". L'acharnement de ces élus à l'encontre des pratiques agricoles ayant atteint des niveaux ubuesques, le monde paysan français à toutes les raisons de s'inquiéter quant au devenir de sa profession.
Quand, depuis Paris, les bureaux des ONG, le ministère de l'Écologie et les strapontins du Palais Bourbon, la stigmatisation de l'agriculture est devenue le divertissement favori de ceux qui, à défaut de chercher des solutions, vont débusquer dans nos campagnes ce qui permet d'alimenter leurs pathétiques inquisitions. Et ce, sans avoir jamais mis les pieds sur un tracteur, sans savoir ce que représente des années de labeur, sans savoir ce qu'il en coûte de rembourser du long terme avec du court terme quand les récoltes sont insuffisantes et que l'argent vient à manquer. Parce que ce qui compte, c'est le contrôle, c'est l'inspection, c'est la verbalisation de celui qui travaille. Ce qui compte, c'est au-delà du "buzz politico-médiatique", l'effet de surprise qui provoque la boule au ventre, c'est le tribunal où "le paysan coupable" va comparaître.
L'agriculture, en France, représente 45 % de la surface du pays avec 26, 8 millions d'hectares cultivés. À cela, il faut rajouter les chemins et les abords entretenus par les agriculteurs pour éviter la fermeture des espaces publics, champêtres, touristiques, forestiers. Imaginons une France sans paysans, car, désabusés, ils auraient décidé de rendre une bonne fois pour toute la clé des champs. Pourrait-on ce jour-là confier aux écologistes et aux administrations qui leurs sont dévouées, serpes, fourches, faux, faucilles, faucheuses, tronçonneuses et autres gyrobroyeurs ou débroussailleuses pour entretenir le pays afin qu'il ne devienne pas un territoire, de Dunkerque à Perpignan et de La Rochelle à Lons le Saunier rendu au maquis, aux landes et à la forêt ?
Nous verrions alors de quoi sont capables ceux qui, pour l'instant, se posent en donneurs de leçons quand ils devront nourrir les populations, juguler les incendies et les inondations, contenir les prédateurs, les espèces invasives, surveiller les friches où le gibier va proliférer, où les trafics en tout genre et les décharges sauvages vont se développer.
Il ne s'agira plus alors de savoir comment 600 mètres de bordures auront été nettoyés. Il ne suffira plus de désigner arbitrairement ceux qui détenaient et transmettaient le savoir-faire permettant d'entretenir pâtures, jardins, vignes et vergers. Mais de savoir pourquoi, une fois la France vouée aux ronces et aux genêts, les idéalistes soutenus par quelques politiciens illuminés ont fait, à ce point, preuve d'ignorance, d'aveuglement et d'irresponsabilité.
|
|
LETTRE D'UN PIEDS-NOIRS AU PERE NOËL
Par G.A.
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°203 - Janvier 2012
|
Cher Père Noël,
Je m'étais juré de ne plus t'écrire, moi qui pourtant t'écrivais chaque année, dès que j'ai pu le faire quand j'avais six ou sept ans. Tu t'en souviens la dernière fois c'était pour le Noël de l'année 1961, pour l'Algérie Française, c'était alors le Noël de l'espoir en Algérie, pour la majorité des européens y résidant, malgré le couvre-feu et la désillusion que l'on sentait à l'affût. prête à nous prendre à la gorge. Les accords d'Evian se négociaient, tambour battant, près de l'Arc de Triomphe, Avenue Kléber, à Paris, pour notre petit peuple rien n'était encore joué, et nous espérions encore un miracle. Mais pour les autres, les négociateurs, les gaullistes et le FLN l'affaire était déjà enlevée et le sort d'un million des nôtres devait être définitivement scellé ce 18 mars 1962 à Evian.... Tu remarqueras cher Père Noël que les villes d'eau inspirent toujours les lâches, les traîtres et les collaborateurs ... après Vichy ... Evian .... J'ai appris que tu ne bois plus que de la San Pellegrino...
Tu connais l'histoire mieux que moi Père Noël. mais voilà ce que je voulais te dire que depuis se sont écoulées 50 années. Pour nous c'est hier ! En 1962 ce fut mon premier Noël en Métropole. Ce fut le plus triste de ma vie, l'année de mes vingt ans, tu ne peux pas imaginer ce que c'est que d'avoir vingt ans, être Pieds-Noirs, dans un pays hostile quand tu travailles en usine avec des ouvriers majoritairement communistes, les autres gaullistes, de gauche, comme de bien entendu. Quant à notre accent c'était notre étoile jaune. Tu as là un aperçu de ce que nous vivions et encore nous n'étions pas harkis, eux c'étaient les camps, l'étoile et le couvre-feu. Toi tu n'a jamais eu vingt ans, tu as toujours été vieux, tu ne peux pas comprendre. Tu es chez toi partout, tout de rouge vêtu tu passes facilement pour un membre du PC, tu apportes des cadeaux, tout le monde t'aime, ce qui n'était pas le cas pour nous Français Pieds-Noirs et Français musulmans !
Dur, dur ce Noël 1962, je ne rentrerai pas dans le détail mais c'est vrai cette année-là je ne t'ai pas écrit, je ne t'ai rien demandé, j'étais dégoûté, destroy, comme on dit aujourd'hui. Sans faire de misérabilisme je me souviens avoir passé ce réveillon seul dans une chambre de bonne, à Paris, dans les beaux quartiers, un toit sous les toits pas plus grand qu'une niche, une pièce pas plus grande qu'un mouchoir de poche dans laquelle j'épanchais mes souvenirs récents, l'Algérie, la trahison, l'abandon, l'injustice, et tout le reste...Enfin le bourdon qui en a mené plus d'un à la solution finale.
Depuis ces Noëls 61 et 62 le sablier s'est inexorablement vidé, chaque année un peu plus, j'ai l'impression que dans cet espace temps je ne suis qu'un oeuf à la coque et que la cuisson arrive à son terme. Tu peux compter sur moi je vais essayer de durer le temps de cuisson nécessaire à un œuf dur pour ralentir l'effet néfaste de ce maudit sablier. Mais avant de partir, en paix, j'aimerais pour la première fois depuis 50 ans te demander un cadeau, pas pour moi, Père Noël car la vie m'en a fait de bien beaux, le plus important est celui de rester vivant alors que la seule autre opportunité qui m'était offerte était le cercueil. Plusieurs dizaines de milliers des nôtres n'ont pas eu cette chance. En France j'ai refait ma vie et j'ai appris à connaître et apprécier mes compatriotes d'ici, il m'a fallu beaucoup de temps, j'ai compris que les pauvres bougres avaient été abusés, comme nous victimes d'une propagande d'état et de partis. C'est vrai qu'ils ont la mémoire courte et que la géographie et l'histoire n'est pas leur fort. mais aujourd'hui beaucoup ont compris qu'on les avait trompés. Ils constatent avec amertume que ces populations qu'ils avaient soutenues et leurs rejetons ne sont pas tout à fait comme ils les imaginaient " qu'elle est belle la vie " c'est seulement à la Télé pas dans les cités et à Marseille ça tire à tout va à l'AK 47. Et sans être devin je peux te dire que cela ne fait que commencer.
Alors voilà, cher Père Noël, ce sera ma dernière lettre et le dernier cadeau que je te demande, par pour moi, c'est presque cuit, je te l'ai déjà dit, mais pour tous ceux que j'aime, mes enfants, petits enfants, toute ma famille, et aussi pour mon pays la France et son peuple, un peu naïf tout de même, que j'ai appris à aimer et dont j'ai pardonné les erreurs. Attention, Père Noël, ne te méprends pas, j'ai dit le peuple et non leurs dirigeants. D'ailleurs ce sont ces derniers qui sont en partie concernés et font l'objet de cette lettre ultime. Tu me feras remarquer, peut-être avec une certaine logique, que je suis né dans ce qui est aujourd'hui un pays étranger, que je n'ai pas une goutte de sang français et que tu t'étonnes que l'avenir de ce pays me préoccupe tant après tant d'ingratitude. Tu auras raison de poser la question mais vois-tu pour une grande majorité de Pieds-Noirs ça n'est pas du sang français qui coule dans nos veines, notre sang nos pères l'ont laissé sur les champs de batailles depuis longtemps. A nous il reste le drapeau et faute du sang c'est la France qui coule dans nos veines. On ne se refait pas...
Le dernier cadeau que je demande pour mon pays, donc pour les miens, très cher Père Noël, c'est premièrement de débarrasser la France de toutes ses politiques aux couleurs aussi diverses que variées, des vert de Dany le Rouge au rouge des Cocos, du vieux rose fané à la rose des cocus, de la pomme véreuse au pommier stérile, du cramoisi des trotskistes au vert et blanc des pro-islamistes de plus en plus nombreux, pour ratisser plus large.
Cher Père Noël, j'espère que tu recevras ma lettre et qu'elle ne sera pas détournée par un Cégétiste haineux ou par le facteur fada de Neuilly. Je te remercie de tout mon cœur de donner ce beau cadeau à la France. N'oublie pas pour 2012 un changement de couleur radical ! J'annonce la couleur " BLEUE MARINE ".
Claude SAËZ
|
|
BRIGITTE BARDOT BARDOT
Envoyé par M. Georges Barbara
|

Toinette, a l'ouvre sa fenetre de bon matin et comme Fifine est entrain d'étendre des serviettes à son balcon dans la maison d'en face, elle l'interpelle!
- " Oh Fifine belle, bonjour ! Ecoute qu'y faut que je t'en raconte une ce matin !
- " Encore toi, et ben ma Fi c'est pas pour rien que dans cette rue Burdeau y t' appellent tous " Le moulin à paroles " et y'en a même qu'y disent que surement t'ya pas envalé ta langue quand ta mère a t'a accouché !
- " Non attends c'est juste pour te dire si tu t'arappelles d'la Fi de Conchette ?
- " Laquelle ? Elle en avait deux de Fis !
- " La grande tu sais celle qu'elle etait toujours sapée à mort : talons hauts, rouge à z'ongles et tout le reste quoi. Et qu'elle etait partie travailler dans les contributions à Constantine, qu'on disait même dans le quartier qu'elle s'l'a faisait a'c un type de la bas. Et que quand elle était jeune si tu t'arrapelles bien a se prenait pour Brigitte Bardot à cause qu'elle avait des gros tétés.
- " Ah oui c'est celle-là qu'elle avait eu la fugure de se présenter au concours de Miss la Colonne ? Et qu'on s'lavait pris à coup de tomates, à la kermesse du curé de Saint Anne? ! Qu'elle rigolade ma Fi, oui oui que je m'arappelle !
- " Ouais c'est celle-là, même qu'elle s'applait Marguerite, tu 'ois un peu Toinette ?
- " Ouais je 'ois main'nan. Et pourquoi elle est morte ?
- Et non qu'elle est pas morte, te crois que j'ai une tête à visser les poignées t'sur les cercueils moi ? Que tu m'dis ça ? J'travaille pas chez Taddo, Diocane pour annoncer tous les morts d'la Colonne ! Je vas finir par te prendre un abonnement à la depeche de l'Est si te continues, comme ça t'yauras tous ceux qu'y te sont morts dans le monde entier et les petites histoires du quartier oualou... que dalle... te pourras courir après.
- " Eh ! Oh ! De bon matin t'les as de travers toi ? Ma parole t'ya du dormir t'sur le ventre ma Fi... Si te continues et ben je vas t'laisser dire tes zboubinettes là. Pourquoi moi j'ai pas fermé l'oeil d'la nuit à cause que mon p'tit Fernand y l'a été malade michkinette !
- " Encore malade çuila ? Et toi aussi t'ya qu'à faire un peu enttention à lui que du matin au soir je le 'ois à piednus dans la rue ! Et ça ma Fi te diras ça que tu veux mais c'est pas bon pour les bronches !
- " Aller o Stroundze agas te m'la finie ton histoire que j'en peux plus et que moi j'ai pas qu'ça à faire !
- " Ah oui de quoi on parlait déjà... a oui, tiens ça me rovient... Et ben fugure-toi qu'hier au soir comme j'étais devant la gare que j'avais rien à faire, qui j'te 'ois sortir bras d'sur bras d'sous a'c sa sœur qu'elle était venue la chercher, et ben c'était notre Miss à la manque…. Pourquoi main'nan qu'elle a pris sa retraite, on m'a dit qu'elle va habiter ou y'avait sa mère avant qu'elle meurt, te 'ois où y'a l'enclos dans la rue Galdès au tournant ?
- " Mamamille ! Et ben y manquait plus qu'ça, qu'on se tappe cette dévergondée dans le quartier !
- " Je va te dire une chose que main'nan c'est vrai qu'elle avait raison, que c'est tout Brigitte crachée parce que si tu la 'ois c'est la même tête que l'aute qu'elle habite à la Madrague à St Tropez. Si te veux demain j'te porte CineMonde où c'est que Brigitte elle est dessur. Alors là, o ma sœur si tu rogars la fugure de la Margueritte, c'est tout Brigitte, mais de mai'nan bien sur…. Adebon c'est une vraie jupe plissée, que même si on te lache nos maris dans la rue on a rien à craindre c'est sur !
- " Abon et ben,…. Mais avant que j'te lache Toinette, la prochaine fois que te dois me sortir tes conneries pas plus grosses que le trou de mon lévier d'la cuisine, et ben rogars que tu me prends rendez-vous avant ! Aller bonne journée !
Georges Barbara, septembre 2022
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
Cours de la Révolution d’Annaba
Envoyé par Basile
http://lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/
9038029-le-champs-de-bataille-des-prostituees
lestrepublicain.com - 22 Nov 2022 Annaba - B. Salah-Eddine
Le « champs de bataille » des prostituées
La prostitution clandestine prend des proportions considérables à Annaba, avec le danger que cela représente, notamment les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST). Devant ce phénomène, des citoyens nous ont contacté à maintes reprises, lançant un SOS en direction des pouvoirs publics pour la réactivation de la brigade des mœurs, chargée de la lutte contre la prostitution, ou du moins, des agents spécialisés en la matière pour mettre un terme à un phénomène qui prend de l’ampleur, particulièrement sur le Cours de la Révolution.
Des jeunes femmes, certaines originaires de différents pays africains, échappant à tout contrôle médical, sont de plus en plus utilisées par les réseaux criminels. Aussi bien à El Bouni, sur les hauteurs du parc d’attraction de Sidi-Achour, la route de Seraïdi, ou à Ras-El-Hamra, se sont transformés en lieux de débauche à ciel ouvert. Et par la force des choses, l’environnement du Cours de la Révolution, principale vitrine de la « Coquette ». En effet, le cœur battant de la ville est actuellement scindé en trois, a-t-on constaté sur place.
En face du siège de la mairie, du matin au soir, des filles, dites « la casse », doivent s’exposer au grand jour sur les bancs publics. Le milieu de cet espace, est détenu par les « prostituées de luxe », opérant sous l’œil vigilant de proxénètes. Et le troisième est occupé par la prostitution masculine qui prend, elle aussi, une dimension considérable. Et pour s’enquérir de la gravité de la situation, il suffit de faire un tour à l’entrée Est de l’esplanade du Cours de la Révolution, pour constater de visu que des dizaines de personnes homosexuelles activent aussi au grand jour.
Des rixes ont lieu au quotidien. Il faut attendre la fin de journée pour voir cette partie du centre-ville libérée, après que ces personnes se déplacent vers les buvettes clandestines, du côté des zones rurales des communes de Benazouz, Boumaiza, Ain-Berda, El-Eulma, pour exercer leur « commerce » nocturne.
B. Salah-Eddine
Service des cartes grises à Annaba
Envoyé par Tatiana
http://lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/
9038009-graves-denonciations
lestrepublicain.com - B. Salah-Eddine - 21 Nov 2022 Annaba
Graves dénonciations
Les employés du service des cartes grises d’Annaba, implanté aux abords de la placette du Champ de mars, ont observé dans la matinée d’hier, lundi 21 novembre, un piquet de protestation devant le siège de l’Assemblée Populaire Communale (APC). Ils ont tenu à signaler le comportement d’un élu local. Alertés, le président de l’APC et le secrétaire général ont invité les protestataires à monter au premier étage où se déroulait une assemblée pour l’étude du budget communal de 2023, afin de discuter autour d’une table.
L’un des représentants de ces employés a dénoncé, pratiquement en pleurs, les agissements d’un élu activant au sein du parti du Rassemblement National Démocratique (RND), qui « était intervenu pour le dossier de la femme de son frère ».
Selon le témoignage accablant du représentant des contestataires, l’élu en question aurait « usé d’insultes » et se serait « introduit de force dans les bureaux, arguant que ceci est de son plein droit ». Tout en évoquant la plainte déposée par les travailleurs à l’encontre de cet élu.
Le représentant syndical Abdesmed Aggoun a, pour sa part, dénoncé la situation vécue. Il a menacé du recours à une grève de trois jours si une solution radicale à ces dépassements n’est pas prise par les membres de l’APC. « Nous ne voulons plus subir ce diktat ». a-t-il déclaré en substance.
Cependant, la permission du premier magistrat de la commune d’Annaba, accordée aux responsables des employés pour s’exprimer, n’a point été acceptée par l’élu pointé du doigt. Cette affaire a donc fini par éclater en pleine séance de l’assemblée, dans une confrontation verbale de bas étage.
Ce n’est qu’après l’intervention énergique du maire face à l’élu en question, le menaçant de faire appel aux agents du service de l’ordre de l’APC pour le faire sortir de la salle, que le calme est revenu.
B. Salah-Eddine
Politique des salaires en Algérie
Envoyé par Marcel
http://lestrepublicain.com/index.php/actualite/item/
9037842-les-critiques-d-un-depute
lestrepublicain.com - Par: Mohamed M 15 Nov 2022 Annaba
Les critiques d’un député
« Le problème est qu’un fonctionnaire continue de gagner aujourd’hui 30.000 DA ou 29.000 DA, alors que des personnes qui n’ont même pas le bac, et qui ne sont pas allés à l’université, peuvent toucher jusqu’à 90.000 DA en étant employés à la Caisse nationale d’assurance, à Naftal ou dans des banques (en tant qu’agents de sécurité) ».
Les propos n’émanent pas d’un simple citoyen, révolté par tant d’inégalités, mais d’un député à l’assemblée populaire nationale, qui s’est soudain rendu l’évidence. Selon ce député, cet exemple illustre « la réalité de ce qu’est la justice sociale dans le pays ». Poursuivant son intervention à propos de ce qu’il considère comme des « incohérences » et des « injustices » à propos de la nomenclature des salaires en Algérie, il a indiqué qu’ « un médecin généraliste qui a passé des années et des années à étudier commence sa carrière avec un salaire de 70 000 DA, alors qu’une personne qui s’est fait renvoyé de l’école, et qui a à peine le niveau de terminale ou de deuxième année secondaire, peut gagner jusqu’à 90 000 DA en tant qu’agent de sécurité dans une banque ».
« Je connais une personne qui travaille en tant que chauffeur à Sonatrach et qui touche 230 000 DA ! « Où est la justice sociale » ? S’est-il interrogé. D’après ce député, les fonctionnaires algériens sont éligibles à la Zakat. « Que voulez-vous que ces fonctionnaires fassent ? Ils voient à longueur de journée des gens qui ont un niveau largement inférieur au leur gagner beaucoup plus qu’eux », a-t-il lâché.
Sur les réseaux sociaux, le « coup de gueule » de ce parlementaire a été différemment interprété. De nombreux internautes ont qualifié ses propos de « populistes ». Un internaute, visiblement mieux imprégné de la problématique, a estimé que c’est de la pure démagogie. « C’est du populisme. La question n’est pas tant de savoir combien gagnent les chauffeurs ou les agents de sécurité, mais plutôt que font ces députés pour que la situation des fonctionnaires s’améliore ? Que proposent-ils ? On attend depuis toujours leurs propositions.
Il ne suffit pas de parler, il faudrait agir », a-t-il écrit sur Facebook. De nombreux internautes sont intervenus pour exprimer ce qu’ils pensent des déclarations de ce député, dont les propos risquent de « mourir » dans l’hémicycle. Quoi qu’il en soit, des fonctionnaires, qui ont le niveau universitaire, auraient vivement souhaité que cette « sortie » donnerait lieu à un débat élargi au niveau de l’APN pour que les députés puissent étudier la question et sortir avec des propositions adaptées à la situation financière du pays. Après tout, c’est leur rôle et leur mission.
Tout le reste n’est que palabres sans fin, qui ne font qu’aggraver la situation de frustration dans laquelle se trouvent des millions d’Algériens.
Mohamed M
Exercices militaires algéro-russes en Algérie
Envoyé par Angèle
http://lestrepublicain.com/index.php/actualite/item/9037871
-des-manoeuvres-inedites-qui-ne-visent-aucun-pays
tsa-algerie.com - par : Mohamed Mebarki 16 Nov 2022
Des manœuvres inédites, qui ne visent aucun pays
Inédit dans les relations militaires algéro-russes pourtant très fortes depuis l’ère soviétique ; par le passé et même jusqu’à un présent récent, des conseillers militaires russes étaient envoyés régulièrement en Algérie pour assister les militaires algériens dans l’entretien et le fonctionnement du matériel russe, mais leur présence était très discrète, pour des raisons qu’il est impossible d’expliquer dans un seul papier.
Cependant, ce que vient de rapporter l’agence Sputnik représente un fait nouveau, que les observateurs n’ont pas manqué d’estimer qu’il pourrait contribuer à faire évoluer les rapports entre Alger et Moscou vers des niveaux insoupçonnables !
Qu’en est-il au juste ? Des manœuvres militaires conjointes entre les armées, algérienne et russe, vont avoir lieu à partir de demain et se poursuivront jusqu’à lundi 28 novembre. Selon Le Journal français, JDD, propriété de Lagardère, ami intime du roi du Maroc, dont le responsable de la communication est un marocain proche de la famille royale, « quelques 200 soldats des forces antiterroristes russes et algérienne seront réunis dans le cadre d’un exercice appelé bouclier du désert ».
« Un pied de nez aux Etats-Unis qui ont décidé de soutenir le Maroc sur le dossier du Sahara occidental », a avancé sournoisement la publication parisienne, qui s’est permis auparavant une question provocatrice flagrante en s’interrogeant « que font les armées, algérienne et russe à la frontière marocaine » ? Baptisées bouclier du désert, ces manœuvres, qui constituent des exercices antiterroristes, verront la participation d’une centaine de membres des forces spéciales algériennes et autant de leurs homologues russes, indique Sputnik.
Il s’agit des premiers exercices terrestres entre l’Algérie et la Russie qui vont se dérouler sur le territoire algérien, à l’est de Abadla et tout juste près de Hammaguir, dont la simple évocation rappelle toute une histoire ! Les soldats des deux pays simuleront « la recherche et la destruction de groupes terroristes ». Deux autres manœuvres ont précédé cette dernière entre les deux armées en 2022, les exercices Vostok-2022, auxquels ont participé des soldats algériens dans le district militaire russe Est en septembre, et l’accotement en octobre à Alger d’un détachement de navires de guerre russes pour un exercice avec la marine algérienne.
Contrairement aux insinuations colportées par le journal français, les exercices annoncés auront lieu à une cinquantaine de kilomètres de la frontière marocaine ne visent « aucun pays tiers », a précisé une porte-parole de la diplomatie russe. Sur un autre registre, l’agence russe, citant la presse algérienne, fait état d’un « méga-contrat » de vente d’armes qui serait en préparation entre les deux pays. Le contrat s’élèverait à 11 milliards de dollars.
Il est également attendu à ce que le Sukhoï Su-75, un avion de combat furtif de?cinquième génération, pourrait figurer parmi les livraisons russes à l’Algérie. Toutefois, il est sûr que cet exercice va traduire une coopération militaire entre l’Algérie et la Russie jamais atteinte auparavant.
Mohamed Mebarki
Transport maritime en Algérie :
un secteur dans la tourmente
Envoyé par Pierre
https://www.tsa-algerie.com/transport-maritime-en-algerie-
un-secteur-dans-la-tourmente/
- Par tsa-algerie.com - Par: Riyad Hamadi 18 Nov. 2022
Le secteur du transport maritime de voyageurs et de marchandises en Algérie va mal. Algérie Ferries vit au rythme des saisies de ses navires dans différents ports européens. L’un des fleurons de la compagnie, le Tariq Ibn Ziad, est bloqué au port espagnol d’Alicante, pour des raisons « futiles ».
Cet énième incident survient alors que le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait évoqué la situation du secteur dimanche dernier en conseil des ministres.
Le chef de l’État a parlé de « laisser-aller » et de « de tentatives de sabotage » au sein de l’entreprise de transport maritime de marchandises.
Selon le communiqué qui a sanctionné la réunion, M. Tebboune a instruit le ministre des Transports « d’élaborer un rapport exhaustif et détaillé sur l’état du secteur, en définissant les responsabilités ».
Il a en outre ordonné de renouveler la flotte de transport maritime « à travers l’acquisition de nouveaux navires ».
Ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat se voit contraint de monter au créneau pour tenter de remettre de l’ordre dans le secteur. En juin dernier, il a limogé le PDG et des cadres d’Algérie Ferries, après les scandales des navettes effectuées presque à vide entre l’Algérie et la France alors que les membres de la communauté nationale établie à l’étranger se bousculaient devant les agences de la compagnie pour obtenir une réservation.
Les bousculades, qui ont nécessité parfois l’intervention des services de sécurité français, étaient perçues comme une atteinte à l’image de l’Algérie.
L’enquête judiciaire a conclu à un acte délibéré au sein de la haute hiérarchie de l’entreprise. Plusieurs responsables ont été écroués.
A la même époque, plusieurs changements ont été effectués simultanément à la tête des entreprises du secteur des transports (Air Algérie, aéroport d’Alger, entreprise des services portuaires Serport…).
Mais c’est le secteur des transports maritimes, à travers ses entreprises dédiées aux marchandises ou aux voyageurs, qui a le plus fait parler.
Le Tarik Ibn Ziad bloqué pour des « problèmes d’hygiène »
Ces derniers mois, les blocages visant des navires algériens dans les ports européens se sont succédé à un rythme effréné.
En novembre 2021, au moins trois navires, le Tamanrasset, le Saoura et le Timgad étaient simultanément bloqués dans les ports de Marseille, Brest (France) et Anvers (Belgique).
D’autres navires comme (Stidia, Tinzirène, Kherrata, Constantine…) avaient subi le même sort dans les ports du Vieux continent.
Certains étaient restés bloqués pendant plusieurs mois. Les raisons des saisies étaient presque à chaque fois les mêmes : non-paiement des redevances, dû des travailleurs non versés, manquement aux règles de sécurité, dégâts occasionnés sur les quais.
Il y a quelques jours, la nouvelle du blocage du navire Tarik Ibn Ziad à Alicante a été ébruitée. A moins qu’il s’agisse d’un acte de représailles des autorités espagnoles dans le sillage de la crise diplomatique entre les deux pays.
Les raisons évoquées sont inacceptables pour une entreprise qui ne peut pas ignorer la rigueur de la législation européenne qui lui a valu le blocage de plusieurs de ses bateaux.
Selon le président de la commission des transports de l’assemblée populaire nationale (APN), le Tarik Ibn Ziad est bloqué à cause d’un manquement aux règles d’hygiène dans le port espagnol.
Après les péripéties de l’année dernières et de la première moitié de l’année en cours, les responsables de la compagnie étaient en principe tenus de prendre leurs précautions.
Une telle situation était en tout cas largement évitable, et se faire saisir un bateau d’une telle importance pour une futilité est inacceptable.
Rédaction
|
|
|
C'est bien la morale
Envoyé par Annie
|
|
Ma petite amie et moi sortions ensemble depuis plus d'un an et nous avions décidé de nous marier. Seule ombre au tableau : sa jeune et magnifique sœur.Très sexy, ma future belle-sœur avait 22 ans, portait toujours des tee-shirts moulants et la plupart du temps sans soutien gorge. Chaque fois qu'elle se penchait en avant, elle m'offrait alors une vue plus que magnifique. Ce qui me gênait c'est, que manifestement, elle ne se comportait ainsi qu'avec moi !
Un jour ma future belle-sœur me téléphona pour me présenter les faire parts de mariage.
À mon arrivée, elle était seule et me susurra aussitôt qu'elle avait des sentiments pour moi, qu'elle me désirait ardemment et qu'elle voulait être à moi, avant mon mariage avec sa sœur.
J'étais assommé et incapable de répondre quoi que ce soit. Elle me dit: «je monte à l'étage dans ma chambre si tu es prêt pour l'aventure, rejoins-moi ». J'étais comme paralysé et la regardais monter. Je restais immobile un moment et me précipitais alors vers la porte d'entrée, j'ouvrais la porte et courais vers ma voiture. Et soudain, quelle ne fut pas ma surprise !
Toute ma future belle-famille était là qui m'applaudissait.Les yeux plein de larmes, mon beau-père me prit dans ses bras et me dit :
« Nous sommes heureux que tu aies passé notre petit test avec succès. Nous ne pouvions rêver d'un meilleur mari pour notre fille.
Bienvenue dans notre famille ! »
Morale de cette histoire :
Il faut toujours ranger ses préservatifs dans sa voiture !
|
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|
 Cette fois, je vous emmène passer la journée dans une jolie petite ville d'Algérie, à deux ou trois cents lieues du moulin… Cela nous changera un peu des tambourins et des cigales…
Cette fois, je vous emmène passer la journée dans une jolie petite ville d'Algérie, à deux ou trois cents lieues du moulin… Cela nous changera un peu des tambourins et des cigales…




 Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes-lièges, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante ; et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades moresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a vingt ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. À chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'inexpérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d'efforts ! Que de fatigues ! Quelle surveillance incessante !
Je restai un moment à regarder cette plantation merveilleuse, où tous les arbres du monde se trouvaient réunis, donnant chacun dans leur saison leurs fleurs et leurs fruits dépaysés. Entre les champs de blé et les massifs de chênes-lièges, un cours d'eau luisait, rafraîchissant à voir par cette matinée étouffante ; et tout en admirant le luxe et l'ordre de ces choses, cette belle ferme avec ses arcades moresques, ses terrasses toutes blanches d'aube, les écuries et les hangars groupés autour, je songeais qu'il y a vingt ans, quand ces braves gens étaient venus s'installer dans ce vallon du Sahel, ils n'avaient trouvé qu'une méchante baraque de cantonnier, une terre inculte hérissée de palmiers nains et de lentisques. Tout à créer, tout à construire. À chaque instant des révoltes d'Arabes. Il fallait laisser la charrue pour faire le coup de feu. Ensuite les maladies, les ophtalmies, les fièvres, les récoltes manquées, les tâtonnements de l'inexpérience, la lutte avec une administration bornée, toujours flottante. Que d'efforts ! Que de fatigues ! Quelle surveillance incessante !
 Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l'agitation d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage. D'autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominaient d'une note suraiguë les " You ! you ! you ! " des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre.
Mon hôte devint tout pâle comme un homme à qui on annonce un désastre, et nous sortîmes précipitamment. Pendant dix minutes, ce fut dans l'habitation, si calme tout à l'heure, un bruit de pas précipités, de voix indistinctes, perdues dans l'agitation d'un réveil. De l'ombre des vestibules où ils s'étaient endormis, les serviteurs s'élancèrent dehors en faisant résonner avec des bâtons, des fourches, des fléaux, tous les ustensiles de métal qui leur tombaient sous la main, des chaudrons de cuivre, des bassines, des casseroles. Les bergers soufflaient dans leurs trompes de pâturage. D'autres avaient des conques marines, des cors de chasse. Cela faisait un vacarme effrayant, discordant, que dominaient d'une note suraiguë les " You ! you ! you ! " des femmes arabes accourues d'un douar voisin. Souvent, paraît-il, il suffit d'un grand bruit, d'un frémissement sonore de l'air, pour éloigner les sauterelles, les empêcher de descendre.
 Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues tracées de poudre.
Au lieu d'écraser les sauterelles, les soldats les flambaient en répandant de longues tracées de poudre.




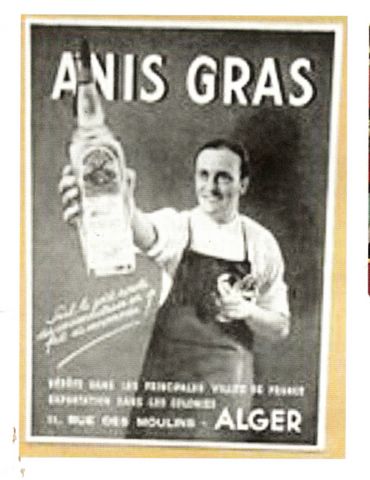
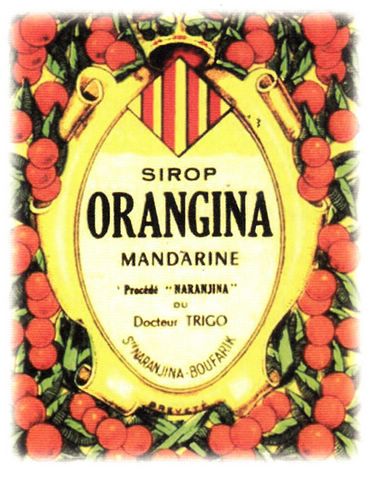

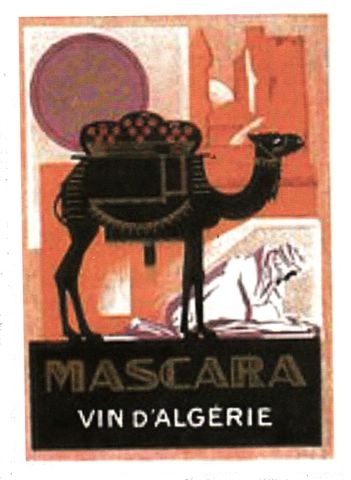 Issus de cépages importés de la métropole au XIXème siècle, la culture de la vigne était très importante avant l'indépendance de l'Algérie et était présente surtout dans l'Algérois et l'Oranie.
Issus de cépages importés de la métropole au XIXème siècle, la culture de la vigne était très importante avant l'indépendance de l'Algérie et était présente surtout dans l'Algérois et l'Oranie.
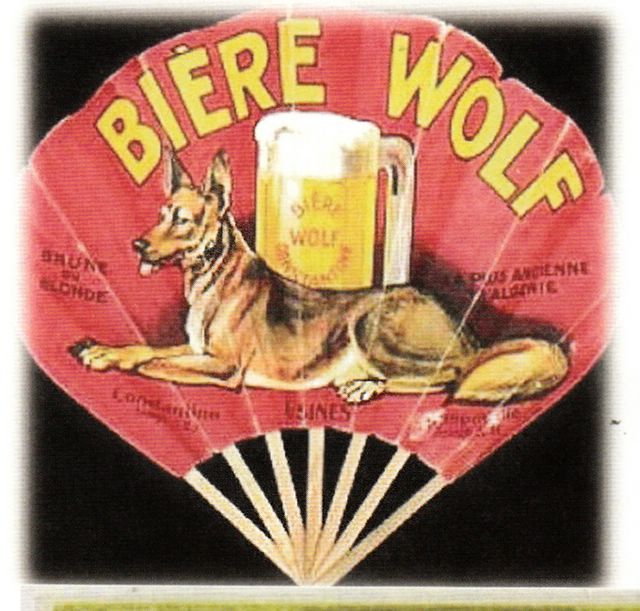

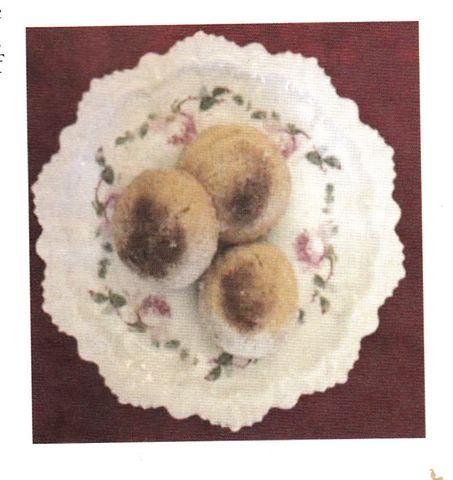 Confiserie, gâteaux, glaces : baklava, beignets sucrés, boule de Moscou, bradges, bûche de Noël, cigare aux amandes, cornes de gazelles, confiture (orange, orange amère, coings, figue, nèfle, pastèque, raisin), couronnes à l'anis, couscous sucré aux raisins secs, crêpes, créponé, dattes fourrées à la pâte d'amande, délices d'Alger, doigts de la mariée, flan à l'orange, ftahir (beignet tunisien), galettes sucrées, gâteau napolitain, gelée d'arbouses, glace italienne, halva (aux amandes, à la vanille, à la pistache, ou au chocolat), makroud au miel, mandarines confites, montecaos, mouna (brioche pour Pâques à l'huile d'olive ou au beurre et à la fleur d'oranger, se mange aussi au petit déjeuner ; jusqu'à l'arrivée dans les foyers des premières cuisinières, la pâte était apportée au four du boulanger qui la cuisait), nougat turon, oreillettes, oublies, pain perdu, pâte de fruits, riz au lait à la pistache, rollicos, patates douces frites et sucrées, pruneaux ...
Confiserie, gâteaux, glaces : baklava, beignets sucrés, boule de Moscou, bradges, bûche de Noël, cigare aux amandes, cornes de gazelles, confiture (orange, orange amère, coings, figue, nèfle, pastèque, raisin), couronnes à l'anis, couscous sucré aux raisins secs, crêpes, créponé, dattes fourrées à la pâte d'amande, délices d'Alger, doigts de la mariée, flan à l'orange, ftahir (beignet tunisien), galettes sucrées, gâteau napolitain, gelée d'arbouses, glace italienne, halva (aux amandes, à la vanille, à la pistache, ou au chocolat), makroud au miel, mandarines confites, montecaos, mouna (brioche pour Pâques à l'huile d'olive ou au beurre et à la fleur d'oranger, se mange aussi au petit déjeuner ; jusqu'à l'arrivée dans les foyers des premières cuisinières, la pâte était apportée au four du boulanger qui la cuisait), nougat turon, oreillettes, oublies, pain perdu, pâte de fruits, riz au lait à la pistache, rollicos, patates douces frites et sucrées, pruneaux ...


 -" " Mamamille, Ouille M'an ! Agads moi çà Mémé, fais un peu entention, la madone de toi, pourquoi te viens de me marcher t'sur mon pied ! Mais où c'est que t'ya appris à danser toi ? On dirait un camion de chez Kaouki ! Et tout à l'heure combien j'avais raison, quand j' voulais pas me faire ce Bolero avec toi, mieux si je m'étais cassé une jambe. Et toi bouche en cœur pour faire le Dandalon te me disais que tu dansais mieux que Fred La Stère ! Pour un Fred La stère comme toi j'en chie un tous les jours !
-" " Mamamille, Ouille M'an ! Agads moi çà Mémé, fais un peu entention, la madone de toi, pourquoi te viens de me marcher t'sur mon pied ! Mais où c'est que t'ya appris à danser toi ? On dirait un camion de chez Kaouki ! Et tout à l'heure combien j'avais raison, quand j' voulais pas me faire ce Bolero avec toi, mieux si je m'étais cassé une jambe. Et toi bouche en cœur pour faire le Dandalon te me disais que tu dansais mieux que Fred La Stère ! Pour un Fred La stère comme toi j'en chie un tous les jours !

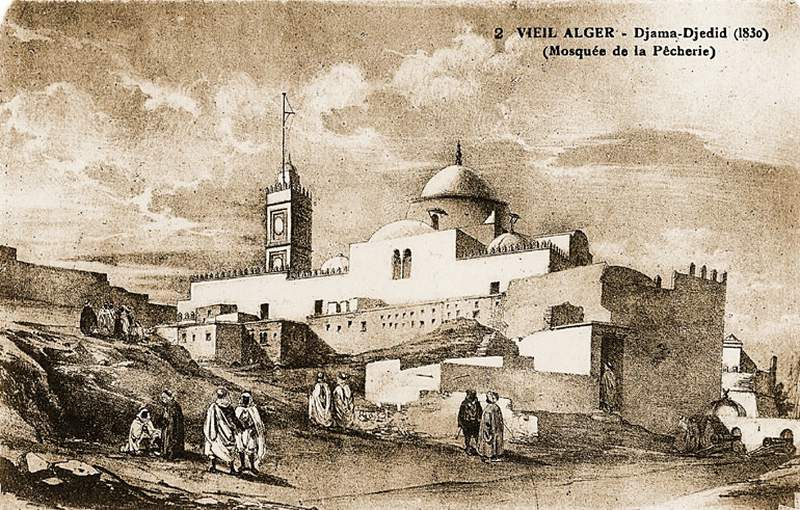


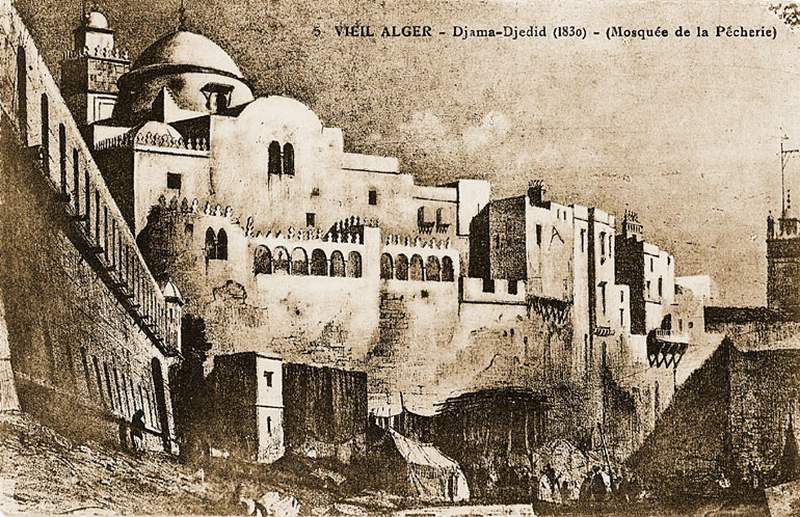


 Qui se souvient encore de ces personnages qui ont hanté les rues de notre ville du temps de notre jeunesse ? Nous les voyions passer sans trop y porter attention car ils étaient quotidiens et qu'il suffisait de se promener dans le centre de la cité ou dans le quartier qu'ils affectionnaient pour les retrouver égaux à eux-mêmes avec leur charge de pittoresque ou de dérision, seuls ou entourés d'une multitude de gamins qui ne se rassasiaient pas de leur originalité, qui les regardaient, comme moi gravement, parce qu'ils dissonaient dans l'univers ambiant ou qui les poursuivaient d'invectives et de quolibets et leur lançaient parfois des cailloux.
Qui se souvient encore de ces personnages qui ont hanté les rues de notre ville du temps de notre jeunesse ? Nous les voyions passer sans trop y porter attention car ils étaient quotidiens et qu'il suffisait de se promener dans le centre de la cité ou dans le quartier qu'ils affectionnaient pour les retrouver égaux à eux-mêmes avec leur charge de pittoresque ou de dérision, seuls ou entourés d'une multitude de gamins qui ne se rassasiaient pas de leur originalité, qui les regardaient, comme moi gravement, parce qu'ils dissonaient dans l'univers ambiant ou qui les poursuivaient d'invectives et de quolibets et leur lançaient parfois des cailloux.
 d'oiseaux et de tulle. Elle s'enveloppait parfois d'un grand châle de soie bordé de cygne. On disait qu'il s'agissait d'une personne du monde, qui avait été frappée par le goût de l'extravagance et avait sombré dans une sorte de folie douce. En tous cas, l'expression "être vêtue comme la Catchavera" est passée dans le folklore oranais.
d'oiseaux et de tulle. Elle s'enveloppait parfois d'un grand châle de soie bordé de cygne. On disait qu'il s'agissait d'une personne du monde, qui avait été frappée par le goût de l'extravagance et avait sombré dans une sorte de folie douce. En tous cas, l'expression "être vêtue comme la Catchavera" est passée dans le folklore oranais.
 Et le marchand de piroulis, planté à la porte des écoles, coiffé d'une casquette de marinier, tenant d'une main un petit garçon de huit ou neuf ans et de l'autre une hallebarde qui soutenait un cône de carton sur lequel se fichait une forêt de piroulis multicolores, à la menthe, à l'anis, au citron, ou à la fraise. La friandise valait deux sous et le commerçant était toujours entouré d'une foule d'enfants braillards qui désignaient du doigt la sucette convoitée. Le jeune garçon, sérieux comme un pape à côté de son père encaissait et rendait la monnaie. Le marchand de piroulis a longtemps profilé sa silhouette digne à la porte du collège du Sacré Cœur, rue Saintes, mais je l'ai retrouvé bien plus tard, toujours aussi majestueux, seul ces fois-là, son garçon avait grandi et fait sa vie autrement et ailleurs.
Et le marchand de piroulis, planté à la porte des écoles, coiffé d'une casquette de marinier, tenant d'une main un petit garçon de huit ou neuf ans et de l'autre une hallebarde qui soutenait un cône de carton sur lequel se fichait une forêt de piroulis multicolores, à la menthe, à l'anis, au citron, ou à la fraise. La friandise valait deux sous et le commerçant était toujours entouré d'une foule d'enfants braillards qui désignaient du doigt la sucette convoitée. Le jeune garçon, sérieux comme un pape à côté de son père encaissait et rendait la monnaie. Le marchand de piroulis a longtemps profilé sa silhouette digne à la porte du collège du Sacré Cœur, rue Saintes, mais je l'ai retrouvé bien plus tard, toujours aussi majestueux, seul ces fois-là, son garçon avait grandi et fait sa vie autrement et ailleurs.
 Passait dans les rues d'Oran, avec comme port d'attache le Petit Vichy le vendeur de bonbons des Vosges, accompagné de son petit âne fanfreluché de rubans, de pompons et de grelots, baté de deux paniers remplis à raz-bord de ces friandises qui ressemblaient à des cailloux multicolores et translucides au goût profond de résine. Il manipulait dans une bouteille pleine d'eau un ludion, une petite poupée de celluloïd noir qu'il appelait Mademoiselle Tapioca. Les enfants accourraient à l'appel d'une flûte de pan pour assister aux acrobaties du baigneur dans son récipient et chacun était enthousiasmé de voir Mademoiselle Tapioca plonger puis remonter à la surface presque miraculeusement. Le commerçant devait faire ses affaires car, dans les dernières années, son bourricot était attelé à une petite carriole blanche et pimpante recouverte d'un toit festonné auquel étaient accrochées des grappes de sucres d'orge de tailles différentes pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses.
Passait dans les rues d'Oran, avec comme port d'attache le Petit Vichy le vendeur de bonbons des Vosges, accompagné de son petit âne fanfreluché de rubans, de pompons et de grelots, baté de deux paniers remplis à raz-bord de ces friandises qui ressemblaient à des cailloux multicolores et translucides au goût profond de résine. Il manipulait dans une bouteille pleine d'eau un ludion, une petite poupée de celluloïd noir qu'il appelait Mademoiselle Tapioca. Les enfants accourraient à l'appel d'une flûte de pan pour assister aux acrobaties du baigneur dans son récipient et chacun était enthousiasmé de voir Mademoiselle Tapioca plonger puis remonter à la surface presque miraculeusement. Le commerçant devait faire ses affaires car, dans les dernières années, son bourricot était attelé à une petite carriole blanche et pimpante recouverte d'un toit festonné auquel étaient accrochées des grappes de sucres d'orge de tailles différentes pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses.












 - " Et Zotch, arogards moi ça, ce matin, O man... C'est Ninette qu'a l'est venue a'c sa sœur, me chercher pour aller à l'école que c'est ojord'hui qu'on rentre ! Et ben si je m'attendais que tu me fais une chose pareille, ma Fi ! T'yes trop genti tu sais !
- " Et Zotch, arogards moi ça, ce matin, O man... C'est Ninette qu'a l'est venue a'c sa sœur, me chercher pour aller à l'école que c'est ojord'hui qu'on rentre ! Et ben si je m'attendais que tu me fais une chose pareille, ma Fi ! T'yes trop genti tu sais !
 "
"