|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
168, 169, 170,
171, 172, 173,
174, 175, 176,
177,
| |
|
EDITO
La Repentance qui nous fait honte !
Chers Amis,
Dans un mois, l'année 2017 sera terminée, nous dirons OUF, un an de plus, mais que nous réservera 2018 ? Je pense qu'il faut s'attendre à tout et préparons-nous au pire.
2017 aura vu l'élection d'un président jeune mais immature ; jeune et fier mais tyrannique ; jeune et riche mais incompétent pour le finances du pays et comprendre le peuple français ; jeune et diplômé mais inintelligent au point d'être manipulé par la haute finance mondiale auquel il est inféodé ; jeune et arrogant mais nul face au respect de l'histoire de son pays et au respect du à ses ancêtres ; jeune et se croyant au-dessus de tout mais qui fait honte au pays avec ses repentances qu'il vomira plus tard.
Comme pour sa politique syrienne face à Poutine (1), un vrai Président, il a bu de tout son saoul une honte et un camouflet lors de son récent voyage au Moyen Orient, notamment à Dubaï et en Arabie Saoudite où les rois se sont foutus ouvertement de sa " belle gueule " d'ange ahuri et n'ayant rien compris de la diplomatie arabe. Le jeune héritier saoudien se permettant même le luxe de le raccompagner à l'avion, suprême affront chez eux. Les médias se sont tus sur ce grave événement. Censure présidentielle ? (2)
Lors de son voyage actuel en Afrique, il vient de démontrer, une nouvelle fois, son incompétence dans son discours de repentance sur les colonisations dont la française, celle qui nous intéresse car nous en sommes le cœur vivant et sa mémoire indéfectible.
Il n'a rien compris sur les colonisations, alors qu'à l'heure actuelle, son pays, sa France subi une colonisation qui se révèle, être la plus importante de l'histoire de l'humanité et qui sera aussi la plus sanglante dans les années à venir.
Une colonisation actuelle de la France qui n'a rien à voir avec celles que l'Afrique du Nord aurait subie, dont les 132 ans de l'Algérie où la France avec son argent et les " peuplades " de la France profonde, de l'Italie, d'Espagne ou de Malte, entre autres, ont CREE un Pays Nouveau, avec un nom.
Ces " peuplades " appelées péjorativement " colons ", devenues Pieds-Noirs, sont fières d'avoir engendré ce nouveau pays dans ses frontières actuelles, dans sa fraternité démontrée et son humanité à toute épreuve que seuls les vrais Algériens reconnaissent et, où, à l'issue de ce long et court bail de 132 ans ils ont été priés violemment de prendre le chemin de l'exil, en laissant leurs biens et leur pays nouveau en pleine croissance, moderne, productif, avec une civilisation avancée.
Bien sur que, comme toutes les colonisations subies par l'Afrique du Nord, la " colonisation française " s'est accompagnée de drames que toutes les communautés ont subis.
Les colonisations et invasions, phénicienne, romaines, vandales, arabe, turc, se sont toutes faites avec des drames humains bien plus importants et atroces que les drames de la colonisation française et pourtant jamais ces peuples et pays n'ont formulé aucune repentance comme vient de le faire l'actuel président de la France.
L'histoire est l'histoire, le passé est le passé, mektoub comme dirait le sage Sidi.
Cette repentance va à l'encontre des pionniers de cette colonisation et de ses communautés de l'exil de 1962 où l'accueil (en général), de ce que l'on croyait " la mère patrie ", n'ait pas exempt de tout reproche et de toute condamnation.
Cela va à l'encontre de la France qui a fait de gros sacrifices humains et financiers pour cette colonisation qui, dans le poids de la balance de l'histoire pèse plus lourd positivement que négativement
Cela va à l'encontre de la simple morale vu les drames qu'ont subi les communautés de Pieds-Noirs et Harkis au moment de l'exil forcé dont tous les problèmes sociaux et humains ne sont, hélas pas réglés.
Alors, oui 2017, se termine avec un note discordante et un tel président. Souhaitons pour 2018, qu'il soit traduit devant les tribunaux pour une destitution car cela s'apparente à de la trahison ou de la sénilité (même les jeunes en sont atteints, la preuve) et qui va conduire le pays à de grandes catastrophes. Merci les 12,5% de la population qui l'ont placé sur son trône.
En attendant, que, cette année se termine avec des fêtes que nous vous souhaitons joyeuses.
Bonne lecture, JPB
Diobône,
A tchao.
1- De Catherine II à Vladimir Poutine par Thierry Meyssan
2 - Le camouflet infligé au président Macron en Arabie saoudite par Thierry Meyssan
|
|
Chrysanthèmes
Par M. Marc Donato
|
Qui, en 1954, aurait pu dire à André ce qu'il serait en 1962 ? Qui aurait pu dire à Marie qu'elle se retrouverait, mariée, à l'autre bout de la France ? 1954, la Toussaint rouge, celle du début des "événements" d'Algérie. Juillet 1962, l'indépendance du pays. 6 août 1962, André et Marie prennent le bateau pour la France. Ils viennent de se marier et ils partent en voyage de noces, pensant bien retrouver leur pays, l'Algérie, après les grandes vacances. Mais les nouvelles envoyées par leurs parents sont péremptoires :
- Tout est fini. Il ne faut pas songer à revenir ; nous aussi, nous faisons nos bagages.
Deux fois le tour de France pour trouver un emploi. Une lettre de l'Administration apprend à André et à Marie qu'ils sont mis à la disposition du département de Meurthe-et-moselle. Direction Longwy, Herserange, plus précisément.
- C'est où ça ?
Longwy, pays de l'acier, des hauts-fourneaux. Le Luxembourg à deux kilomètres. Arrivée sous un ciel gris ; la saleté d'un après-midi de jour de marché. La pluie, le terril en forme de volcan, les feux d'artifice infernaux des soufflantes des usines sidérurgiques. Après 22 ans de soleil, de mer, de plages, de ciel bleu ! Mais ils sont jeunes, André et Marie, rien ne leur fait peur. Ils vont de découverte en découverte depuis quatre mois, et puis ils n'ont pas eu le temps de comprendre encore.
Ils n'imaginent pas : pour eux le voyage de noces continue. Ils arrivent à Longwy un trente octobre. Celle qui sera leur directrice d'école pendant 10 ans a été assez gentille pour leur prêter une chambre de bonne. Pas d'eau. Une bouteille de Perrier fera l'affaire. Quelques gouttes sur le visage, le matin… Pas de toilettes ; un pot de chambre de faïence, caché sous un journal pour le dissimuler aux regards, furtivement glissé dans la voiture, sorti avec autant de précautions.
Pas de classe, ce sont les vacances.
Et puis, la curiosité : connaître cette ville où ils vont vivre. La Toussaint approche, plus qu'un jour. Toussaint cette fête qui, de toutes les fêtes est celle qui fait le plus déplacer les Français… Cette fête où, là-bas, ils apportaient religieusement sur les tombes familiales le pot de chrysanthèmes choisi avec soin chez "Vito", l'horticulteur des grandes occasions. Un jaune pour la Mamie, c'est la couleur qu'elle préférait, un blanc, pour ce petit frère mort tout jeune et jamais connu ; un violet pour…
Ici aussi, à Longwy, la Toussaint est célébrée avec ferveur. On est en pays minier, pays d'usines, pays de Romagnols, émigrés de cette Italie misérable, de Polonais, aussi, venus chercher du travail à défaut de fortune dans ce pays de cocagne. Les uns et les autres sont encore empreints de religiosité et célèbrent la Toussaint ; ils ont déjà quelques morts à honorer ici, même s'ils ne sont pas arrivés depuis des lustres. Mortalité enfantine, maladies, accidents du travail, vieux parents, encore, amenés avec les bagages depuis leurs terres de départ. Alors on sacrifie à la coutume locale. On achète son pot de chrysanthèmes et on fleurit la tombe du petit, celle de la mamma, de Giuseppe ou de Janusz…
Et c'est là qu'André et Marie ont pris conscience de ce qu'ils voyaient : les gens autour d'eux parcouraient les rues les bras chargés de fleurs coupées, de pots de chrysanthèmes. Seules touches de couleur aux bras de ces hommes sombres, étoiles filantes pointillistes de ces femmes en noir, chrysanthèmes-soleil dans ce ciel gris qu'il faudra bien apprivoiser un jour…
Brusquement, ils ont compris, André et Marie. Ils se sont regardés et leurs yeux ont parlé pour eux. La triste réalité venait de les rattraper : ils ne pourraient plus aller rendre visite à leurs morts restés de l'autre côté de la Méditerranée et qu'ils ne devaient plus jamais revoir. Adieu, Vito, tu ne leur vendras plus tes fleurs ; adieu, les marchands de chrysanthèmes éphémères devant le cimetière. Adieu, Mamie, adieu, petit frère, adieu à vous tous, morts de leurs familles. Les fleurs de la Toussaint ne viendront plus réchauffer vos corps gelés.
Les racines d'André et de Marie, leurs racines, foutaient le camp avec la Toussaint. Terminus, tout le monde descend… Le voyage de noces s'arrête ici. En un éclair de chrysanthèmes, ils venaient de réaliser qu'ils avaient tout perdu, qu'ils étaient devenus des rapatriés.
A quoi cela tient parfois ! Un pot de chrysanthèmes, un jour de Toussaint 1962.
M. Marc Donato
|
|
| JOYEUX NOËL !
Envoyé Par Hugues
|
C'est au temps de l'Avent qu'on prépare Noël,
La merveilleuse nuit où naquit l'Emmanuel,
Messie, appelé Jésus, dont cette fête annuelle
Est issue de coutumes et us traditionnels.
Tradition honorée pour la huitième année,
Dans un village perché de Méditerranée,
Où deux femmes et deux hommes, parité respectée,
Erigent une immense crèche. Oeuvre perfectionnée !
Architectes bâtisseurs, artistes décorateurs,
Accent méridional, provençaux dans leur coeur,
Apportent à FALICON une âme de créateurs
Qu'apprécieront, sans faille, les nombreux visiteurs !
Qualifiée de "géante" par la Presse Régionale,
La Crèche de FALICON, unique, originale,
Accueille humblement en ce lieu, c'est normal,
Croyants et agnostiques sans esprit doctrinal
Hugues JOLIVET
Décembre 2017
|
|
|
PHOTOS DE BÔNE
Envois par Divers Lecteurs
|
Photo insolite de Saint Augustin (Mme J. Mas)

Photo du Caramy (M. J.L. Ventura)

Photos du cinma Varièté, Avant / Après (M. R Bussola)


Photo de l'école de l'Orangerie (M. R. Bussola)

Photo de lécole caraman (M. R. Bussola)

|
|
|
LE MUTILE N° 44, du 20 janvier 1918 (Gallica)
|
|
Tribune Libre
Alger, 14 Janvier 1918
M'sieu Director di Jornal Mutilé, Alger,
Bian sur ti me connis bas, mais moi je te connis beaucoup. parce que quand j'étis betit, j'ai fire pour toi les commissions.
Je suis né au douar Beloua, commune de Tizi-Ouzou, et j'ai appris à lire et à écrire en français à l'école de M. Vuichard, qu'il est maintenant à Médéa ; quand j'a su lire ; écrire et compter, mon père il m'a acheté des brosses, du cirage et une caisse en bois, et il dire à moi : Foute moi le quand gagner ton pain. Trois jours ji reste à fire cirer à Tizi-Ouzou, puis j'viens à Alger, pour cirer la glace de Paris ; mais c'est pas bon métier, j'y gagne pas grand soge, et j'y faire les commissions pour les français d'Alger, y pour les touristes Anglis. Allemands (naadini mek) pu la Khor et j'y gagne besef des sous.
Y en a trois ans, la guerre des Boches elle est déclarée, plus de touristes, j'y gagne plus rien, ouallou, alors j'y faire ni une, ni deusse, j'y gagé soldat militaire, tiraillor et j'ai parti pour la France, casser la gueule aux Allemands, j'en ai touié autant que j'ai pu, et dans la Marne j'ai été blessé, une jambe coupée par un obus. Le toubib militaire il m'a bien soigné, à Orléans, Madame la Croix-Rouge il faire pour moi, beaucoup besef de bien, et maintenant je suis guéri, j'ai une jambe de caoutchouc tote nove, et j'y marche come un homme naturel, avec pension de 750 frs que me paie le baylik.
Quand j'ai revenu en Algérie, j'ai resté à Alger, parce que c'est plus meilleur que Tizi-Ouzou, et commé je n'avais pas besef de fonds, j'y faire cafetier maure, rue de la Girafe, ti sais bien, café maure avec pois chiches grillés, mais les pois sont chers, le sucre aussi, et j'ai pas gagné assez pour vivre et envoyer de l'argent à ma mère au Beloua, où que mon père il a crevé comme mort, depuis deux ans. Alors j'ai vendu mon café maure, et j'ai faire marchand de lait, avec moitié de l'eau, à 12 sous le litre. Ça va bien, j'y gagne beaucoup, mais un agent de police, il me dresse procès barbare, et j'ai condamné à cinquante francs des amendes.
Ah ! sidi Belloua, que j'ai dit, ji ne marche blus fic le lait, j'y faire autre soge, et je faire boucher, vendre la viande au marché de la Lyre, ça mon vieux, c'est bon, tu vends comme tu veux et personne y dire rien. Il y en a bien la taxe, mais ça fait rien, quand la police y n'est pas là ti vends le prix comme ti voudras, les os à 2 francs le kilog, et la viande qu'il y pas des os, elle n'est pas taxée, et t'y vends ça que tu veux, catégorie spéciale.
Les bouchers, que c'est tous des malins, ils désossent toute la viande et on vend 48 sous et même 50 sous la livre la viande sans os, au lieu de trois francs le kilog. Ti voi c'est bon bénéfice, et ji suis content, bien content, parce que j'y gagne beaucoup d'argent, et ji pense quand la guerre y sera finie, ji pars en Kabylie, j'y chète une maison au Beloua et avec mon pension, j'y faire rentier, kif-kit Monsieur Rochild.
Je te salue bien,
DJALI BEN KACI,
mutilé de la guerre.
|
|
| Fables Bônoises
De M. Edmond Brua
Envoyé Par M. Carpy Dominique
|
|
LE POT
Vous qui cultivez un domaine
Où les semences de l'esprit
Ne donnent de fleur ni de fruit
Qui ne tirent leur suc de la nature humaine,
Naguère, en un cercle savant,
Vous avez chanté les louanges
De ces véhicules étranges
Qui marchent sans chevaux, sans vapeur et sans vent,
Grincent fort, s'arrêtent souvent
Et : suivant leur voie immuable,
Offrent au sage une place impayable
Pour observer la vie et les vivans.
Souffrez que je vous conte et que je vous dédie,
Tout juste vu comme il vous plaît,
Un acte, parmi cent, de l'ample Comédie.
Donc, un jour, sur sa tête ayant un beau trollet,
Un tramouët déambuloit.
Le ciel resplendissoit d'azur et de lumière. .
L'air étoit pénétré de douceur printanière
Et dédaigneux du coup de frein,
Femmes, moines, vieillards, avant l'arrêt du train,
Tout montoit dans la jardinière.
Une mère et son fils, non pas un nourrisson,
Mais déjà garçonnet tirant sur le garçon,
Depuis Bab-El-Oued y menoient grand tapage.
L'enfant, qui trépignoit de rage
Ou gémissoit comme un martyr,
Montroit un chef énorme et serré de bandages
A la manière des fakirs.
Et la mère, personne d'âge,
A chaque cri du freluquet;
Par des taloches répliquoit.
Cela vous résonnoit de sinistre manière,
Tant qu'à la fin mainte commère
Se récria. Ce fut bientôt un chœur !
- Sûr, sa mère à de bon, qu'elle est au cimitière
- Atso, Monsieur le Receveur,
Fésez signe à le conducteur
Qu'i' s'arrête un peu la oiture
Pour pas qu'il arrive un malheur !
- Arrégardez-moi sa fugure :
Peur i ' fait de tant qui' vient blanc !
- Appelez vite à les agents !
- C'est pas croyabe à croire, en plein devant les gens,
Qu'un pareil escandale i' dure !
- Vous avez pas du cœur, ou quoi ?
- Vous se croyez qu'il a la tête en bois ?
- Quâ même, i' faut qu'elle est bien dure !
- Michquinette !
- Allez, tape encor !
- Vinga dessur la carabasse !
- Don-z'y bon !
- Entention la casse !
- Sûr son père aussi qu'il est mort,
Aussinon, comme i ' s' la tabasse !
- Que père ? O va de là, le pauv', il est bâtard !
Ainsi s'exprimoient la plupart.
Quelques-unes montroient un peu plus de réserve,
Disant : - E t pourquoi qu'on s'I'énerve ?
- O petit, ça fait mal ? Allez, va, n'as pas peur,
Manman i' te porte au docteur.
- Assaoir ça qu'il a ?
- C'est la matsoïdite.
- C'est le tobus qu'il a décapoté,
Pourquoi toujours i' vont trop vite !
- Il est fartass, oilà la vérité.
- Alors, entention la petite !
- Que fartass ? Un aparions
Qu'i' s'a trapé les orillons ?
A ces bienveillantes harangues,
L'enfant (cet âge est sans pitié)
Répondoit en tirant la langue
A la longueur d'un demi-pié.
L a mère à tout ceci n'avoit point sourcillé,
Quand elle dit, de guerre lasse :
- Le monde, alors, i ' sont jobasses !
Mala qu'il a pas son papa !
Pis, ça vous arrégarde pas.
Il a payé sa dimi-place.
Et ce disant, vous rebourroit de coups
Sa criarde progéniture,
Ajoutant : - Méteunant, la honte à la fugure
I' faut qu'on te oit de partout !
Ah ! ouais, vous se croivez pétêtre
Qu'il a tombé par la fenêtre,
Qu'il a la tête plein des poux ?
Eh ! ben, oualloù !
T't-à-l'heure, à la maison, ce calamar i' rentre
Aux cabinets. J'y fais : T i as mal au ventre ?
Rien i ' répond. Je vas oir... Popopo !
Le vase en fer, enfin, le pot
Qu'on fait dedans, assaoir, ce caouette,
S'i' s'a cru de oir un chapeau,
I s'I'avoit rentré dans la tête !
Quand i' crient les enfans, mieur les laisser crier.
La mère i ' sait toujours comment qu'on s'ies élève.
Mâ le pot, qui c'est qui lui lève ?
Je m'ie porte à chez le plombier !
Edmond Brua
|
|
|
| Bulletin - Oeuvre de saint Augustin et de sainte
Monique, patronne des mères chrétiennes
N° 18 - Avril 1876 - Brochure trouvée à la BNF
|
|
LES MONTAGNES DE L'AURÈS
Biskra, le 1er mars 1877,
Mon très-révérend Père,
Dans ma dernière lettre, je vous annonçais mon départ pour les Aurès. Malgré le mauvais temps, j'ai pu faire ce voyage assez rapidement et être de retour à Biskra en cinq jours. Le froid, la pluie et la neige auxquels je ne suis plus guère habitué m'ont empêché de prolonger mon séjour dans ces montagnes autant que je l'aurais voulu. Je n'avais pas vu de glace depuis mon départ de France et j'en ai retrouvé avec surprise dans la rivière qui passe près de Takout, au pied du Djebel R'asira et du Djebel Bené-Bou-Sluman qui font partie du massif de l'Aurès et cela en plein Sahara.
Le Djebel Aurès, l'Aurasius des Latins, célèbre dans l'histoire de l'Algérie, a au moins un million d'hectares de superficie. Il s'élève près de Batna, à environ 110 kilomètres de Constantine, entre les oasis des Zibans et les Hauts-Plateaux. La partie du massif qui avoisine Batna est couverte de magnifiques forêts de cèdres. Pics déchirés, sommets majestueux, gorges pittoresques et d'une effrayante profondeur, sites grandioses, neiges éternelles, tout contribue à faire de l'Aurès un des plus beaux massifs montagneux du nord de l'Afrique. Cette région est habitée par des Kabyles dits Chaouïas et des Arabes berbérisants. On y parle un dialecte berbère analogue, quoique bien distinct, de celui qui est usité dans la grande Kabylie. A la base de l'Aurès, du côté du Sahara, commencent les splendides plantations de palmiers des Zibans.
En suivant la rivière le long de laquelle les villages sont bâtis, j'ai vu divers beaux emplacements pour la fondation d'un poste, mais l'endroit qui m'a le plus frappé, ce sont les trois villages des Oulad Abed, des Oulad Iddir et des Oulad Ben-Accas, placés sur trois mamelons assez rapprochés. Ces villages sont assez importants. Avant d'y arriver on en rencontre trois ou quatre que l'on pourrait visiter facilement en tournée. A quelque distance plus loin se trouve encore un gros village appelé Tilfalfal. Les trois villages mentionnés plus haut et désignés sous le nom d'El-Aarich renferment de nombreuses ruines romaines. J'y ai vu des tronçons de colonnes mesurant près de deux mètres. Dans la construction des maisons kabyles, beaucoup de pierres ont été empruntées aux ruines. A quelques minutes du village on montre l'emplacement d'une maison dont on ne retrouve presque plus, rien et que les kabyles appellent dar-er-roumia (maison de la Chrétienne). Ailleurs, sur un très-bel emplacement, on voit à fleur de terre les murs d'enceinte d'un ancien marché romain. Il n'y a rien de surprenant que les Romains aient habité et couvert d'établissements cette belle contrée qui est assez à proximité de Lambèse; pour aller de cette dernière ville à Takout, résidence du caïd, il ne faut qu'une journée de voyage à mulet en passant par la montagne. A mon arrivée, les malades se pressaient en foule autour de moi, j'ai distribué les médicaments que j'avais apportés et épuisé ma provision de quinine et de sulfate de zinc.
Les Chaouïas m'ont promis, maintenant qu'ils me connaissent, de venir nous demander nos remèdes et nos soins lorsqu'ils viennent à Biskra, en attendant qu'il nous soit possible de résider à poste fixe chez eux. Le caïd de Takout m'a proposé, lorsque je retournerais le voir à la belle saison, de m'accompagner et de me faire visiter en détail la plus grande partie de l'Aurès. En attendant, je ne négligerai aucune occasion d'entretenir de bons rapports avec ces sympathiques et intéressantes populations. Daigne la Divine Providence nous envoyer de nombreux ouvriers apostoliques pour nous permettre de fonder bientôt chez elles des établissements aussi nombreux et prospères que ceux que nous avons déjà dans la Grande Kabylie.
Agréez, etc.
P. LABARDIN,
Missionnaire d'Afrique, à Biskra.
A SUIVRE
|
|
| La déclaration d’amour
Envoyé par Roger.
|
Je te cherche et je te trouverai,
Au lit, je t’emporterai,
Et là , j’abuserai de toi,
Je te ferai Frémir, Suer,
Trembler
jusqu’à ce que tu gémisses
Je te ferai demander grâce,
jusqu’à ce que tu me supplies d’arrêter,
Je te rendrai faible
au point que tu seras heureuse que j’aie fini,
Et quand j’aurai fini,
fébrile pour des semaines,
tu resteras !!!
Avec tout mon amour
Signé : LA GRIPPE
Maintenant ôte-toi
ces idées cochonnes
de la tête et va te faire vacciner !!!
|
|
|
ANNALES ALGERIENNES
Tome 1
|
|
LIVRE III
Entrée des Français à Alger. - Confiance de la population, malgré quelques désordres partiels. - Trésor de la Casbah. - Désarmement des Indigènes. - Digression sur le gouvernement intérieur d'Alger sous la domination des Turcs. - Désordre administratif après l'occupation. - Commission centrale du gouvernement, présidée par M. Denniée. - Conseil municipal. - Police française. - Corporation juive. - Octroi. Douanes, etc., etc.
Alger, lorsque les Français y entrèrent le 5 juillet 1830, ne présentait pas l'aspect triste et désolé d'une ville où la victoire vient d'introduire l'ennemi. Les boutiques étaient fermées, mais les marchands, assis tranquillement devant leurs portes, semblaient attendre le moment de les ouvrir. On rencontrait çà et là quelques groupes de Turcs et de Maures dont les regards distraits annonçaient plus d'indifférence que de crainte. Quelques Musulmanes voilées se laissaient entrevoir à travers les étroites lucarnes de leurs habitations. Les Juives, plus hardies, garnissaient les terrasses de leurs demeures, sans paraître surprises du spectacle nouveau qui s'offrait à leurs yeux. Nos soldats, moins impassibles, jetaient partout des regards avides et curieux, et tout faisait naître leur étonnement, dans une ville où leur présence semblait n'étonner personne.
La résignation aux décrets de la Providence, si profondément gravée dans l'esprit des Musulmans, le sentiment de la puissance de la France, qui devait faire croire en sa générosité, étaient autant de causes qui appelaient la confiance ; aussi ne tarda-t-elle pas à s'établir ; si depuis elle s'est affaiblie, la faute n'en est qu'à ceux qui ont si étrangement gouverné une population si facile à l'être.
Le peu de relations individuelles qui s'établirent d'abord entre les vainqueurs et les vaincus, si toutefois on peut donner ce nom aux Maures qui avaient à peine soutenu de leurs vœux le gouvernement turc, furent en général favorables à la domination française. Sans haine et sans préventions contre les habitants de la Régence, nos soldats y déployaient une aménité et une bienveillance qui sympathisaient avec le' caractère doux et sociable des Algériens. Les impressions qui en résultèrent ne purent être entièrement effacées par quelques désordres partiels, ni par les fautes de l'administration, causes premières de ces désordres ; et aujourd'hui encore, après une suite d'actes peu faits pour honorer notre gouvernement aux yeux des Indigènes, le nom de Français n'excite pas, chez eux, plus de sentiments de répulsion que celui de tout autre peuple chrétien.
Les premiers jours de la conquête furent signalés par le respect le plus absolu des conventions. Les personnes, les propriétés privées, les mosquées, furent religieusement respectées ; une seule maison fut abandonnée au pillage, et, il faut bien, le dire, ce fut celle qu'occupait le général en chef, la fameuse Casbah. Mais hâtons-nous d'ajouter que ce pillage, qui du reste a été beaucoup exagéré, fut plutôt l'effet de la négligence qu'un calcul de la cupidité. Par l'imprévoyance du commandant du quartier général, chacun put entrer dans la Casbah, et en emporter ce que bon lui semblait. Beaucoup se contentaient du moindre chiffon, comme objet de curiosité ; d'autres furent moins réservés ; et parmi eux on doit compter plusieurs personnes de la suite de M. de Bourmont, et même des généraux. Tout cela est fort répréhensible sans doute; mais tous ceux qui ont jeté la pierre à l'armée d'Afrique avaient-ils donc les mains si pures ?
Une affaire bien autrement importante que le vol de quelques bijoux à la Casbah, serait la dilapidation du trésor de la Régence, si elle avait eu lieu. Je ne crois pas que les soupçons qui ont pesé sur quelques personnes à cet égard fussent fondés ; dans mon opinion, ce trésor est venu grossir en entier celui de la France, quoique les usages de tous les peuples en accordassent une partie à l'armée qui l'avait conquis. Il était placé dans des caves, dont l'entrée, exposée aux regards du public, fut mise sous la garde de douze gendarmes qui étaient relevés à court intervalle, et il n'en sortait rien que pour être transporté sur-le-champ à bord des bâtiments de l'État, sous la conduite d'officiers pris au tour de service et sans choix. J'ai moi-même fait transporter un million de cette manière, et je ne savait pas en allant à la Casbah à quel genre de service j'étais appelé. Ce trésor fut inventorié par une commission de trois membres, qui étaient le général Tholozé, M. Denniée et le payeur général, M. Firino ; on y trouva 48,700,000 francs.
La ville d'Alger n'ayant que peu de casernes, on n'y établit que quelques bataillons ; et le reste de l'armée bivouaqua au dehors, où fut logé dans les nombreuses maisons de campagne des environs. Le général Tholozé, sous-chef d'état-major, fut nommé commandant de la place.
Dans l'ignorance où était le général en chef des intentions du gouvernement au sujet d'Alger, il se tint prêt pour tout événement. Ainsi, d'un côté, il se fit présenter un travail sur les moyens de détruire les fortifications de la marine, et de combler le port, et, de l'autre, il se livra à quelques actes administratifs qui, s'ils n'annonçaient pas une grande prévoyance, du moins semblaient indiquer le désir de conserver le pays.
Le premier de ces actes fut la création d'une commission centrale du gouvernement, chargée de proposer les modifications administratives que les circonstances rendaient nécessaires ; la présidence en fut dévolue à M. Denniée, intendant en chef de l'armée. Ce personnage, s'étant trouvé ainsi en quelque sorte le chef civil de la Régence, sous l'administration de M. de Bourmont, doit supporter la responsabilité morale de tout ce qui fut fait, ou plutôt de tout ce qui ne fut pas fait à cette époque ; car c'est par l'incurie, plus encore que par de fausses mesures, que nous avons commencé cette longue série de fautes qui rendent l'histoire administrative de notre conquête si déplorable, que pour savoir ce qu'on aurait dû faire, il faut prendre presque toujours le contraire de ce qu'on a fait.
S'il est un principe dicté par la raison et reconnu par le plus vulgaire bon sens, c'est celui qui veut que lorsqu'on est appelé à administrer un pays conquis, on respecte d'abord l'organisation administrative existante, afin d'éviter le désordre, et de conserver la tradition et la suite des affaires. On peut, plus tard, introduire avec réserve et ménagement les changements reconnus utiles ; mais dans les premiers instants de la conquête, un vainqueur sage et avisé n'a qu'à se mettre aux lieu et place du vaincu. C'est ainsi qu'on se réserve des ressources, et qu'on prévient tous ces froissements qui sont bien plus sensibles au peuple conquis que l'humiliation passagère de la défaite. Quelque peu contestable que soit ce principe, il fut méconnu par l'autorité française. Je ne sais si elle s'imagina que la population algérienne ne formait qu'une agglomération d'individus sans lien commun et sans organisation sociale ; mais elle agit exactement comme si elle en avait la conviction. Aucune disposition ne fut prise pour régler la nature des relations des diverses branches du service public avec le nouveau pouvoir. Aucun ordre ne fut donné aux fonctionnaires indigènes : on ne leur annonça ni leur conservation, ni leur destitution. On agit comme s'ils n'existaient pas: aussi, ne sachant à qui s'adresser, ils abandonnèrent le service sans en faire la remise, et en emportant, ou en faisant disparaître presque tous les registres et les documents les plus précieux. Dans la Casbah même, sous les yeux de M. Denniée, j'ai vu des soldats allumer leurs pipes avec les papiers du Gouvernement dispersés çà et là sur le sol.
Jamais, peut-être, une occupation ne s'est faite avec autant de désordre administratif que celle d'Alger, même dans les siècles les plus barbares. Les hordes du Nord, qui s'arrachèrent les débris de l'empire romain, se conduisirent avec plus de sagesse et de raison que nous n'avons fait en Afrique. Les Francs dans les Gaules, les Goths en Espagne et en Italie ; eurent le bon esprit de conserver ce qui existait, tant dans leur intérêt que dans celui des nations soumises. Lorsque les Arabes remplacèrent ces derniers en Espagne, ils ne se hâtèrent pas non plus de tout détruire ; il nous était réservé de donner l'exemple d'une telle extravagance.
Nous avons fait connaître, dans le premier livre de cet ouvrage, les principaux ressorts du gouvernement turc de la Régence : avant d'entrer dans les détails des actes administratifs de l'autorité française, nous allons expliquer, en peu de mots, quel était le gouvernement intérieur d'Alger.
Ce gouvernement qui, sous bien des rapports, mérite le nom de municipal, était basé sur les droits et les devoirs qu'une communauté, plus ou moins intime d'intérêts, établit entre les diverses catégories de citoyens. C'est à ce principe que durent le jour les Communes du moyen âge, et les grandes Assemblées représentatives des nations de l'Europe. Plus tard la révolution française a prouvé que chez un peuple avancé, ses intérêts devaient être encore plus généralisés ; mais, chez les nations qui ne sont encore qu'au second degré de la civilisation, et qui se trouvent en face d'un pouvoir violent et brutal, comme l'était celui du Dey à Alger, et celui des seigneurs dans l'Europe au moyen âge, le système des catégories d'intérêts est celui qui offre le plus de garanties aux libertés individuelles. C'est ce système qui s'introduisit à Alger sous la domination des Arabes, et que les Turcs y respectèrent.
Chaque métier formait une corporation qui avait à sa tête un syndic, appelé Amin, chargé de sa police et de ses affaires ; tous les Amins étaient placés sous les ordres d'un magistrat appelé Cheik-el-Belad (chef de la ville).
La surveillance des marchés était confiée à un magistrat appelé Moktab, qui avait le droit de taxer les denrées.
Deux magistrats étaient chargés de la police générale ; le premier, appelé Kaïa (lieutenant), exerçait pendant le jour; il était chef de la milice urbaine et pouvait être pris parmi les Kourouglis ; le second, qui ne pouvait être choisi que parmi les Turcs, exerçait pendant la nuit : on le nommait Agha-el-Koul. Un fonctionnaire particulier, nommé Mezouar, avait la police des maisons de bains et des lieux de prostitution ; il était, en outre, chargé de faire exécuter les jugements criminels.
Un employé supérieur, appelé Amin-el-Aïoun, veillait à l'entretien des fontaines, au moyen des revenus affectés à ces sortes d'établissements de première nécessité.
Tous ces magistrats étaient sous les ordres immédiats du Khaznadj qui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, était le ministre des finances et de l'intérieur.
Tel était le gouvernement de la ville d'Alger, que nous nous hâtâmes de détruire, ou plutôt de laisser périr.
On créa, pour le remplacer, un conseil municipal, composé de Maures et de Juifs. On y vit figurer tous les Indigènes qui s'étaient les premiers jetés à notre tête, c'est-à-dire les intrigants et quelques notabilités maures, dont on faisait grand cas alors, mais dont le temps nous a démontré l'insignifiance : Ahmed-Bouderbah en eut la présidence. C'est un homme d'esprit, ? n et rusé, mais sans le moindre principe de moralité, et plus tracassier qu'habile ; il avait longtemps habité Marseille, d'où une banqueroute frauduleuse le força de s'éloigner. Nous en parlerons plus d'une fois dans la suite de cet ouvrage.
Le service de la police fut confié à M. d'Aubignosc, dont il a déjà été question ; il, reçut le titre de lieutenant-général de police, et un traitement annuel de 18,000 francs, y compris les frais de bureaux. Son action dut s'étendre sur la ville et sur le territoire d'Alger. On plaça sous ses ordres : un inspecteur, deux commissaires de police, et une brigade de sûreté maure, composée de vingt agents et commandée par le Mezouar, qui conserva en même temps l'emploi de surveillant des filles publiques. Malgré tous ces moyens, et le concours de l'autorité militaire, la police française a presque toujours été au-dessous de sa mission, ce qui est d'autant plus choquant que, sous le gouvernement Turc, la ville d'Alger était peut-être le point du globe où la police était le mieux faite. Les vols, naguère presque inconnus, se multiplièrent dans des proportions effrayantes, et les Indigènes en furent encore, plus souvent les victimes que les auteurs.
Un désarmement général de tous les habitants d'Alger fut ordonné. Les Algériens, qui s'y attendaient, s'y soumirent sans murmure ; mais cette mesure fournit une pâture à la cupidité de quelques personnes. Des armes précieuses, enlevées à leurs propriétaires, au lieu d'être déposées dans les magasins de l'État, devinrent la proie de tous ceux qui furent à portée de s'en emparer tant on mit peu d'ordre dans cette opération qui en demandait beaucoup.
De tout temps, les Juifs d'Alger avaient formé vaste corporation, ayant à sa tête un chef à qui, par dérision, on donnait souvent le nom de roi des Juifs. Cette organisation fut conservée, grâce à l'influence du fameux Bacri.
Sous la domination des Turcs, les Juifs, même les plus riches, étaient traités de la manière la plus ignominieuse, et souvent la plus cruelle. En 1806, le Dey Mustapha-Pacha ne trouva d'autre moyen d'apaiser une révolte de la milice, que de lui livrer à discrétion les biens et les personnes de ces malheureux. En peu d'heures, trois cents d'entre eux furent massacrés, et on leur enleva des valeurs immenses, que quelques personnes portent à trente millions de francs ; mais patients comme la fourmi, et comme elle économes, ils eurent bientôt relevé l'édifice de leur fortune.
M. de Bourmont eut le tort, que la plupart de ses successeurs ont partagé, de se livrer trop à cette classe d'hommes : les Juifs, déjà portés à l'insolence, par le seul fait de la chute de leurs anciens tyrans, ne tardèrent pas à affecter des airs de supériorité, à l'égard des Musulmans qui en éprouvèrent une vive indignation. De tous les revers de fortune, ce fut pour eux le plus sensible, et celui qu'ils nous pardonnèrent le moins. La population Israélite doit être traitée comme les autres, avec justice et douceur, mais il ne faut en tenir aucun compte dans les calculs de notre politique envers les Indigènes. Elle nous est acquise, et ne pourrait, dans aucun cas, nous faire ni bien ni mal. Sans racine dans le pays, sans puissance d'action, elle doit être pour nous comme si elle n'existait pas ; il fallait donc bien nous garder de nous aliéner, pour elle, les populations musulmanes, qui ont une bien autre valeur intrinsèque. C'est ce que tout le monde n'a pas compris ; et la faute que nous avons commise pour les Juifs à l'égard des Musulmans en général, nous l'avons commise pour les Maures à l'égard des Arabes ; comme nous le verrons dans le livre suivant.
Une décision du 14 juillet conserva aussi la corporation des Biskris, et celle des Mozabites. Les Biskris sont des habitants de Biskra, qui viennent à Alger pour y exercer la profession de portefaix et de commissionnaire, comme le font les Savoyards pour la France et l'Italie. Les Mozabites, ou plutôt les Beni-Mezab, appartiennent à une tribu du désert, à qui le monopole des bains et des moulins d'Alger fut concédé dans le XVIe siècle, en récompense des services qu'elle rendit à l'époque de l'expédition de Charles-Quint. Ces deux corporations ont leurs syndics nommés par l'autorité française ; il en est de même pour les nègres libres, dont le syndic a le titre de Kaïd.
La capitulation ne disait en aucune manière, que la population d'Alger serait affranchie des anciens impôts, et certainement, il n'entrait pas dans la pensée de ses nouveaux dominateurs, de l'exempter de toutes les charges publiques. Néanmoins les perceptions s'arrêtèrent par suite de la désorganisation de tous les services. Il faut en excepter celle des droits d'entrée aux portes de la ville, ce que nous appelons chez nous l'octroi. Un arrêté du 9 août en affecta les produits aux dépenses urbaines, et la gestion au conseil municipal ; mais on oublia bientôt l'existence de cette branche de revenu, et les membres maures de la municipalité, auprès de laquelle il y avait cependant un Français pour commissaire du roi, se la partagèrent tranquillement, et n'en rendirent jamais de compte : ce fait peut paraître incroyable, il est cependant de la plus complète vérité. Ce ne fut que plusieurs mois après, sous l'administration du général Clauzel, que le hasard fit découvrir qu'il existait un octroi. On le réduisit alors aux provenances de mer, et on le retira à la municipalité, ainsi que le débit du sel qui lui avait été aussi affecté.
L'histoire de la douane française à Alger, offre quelque chose d'aussi bizarre que celle de l'octroi. La douane turque s'étant dispersée, fut remplacée par quelques individus qui avaient suivi l'armée, je ne sais à quel titre, et qui perçurent, sans tarif et sans reddition de comptes, pendant quinze jours. On trouva dans les magasins de la douane, une grande quantité de blé, le directeur de la nouvelle administration le prit à compte pour 4,000 sâas (mesure d'Alger de 54 litres). On en vendit pendant deux mois, et sous le général Clauzel, on trouva qu'il en restait encore 6,000 sâas. Je laisse au lecteur le soin d'expliquer ce prodige.
Il ne fut fait aucune remise des biens domaniaux, tant meubles qu'immeubles ; aussi, est-ce de cette époque, que date l'horrible chaos, qui existe dans cette branche de l'administration, laquelle a été longtemps sans titres et sans registres. Les objets existant dans l'arsenal de la marine et dans le port, furent abandonnés pendant plusieurs jours à qui voulut s'en emparer ; les bâtiments de commerce qui avaient été nolisés pour l'expédition, vinrent s'y pourvoir de chaînes, de câbles, d'ancres et d'agrès de toute espèce. Les portes de l'hôtel des monnaies, qu'on ne songea à occuper qu'au bout de deux ou trois jours, se trouvèrent enfoncées, et toutes les valeurs avaient été enlevées. Enfin, on fut loin de prendre toutes les mesures convenables pour assurer au nouveau pouvoir l'héritage intact du pouvoir déchu. M. de Bourmont peut, jusqu'à un certain point, trouver son excuse dans la douleur dont la mort de son fils avait pénétré son âme ; mais M. Desprez, son chef d'état-major, mais M. Denniée, son intendant en chef, avaient-ils aussi perdu un ? ls ?
|
|
AÏN EL TURCK
ECHO D'ORANIE - N°249
|
C'était un petit village sage
Où tous le monde se connaissait et s'estimait
Il y avait la Mairie, les P.T.T. et l'Eglise à coté
O mon village tu étais si gai que tous le monde s'amusait
Je ne peux oublier tous ce monde dispersé
Nous étions unis et nous sommes tous parti
Ain el Turck est resté mais tout à changé.
La Rue Boukhatem n'est plus la même.
Rue cap Falcon à Foutu le "con"
La place Vassas n'est plus hélas.
Tout est parti avec mon voisinage
La station Alarcon ne porte plus ce nom.
La Boulangerie Férrère est partie en l'air,
Le Kiosque Agullo est au rouleau.
La pêcherie me fait pleurer à chaque fois que j'y vais.
Car mes Souvenir sont restés
Ain el Turck c'était un village mais aussi la reine de plage
L'algérie vous embrasse et vous envoi des caresses
Elle était votre maîtresse et plus maintenant hélas
Mais il ne faut pas lui en vouloir car elle vous aime encore
Louisa Boukhatem
Je dédie ce poème à tous les Pieds-Noirs d'Ain-el-Turck, notre village natal où nous sommes tous nés et grandis et finalement quitté, hélas et particulièrement à notre voisin M. Tari.
|
|
|
RAID TERRORISTE
HIER SOIR A BONE
Date inconnue de ces attentats
Envoyé par J.L. Ventura
|
|
Une jeune fille et deux Musulmans tués
5 Européens dont deux policiers blessés
UN HORS-LA -LOI ABATTU
 BONE (D.n.c.g.). - les terroristes ont opéré hier soir, en plusieurs endroits de la banlieue bônoise. Alors que Ia nuit descendait lentement, vers 17 h. 30, un groupe de terroristes embusqués rue de Bélisaire, non-Ioin du Ruisseau d'Or, dans le quartier des Cités, ouvrit le feu sur des Européens. Une jeune fille, qui circulait, fut mortellement blessée et devait succomber peu après l'agression. II s'agit de Mlle Josette Gauci, âgée de 20 ans. BONE (D.n.c.g.). - les terroristes ont opéré hier soir, en plusieurs endroits de la banlieue bônoise. Alors que Ia nuit descendait lentement, vers 17 h. 30, un groupe de terroristes embusqués rue de Bélisaire, non-Ioin du Ruisseau d'Or, dans le quartier des Cités, ouvrit le feu sur des Européens. Une jeune fille, qui circulait, fut mortellement blessée et devait succomber peu après l'agression. II s'agit de Mlle Josette Gauci, âgée de 20 ans.
Aussitôt les forces de police, aidées par une patrouille d'une unité territoriale, encerclaient le quartier. Les rebelles surpris ouvrirent le feu sur les forces de l'ordre pour se dégager. Le commissaire de la police d'État. M. de Landau, fut blessé grièvement d'une balle au ventre, et le gardien de la paix Tabone reçut une balle en plein corps. Deux français-Musulmans qui se trouvaient à proximité furent tués, atteints par plusieurs balles.
Profitant de la surprise les terroristes prirent la fuite malgré l'énergique riposte des forces de l'ordre.
Grenade dans une épicerie
Pendant que se déroulait cette tragique fusillade, les terroristes lançaient une grenade dans l'épicerie de M. Portelli située rue Mirabeau dans le quartier de la Cité Auzas. A ce moment quelques personnes se trouvaient à l'intérieur du magasin. L'engin explosa et blessa aux jambes Mme Renaud, âgée de 70 ans, habitant rue Sisovath et le Jeune Bernard Portelli âgé de 7 ans, fils du propriétaire de l'épicerie. Les terroristes s'enfuirent vers la rue Célestin Bourgoin, en protégeant leur fuite de plusieurs coups de feu.
Pris en chasse par la police, l'un d'eux fut abattu. Il était porteur d'un revolver de calibre 6 mm 35.
Un scootériste blessé
Vers 18 heures hier également, un scootériste, M. Henri Baudon, potier, circulait sur la route du Pont Blanc. Les terroristes tirèrent sur lui plusieurs balles, l'une d'entre elles atteignit M. Baudon qui tut légèrement blessé.
Une vraie opération a été aussitôt déclenchée dans ces quartiers périphériques de la ville par la police et l'armée. Des suspects ont été arrêtés.
Grenade dans une bijouterie
Un autre attentat à la grenade a été commis le matin en plein centre de Bône à une heure où l'affluence est nombreuse. En effet, Il était 11 heures 30 lorsqu'un terroriste lance une grenade dans la bijouterie Carlin Santoni, située rue Trézel, à quelques mètres du Cours Bertagna, face au Crédit Lyonnais. A ce moment deux employées se trouvaient à l'Intérieur du magasin derrière le comptoir. Elles purent se jeter à terre avant l'explosion de l'engin qui fit des dégâts Importants, de nombreuses, glaces ainsi que des objets de valeur s'étant cassés par la déflagration. Aucune employée ne fut blessée. A l'issue de l'attentat, un individu qui s'enfuyait sous les arcades du cours Bertagna, poursuivi par un autre fut arrêté et conduit au commissariat. S'agit-Il du terroriste ? La police poursuit son enquête.
Coups de feu sur le commandant
de la station hertzienne à Bugeaud
A quelque, kilomètres de Bugeaud, station estivale située à 14 km de Bône, leu rebelles utilisant des armes de guerre ont tiré hier, neuf coups de feu sur le commandant de la station hertzienne qui n'a pas atteint. Les rebelles se sont enfuis.
B. L. de la dépêche de l'Est
|
|
UN CHANT DANS LA NUIT
L'Effort Algérien N°36, 7 janvier 1928.
|
Au cours d'un voyage que je fis, il y a quelques années, à travers la Kabylie - aux sites agrestes, pittoresques et enchanteurs, il m'arriva d'être surpris par la tombée de la nuit, dans un douar éloigné de la gare. Les seuls européens installés dans ce douar sont des Religieux Franciscains, qui s'empressèrent - aussitôt que ma présence leur fut signalée - de m'offrir l'hospitalité nécessaire. J'acceptai cette aimable invitation.
L'établissement de ces prêtres Franciscains est situé sur une colline d'où l'on découvre un immense et merveilleux panorama. Le clocher du couvent dresse sa silhouette simple, mais majestueuse, face au Djurdjura que les connaisseurs appellent : les Alpes Algériennes. A l'époque où j'effectuai le voyage que je narre ici, les cimes du Djurdjura étaient recouvertes du manteau blanc de la neige. Spectacle grandiose qui procure la joie des yeux, et l'élévation de l'âme - attirée à son insu, vers l'Infini, vers DIEU, son Créateur. Vision enchanteresse, dont je pus jouir tout à mon aise, dès mon réveil, le lendemain matin.
Entre nous, chers lecteurs, je puis vous confier que j'eusse préféré descendre dans un quelconque hôtel, pour y dîner et y passer la nuit. Le motif ? C'est que, quoique profondément croyant, et, sans doute à cause de cela même, j'ai toujours eu une grande aversion pour ce que l'on est convenu de désigner sous le nom de " cléricalisme ". J'ai dévoré (excusez l'expression), tant de lectures sur ce sujet ! Ces Religieux Franciscains me paraissaient, à priori, incarner l'esprit de domination, de dictature, de théocratie sociale, en un mot foncièrement opposé à mes idées de liberté et de démocratie.
Faute de restaurant, ou d'auberge quelconque, et n'ayant pas l'embarras du choix, je deviens donc l'hôte de ces Messieurs Franciscains. Je suis loin de le regretter.
Nous causâmes longuement. Il fallut me rendre à l'évidence, c'est-à-dire à une plus exacte et plus équitable appréciation du rôle, de l'œuvre de ces prêtres installés au milieu des populations si laborieuses de Kabylie. Se tenant à l'écart des agitations politiques qui divisent souvent les hommes, le programme de ces missionnaires consiste à faire du bien, le plus de bien possible autour d'eux. Pratiquant ainsi la philanthropie sociale, sous mille formes, ils s'efforcent, de plus, de conquérir au Christianisme, les pauvres âmes innombrables, égarées dans tes ténèbres islamiques. Ce programme est tout simplement magnifique, admirable.
J'interrogeai une foule de gens, musulmans el convertis. Tous furent unanimes à me louer les qualités et les vertus du R. P. Louis Vidal, le supérieur de la Mission des Religieux Franciscains. Sa simplicité, son esprit de dévouement, sa charité exemplaire, sa bonté inépuisable, sa vie digne et honorable, lui ont valu un respect le plus grand en même temps qu'une sympathie générale et ardente. Il me faut également ajouter que la bonne Mère Jean-de-Dieu, Supérieure des Religieuses Franciscaines, dans ce même douar, personne dévouée et aimable, jouissait, elle aussi, d'un grand crédit et d'une affection déférente, mais vive, tout à fait justifiée.
Le dîner, composé du menu frugal ordinaire - auquel, cependant, on avait, en mon honneur, ajouté un supplément - venait d'être achevé. Les Franciscains, quittèrent le modeste réfectoire et montèrent au premier étage, où se trouve leur chapelle, afin d'y réciter, en commun , la prière du soir.
Pendant ce temps, je me mis à faire les cent pas dans la cour de la maison religieuse, tout en savourant - en vrai touriste et en bon fumeur qui se respecte - un de ces cigares londrès dont j'avais fait, lors de mon départ d'Alger, provision pour mon voyage.
II fait une obscurité profonde. La population paysanne et travailleuse des montagnes du Djurdjura, se couche dès la tombée de la nuit, dans ces villages aux maisons basses, dénuées de tout confort, sans cheminées, sans fenêtres - maisons entassées les unes contre les autres sur les hauteurs. Le silence est complet, impressionnant. Il n'est troublé que par les aboiements de chiens que l'on entend là-bas, dans le lointain. On entend aussi le murmure régulier, monotone mais agréable, de la rivière qui coule paisiblement, au fond de la vallée.
Cependant, il n'est pas encore neuf heures - disons 21 heures - c'est-à-dire le moment où, dans les villes, la foule joyeuse et avide de plaisirs, envahit les salies de spectacles : théâtres, cinémas, dancings.
Ici, tout dort. Nul bruit. On se croirait presque dans un pays inhabité. Pas le moindre réverbère dans ces montagnes. La seule lumière encore visible est celle que projette, dans la cour où je continue à me promener, en fumant, la fenêtre de la chapelle des Pères Franciscains.
Or, voici que des voix d'hommes, graves et lentes, s'élèvent soudainement, coupant le silence. J'entends également l'accompagnement d'un harmonium.
Qu'est-ce donc ? C'est le chant suave du " Sancta Maria ". Les paroles latines se succèdent en l'honneur de la Vierge du Ciel. J'écoute la ravissante musique.. Succure miseris... ora pro populo...tuum sanctam commemoralionem. Maintenant, c'est fini. La nuit redevient silencieuse.
Chaque Franciscain - après cet hymne à Notre-Dame-d'Afrique - rejoint sa cellule. Je monte dans la " Chambre des Etrangers ", qui m'a été indiquée avant le dîner. Probablement plus confortable que les autres, elle se compose du mobilier suivant : un lit en fer (à une place), deux chaises, une table de nuit, une table à écrire ; c'est tout. J'y ai excellemment dormi.
De bonne heure, la cloche du couvent me réveille. Je remercie les Religieux Franciscains de leur délicate attention à mon égard, et je prends congé d'eux. Je regagne la gare, pour rentrer à Alger, me promettant bien de relater pour les lecteurs de l'Effort Algérien ces impressions de voyage, et notamment le charme incomparable que produisit sur mon âme, le chant du "SANCTAMARIA", en Kabylie... chrétienne, ou... musulmane (comme on voudra).
(Un conseil en terminant : ne cherchez par trop à savoir si les Religieux dont je vous ai entretenu sont ou ne sont pas réellement des Franciscains.)
Joseph Zentar
|
LES ŒUVRES DE MUSETTE
LE MARIAGE DE CAGAYOUS
|

CHAPITRE V
Scaragolette
Le petit à ma soeur y g... à mort en sautant dessus un pied comme si jouerait à la marène.
D''aoùsque que tu viens, petit cochon, et quoi c'est ti as fait encore ? elle crie Chicanelle. Voir moi ça qu'il a l'ait vec son tablier que ,j'y a mis prope ce matin ! Me casse pas les oreilles ; j'a pas assez me faire le mauvais sang vec ton père et vec ton onque, non ?
- Kiki y m'a mordu, y g... Scaragolette.
- Qui c'est Kiki ? Le petit à la charbonniere.
Non. C'est le chien à Thomasette, du temps que nous jouons le tchic-tchic.
- Et aoùsque y t'a mordu, Kiki ?
- Je sais pas, y pleure Scaragolette.
- C'est bien fait pour toi ! Ça t'apprendra de pas jouer vec les chiens, une aute fois.
C'est lui qu'il a commencé, pourquoi j'y a touche un peu la queue vec la cigarette que j'a ramassée.
Vec la cigarette allumée ? j'y demande à le petit.
- C'est Thomasette qui se tirait une bouchée ; moi non.
Manque plus que tu fumes le tabac à prisent, elle crie Chicanelle en colère. Si jamais je t'attrape, je te tombe les dents vec un soufflet, petit merdeux !
- C'est pas moi !
Tu veux te taire. Hein, ou tu veux la raclée ? Mouche toi ton nez ça vaudra mieux...Pas vec ton tablier, spèce de vaurien. Ti as pas le mouchoir ? Qu'est-ce ti as fait de cuilà que je t'a ,mis dedans la poche ?
- Un enfant y m'a fait mendja galette.
- Fais voir ici que je t'assomme.
Oilà Scaragolette qui se sort d'en dessous ses effets un bout du chiffon sale, vec tout plein des noeuds, qu'un y a une pierre dedans.
Pour l'amour à Sainte-Joséphine, elle dit nia soeur, arrégardez-aloi ça qu'il a fait vec son mouchoir tout neuf ! Dessur la paille y me met ce petit si je le laisse ! A l'Harrach, tu rentres un jour, c'est moi que je te le dis. Mais arrégardez-moi ce mouchoir quel état qu'il a mis !
C'est pas moi, y répond Scaragolette ; c'est un enfant.
-- Comment qui s'appelle "
II a pas le nom.
Assez, petit menteur !
Pourquoi tu le portes pas à l'école pour qu'on s'apprend à lire, j'y demande à ma soeur ?
- Y a pas la place ; à une aute école que j'a été, on l'a pas voulu qui rentre pourquoi il a un blanc dessur la tète que ça ressemble la pélate. Un coup de caillou c'est je m'en rappelle bien, va. Et pis faut qu'on porte l'astrait de naissance. Moi je veux pas qu'on connait que Scaragolette il est naturel et que tous les enfants y se l'appellent bâtard. Mieux qui reste bourriquot jusqu'à temps que son père il l'aye reconnu.
- Par force faut que tu te l'envoves à l'école. Y a la loi dessur ça.
- Assez ! et moi ça nie fait plaisir que mon petit y reste vec moi. qui c'est qui me commande ? Amène le cuilà-là. que nous parlons moi et lui...
Scaragolette ! Aousqu'il a parti encore ?
Scaragolette, sans dire rien, y s'avait plongé la tête dessur un bout de pain, y s'avait choppé une poignée des olives cassées dedans la jarrette qu'elles sont, et vingà de se trotter dehiors. Scaragolelte il aime se barbotter les olives pour jouer à lancer les noyaux vec le tuyau comme si ça serait les lionces. Le goût, maintenant, c'est qu'on va se casser les verres à les lampes à les magasins. Vec Scaragolette faut rouvrir l'oeil dessus tout à la maison ; chaque chose que ça li plait, y se le barbote pour jouer. Avant, quand ma soeur elle s'achetait les allumettes bougie bleues, qu'un li dit les allumettes arabes, jamais y reste une boite ; Scaragolette y se les portait dessur les rails à les tramelecs pour les faire péter. Qué filou qu'il est ce gosse là !.
- Faut que je me l'attache vec la corde, à le pied du lit, elle dit Chicanelle. C'est trop, ça qui me fait faire la bile, ce petit !
- Laisse-le qui prend l'air, va ! Dedans la rue y s'apprend ça que c'est le monde, mieux que dedans les jupons de sa mère.
Pardi, toi ti as passé le temps dessur les pavés, c'est naturel que tu parles comme ça ! Mais au jour d'aujourd'hui le monde il a sang : pour manger le pain, y faut abaisser sa tète.
- Encore tu parles vec le pain ? Tout à l'heure, tu dis que les filles elles se prend un homme rien que pour manger le pain...
- C'est faux. J'a dit comme ça que quand un homme y se marie. y faut qu'il aye de quoi donner à manger à sa femme.
- Le pain, le pain, ti as dit.
Bien sûr qui faut gagner le pain, les hommes comme les femmes, naps que ti es ! Assez. ho, d'angorer à le pibllic vec le pain. Moi je me connais des filles qu'elles gagnent cinquante sous par jour à la fabrique et qu'elles dépensent rien que dix sous pour manger. Ça qui reste c'est pour s'acheter la robe, les rubans, la poude de riz, l'odeur, les bottines, le chapeau et un tas des trucs, comme si elles font concurrence à les femmes riches. Chaque bonne qu'y a, à présent, elle veut s'habiller la même chose qu'à sa patronne. On pense rien que à faire des osquinfes et un tas de fantaisies que ça fait ch... Si la bonne elle se tient la sanche que sa bourgeoise elle est un peu fourneau et que le patron il a le flous, elle continence de li jeter le broumitche vec les cheveux bien anrangés, vec le peigne doré, vec quate ou cinq dimi jupons par en dessous sa robe que ça li fait la popa comme une pastèque, et après, vingà de s'amorcer à le type sans faire ensemblant, jusqu'à temps qui s'y achète les meubes et tout ça qui faut... Tss ! tu te crois qu'on connait pas alorss !
- Mieux que tu dis qu'y a pas des femmes qu'elles sont honnêtes ! Si les hommes ça serait pas tous des crapules, les femmes elles viendraient pas si malheureuses.
Qui c'est qu'il a commencé à sercher à l'aute, qui c'est ? A peine une fille elle commence de pousser les tétés, tout de suite elle veut qu'on fait entention dessur elle. Sans dire rien, elle fait la provocation. Et après. si un y se choppe le hameçon qu'un li catouille le nez et qui vient ça qui vient, oilà la fille qu'elle dit qu'on l'a trompée, que les hommes c'est des cochons qui pensent rien que rigoler et un sac des histoires que ça fait sortir tous les concierges de dedans son trou...
- C'est dedans les livres que ti as appris tout ça ? Eh bien, c'est pas pour dire. mais ça vaut mieux que tu restes bourriquot comme avant, pourquoi ti as perdu tous les économies de l'entelligence que ti avais mis à la caisse d'épargne. Toi tu parles de rien que de. ça que ti as vu ; et ça que ti as pas vu ça compte pas. Tout le temps tu restes dedans la rue, forcé que tu connais rien que les filles de les rues. L'aute qualité elle est en dessur de toi. Dommage qu'une fille comme je dis moi, elle aye port son coeur dessur un endividu qui vaut pas la corde qu'on s'attache les balais.
Quelle fille elle a porté son cœur dessur mon endividu ? Quelle ? Ma parole j'y envoie le portrait.
Ça te régare pas. Ça c'est muon affaire. Mais n'aye pas peur, va, je m'en vais y sortir le gout rien qu'en li faisant voir ça qu'il est ton niméro. Y manque pas des junhomnes cent mille fois pluss mieux que toi qui seront contents qu'un li porte la dot vec la fleur d'oranger et tout ça qui faut pour venir heureux.
- Splique de quoi tu parles au lieur de faire un tas des divinettes qu'on comprend rien.
- A quoi ça sert ? Foutche d'ici, va-t-en faire l'armée vec tes camarades. Mecieu Hoc il a bien raison.
Sacramento ! T'y diras à Mecieu Hoc que j'y pisse à l'endroit qu'on se commence à les couffins, de ma part. Je n'emporte à Scaragolette pour y payer la crème.
Laisse le petit là ousqu'il est. C'est pas la peine que t'y apprends à venir un voyou comme toi.
- Tu veux qui vienne avocat ou chef de garé, ho ?
Quand même y sera rien, encore sera pluss que toi, n'ave pas beur !
- Combien le kilo tu le vends :'
Ça iavous, elle crie ma soeur. si tu t'en vas pas d'ici, je sais pas quoi je t'envoie des-sur. Allez. balk, sale personnage.
J'a plus de courant. ho !
Comme Chicane!le elle est capabe de me f... dessur le caillou le fer à répasser qu'elle s'avait empoigné, j'a descendu en devant la porte, en bas la rue, pour arrégarder Scaragolette qui s'avait grimpé en haut un arbre.
(A suivre......)
|
|
PHOTOS de KIOSQUES
Envoyé par M. Remy Lafranque
|
|
Docteur, j'ai un problème.
Envoyé Par Mme Elyette
|
|
Docteur, j'ai un problème. Tous les soirs, quand je suis au lit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un caché dessous. Alors, je me relève pour regarder sous le lit et, bien sûr, il n'y a personne. Je me recouche, mais au bout d'un moment, je me dis que je n'ai peut-être pas bien regardé. Alors je me relève pour vérifier de nouveau, sans résultat bien entendu. Bref, j'ai beau me dire que c'est idiot, je ressens toujours le besoin de m'assurer que personne n'est caché sous le lit. Ça dure toute la nuit ... Docteur, tout cela me pourrit la vie, pouvez-vous faire quelque chose ?
Le psychiatre : Hum... Je vois... obsessionnel compulsif... Comptez quatre ans d'entretiens de psychothérapie, à raison de trois séances par mois, et je vous guéris de votre obsession.
Le patient : Euh... Combien ça va me coûter, Docteur ?
Le psychiatre : 60 euros par séance. Donc 180 euros par mois, soit 2160 euros par an et donc 8640 euros au final.
Le patient songeur : Euh... je crois que je vais réfléchir.
Six mois plus tard, le psychiatre rencontre le type dans la rue, par hasard :
Alors ? Pourquoi n'êtes-vous jamais revenu me voir ?
Le patient : C'est que ... 8640 euros ... alors que mon livreur de pizza m'a résolu mon problème pour 30 euros seulement.
Le psychiatre vexé : Votre livreur de pizza ? Vraiment ? Et comment a-t-il fait ?
Le patient : Il m'a conseillé de scier les pieds de mon lit !
Bonne journée Docteur.
|
|
|
| Yousouf, Un exceptionnel destin
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Archives militaires - Yusuf par E. Balme - l'Algérie de 1830 à 1840 - annuaire encyclopédique - documents officiels - annales algériennes
Joseph Venturi dont l'origine est assez incertaine et l'histoire diversement racontée, surtout dans la première partie de sa vie, est né en 1809 sur l'île d'Elbe. Il raconte que très jeune en 1814 il a vu Napoléon mais ne garde aucun souvenir de ses proches ; Pauline Borghèse, sœur de l'Empereur venue lui rendre visite, séduite par l'intelligence de l'enfant aurait proposé de prendre à sa charges ses études dans un collège de Florence ; d'autres sources indiquent que c'est sa famille qui aurait eu ce dessein.
A cette époque la Méditerranée était infestée de corsaires. Le bateau qui cinglait toutes voiles aux vents vers les côtes toscanes et à bord duquel avait pris place l'enfant âgé d'environ sept ans, fut attaqué et arraisonné par des marins barbaresques ; Joseph fut fait prisonnier et débarqué à Tunis où ses geôliers le livrèrent au Bey. On aurait alors pu penser qu'il serait destiné, comme d'autres d'ailleurs, à devenir eunuque, mais le sort en décida autrement.
Résidant au palais il fut remarqué par un chirurgien français qui fortement impressionné par sa vivacité intellectuelle usa de son influence auprès du Bey afin de permettre à l'enfant d'échapper à un si funeste sort ; il obtint du souverain la promesse de diriger le jeune garçon vers l'école des Mameluks que certains rejoignaient dès l'âge de treize ans.
Résidant dans le sérail on lui fit alors embrasser d'autorité la religion musulmane et Joseph, comme par enchantement, devint Yousouf. Il ne tarda pas grâce à son esprit vif à se faire remarquer de ses maîtres ; Jusqu'à l'âge de douze ans il suivit l'enseignement difficile de la rigoureuse école coranique; il apprit l'Arabe, l'Espagnol, le Français, le Turc langues qu'il parla, semble-t-il couramment, et la maîtrise de l'art de la guerre ; peu à peu on loua son adresse, sa folle témérité et son courage hors du commun.
Avant d'atteindre ses vingt ans il fut nommé Bey de camp, distinction équivalente à celle de général français ; respecté, admiré, vénéré par le peuple, ce chef des Mamelouks (1) du souverain tunisien s'illustra dans de nombreuses campagnes et combats auxquels il participa hors de Tunisie.
A son retour en 1830 il retrouva la compagne de jeux de son enfance, la princesse Kabira marié à un prince ; une tendre complicité et une passion brûlante uniront les deux jeunes gens ; on murmure même qu'un eunuque les ayant surpris, Yousouf prit l'audacieuse décision de le suivre dans les jardins du palais, de l'attendre en embuscade et de le massacrer. Victime de sa folle imprudence il fut alors forcé de chercher son salut dans la fuite et prépara son évasion u pays.
Il quitta le sérail en concevant, avec la complicité du consul général de France, un stratagème lui permettant de fuir et d'échapper à une inévitable arrestation. Un accord intervenu entre le commandant d'un brick l'Adonis et le représentant français en Tunisie permit à Yousouf d'embarquer et d'arriver le 14 juin 1830 tout près d'Alger, à Sidi Ferruch, où l'escadre préparait les premières missions de la conquête.
Il entra au service de la France et toute incertitude sur les évènements passés de sa vie disparaît ; sa connaissance des langues apprises à Tunis et plus particulièrement l'Arabe et le Turc vont faire de lui un auxiliaire précieux et un interprète de tout premier choix ; il obtint et donna à ses supérieurs de précieux renseignements sur les mœurs, la tactique, les armes des Arabes.
Plusieurs missions périlleuses dont il s'acquitta avec zèle et intelligence auprès des chefs de plusieurs tribus éloignées lui ouvrirent la carrière des armes
Après la prise d'Alger le général Clauzel le nomma agha puis, en décembre 1830, capitaine à titre provisoire au premier escadron des chasseurs algériens. Il se fit rapidement remarquer par ses qualités de guerrier, de stratège, par un courage à toutes épreuves et une rare intelligence ; son grade de capitaine lui fut définitivement acquis en mai 1831. L'un de ses plus grands faits d'armes resta la conquête de la ville de Bône en mars 1832.
Après le pillage et la dévastation de sa ville par les troupes du Bey de Constantine, Ibrahim le Bey de Bône avait réussi bien difficilement à repousser les assauts meurtriers et répétés de Ben Aïssa ; doutant peut-être de la capacité de résistance de ses soldats il évacua la ville et se réfugia à Bizerte. Yousouf conçut avec le capitaine d'Armandy le projet de s'introduire dans la ville avant que les assiégeants ne s'en aperçoivent ; lorsque le pavillon français fut arboré, Ben Aissa lança une violente attaque contre la ville qui échoua; il envisagea alors de corrompre quelques militaires de la garnison chargés d'assassiner les deux officiers, de massacrer les soldats et de s'emparer de la citadelle ; ces derniers avisés du complot rassemblèrent les conjurés et Yousouf leur dit : " Vous avez résolu de livrer la Casbah à l'ennemi; Vous êtes des traîtres et des lâches ; je sais que certains d'entre vous ont résolu de se défaire de moi et que c'est la nuit prochaine qu'ils ont choisi pour mettre à exécution leur infâme projet. Les coupables me sont connus; qu'ils frappent d'avance ceux qui ne craindront pas de porter la main sur leur chef ; Jacoud, Mouna, vous restez impassibles ; Voici le moment propice de mettre une partie de votre projet à exécution : frappez, je vous attends. Vous ne me donnez pas le signal de l 'attaque alors moi je commence " et de deux coups de pistolet il leur fracassa le crâne puis à la tête de ses troupes il fit subir à Ben Aïssa de bien cruelles pertes.
Quelques mois plus tard Ibrahim voulut reprendre la ville à la tête d'une troupe de 12 à 15.000 hommes, Youssouf fit une sortie dont lui seul avait le secret et le battit définitivement.
Ses faits d'armes et sa brillante conduite lui valurent en avril 1833 le grade de chef d'escadron du troisième régiment de chasseurs d'Afrique et pendant trois ans d'un séjour ininterrompu à Bône ; il montra maintes fois son courage et son habileté à mener une attaque. Il fit subir aux soldats du Bey de Constantine, qui avaient ravagé le territoire des Eulma alliés de la France, une cinglante et cuisante défaite. Près de 200 ennemis tués et 40.000 têtes de bétail capturées.
Yousouf fut nommé bey de Constantine mais ce titre ne fut jamais qu'honorifique.
Après la malheureuse expédition qu'il avait provoqué contre cette ville en représentant la marche sur cet objectif comme une promenade militaire, il quitta Bône en mai 1837 pour regagner Paris durant un an.
De retour en Algérie , le maréchal Bugeaud demanda, en 1842, qu'il soit promu au grade de colonel et commandant de tous les spahis car, disait-il,
" il était bien peu d'officiers de cavalerie légère qu'on puisse lui comparer et que jamais on n'avait montré plus d'élan, plus d'activité d'esprit et de corps ".
En 1843 sous les ordres du Duc d'Aumale il participa à la prise de la smala d'Abdel Kader puis en 1844 à la bataille d'Isly, à la frontière marocaine contre les troupes du sultan du Maroc Moulay Abd- er- Rahman et sous le commandement du général Bugeaud.
Par la suite Il obtint la reddition des tribus kabyles et s'empara en 1852 de la ville de Laghouat.
Après un court séjour en Crimée il devint gouverneur de la ville d'Alger de 1855 à 1865, puis nommé général en 1856 ; il participera aux opérations de Kabylie et a l'expédition du Djurjura.
En 1865 Napoléon lll nomma Mac Mahon gouverneur général de l'Algérie ; mais l'homme peu enclin à partager les honneurs posa comme conditions avant d'accepter son poste que Yousouf soit affecté en Métropole. Le 8 mai 1865 le héros emblématique quitta Alger salué sur le port par une foule enthousiaste où européens, arabes, kabyles, noirs, civils et militaires se mêlent, animés par la même ferveur.
Nommé commandant de la division de Montpellier en 1865, il s'éteignit à Cannes le 16 mars 1866 ; quelques jours après, ramené à Alger, l'armée et la population lui firent des funérailles nationales et selon ses vœux il fut enterré dans les jardins de sa villa ; il y reposera jusqu'en 1909 puis inhumé au cimetière de Saint Eugène à la périphérie de la capitale.
Commandeur de la légion d'honneur en 1843, puis grand officier en 1852, il fut promu grand-croix en 1860.
En 1845 il avait abjuré le mahométisme, s'était reconverti à la religion chrétienne et avait épousé une nièce du général Guilleminot ; il aimait profondément l'Algérie et ne la quitta qu'à regret.
Mais n'est-ce pas le capitaine Pélissier qui détenait une partie de vérité sur le cheminement exceptionnel de Yousouf lorsqu'il disait : "On a donné à Joseph plusieurs grades dans l'armée, c'est une faute; on l'a fait capitaine et chef d'escadron : c'était lui mettre des lisières que sa structure ne comporte pas, le turban lui allait infiniment mieux; c'était l'étouffer sous un habit étranger, il fallait lui laisser le sien. Qu'est-il arrivé ? Lorsqu'il était chef d'escadron pour nous, il est resté bey pour les Turcs à Bône qui lui rendaient des honneurs inconnus, qui lui baisaient les mains. C'est que, malgré nous et malgré nos formes, il est resté lui et c'est là le seul rôle qui puisse nous donner cet homme tout entier. On pouvait le grandir par la dénomination si l'on ne pouvait le grandir par le grade. On l'eût appelé bey, cheik, gouverneur ; c'eût été un commandement à siéger au milieu des Arabes qu'il fallait demander pour lui; avec son courage éprouvé, sa connaissance de la langue du pays il était dans les conditions du succès et c'est le succès que nous devions chercher.
Aujourd'hui que Joseph est arrivé à l'apogée de l'avancement nous ne pouvons plus y rien changer. Nous l'avons fait général et nous avons par conséquent récompensé amplement ses services. Depuis, il a épousé une Française, une jeune personne appartenant à une des meilleures familles de la capitale et il est maintenant dans les meilleures conditions pour devenir nôtre et par conséquent se faire naturaliser Français ".
La vie de cet homme étonnant, habile, intelligent et rusé ne fut qu'une succession d'aventures aux multiples facettes, et aux rebondissements souvent surprenants, voire rocambolesques :
Captif du bey de Tunis alors qu'il n'était qu'un enfant, amoureux d'une princesse, fuyant le pays pour débarquer en Algérie en 1830, interprète de l'armée française, chef des spahis, couvert de gloire grâce à ses exploits guerriers, général, on a dit de lui qu'il fut un homme exceptionnel, au destin hors du commun, audacieux, courageux, téméraire, dévoué envers ceux dont il avait reçu les bienfaits et fidèle dans ses affections et ses amitiés.
Mais cette vie trépidante recèle, à n'en point douter, des périodes moins brillantes peut-être, moins connues certainement; et si des ombres subsistent encore sur l'épopée, elles aussi concourent à apporter ce charme et ce mystère qui entourent très souvent les héros et participent au mythe et à la légende… Yousouf fut de ceux-là.
C. Graille
(1) troupes d'élite, membres d'une milice formée d'esclaves ou de captifs au service des califes musulmans et de l'empire ottoman.
|
|
| Voyage dans la Régence d'Alger
Par le Docteur Shaw. Edition 1830 (a)
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Texte traduit de l'anglais par J. Mac Carthy, membre de la société géographique de Paris.
Toutes les denrées nécessaires aux besoins de la vie sont ici à très bas prix. Par exemple on peut se procurer pour moins d'un centime (1) un gros pain, une botte de navets et un petit panier de fruits. Une volaille vaut 25 centimes, un mouton environ 4 francs 40 centimes, et une vache avec son veau 25 francs. Le blé ne coûte ordinairement, année commune, qu'un franc 50 à 1 franc 80 centimes le boisseau (2).
Cette modicité de prix est un bienfait pour les habitants du pays qui, comme tous les Orientaux, mangent beaucoup de pain. En effet on compte que sur quatre personnes, il y en a trois qui s'en nourrissent exclusivement, ou tout au moins de pâtes faites avec de la farine d'orge et de froment.
Il existe dans toutes les villes et les villages des fours publics. Les Maures font ordinairement lever la pâte ; mais il n'en est pas de même des Bédouins, qui, dès que celle-ci est pétrie, en forment des gâteaux minces, qu'ils cuisent sur la braise ou dans un tajen (3). Tels étaient les pains, les beignets et les gâteaux sans levain dont il est si souvent mention dans l'Écriture Sainte.
Dans la plupart des familles on moud soi-même le froment et l'orge dont on a besoin.
Outre le bouilli et le rôti (plats qu'ils accommodent d'une manière fort délicate), les Turcs et les Maures mangent encore toutes sortes de ragoûts et de fricassées. Chez les gens riches, on sert aussi un grand nombre de plats d'amandes, de dattes, de confitures, de laitage, de miel et d'une multitude d'autres comestibles semblables dont il serait ennuyeux de faire ici l'énumération. J'ai vu quelquefois servir dans leurs fêtes plus de deux cents plats qui étaient apprêtés au moins de quarante manières différentes.
Mais les Bédouins et les Kabyles n'ont ni les ustensiles ni les commodités nécessaires pour faire des repas aussi splendides. Deux ou trois plats de bois, un pot et un chaudron composent toute la batterie de cuisine du plus grand émir.
Tous, depuis le plus pauvre Bédouin jusqu'au plus riche pacha, ont cependant la même manière de prendre leur repas. Ils se lavent premièrement les mains, après quoi ils s'asseyent les jambes croisées autour d'une natte ou d'une table basse. Mais ils n'ont pour tout linge de table qu'un grand essuie-mains qui est disposé autour de la table. L'usage des couteaux et des cuillers n'est pas général parmi eux, leurs viandes étant bouillies ou rôties au point qu'il n'est pas nécessaire de les découper. Leur couscous et autres mets du même genre que nous mangerions à la cuiller se servent tièdes.
Aussitôt que la table est servie, les convives mettent tous à la fois la main droite dans le plat, puis chacun en retire avec les doigts la quantité suffisante pour une bouchée et en fait dans la paume de la main une petite boulette qu'il avale ensuite. Dès qu'un convive a mangé suffisamment, il se lève, et après s'être lavé, s'en va, sans proférer un mot et un autre prend aussitôt sa place. Il en résulte souvent que le valet succède à son maître car ces peuples ne connaissent pas l'usage d'avoir plusieurs tables.
Lorsqu'ils prennent leurs repas ou pour mieux dire toutes les fois qu'ils mangent ou boivent, qu'ils travaillent ou qu'ils entreprennent quelque chose, ils ne manquent jamais de prononcer avec beaucoup de respect et un grand sérieux le mot bismallah, c'est-à-dire au nom de Dieu ; et lorsqu'ils ont fini de manger ou de travailler celui d'alhamdjllah, ou le Seigneur soit loué !
Les Turcs et les Maures se lèvent en général de très bonne heure et ne manquent jamais de faire leurs dévotions publiques au point du jour ; ensuite chacun se met à son ouvrage ou vaque à ses affaires accoutumées jusqu'à dix heures qui est ordinairement celle du dîner (4) ou du soleil couchant ; on prie encore lorsque le guet commence sa ronde et on se couche dès qu'il fait nuit (5).
Beaucoup de gens oisifs passent la journée à causer dans les hafeffs (boutiques de barbiers), aux bazars ou dans les cafés tandis que nombre de jeunes Turcs et de Maures, ainsi que des militaires non mariés, font des parties de plaisir à la campagne ou se divertissent dans quelques lieux publics ; ce qui, à la vérité, est expressément défendu par leur religion mais que les magistrats sont souvent obligés de tolérer pour différents motifs.
Les Arabes, quand ils ne sortent pas, restent tranquillement chez eux à fumer au frais. Ils ne connaissent point les plaisirs domestiques et ne savent ce que c'est de causer avec leurs femmes ou de jouer avec leurs enfants. Tout ce qu'ils aiment le plus au monde, ce sont leurs chevaux, qui sont les seuls objets de leurs soins ; ceux dans lesquels ils font consister leurs plus grandes jouissances ; et jamais ils ne sont plus satisfaits que lorsqu'ils se trouvent éloignés de chez eux, occupés à chasser, ou livrés à d'autres divertissements.
Il s'ensuit que les Arabes et les Orientaux, en général, sont de très bons cavaliers ; il n'y a pas un Arabe qui ne puisse terrasser un sanglier.
On voit dans l'un des médaillons de l'arc de Constantin (6) une chasse au sanglier très bien représentée ; cette chasse se fait encore aujourd'hui de la même façon chez les Arabes.
Après avoir lancé la bête, on tâche de la fatiguer à force de tours et de détours, puis on lui décoche un javelot, ou bien on l'attaque la lance à la main. Lorsqu'il s'agit de la chasse au lion, on somme tous les hommes d'un même district de s'y trouver. Une fois réunis, ils forment, en raison de leur nombre et selon que le terrain le permet, une espèce de ligne de circonvallation de deux, trois ou quatre lieues de circuit.
Ces premières dispositions prises, ceux qui sont à pied s'avancent avec leurs chiens et la pique à la main, puis battent les buissons et les taillis pour faire lever l'animal tandis que les cavaliers les suivent à une petite distance et se tiennent prêts à charger le lion dès qu'il paraît. Le cercle que décrivaient les chasseurs se resserrant graduellement, il arrive souvent que l'enceinte se rétrécisse au point qu'ils finissent par se toucher.
Ces sortes de battues se bornent rarement à la chasse au lion car elles englobent aussi des chacals, des hyènes, des lièvres et autres animaux sauvages. On a remarqué ici que lorsque le lion s'aperçoit qu'il est en danger, et quelquefois même en sortant de sa tanière, il se jette sur le chasseur qui se trouve le plus à sa proximité, et se laisse tailler en pièce plutôt que de lâcher prise.
La chasse à l'oiseau est un des plus grands plaisirs des Arabes, et de tous les gens un peu aisés dans la régence de Tunis, dont les forêts et les bois fournissent abondamment des éperviers et des faucons que l'on dresse à cet effet. Il paraît même, qu'il y a deux siècles cet État était célèbre pour ce genre d'oiseaux.
Ceux qui chassent au fusil ne font pas comme nous lever le gibier avec un chien mais se couvrant par-devant d'un morceau de toile tendu sur deux bâtons, ils se promènent ainsi dans les endroits où ils croient en trouver. Cette toile est ordinairement bariolée de différentes couleurs ; quelquefois même on y peint un léopard et à la hauteur du visage il y a un ou deux trous à travers lesquels le chasseur regarde pour voir ce qui se passe devant lui.
Ce qu'il y a d'assez singulier, c'est qu'à l'aspect de cette figure, les oiseaux qui vont communément par volées et dispersés se réunissent aussitôt par troupes nombreuses, et que même les bécasses, les cailles et autres oiseaux vivant isolément, s'arrêtent comme saisis d'effroi. Le chasseur profite de cette circonstance pour s'approcher de sa proie le plus possible, puis posant sa toile à terre et passant son fusil par l'un des trous destinés à éclairer sa marche, il tue ordinairement un très grand nombre d'oiseaux.
Les Arabes ont encore une autre façon de faire la chasse aux perdrix mais qui est beaucoup plus fatigante que celle que nous venons de décrire. On a remarqué qu'après les avoir fait lever deux ou trois fois de suite, ces oiseaux en deviennent si las et si abattus que rien n'est plus facile pour ceux qui les poursuivent avec l'acharnement qu'y mettent les Arabes, de se jeter dessus avant qu'ils aient pu se relever et de les assommer.
Quant aux mœurs et aux coutumes des Bédouins il est bon de dire qu'ils ont conservé un grand nombre d'usages de leurs aïeux, tel qu'il en est fait mention dans l'histoire sacrée et profane, et qu'à la religion près, on peut dire jusqu'au costume, que c'est encore le même peuple que son isolement et sa vie nomade ont soustrait jusqu'à présent aux fréquents changements qui se sont introduits parmi les habitants des villes.
Lorsque deux Bédouins se rencontrent, ils s'abordent en se disant comme le faisaient leurs pères, salem alekum, ou la paix soit avec toi ; souhait dont leur superstition a fait un compliment religieux et qui en ce sens signifie :
" Je souhaite que tu sois sur la voie du salut ". Avant que les Mahométans eussent conquis ce pays on se disait en s'abordant : " Dieu te prolonge la vie ". (7)
La posture la plus ordinaire que l'on prend lorsqu'on se salue mutuellement est de mettre la main droite sur la poitrine. Mais quand on est intime, ou égal en âge et en dignité, on se baise réciproquement la main, la main ou l'épaule. A la fête du baïram (8) et dans d'autres occasions solennelles, les femmes baisent aussi la main de leurs maris en les saluant. Les personnes du premier rang, dans ce pays, ne se font aucun scrupule de s'occuper de choses que nous autres Européens nous regardons comme au-dessous de nous. Par exemple, le plus grand personnage ne croit point s'humilier en allant prendre lui-même un agneau de son troupeau pour le tuer ensuite, pendant que sa femme prépare le feu et tout ce qui est nécessaire pour l'accommoder.
Il est un autre usage qui contraste aussi assez avec notre manière de voir, mais qui paraît cependant assez naturel dans un pays où l'on marche pieds nus, sans autre chaussure que des sandales ; c'est d'offrir à tout étranger qui se présente dans une maison de l'eau pour se laver les pieds. C'est toujours le maître de la maison qui la présente, qui souhaite la marhabbah ou la bienvenue à l'étranger et se montre le plus prévenant de la famille. Le repas étant prêt, il ne se met point à table avec son hôte mais se tient debout auprès de lui pour le servir. Néanmoins, toute cette politesse n'influe en rien sur les inclinaisons des Arabes. On les accuse non seulement de dévaliser les étrangers et tous ceux qu'ils surprennent sans défense, mais encore de nourrir des haines et des animosités héréditaires et implacables les uns contre les autres, accomplissant encore aujourd'hui ce que l'ange prédit à Agar (9) touchant Ismaël : " qu'il est un âne sauvage ; qu'il lèverait la main contre tous, et que tous lèveraient la main contre lui ". Je dois cependant dire, à l'honneur des Maures occidentaux, que, depuis un temps immémorial, ils trafiquent avec différentes peuplades barbares qui habitent le long du Niger, sans les avoir jusqu'à présent jamais trompées, ni enfreint en aucune manière les traités qu'ils ont conclus ensemble, quoiqu'ils n'aient d'ailleurs aucun rapport direct les uns avec les autres. Voici comment leur trafic a lieu. Chaque année, en hiver, les Maures expédient une caravane nombreuse, portant une grande quantité de coraux et de colliers de verre, des bracelets de corne, des couteaux, des ciseaux et autres objets de quincaillerie. Arrivés au lieu indiqué, et à un jour déterminé par l'une des phases de la lune, ceux qui sont chargés de la conduite de la caravane trouvent, sur le soir, des petits tas de poudre d'or rangés sur une ligne.
Les Maures placent auprès de chacun d'eux à peu près l'équivalent en articles qu'ils ont apportés et que les Nigritiens enlèvent le lendemain matin s'ils sont satisfaits de l'échange, en laissant leur poudre d'or sans y toucher. Dans le cas contraire ils en diminuent ce qu'ils jugent équitable ; et tout cela ne se passe sans la moindre supercherie.
L'ancienne coutume des Nasamons (10) de boire dans la main l'un de l'autre en se donnant leur foi est encore aujourd'hui la seule cérémonie matrimoniale en usage parmi les Algériens. Seulement les pères et les mères des jeunes époux règlent les termes du contrat de mariage, où sont expressément spécifiés le montant du saddock ou de la dot, le nombre de robes, de bijoux et d'esclaves que l'épouse doit avoir en entrant dans la maison de son mari. Du reste les futurs époux ne se voient point avant le jour de la célébration du mariage.
Un mari peut renvoyer sa femme quand cela lui plaît, en lui rendant toutefois sa dot ; mais il ne peut plus la reprendre, à moins qu'elle n'ait été remariée à un autre.
On traite ici de puérilités les égards qu'en Europe on a pour les femmes, et l'on prétend que nos déférences pour le beau sexe sont autant d'infractions que nous faisons à la loi naturelle qui assigne à l'homme la supériorité sur la femme. Il s'ensuit que les premières dames de ce pays ne sont regardées que comme des servantes d'une classe supérieures (rang qu'un grand jurisconsulte anglais assigne également aux dames de son pays), dont en effet elles remplissent à peu près les mêmes devoirs. Car pendant que les maris se reposent nonchalamment et que les enfants, garçons et filles, gardent les troupeaux, les femmes mariées sont occupées le jour entier à leur métier à tisser, à moudre du blé, ou à faire la cuisine.
Mais leurs travaux ne s'arrêtent pas là ; il faut encore que le soir elles aillent chercher de l'eau dans des cruches et des outres, souvent à plus d'une lieue de distance, et quelquefois chargées de leurs enfants à la mamelle, qu'elles allaitent chemin faisant. Cependant au milieu de tant de peine et d'embarras, les femmes des villes, comme celles de la campagne ne quittent jamais aucun de leurs ornements tels que leurs bracelets, leurs boucles d'oreilles et de nez (ces dernières sont encore en usage parmi les femmes arabes), et ne négligent même pas de se teindre les paupières tant est grand l'amour des Africaines pour la parure !
La plupart des femmes mauresques passeraient pour belles, même en Angleterre. Quant à leurs enfants, ils ont assurément le plus beau teint que j'aie jamais vu. Il est vrai que les garçons qui sont constamment exposés au soleil, et qui ne portent que la petite calotte rouge, brunissent bientôt ; mais les filles qui restent davantage à la maison, conservent leur beauté jusqu'à l'âge de trente ans, époque à laquelle elles cessent ordinairement d'être mères. Comme elles se marient souvent à onze ans, elles ont quelquefois des petits-enfants à vingt-quatre, et comme elles vivent aussi longtemps que les Européennes, il n'est pas rare qu'elles voient plusieurs générations à un âge encore peu avancé.
Dans leurs grandes fêtes, les femmes pour témoigner leur allégresse, à l'arrivée de chaque convive, crient toutes ensemble et à plusieurs reprises you ! you ! Elles se servent aussi de cette exclamation aux enterrements et dans d'autres circonstances analogues ; seulement elles la prononcent alors d'une voix basse et d'un ton plus modeste, en l'accompagnant de profonds soupirs.
On loue aussi pour des enterrements des femmes qui, semblables aux pleureuses des anciens, sont maîtresses passées en ces sortes de lamentations. En effet, elles jouent si parfaitement bien leur rôle, et gesticulent d'une manière si lamentable, qu'elles manquent fort rarement d'inspirer à toute l'assemblée une véritable tristesse.
Il n'y a point de peuple au monde aussi superstitieux que les Arabes ou que les Mahométans en général. Par exemple, ils suspendent au cou de leurs enfants l'image d'une main ouverte, objet qu'ils peignent aussi sur leurs maisons, comme un antidote sûr contre un mauvais œil. J'attribue cette coutume à ce que le nombre cinq est regardé parmi eux comme un nombre malheureux. De là aussi l'expression " cinq (peut-être faut-il sous-entendre doigts) dans vos yeux ! " imprécation qu'ils emploient quand ils veulent se narguer des efforts de quelque ennemi peu redoutable.
Les personnes d'un âge mûr portent toujours sur elles un petit rouleau de parchemin où se trouve transcrit un passage quelconque du Coran, qu'elles placent, comme les Juifs font de leur phylactère (11), sur la poitrine ou sous leurs bonnets afin de se garantir de toute fascination ou sortilège, de maladies ou d'accidents fâcheux. Les Maures sont si persuadés de l'efficacité de ces amulettes, qu'ils les appliquent à tout, et en suspendent également au cou de leurs chevaux, de leurs bêtes de somme, et en général de tout leur bétail.
Ils croient implicitement aux magiciens et aux sorciers, comme faisaient jadis les Égyptiens ; et dans certaines occasions extraordinaires, particulièrement dans les maladies de langueur, ils ont recours à différentes cérémonies superstitieuses, comme de sacrifier un coq, un mouton ou une chèvre dont ils enterrent quelquefois le corps et boivent le sang, ou dont ils brûlent et dispersent les plumes, la laine ou le poil.
C'est une opinion généralement reçue dans ces contrées que la plupart des maladies résultent de l'offense faite d'une manière ou d'autre aux jenounes, espèce de créatures qui, d'après les Mahométans, tiennent le milieu entre les anges et les démons. Ces êtres imaginaires, qui répondent assez aux fées de nos ancêtres, se plaisent, dit-on, à l'ombre des bois et auprès des fontaines, sous la forme de crapauds, de vers et autres insectes que l'on court souvent le risque d'écraser. Quand quelqu'un tombe malade ou qu'il reçoit une blessure dont il reste estropié, ils s'imaginent aussitôt qu'il a offensé quelque jenoune, et appellent à l'instant même des matrones, qui, à l'exemple des anciennes enchanteresses, munies d'encens pur et d'autres parfums, se rendent un mercredi à quelque source du voisinage et y sacrifient une poule ou un coq, une brebis ou un bélier, etc, suivant le sexe ou la maladie du malade et la nature de la maladie.
Les Mahométans ont une grande vénération pour leurs marabouts, qui sont en général des hommes d'une vie fort austère, toujours occupés à dire leurs chapelets ou plongés dans la méditation. Cette sainteté est héréditaire, et l'on rend au fils le même respect et les mêmes honneurs qu'au père, pourvu qu'il observe un certain décorum, et qu'il sache prendre un air et un ton de gravité convenables. Il y en a parmi eux qui, comme leur prophète, ont la réputation d'avoir des visions et de s'entretenir avec la divinité. D'autres vont encore plus loin, et prétendent faire des miracles, privilège dont Mahomet lui-même ne s'est jamais vanté.
(a) Résida à Alger pendant douze ans comme chapelain à la factorerie anglaise, au début du XVIIIème siècle.
(1) L'auteur dit la 676° partie d'un dollar. (Note du traducteur).
(2) Ces différents prix sont exprimés en argent d'Angleterre. (Note du traducteur).
(3) Plat en terre cuite muni d'un couvercle conique dans lequel on cuit le Ragoût. Nous disons actuellement tajine.
(4) Ce que nous appelons le déjeuner
(5) Il y a cinq prières : la première qui se fait au point du jour, et se nomme Caban ; la seconde à midi, et qui se nomme dohor ; la troisième avant la nuit, en quelque saison que ce soit, et qui est appelée lazaro ; la quatrième la cinquième, qui ont toujours lieu pendant la nuit, et que l'on nomme magreb et lutamar. (Note du traducteur).
(6) L'arc de Constantin à Rome.
(7) L'Afrique du nord fut chrétienne avant la conquête des Arabes, qui introduisirent la religion islamique.
(8) C'est la Pâques des Turcs (note du traducteur).
(9) Dans la Bible Agar est la servante égyptienne de Sarah, femme d'Abraham.
(10) Peuple vivant dans le sud de la Libye.
(11) Amulette, talisman.
|
|
| Obstacles à la colonisation
Jean-Jules Clamageran Édition 1874
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Impressions de voyage (17 mai-4 juin 1873)
Des causes multiples ont entravé les progrès de la colonisation.
Ce fut tout d'abord un état de guerre permanent qui freina toutes formes de projets ; puis à partir de 1848, une paix troublée par des insurrections violentes.
On assista également à la ferme volonté affichée par les chefs militaires de continuer à diriger, à leur guise, l'administration d'un pays conquis par les armes.
Les hésitations et les incertitudes gouvernementales qui oscillent entre des options souvent totalement opposées posent également problème.
Nos dirigeants sont tour à tour partisans de l'occupation restreinte puis de l'occupation étendue des colonies militaires et des colonies civiles.
On passe ensuite de la chimère d'une colonisation décrétée et dirigée par l'État à la chimère du royaume arabe, idée funeste.
Et dans cette confusion qui ne veut pas dire son nom on feint d'ignorer, qu'en fait, il n'existe qu'une seule préoccupation constante c'est celle de voir, dans l'Algérie, un vaste champ de manœuvres; un endroit gigantesque où nos armées viendraient apprendre, par la pratique, l'art difficile de la guerre.
Enfin le tableau peut être rendu encore plus sombre par le dédain manifesté pour des études sérieuses et des explorations scientifiques.
On ignore les procédés employés avec succès par les peuples colonisateurs dans des régions différentes.
Ajoutée à tous ces handicaps, la ténacité de notre routine administrative, qui est demeurée identique à ce qu'elle était sous l'ancien régime, malgré nos révolutions successives.
De toutes ces causes, il est résulté que les vrais principes en matière de colonisation ont été longtemps négligés, et qu'après avoir été reconnus tardivement, ils ont été appliqués de façon maladroite, intermittente et incomplète.
Ces principes peuvent se résumer ainsi :
Faciliter les échanges de la colonie avec la métropole et l'étranger, rendre la terre accessible en droit et en fait aux émigrants capables de l'acheter à sa juste valeur et de l'exploiter,
Accorder aux colons une large part dans le maniement des affaires coloniales.
Qu'a-t-on fait à ce triple point de vue ?
Peu de chose jusqu'en 1848, un peu plus dans la période suivante jusqu'en 1870.
Mais bien que l'on soit entré depuis quelques années dans la voie des grandes réformes, il reste encore beaucoup à faire, soit pour consolider, soit pour étendre les améliorations accomplies.
|
|
| Les Mzabites
Paul Soleillet (Voyageur et explorateur ) édition 1877
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
L'Algérie occidentale, Algérie, Mzab, Tildikelt
Les habitants du Mzab, appelés Mzabites ou Beni-Mzab, forment un petit peuple de Berbères de cinquante à soixante mille âmes, qui ont toujours su se préserver de toute contamination étrangère. Comme tous les Berbères ils ont accepté l'Islam.
Cette apostasie de toutes les nations qui habitaient l'Afrique septentrionale est un des faits les plus curieux que l'histoire ait eu à enregistrer ; au moment de l'invasion arabe en 643 le Maghreb tout entier était occupé par des populations chrétiennes ou juives ; il est certain que tous les chrétiens et presque tous les juifs se sont fait mahométans.
Ces conversions ne doivent pas être attribuées, ainsi qu'on pourrait le croire, à des rigueurs exercées en Afrique plus considérables que celles qu'ont eu à subir de ces même conquérants les chrétiens et les juifs de l'Arabie, de l'Égypte où une grande partie de la population a conservé le christianisme et le judaïsme, tout en acceptant la domination des mahométans.
Ce fait de l'apostasie des Berbères paraîtra moins extraordinaire si l'on se rappelle que ces populations avaient déjà eu à subir un changement de religion ; les Vandales lorsqu'ils envahirent l'Afrique au sixième siècle y avaient implanté l'arianisme (a) par le fer, le feu et le sang.
(a) Hérésie chrétienne d'Arius qui, rejetant l'unité et l'identité de substance du Fils avec le Père, ne reconnaît que partiellement la nature divine de Jésus-Christ refusant ainsi le dogme de la Trinité.
Déjà au quatrième siècle les chrétiens africains étaient fort divisés ; au moment de l'invasion arabe les dissensions religieuses avaient mis le trouble dans tout le pays. Il n'y avait pas de si petite bourgade qui n'eût plusieurs évêques s'excommuniant les uns les autres ; les familles étaient divisées et il n'était pas rare de voir le père d'une secte, la mère d'une deuxième, le fils d'une troisième, la fille d'une quatrième et ainsi de suite. Aussi un grand nombre de Berbères chrétiens acceptèrent-ils plus facilement une nouvelle religion qui se donnait comme la suite du christianisme et qui pouvait mettre fin à leurs luttes religieuses.
Ce sont les Berbères qui conquirent en grande partie l'Espagne ; c'est eux qui l'organisèrent et qui firent élever ces monuments merveilleux de la domination musulmane. Il y en eut d'autres, les Touaregs, les Beni-Mzab qui se retirèrent dans le Sahara et y ont conservé dans leurs oasis les vestiges d'une civilisation qu'ils tiennent de Carthage et de Rome. Ils ont aussi conservé, quoique mahométans, l'usage de l'année solaire et ils donnent à leurs mois des noms qui rappellent les nôtres. Ils ne se servent du calendrier musulman que pour les fêtes.
Le fond de la croyance des Mzabites est basé sur la lettre du Coran ; ils ne reconnaissent aucun commentateur et n'admettent nullement la noblesse religieuse des marabouts : ils ne croient pas que la vertu puisse être donnée comme un nom par filiation. Dans la pratique de leur religion ils ont conservé plusieurs coutumes qui paraissent dérivées du christianisme ou du judaïsme que ces populations ont très probablement professé.
Ils font par exemple des ablutions beaucoup plus complètes que les Arabes; ils ont dans leurs mosquées de petits cabinets dans lesquels se trouvent des cuves où ils se lavent le corps. Les israélites faisaient de même pour les purifications prescrites par la loi de Moïse.
Lorsqu'un homme a commis quelque faute grave, ils prononcent contre lui la peine du bannissement, véritable excommunication. Un banni devient complètement étranger ; ses biens sont confisqués au profit de la mosquée ou distribués à ses héritiers. Le banni est considéré comme mort ; il devient une chose immonde ; il ne peut plus entrer dans aucune ville du Mzab ; aucun de ses concitoyens ne peut, sans encourir des peines sévères, loger sous le même toit que lui ; lui donner une nourriture quelconque, ne serait-ce que de l'eau, est considéré comme une faute grave, et l'on est réputé avoir failli et obligé de payer l'amende si l'on laisse, même par mégarde, son burnous frôler les vêtements d'un banni.
Toute faute, depuis la plus grave jusqu'à la plus légère, peut être rachetée au Mzab d'une façon bien curieuse. Un Beni-Mzab, qui se sent la conscience peu en ordre, se rend, un vendredi, au moment de la prière, à la mosquée ; il se met au milieu du temple, dans la posture d'un suppliant, quand tous les fidèles sont réunis ; le prêtre avant de commencer, lui demande ce qu'il veut ; le patient déclare devant toute l'assistance qu'il est coupable ; il énumère les fautes qu'il a commises et finit en demandant pardon. Il est admonesté par le prêtre, qui lui promet le pardon, s'il veut s'astreindre à la pénitence qui lui sera imposée et qui consiste à rester pendant un temps, plus ou moins long, privé de tout rapport avec ses coreligionnaires, quoique vivant au milieu d'eux.
N'est-ce pas là la confession publique et la pénitence du christianisme des premiers siècles ?
L'autorité des prêtres (la Djemâa, assemblée de notables) qui prennent le nom modeste de Tolba (étudiants) est considérable au Mzab tandis que le pouvoir civil est restreint à l'administration d'une seule ville.
La Djemâa a une domination complète sur la confédération toute entière.
Ce clergé a une organisation qui rappelle celle de l'église romaine; à sa tête se trouve un chef unique nommé par le chef des Tolbas de chaque ville qui peuvent être assimilés aux évêques et c'est lui qui nomme de son vivant les chefs des Tolbas.
Le pouvoir judiciaire tout entier est entre les mains de ces prêtres ; c'est eux qui condamnent sans appel les infractions aux lois du Mzab.
Quelques-unes de ces lois doivent être indiquées ici :
Il est interdit aux Beni-Mzab d'épouser une femme de race étrangère. L'infraction à cette loi est punie du bannissement perpétuel.
Les femmes mariées et les filles ne peuvent quitter le Mzab sous quelque prétexte que ce soit ; la peine est encore le bannissement perpétuel.
Un Mzabite ne peut voyager avant d'être marié et s'il n'a pas d'enfant il doit, avant de partir, jurer qu'il laisse sa femme enceinte ; cette dernière loi est depuis quelque temps tombée en désuétude.
Les peines que peuvent infliger d'après la loi les Tolbas sont pour les fautes graves le bannissement à temps ou à perpétuité ; pour les moindres la bastonnade ; la peine de mort et la prison sont inconnues ; les amendes sont infligées par les Djemâas pour infraction aux règlements municipaux.
Les mosquées ont de grands biens et chaque citoyen est obligé à donner, suivant ses moyens, un tribut.
Comme dans nos anciennes paroisses, se tiennent des registres de l'État civil où sont soigneusement enregistrés les naissances, les décès, les mariages.
Le mariage est au Mzab un acte sérieux ; la famille y est fondée sur des principes analogues à ceux des occidentaux ; le Mzabite est monogame, n'achète point sa femme, au contraire elle lui apporte une dot, et quoique la femme mariée ne sorte point du Mzab elle a une grande influence sur toute sa famille et se laisse voir des parents et des amis qui fréquentent sa maison. Le divorce existe bien au Mzab mais il est très rarement appliqué ; les Tolbas ne l'accordent que pour de graves motifs.
Les registres de l'état-civil ne sont pas les seuls à être tenus ; des chroniques sont rédigées et sont consignées sur tous les faits qui se passent au Mzab tout comme les procès-verbaux des réunions du clergé.
Chaque ville est administrée séparément par une Djemâa dont les membres, comme l'étaient les sénateurs de Rome, les anciens de Carthage et ceux des conseils qui gouvernaient les villes des Phocéens, sont choisis parmi les chefs des anciennes familles de chaque cité.
Chaque Djemâa élit trois mokadem (gardiens) qui s'occupent d'une manière plus spéciale de l'administration de la commune ; ils ont dans leurs attributions la police des marchés, de la voirie et la répression de tous les délits qui peuvent être commis ; ce sont eux qui sont chargés d'assembler la Djemâa, de porter à sa connaissance les affaires qui l'intéressent et de faire exécuter ses décisions.
Les Beni-Mzab, perdus comme ils le sont au milieu du Sahara, exposés aux courses des Touaregs, des Chaâmbas, etc., étant tous marchands et ayant des richesses considérables chez eux, ont dû se préoccuper des moyens de se mettre à l'abri de ces dangers, et ils ont su organiser une force militaire capable de les faire respecter.
Dans chaque mosquée se tient un rôle où est soigneusement marqué le nom de tous les hommes valides en état de porter les armes : il est indiqué sur ce même rôle si la personne est au Mzab ou si elle en est sortie, si elle a un cheval, un mulet. Chaque citoyen est obligé d'avoir chez lui et de représenter aux tolbas, chaque fois qu'il en est requis, un fusil, un pistolet, un sabre et une giberne, plus une provision déterminée de poudre et de balles.
Chaque ville est entourée d'une muraille soigneusement bâtie, dans les tours de laquelle veillent constamment plusieurs citoyens ayant leurs armes auprès d'eux.
Malgré cette milice, les Beni-Mzab ne se sont pas toujours crus assez forts, et ils ont quelquefois appelé à leur secours des nomades qu'ils ont pris à leur solde; et cela souvent pour se livrer aux luttes intestines qui ont déchiré bien des fois leur confédération, qui est divisée en partis, comme l'étaient, au moyen-âge, les petites républiques italiennes.
Au physique, les Beni-Mzab se distinguent des autres Berbères en ce qu'ils n'ont presque pas de blonds parmi eux et des populations d'origine arabe, par leurs mains et leurs pieds très développés et leur taille petite et ramassée. Les Beni-Mzab sont trapus, parce qu'ils ont, dit-on, l'habitude de rester accroupis dans des boutiques ; cette raison est mauvaise : Les Juifs du Sahara sont généralement grands, et ils vivent tout autant dans les boutiques que les Beni-Mzab ; je crois que la courte taille du Mzabite provient plutôt du travail spécial auquel il est soumis dès l'enfance, et qui consister à tirer, plusieurs heures par jour, sur une corde pour puiser de l'eau ; un travail analogue a amoindri la taille d'un grand nombre de populations maritimes de l'Europe.
Si au Mzab l'on occupe manuellement tous les jeunes garçons, l'on est loin de négliger leur éducation intellectuelle : ils passent chaque jour plusieurs heures dans les écoles tenues par les Tolba et qui sont situées près des mosquées. Là on leur apprend, avec les préceptes de la religion et les lois particulières au pays, à lire, à écrire et calculer en langue arabe ; l'idiome berbère étant considéré comme un patois ne s'enseigne pas.
Plusieurs Mzabites font apprendre à leurs enfants les éléments de la langue française qu'ils comprennent et parlent presque tous et qu'un certain nombre lit et écrit. Les Beni-Mzab du reste élèvent rudement leurs fils ; rarement ils les laissent jouer ; levés avec le jour, ils les envoient dans les jardins où ils puisent l'eau pendant trois ou quatre heures consécutives. En quittant ces jardins ils les font aller à l'école, et de l'école ils retournent travailler la terre ou sont employés dans les boutiques de leurs parents.
Tous les Beni-Mzab s'occupent ou se sont occupés de commerce ; ils ont et au Mzab et dans le Tell algérien ou tunisien des comptoirs dans lesquels ils vendaient toute espèce de marchandises, font des opérations de banque, etc. . Leur industrie est assez développée ; ils se livrent en grand à la fabrication de la poudre et ils ont de quatre à cinq mille métiers sur lesquels les femmes fabriquent des étoffes d'un tissu ordinaire mais très apprécié ; les burnous, les haïks, les tapis du Mzab sont répandus dans toute l'Afrique du nord et dans tout le Sahara, et le bas prix auquel une main-d'œuvre peu coûteuse permet de les livrer leur assure toujours un écoulement rapide et certain.
Le début dans les affaires d'un Beni-Mzab, quand il n'est point commandité par un parent, un ami ou un ancien patron consiste à aller dans le Tell vendre de ces tissus de laine. Quand un Mzabite est arrivé à Alger, Tunis, Constantine ou toute autre ville du Tell avec sa charge de tissus, il emploie l'argent que lui a procuré la vente de sa pacotille à ouvrir un étal de boucher ou une boutique de maraîcher et il passe un ou deux ans ainsi occupé. Au bout de ce temps, un autre Mzabite avec lequel il est associé et qui est resté dans le désert soignant les palmiers et la maison de l'ami qui habite le Tell, arrivera pour le remplacer dans sa boutique ; lui retourne au Mzab avec des marchandises et il ouvre un magasin dans son pays et ces deux associés commenceront ainsi une maison de commerce qui au bout de quelques années comptera plusieurs succursales, et avec le temps elle peut devenir très puissante.
Il y a des Beni-Mzab aujourd'hui millionnaires qui n'ont point eu d'autres débuts.
Les femmes vivent constamment enfermées dans les maisons à filer et à tisser. Ces mille et mille commissions qui obligent nos ménagères à sortir à chaque instant du jour sont faites par les petites filles ; c'est elles qui donnent aux villes du Mzab de l'animation et de la gaieté ; elles sont forts gentilles et presque toutes jolies, ayant de grands yeux noirs et des traits réguliers, vêtues à peu près comme les autres filles du désert d'une robe en laine rouge ou bleue, retenue par des agrafes de métal et serrée à la taille par une ceinture ; elles n'ont aucune autre coiffure que leurs cheveux, qui sont arrangés d'une façon assez bizarre ; derrière la tête elles en font une sorte de couronne et de chaque côté des tempes une grosse coque ; cela leur donne une physionomie étrange ; elle est encore augmentée par l'usage où l'on est de leur badigeonner le bout du nez avec du goudron pour les préserver du mauvais œil.
Les savants ont déjà discuté sans conclure pour savoir à quelle race primitive l'on peut rattacher les Beni-Mzab ; je croirais volontiers qu'ils appartiennent à la race sémite et que ce sont ou des anciens israélites ou qu'ils descendent de ces peuples qui habitaient la Palestine et avaient une foule d'usages communs avec les Hébreux, tels que la circoncision.
Ne seraient-ils pas des Moabites qui vécurent longtemps dans l'amitié d'Israël et furent tributaires de David ?
Et pourquoi ne trouverait-on pas dans les Mzabites des descendants des anciens Carthaginois ? Quelques colonies de ces riches et fiers marchands n'auraient-elles pas pu chercher, après la destruction de Carthage, un asile dans le Sahara ? Cette hypothèse expliquerait le soin religieux avec lequel ils ont toujours conservé la pureté de leur race et la tradition commune chez eux qui les fait originaires de l'Orient.
|
|
| L'islamisme algérien
par P. Bernard et F. Redon 1926
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
Histoire, colonisation, géographie, administration
Tous les Indigènes algériens sont musulmans. Ils observent les prescriptions du Coran : ablutions, prières, jeûne du Ramadan. Les plus riches font le pèlerinage à la Mecque.
Les hommes fréquentent les mosquées, surtout le vendredi. Les femmes font plutôt leurs dévotions dans les cimetières, près des Koubas, petits monuments avec coupoles, blanchis à la chaux, appelés communément " marabouts " parce que de pieux musulmans y sont enterrés.
La religion musulmane n'a pas de clergé. Dans les mosquées l'imam est un lecteur du Coran ; le muezzin, qui rappelle l'heure de la prière, du haut des minarets, un sacristain. Ce ne sont pas des prêtres. Le muphti, qui est le grand chef, exerce les fonctions d'un juge religieux.
Les marabouts ne sont pas des moines, mais de dévots personnages, laïques, à qui la foi populaire attribue le pouvoir de guérir les malades, comme aux d'autrefois. La dignité maraboutique se transmet de père en fils, c'est une sorte de noblesse religieuse.
Les Musulmans aiment à s'associer en confréries pieuses, mais laïques. Ils s'appellent alors Khouans (frères). Ils paient des cotisations destinées surtout à entretenir les écoles musulmanes appelées zaouïas où l'on apprend le Coran aux étudiants.
Bien que très attachés à l'Islamisme, les Kabyles se différencient des Arabes, sur certains points, dans la pratique de la religion. Ils acceptent le Coran comme loi religieuse, mais non comme loi civile ; ils suivent, à cet égard, les traditions de leurs kanouns (coutumes) ; ils n'ont pas de mosquées. Ils ne vont guère à la Mecque.
|
|
| En Algérie. Souvenirs d'un Provinois
E. Bourquelot. Edition 1881
Envoyé par M. Christian Graille
|
|
La diligence et le chemin de fer
de Guelma à Bône. Héliopolis.
Un rafraîchissement qui altère.
Le lac Fetzara. Arrivée à Bône.
La genette. La mosquée et les cigognes.
Aujourd'hui encore, c'est la diligence qui va nous transporter de Guelma à Bône. Avant peu, ce monument rétrospectif d'une civilisation arriérée aura disparu de ce pays, pour céder la place à la vapeur, qui n'est sans doute pas le dernier mot du progrès en fait de locomotion.
Tout le monde a pu lire, il y a quelque temps, sur la quatrième page des journaux industriels et autres, les annonces alléchantes de la compagnie de chemin de fer de Bône à Guelma, en voie d'exécution.
J'aurai l'air à mon tour de faire de la réclame si j'essayais de vanter les avantages de la ligne qui va dans le mois ou deux être livrée à la circulation. Il ne m'est pas cependant pas défendu de dire que, d'après ce que j'ai vu et ressenti sur les lieux, le railway destiné à relier le port de Bône à Constantine offre des chances sérieuses d'avenir et de prospérité. Il existe dans le voisinage de Bône d'importantes mines de fer qui jusqu'ici n'ont pu être qu'imparfaitement exploitées à cause de l'insuffisance des moyens de transport.
(Le chemin de fer reliant Constantine à Guelma et Bône est livré aujourd'hui à la circulation.)
Il m'est encore permis de constater qu'en attendant le moment prochain de sa retraite, la diligence de Guelma continue à marcher avec des allures nonchalantes qui ne feront pas trop regretter ses services.
Elle suit d'abord une route dépourvue d'arbres, tracée au milieu de montagnes étagées sur plusieurs plans. Les villages qui se succèdent, assez rapprochés, se présentent sous un aspect riant et confortable, la campagne qui les environne paraît cultivée avec beaucoup de soins et d'intelligence.
On relaie à Héliopolis (ville du soleil) ; c'est un bien beau nom pour cette modeste bourgade exposée, il est vrai, aux brûlantes caresses de l'astre du jour, mais qui, à part cela, ne ressemble en rien à ses sœurs d'Orient portant la même dénomination et dont on admire encore les temples consacrés au Dieu Hélios.
De temps en temps émergent du sol mouvementé quelques gourbis couverts de branchages entrelacés. Nous, nous croisons avec des Indigènes, les uns à pieds, les autres à cheval ou à mulet. Souvent ils sont deux qui ont enfourché la même monture, moyen de locomotion plus économique que commode et gracieux.
Presque à chaque débit de boissons, et ils sont nombreux sur cette route fréquentée, la diligence s'arrête, le conducteur descend de son siège et invite avec sollicitude les voyageurs à se rafraîchir en donnant lui-même un exemple contagieux. Les tournées d'absinthe se succèdent rapidement.
Je doute que l'absorption réitérée du nectar corrosif, plus propre à irriter la soif qu'à l'apaiser, procure un soulagement réel à ces gosiers altérés, mais c'est là un détail personnel dont je n'ai pas à me préoccuper.
Le résultat le plus appréciable de ces haltes multipliées, et ce détail m'est moins indifférent, est de retarder infiniment la marche déjà si peu accélérée du véhicule.
Heureusement le temps est splendide ; grâce à la pureté et à la transparence de l'air, rien n'échappe à l'œil de l'observateur. Notre attention est longtemps captivée par le panorama aussi étendu que varié que l'on embrasse du point culminant de la route taillée en partie dans le roc. C'est un travail prodigieux exécuté par nos soldats, ainsi que l'indique l'inscription gravée sur la colonne commémorative érigée à cet endroit.
Encore quelques pas et nous apercevons une vaste nappe d'eau encadrée de verdure ; c'est le lac Fetzara. On sait que les lacs sont rares en Algérie. Celui-ci malgré son nom italien ne ressemble ni aux lacs gracieux de Côme, de Garda ou de Lugano, ni à ceux si pittoresques de la Suisse. Les montagnes qui se profilent à l'horizon sont trop éloignées du lac Fetzara dont les rives plates et tristes ne sont égayées que par la quantité de fleurs sauvages dont la prairie qui l'entoure est émaillée.
On ne découvre dans le voisinage aucune maison, pas le moindre abri ne se montre ; le sol marécageux et l'insalubrité de l'air rendent ce pays inhabitable. Il est sérieusement question de dessécher ces marais pontins de l'Algérie. En attendant il se fait de nombreuses plantations d'eucalyptus qui ont la propriété d'assainir l'atmosphère pestilentielle.
Deux Arabes aux burnous sales et déguenillés, postés en embuscade sur le bord du chemin semble guetter le passage de la diligence ; ils font signe au conducteur de s'arrêter. Celui-ci obéit. Un instant de panique se produit chez les voyageurs. Que va-t-il se passer ?
Voilà peut-être, pensai-je, un épisode tragique qui se prépare et fera bonne figure dans mes impressions de voyage.
Mais il faut renoncer encore aujourd'hui à procurer au lecteur ce genre d'émotion. Les deux personnages sont animés des intentions les plus pacifiques. En guise d'armes homicides l'un tient à la main dans un sac de toile un petit animal dont il propose au conducteur l'acquisition. C'est une espèce de mammifère rongeur à la queue longue et au poil épais rayé de zébrures jaunes et noires. Mes voisins m'apprennent que cette bête, appelée genette est rare et fort recherchée à cause de sa fourrure.
L'acquéreur a conclu un bon marché, il vient de payer un franc ce qu'il revendra dix. Partout l'exploitation de l'homme par l'homme.
La genette présentée aux voyageurs de l'impérial passe de main en main et ne tarde pas à succomber sous les étreintes multipliées des curieux.
Le trajet s'effectue ensuite sans autre incident. Les arcs de verdure sous lesquels nous passons en traversant chaque village à partir du lac Fetzara ne sont pas dressés à notre intention, personne ne se fait illusion à cet égard. Ce sont encore des témoignages sympathiques que les habitants ont voulu donner au général Chanzy qui se rend de Souk-Ahras à Bône. Tout est en fête à l'occasion de sa visite annoncée pour aujourd'hui.
Nous, nous approchons des montagnes dont les derniers contreforts s'abaissent en pente douce jusqu'à la mer. Leurs croupes aux molles ondulations sont tapissées d'une fraîche et riche verdure qui leur donne la physionomie la plus souriante. La dernière partie de la route est une charmante avenue, ouverte au milieu de vastes jardins divisés par des buissons de cactus, de myrtes, de grenadiers et de roseaux gigantesques.
On revoit bientôt la Seybouse dont le lit s'élargit de plus en plus jusqu'à son embouchure. Le sentier qui se bifurque à gauche conduit à Hippone ou plus justement aux ruines de cette ville jadis fameuse. C'est un pèlerinage intéressant que je me réserve de faire pendant mon séjour à Bône.
La diligence nous dépose sur le court national, large boulevard dont les deux côtés parallèles sont ornés de galeries à arcades surhaussées. Ce boulevard se prolonge jusqu'au port, et à son extrémité opposée, une église moderne de style néo-byzantin se dresse en avant des collines boisées.
Nous trouvons à nous caser fort confortablement à l'hôtel d'Orient situé sur le cours malgré les appréhensions que nous avait causées l'annonce de l'arrivée du gouverneur qui devait loger au même hôtel. De l'étage supérieur où nous sommes installés on jouit d'une ravissante perspective sur les montagnes de l'Edough et sur la ville de Bône. L'impression première est très favorable et justifie l'excellente réputation de ce chef-lieu d'arrondissement qui passe pour une des résidences les plus agréables de l'Algérie.
Une partie, la plus ancienne, est assise sur le versant d'une colline qui domine la mer ; on y respire un air pur et salubre.
La partie basse, à peu près complètement reconstruite, se compose de rues qui se coupent à angles droits ; la plupart sont bordées de galeries sous lesquelles se pressent de nombreux magasins et des cafés non moins nombreux.
La place d'armes, située au centre, se distingue par ses plantations variées qui entourent comme d'une ceinture verdoyante une fontaine vraiment monumentale. Un côté de la place, principal rendez-vous des oisifs, est occupée par une élégante mosquée dont la galerie extérieure, découpée en arceaux mauresques abrite un corps de garde peu monumental à côté duquel plusieurs marchands indigènes vendent diverses denrées.
Parmi les différentes espèces de fruits étalés sur le sol, je remarque une quantité de jujubes renfermés dans d'immenses sacs de toile. Les jujubiers croissent en telle abondance dans ce pays que les Arabes appellent Bône la ville des jujubiers. Les indigènes font une énorme consommation de ce petit fruit rouge qui ne s'emploie guère chez nous qu'en tisane et qui a donné son nom à une pâte pectorale, laquelle n'en contient pas le moindre atome.
Le minaret est, comme ceux de Constantinople, une tour ronde, coiffée d'un éteignoir, dans le voisinage de laquelle plusieurs familles de cigognes ont fait élection de domicile.
De même qu'à Strasbourg et à Bâle ces disgracieux et inoffensifs volatiles sont ici l'objet d'une grande vénération. Ils se promènent et flânent comme de véritables badauds sur les toitures des maisons avec la plus entière sécurité. Personne ne songe à les inquiéter. Quand on voit ces oiseaux regagner leur nid, perchés sur leurs grêles échasses, on dirait de bons bourgeois rentrant tranquillement au logis.
La visite du Gouverneur, qui en ce moment parcourt la ville escorté d'un brillant état-major ne paraît aucunement préoccupé l'habitant des toits. J'observe d'ailleurs que l'empressement et la curiosité de la population bônoise sont moins vifs qu'à Guelma. L'accueil ici est plus respectueux qu'enthousiaste.
Pas la moindre fantasia ne vient égayer la réception officielle.
Nous avons heureusement aujourd'hui en perspective l'excursion d'Hippone qu'on peut faire aisément entre le déjeuner et le dîner.
Excursion à Hippone
Le monument de Saint Augustin
et les Thermes. Banquet officiel.
Le journal de Bône. Pauvre Cassard !
Rien de plus délicieusement romantique que le chemin encaissé par une double haie d'oliviers séculaires, entremêlés de grenadiers, de lentisques, de jujubiers, de lauriers et d'aloès. Sur les pentes qui s'étagent à droite et à gauche, apparaissent, à demi englouties dans des oasis de verdure, les blanches villas mauresques. Le calme le plus profond règne dans la campagne presque solitaire.
Un sentier étroit et tortueux se détache de la route et serpente sur le flanc d'un monticule verdoyant que couronne un petit monument élevé en mémoire de Saint Augustin. Une grille circulaire, précédée de plusieurs degrés, entoure un autel de marbre surmonté de la statue en bronze de l'illustre évêque d'Hippone. On célèbre une fois par an la messe à cet autel le jour de la fête du Saint. La statuette n'a aucun caractère artistique, elle est d'une mesquinerie et d'une vulgarité affligeantes ; on dirait un jouet d'enfant. Cette ridicule exhibition gâte quelque peu l'impression dont il est impossible de se défendre à la vue de ces lieux si pleins de grands souvenirs. Je me hâte de détourner mes regards pour évoquer l'admirable tableau dans lequel Ary Scheffer(1) a représenté Sainte Monique et son fils plongés dans une rêverie statique.
(1) Peintre d'origine hollandaise qui s'est imposé parmi les maîtres de la peinture romantique. (1795-1858).
J'aime à me rappeler, en ce moment, l'expression angélique que le peintre hollandais a su donner à ses personnages, sur le front desquels rayonne une céleste auréole de beauté. L'idéal de l'art ne peut aller plus loin.
Sauf quelques débris de constructions, dont une partie, enfouie sous le sol, occupe un espace assez restreint, il ne reste plus rien de la cité fameuse qui rivalisait d'importance avec Carthage dont elle partagea un peu plus tard le sort Sa destruction, commencé par les Vandales, fut entièrement achevée au VIIème siècle par les Arabes.
Les vestiges antiques se réduisent à une réunion de salles souterraines aux voûtes épaisses et noires qui communiquaient entre elles par des corridors latéraux. Certains archéologues croient reconnaître dans cet amas incohérent des restes des thermes romains. Je suis très disposé à leur donner raison. De place en place, à travers de larges crevasses qui trouent les murailles délabrées, passent des branches de figuiers et d'autres arbres dont le feuillage agrémente un peu la mélancolie de ces vieilles pierres.
Je constate encore que ces vénérables ruines sont outrageusement souillées par certains visiteurs peu scrupuleux qui laissent à l'intérieur des traces non équivoques d'un ignoble réalisme.
Après avoir ramassé, pour enrichir ma collection céramique, quelques tessons de poteries romaines accumulées sur un tertre voisin, sorte de petit mont Testaccio (2) africain et avoir jeté un dernier coup d'œil sur le magique spectacle que présente de là Bône et ses environs, je rentre en ville.
(2) petite colline artificielle de Rome.
Les abords de l'hôtel d'Orient sont garnis de curieux ; c'est l'heure des dîners. En passant devant la salle à manger dont la porte est restée ouverte, j'aperçois la brillante composition des convives réunis autour de la table du banquet officiel présidé par le général Chanzy.
Si l'on n'avait pas tant abusé du métaphorique bouquet de fleurs comme moyen de description, je m'en serais peut-être servi à l'occasion des dames de Bône qui assistaient au repas et dont les fraîches et riches toilettes se détachaient harmonieusement sur l'ensemble des habits bourgeois et des uniformes militaires ; mais je laisse là ce vieux cliché de circonstance pour m'occuper de la partie musicale qui était appelée à jouer un grand rôle pendant le repas. En effet le courrier de Bône, organe des intérêts de l'Algérie que j'avais acheté la veille, donnait à ce sujet des détails de nature à piquer vivement ma curiosité de mélomane. On verra par l'extrait que j'emprunte à la feuille locale si c'était à tort :
" La prochaine arrivée du gouverneur a surexcité outre mesure le zèle musical de tous les instrumentistes de notre ville. Spontanément trois ou quatre musiques se sont formées sans compter les orphéons et les fanfares. Il va sans dire que ces différentes sociétés d'harmonie sont à couteaux tirés et se chamaillent du matin au soir.
On assure que la municipalité est émue, à juste titre de ce débordement de mélodie, se dispose à prendre un arrêté fixant les heures auxquelles il sera permis aux diverses musiques de se faire entendre. Sans cela elles joueraient toutes à la fois et produiraient trop d'effet.
S'il nous est permis d'émettre un humble avis, nous trouvons que les instrumentistes de notre localité se creusent bien inutilement la tête pour former des corps musicaux. Nous possédons dans nos murs une musique italienne attachée au cirque des allées qui donne chaque après-midi un échantillon de son talent et qui rend superflue l'institution des musiques civiles qui ne pourront jamais égaler sa vigueur et son impétuosité.
Nous voudrions, pour notre compte, qu'il ne fût pas permis aux musiques et fanfares de se faire entendre ailleurs qu'à la campagne."
L'auteur de ce mordant article, dans lequel l'amour-propre des musiciens bônois était peu ménagé, obtint un plein succès. Il en résulta qu'aucune des sociétés rivales ne fut admise à se faire entendre. Une excellente musique militaire remplaça avec avantage, j'ai tout lieu de le présumer, celles qui se disputaient avec tant de zèle l'honneur de charmer l'auditoire.
Le soir, j'ai le plaisir d'assister au défilé des invités français et indigènes qui vont au bal offert par la municipalité au gouverneur, dans le théâtre situé à proximité de notre hôtel. Les Arabes y sont très nombreux ; ils traversent la foule avec un air grave et solennel comme s'ils se rendaient à un enterrement. Je suppose, du reste, que leur rôle se borne à celui de spectateurs.
Les habits noirs mêlés aux burnous me font l'effet de tâches d'encre sur l'étoffe blanche des costumes indigènes. Quant aux toilettes féminines, les manteaux qui les recouvrent m'empêchent d'en apprécier la beauté et l'élégance.
De ma fenêtre, qui donne vis-à-vis le théâtre, j'entrevois à travers les vitres des couloirs, splendidement éclairées, les silhouettes des cavaliers et des danseuses qui passent et repassent comme des ombres chinoises.
Pendant toute la nuit, les musiciens d'un nombreux orchestre, on sait maintenant que les exécutants ne manquent pas à Bône, jouent les airs de musique les plus variés.
Pour moi, malgré mes goûts de dilettante, je commençais singulièrement à me blaser sur ces auditions répétées d'harmonie nocturnes dont me faisait bénéficier la coïncidence fortuite de mon voyage avec celui du général Chanzy. Le lendemain la ville avait repris son calme habituel, le Gouverneur se dirigeait du côté de la frontière tunisienne où je n'avais aucune chance de le rencontrer, Bône étant ma dernière étape en Algérie.
C'est encore au journal de la localité que j'ai recours pour donner au lecteur quelques détails intéressants sur le bal officiel où je n'avais aucun titre pour être admis :
" La décoration du vestibule, dit le Courrier de Bône du 4 mai, fait honneur au goût artistique de M. Gousselin. Sa cascatelle improvisée, s'échappant d'une grotte de liège mâle, était d'un très bon effet au fond de la chambre mauresque …
Le buffet était abondamment garni mais nous ne pouvons que regretter la confusion qui s'est produite à l'heure de la collation …
La commission était insuffisante pour tenir tête à un envahissement du sexe masculin qui ressemblait à un assaut et qui nous a paru fort mauvais goût. Beaucoup de dames et d'invités étaient restées dans les loges ou les couloirs tandis que ces messieurs se livraient sans retenue à la satisfaction d'un appétit, qui, pour être légitime, n'en était pas moins prématuré au point de vue de la galanterie française.
Tout le monde mange, c'est une dure nécessité, mais… Par contre nous adressons nos modestes éloges aux dames qui se sont montrées de beaucoup supérieures au sexe fort, etc… "
Ces quelques citations me dispensent de tout commentaire personnel ; il y a un point noir dans ce petit aperçu de mœurs locales qui n'aura sans doute pas échappé à la perspicacité du lecteur.
Le compte-rendu du bal était suivi d'une nouvelle maritime qui avait un caractère incontestable d'actualité ; il s'agissait de l'aviso à vapeur le Cassard sur les infortunes duquel j'ai déjà appelé l'attention du lecteur : " Le Cassard , disait la feuille bônoise, a éprouvé ce matin, à sept heures, un accident fâcheux en franchissant la darse. Par suite d'une fameuse manœuvre, sans doute, il a touché sur un bloc, et le contre coup l'a fait dévier de la ligne du chenal ; il est allé s'ensabler à quelques mètres au-delà. Le Cassard a brisé dans ce choc trois ailes de son hélice. Un quatre-mâts, la Lorraine , a prêté son concours pour retirer le Cassard. Ce fait semble une preuve évidente que l'on ne peut plus retarder les travaux du port, etc.
" A quelque chose malheur est bon " conclut philosophiquement le journaliste.
Pauvre Cassard, quand donc les destins contraires cesseront-ils de te persécuter !
|
|
| 20 ans en Algérie
ou tribulations d'un colon
DE A. Villacrose
Recherches et études effectuées par M. Christian Graille
|
|
Cet ouvrage fort intéressant écrit par un certain A. Villacrose nous replonge dans un passé douloureux, pénible, semé d'embûches, mais ô combien exaltant et passionnant. Il nous narre les efforts déployés pour tenter de mettre en valeur des terres souvent arides, pauvres et incultes, défrichées avec une farouche volonté par les premiers arrivants européens, puis exploitées et rendues viables grâce à un labeur acharné.
L'auteur naquit à Paris en 1832. Sa mère mourut alors qu'il n'avait qu'un an et se trouvait en nourrice. Il fut confié à son grand-père maternel qui devint son tuteur car son père s'était installé à Alger où il y avait ouvert une étude d'avocat en 1844.
C'est donc lors de vacances passées près de lui qu'il découvrit l'Algérie.
Il entra dans un établissement destiné à préparer le concours d'entrée aux écoles de Saint-Cyr, Polytechnique et de la Marine.
Ce fut un échec.
En 1851, il entreprit des études de droit mais son penchant prononcé pour les plaisirs faciles, l'oisiveté et ses dettes amena son grand-père à prendre la décision de le renvoyer en Algérie près de son père dont l'ambition était de lui faire embrasser une carrière militaire, profession pour laquelle il manifesta bien plus de réticences que de réel intérêt.
Il obéit cependant à l'injonction familiale et s'engagea.
Militaire au premier régiment de Chasseurs d'Afrique en mai 1852, il fut nommé brigadier en janvier 1853, participa à l'expédition de Dra El Mizan en Kabylie puis fut en poste à Aumale et l'Arba.
Lorsqu'en 1854 éclata la guerre d'Orient, il participa avec son unité à la bataille de l'Alma et au siège de Sébastopol.
Rentré en France à vingt-trois ans, il abandonna la carrière et devint commis auxiliaire de deuxième classe dans l'administration du trésor et de la poste, fonctions dont il démissionna plus tard pour acheter une propriété d'une vingtaine d'hectares sur la route d'Alger, à quatorze kilomètres de Dellys.
Laissons-nous guider, par le narrateur, dans ce passé, celui de notre histoire, qui peut sembler si lointain mais qui, pour les anciens, n'a jamais été aussi proche et aussi vivant :
" Moyennant six mille francs, nous dit-il, j'achetai quinze hectares de montagnes de médiocre qualité, cinq hectares de plaine, alluvion riche et profonde, une maisonnette composée de deux pièces sur rez-de-chaussée, deux appendices formant écuries, un matériel d'exploitation composé de quatre bœufs de labour, deux juments, une charrette, les ustensiles aratoires et la semence pour l'année agricole qui s'ouvrait "… et il poursuit :
" C'est au colon d'Algérie que je m'adresse, c'est pour lui que j'écris. Instruire et amuser tel est mon but, puis-je l'atteindre. A défaut d'autre mérite mon livre aura celui d'être un livre de bonne foi; tout fait avancé sera marqué au coin de la plus stricte vérité "…
" Il y avait à peine quelques mois que je m'étais installé à Ben-Ameur, que, déjà, je commençais à comprendre que si, en France, un paysan vit et, qui plus est, se trouve à son aise avec dix hectares de terre il en est tout autrement en Algérie ou à moins de vingt et trente hectares le colon peut à peine végéter, bien que les terres soient au moins égales en qualité à celles de la mère patrie.
Cette allégation paraît fausse au premier abord, deux mots d'explication sont ici nécessaires.
Le paysan à qui, par héritage ou autrement, vient à échoir une métairie composée de quelques hectares, trouve son petit domaine tout prêt et récolte dès la première année.
Telle parcelle parfaitement nette des plantes parasites, de pierres, ronces et autres impedimenta, ayant déjà reçu d'abondantes fumures, parfaitement meuble quant au sol, mènera à bien la semence qui lui sera confiée; telle autre en nature de prairies, convenablement aménagée reçoit les eaux du ruisseau voisin. Les rigoles, les canaux sont prêts, il ne s'agit plus que d'ouvrir l'écluse; celle-ci, convertie en verger et potager depuis de longues années donnera à son heureux propriétaire des fruits et des légumes à profusion; celle-là, splendide par sa plantation de vignes en parfait état d'entretien lui fournira à l'automne sa provision de vin; la maison d'habitation est depuis longtemps bâtie et appropriée aux besoins de l'exploitation ; en un mot, la propriété en France est achevée, si je puis m'exprimer ainsi, et le paysan jouit dès le premier jour de sa prise de possession.
En Algérie c'est le contraire qui a lieu.
Il faut des années pour arriver, à force de travail et d'argent à créer une ferme; tout est à faire. Les terres que vous donne l'administration, à titre de concession, sont ou couvertes de palmiers nains et de broussailles ou épuisées par une culture sans fumure et sans assolements réguliers.
La charrue arabe, qui ne fait absolument que gratter le sol sans l'entamer, passe au milieu des pierres, des rochers, va, vient, tourne en tous sens, enfouissant la graine des chardons, buttant le chiendent, faisant un travail détestable pour le bon grain, excellent pour l'entretien du mauvais ; aussi les champs sont-ils sales, infestés de plantes parasites, la terre est-elle compacte, faute d'avoir été fumée et défoncée, boueuse à la moindre pluie, fendue à un mètre de profondeur après quelques jours de soleil. En Algérie, vous devez bâtir, planter, faire des haies, creuser les puits, tracer les chemins, tout faire en un mot.
Lorsque l'administration a confié à l'immigrant dix ou quinze hectares alors qu'il n'y a dans le pays ni routes ni ponts, elle croit avoir fait un brillant cadeau et fait sonner bien haut le mot, gratuitement; la vérité est qu'elle vous donne gratis l'occasion de dépenser vos forces, ruiner votre santé et votre bourse, pour mener à bien quelques fois, à mal plus souvent, la petite exploitation commencée.
Il est de notoriété que celui qui crée en Algérie ne jouit pas. Quelquefois les enfants, presque toujours les créanciers profitent de la dépense et du travail faits.
Rien de plus commun que de voir sur les affiches ou dans les journaux des expropriations ou des citations, à la suite desquelles, une ferme qui a coûté au concessionnaire, soixante, quatre-vingts, même cent mille francs soit adjugée pour quelque mille écus.
Le touriste qui parcourt aujourd'hui la plaine de la Mitidja reste émerveillé devant la splendide végétation, les luxuriantes récoltes, l'air coquet et heureux des villages de Boufarik, de Marengo et tant d'autres ; son étonnement n'a plus de bornes quand il apprend que son immense étendue de prairies, de vergers, de bois, de champs de tabac, de blé, d'orge, d'avoine, que ces jardins d'orangers, de citronniers, de poiriers, de pommiers, d'abricotiers, d'amandiers, que ces vignes n'étaient, il y a trente ans, qu'une plaine marécageuse, pestilentielle, couverte de broussailles et de palmiers nains hantée par des bêtes fauves.
Pour lui l'Algérie est une véritable terre promise, un séjour enchanteur, un pays de cocagne; il ne voit que le résultat, mais les moyens, il ne s'en doute pas.
Il ne sait pas ce qu'il a fallu d'argent et d'existences d'hommes ; il ne compte pas les tombes qui par milliers, recouvrent les corps des travailleurs morts à la peine, tués par le climat; il n'a pas fouillé dans les archives des huissiers pour savoir combien ont été ruinés.
Vie, argent, tout a été donné pour arriver à ce miracle d'une plaine empestée, transformée, comme touchée par la baguette d'une fée, en un immense jardin dont se montrerait fier le plus privilégié de nos départements."
La comparaison faite entre le paysan de France et celui d'Algérie est tout à fait révélatrice des obstacles souvent quasi insurmontables et des énormes difficultés rencontrées.
Il ne faut surtout pas oublier que le second vivait dans un état de grande pauvreté mais que certains détracteurs continuent encore aujourd'hui à occulter, à ignorer, parfois à nier avec une facilité pour le moins déconcertante et une évidente mauvaise foi.
Cette pauvreté était pourtant le seul lien qui, dans les premières années de la colonisation, unissait ces gens venus avec femmes et enfants de Métropole et du bassin méditerranéen, tentant leur chance dans un pays hostile, travaillant comme des forçats, accomplissant de rudes efforts pour mettre en valeur ces terres délaissées, en friche et ingrates. Terrassés et décimés par les fièvres, certains se retrouvaient ruinés, d'autres vivotaient des décennies, d'autres enfin réussissaient fort heureusement.
Mais laissons l'auteur poursuivre sa narration :
" Je me trouvais beaucoup trop à l'étroit avec mes vingt hectares; mes deux ouvriers avec leurs deux charrues avaient, en deux mois, trouvé le moyen de gratter la moitié de la propriété.
Il fallait, me disaient-ils, conserver cinq hectares pour la culture du bechena (sorgho kabyle), des gilbens, pois dont les Arabes font grande consommation, des pois chiches, des lentilles, des haricots du pays, des pastèques, des melons, culture qui ne se fait qu'au printemps.
C'était donc, tout au plus, deux ou trois hectares qui allaient me rester pour faire un peu de fourrage sec pour la nourriture de mes chevaux et servir de parcours à mes bœufs et à ma vache, le reste du terrain étant tout à fait impropre à la culture ou occupé par les bâtiments, le potager, la vigne et les chemins indispensables.
Dans de pareilles conditions, je ne pouvais avoir de troupeaux. Or pas de troupeaux, pas de fumier, pas de fumier, pas de récoltes.
L'usure a été, est encore une des plaies de l'Algérie qui concurremment avec la fièvre a tué nombre de colons; grâce au sulfate de quinine on peut se débarrasser de celle-ci mais à la première il n'est qu'un remède et l'Etat seul peut l'appliquer.
Une fois engagé dans cette funeste voie, vous ne pourrez plus en sortir. Outre les intérêts que vous devez payer et pour le service desquels vous serez bien souvent obligé d'emprunter de nouveau, vendre en herbe partie de votre récolte en passant sous les fourches caudines du négociant, conduire au marché les meilleures bêtes de votre attelage ou vos brebis encore agnelles ou vos vaches encore génisses vous privant ainsi du bénéfice du croit et de l'engraissement, vous aurez encore suspendu sur votre tête l'échéance, cette épée de Damoclès, qui viendra s'asseoir à votre chevet et compagne assidue de vos nuits sans sommeil vous montrera pour comble d'infortune l'expropriation c'est-à-dire, la ruine.
En vain vous supplierez : le créancier vous a prêté avec l'idée que vous ne pourriez pas vous acquitter.
Ce qui vous perd l'enrichit ; il aura pour le quart de sa valeur votre propriété, l'enfant de vos travaux, le fruit de vos sueurs, l'espoir de vos vieux jours, le pain de vos enfants; cette propriété il la revendra demain, dans six mois, dans un an avec un gros bénéfice car il a le temps d'attendre lui. N'est-il pas riche ? Riche du bien de ceux qu'il a ruinés.
Ce vampire qui vous sucerait le sang pour augmenter son avoir vous ne le connaissez pas encore; vous cherchez à exciter sa pitié ; allons donc ! Pour qui le prenez-vous? Les affaires sont les affaires.
La récolte a été mauvaise, les sauterelles sont venues, le siroco a brûlé votre vigne, votre femme a été longtemps malade, vous demandez un délai. Eh bien ! Tant pis pour vous, les affaires sont les affaires ; et en avant l'huissier, la mise en demeure, la saisie, la citation, le jugement etc…
Peut-être vous représentez-vous l'usurier comme l'a dépeint Balzac, comme l'a crayonné Gavarni : chétif, le chef couvert d'une calotte crasseuse, avec des lunettes et un abat-jour vert sur le front, assis dans un fauteuil de vieux cuir, devant un bureau vermoulu, comptant et recomptant, escomptant, supputant ? Oh ! Que non pas…
L'usurier algérien n'est point un type comme ses collègues de France. S'il en est qui se cachent, beaucoup agissent au grand jour et se sont fait un front qui ne rougit jamais.
Tout Alger n'a t-il pas connu un de ces éhontés coquins qui tout le premier s'appliquait à lui-même l'épithète de voleur que chacun lui donnait ?
En Algérie l'usurier est un homme comme les autres, c'est celui que vous voyez passer, tantôt sur un fringant coursier, tantôt dans un break élégamment attelé menant à Saint Eugène la cocotte en renom; il s'intitule homme d'affaires ou banquier.
Il a des bureaux, une caisse, des commis ; son meuble est des plus coquets ; une autre fois c'est votre épicier, votre boulanger ; quelque fois c'est un homme à qui la position devrait interdire un semblable métier ; celui-là n'opère pas par lui-même ; il a un prête-nom, un homme de paille, celui qui vous dit: je vous trouverai cela… la personne veut bien consentir… je connais un capitaliste… Je connais de nom bien entendu bon nombre d'employés à deux ou trois mille francs d'appointements dont les femmes dépensent le triple pour leur toilette et qui, à leur retraite, achètent des propriétés pour deux ou trois mille francs… Usuriers.
Un premier clerc de défenseur après dix ans d'exercice comme huissier dans l'intérieur donna sa démission et se fit…rentier….
Usurier encore ce coiffeur de petite ville qui trouve le moyen avec des barbes à trois sous et des coupes de cheveux à six de se faire douze mille francs de revenus.
Usurier toujours ce boulanger venu nu-pieds en Algérie et dont le coffre-fort regorge de billets de banque au bout de six ans d'un commerce équivoque; usuriers enfin ces colons qui ne cultivent pas et s'enrichissent au détriment des Arabes à qui ils prêtent une mesure d'orge pour en prendre trois à la récolte.
Que d'exemples je pourrais citer de bons et honnêtes travailleurs ruinés, expropriés pour avoir eu recours à l'emprunt! Une ou deux mauvaises récoltes, la maladie, la mortalité des bestiaux et le malheureux colon, aux abois, commence à faire un trou pour en boucher un premier.
En vain, il travaille; ses efforts seront vains; les mailles du filet se resserrent d'année en année; le découragement arrive; le malheureux se trouve bientôt réduit aux expédients, il est perdu, perdu sans ressources et forcé d'abandonner sa concession, il en est réduit, quand sonne l'heure du repos, à chercher chez autrui de quoi ne pas mourir de faim.
Puisse le tableau que je viens de tracer arrête au bord de l'abîme quelques malheureux sur le point d'y tomber!
Mangez du pain tout sec s'il le faut,
Buvez de l'eau,
Vendez une parcelle de votre bien pour conserver l'autre intact mais n'empruntez jamais ou, je le répète, vous êtes perdu.
Un négociant, un industriel, un très gros propriétaire peut avoir recours à l'emprunt et en tirer profit, un agriculteur jamais. Pour deux ou trois à qui l'emprunt aura réussi cent s'y ruineront; la proportion des chances favorables est trop faible pour tenter l'essai ".
L'emprunt, l'usure ces terribles maux qui souvent ont rongé des années la vie de ces cohortes de petits défricheurs sont l'une des tristes réalités des débuts d'une bien difficile la colonisation; exploités et méprisés ces exilés venaient d'abandonner une misère dans laquelle ils étaient plongés depuis bien des années dans leurs régions ou pays d'origine.
Désormais ils n'aspiraient qu'à une vie moins rude, plus paisible, plus sereine mais ils n'étaient encore pas au bout de leurs peines…
Notre conteur vivra également les révoltes musulmanes et les quelques exemples qu'il nous relate ne peuvent que rappeler de bien douloureux souvenirs:
" Dès huit heures du matin le mardi 18 avril 1871 les villages et les fermes de la vallée du Sebaou étaient en feu, le pillage avait été lestement opéré, ils étaient si nombreux. Aux Béni-Thour, aux Taourga étaient venus se joindre les gens des Issers-Djedian, des Oulad-Smir, des Issers-Droh.
Pensez donc vingt mille indigènes pour saccager une centaine de maisons, c'est vite fait et ces messieurs vont vite en besogne; c'est si bon de détruire et surtout si facile; faire le plus de mal possible à ces Français abhorrés, quelle volupté sans pareille !
Et les scènes de désolation que je viens d'imparfaitement retracer se passaient en même temps à Tizi-Ouzou, à Azib-Zamoun, à Bordj-Ménaiel, à Dra El Mizan, à Bordj-Boghni, au col des Beni Aicha, à l'oued Corso, à Palestro, ou quarante- trois colons périrent, assassinés par leurs voisins, les Kabyles des Béni-Khalfoun ; pas une maison ne fut épargnée ; tout absolument tout fut pillé, saccagé, brûlé.
Le premier assassinat fut commis à cinq heures de l'après-midi ; le nommé Blanc instituteur à Reybeval fut la première victime.
Le malheureux se sauvait mais au lieu de suivre la grande route il voulut couper à travers champs ; des gens du douar de Ben-Archao l'aperçurent et le tuèrent.
A sept heures du soir une autre tentative d'assassinat avait lieu contre le sieur Rouchon aubergiste à Reybeval ; comme les autres il se sauvait dans une voiture ; trois kilomètres avant d'arriver à Dellys plusieurs coups de fusil furent tirés, une balle lui traversa le mollet.
Le curé de Reybeval et trois autres personnes furent également assaillis par une fusillade assez vive, personne heureusement ne fut atteint.
Onze colons n'avaient pu se décider à abandonner leur maison ; les femmes et les enfants étaient partis, ils crurent avoir le temps d'emporter encore quelques objets et cacher le reste. Les malheureux ! Ils avaient confiance dans les Arabes qu'ils employaient.
Les indigènes du douar de Barlia distant de Reybeval de trois cents mètres seulement vinrent, le soir du 17 avril offrir leurs services aux quinze malheureux colons qui les connaissaient de longue date, vivant côte à côte avec eux, travaillant ensemble, crurent pouvoir se fier à ceux qui s'offraient à les protéger.
Acceptant avec reconnaissance les offres de leurs voisins, ils leur donnèrent du pain, du café et la nuit se passa en causeries intimes ; mais le lendemain matin les défenseurs se firent égorgeurs; ils étaient trois cents contre onze, les lâches ! Ils tuèrent huit malheureux affolés qui ne songèrent même pas à se défendre.
Cependant les trois derniers refusèrent de se laisser égorger comme des moutons à l'abattoir et les poches garnies de cartouches, le fusil en bandoulière ils se précipitèrent dans la maison d'école dont ils barricadèrent la porte. Pendant une demi-heure ils tinrent en échec trois cents bandits, trois cents assassins. Pendant ce temps les gens de la tribu des Taourga arrivent en foule pour prendre leur part à la curée humaine; la besogne était faite aux trois quarts, les colons étaient égorgés.
La maison d'école servait de cible, déjà sept des assaillants étaient mortellement atteints lorsque Ahmet, le fils d'Aomar Ben Mahi-Eddin le chef des insurgés de Taourga, arrivant au galop de son magnifique cheval noir donna l'ordre de mettre le feu la maison d'école et d'enfumer, comme des sangliers dans leur bauge, les trois braves qui résistaient toujours.
Aussitôt les fagots amoncelés près des demeures des colons et destinés à chauffer le four furent apportés et bientôt les malheureux asphyxiés par la fumée furent obligés de grimper jusque sur la toiture du bâtiment.
Un des trois, le fils du maître d'école assassiné la veille, reçut une balle au moment où il passait la tête par une ouverture faite à la toiture, et deux mois après on voyait encore la traînée de sang le long du mur noirci.
Un second fut abattu au moment où, perdant la respiration, il cherchait à ouvrir une fenêtre du premier étage, quant au dernier, Lambert, sautant d'une hauteur de huit mètres, il vint donner, tête baissée, au milieu de la tourbe des assaillants. En un clin d'œil, il fut haché, chacun tenant à honneur de faire son trou dans ce corps déjà cadavre.
Et les plus acharnés, les plus avides de sang de ce malheureux père de famille, étaient précisément ceux à qui, une heure auparavant, il offrait une tasse de thé confectionné par lui-même au foyer domestique.
Mais nous ne sommes pas au bout, j'ai d'autres atrocités à vous raconter: Jourdan, colon à Reybeval reçoit à bout portant une coup de feu qui lui traverse la cuisse; il tombe, trois Arabes le prennent, le portent sur son lit, pillent sa maison, ferment les fenêtres, se retirent en tirant la porte à eux, mettent le feu aux quatre coins et brûlent le tout.
Canette se sauve, atteint la berge du Sébaou; six Arabes le poursuivent, tirent sur lui et le manquent ; d'autres arrivent, tirent aussi mais ne sont pas plus adroits ; la chasse continue, le gibier n'est pas atteint et cela dure dix minutes ; enfin le malheureux sent ses forces l'abandonner, son pied glisse, il s'abat et les chasseurs d'hommes trop maladroits pour atteindre leur victime, la course lui envoient trois balles à bout portant. Canette demande grâce, supplie ses bourreaux.
Un tigre plus tigre que les autres lui promet la vie s'il fait la prière de tout bon musulman : la iah ila Allah ou Mohamed raçoul Allah ; le malheureux est fort empêché, il ne sait pas un mot d'arabe ; répète lui dit-on : la ila Allah et Canette bégaie la formule ; à peine a-t-il prononcé le dernier mot qu'il reçoit un coup de bâton sur la tête et les monstres l'achèvent.
Rey est sur le seuil de sa porte, il se demande où fuir; passe Ali Srier l'ancien cheik de Barlia qui depuis dix ans que Reybeval est créé passe toutes ses journées au village, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre.
Rey l'appelle, lui demande aide ; Ali Srier s'approche et pour toute réponse plonge son poignard dans le ventre du colon et coupe proprement le cou à celui dont, il y a deux heures, il serrait la main.
Soudon a soixante-trois ans, il n'a pas voulu fuir la veille, quoique n'ayant rien à sauver ; c'est un maçon qui vit du travail de ses mains au jour le jour mais il est assez vieux, dit-il, pour faire un mort : Ali Mansour le voit, l'ajuste et l'abat d'un coup de fusil.
Onze ils étaient, onze furent assassinés. "
Après ces événements dramatiques, Villacrose regagna la Métropole en attendant que les émeutes se calment, que la vie reprenne son cours normal. Il conclut ainsi son récit d'une vie riche en événements de toutes sortes mais qui pour lui reste sans issue viable :
" Une fois marié je retournai en Algérie avec l'idée que j'allais dire un adieu définitif à ce beau pays ou s'étaient écoulées les vingt plus belles années de ma vie.
C'était au mois de juin 1873 ; je résolus, avant de partir, de faire voir à ma femme la Kabylie et quelques sites de la Mitidja. Nous fîmes une excursion à Tizi-Ouzou et Fort National, nous visitâmes Blidah, les gorges de la Chiffa et les villages échelonnés sur la route de la Kabylie.
Quitter Ben Ameur, dire un dernier adieu à ce que l'on a créé, ou quinze années de l'existence se sont passées avec alternatives de bons et de mauvais jours, abandonner pour toujours une position faite, quelque défectueuse qu'elle soit, rompre avec de vieilles habitudes d'indépendance, laisser derrière soi tous les vieux souvenirs ne se peut faire sans un grand déchirement intérieur.
Aussi n'étonnerai-je personne quand je dirai que lorsque la diligence passa devant ce qui avait été ma ferme, devant ces arbres que j'avais plantés et soignés, ce jardin, l'objet de toutes mes attentions, cette maison, cette avenue aux haies qui longent la route sur une longueur d'un kilomètre, lorsque enfin je me penchai à la portière, au détour d'un chemin, pour dire un dernier adieu à tout ce que j'aimais, je versai d'abondantes larmes.
Ma pauvre femme comprit bien ma douleur et l'étendue du sacrifice que je m'imposais car elle me serra la main ; ses yeux étaient humides et son regard voulait dire: je te rendrai en affection, en dévouement ce que tu abandonnes.
Le voyage s'effectua sans encombres, les deux journées de séjour à Alger furent employées aux quelques visites indispensables ainsi qu'aux acquisitions d'objets arabes que l'Algérien allant en France ne manque jamais d'emporter avec lui.
Enfin le samedi 10 janvier nous montions à bord du Lou Cettori, capitaine Cambiaggio, et trente heures plus tard nous débarquions à Marseille.
Cette fois j'étais en France et pour longtemps j'espère. "
Ecrits par " un petit colon " dont on ne connaît pas le prénom, ces extraits portent un témoignage essentiel sur le singulier parcours d'un homme confronté à l'hostilité de son environnement naturel et humain. Un homme " simple ", cultivé et lucide qui a, comme tant d'autres, fait le choix, un peu par hasard, de faire sienne cette terre d'Algérie qu'il a, au fil du temps, appris à aimer.
Révélant une expérience individuelle hors du commun, les tribulations s'inscrivent dans un contexte mondial de bouleversements politiques, de crises économiques et sociales majeures.
Pour se limiter à 1871, les sanglantes révoltes en Kabylie auxquelles Villacrose assiste coïncident à quelques mois d'intervalle, avec la défaite de la France face à l'Allemagne, l'écrasement de la commune de Paris, la proclamation du Reich allemand, l'abolition de la féodalité au Japon.
Pendant que la révolution industrielle bourgeoise s'impose à marche forcée dans la plupart des régions du globe, notre observateur engagé, à la plume rythmée et acérée, décrit une Algérie toujours ancrée dans un modèle agraire et dominé par une poignée d'exploiteurs avides de profits.
Sur ces terres inhospitalières, infructueuses et périlleuses, tout semble à faire souvent pour la majorité des habitants, qu'ils soient européens ou " indigènes " et ce dans des conditions matérielles et morales défavorables, déprimantes voire effroyables.
Entre les lois humaines et naturelles, les colons d'Algérie devaient pour longtemps encore se trouver au cœur de bien des " tribulations " - du latin ecclésiastique tribulatio (" tourment "), de tribulare (" battre avec le tribulum, herse à battre le blé "). Aussi est-il aujourd'hui nécessaire de lire, d'écouter et d'étudier, sans préjugé ni parti pris, tous les acteurs de cette dramatique histoire.
Ceux qui, depuis des décennies, ont dressé de la présence française un bien sombre tableau, niant les évidences et les réalités devraient faire preuve de pudeur et d'humilité en essayant de poser un regard plus honnête sur ce passé.
Par delà leur prêt à penser, leur haine idéologique de la colonisation, la surdité et la cécité leur tenant lieu d'objectivité et de vérité, ils comprendraient alors peut-être quelles furent les difficultés, les souffrances, les déceptions, les désillusions, les passions aussi qui jalonnèrent le parcours de ces dizaines de milliers pionniers.
N B : Vingt ans en Algérie ou tribulations d'un colon racontées par lui-même : la colonisation en 1874, le régime militaire et l'administration civile, mœurs, coutumes, institutions des indigènes, ce qui est fait, ce qui est à faire par A. Villacrose .
Le texte complet de cet ouvrage est disponible sur le site http://www.algerie-ancienne.com et sur le site gallica.bnf.fr de la Bibliothèque Nationale.
Recherches et études effectuées par Christian Graille
|
|
Racontez-nous vos vingt ans
À Alger en 1962
|
Avoir 20 ans ! C'est devenir un adulte, être libre de penser et d'agir.
Avoir 20 ans ! C'est toute la joie du monde qui vous assaille. C'est être heureux, avoir envie de danser, de rire, de chanter, d'aimer.
Comme l'a écrit Damien Sargue dans la comédie musicale Roméo et Juliette : " Avoir 20 ans : c'est rêver que le monde est beau ".
Mais aussi : avoir 20 ans, c'est trembler de peur.
Pour moi, l'anniversaire de mes 20 ans est le plus triste de mes souvenirs.
Mon anniversaire aurait dû se dérouler, comme tous les autres anniversaires, chez mes grands-parents, entourée de toute la famille, dans la joie et le bonheur. À la table de mes grands-parents chargée de mets appétissants préparés avec amour, dans le brouhaha d'éclats de rires, dans une atmosphère de chaude affection et de bonne humeur, attendant la " distribution " des cadeaux avec force exclamations !
Mais non ! La vie (l'Histoire devrais-je dire) en a décidé autrement.
Nous avons échappé à plusieurs reprises à la mort : une bombe explosant à la sortie du lycée, puis la fusillade du 26 mars 1962 à Alger où des soldats français ont tiré sur d'autres Français : des femmes, des enfants, des hommes désarmés, uniquement chargés de victuailles, de lait pour les enfants, de médicaments, se dirigeant en cortège pour approvisionner les habitants du quartier de Bâb el Oued bouclé par les CRS.
Dans un fracas épouvantable, les militaires ouvrent le feu dans notre dos ! Les rafales d'armes automatiques claquent sans sommation, reprennent, se prolongent, interminables. La foule se disperse, court en tous sens, des femmes tombent blessées à mort, la rue Michelet se couvre de sang. Le drapeau tricolore porté avec tant de fierté baigne dans le sang de ses fils assassinés. Les cris des enfants cherchant leurs mères, la colère, le désespoir.
Mon père, après quatre jours de file interminable sous un soleil de plomb, a réussi à avoir des places sur le "Ville d'Alger " en partance pour la France. Nous venions à tour de rôle le ravitailler en eau fraîche et en nourriture, pour qu'il ne perde pas sa place.
Le container que nous avions obtenu à prix d'or fut soigneusement immergé à plusieurs reprises par les dockers ; si bien que quelques mois plus tard, après l'avoir laissé dans un garde-meubles, puisque nous ne savions pas où aller, tout était moisi, irrécupérable.
Les files de Pieds-Noirs, harassés, écrasés de chaleur, de fatigue et de désespoir, sont comme des chênes déracinés, qu'on arrache à leur terre. Les collines d'Alger la blanche s'éloignent, la mer si bleue lui sert d'écrin.
Les larmes coulent sur les visages. Le désespoir se lit dans les regards. Notre cœur se déchire. Tout un peuple meurtri s'arrache à son pays. Nous montons sur la passerelle du bateau comme si nous allions à l'échafaud.
Sur le pont, ma mère soudain me prend dans ses bras, et en pleurant me dit :" Ma pauvre chérie, on n'a même pas pensé à ton anniversaire ! ". Là, accoudées au bastingage, serrées l'une contre l'autre, mêlant nos larmes et nos angoisses, je réalise que je viens d'avoir 20 ans ! Là, sur ce bateau qui nous emporte sur les routes de l'exil..
Qu'est-ce qu'un anniversaire, fut-ce celui de vos 20 ans, quand vous perdez votre terre, vos morts, vos amis, votre maison, vos animaux de compagnie, votre école ? Quand vous perdez tout ce qui a fait votre vie ? Un déchirement. Voilà ce que c'est.
Je joins cette photo où on voit ma grand-mère toute petite et menue, manteau noir et foulard blanc, au premier plan sur le pont du bateau. Vous remarquerez que nous portions tous des manteaux alors que nous étions en plein mois de juin en Algérie. (II fait froid en France ! Et nous n'avions droit qu'à une valise).
Jocelyne MAS
(1) Poète, écrivain, conférencière; Maître en littérature, chevalier dans l'ordre national du Mérite, membre de la Société des Poètes Français.
Site Internet : http://www.jocelynemas.com
|
|
PHOTOS de KIOSQUES
Envoyé par M. Remy Lafranque
|
|
LES FRANÇAIS EN ALGERIE (1845)
Source Gallica : Louis Veuillot N°15
|
FIGURES HOMERIQUES
Un kaïd des plus braves avait une femme spirituelle et jolie, nommée Mouna, et de cette femme un fils, le plus charmant enfant du monde, gracieux, intelligent, déjà brave, et l'un des meilleurs écoliers du curé de Constantine. C'était une famille heureuse. Mais, toute charmante qu'était Mouna, elle se trouva un jour avoir huit ou neuf ans de mariage, et le kaïd, sans cesser de l'aimer, épousa une autre femme, Loulou, qui veut dire perle, riche et de bonne famille, plus jeune que Mouna, sinon plus belle.
C'est l'usage à Constantine qu'un homme, lorsqu'il est marié à plusieurs femmes, fasse demeurer chacune d'elles dans une maison séparée. Le ménage autrement ne serait pas tenable. Les femmes, en créant cette nécessité, ont ainsi élevé un petit obstacle aux débordements de la polygamie. Mouna n'eut donc pas le chagrin de voir sa rivale, mais elle ne tarda pas à connaître qu'il ne lui restait plus qu'une faible partie du cœur qu'elle avait possédé en entier. Un noir chagrin s'empara d'elle.
Sans se plaindre à l'ingrat, la pauvre créature, un jour (elle ne l'avait point vu de tout ce jour-là), fit un nœud à son écharpe de soie, et se pendit. Les négresses qui la servaient se mirent à percer l'air de leurs cris, ne songeant point du reste à détacher leur maîtresse, déjà sans mouvement. Par bonheur, le soldat qui était de faction à la porte les entendit. Il appela ses camarades ; et, bien qu'il soit défendu d'entrer dans les maisons musulmanes, ces hommes pénétrèrent courageusement chez le kaïd, forçant les portes qu'on n'ouvrait pas. Ils commencèrent par couper l'écharpe ; d'autres coururent au médecin qui arriva bientôt, accompagné d'une sœur. On vit que Mouna respirait encore, et à force de soins on la fit revenir. Le kaïd parut sur ces entrefaites.
Un peu surpris devoir sa maison pleine de soldats, de médecins, de religieuses, il s'informa d'où venait ce désordre. On le lui dit, et il ne trouva point mauvais qu'on eût empêché sa femme de mourir.
L'événement avait produit dans la ville une grande rumeur. Quelque chose en vint jusqu'aux oreilles du lieutenant général, qui, le soir même, voyant le kaïd, le questionna. " Bah ! Répondit celui-ci, un rien ! Une de mes femmes s'était pendue par jalousie. Le factionnaire a entendu crier, il est entré chez moi, et il a décroché ma femme; je vous prie de ne le point punir. "
Le curé, ami de la maison, alla voir Mouna, et lui offrit des consolations qu'elle reçut avec reconnaissance. Elle parut heureuse surtout de se confier à la religieuse qui l'avait secourue, et qui, parlant arabe, pouvait entendre au plus long le récit de ses douleurs. Elle déplorait amèrement le cruel usage qui permet au mari d'abandonner la mère de ses enfants pour former de nouveaux nœuds ; elle enviait aux femmes chrétiennes leur liberté, leurs droits, leur sécurité. " Je ne puis être chrétienne, ajouta t-elle, mais je veux au moins que l'enfant que je porte (elle était enceinte), si c'est une fille, soit plus heureuse que sa mère, et, si c'est un garçon, ne soit pas accusé un jour par des pleurs semblables à ceux que son père fait couler. Il faut que cet enfant soit chrétien."
Elle exprima ce désir à son mari. " Mais, répondit le kaïd, qu'à cela ne tienne! " Il alla trouver le curé. " Eh bien, l'enfant de Mouna sera chrétien. Elle le désire, et je le veux. Nous lui donnerons ton nom si c'est un garçon ; si c'est une fille, on lui donnera le nom de la religieuse. Tu as fait du bien à ma femme en lui parlant de Dieu. J'en suis content; je t'en remercie."
En effet, quand la Mouna fut délivrée, on porta l'enfant au curé de Constantine pour qu'il lui administrât le baptême. Le curé ne trouva point que tout cela fût assez sérieux ; il craignit de hasarder le sacrement sur la garantie d'une pareille démarche, et engagea les parents à réfléchir de nouveau. Le kaïd ne se crut point délié de sa promesse ; en attendant qu'on baptise son enfant, il l'a nommé Yacoub, le curé se nommant Jacques. Puisse le baptême promis à cette innocente créature lui être donné un jour, et puissent avec le baptême descendre sur elle toutes les bénédictions du Ciel! Quant à la Mouna, toujours délaissée, toujours triste, elle s'est résignée à vivre ; Quelle mère voudrait mourir lorsque la faible main d'un enfant qui vient de naître, la retient captive au bord de son berceau?
Voici d'autres histoires du même. Nommé chef (un peu in partibus) d'une tribu mal soumise, il fit sur cette tribu, pour la décider à payer l'impôt, une première expédition qui ne réussit pas. Tandis qu'on en préparait une seconde, le kaïd reçut du roi un magnifique yatagan. Il en baisa la poignée, et jura qu'il ne s'en servirait que pour la France. La seconde expédition partit ; les insoumis, fiers de leur premier succès, attendirent de pied ferme les collecteurs. Mais nous avions un échec à venger, et le kaïd voulait tout à la fois entrer en possession de sa charge et faire honneur au yatagan du roi.
Il se précipita sur l'ennemi comme un héros et comme un fou, accompagné de son jeune enfant, qui le suit toujours à la guerre. Les rebelles ne purent résister; bientôt défaits, ils lâchèrent pied. On les poursuivit quelque temps, on leur prit du butin, ils demandèrent grâce, se montrant disposés à payer. Le kaïd voulait toujours frapper ; mais, Dieu merci, nous ne savons pas frapper l'ennemi qui se met à genoux, fussions-nous cent fois assurés de son parjure. Forcé d'être clément, le kaïd envoya aux chefs amnistiés un de ses hommes pour recevoir l'impôt. Ce cavalier ne tarda pas à revenir mécontent, disant que les vaincus y mettaient de la mauvaise grâce, et que ceux qui versaient la contribution en blé ne faisaient pas bonne mesure. Le kaïd s'élance à cheval, fond sur le groupe qu'on lui dénonçait, et, sans prendre aucune information, sans regarder où portent ses coups, il en tue trois. Les autres alors reconnurent leur faute et protestèrent qu'ils mesureraient mieux. Parmi les trois tués se trouvait un scheik ; le kaïd le remplaça, et le payement se fit sans murmure.
Tout n'était pas fini cependant. Des parents et des amis du scheik tué avaient résolu de le venger. Ils pénètrent la nuit dans la tente de son remplaçant et lui coupent le cou. La nouvelle en fut bientôt, connue à Constantine.
Le kaïd la reçut dans le salon même du général. Il commença par pleurer de rage; puis, tirant son sabre, il lui fit serment de ne le point remettre au fourreau avant d'avoir obtenu par lui justice et vengeance de cet affront. Il part sur-le-champ, emmène ce qu'il rencontre de cavaliers, et se lance avec cette faible escorte, au milieu des rebelles. Deux jours après il revint. Trois tètes étaient pendues à la selle de ses cavaliers.
Comment se trouve-t-il de l'humanité dans un pareil caractère? Et cependant il y en a. Un jour d'hiver, marchant, avec une colonne française qui avait à franchir un torrent grossi par la pluie et fort dangereux, l'implacable chef passa successivement sur son cheval plus de trente fantassins des plus faibles et des plus fatigués, exposant en une heure plus de trente fois sa vie. D'Aceilly disait en son temps :
Je ne connois qui que ce soit,
De ceux qui maintenant suivent Mars et Bellone,
Qui (s'il ne ravageoit, voloit, tuoit, brûloit)
Ne fut assez bonne personne.
Ces traits s'appliquent assez aux zouaves, corps formé à l'origine d'indigènes et de Français, mais où les Français sont aujourd'hui en majorité : il n'y a point de meilleure troupe : terrible au feu, patiente dans les garnisons, bonne à tout, et, à ce que me disait un de ses officiers, douce comme une brebis. Ayant toujours été employés aux choses les plus difficiles, les zouaves sont presque aussi admirables par leur industrie que par leur courage. Il faut voir, par exemple, à combien d'usages ils savent employer la légère pièce d'étoffe verte qui, roulée autour d'une calotte rouge, leur forme un turban : premièrement, dans les haltes au soleil, étendue sur quelques baïonnettes habilement disposées, où accrochée par un bout aux épines d'un buisson, et fixée, de l'autre, à terre par une pierre ou par la crosse d'un fusil, elle sert d'ombrage : c'est l'affaire d'un clin d'œil. A peine la halte est sonnée : vous regardez où sont les zouaves;maïs, suivant l'expression d'un tambour de zéphyrs : éclipse de ces messieurs ! ils sont sous leur verdure : vous n'en voyez plus que les extrémités. Cependant le zouave se livre aux douceurs de la sieste, et, grâce à l'abri qui le préserve de l'accablement, suite ordinaire d'un somme fait au soleil, il est toujours alerte et dispos. Au milieu de la marche on rencontre une citerne : un peu d'eau fraîche y brille, éclat plus séduisant que celui de l'or ! Il ne s'agit que d'atteindre à cette onde de délices.
Mais, hélas ! la saison est brûlante, l'eau a baissé dans cette citerne profonde. Le pauvre fantassin regarde et passe en soupirant. Arrive le zouave, et l'utile turban devient corde à puits ! Le soir, campe-t-on près d'une rivière, on voit (merveille de l'industrie et de la nécessité !) des soldats pécher à la ligne avec leurs fusils : des crins, dérobés à l'ondoyante queue d'un cheval arabe, sont attachés à la baïonnette, une épingle, précieusement conservée, forme l'hameçon ; ou appâte par quelque procédé inventé sur l'heure, et le poisson est si ingénu, qu'il se laisse prendre. Le zouave, lui, pèche en grand : de son turban il fait un filet, et sa marmite est encore la mieux garnie. Dans une razzia le turban devient licol pour mener le petit bétail: vous voyez chaque zouave tenir en laisse, comme un berger de Gessner, ou sa chèvre ou son mouton, après le combat, c'est encore une chose très-parfaite pour lier les prisonniers. Lorsque l'on prévoit un bivouac sans bois, rien n'est meilleur pour emporter de petits fagots d'épines, destinés à faire bouillir le pot. Un pauvre petit enfant, malade et nu, fut trouvé sur la paille d'une gourbi abandonnée de la veille : un zouave le roula dans son turban comme une momie, et le porta ainsi au quartier du général Mustapha. On est très-convaincu que, si un zouave pouvait se pendre, il se pendrait avec son turban. Enfin ce turban, qui sert à tant d'usages et à mille autres, sert aussi de turban : coquettement disposé autour de la calotte rouge, il sied à la physionomie du soldat ; il peut préserver le visage d'un coup de soleil, et la tète d'un coup de yatagan.
Ce serait une longue besogne, à quoi je renonce, de décrire la cuisine du zouave : il mange et boit de tout. Nul n'assaisonne mieux l'artichaut sauvage, qui croît en abondance dans le pays de Mascara; il fait un plat agréable d'un peu de blé vert, il se régale de tortues, de limaçons ; il n'attendrait pas d'être pris par la famine, pour se servir, comme le fit la garnison de Lille, un chat flanqué de douze rats et de pareil nombre de souris ; je ne sais s'il s'accommode du chacal, mais j'ose affirmer qu'il en a goûté; quant au cheval il l'estime autant que cavalier qui soit dans le monde ; s'il voit
……… glisser sur la verdure
Comme sur un tapis tissu par la nature,
Sans fiel et sans venin, des serpents écaillés,
De couleur, de vernis, de dorure émaillés,
Qui, différents de forme et de lustre superbes,
Semblent des veines d'or qui rampent sur les herbes,
il ne s'amuse pas à les admirer, mais bien à les saisir et encore plus à les manger. Enfin que dirai-je? On vit un jour deux zouaves en discussion pour savoir à quelle sauce ils pourraient mettre un nid de cloportes qui se remuaient à leurs pieds. Voilà pourtant comment se nourrissent les héros.
Je reviens à nos alliés arabes : voici un trait d'Ismayl, neveu du général Mustapha, qui fait voir qu'on sait se battre aussi bien dans la province d'Oran que dans celle de Constantine
A la fin d'une longue journée de marche et de combat, Ismayl aperçut au loin, presque à perte de vue, trois Arabes ennemis. Calculant la force de son cheval et la faiblesse des leurs, sans rien dire à personne, il fondit sur eux avec la rapidité de l'éclair. On pensait si peu qu'il fût possible de les atteindre, et c'était une si inconcevable témérité d'aller seul les attaquer, que personne au premier moment ne devina ce que voulait faire Ismayl. Lorsqu'il ne fut plus possible de douter, il n'y eut qu'une voix contre sa folie. On disait qu'il allait bien gratuitement se faire couper le cou. Toutefois quelques Douairs, des moins fatigués, se lancèrent sur ses traces.
Les Arabes poursuivis ne s'éloignaient pas, soit qu'ils pensassent qu'on ne pourrait les joindre à la distance où ils étaient, soit qu'ils se crussent en force. Ismayl, cependant, se trouva près d'eux, et, presque au même instant, deux coups de feu partirent, un homme tomba. De loin, l'armée suivait avec anxiété ce combat inégal, ne sachant si c'était Ismayl ou un autre qui venait de tomber. Les Douairs labouraient les flancs de leurs chevaux qui volaient, et ils les excitaient encore par des cris ; mais Ismayl, s'il n'était pas mort, pouvait mourir cent fois avant qu'ils fussent arrivés. Le vieux Mustapha, à cheval, sa lorgnette à la main, demeurait impassible. On vit les trois hommes disparaître. Les Douairs s'avançaient toujours; les uns pensaient qu'ils voulaient au moins rapporter le cadavre d'Ismayl ; les autres, qu'on remmenait prisonnier, et qu'ils voulaient tenter de le délivrer.
Les hommes poursuivis étaient des Douairs déserteurs. Ils avaient tiré sur l'assaillant sans l'atteindre; plus heureux, Ismayl abattit d'un coup de pistolet celui qui venait de le viser. Voyant un des leurs hors de combat, et saisis de crainte à l'aspect du terrible chef, les deux autres voulurent fuir; mais, ainsi qu'Ismayl l'avait bien prévu, leurs chevaux épuisés ne purent gagner de vitesse. Les cavaliers approchaient, toute résistance était impossible. Quoique sachant bien ce qui les attendait, ils se rendirent ; on les vit tous reparaître à l'horizon, et bientôt Ismayl remit sa prise à Mustapha. Ce fut le commencement d'un autre drame.
Mustapha avait déjà reconnu les déserteurs. Il prit en silence son fusil, et tira sur l'un d'eux, qui tomba percé de balles. C'est la justice de l'agha. Le second allait subir le même sort; mais un jeune officier qui se trouvait là, cédant à la pitié, sans calculer autre chose, le prit dans ses bras, le mit sur son cheval, et, s'enfuyant accompagné des imprécations du vieux chef, il alla se jeter aux pieds du général Lamoricière. Aussitôt que lui arriva un cavalier hors d'haleine, qui dit que l'agha, regardant l'enlèvement de ce prisonnier comme une offense, se livrait à une fureur qui faisait trembler tout le monde.
Il prétendait que personne n'avait le droit de soustraire un de ses hommes à ses châtiments, et il exigeait qu'on lui rendît le captif, pour qu'il le mit à mort. M. de Lamoricière n'avait rien à opposer à ces réclamations; néanmoins il ne pouvait se décider à renvoyer l'Arabe. On aurait fusillé un Français, mais avant de le fusiller, on l'aurait jugé. La justice musulmane déconcerte notre sévérité judiciaire, et, lorsqu'elle frappe, elle semble assassiner. M. de Lamoricière députa vers l'agha, pour l'engager à se calmer, lui promettant qu'il ferait juger et punir le déserteur. Mustapha ne voulut rien entendre, et sa colère s'accrut. Il jura qu'il ne laisserait point méconnaître son autorité, qu'il ne bougerait avant que le coupable fût entre ses mains, qu'il ne rentrerait jamais dans Oran, et s'en irait plutôt à l'ennemi. De nouvelles démarches furent inutiles. Mustapha était homme à tenir ses menaces, il fallut bien céder. On lui conduisit donc lentement le déserteur, en lui disant que le général le recommandait à sa clémence. C'était tout ce que l'on pouvait faire, au point où les choses en étaient venues. Mustapha ne voulut rien promettre. Quand l'homme parut, il prit des mains d'un de ses moukalia son fusil, qu'il avait fait recharger ; le cadavre de l'autre était encore là.
Tout le monde était dans la stupeur et gardait le silence : en ce moment Ismayl intervint. Il se plaça devant son oncle, mais en lui tournant le dos ; et, sans s'adresser à l'agha, comme s'il n'eût point songé à ce qui se passait, il se mit à flatter le cou du magnifique cheval que montait le vieux chef. "Oh ! lui dit-il à demi-voix, en l'appelant par son nom, tu es un noble animal, et tu appartiens à un noble maître. Tu aimes l'odeur de la poudre et le bruit des fusils, mais ton maître s'y complaît davantage, et combien n'en a-t-il pas fatigué de plus robustes que toi ? Tu sais combien il est terrible, tu ne sais pas combien il est généreux."
Le déserteur n'était plus qu'à deux pas. Contre l'attente générale, Mustapha, au lieu de tirer sur lui, le regarda en silence, avec des yeux foudroyants. Ismayl, s'adressant toujours au cheval, sans regarder son oncle, continua :
"Le maître que tu portes au-devant de la mort, et qui l'a bravée quatre-vingts ans, a fait trembler tous ses ennemis ; dans tout le Maghreb tu n'en pouvais trouver un plus redoutable ni plus respecté. Ceux qui ont vu d'autres hommes proclament qu'il n'y en a point d'aussi vaillant que Mustapha...
- Chien, dit le vieux chef au déserteur, pâle et tremblant, d'où viens-tu ? que t'a donné Ben-Mahiddin ? Comment t'a récompensé le fils de Zohra la danseuse ( 1 )? qu'il vienne maintenant te tirer d'ici."
(1) C'est toujours par ces termes de mépris que Mustapha désigne Abd-el-Kader; il ne le nomme jamais par son nom. Il aime à répéter que sa mère allait danser chez les Turcs, ce qui est très-méprisé, et que l'émir n'était qu'un petit mendiant qui venait lui lire les saintes Écritures pour quelques sous.
Le déserteur n'eut garde de répondre. Mustapha continua d'attacher sur lui ses terribles regards. Ismayl poursuivit :
" Quel homme sur la terre pourrait sauver un autre homme de la colère de ton maître, ô noble cheval ? Ce n'est ni le sultan de Fez, ni celui de Constantinople, ni celui de Paris. Mais ce qu'aucun prince ne peut faire, sa clémence et la grandeur de son âme l'ont fait souvent. Il sait que sa justice est respectée, et il n'a pas besoin du sang des misérables. Il accorde à la faiblesse et à la prière ce qu'il refuserait à la force des souverains."
Ismayl se tut ; il y eut encore un moment de silence. Mustapha parut faire un effort.
"Va, chien, dit-il enfin au déserteur, tu devrais mourir ; mais va dire à mon ami (le général Lamoricière) que je te fais grâce, parce que tu as eu le bonheur de toucher son cheval."
C'est par cette sévérité que le vieil agha a retenu et peut retenir encore beaucoup des siens dans le devoir ; mais il y a bien à penser qu'il sera le dernier des chefs arabes. Avec lui mourra la tradition. Nul autre n'aurait le pouvoir de rendre ainsi la Justice.
Voici une figure française. Le colonel T*** ne charge jamais assez selon ses goûts. Lorsqu'il voit un beau groupe d'Arabes, il commence par le caresser d'un œil d'envie; puis il tourne la tète pour ne pas céder à la tentation, puis il regarde encore, il se raisonne, il se dit qu'il ne faut pas faire d'imprudence inutile, que si le colonel n'est pas sage, les soldats deviendront fous ;... puis enfin il n'y tient plus, pique des deux, vole au-devant des ennemis, et ne s'arrête que lorsqu'il est à la portée de la voix, c'est-à-dire beaucoup plus près qu'il ne faut pour être à la portée du fusil ; et alors, comme un véritable héros d'Homère qu'il est, il adresse aux Arabes un petit discours : "Ah ! leur dit-il, gredins ! (ou quelque autre épithète du même genre) croyez-vous qu'on a peur ? C'est moi, T*** ! Venez donc un peu , seulement quatre ou cinq, causer jusqu'ici. " On l'ajuste, il laisse faire; et s'il voit les Arabes fondre sur lui, il se retire tout doucement, pour donner le temps de le rejoindre aux plus pressés, tenant prête sa longue lame étincelante, dont on connaît les grands coups. Ce naïf courage plaît aux soldats plus qu'on ne saurait le dire, et personne dans l'armée ne doute de ce qu'une bonne escouade est capable de faire quand le colonel T*** la conduit.
Ce noble guerrier a manqué son époque; il aurait dû naître au temps des croisades. Son noble cœur palpite sous la croix d'honneur, qu'il a bien gagnée ; avec quelle force n'aurait-il pas battu sous une autre croix, non moins glorieuse et plus sainte; et comme ces aspirations de renommée et d'avenir qui se bornent à la terre, parce qu'ainsi le veut notre temps, se seraient magnifiquement élancées vers le ciel !
J'estime toutes les bravoures ; mais, je l'avoue, j'ai un goût particulier pour ces preux dont le caractère me rappelle si bien les vieux pourfendeurs de cimier et les vieux marteleurs d'armures, qui, se reposant de la tactique sur la sagesse du roi Philippe-Auguste, ne s'inquiétaient que de pénétrer dans les rangs des Sarrasins aussi loin que le roi Richard.
Notre armée en renferme beaucoup de ceux-là ; c'est ma joie de le voir, et d'entendre conter leurs beaux faits. Pendant la marche, durant le repos des haltes, on se répète le récit de cent traits admirables, légendes de ce peuple flottant. Les hommes ont raison de tant louer le courage, ce n'est presque jamais une vertu isolée; d'autres vertus l'accompagnent, et sont pour ainsi dire la vigoureuse racine dont le courage est la merveilleuse fleur. Celui qui est toujours prompt à l'attaque, toujours calme dans le péril, et qui sait, comme il arrive tous les jours, exposer sa vie non-seulement pour acquérir la considération et la gloire, mais parce qu'il veut au fond de l'âme honorer son drapeau, sa patrie, et dans mille occasions secourir un frère d'armes, un malheureux qui va périr, celui-là aurait fait de grandes actions partout.
Quand je vois ce que deviennent sous l'uniforme ces hommes que la vie civile nous montre en France si généralement dépourvus de toute grandeur, je me reprends d'admiration pour l'espèce humaine et pour mes concitoyens. A travers les vices qu'ils gardent encore, je salue avec amour la noble étincelle que le choc d'un devoir fait jaillir de ces cœurs trop refroidis. Je pense à ces autres soldats qui, sous le conseil d'une pensée plus haute et d'un sentiment plus généreux partent un à un du même sol de France, sans bruit, sans armes, sans gloire humaine, pour aller à travers plus de périls conquérir à leur roi céleste non des villes et des provinces, mais des royaumes et des mondes. O France! sans tes prêtres et sans tes guerriers, quel serait ton rang parmi les nations !
O terre de gloire qui peux produire de tels saints et de tels héros, pourquoi n'es-tu pas tout entière héroïque et sainte? Pourquoi tes drapeaux n'abritent-ils pas tes missionnaires? pourquoi la croix de tes missionnaires n'accompagne-t-elle pas en tous lieux tes drapeaux? Ton sol généreux engraisse une race vile, qui annule, en les désunissant, tes deux grandeurs, et les empêche de t'assurer l'empire du monde.
|
La dame aux cheveux argentés
Envoyé Par Mme Eliane
|
|
Une dame aux cheveux argentés téléphone à son voisin et lui dit :
S'il te plaît, viendrais-tu chez moi? J'ai besoin de ton aide pour commencer à assembler un puzzle.
Son voisin décide d'aller lui donner un coup de main.
Arrivé chez elle, elle le laisse entrer et lui montre toutes les pièces du casse-tête éparpillées sur la table.
Son voisin lui demande:
Qu'est-ce qu'il est supposé représenter ton casse-tête ?
Elle lui répond : Selon la photo sur la boite, ça devrait être un coq.
Il se met à examiner les morceaux pendant un certain moment, puis regarde la boite et, se tournant vers elle lui dit :
Premièrement, peu importe ce que nous faisons, nous ne serons pas capables d'assembler ces morceaux pour en faire un coq.
Il prend sa main et lui dit :
Deuxièmement, je veux que tu te relaxes.
Prenons une bonne tasse de thé.
Et ensuite, il ajoute après avoir laissé échapper un profond soupir ......
Remettons tous les Corn Flakes dans la boite!
|
|
|
Le monde intellectuel français, l'abandon et l'exode des Pieds-Noirs : Des années 50 à nos jours
Envoyé par Marius Piedineri
|
" Nous avons chacun à notre tour à assumer notre rôle de témoin. C'est peu. Mais c'est mieux que de demeurer emmurés dans les interdits qui nous mènent tout droit, silencieusement, après notre bannissement physique et symbolique hors de l'Algérie et hors de l'histoire de France, à l'effacement total " Emmanuel Navarro
Dans un article précédent, j'étais amené à citer un extrait d'un roman d'Alexis Jenni, L'art français de la guerre, prix Goncourt 2011. Il y fait dire à l'un de ses personnages :
" Les pieds-noirs, c'est notre mauvaise conscience, ils sont notre échec encore vivant. Nous voudrions bien qu'ils disparaissent, mais ils restent. On entend encore leurs brailleries et leurs outrances verbales. Leur accent en voie de disparition, on l'entend toujours, comme le ricanement de fantômes."
Tout porte à croire que ces mots reflètent la pensée profonde de l'auteur. Alexis Jenni - qui a récemment co-signé un essai avec Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation (Mémoires dangereuses) - affirmait ainsi dans un entretien donné à L'Express, à propos des Pieds-Noirs et de la guerre d'Algérie, que " leur présence même interdisait la résolution du conflit "(1)
Comme on le voit, les Pieds-Noirs sont ici assimilés au pire, à une tumeur à éliminer, au mieux au petit grain de sable qui aurait enrayé l'amitié franco-algérienne. Ce qui empêchait, pour lui, la résolution du conflit, ce n'est pas la présence de deux civilisations antagonistes, la violence et l'intransigeance du FLN, ou le panarabisme de Nasser, pas non plus la politique coloniale menée par Paris depuis plus de cent ans, ni même les " ultras " de l'Algérie française, non, ce qui empêchait la résolution du conflit algérien, c'est un petit peuple d'un million de personnes fait essentiellement d'ouvriers, d'employés, de fonctionnaires, de petits commerçants, de petits colons, de chauffeurs de taxi, de boulangers, de pêcheurs, de médecins et d'instituteurs ; un petit peuple avec ses qualités et ses défauts, peu politisé mais de sensibilité essentiellement patriote et républicaine, qui fut en première ligne dans les armées de la Libération en 1944/1945 ; une communauté entière d'hommes et de femmes qui eurent le seul tort de naître Français au Sud de la Méditerranée, quand bien même l'arbre généalogique de certains d'entre eux plonge ses racines en Algérie depuis des millénaires ; enfin un petit peuple de pionniers qui fit naître une culture originale à la croisée des chemins, français, latins, berbères, avec l'apparition d'un dialecte, d'une littérature, d'un folklore, d'un humanisme méditerranéen, d'un mode de vie, et d'une école de peintres plus que prometteuse.
Dans ce cas pourquoi ne pas dire que ce qui empêchait la résolution du conflit au Rwanda, c'était la présence des Tutsis, ou, en ex-Yougoslavie, la présence de Croates qui eurent l'outrecuidance de ne pas accepter le nettoyage ethnique qui leur était promis ? Alexis Jenni parle-t-il en l'air, ou bien ses propos reflètent-ils la pensée profonde d'une partie du monde intellectuel au sujet des Français d'Algérie ? Notre petite étude nous montrera que de telles assertions ne doivent en effet rien au hasard. Dès les années 50, certains intellectuels parmi les plus éminents ont banalisé, justifié voire encouragé l'éventualité d'une disparition collective du peuple Français d'Algérie, au mépris du plus élémentaire droit des gens. Nous tenterons également, en conclusion, de faire le lien entre cet abandon passé et la situation actuelle.
I. Tout le monde ou presque savait qu'il n'y aurait aucune place pour les Pieds-Noirs dans une Algérie entièrement livrée au FLN.
Tout le monde ou presque savait, et pourtant…
Les anticolonialistes qui, bien naïfs, ont cru sincèrement à la possibilité d'une Algérie indépendante sous l'égide du FLN où toutes les communautés, Pieds-Noirs, Arabes et Berbères, chrétiens, juifs et musulmans auraient pu vivre dans la paix et la fraternité ne sont bien sûr pas visés dans cet article. Mais il y en eut d'autres, des partisans du FLN, qui furent parfaitement lucides sur le sort qui serait réservé aux non-musulmans après l'indépendance acquise. Seulement, il en fallait plus pour les faire reculer et se remettre en question. C'est d'eux que nous parlerons ici, à commencer par le sinistre Jean-Paul Sartre.
Le philosophe Jean-Paul Sartre, proche du Parti communiste (" tout anticommuniste est un chien ", dira-t-il) est dans les années 50 l'intellectuel français le plus estimé dans le monde. Sa parole porte sur les cinq continents. Discret sous l'Occupation où il ne prit part à aucune action sérieuse de la Résistance, il tentera de se racheter - tout en prenant beaucoup moins de risques, ce qui est un avantage indéniable - pendant la guerre d'Algérie, prenant très tôt position en faveur de la cause indépendantiste incarnée par la rébellion armée du FLN. Sa préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon, qu'il signe en 1961 va lui donner l'occasion d'exposer ses idées manichéennes et ultra radicales sur la question, Sartre n'hésitant plus à légitimer la violence la plus crue vis-à-vis des Européens d'Algérie qu'il assimile en bloc à des " colons ", destinés à être éliminés purement et simplement.
D'abord il faut rappeler que lorsque ce dernier écrit dans un café des quartiers bourgeois de Paris, en ce début des années 60, ses appels au meurtre, des Hommes, des Français, des enfants parfois se font quotidiennement égorgé en Algérie. Ces gens vivent donc dans leur chair la réalité tragique de la guerre et du terrorisme, loin, très loin de l'abstrait d'une discussion philosophique. Il faut être un " assassin de comptoir " comme Jean-Paul Sartre pour se payer le luxe d'appeler par la plume au massacre de civils innocents sans prendre lui-même le moindre risque.
La parole est à l'assassin :
" Car, en ce premier temps de la révolte, écrit Sartre, il faut tuer : abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : reste un homme mort et un homme libre ".
Je ne suis certes pas agrégé de philosophie comme l'était ce phare de la pensée, mais j'ai tout de même suivi quelques cours de mathématiques à l'école, et puis, j'ai un esprit assez simple.
Si je comprends bien, si un Européen mort = un colonisé libre, pour que tous les colonisés accèdent à la liberté, il faudrait tuer tous les Européens… Peut-être que je me trompe, après tout, je ne sais pas. Pourtant Sartre, dénonçant quelques années plus tôt " le cycle infernal du colonialisme " affirmait que ce cycle " s'incarne dans un million de colons, fils et petits-fils de colons " (2) vivant en Algérie, soit la totalité de la population Européenne, hommes, femmes, enfants. C'est donc un million de personnes, un million de Françaises et de Français que Sartre appelle tranquillement à éliminer : " il faut tuer ", dit-il. Voilà qui résonne comme un appel, certes " philosophique ", au génocide de classe (3) , et il est étonnant que quasiment personne ne l'ait relevé jusqu'à aujourd'hui. Les plus critiques envers Sartre affirment qu'il serait seulement " allé trop loin ", et cet homme, qui a du sang sur les mains jusqu'aux coudes, est aujourd'hui encore admiré et respecté par une bonne partie de l'intelligentsia française (rappelons qu'il est le fondateur du quotidien de gauche Libération, ce journal abreuvé de subventions publiques). Car l'élan génocidaire se confirme lorsqu'il écrit :
" avec le dernier colon tué, rembarqué ou assimilé, l'espèce minoritaire disparaît, cédant la place à la fraternité socialiste ".
L'assassin de comptoir Jean-Paul Sartre, précédant même le FLN, promet donc aux Pieds-Noirs " la valise ou le cercueil " ! Cette phrase, est un appel on ne peut plus clair à la mort collective des Européens d'Algérie, " espèce minoritaire ", au pire par le massacre généralisé (" le dernier colon tué "), au mieux par le nettoyage ethnique et l'exode (" le dernier colon […] rembarqué "). Et l'on trouve encore aujourd'hui des gens de gauche, admirateurs de Sartre, pour expliquer aux Pieds-Noirs que s'ils ont dû quitter leur pays, ce serait du fait des crimes de l'OAS ! Mais c'est leur maître à penser qui, comme on le voit, a lui-même théorisé " la valise ou le cercueil " ! Qu'ils l'assument ! On ne m'enlèvera d'ailleurs pas de l'idée que si Sartre écrit cela, c'est bien qu'une partie non négligeable de la société française de l'époque était prête à accepter ce discours de haine.
A sa décharge et à celle de ses amis d'extrême gauche, leurs appels au meurtre contre les méchants colons d'Algérie ne représentent, il est vrai, que peu de choses si l'on additionne l'ensemble de leurs compromissions avec les mouvements terroristes et autres régimes criminels du XXème siècle. Comme l'écrivait récemment Emmanuel Navarro, professeur de philosophie et docteur en sciences sociales, " au moment où ces intellectuels s'engagent dans l'affaire algérienne, leur mode de raisonnement est profondément aliéné. Entre Staline, Lénine et Mao, c'est déjà quelque cent millions de morts que ces révolutionnaires de salon n'avaient pas remarqués. Leur engagement contre la guerre d'Algérie n'augurait rien de bon. " (4) Il faut bien le reconnaître, reprocher à Sartre sa responsabilité dans l'exode des Pieds-Noirs d'Algérie revient un peu à accuser un serial-killer d'avoir volé un bonbon, enfant, à un camarade de classe.
Pour en finir avec Sartre, je citerai les mots du rappeur plutôt islamiste et violemment antifrançais Médine (de son nom complet Médine Zaouiche), né au Havre en 1983 de parents Algériens, qui, dans une chanson sur la guerre d'Algérie datant de 2012 le qualifie… de " traître " (5) !, " car porteur de valises ". Ce pauvre Sartre, on le voit, n'a même pas su se faire respecter par ses petits protégés. Il avait pourtant fait tout son possible pour gagner l'amitié du " peuple Algérien " (peuple qu'il ne connaissait absolument pas, d'ailleurs) opprimé par la France, jusqu'à l'encourager à massacrer le plus possible de Pieds-Noirs. Tout ça, pour, 50 ans après, se faire traiter de " traître " par ceux-là même qu'il a défendus si passionnément… Ce mot de Médine rappelle une remarque que s'entendaient dire de la part des Algériens les Français ayant soutenu la lutte du FLN (les fameux porteurs de valises), après l'indépendance : " Soit ! nous vous reconnaissons du courage et vous aurez droit éternellement à notre gratitude. Mais quelque chose nous gênera toujours un peu : comment vous, Français, avez-vous pu trahir la France, même pour nous ? " (6)
Venons-en à la duplicité de certains responsables communistes. Jean Chaintron en est un bon exemple. Ce dernier, venu de France métropolitaine en Algérie le temps de quelques années uniquement pour y faire de la politique, fut candidat du Parti communiste aux législatives à Alger en 1936 sous le pseudonyme de " Barthel ". Il faillit arriver au second tour, à 70 voix derrière le candidat de centre-gauche Henri Fiori, rassemblant près de 20 % des voix des Pieds-Noirs Algérois. Chaintron avait été condamné par la justice quelques mois plus tôt pour avoir rédigé un document anticolonialiste dit " circulaire Ferrat-Barthel ", appelant " le peuple algérien " à la lutte contre la France " oppresseuse ", y compris par la violence.
Le double discours, voire le cynisme de cet homme est assez net.
D'abord, voici ce qu'indique la profession de foi de son parti à Alger, distribuée pendant la campagne électorale : " Nous luttons pour instaurer, comme en Union soviétique, un gouvernement ouvrier et paysan dans une Algérie libérée, où sans distinction de race ou de religion les travailleurs, débarrassés de leur exploiteurs communs, vivront libres et égaux dans le bien-être et la paix. " (7) Sans distinction de race ou de religion… Il promet donc à tous un avenir radieux. Mais voici ce que le même Chaintron/Barthel écrit de l'Algérie des années 30 dans son autobiographie, parue en 1993 :
" La réalité était différente du schéma de la fameuse " circulaire Ferrat-Barthel ". La religion musulmane était la base effective du mouvement national algérien. Les chefs musulmans avaient certes diverses tendances politiques : celle des oulémas tels Cheik Ben Badis, El Okbi, Brahimi, des réformistes tels Ferhat Abbas, Bendjelloul, Lamine Lamoudi, des révolutionnaires tel Messali Hadj de l'Etoile nord-africaine. Le lien, le ciment, le trait commun, était l'Islam. Les communistes musulmans seuls étaient associés à un mouvement national. Aucun Européen ne pouvait y appartenir. " (8)
Aucun Européen ! Quel aveu ! Ce qui ne l'a pas empêché de continuer à tenter de rallier les Européens d'Algérie à l'idée d'indépendance totale tout en sachant bien, au fond de lui, qu'elle se ferait sans eux, et sans même les prévenir du danger qu'ils encouraient. Jean Chaintron n'a donc pas hésité à " jeter dans la gueule du loup " ses propres électeurs. Ajoutons qu'il n'a pas un seul mot de compassion, dans cette autobiographie rédigée dans les années 80, pour ce peuple ouvrier d'Alger qui lui avait fait confiance au moment du Front populaire, désormais " rapatrié " après huit années de souffrances. Pour lui qui se vante à plusieurs reprises de son bon score électoral (il frôle les 30 % dans le faubourg ouvrier de Bab-el-Oued), ces hommes ne représentaient sans doute qu'un tremplin à sa carrière politique.
Revenons-en à la guerre d'Algérie. Signe de plus que bon nombre d'intellectuels Français n'avaient strictement rien à faire du sort de leurs compatriotes d'outre-mer, l'affaire du Manifeste des 121, cette " Déclaration " sur le droit des soldats à l'insoumission datant de septembre 1960, justifiant " le refus de prendre les armes contre le peuple algérien " (9) et faisant de " la cause " de ce peuple celle Un manifeste signé entre autres par Françoise Sagan, Simone Signoret et Marguerite Duras. Mais l'intellectuel Jean Daniel, pourtant favorable aux thèses anticolonialistes, explique avoir refusé de le signer. Pourquoi ? Il le dit lui-même : " j'avais soumis mon acceptation à un additif concernant les Français d'Algérie qu'une désertion des nôtres laissait à la merci des égorgeurs du FLN. […] Beauvoir a refusé. " (10) Que les Français d'Algérie soient laissés à la merci des égorgeurs du FLN, il en fallait plus pour émouvoir Mme Simone de Beauvoir et tous les autres signataires ! La suite a montré que les massacres redoutés par Jean Daniel ont bien eu lieu. On comprend mieux maintenant pourquoi de nombreux Pieds-Noirs ont pu être persécutés, au lendemain du cessez-le-feu du 19 mars 1962, dans une relative indifférence. Sans parler des Harkis.
On a là un exemple parfait de la trahison d'une certaine gauche intellectuelle à l'égard des Pieds-Noirs. Car ce sont ces mêmes gens de gauche, y compris socialistes, qui au milieu du XIXème siècle appelaient à coloniser la moitié de la planète pour la faire profiter des " bienfaits " de la civilisation Européenne et des " Droits de l'Homme " (en effet l'Algérie française est d'abord en bonne partie une idée de gauche de "tous les hommes libres". (11) : n'oublions pas que c'est la Révolution de 1848, qu'on ne peut pas soupçonner d'être de droite, qui fit de l'Algérie un territoire officiellement " français " (12), sans parler de la politique assimilationniste menée par la IIIème République), ce sont ces mêmes gens de gauche, disais-je, qui brutalement, à partir des années 1950 ne jureront plus que par l'idée toute neuve de " décolonisation ", quitte à appeler au meurtre des descendants des colons qu'ils ont eux-mêmes installés un siècle auparavant. Rappelons au passage que c'est la droite qui, pendant longtemps, quasiment seule s'est opposée à la politique coloniale de la France. Et, saviez-vous, que le journal de Léon Gambetta, grand homme de gauche et père fondateur de la République française, dans un article de 1875 traitant de l'Algérie désignait l'Islam comme " ennemi de la République " (13) ? Même journal qui défendait en même temps l'idée de peupler l'Algérie de nouveaux colons. Voilà qui n'a pas empêché une grande partie de la gauche (pas toute, heureusement) d'accepter que soient jetés en pâture à l'Islam les Français d'Algérie en 1962, avec le résultat que l'on connaît. On désigne un " ennemi " après avoir conquis son territoire, et puis on livre un million de citoyens Français à cet " ennemi ".
Il est vrai que la gauche française est habilement parvenue - sur le dos des Pieds-Noirs - à faire oublier le rôle majeur qu'elle a tenu dans l'histoire de la colonisation (14) . Il y eut, pendant la guerre, les " résistants de la dernière heure ", on peut aussi parler d'" anticolonialistes de la dernière heure ", de ces gens qui avant 1954 savaient à peine situer l'Algérie sur une carte et qui, le premier Pied-Noir égorgé, se sont brusquement découvert une âme de défenseur du peuple Arabe opprimé par les colons. Car le peu d'intérêt longtemps manifesté par les adhérents des partis de gauche sur les questions algérienne et coloniale a déjà été démontré par de nombreux historiens. De même, lorsqu'en 1920 le député Pied-Noir d'Alger Charles-Eugène Lefebvre (radical-socialiste), dénonce avec vigueur à la tribune de l'Assemblée nationale (15) , la famine qui menace chez les musulmans Algériens des campagnes suite à une récolte désastreuse, seuls quelques députés assistent à la séance. En effet la famine touchant les Arabes intéressait si peu les députés de Métropole que la séance faillit être reportée (16) … Alors, que chacun reconnaisse ses torts et ses responsabilités et tout ira pour le mieux. Tout historien sérieux le sait : les premiers à avoir nettement dénoncé la grande misère du peuple musulman en Algérie française furent des Pieds-Noirs, de toutes tendances politiques, et ce dès le XIXème siècle (17) . Ils n'ont pas attendu pour cela les leçons de morale du consortium Sartre-Beauvoir et de l'extrême gauche parisienne des années 1950.
Ajoutons que l'anticolonialisme moderne est né à l'aube du XXème siècle seulement (18) , et qu'il fut même longtemps ultra-minoritaire. A ce moment-là, les Pieds-Noirs étaient déjà solidement implantés en Algérie. Ce peuple n'a donc pas à répondre d'un " crime " qui n'existait pas à l'époque où il s'est constitué, pas plus que les Italiens d'aujourd'hui n'ont à répondre des crimes des Romains de l'Antiquité. On ne verbalise pas un homme et encore moins un groupe humain, en démocratie, pour une action commise avant qu'elle ne soit répréhensible. Ce d'autant plus que la population Européenne d'Algérie, démocratie de petites gens, n'était pas une population coloniale au sens premier du terme. D'après l'historien Pierre Darmon, celle-ci n'a, je cite, " aucun point commun avec [les populations] des autres colonies où de riches planteurs vivent du travail d'une main-d'œuvre servile ou indigène nombreuse et misérable ", mais, ressemble " davantage " à celles " des autres pays méditerranéens " :
" Les grands propriétaires terriens et les grandes exploitations capitalistes existent, certes, mais le phénomène reste limité […]. En revanche, les petites gens et les petits métiers sont pléthore, ajoute cet historien décrivant le travail dans les villes d'Algérie au XIXème siècle. " (19)
Mieux, voici ce qu'écrit l'historien Juan Bautista Vilar au sujet des immigrés Espagnols, " pépinière de main-d'œuvre " dont la France avait besoin pour construire l'Algérie : " Pendant la conquête et jusqu'au début du XXe siècle, la réticence massive de la population autochtone à collaborer avec l'occupant européen a rendu indispensable le recours à une main d'œuvre importée. " (20) Ecoutons enfin le journaliste Ernest Mallebay, bon bourgeois d'Alger né en France métropolitaine, s'étrangler face au manque de main-d'œuvre dans l'industrie du bâtiment en 1928 :
" Même avec ces salaires de quarante et cinquante francs par jour, [les patrons] commencent à n'en plus trouver. Et, pas moyen d'en faire venir de France où se manifeste comme ici, la furie de construction !... Quant à l'Italie qui nous fournissait tant de bons maçons et de manœuvres, on ne peut plus compter sur elle. Le régime mussolinien a tari l'immigration de l'étranger… " (21)
On le voit, presque cent ans après la conquête de l'Algérie, la France comptait encore sur l'importation d'une main-d'œuvre Européenne à bon marché pour construire Alger ! Ce sont les descendants de ces pauvres et laborieux immigrés que Sartre appellera à massacrer. Ce sont eux qui en France se feront - et se font encore aujourd'hui - traiter d'esclavagistes, chose qu'ils n'ont, croyez-moi, toujours pas digérée. Même les colons d'ailleurs, les fameux " colons ", qui représentaient moins de 10 % de la population Pied-Noir, n'étaient pour la plupart que de modestes paysans. Ainsi des vignerons, dont seulement 10 % possédaient plus de cinquante hectares de terre, et, beaucoup, moins de dix hectares (22) .
Faut-il rappeler que le revenu de la très grande majorité des Français d'Algérie, dans les années 1950, était encore inférieur de 20 % au revenu moyen des Français de Métropole ? Faut-il également rappeler que l'Assemblée nationale n'a jamais siégé à Bab-el-Oued, et que c'est bien la France métropolitaine qui en Algérie a toujours été maîtresse de la situation ? Ces gens de gauche, sachant cela (car ils le savaient) auraient donc pu se contenter de dénoncer le fait que le pouvoir parisien a toujours permis aux gros colons, pourtant ultra-minoritaires, d'être surreprésentés pour porter la parole des Français d'Algérie, et épargner ainsi la grande majorité de cette population faite essentiellement de petites gens, de leur hargne. Mais non, ils ont décidé de faire d'une population entière d'un million de personnes une coupable. Coupable de quoi ?
On ne sait pas. Peut-être de troubler la tranquillité d'un pays qui était réticent à entamer une nouvelle guerre à l'heure des Trente Glorieuses et de la société de consommation. Mais ça, ils ne le diront pas. Mieux vaut affirmer avec force que " la cause du peuple algérien est la cause de tous les hommes libres " (ça sonne si bien comme formule) que d'avouer avoir "la flemme " et la lâcheté de porter secours à de lointains compatriotes en danger de mort.
La guerre d'Algérie est donc ce moment où le maçon de Bab-el-Oued, le marchand de glaces de Boufarik et le cafetier de Constantine se sont fait traiter de colons esclavagistes (avec l'idée que pour cela, ils devaient être violemment punis) par une bande d'acteurs de cinéma et de grands bourgeois Parisiens sortis tout droit des grandes écoles, n'ayant jamais manqué de rien.
Reste quand même une interrogation. Comment est-il possible, à la vue de ces jeunes Juifs ou de ces ouvriers de Bab-el-Oued ayant toujours voté à gauche venant grossir les rangs de l'OAS, comment est-il possible que ces intellectuels ne se soient pas posé quelques questions, ne se soient pas dit, constatant cette réalité, qu'il y avait " quelque chose qui cloche " dans leur raisonnement, et que, peut-être, la cause du conflit algérien était à rechercher ailleurs que dans la lutte simpliste entre des Arabes opprimés et de méchants colons capitalistes ? Quid de l'Islam ? De l'arabisme ? De l'intransigeance fanatique du FLN ? En effet pour quelle raison étrange un ouvrier Pied-Noir, socialiste depuis toujours, se serait-il brusquement transformé en soldat d'une armée fasciste rêvant de renverser la République, dans un petit laps de temps allant de 1960 à 1962 ? N'y avait-il pas là matière à réflexion chez ces phares de la pensée parisienne ?
Mais il fallait liquider le " système colonial " au plus vite, comme ils le disaient (un système qu'ils ont, rappelons-le, eux-mêmes largement contribué, philosophiquement et matériellement, à mettre en place, en tant que républicains et hommes de gauche). Peu importe si cela implique au passage la liquidation d'un peuple entier fortement enraciné sur ses terres. Il l'avait bien cherché de toute manière, ce peuple, puisqu'il était un élément de ce fameux " système colonial ". La guerre d'Algérie des intellectuels de gauche, où quand l'idéologie ne voit plus dans les hommes et les femmes faits de chair et de sang qui peuplent un pays, que les " éléments " d'un " système " à " liquider ". Voilà l'idée générale : Nous nous sommes mal comportés, pendant 132 ans, avec les Arabes ? Eh bien, sacrifions-leur les Français d'Algérie, et tous ces mauvais souvenirs seront vite oubliés ! Albert Camus, appelait cela " battre sa coulpe sur la poitrine d'autrui " (23) , ce qu'il trouvait, au passage, " dégoûtant " : " Si certains Français considèrent que, par ses entreprises coloniales, la France (et elle seule, au milieu de nations saintes et pures) est en état de péché historique, ils n'ont pas à désigner les Français d'Algérie comme victimes expiatoires […], ils doivent s'offrir eux-mêmes à l'expiation ", ajoutait-il avec sagesse.
Rappelons au passage que certains communistes, si prompts à dénoncer - avec raison, sur le fond - la torture pratiquée par l'armée française sur les nationalistes algériens, s'accommoderont fort bien en tant que " pieds-rouges " de cette même torture dans l'Algérie indépendante de Ben Bella quand celle-ci sera homologuée " socialiste ". Car la guerre d'Algérie restera aussi comme ce moment étrange où des communistes staliniens sont parvenus à se faire passer pour des parangons de vertu et de grands humanistes devant l'Eternel…
Mais au-delà de Sartre et de la gauche, il existe d'autres tendances dans l'indifférence au sort des Français d'Algérie, dont une tendance plus " douce ", " de droite ", qu'incarne bien Raymond Aron, l'autre grand intellectuel des années 50. Homme de centre-droit, libéral, Raymond Aron ne voue aucune haine aux Français d'Algérie, il n'en a juste pas grand-chose à faire. Pour lui, ils ne servent plus - économiquement parlant - à rien. Et tant pis s'ils doivent être brutalement arrachés à leur terre. André Rossfelder relate un dialogue édifiant de cynisme qu'il eut avec lui dans son bureau parisien, dans les premiers temps de la guerre d'Algérie. Raymond Aron lui faisant part du gouffre financier que représenterait selon lui le maintien de l'Algérie sous souveraineté française, il lance ensuite au Pied-Noir Rossfelder venu à sa rencontre pour discuter pétrole : " Croyez-moi. Il vaut mieux clore l'affaire et rapatrier les Français d'Algérie " (24) . Jean Daniel parle lui-même des " thèses d'Aron, qui préconisait un abandon immédiat pur et simple, un rapatriement à froid des Français d'Algérie " (25). Aron, en bon capitaliste propose donc un gigantesque plan social, considérant les gens et les peuples comme des pions sur un échiquier. Encore s'agit-il d'un peuple bien particulier, celui des Français d'Algérie, ces Français lointains, qui plus est " bâtards méditerranéens " (cette sympathique expression nous vient de l'historien " anticolonialiste " Gilbert Meynier (26) ), un peuple dont on pouvait par conséquent bien se passer. Car on ne peut pas négliger complètement la question sous-jacente du racisme dans toute cette histoire - bien que, je tiens à le préciser, j'ai horreur des discours victimaires à la mode.
Souvenons-nous de l'écrivain François Mauriac parlant des Français d'Algérie comme d'une " race méditerranéenne, française par la langue, mais non par le tempérament ", ou des mots de de Gaulle sur les " braillards " et les " Marseillais puissance dix ", pour ne pas citer d'autres exemples.
Les populations d'Algérie, faisaient aussi partie de ces Français d'outre-mer que l'on peut bazarder au gré des caprices ou des intérêts de la Métropole. De ça les Canadiens-Français, ancêtres des Québécois, ont failli en faire les frais il fut un temps. Un " intellectuel " de l'époque de Louis XIV, ancêtre spirituel de Raymond Aron, après avoir fait le constat que le Canada n'enrichissait pas assez le Royaume de France proposait de le céder aux Britanniques en cas de défaite, puis d'envoyer ses habitants Français peupler la lointaine vallée du Mississipi. Un historien écrit ainsi :
" Sujets du roi que l'on tient à conserver, les Canadiens sont néanmoins une population de seconde zone, de celles, vaillantes et serviables mais périphériques et finalement plus guère inquiétantes, que l'on songe à déplacer selon les besoins de la métropole " (27).
Remplacez roi de France par général de Gaulle, et Canadiens par Pieds-Noirs, et le tour est joué. On comprend mieux, après cette anecdote, les grands débats qui l'année 1962 virent de Gaulle et ses conseillers se disputer sur l'utilité ou non d'envoyer les Pieds-Noirs, déracinés, peupler l'Amérique du Sud ou d'autres terres lointaines. Après tout on eut bien, autrefois, l'idée étrange de considérer l'esclavage comme pratique illicite sur le sol de France, mais comme un mal nécessaire dans de lointaines colonies type Antilles ou Guyane… " Un monde nous séparait des métropolitains ! écrit le Pied-Noir Emmanuel Navarro. […] Nous leur avons été utiles, en notre temps. Nous étions là parce qu'ils l'avaient voulu, nous sommes partis quand ils le décidèrent. Utiles, et jetables. Bref, simples pions. Les Français s'étaient payé l'Algérie. Durant plus d'un siècle aucun problème moral majeur n'obscurcit leur horizon. Aux premiers coups de fusil ils s'en découvrirent des problèmes moraux, s'en effrayèrent et ils la rendirent. " (28) L'exemple du Canada présenté plus haut ne peut que confirmer cette brillante analyse.
Car il est certain qu'un homme comme François Mauriac, bon bourgeois de droite fortement attaché à son terroir bordelais, qui prit assez rapidement position, à demi-mot, pour la cause du FLN (29), aurait fait la malafatche (la grimace, en parler Pied-Noir) si ç'avait été les gens de " sa race " qui s'étaient trouver menacés par le terrorisme et l'exil forcé sans retour. Se lançant dans une comparaison entre les vins de Bordeaux et de la Bourgogne, il écrivait, en effet : " Pour moi, la supériorité du bordeaux vient de son naturel : il est né de ma terre, de mon soleil et de l'amour attentif que lui voue ma race " (30) . C'est si joliment dit. Mais quant à la " race " des Européens d'Algérie, et avec eux, leurs vins, ils pouvaient bien crever, il en fallait plus à cet homme pour l'empêcher de dormir.
La France dans son ensemble a accepté sans broncher, en 14-18, de sacrifier un million et demi de ses enfants pour récupérer l'Alsace et la Lorraine (région comprenant à peine plus d'un million d'habitants), tandis que moins d'un an après le début du conflit algérien, une bonne partie des intellectuels Français avait déjà pris parti pour la capitulation et contre la continuation de la guerre déclarée par le FLN. Une guerre, visant il est vrai en partie à secourir un pseudo-peuple de Français exotiques, aux noms de famille la plupart du temps espagnols, italiens ou sépharades… C'est à se demander dans quel camp se trouvaient les vrais " racistes ".
Nous ne parlons pas, bien sûr, de ce racisme haineux qui déchaîne les passions, mais, plutôt de ce petit mépris d'abord inoffensif, qui devient toutefois plus gênant dès lors qu'il est question de faire des sacrifices en faveur de celui qu'on a depuis longtemps rabaissé. C'est cela, aussi, qu'ont vécu les Français d'Algérie entre 1954 et 1962. Savez-vous qu'un journal parisien, dans les années 1920, se permettait de traiter de " bicots " (31) les députés Pieds-Noirs, et que l'un d'entre eux, le républicain-socialiste Henri Fiori, était gentiment surnommé " le Sidi " par ses collègues de Métropole (mais lui, loin de s'en plaindre disait en être " très fier " (32) …) ? Quant au grand écrivain Pied-Noir Albert Camus, il restait pour le Parisien Jean-Paul Sartre, malgré son prix Nobel, un " petit voyou d'Alger " (sic) qui a osé venir jouer dans la cour des grands.
Qu'on ne s'étonne pas, après ça, si le parti de l'abandon en rase campagne des Européens d'Algérie ait été si puissant en France durant la guerre d'Indépendance, et si l'accueil qui leur fut réservé en Métropole après le sauve-qui-peut final fut si froid. Bien sûr il ne s'agit pas de présenter les Pieds-Noirs comme les pauvres victimes du racisme de leurs compatriotes, et nous savons bien que les choses sont beaucoup plus complexes, comme nous savons aussi que les Pieds-Noirs eux-mêmes n'ont jamais été avares de moqueries et de préjugés vis-à-vis des Français de Métropole (qu'ils surnommeront, avec humour, " les patos ", mot qui signifie en espagnol petits canards…). Mais, quand même, il y a des facteurs qu'on ne peut pas négliger si l'on veut être honnête.
On a même vu naître pendant la guerre d'Algérie, un discours sournois (discours que l'on entend encore aujourd'hui) visant à présenter comme des frères qui s'ignorent le jeune soldat Français, paysan appelé sous les drapeaux, un peu fruste, gentiment xénophobe, et bercé des souvenirs récents de la lutte contre l'Occupation allemande, et le fellagha Algérien assimilé à un Résistant, un maquisard luttant fièrement pour sa terre. Une fraternisation, imaginée sur le dos des Pieds-Noirs (puisque c'est bien connu, toute fraternisation se fait sur le dos de quelqu'un), ce jeune peuple de " colons " cupides, de " bâtards méditerranéens " qui " n'avait rien à faire là-bas ", et ne pouvait pas se targuer d'une présence dix fois millénaire sur son sol natal. En somme, l'alliance du Gaulois éternel et de l'Arabe, indigènes " authentiques ", contre le Pied-Noir abâtardi et hors-sol !
Et il n'y a guère que pour discréditer les Pieds-Noirs qu'un historien comme Michel Winock, parangon de l'intellectuel Français antiraciste et de gauche, peut se permettre de banaliser des propos xénophobes. Dans son ouvrage L'agonie de la IVe République (33) sorti en 2006, ce dernier cite l'écrivain Anatole France qui s'indignait, en 1905, évoquant l'Algérie : " [La France] a, pendant soixante-dix ans, dépouillé, chassé, traqué les Arabes pour peupler l'Algérie d'Italiens et d'Espagnols. " Mais, loin de contredire Anatole France et de souligner sa xénophobie, Michel Winock en remet une couche en citant opportunément les obscurs " frères Tharaud ", qui en 1912 se désolaient que " l'Afrique du Nord n'est plus à nous : c'est une vache que le Français maintient solidement par les cornes, tandis que le Maltais, l'Italien, l'Espagnol la traient inépuisablement. Est-ce donc pour installer chez nous quatre cent mille étrangers que nous avons dépensé des milliards […] ? Bientôt, si cela continue, nous ne serons plus qu'une poignée de fonctionnaires et de capitalistes perdus dans une masse italo-espagnole, et c'est nous qui serons forcés de nous assimiler à ces étrangers ". De telles paroles ouvertement xénophobes, qui auraient en temps normal fait bondir ce grand " républicain " qu'est Michel Winock, sont présentées ici comme une indignation bien légitime. On voit à travers cet exemple qu'un historien plutôt de gauche, dès lors qu'il s'agit des Pieds-Noirs acquiesce au discours anti-Etrangers le plus caricatural qui soit. Le lecteur de ce livre d'histoire on ne peut plus sérieux aura donc compris que l'Algérie française, c'est l'histoire d'un malheureux territoire livré à une bande de gangsters Italo-Espagnols, hommes étranges et malhonnêtes qui n'auraient eu comme seul objectif que de la " traire " pour mieux s'enrichir facilement.
Mieux, quelques pages plus loin, l'historien Winock cherche à ridiculiser le Pied-Noir Albert Camus pour sa volonté de résoudre la guerre d'Algérie en posant comme principe fondamental de ne pas sacrifier une des deux communautés du pays - en l'occurrence la sienne -, ce qui semble pourtant assez sain comme idée. Voilà le " crime " de Camus ! Il est vrai que Michel Winock n'a jamais témoigné d'une grande sympathie pour les Français d'Algérie. Revenant en 1972 sur sa jeunesse anticolonialiste, il dit à propos d'eux : " Il nous restait l'impression que nous avions affaire à une bande de sauvages, faite d'anciens combattants à béret basque et de blancs-becs vociférants […]. Par ces clichés sur les Pieds-noirs, nous nous sentions justifiés de les maudire. " (34) Que l'histoire de l'Algérie eût été belle s'il n'y avait eu que de braves Français comme M. Winock, défenseurs distingués des Droits de l'Homme, de la veuve et de l'orphelin (comme l'est tout " vrai " Français…), au lieu de ces prolétaires, ces usurpateurs Italo-Espagnols - et même Maltais, imaginez !... - qui par leur seule présence ne pouvaient que tuer dans l'œuf la grande amitié franco-arabe. Peu importe que ces gens ne soient absolument pour rien dans la décision prise par le roi Charles X de conquérir Alger en 1830, peu importe qu'ils aient été naturalisés Français depuis bien longtemps déjà, et qu'ils aient donné leur sueur pour féconder la terre algérienne (35) comme ils ont versé leur sang pour la Libération de la France en 1945, plus que tout autre Français (36) .
Ce mépris face au sort des populations d'Algérie infuse jusque dans la culture populaire, comme le montre si bien la chanson Cette-année-là (1962), interprétée par Claude François (pourtant lui-même exilé d'Egypte) dans les années 70. Voilà une chanson, dont les paroles sont une véritable insulte à un tout un peuple de déracinés, ayant déjà eu largement son compte d'humiliations, obligé de subir la vision d'un chanteur en costume à paillettes, sautillant et chantant " C'é-tait-l'a-nnée… soi-xan-te-deux ! " sur un air de fête. Et pourquoi pas l'année 1914, ou l'année 1940 ! Là encore, peu importe que " cette année-là ", quoi qu'on pense de l'Algérie française, la France ait été amputée d'une grande partie de son territoire. Peu importe que " cette année-là " des dizaines de milliers de Harkis aient été massacrés. Peu importe également qu'une communauté entière de près d'un million de Français ait été chassée de sa patrie, dispersée aux quatre coins de la planète sans espoir de retour, la plupart n'emportant de leur vie là-bas qu'une valise.
Ce mépris, on le constate encore de nos jours jusque dans les plus petites communes de France, avec ces rues, ces places, et ces commémorations du 19 mars 1962.
L'atmosphère était créée. Les esprits étaient préparés à admettre l'injustice. On a même pris soin préalablement de défranciser une population devenue trop gênante ; de Français d'Algérie, d'Algériens (37) ils sont devenus " Pieds-Noirs ", ou " petits-Blancs ". C'est ce qui fait dire au philosophe Emmanuel Navarro :
" Le plus difficile à faire entendre en France fut manifestement que […] la communauté pied-noir existait et qu'elle devait continuer d'exister afin que l'exigence de justice fût respectée. Camus a tenu à en témoigner jusqu'au bout, contre tous. […] Pour [les " intellectuels engagés "] le seul " réalisme " politique concevable devait aboutir au sacrifice des Pieds-noirs. […] Condamnés au bannissement, promis et exposés aux représailles, nous l'étions déjà dans les mots des intellectuels parisiens, comme les Tutsis du Rwanda l'étaient sur les ondes de la Radio des mille collines avant leur massacre effectif. " (38)
Car tout le monde ou presque savait ce qu'il adviendrait des Pieds-Noirs au cas où l'Algérie serait entièrement livrée au FLN. De grandes voix se sont élevées pour le dire. En vain. Parmi ces voix disparates, celles du Maréchal Juin, du député Pascal Arrighi ou bien d'Albert Camus. Une phrase de Camus datant de mars-avril 1958, jamais citée mais néanmoins très instructive, alertait :
" Ceux qui préconisent, en termes volontairement imprécis, la négociation avec le F.L.N. ne peuvent plus ignorer, devant les précisions du F.L.N., que cela signifie l'indépendance de l'Algérie dirigée par les chefs militaires les plus implacables de l'insurrection, c'est-à-dire l'éviction de 1 200 000 Européens d'Algérie et l'humiliation de millions de Français avec les risques que cette humiliation comporte. C'est une politique, sans doute, mais il faut l'avouer pour ce qu'elle est, et cesser de la couvrir d'euphémismes. " (39)
Et l'on reproche encore maintenant à Camus de s'être " trompé " sur la guerre d'Algérie ? Mais cet homme était un visionnaire !
Deux ans plus tôt, le 31 janvier 1956, Camus toujours, conversant avec son ancien professeur Jean Grenier, évoquait en ces termes ce qu'il nomme les " folles exigences " du FLN : " une nation algérienne indépendante ; les Français sont considérés comme étrangers, à moins qu'ils ne se convertissent. La guerre est inévitable. " A Jean Grenier qui lui demande : " Et si la France abandonne tout, comme elle est disposée à le faire ? ", Camus, " naïf ", répond : " Elle ne le pourra pas, parce que jeter 1 200 000 Français à la mer ne pourra être admis par elle. " (40) Ça le sera. Notre écrivain ne disait pas autre chose, dans le fond, que le socialiste Guy Mollet, s'exprimant à l'Assemblée nationale le 9 mars 1956 comme chef du Gouvernement : " préparer l'avènement d'un Etat musulman indépendant d'Algérie […] reviendrait à éliminer la population d'origine européenne ". " Pas avec nous ! ", concluait-il fermement. Là encore, on connaît la suite. Fait essentiel : ces paroles, qui datent de l'hiver 1956, sont bien antérieures à l'apparition de l'OAS, et précèdent même l'envoi du contingent. Ce qui relativise donc fortement l'idée selon laquelle l'exode final des Français d'Algérie n'aurait pu être évité que par une capitulation immédiate face au FLN, ou serait dû à la seule intransigeance des " ultras " de l'Algérie française.
Quant au FLN, on ne compte plus les indices et les déclarations de ses dirigeants montrant qu'il n'avait nullement l'intention de construire une Algérie indépendante avec les Pieds-Noirs. Simple exemple : " La vengeance [sera] longue, violente et […] [exclut] tout avenir pour les non-musulmans ". Cette sentence ne souffrant aucune ambigüité est prononcée par deux hauts responsables du FLN discutant avec Jean Daniel en 1960 (41) . Le but d'une telle " vengeance " ? " Redonner à l'islam sa place ", précisent-ils. Si cela ne suffit pas, rappelons qu'il n'y a pas un seul exemple à cette même date (et encore aujourd'hui, d'ailleurs) d'un pays musulman qui ait traité ses minorités chrétienne et juive dans l'égalité et dans un respect absolu. L'Algérie du FLN aurait-elle fait exception à la règle ?
Toutes ces bonnes âmes type Jean-Jacques Servan-Schreiber (et avec lui L'Express, son journal), qui exhortaient jour après jour le gouvernement français à " discuter " et " négocier " avec le FLN, étaient-ils au courant du fait que c'est le FLN qui s'est toujours refusé à négocier quoi que ce soit, y compris - ce qui a posteriori en dit long sur ses intentions… -, y compris un statut au rabais de protection de la minorité Pied-Noir après une éventuelle indépendance ! Cette intransigeance, sur ce point précis, n'était-elle pas à elle seule tout un programme ? Mais ne soyons pas naïfs. Il semble plus juste que ces appels à la " paix " et à la " négociation " ne furent qu'un faux prétexte pour mieux dissimuler leur manque de solidarité.
Car évidemment, lorsqu'on se veut un " intellectuel " Français héritier de Zola, admettre sans précautions oratoires que l'on s'apprête à livrer un million de ses compatriotes à leurs égorgeurs potentiels, ne fait pas très " propre ". Parlons plutôt de " paix négociée ", de " paix juste " (les jolis mots…), et l'honneur sera sauf. Notons qu'on retrouve aujourd'hui les mêmes bonnes âmes incitant Israël à négocier avec le Hamas, organisation islamiste qui prévoit dans ses statuts… la destruction d'Israël.
Personne ne peut donc dire, dans cette affaire, qu'il " ne savait pas ". C'est pourquoi à l'aube de l'année 1962 un Français d'Algérie, le diplomate Marcel Ducrocq, lançait ce cri du cœur :
" On peut accepter pour soi le martyre ; nul n'a le droit de l'exiger des autres et à plus forte raison d'une population entière " (42) ; " Car, en ce moment, tout repose sur de l'indéterminé. […] Mais chez les intellectuels, les champions des droits de l'homme, quels déchirements [la perte de l'Algérie] n'eût-elle pas dû provoquer ? Eh bien ! il n'en est rien ! C'est avec sérénité qu'ils envisagent l'épreuve des autres, se contentant d'exprimer des souhaits. Ne serait-ce que pour les écarter, que d'arguments auraient dû se présenter à leur esprit ? " (43)
Tout était prévisible. Tout, jusqu'aux milliers d'enlèvements d'Européens au lendemain de l'indépendance. En cela, la lecture du livre Juifs en pays arabes, Le grand déracinement (44) de l'historien Georges Bensoussan nous éclaire. Peu avant l'indépendance du Maroc, des dirigeants communautaires Juifs Marocains alertent : " Le vieux fond antisémite des musulmans n'est pas près de s'estomper. Nous n'attendons ce respect que d'une présence française, qu'elle qu'en soit la forme. " Un contrôleur civil prévient à son tour : " Si la France devait partir, les israélites marocains s'efforceraient par tous les moyens de quitter ce pays ".
La France part, et les Juifs comme prévu s'exilent en masse. En mai 1956, le haut-commissaire de la France au Maroc parle d'une " fuite " des Israélites " inquiets pour leurs biens et pour leur vie ", et précise : " Les mauvais traitements qui leur sont actuellement infligés (imposition de contributions, enlèvements, meurtres) ne peuvent que les pousser au départ ". Vous avez bien lu : " ENLEVEMENTS ". Et c'est cette même " technique ", qui sera méthodiquement mise en œuvre six ans plus tard en Algérie pour faire fuir les Européens (45) , mais également les Juifs d'autres pays arabes. Il n'empêche que là encore, on ose accuser l'OAS d'avoir par sa continuation du conflit, encouragé le FLN à mener, en réponse, ces enlèvements de civils. Pourtant l'OAS n'existait pas dans le Maroc de 1956…
Enfin signalons qu'à l'aube des années 1960, la grande majorité des Pieds-Noirs de Tunisie et du Maroc ont déjà quitté ces pays devenus indépendants. Pour quelle mystérieuse raison ceux d'Algérie auraient-ils échappé à ce sort, qui plus est après huit années de guerre ?
De Gaulle lui-même savait. Ainsi Alain Peyrefitte - qui défendait l'idée d'une partition de l'Algérie pour sauver ce qui pouvait être sauvé et permettre aux Pieds-Noirs de rester dans leur pays (le but : laisser l'essentiel de l'Algérie au FLN tout en en conservant un petit morceau sur une bande littorale afin d'y regrouper Pieds-Noirs et musulmans francophiles) -, Alain Peyrefitte rapporte ce dialogue qu'il eut avec lui en 1961 : " Mon général, lui dit-il, si nous remettons l'Algérie au FLN, ils ne seront pas cent mille [rapatriés], mais un million ! ". A cela de Gaulle répondra : " Je crois que vous exagérez les choses. Enfin, nous verrons bien. Mais nous n'allons pas suspendre notre destin national aux humeurs des pieds-noirs ! " (46) . " La France n'a pas le droit d'abandonner ceux qui ont cru en elle ! " lui objectera Peyrefitte, en homme d'Honneur effaré devant tant de cynisme. Au passage, imagine-t-on de Gaulle dire " nous n'allons pas suspendre notre destin national aux humeurs des Bretons ", " des Auvergnats " ou " des Provençaux ", si ceux-ci étaient menacés à court terme de finir dans les poubelles de l'Histoire ? Personnellement je ne le pense pas. L'Histoire dira (et d'éminents auteurs comme le regretté Raphaël Draï (47) ou Georges-Marc Benamou (48) l'ont déjà dit) que les accords d'Evian ne furent qu'une énorme - et criminelle - supercherie destinée à faire croire, uniquement pour la forme et pour donner bonne conscience aux négociateurs, que les Français d'Algérie pourraient continuer à vivre libre sur leur terre natale, à rebours de ce qu'indiquaient toutes les prévisions.
Mais, il est vrai que la perpétuation du problème algérien avait comme inconvénient principal de gêner le général de Gaulle dans ses ambitieux projets, lui qui, dirigeant d'une des plus grandes puissances planétaires, souhaitait à tout prix devenir le " leader "… du Tiers-Monde ! Un projet qui, certainement, justifiait l'abandon des Pieds-Noirs et du Sahara français. On ne sait s'il faut en rire ou en pleurer.
L'ethnologue Jacques Soustelle, homme de gauche et grand Résistant n'ayant jamais abandonné les Pieds-Noirs n'exagérait donc pas en les présentant comme " un peuple longtemps trompé et bercé d'illusions " se trouvant " face à face avec le génocide, le massacre et l'exil " (49) , et en décrivant leur lutte finale comme " un rassemblement spontané contre la mort " - bien que je ne pense pas, pour ma part, que les Pieds-Noirs étaient menacés d'un quelconque début de génocide, essentiellement parce que ces derniers avaient toujours une possibilité de repli en direction de la France et de l'Europe en cas de massacres généralisés (et ce repli a bien eu lieu). Le terme d'épuration ethnique, en revanche, me semble parfaitement adapté. Des historiens très sérieux n'hésitent désormais plus à l'utiliser. Ainsi Guy Pervillé, grand spécialiste de la guerre d'Algérie : " L'action du FLN, dit-il, aboutit donc à un affrontement peuple contre peuple, " race contre race ", délibérément provoqué. " A un journaliste lui demandant aussitôt : " N'est-ce pas l'épuration ethnique avant l'heure ? " Guy Pervillé répond : " On peut le soutenir. " (50)
Qu'on nous entende bien. Ces intellectuels et hommes politiques avaient parfaitement le droit de défendre l'idée d'indépendance algérienne. Sans doute même avaient-ils raison, peu importe, là n'est pas la question. Le problème, est que cette indépendance-là impliquait à coup sûr, comme on l'a vu, l'exil d'une population entière, sous la forme d'un nettoyage ethnique et religieux. On pouvait donc penser qu'ils s'y reprendraient à deux fois avant de soutenir la cause du FLN. Il n'en a rien été. Eux qui ne juraient que par l'idée - plutôt noble - du " droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ", étaient-ils au courant que deux peuples se partageaient l'Algérie, deux peuples qui avaient un droit égal " à disposer d'eux-mêmes " ? Apparemment non. Au seul prétexte que l'indépendance était selon eux " inéluctable " et allait dans le " sens de l'histoire ", elle pouvait à leurs yeux justifier toutes les injustices, y compris le bannissement d'un peuple entier d'un million de Français ! La guerre d'Algérie, c'est l'universalisme - français comme chrétien - devenu fou.
Mais " le sens de l'histoire n'est que l'excuse des lâches " (51) comme l'écrivait si bien Marcel Ducrocq. Aveugles qu'ils étaient, ils n'ont même pas su faire la différence entre leurs frères, leurs alliés, et leurs ennemis. Ce qui, sauf erreur, ne s'est vu que très peu de fois dans l'histoire de l'Humanité. Le tiers-mondisme, et plus particulièrement la guerre d'Algérie avec ses porteurs de valises et autres partisans d'un abandon total restera comme le moment où une partie importante d'une nation et d'une civilisation prit le parti de ses ennemis contre ses propres ressortissants. La guerre d'Algérie restera ce moment, où l'on vit des hommes d'Eglise, prêtres, évêques, abbés, aider matériellement et moralement des combattants du FLN (52) , organisation terroriste qui massacrait quotidiennement leurs coreligionnaires ! Ce n'est rien de moins qu'un coup de poignard dans le dos qui fut asséné aux soldats du contingent, aux Pieds- Noirs et aux musulmans Algériens favorables à la France, de la main de leurs propres frères.
Impossible de prévoir les conséquences à long terme de cet acte qui ressemble fort à un suicide, mais il est à parier que la France risque d'en payer le prix fort. Car a-t-on déjà vu des intellectuels arabes ou musulmans, ou des imams, appelant leur pays à céder aux chrétiens des territoires conquis autrefois, par pure philanthropie et désir de " justice " (et pourtant, il y en aurait !, à commencer par Istanbul/Constantinople, hier capitale des Grecs et de la chrétienté d'Orient, avant sa conquête par les Turcs au XVème siècle) ? La réponse est non.
Faisons maintenant l'effort d'imaginer un seul instant, les indigènes chrétiens Coptes d'Egypte, se lancer dans une lutte nationale en vue de construire un Etat chrétien indépendant englobant toute l'Egypte, lutte faisant peser la menace d'une persécution ou d'une expulsion de la terre égyptienne de ses habitants arabo-musulmans, héritiers de la conquête arabe du Moyen-Âge. Imagine-t-on ne serait-ce qu'une infime partie du monde musulman se solidariser avec ces indigènes chrétiens Egyptiens dans leur lutte contre le joug arabe et musulman ? Non. Ils seraient voués à l'écrasement, et l'ensemble du monde musulman se serait coalisé contre eux dans un djihad impitoyable.
" Trop bon, trop con " dit un proverbe… Il s'applique bien à ces pseudo-humanistes et à ces anticolonialistes primaires, adversaires acharnés et haineux de leurs compatriotes d'Algérie, qui pensaient fraternité des peuples au-delà des frontières quand l'Histoire leur répond qu'elle est tragique et que tout est question de rapports de force, plus encore dans les relations internationales et dans les rapports entre civilisations. Et, avec le recul du temps, il semble bien que tous ces gens se soient trompés d'ennemis, et se soient même tiré une belle balle dans le pied. Car si la guerre d'Algérie était aussi la lutte bien légitime d'une partie d'un peuple appauvrie et attachée à son indépendance, ce fut surtout la lutte du monde arabe contre le monde occidental, et plus encore celle de l'Islam contre l'Europe chrétienne et laïque. Le FLN ne déclencha-t-il pas ses hostilités, le 1er novembre 1954, le jour de la fête chrétienne de la Toussaint (comme le récent massacre du Bataclan, à Paris, eut lieu un vendredi 13, superstition tout aussi chrétienne), et parmi les premiers morts de cette guerre d'Indépendance ne trouve-t-on pas, plutôt qu'un légendaire " gros colon raciste ayant fait suer le burnous ", un simple instituteur, républicain, laïque et de gauche, le jeune Guy Monnerot, venu enseigner en Algérie où il sera lâchement assassiné ?
Pour comprendre la tragédie algérienne, il faudra donc toujours en revenir à ces mots d'un militant socialiste Pied-Noir datant des années 1920 :
" Sans remonter aux causes, discutables, certes, de l'établissement dans ce pays d'une population européenne déjà importante, en réservant les moyens, critiquables également par lesquels elle s'y maintient, elle y a, à nos yeux, le droit de cité autant que les Indigènes. Le nationalisme arabe met ce droit en question et contre lui nous sommes en état de légitime défense. " (53)
Voilà la parole sensée d'un homme qui, tout en reconnaissant certaines inégalités, reste bien déterminé à ne pas se laisser écraser par ses ennemis, et à ne pas sacrifier sa mère au nom d'une prétendue " justice ".
Mais, même d'un point de vue purement géopolitique et stratégique, il faudra un jour s'interroger sur les conséquences à long terme d'une décolonisation brutale et mal gérée. Voici par exemple ce que répond l'historien Espagnol Serafín Fanjul, à la question " Quels sont selon vous les facteurs expliquant l'essor de l'Islam au début du XXIème siècle ? " :
" La grande explosion démographique, le contrôle du pétrole et des énormes masses de capitaux sur les marchés financiers par quelques pays islamiques (qui ne sont pas précisément démocratiques), l'autodestruction de l'impérialisme européen, qui a mis fin à sa propre existence même s'il a subi des pressions des Etats-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Ajoutons l'occupation de grands espaces laissés libres par le nationalisme arabe et l'islamisme qui, logiquement, a tendance à s'étendre. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une simple description. " (54)
En effet qui sait aujourd'hui qu'une grande partie des élites Africaines des anciennes colonies françaises ne souhaitaient pas l'indépendance de leurs pays, mais bien une association fédérale avec la France dans l'égalité, et la fin du colonialisme dans une Union française renouvelée ? Mais de Gaulle, dans sa vision étriquée du monde ne voyait la France qu'à travers son village de Colombey-les-Deux-Eglises. Que des gens nés à Bamako, Libreville ou Abidjan se disent Français, voilà qui était inimaginable pour lui. Cet homme n'a fait en réalité que perpétuer le colonialisme le plus sournois à travers la " Françafrique ", et les populations appauvries, spoliées par leurs dirigeants, de ces pays en voie d'explosion démographique ne cessent aujourd'hui de vouloir rejoindre l'ancienne Métropole française à leurs risques et périls, jusqu'à faire de la Méditerranée un cimetière. Le maintien de la France républicaine dans ces territoires, avec tous les avantages liés à celui-ci, n'eût-il pas permis la régulation de leur démographie, et encouragé leurs habitants à rester vivre chez eux, en profitant de la mise en valeur des nombreuses richesses que renferment leur sol et leur sous-sol, richesses qui bien sûr auraient dû être redistribuées le plus équitablement possible ? La question vaut au moins d'être posée, je ne prétends pas avoir une réponse. Mais, je m'arrête de suite, car, j'entends, déjà, certains lecteurs m'accuser d'être un " nostalgique de l'Empire colonial ", et peut-être même un " esclavagiste ", qui sait… Je me rends, ne tirez pas !...
Après cette digression, revenons-en à nos moutons, à savoir les Pieds-Noirs, et leur abandon par une partie importante du monde intellectuel français.
Abordons maintenant une question essentielle. On peut en effet se demander pourquoi, sachant le destin des Pieds-Noirs plus que compromis dans une Algérie FLN (c'est le moins qu'on puisse dire), sachant aussi que ces mêmes Pieds-Noirs ne souhaitaient en aucun cas échanger leur citoyenneté française - à laquelle ils étaient attachés comme à la prunelle de leurs yeux -, contre une hypothétique nationalité algérienne, pourquoi la plupart de ces hommes politiques, intellectuels et pacifistes de tout bord n'ont-ils pas ne serait-ce qu'envisagé l'idée d'une partition du territoire comme il y en eut tant, en Irlande, à Chypre et ailleurs, ou alors d'autres solutions, qui auraient permis à toutes les communautés d'Algérie de s'épanouir sur leur terre natale ? Autrement dit, si l'Algérie ne pouvait/devait pas rester française, si une grande partie des musulmans d'Algérie ne souhaitaient pas devenir Français mais préféraient vivre dans un Etat musulman indépendant, et si inversement l'immense majorité des Pieds-Noirs ne souhaitaient pas devenir citoyens asservis de ce nouvel Etat musulman, l'Honneur - et accessoirement l'intérêt de la France - commandait au moins de se battre pour conserver une petite parcelle de l'Algérie dans laquelle Pieds-Noirs et musulmans francophiles auraient pu se regrouper et subsister, quitte à envisager pour plus tard une éventuelle réunification (55) . Ce d'autant plus que la France avait gagné militairement contre le FLN. Mais non, ils ont choisi la solution de facilité, le défaitisme, le déshonneur, le lâche abandon de leurs frères, et l'Histoire les jugera.
Il serait bon de se demander jusqu'à quel point ce défaitisme ambiant et cette campagne de désolidarisation générale menée tambour battant contre l'armée et les Français d'Algérie influença un général de Gaulle vieillissant, qui écrivait dans une lettre au Maréchal Juin peu avant son retour au pouvoir en 1958 : " Tout le drame est que le peuple français a été créé et, ensuite, façonné pour les grandes actions, mais qu'il ne désire plus celles-ci parce qu'il croit n'en avoir plus les moyens. Alors ça ne l'intéresse plus ! Mais tout passe, même la bassesse. " (56)
Trois ans plus tard, expliquant à Alain Peyrefitte son refus de recourir à un partage de l'Algérie comme son désir d'en finir le plus vite possible avec ce pays, quitte à tout brader, il aura ces mots troublants, prononcés d'un ton résigné : " Le temps travaille contre nous ! L'Algérie, ça nous gangrène ! Ça gangrène notre jeunesse ! Mieux vaut s'en aller la tête haute que de rester au prix du sang. (Il doit penser : " au prix de la torture ", précise Peyrefitte ; bien qu'il l'ait énergiquement proscrite, il ne se fait pas d'illusions pour l'avenir.) " (57) . Une question : lorsque de Gaulle affirme que la guerre d'Algérie " gangrène " la jeunesse, veut-il parler de l'UNEF (syndicat étudiant, à l'époque très anticolonialiste) et autres agitateurs d'extrême-gauche, ou encore du Manifeste des 121 sur le " droit à l'insoumission " des soldats ? C'est très probable.
La responsabilité des intellectuels dans l'abandon des Français d'Algérie est donc, n'en doutons pas, très lourde. Car à lire ces mots du général de Gaulle il semble bien que cet homme, qui a autrefois refusé, seul, de céder face à l'Allemagne nazie, ait fini, sur l'Algérie, par céder à la pression d'un Servan-Schreiber, d'un Jean-Paul Sartre, et d'un syndicat étudiant.
Ce parti de l'abandon, Pierre Mendès France, figure centrale de la gauche modérée dans les années 50 l'incarne mieux que quiconque, ce dans toute sa complexité. Voilà un homme qui dans les premiers temps de la guerre d'Algérie était partisan d'une répression sans nuances du FLN (quoique accompagnée de réformes politiques et sociales), qui multipliait les déclarations assurant aux Français d'Algérie qu'ils ne seront jamais abandonnés, et, même, que l'Algérie était une terre française de manière irrévocable (" L'Algérie est la chair de la France ", disait-il), prédisant les conséquences les plus graves pour l'avenir de la Nation au cas où ce pays accèderait à l'indépendance. Ce jusqu'aux années 1957-1958… A partir de là, Mendès France change radicalement de discours, et invite très tranquillement les Pieds-Noirs à vivre dans une future Algérie dirigée par le FLN, Pieds-Noirs qu'il a, au passage, compromis en soutenant une politique de répression tous azimuts contre ce même FLN… En 1960 il déclare, se voulant rassurant, à propos d'un possible cessez-le-feu : " C'est la présence de l'armée française qui garantit la vie quotidienne des Européens. Cette situation devra se prolonger aussi longtemps qu'elle apparaîtra nécessaire. " Mais, précise la sociologue Jeannine Verdès-Leroux, " c'est un vœu […] pour lequel il ne s'est pas battu, au moment des accords d'Evian en particulier " (58) , sociologue qui par ailleurs évoque chez lui " une méconnaissance complète de l'idéologie du F.L.N. et de ses ambitions. " Et plus on se rapproche de la paix, nous dit encore Jeannine Verdès-Leroux, plus " en ce qui concerne le sort des Européens, [Mendès France] en était venu à un simple vœu : j'espère, disait-il, que la plupart " trouveront la possibilité de continuer à travailler, à vivre, à prospérer et à apporter leur contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle ". " (59) .
J'espère… Tout cela est bien léger. Pressé d'en finir, il balaiera d'un revers de la main, comme on pouvait s'y attendre, la proposition de Peyrefitte d'une partition de l'Algérie, pourtant un des derniers espoirs crédibles pour les Pieds-Noirs de rester vivre dans leur pays. Mais Mendès France ne connaissait pas ou très peu de Français d'Algérie. Pour lui aussi, ils étaient avant tout des pions, sortes d'ambassadeurs de la civilisation française dont le sort dépend essentiellement de la stratégie géopolitique définie par la mère-Patrie, et non une population Française en tant que telle. Il apporte finalement son appui aux accords d'Evian, en 1962, et restera silencieux devant l'exode massif qui s'en est suivi. L'attitude de Mendès France à l'égard des Pieds-Noirs a un nom : l'abandon pur et simple de ceux envers lesquels il s'était engagé solennellement (" il n'est pas question de sacrifier les Français d'origine européenne […]. Bien au contraire, il s'agit de les sauver " (60) , lançait-il en 1956). De Gaulle n'est pas seul à avoir trahi.
Pourtant, et aussi surprenant que cela puisse paraître, même les plus farouches partisans de l'Algérie française étaient prêts à faire des concessions et à admettre des solutions alternatives, à condition qu'elles garantissent certaines libertés fondamentales. C'est la propagande gaulliste et gauchiste qui s'est plu à présenter tous ces hommes comme des jusqu'au-boutistes aveugles et fanatiques d'une Algérie française éternelle. L'OAS elle-même était divisée à l'idée d'un éventuel partage du territoire, et le général Jouhaud, l'un de ses dirigeants, admettait volontiers l'idée d'une Algérie largement autonome, ou, alors, si celle-ci ne pouvait se faire, la fameuse partition. Il écrit le 20 janvier 1961 dans une note :
" Entre la francisation et l'indépendance, n'y a-t-il pas de solution ? Les Français d'Algérie manifestent la crainte de voir la minorité européenne écrasée par la majorité musulmane. A cet égard, deux points me paraissent devoir être soulignés. Il faut d'abord poser cette question les yeux grands ouverts : Si nous croyons les Musulmans irrémédiablement hostiles à notre présence, ne nous faisons aucune illusion ; il nous faut partir ou nous regrouper dans une portion de territoire. Nous partagerons l'Algérie. " (61)
Quant au colonel Bastien-Thiry, organisateur de l'attentat du Petit-Clamart dont le but était de tuer le général de Gaulle, il aura l'occasion de s'expliquer sur ses propres motivations lors de son procès (qui aboutira à sa condamnation à mort), dans sa Déclaration du 2 février 1963 :
" Nous étions sincèrement partisans de l'Algérie française, parce que nous estimions cette solution réaliste et bénéfique pour tous ; mais nous concevions qu'il y eut d'autres solutions pour l'avenir algérien, solutions pouvant être défendues de façon honnête et sincère ; l'impératif absolu, quelle que fût la solution finalement retenue, était, en tout état de cause, et sous peine de trahison et d'infamie pour le pouvoir politique mettant en œuvre cette solution, de faire respecter la vie, la liberté et les biens des millions de Français de souche et de Français musulmans vivant sur cette terre. " (62)
Et puisque notre article s'intéresse plus particulièrement à l'abandon des Pieds-Noirs, voici ce qu'en dit Bastien-Thiry, quelques mois après l'Exode fatal :
" Il existait en Algérie une collectivité nationale française nombreuse, dynamique et florissante. Cette collectivité était fortement enracinée sur ses terres et dans ses villes ; ces terres et ces villes avaient tous les caractères de terres et de villes françaises ; cette population y avait ses coutumes, ses traditions, ses cimetières et ses morts. Les représentants de cette collectivité avaient depuis longtemps dénoncé et prévu les funestes conséquences de cette politique faite sans eux et contre eux. Cette collectivité fut littéralement dispersée et détruite à la suite des accords d'Evian ".
On le voit, Bastien-Thiry insiste sur le fait que les Français d'Algérie et leurs représentants n'ont pas même été consultés sur des questions les concernant au premier chef, en particulier sur leur nationalité, ce qui n'a malheureusement pas choqué grand-monde à l'époque. Car il n'y avait pas plus de légitimité à faire perdre aux Pieds-Noirs - sans leur demander leur avis - leur nationalité française (comme le prévoyaient les accords d'Evian), que de forcer les musulmans Algériens qui ne le voulaient pas à devenir Français. Et l'on sourit - amèrement - lorsqu'on sait que le nombre de Français ayant la double nationalité algérienne se compte aujourd'hui sans doute en millions, alors même que le FLN n'a jamais accepté qu'un petit million de Français d'Algérie puisse bénéficier de ce droit… Enfin l'hystérie d'une partie de la gauche s'opposant, lors d'un débat récent, à la proposition du gouvernement Valls de déchoir de la nationalité française les terroristes islamistes binationaux, contraste avec le silence de cette même gauche lorsqu'on a, avec les accords d'Evian, intimé l'ordre à un million de Français parfaitement innocents, eux, de choisir entre leur patrie et leur nation, puisque, comme chacun sait, une fois l'Algérie indépendante les Pieds-Noirs qui souhaitaient y rester perdaient automatiquement leur nationalité française dans les trois ans. Avec un peu de mauvaise foi, on pourrait dire que les terroristes islamistes ont donc mieux été défendus que les Français d'Algérie.
II. Plus de 50 ans après, les Pieds-Noirs encore
et toujours sur le banc des accusés
On nous dira : " tout ça, c'est le passé, il faut savoir passer à autre chose et regarder vers l'avenir ". Certes, mais, justement, que nous dit toute cette histoire passée de notre époque ? Car comble de l'ignominie, on en vient aujourd'hui à rejeter sur les Pieds-Noirs une partie de la responsabilité du " malaise des banlieues " actuel et de la montée du Front National. Ceux-ci auraient amené en Métropole, avec leur valise et leur accent, leur mentalité légendaire de " petit-Blanc " raciste attaché à ses privilèges, qu'ils auraient inoculée à l'ensemble de la société française par contamination. Benjamin Stora a même pour expliquer cela, forgé l'expression de " sudisme à la française " (en référence aux esclavagistes Nord-Américains !), sudisme importé, bien sûr, par les méchants Pieds-Noirs. La grande peur de Louis Joxe se serait-elle finalement réalisée, celle de voir les Pieds-Noirs " rapatriés " en Métropole " inoculer le fascisme " (sic) en France ? Mais M. Stora, ce ne sont pas des " sudistes " mais bien des " djihadistes à la française " qui tuent nos enfants dans nos rues !
Cette accusation est d'autant plus injuste lorsqu'on sait que les Pieds-Noirs votaient en Algérie en général au centre, centre-gauche (une gauche essentiellement patriote et républicaine, celle, aujourd'hui, grosso modo, d'un Manuel Valls, bien que socialistes et communistes faisaient eux aussi des scores respectables) et centre-droit (63) , et qu'Alger était traditionnellement plutôt une ville de gauche - bien qu'une extrême-droite radicale et antisémite ait effectivement prospéré dans les années 30, en Oranie surtout. L'historien Jacques Binoche explique même que la quasi-totalité des parlementaires élus par les Français d'Algérie entre 1871 et 1914, siégeaient à gauche, ce dernier allant jusqu'à qualifier l'Algérie de ce temps de " bastion du régime " (64) républicain, tandis qu'en Juin, 36 ouvriers Européens et Musulmans, hommes et femmes, défileront ensemble pour le Front populaire, les congés payés et la semaine de quarante heures. Ce qui ne veut pas dire que voter à gauche ou au centre-droit est un bien en soi, mais on est tout de même loin du fascisme ! Rien de bien original donc, dans ce comportement politique, hormis des tensions raciales plus fortes qu'ailleurs du fait du contexte multicommunautaire, et d'une bêtise humaine que l'on nomme antisémitisme. On votait en Algérie les mêmes partis qu'en France métropolitaine. C'est la montée du nationalisme arabe, puis la guerre d'Algérie et l'Exode forcé qui ont droitisé les Pieds-Noirs (65) , comme le terrorisme islamiste contribue aujourd'hui à droitiser les Français.
La vérité, c'est qu'on pensait que les Pieds-Noirs intégreraient définitivement l'idée que le " sens de l'histoire " commandait qu'ils disparaissent sans faire de vagues, l'idée qu'ils avaient été un peuple de trop sur cette Terre. On les pensait morts et enterrés. Mais, ils montrent encore quelques signes de vie à intervalles réguliers. Alors on regrette que la bête bouge encore et pour l'achever, on l'accuse de " crime contre l'Humanité ".
L'humiliation et la calomnie, parlons-en. Cela faisait aussi partie du processus d'abandon des Pieds-Noirs, présentés à l'opinion publique comme de riches colons racistes et profiteurs, égoïstes et vulgaires, et, surtout, artisans de leur propre malheur. On est allé jusqu'à les accuser d'avoir été vichystes entre 1940 et 1942, comme s'ils avaient été les seuls ! On leur a même quasiment reproché d'être responsables de la guerre d'Algérie, pour avoir - ce qui reste encore à démontrer - fait retarder de dix ans (de 1936 au Statut de 1947) une loi accordant le droit de vote aux Algériens musulmans pour les élections législatives. Quel crime abominable ! Compte tenu de l'amour immodéré que vouait le FLN à la démocratie (il nous l'a bien prouvé, depuis 50 ans…), on se doute bien que c'est cette terrible injustice qui le poussa à déclencher la lutte armée. Certes on peut penser que la France n'a pas su anticiper, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le désir global, chez les Arabes d'Algérie, d'une large autonomie et d'un plus grand respect de leur personnalité. Certes, comme l'écrit le Pied-Noir Robert Lopez, " les Arabes avaient, semble-t-il, plus besoin de reconnaissance qu'ils n'avaient de souci d'exclure les pieds-noirs pour s'approprier leurs biens " (66) . Mais il est quand même troublant, avec le recul, de constater que les mêmes qui hier expliquaient le déclenchement et la violence de la guerre d'Algérie par l'échec d'une réforme électorale et les discriminations coloniales, les mêmes croient voir aujourd'hui dans le terrorisme islamiste une conséquence de l'exclusion sociale, de la " ghettoïsation " des enfants d'immigrés et de leur " abandon " par la République…
J'ai moi-même lu il y a deux ans l'interview (67) d'un artiste Français d'origine algérienne (et fils de combattant FLN), où ce dernier insinuait que la vague d'attentats meurtriers qu'a récemment connu le pays était aussi, grosso modo, une conséquence du refus de la France, depuis vingt ans, d'accorder le droit de vote aux étrangers…
On le voit, il en faut peu pour irriter certaines susceptibilités. Il en faut peu, pour prendre le risque de tomber sous le couteau des égorgeurs. " Respectez-moi ou je vous massacre ! ", telle semble être la philosophie politique de certains. Quitte à décimer la rédaction d'un journal satirique pour un dessin jugé " blasphématoire ". Mais jusqu'où va-t-on reculer, jusqu'à quand va-t-on se coucher à force de trouver des excuses à nos ennemis ? " Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'on tombe le pantalon ? " 68 s'énervait il y a soixante ans Albert Camus, stigmatisant les pacifistes qui dans leur naïveté s'imaginaient qu'en faisant toujours plus de concessions au FLN celui-ci finirait pas être moins intransigeant - ce qui évidemment n'arrivera pas. Eh bien le pantalon, force est de constater que beaucoup aujourd'hui continuent à le baisser, prêts à toutes les compromissions dans le but d'obtenir une paix que l'islamisme, à la suite du FLN, ne leur accordera pourtant jamais.
C'est que l'on a parfois du mal à s'y retrouver : Hier la gauche dénonçait en Algérie - non sans raisons - le fait que trop peu de jeunes Arabes étaient scolarisés, …mais le FLN assassinait les instituteurs ! Aujourd'hui, en France cette fois, la gauche se plaint du manque de moyens investis dans les écoles des " banlieues difficiles ", …mais ces écoles sont régulièrement incendiées et saccagées par des groupes de jeunes habitant ces banlieues ! De même que l'on a longtemps reproché aux Français d'Algérie de vivre pour la plupart dans des quartiers séparés de ceux des musulmans, les bonnes âmes croyant ainsi déceler leur racisme atavique, mais les mêmes problèmes de " coexistence " et de " mixité " se posent aujourd'hui en France avec autant d'acuité… Seulement cette fois, il n'y a plus de méchants colons sur qui rejeter la faute. Il va falloir trouver d'autres coupables.
Retour à la guerre d'Algérie. L'adage est connu : " qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage ". Il fallait culpabiliser la victime. Et l'historien Pierre Nora qui, tel un gros bras de cour d'école malmenant par lâcheté les plus faibles de ses camarades, de profiter du fait que les Pieds-Noirs soient en infériorité numérique à la fois vis-à-vis des musulmans d'Algérie et des Français de Métropole pour mieux les humilier. Cet homme crut bon en effet de traîner dans la boue une population déjà à l'agonie comme on tire sur une ambulance, tant l'aigreur et le mépris moqueur transparaît à chaque page de son pamphlet Les Français d'Algérie, publié en 1961, pamphlet dans lequel, animé par le seul but de convaincre les Français de Métropole de livrer leurs compatriotes d'Algérie aux fellaghas, il va jusqu'à mettre en cause la sincérité de leur patriotisme. Et voici par exemple comme il tente de ridiculiser les Pieds-Noirs d'Oran en moquant leur accent :
" Dans la rue, au premier incident, l'argument arrive - " Je suis français " - prononcé d'ailleurs avec l'accent : froncé. " Je suis froncé, moi, Monsieur, je suis aussi froncé que vous ! " ".
Après Tintin au Congo, " Nora à Oran " ! Il n'hésite pas non plus à écrire que " tous les Français d'Algérie sont […] méprisants ". Tous sans exception ! Les bobos bien-pensants de notre époque assimileraient une généralisation de ce type à de l'" essentialisme " et du " racisme ". Mais, cet homme est considéré dans la France d'aujourd'hui comme un vieux sage, un " intellectuel de centre-gauche " on ne peut plus respectable…
Il faut dire aussi que ces calomniateurs étaient confortés dans leurs idées par une toute petite minorité de Français d'Algérie pro-FLN souvent d'extrême gauche, qui n'ont malheureusement rien arrangé. Et trop nombreux furent les intellectuels d'extraction Pied-Noir qui, ce qui est encore plus grave, n'ont pas pris la défense des leurs voire les ont carrément abandonnés. La palme, revient à l'écrivain Jules Roy, ancien sympathisant d'extrême droite né dans la Mitidja, qui, après avoir pris le parti des fellaghas, est allé jusqu'à trouver des excuses aux vandales et aux fanatiques qui saccageaient les cimetières chrétiens au lendemain de l'indépendance (69) , sur le mode " mais qu'aurais-je fait, moi, si j'avais été à leur place ? ".
Et le journaliste Patrick Cohen, qui récemment osait demander sur France Inter si les Pieds-Noirs avaient pensé à faire leur " examen de conscience " (70) . Et puis quoi encore ? S'il faut être puni, " la valise ou le cercueil " ne suffisait pas ? Il faudrait en plus de ça se mettre à genoux et demander pardon ? Quand bien même ils le voudraient d'ailleurs, les Pieds-Noirs sont bien trop occupés à se défendre des multiples calomnies qui circulent sur leur compte depuis des décennies pour avoir le temps de commencer un quelconque " examen de conscience ".
L'examen de conscience, en revanche, nous l'attendons encore de tous ces gens, de gauche comme de droite, journalistes, intellectuels, artistes, hommes d'Eglise, syndicalistes, militants, hommes politiques - et tous leurs héritiers -, qui, consciemment, ont joué avec le sort de populations entières et contribué par leur lâcheté à donner l'entièreté de l'Algérie aux terroristes du FLN sans mesurer une seule seconde les conséquences dramatiques que cela impliquait. Imaginez-vous ! Ces grands défenseurs autoproclamés des " Droits de l'Homme ", qui auraient couvert l'un des plus grands exodes de tous les temps et n'auraient pas bougé le petit doigt face au massacre de dizaines de milliers de Harkis ? Impensable ! D'où l'obsession de nombre d'entre eux à vouloir mettre tous ces drames sur le compte de l'OAS, bouc-émissaire idéal, pour garder la conscience tranquille et éviter de se remettre en question en avouant enfin s'être trompé sur toute la ligne. D'où, pour mieux nier leur responsabilité dans l'épuration ethnique, leur volonté de mettre sans cesse en avant les " bons " Pieds-Noirs qui seraient " restés " vivre en Algérie après 1962, quand bien même ils n'y sont plus que quelques vieillards (71) . D'où, depuis peu, leur volonté obsessionnelle, en bons pompiers pyromanes qu'ils sont, de construire une histoire dite " enfin apaisée " de la guerre d'Algérie, comme si une histoire apaisée était aujourd'hui envisageable lorsqu'on sait qu'un homme comme Sartre appela à faire " disparaître " par tous les moyens " l'espèce minoritaire " Européenne d'Algérie, sans encourir pour cela la moindre petite poursuite judiciaire, et lorsqu'aujourd'hui, un rappeur d'origine algérienne comme Médine, bien que né en France plus de vingt ans après l'indépendance de l'Algérie prévient dans l'une de ses chansons citée plus haut : "
On n'oublie pas ses ennemis " (tout un programme !). D'où, enfin, cette façon de mettre en cause en permanence la " violence " et le racisme du " système colonial " pour expliquer l'Exode final, comme si cette violence coloniale - qui bien sûr existait, il ne s'agit pas de la nier - pouvait justifier le moins du monde le martyre qu'a vécu le peuple Pied-Noir. A ce sujet, voici ce que, récemment (en 2011), osait encore écrire Pierre Nora dans son autobiographie, à propos des Français d'Algérie et de leur drame. Tenez-vous bien :
" Derrière tant d'irraison, la logique de leur histoire tombe comme un fil à plomb. Cette société, dont la violence était la loi, meurt de la violence […]. En saine logique, ils devraient être obligés de partir jusqu'au dernier. Le rapatriement généralisé avec un pont aérien fait partie de l'épure. " (72)
Mais depuis quand, M. Nora, une épuration ethnique obéit à " la logique ", " saine " qui plus est ? Car, si les Européens d'Algérie méritaient le bannissement, voire la mort, pour avoir " profité " pendant 132 ans d'un système colonial inégalitaire, que méritent alors les Blancs d'Afrique du Sud pour avoir instauré l'apartheid, ou les Arabes pour avoir, au Moyen Âge, éradiqué le christianisme d'Afrique du Nord, et pour continuer, aujourd'hui encore, à traiter en sous-citoyens ce qu'il reste de " chrétiens d'Orient ", mais également les protestants de l'Irlande, pour avoir opprimé, pendant des siècles, les catholiques, ou les Brésiliens descendants des colons Portugais, pour avoir prospéré sur l'esclavage des Noirs, sans parler des Caldoches, pour s'être installé en Nouvelle-Calédonie, et, enfin, les descendants de colons Etats-Uniens, pour l'anéantissement des Indiens d'Amérique du Nord ? Doivent-ils, à leur tour, faire leur valise et prendre le bateau vers une destination inconnue ? Non, seuls les Européens d'Algérie devaient être crucifiés sur l'autel de l'anticolonialisme, et racheter par leur martyre tous les péchés de l'Humanité.
Quand reconnaîtra-t-on que ce dont ont été victimes les Pieds-Noirs, ce n'est ni d'un " malentendu " de l'Histoire qui aurait tragiquement séparé deux peuples faits pour vivre ensemble, ni d'une " juste punition " pour avoir " colonisé " un pays, mais bien d'une épuration ethnique, culturelle et religieuse, semblable à celle qu'ont connu au début du XXème siècle plus d'un million de chrétiens Grecs d'Asie Mineure, qui, loin d'être des colons étaient eux de parfaits autochtones, ce qui n'a pas empêché la Turquie musulmane de les chasser jusqu'au dernier de leur terre ancestrale.
Prenons maintenant l'exemple de l'Irlande colonisée, pendant des siècles, par sa voisine l'Angleterre. Longtemps, les colons protestants Britanniques possédaient 90 % des terres irlandaises, ce qui s'apparente à une véritable spoliation (et le mot est faible), sans parler des humiliations de toutes sortes qu'ont eu à subir les catholiques autochtones. En Algérie, ce fut l'inverse. 90 % des terres appartenaient aux " indigènes " musulmans, le reste (certes les meilleures terres) aux colons. Se pose donc la question de savoir pourquoi les Pieds-Noirs " méritaient ", selon certains, d'être chassés de leur pays, avec l'idée toujours sous-jacente qu'ils l'ont " bien cherché ", alors que les protestants de l'Irlande, descendants de colons ayant littéralement spolié les indigènes catholiques Irlandais ont, eux, la chance de toujours vivre sur la terre irlandaise ? Autrement dit, si les Pieds-Noirs avaient été musulmans, auraient-ils été chassés d'Algérie ?
Il est en outre toujours intéressant de constater qu'après à peine cent ans de présence française en Algérie, la principale revendication des élites arabo-musulmanes du pays était d'obtenir - tout en conservant la soumission aux lois coraniques - le droit de vote à toutes les élections (73) (signe parmi d'autres que, si c'était là leur préoccupation essentielle, la situation de leur communauté n'était pas désespérée et qu'elle n'était pas victime d'un esclavage insoutenable), une demande d'ailleurs assez vite satisfaite par la France républicaine, alors que, dans les pays arabes, après maintenant plus de 1.300 ans de domination musulmane, les hommes chrétiens (" indigènes ", eux aussi) de ces pays, en tout cas le peu qu'il en reste, n'ont toujours pas pu obtenir ne serait-ce que le droit d'épouser une femme musulmane, sans parler des innombrables autres discriminations qu'ils subissent. Et l'on vient nous expliquer, très sérieusement, que ce sont les Pieds-Noirs les horribles " racistes " imbus d'un sentiment de supériorité…
Mais attention… Loin de nous l'idée de nier ni même de relativiser, à travers cet exemple, la violence réelle et profonde que constitue un processus de conquête coloniale, et l'Algérie n'échappe pas à la règle. Il s'agit juste de remettre les pendules à l'heure. Si péché il y a, que chacun reconnaisse les siens. Et, c'est un fait, il valait mille fois mieux être arabe et musulman en Algérie française, qu'être chrétien minoritaire en terre d'Islam. Ceux qui affirment l'inverse sont des menteurs. On peut même oser la comparaison avec la France actuelle puisque le récent assassinat du père Hamel dans son église de Normandie par des islamistes radicaux (juillet 2016), vient nous rappeler au passage que pas un seul Européen d'Algérie, fût-il extrémiste, ne s'est jamais levé un matin avec l'idée d'aller égorger un " prêtre " musulman dans une mosquée. Les pendules à l'heure…
L'Histoire retiendra probablement que de tous les peuples mis en situation coloniale, les Européens d'Algérie, certes loin d'être parfaits, furent parmi les plus progressistes et les plus fraternels. Tous les Algériens de bonne foi le diront. Mais peu importe, après tout. Les Pieds-Noirs ne doivent pas s'enfermer dans une posture de " mendiants de l'amour ", car ils n'ont pas de comptes à rendre. Quand bien même ils auraient été dans les faits les salauds qu'on a bien voulu dire, rien ne justifie ce que ce peuple a dû subir, en particulier le terrorisme. Que la France ait construit des routes et des écoles (vision " positive " de la colonisation), qu'elle ait opprimé un peuple (vision " anticolonialiste "), ou qu'elle ait fait les deux à la fois, ça, c'est encore un autre problème. Car les Pieds-Noirs, pas plus que les Esquimaux, les Basques ou les Touaregs, n'ont à se justifier d'exister. Leur histoire n'a pas à être passée à la moulinette par des historiens qui tels des justiciers, chercheraient à conclure si oui ou non ce peuple méritait la peine de mort. Il ne la méritait pas parce qu'aucun peuple ne la mérite. Tout simplement.
Pour couronner le tout, certains ont voulu faire de la nostalgie pied-noir une mauvaise chose, un vice à éviter. Privés de patrie, il fallait aussi se priver de mémoire. Encore aujourd'hui, un Pied-Noir qui, bien que très bien intégré en Métropole comme l'immense majorité de ses courageux compatriotes, évoque son passé en Algérie comme n'importe quel Français peut le faire de sa province, se voit aussitôt qualifié de " nostalgique de l'Algérie française ", ou, mieux, " nostalgérique ". A supposer qu'il ait été heureux en Algérie, et qu'il se permette de le dire à haute voix, le voilà qui regrette " le bon vieux temps des colonies " ! Oui, le bon vieux temps ! Le bon vieux temps où il vivait dans sa petite patrie, dans le village de son enfance, le bon vieux temps où il se sentait chez lui, où il pouvait fleurir les tombes des siens, où il entendait, au quotidien, l'accent de ses parents et de ses grands-parents, le bon vieux temps où sa famille n'était pas dispersée aux quatre coins de l'Hexagone, etc., etc., etc. Et ceux-là même qui tentent de remettre les Pieds-Noirs à leur place en leur disant qu'il faut oublier et passer à autre chose sont parfois ceux-là même qui sont attachés à leur propre terroir d'origine comme une moule s'accroche à son rocher…
" Nostalgiques de l'Algérie française ", " nostalgiques de l'Algérie française "… Mais, messieurs les censeurs, de quoi le Pied-Noir devrait-il être nostalgique ? Dîtes-nous, nous sommes preneurs. De l'Algérie d'avant 1830, celle des Turcs ? Trop jeune, il ne l'a pas connue (et c'est mieux comme ça puisque sa place naturelle y aurait été celle d'" esclave chrétien "). De l'Algérie FLN ? A moins d'être masochiste, un Pied-Noir ne peut pas être nostalgique de l'Algérie du FLN. De plus, ce serait là encore être nostalgique de ce qu'il n'a pas connu puisque les non-musulmans, même ceux favorables au FLN, n'y étaient pas invités. Alors, dîtes-nous, de quelle Algérie faudrait-il être nostalgique ?
Mais le plus grave dans toute cette histoire est peut-être que, encore aujourd'hui, plus de cinquante ans après, alors même que l'on sait les conséquences désastreuses d'une indépendance bâclée et sanguinaire, ceux qui ont soutenu hier, de près ou de loin, la lutte du FLN (et se sont faits par conséquent les complices de ce qui ressemble fort à une épuration ethnique), ceux-là font encore figure, dans l'inconscient collectif français et les médias, de glorieux visionnaires qui se seraient trouvés dans le " bon camp ", alors que les personnalités plutôt " Algérie française ", sentiment certes discutable et non exempt chez certains de rigidité intellectuelle, mais qui revendiquait au moins comme noblesse une certaine idée de l'honneur et de la solidarité envers des compatriotes menacés, ceux-là sont mis au ban de la mémoire nationale, rangés dans le même sac que les " collabos ", et autres " fachos " ou esclavagistes.
Voilà l'état de confusion mentale dans lequel baigne la France d'aujourd'hui. Le bannissement d'un peuple d'un million de Français hors de son sol natal, là où, écrit Jean-François Giordano, " tout un univers, d'un coup d'un seul, fut brisé, éparpillé, rasé à tout jamais de l'histoire des Hommes ", où " le Pied-Noir devint alors une espèce en voie instantanée de disparition " (74) , ce bannissement devrait en toute logique être reconnu, au moins symboliquement, comme un des plus grands drames de l'Histoire de France (sans parler de revendications " communautaires " (75) : les Pieds-Noirs ne se sont jamais victimisés, ne sont pas, n'ont jamais été des mendiants, et leur but n'est en aucun cas d'affaiblir la Nation). Eh bien non. Ce ne serait qu'un banal accident, un petit évènement sans conséquences. " Fichez-nous la paix avec vos histoires de rapatriés ! C'est du passé, tout ça ! " Du passé ? Pas si sûr…
III. Quelles conséquences pour l'avenir ?
Pour expliquer leur attitude face à l'exode Pied-Noir, les responsables de ce désastre auront le choix entre l'hypocrite " on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer ", le non moins hypocrite " il n'y avait pas d'autres solutions ", et le célèbre " c'est-la-faute-à-l'OAS ". Je pense avoir montré dans cette petite étude que ces justifications ne furent souvent que des prétextes pour mieux masquer un manque de solidarité envers leurs compatriotes d'Algérie, manque de solidarité dont les causes étaient plus profondes, parfois même plus mesquines, qu'ils ne veulent bien l'admettre.
Le problème, est qu'en légitimant l'élimination d'une minorité au seul prétexte qu'elle gênait, on a créé un précédent fâcheux. On ne peut pas, après ça, s'étonner de voir aujourd'hui des personnalités d'extrême droite reprendre les mêmes argumentaires, cette fois dirigés contre les Français issus de l'immigration musulmane. L'idée de " remigration ", très en vogue ces derniers temps, qui implique le " retour " forcé de ces Français d'origine africaine dans leurs pays d'origine quand bien même ils n'y auraient plus aucun lien, est en effet directement inspirée du FLN et de la bande à Sartre. L'écrivain Renaud Camus, nouvelle vedette d'une partie de la droite, créateur du concept tant débattu de " Grand Remplacement ", cite constamment l'exode Pied-Noir de 1962 pour justifier ses propres utopies politiques. Comme un exemple à imiter, en quelque sorte. Puisqu'" ils " (les " musulmans ", les " arabes ") ont chassé les Français, pourquoi ne pourrions-nous pas faire la même chose en sens inverse ?, se dit cet homme. Renaud Camus est fasciné par le FLN, comme Sartre l'était hier.
Renaud Camus assimile de façon abstraite l'ensemble des enfants d'immigrés et des musulmans de France à une population de " colons ", comme Sartre le faisait hier des Pieds-Noirs. En somme, la haine et le mépris déployés dans les années 50/60 contre les Pieds-Noirs ont muté, et les " jeunes de banlieue issus de l'immigration " courent aujourd'hui le risque d'être les " Pieds-Noirs de demain ". La bande à Sartre, Pierre Nora et beaucoup d'autres, ont fait du sacrifice humain et de la responsabilité collective une idée politique ; mais en invitant très tranquillement les Pieds- Noirs à choisir entre la valise ou le cercueil, on n'a pas pensé que d'autres, plus tard, pourraient s'inspirer de cette idée pour mettre en œuvre leurs propres projets. Sartre penseur de l'ultra droite ? Qui l'eût cru ? Et pourtant… Car Sartre, par son cynisme et sa glorification de la violence extrême, aura réussi l'exploit d'inspirer à la fois le terrorisme islamiste anti-occidental, et l'ultra droite française rêvant de " nettoyer " la France de ses musulmans ! On a la postérité qu'on mérite.
De même Pierre Nora, qui s'est cru malin en cherchant à humilier et à passer par les armes à l'aide de son petit stylo le peuple Français d'Algérie, s'est peut-être réjoui trop vite. Vous, vous dîtes que j'exagère ? Lisez plutôt :
" Ils sont petits. […] ; ils ne sont pas même un million, écrit-il en 1961 à propos des Français d'Algérie. […] Le référendum du 9 janvier permet de définir le lien actuel des Français métropolitains et des Français d'Algérie. Ceux-ci ne s'y sont pas trompés. Ils ont accusé le coup et senti passer le froid de la mort. […] Les Français demandent aujourd'hui au président de la République de les débarrasser des Français d'Algérie […]. […] il faut frapper. Vite et fort. […] seule une rupture brutale peut impressionner les Français d'Algérie. Il est exclu de les calmer […]. Seule une expérience-choc peut surprendre les Français d'Algérie, peut les prendre de court. […] les Français d'Algérie ont développé une ruse de malade et d'enfant, un réalisme de grands fauves. Ils ont un flair sans égal de limiers, une roublardise de braconniers. Inutile de jouer au plus fin ; on part perdant. […] il faut recourir au bistouri et trancher le cordon ombilical. […] Il y a même intérêt à les priver momentanément de tout espoir de secours. Rien n'est plus inutile que d'habituer les Français d'Algérie à l'idée anémiante qu'ils vont être " bradés ". Il faut qu'ils voient la chose faite. " (76)
Fascinant n'est-ce pas, cette jouissance sadique à vouloir mettre à mort sa cible ? On croirait lire le mode d'emploi d'un piège à souris. Voilà un homme qui a au moins le mérite d'avoir dit clairement ce que beaucoup au même moment pensaient de manière plus polie. Le général de Gaulle a dû lire Pierre Nora, puisque la méthode qu'il préconise en cet hiver 1961 afin de neutraliser définitivement les Français d'Algérie sera scrupuleusement mise en œuvre par le pouvoir dans les mois qui suivent. Nora a gagné la bataille. Les " fauves " ont bien été éliminés, une main devant une main derrière, et leurs yeux pour pleurer. Mais cet homme a joué avec le feu, un feu qui, à la lueur des récents évènements n'est sans doute pas près de s'éteindre. P. Nora devrait peut-être méditer cette magnifique formule de l'historien Pierre Darmon :
" De toutes les armes, [le racisme] est celle qui ressemble le plus à l'arme bactériologique. L'Histoire est formelle : tôt ou tard, si l'on n'y prend garde, elle se retourne contre ceux qui l'ont utilisée avant d'engloutir tout le monde. " (77)
Le but n'est pas d'insinuer que Pierre Nora est raciste (quoique sa détestation profonde des Européens d'Algérie pose de nombreuses questions (78) ). En revanche il est indéniable qu'en comptant sur une épuration ethnique du FLN pour en finir avec la guerre d'Algérie, et en faisant de la population Pied-Noir à elle seule un " problème " dans le règlement du conflit (" ce problème qui bouche actuellement l'avenir de dix millions d'Algériens et quarante-cinq millions de Français ", dit-il), nul ne peut nier qu'il a joué avec le racisme et le fanatisme religieux comme moteur légitime de l'Histoire. La banalisation d'un drame humain de grande ampleur à laquelle il s'est livré, est aussi très dangereuse.
" Il arrive, parfois, que l'Histoire se venge ", écrit majestueusement Michel De Jaeghere (79) . C'est à craindre en effet.
Sans le savoir, en croyant se débarrasser d'une collectivité humaine comme on se débarrasse d'une vieille chaussette, il est possible que ces intellectuels, et avec eux nombre d'hommes politiques en premier lieu desquels un certain Charles de Gaulle, aient contribué à préparer pour la France des heures sombres. On pensait, en abandonnant les Français d'Algérie à leur propre sort se débarrasser facilement d'un problème, j'ai bien peur qu'on n'en ait créé de nouveaux.
Car on ne justifie pas le massacre, l'exil ou l'humiliation d'un million de compatriotes sans qu'il n'en résulte de graves conséquences pour l'avenir. De même qu'on ne s'amuse pas impunément à traiter de " collabos " et de " traîtres " - le monde à l'envers ! - des gens comme les Harkis, qui luttaient pourtant au côté de la France contre ses ennemis, sans que le fantôme de ces hommes ne hante pour longtemps l'inconscient national.
Si de telles choses ont pu se faire l'année 1962, c'est bien qu'à ce moment-là l'idée de solidarité nationale, et donc, in fine, de l'instinct de survie d'un pays, en avaient pris un sacré coup. Mais tout porte à croire, à voir l'évolution actuelle que l'abandon des Pieds-Noirs et des Harkis s'inscrit dans un processus plus global entamé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la découverte des crimes nazis, dont l'idéologie de la repentance ne constitue que la face immergée de l'iceberg. " Notre histoire a fait de nous les témoins (malheureusement) privilégiés d'un long processus historique de renoncement à soi qui a été inauguré avec nous, voilà ce qui est à comprendre et à faire comprendre " (80), dit Emmanuel Navarro. Et si la guerre d'Algérie n'avait été qu'une simple bataille comprise dans une guerre plus vaste ?
Beaucoup de Français pensent que ce sont les Pieds-Noirs qui, revanchards, rejouent continuellement la guerre d'Algérie. Mais ils se trompent. Tout indique au contraire que ce sont les Algériens de France (et/ou les Français d'origine algérienne) - en tout cas une partie non négligeable d'entre eux -, qui cherchent à continuer cette guerre, en France cette fois. Car comment interpréter ces paroles du rappeur Médine que j'ai déjà citées : " On n'oublie pas ses ennemis " ? Comment interpréter l'image désastreuse de l'ex-président Hollande, interpellé par une adolescente lui reprochant le prétendu " génocide " de la France en Algérie ? Comment interpréter le fait que de jeunes Français d'origine algérienne osent se balader dans les rues de nos villes en portant des t-shirts à l'effigie d'Ali la Pointe, le terroriste de la Casbah d'Alger ?
Le peuple Français d'Algérie a donc bien été assassiné, par l'alliance de de Gaulle et du FLN certes, mais avec la complicité d'une bonne partie du monde intellectuel français. Ces gens, qui dans leur mégalomanie se prenaient pour les héritiers des dreyfusards ne cherchaient pas la résolution d'un conflit, encore moins la justice ; ils ont seulement pris parti pour une communauté contre une autre, l'Arabe contre la Française, quitte à vouer aux gémonies la seconde. Ce qu'Emmanuel Navarro nomme le " culte des hommes premiers ". On a idéalisé l'Arabe musulman d'Algérie comme l'autochtone par excellence (ce qu'il n'est pas d'ailleurs, puisque l'arabité de l'Algérie résulte d'une violente conquête au Moyen-Âge, qui mettra fin à la civilisation florissante de l'Afrique romano-berbère, latine et chrétienne), afin de mieux rendre illégitime la présence des Pieds-Noirs essentiellement latins et catholiques, issus d'un processus de colonisation, et assimilés de ce fait à un corps étranger en " terre d'Islam " (81) . " Les Pieds-Noirs n'avaient rien à faire en Algérie ! " : la formule est célèbre. Mais qu'on ne s'étonne pas alors de voir aujourd'hui refleurir à l'extrême droite le mythe du Français " de souche ", celte et catholique, éternel Gaulois faisant face aux " envahisseurs " musulmans et africains. Il n'y a qu'à se pencher sur les textes et discours du Bloc Identitaire et autres groupuscules d'extrême droite pour voir à quel point leur vocabulaire ressemble comme deux gouttes d'eau à certains écrits anticolonialistes et tiers-mondistes des années 1960…
Car à l'heure où l'on voit se développer dangereusement sur le sol de France, et particulièrement dans ses banlieues, l'Islam politique, mais aussi un parti, le Parti des Indigènes de la République (PIR), héritier direct pour ne pas dire fils spirituel du FLN, propageant la même idéologie morbide faite d'un mélange de marxisme, d'islamisme, d'arabisme, et, surtout, de haine anti-occidentale et anti-chrétienne, on a parfois l'impression que l'histoire se rejoue. Ces derniers sont d'ailleurs soutenus par les mêmes idiots utiles (entre bobos naïfs, chrétiens progressistes et islamo-gauchistes) qu'hier le FLN, ce qui ne manque pas de fasciner. On nous dira qu'ils ne représentent qu'une minorité - et c'est juste -, mais, l'Histoire nous a montré plus d'une fois que ce sont souvent les minorités qui la façonnent, surtout lorsqu'elles s'imposent par la terreur.
" La vengeance sera longue, violente ", disait le FLN… Espérons que cette fois, les Français ne s'offriront pas en sacrifice à leurs bourreaux comme ils ont sacrifié, hier, leurs compatriotes d'Algérie.
Marius Piedineri
Novembre 2017
1 C'est nous qui soulignons en gras. Interview publiée le 02/11/2011. Lien : http://www.lexpress.fr/culture/livre/alexis-jenni-je-pensais-etre-un-ecrivain-rate-comme-tant-d-autres_1046750.html.
2 Jean-Paul Sartre, " Le colonialisme est un système " (1956), Situations, V, Gallimard, 1964, p. 43. Cité par Jeannine Verdès-Leroux dans Les Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui, Une page d'histoire déchirée, Fayard, 2001, p. 13 (c'est nous qui soulignons en gras). Sartre, il est vrai, précisait quelques pages plus haut dans une note de bas de page qu'il " n'appelle colons ni les petits fonctionnaires, ni les ouvriers européens à la fois victimes et profiteurs innocents du système ". Mais ce passage sur le " million " de colons, quelques pages plus loin, annule de manière définitive cette note, de même que lorsqu'en 1961 il affirme qu'" abattre un Européen, c'est supprimer un oppresseur ", on ne sait si cet Européen est un colon (petit ?, grand ?), un mécanicien, un avocat ou un facteur. C'est " un Européen ", et cela suffit à ce qu'il soit condamné à mort. Enfin, si Sartre avait voulu distinguer les " gros colons " de la masse des Européens d'Algérie dans sa préface aux Damnés de la terre, il l'aurait précisé lui-même, l'enjeu étant trop important. Or, il ne le fait pas.
3 Sur la notion de génocide de classe, voir Stéphane Courtois, " Le génocide de classe : définition, description, comparaison ", in Les Cahiers de la Shoah, 2002/1, n°6, p. 89-122.
4 Emmanuel Navarro, Enquêtes d'Algérie, Tome 2, Compromission, L'Harmattan, 2016, p. 9.
5 Alger pleure, 2012.
6 Rapporté par Henri Mas, cité par Edmond Jouhaud dans Serons-nous enfin compris ? (Albin Michel, 1984, p. 202).
7 CAOM FR ANOM 91/1K623, Législatives 1936.
8 Jean Chaintron, Le vent soufflait devant ma porte, Editions du Seuil, Paris, 1993. C'est nous qui soulignons les phrases en gras.
9 Pascal Ory, Jean-François Sirinelli, Les intellectuels en France, De l'affaire Dreyfus à nos jours, Armand Colin, 2004 (1ère éd. 1987), p. 315.
10 Jean Daniel, Œuvres autobiographiques, Grasset, 2002.
11 Voir, par exemple, Philippe Darriulat, " La gauche républicaine et la conquête de l'Algérie, de la prise d'Alger à la reddition d'Abd el-Kader (1830-1847) ", in Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 82, n°307, 2e trimestre 1995, p. 129-147. L'auteur de cet article montre bien que l'idée de " mission civilisatrice " de la France fut portée par le parti républicain bien avant Jules Ferry et la Troisième République. Il montre également que les républicains furent de ceux qui, lors de la conquête de l'Algérie, dénoncèrent certaines brutalités propres à celle-ci.
12 Voir à ce sujet Bertrand Jalla, " Les colons d'Algérie à la lumière du coup d'État de 1851 ", Afrique & histoire, 1/2003 (Vol.1), p. 123-137. Mais aussi les travaux de Maurice Agulhon, grand spécialiste de la période, parmi lesquels : Les Quarante-huitards, Collection Folio histoire, Gallimard, 1992 (1 ère éd. 1975), p. 109 ; et 1848 ou l'apprentissage de la République, 1848-1852, Editions du Seuil, 1973 (éd. 2002), p. 148-149. Dans Les Quarante-huitards, Maurice Agulhon écrit : " l'Arabe est considéré comme un barbare arriéré et cruel qu'il est tout naturel de refouler dans ses montagnes (comme, à la même époque, l'Indien d'Amérique en ses prairies). Les seuls opprimés que les républicains reconnaissent en Afrique du Nord sont les colons français, à qui la République accorde dans l'assentiment général les droits et les institutions politiques de la citoyenneté française ".
13 Pierre Antonmattei, Léon Gambetta, héraut de la République, Editions Michalon, 1999, p. 510.
14 Bernard de Pasquale l'a déjà dit mieux que moi dans ce journal (voir La Seybouse n°140, juin 2014).
15 On disait à l'époque " Chambre des députés ".
16 Le Populaire du 24 décembre 1920.
17 La lecture des journaux d'Algérie de l'époque ne laisse aucun doute sur ce point.
18 Voir la thèse de Claire Marynower, Etre socialiste dans l'Algérie coloniale, Pratiques, cultures et identités d'un milieu partisan dans le département d'Oran, 1919-1939, p. 224-229 ; mais aussi Gilles Candar, " La gauche coloniale en France, Socialistes et radicaux (1885-1905) ", Mil neuf cent, Revue d'histoire intellectuelle, 2009/1 (n° 27), p. 37-56.
19 Pierre Darmon, Un siècle de passions algériennes, Une histoire de l'Algérie coloniale (1830-1940), Fayard, 2009, p. 188.
20 Juan Bautista Vilar, " Immigration et présence espagnoles en Afrique du Nord (XIXe et XXe siècles) ", in Migrance n°21, Espagne, pays de migrations, 2e trim. 2002, p. 10-27.
21 Annales Africaines du 1er octobre 1928.
22 Paul Birebent, Hommes, vignes et vins de l'Algérie Française, 1830-1962, Editions Jacques Gandini, 2007, p. 139 et p. 142. Voir aussi Hildebert Isnard, " IV. Vigne et colonisation en Algérie (1880-1947) ", in Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, 2 e année, N3, 1947, pp. 288-300.
23 Albert Camus, Chroniques algériennes, 1939-1958, Actuelles III, Editions Gallimard, 1958, p. 22.
24 André Rossfelder, Le onzième commandement, Editions Gallimard, 2000, p. 412.
25 Il poursuit : " A gauche, on avait accusé Aron de pessimisme, de défaitisme, de sécheresse de cœur " (Œuvres autobiographiques, Grasset, 2002).
26 Expression qu'il écrit lui sans guillemets (Gilbert Meynier, L'Algérie révélée, La guerre de 14-18 et le premier quart du XXème siècle, Librairie Droz, 1981, p. 169), pour qualifier les Français d'Algérie. Le mot " bâtards " était déjà utilisé, toujours sans guillemets, page 35.
27 Thomas Wien, " Quelle est la largeur de l'Atlantique ? Le " François canadien " entre proximité et distance, 1660-1760 ", in Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, XVIe-XIXe siècle, Editions EHESS, Paris, 2014, p. 55-75.
28 Emmanuel Navarro, Enquêtes d'Algérie, Tome 2, Compromission, L'Harmattan, 2016, p. 170. Un livre dont je vous recommande vivement la lecture (avec le tome 1).
29 Il fait partie, aux côtés notamment de Dionys Mascolo et Jean-Paul Sartre, du Comité d'action des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord, créé en 1955. Voir aussi les articles " Mauriac et l'Algérie : Le temps des certitudes (1954-mai 1958) ", et " Mauriac et l'" équivoque " algérienne, 1958-1962 ", dans Philippe Baudorre (dir.), La Plume dans la plaie, Les écrivains journalistes et la guerre d'Algérie, Presses Universitaires de Bordeaux, 2003.
30 Nouveaux cahiers François Mauriac, n°4, Grasset, 1996, " Le vin de Bordeaux, par François Mauriac ".
31 Les Potins de Paris du 14 juillet 1922.
32 L'Echo d'Alger du 21 décembre 1932.
33 Michel Winock, L'agonie de la IVe République : 13 Mai 1958, Gallimard, 2006.
34 Cité par Jeannine Verdès-Leroux dans Les Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui, Une page d'histoire déchirée, op. cit.
35 Voir Gérard Crespo, Jean-Jacques Jordi, L'immigration espagnole dans l'algérois, de 1830 à 1914, Editions de l'Atlanthrope, 1991.
36 Les taux de mobilisation des Européens d'Afrique du Nord en 1944/1945, entre 16 et 17 % de la population active, dépassent les plus forts taux de mobilisation de la Première Guerre mondiale. En tout, il y aura 170.000 hommes mobilisés, dont 120.000 pour la seule Algérie, représentant en proportion l'essentiel de l'armée de Libération. Ces hommes, aux côtés de leurs frères d'armes musulmans, africains et Français Libres, aidés des Alliés, se battront pendant trois ans au moins, en Tunisie, en Italie, en Corse, avant de venir libérer une bonne partie de la Métropole française, jusqu'en Alsace (nous citons nos chiffres d'après Jacques Cantier, " 1939-1945, Une métropole coloniale en guerre ", in Jean-Jacques Jordi, Guy Pervillé (dir.), Alger 1940-1962, Une ville en guerres, Editions Autrement, 1999, p. 16-61).
37 Plus grand-monde le sait aujourd'hui mais les premiers à s'être dénommés " Algériens " sont les Européens d'Algérie, dès le XIXème siècle. Il n'existait à cette époque aucune unité nationale chez ceux que l'on appelait alors les " indigènes ", Arabes et Berbères divisés en de multiples tribus et peuples rivaux, leur seul lien réel étant l'appartenance à l'Islam. Le nom même d'"Algérie " est une création française datant de la conquête. L'expression " Pieds-Noirs ", quant à elle, n'a commencé à être vraiment utilisée que vers la fin de la guerre d'Algérie.
38 Emmanuel Navarro, Enquêtes d'Algérie, Tome 2, Compromission, L'Harmattan, 2016, p. 287. Livre dont je recommande une nouvelle fois vivement la lecture.
39 Albert Camus, Chroniques algériennes, 1939-1958, Actuelles III, Editions Gallimard, 1958, p. 25-26. C'est encore nous qui soulignons en gras.
40 Olivier Todd, Albert Camus, une vie, Editions Gallimard et Olivier Todd, 1996, p. 869. " Les Français de la métropole ont l'esprit de Munich " continue Grenier, ce à quoi Camus répond : " Oui, c'est le Munich de gauche. "
41 Jean Daniel, Cet étranger qui me ressemble, Grasset, 2004, p. 172. Jean Daniel, favorable à l'indépendance de l'Algérie, pays dont il est originaire, avouant être " tombé de très haut " suite à cette conversation poursuit : " En recevant cette douche, j'ai regretté qu'ils soient si francs. Ils m'ôtaient tout alibi pour rester proche d'eux. Et comment faire accepter ça aux Européens d'Algérie ? " Ce qui questionne également, c'est pourquoi Jean Daniel, alors journaliste reconnu, n'a pas jugé utile d'informer le plus possible de Français sur ce qu'il venait d'entendre, et a attendu si longtemps pour révéler le contenu de cet entretien.
42 Marcel Ducrocq, Une œuvre fraternelle, Notre Algérie (lettre du Maréchal Juin, préface de R. Abdesselam, député d'Alger-Banlieue), Nouvelles Editions Latines, 1962, p. 51.
43 Ibid., p. 68-69.
44 Tallandier, 2012.
45 Sur cette question, voir les travaux de l'historien Jean-Jacques Jordi.
46 Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, Tome I, Fayard, 1994.
47 Raphaël Draï, La fin de l'Algérie française et les juridictions d'exception, Etat, Justice et Morale dans les procès du putsch d'Alger et de l'OAS, Editions Manucius, Paris, 2015.
48 Georges-Marc Benamou, Un mensonge français, Retours sur la guerre d'Algérie, Editions Robert Laffont, Paris, 2003, p. 189-215. Robert Lopez parle également de ces accords comme d'une " falsification historique ", d'une " braderie institutionnelle ", et d'une " infamante mascarade institutionnelle " (Robert Lopez, Le bonheur perdu des exclus, 1962 : les conditions désastreuses de l'exode des pieds-noirs et des harkis, Préface de Alain Vircondelet, L'Harmattan, 2012, Deuxième partie).
49 Jacques Soustelle, Sur une route nouvelle, Editions du Fuseau, 1964.
50 Interview intitulée " Le FLN voulait-il des Pieds-noirs ? ", publiée dans un numéro hors-série de Science et vie, " Algérie 1954-1962, la dernière guerre des Français ", en 2004. Lien : http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=161.
51 Marcel Ducrocq, Une œuvre fraternelle, Notre Algérie, op. cit., 1962, p. 110.
52 Voir Sybille Chapeu, Des chrétiens dans la guerre d'Algérie, L'action de la Mission de France, Editions de l'Atelier, 2004 ; Hervé Hamon, Patrick Rotman, Les porteurs de valises, La résistance française à la guerre d'Algérie, Editions du Seuil, 1982 ; Edmond Jouhaud, Serons-nous enfin compris ?, Albin Michel, 1984, p. 159-188 (soit les chapitres " La subversion. - Les porteurs de valise " et " Les chrétiens progressistes ").
53 Cité par Gilbert Meynier dans sa thèse L'Algérie révélée. C'est nous qui soulignons en gras.
54 Entretien réalisé en 2012. Lien : http://www.prechi-precha.fr/propagande-le-mythe-de-lespagne-musulmane-entretien-avec-serafin-fanjul/.
55 En plus de l'idée défendue par Alain Peyrefitte en 1961, comme nous l'avons vu plus haut, il y eut bien une proposition de ce type, dite " plan Hersant ", déposée en 1957 sous la forme d'une proposition de résolution, par plusieurs députés essentiellement centristes. Mais ce projet, qui ne souleva pas un très grand intérêt, suscita de violentes critiques dans les rangs de la droite au prétexte qu'il portait atteinte à " l'intégrité du territoire national " (même droite qui, parfois, suivra de Gaulle dans sa politique d'abandon total quelques années plus tard…).
Il sera retiré quelques mois après. Voilà un exemple parmi d'autres de la lourdeur de la politique française caractéristique du conflit algérien. Ajoutons que le futur président de la République Valéry Giscard d'Estaing était très favorable à cette idée de partition, ce du " plan Hersant " jusqu'aux derniers moments de la guerre d'Algérie (Jean Bothorel, Un si jeune président…, Grasset, 1995).
56 Jean-Christophe Notin, Maréchal Juin, Tallandier, 2015, p. 598-599.
57 Alain Peyrefitte, C'était de Gaulle, Tome I, Fayard, 1994.
58 Jeannine Verdès-Leroux, Les Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui, Une page d'histoire déchirée, Fayard, 2001, p. 434.
59 Ibid., p. 435.
60 Ibid., p. 430.
61 Edmond Jouhaud, Ce que je n'ai pas dit, Sakiet, OAS, Evian, Fayard, 1977. Il tient à affirmer " l'authenticité " de cette note.
62 Cette Déclaration a été mise en ligne sur le site Internet You Tube.
63 Voir par exemple Jacques Cantier, L'Algérie sous le régime de Vichy, Odile Jacob, 2002, p. 22-23.
64 Jacques Binoche, " Les élus d'outre-mer au Parlement de 1871 à 1914 ", in Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 58, n°210, 1 er trimestre 1971, p. 82-115 (plus précisément p. 90 et p. 107).
65 Ce n'est pas une vue de l'esprit. Cela a été démontré de la façon la plus scientifique possible par Emmanuelle Comtat dans son ouvrage Les pieds noirs et la politique, quarante ans après le retour (Les Presses Sciences Po, Paris, 2009). Quant à la droitisation des Français d'Algérie face à la montée du nationalisme arabe à partir des années 20, voir Xavier Yacono, Histoire de l'Algérie, de la fin de la Régence turque à l'insurrection de 1954, Editions de l'Atlanthrope, 1993, p. 309-310.
66 Robert Lopez, Le bonheur perdu des exclus, 1962 : les conditions désastreuses de l'exode des pieds-noirs et des harkis, Préface de Alain Vircondelet, L'Harmattan, 2012, p. 73. Un livre à lire, très intéressant, qui remet quelques pendules à l'heure au sujet de l'histoire des Pieds-Noirs, tout cela sans agressivité et avec une grande sagesse.
67 Dans l'hebdomadaire Marianne, en janvier 2015 si je me souviens.
68 André Rossfelder, Le onzième commandement, Editions Gallimard, 2000, p. 388.
69 Dans son autobiographie, Mémoires barbares (Albin Michel, 1993).
70 France Inter, Le 7/9, 19 mars 2012.
71 Je pense en particulier à une récente tentative - qui serait ridicule si elle n'était pas dangereuse - menée par un certain Pierre Daum, journaliste d'extrême gauche, auteur d'un livre que je ne citerai même pas.
72 Historien public, Gallimard, 2011. C'est nous qui soulignons la phrase en gras.
73 A partir des années 1920-1930 essentiellement. Une lutte qui culminera avec le projet Blum-Viollette au moment du Front populaire.
74 Jean-François Giordano, " Bab-el-Oued : place Lelièvre, cœur éclaté... ou l'énumération prodigieuse ", texte extrait du journal Aux échos d'Alger, n°37, 1992 (http://alger-roi.fr/Alger/bab_el_oued/textes/babeloued_aea37.htm).
75 Un peu grosse est la tentative ces derniers temps de mettre sur le même plan les plaintes et les revendications des Pieds-Noirs avec celles des héritiers du FLN, sous le couvert d'un hypocrite " respect de toutes les mémoires ", comme si celles-ci se valaient toutes. Cela n'est rien d'autre qu'une façon moderne de noyer le poisson (le " poisson " Pied-Noir, bien entendu). Pourquoi, à ce compte-là, ne pas demander à l'Algérie de célébrer les soldats Français morts pendant la guerre d'indépendance ?
76 Pierre Nora, Les Français d'Algérie, Christian Bourgeois éditeur, 2012 (1ère éd. 1961), p. 250-257. Le plus atroce est que Pierre Nora, dans sa préface à la réédition du livre en 2012, avoue n'avoir jamais cru que les Français d'Algérie pourraient rester vivre dans une Algérie FLN (" ils reviendraient tous "), alors qu'il affirmait dans l'édition de 1961 qu'" un tiers " d'entre eux seulement " reviendrait ", ce par simple stratégie.
77 Pierre Darmon, Un siècle de passions algériennes, Une histoire de l'Algérie coloniale (1830-1940), Fayard, 2009, p. 588.
78 Sur la manière qu'a Pierre Nora d'enfermer les Français d'Algérie dans une image de Méditerranéens vulgaires, voir Manuel Borutta, " De la Méridionalité à la Méditerranée : Le Midi de la France au temps de l'Algérie coloniale ", in Cahiers de la Méditerranée [Online], 87 | 2013.
79 Le Figaro Histoire, décembre 2014 (" La guerre d'Algérie est-elle terminée ? ", par Michel De Jaeghere).
80 Emmanuel Navarro, Enquêtes d'Algérie, Le culte des hommes premiers, Tome 1, Bannissement, L'Harmattan, 2016, p. 60.
81 Remarquez qu'on n'utilise jamais l'expression " terre chrétienne ", " terre juive " ou " terre bouddhiste ".
|
|
Chantiers nords-africains
Trouvé à la BNF 07-1931 N°7
|
Le Port d'Oran
Notre but n'est pas de faire un historique détaillé de ce port, le premier de l'Afrique du Nord, l'un des plus importants du bassin méditerranéen. Ce que nous voulons surtout, c'est, après un bref aperçu rétrospectif, indiquer sa situation actuelle et celle qui découlera dans un avenir plus ou moins éloigné, de l'exécution des travaux projetés dont quelques-uns sont déjà achevés ou en voie d'achèvement.
Oran, nous apprend l'histoire, aurait été fondé en l'an 902 de l'ère chrétienne par des Maures d'Andalousie attirés par le commerce de Tlemcen et de Fez. Mais des recherches paléontologiques ont démontré qu'Oran existait déjà à l'époque préhistorique. Nous en avons des vestiges dans les grottes du Murdjadjo. Cependant, des huttes de paille remplacèrent, peu à peu les cavernes ; ces huttes firent place, à leur tour, à des habitations de pierre.
A dater de 902, la cité subit des fortunes diverses : en 910, invasion des Fatimides qui la ruinèrent ; domination en 1083 des Almoravides, en 1137 des Almohades, en 1242 des Mérinides, en 1360 des Abd-el-Ouadites ou Béni-Zian. Enfin, en 1509 : débarquement des Espagnols qui occupent Oran jusqu'en 1708, l'évacuent à cette date puis y reviennent en 1732 pour y résider jusqu'en 1790 (tremblement de terre). De 1790 à 1830, date de notre débarquement, cette ville subit la domination des beys de l'Ouest.
Il va sans dire que le port d'Oran épousa étroitement les phases diverses de l'agglomération. Escale précaire au début, les Espagnols ne purent lui imprimer aucun essor commercial par suite de l'état perpétuel de guerre dans lequel ils vivaient avec les tribus indigènes de l'intérieur.
Jusqu'à la date de notre débarquement (1830), toutes les opérations maritimes qui intéressaient Oran et sa région, s'effectuaient à Mers-el-Kébir. Il existait cependant à l'emplacement actuel du quai Bougainville (Quai du Centre ou Quai Transatlantique) une jetée de 40 mètres environ de longueur, construite un siècle avant peut-être dans un but stratégique, afin que même isolé de Mers-el-Kébir le présidio d'Oran put être facilement ravitaillé.
Dès les premières années de l'occupation, le Colonel Fitz James, commandant la Place d'Oran, et M. Pézerat, ingénieur des Ponts et Chaussées, jugèrent utile de compléter les travaux existants par l'établissement de quais et la construction d'un épi de manière à constituer un petit bassin suffisamment fermé et abrité. Les premiers projets soumis au Gouvernement furent successivement rejetés ou négligés et ce fut seulement de 1844 à 1864 que l'on construisit, à peu près dans sa forme actuelle, le bassin appelé aujourd'hui " Vieux Port " et qui est réservé presque exclusivement aux chalands et embarcations de plaisance.
Le 2 juillet 1864, le paquebot poste " La Tamise " des Messageries Impériales, vint mouiller dans le port d 'Oran, venant de Marseille, mais ne put stationner faute de bouée d'amarrage. Il fut aussitôt remédié à cette lacune et le 24 juillet de la même année, le paquebot " Seine " inaugurait l'escale définitive d'Oran.
Le développement commercial de la ville fut tellement rapide qu'en 1857, avant même l'achèvement des travaux compris dans le projet de 1848, on reconnut que le bassin en cours d'exécution serait insuffisant. Plusieurs projets, dont les tracés différaient peu entre eux furent dressés et examinés et au cours des enquêtes, des propositions nouvelles surgirent.
Le Général Frossard, Commandant supérieur du Génie en Algérie, soutenait très vivement un projet consistant à créer à Mers-el-Kébir un port militaire servant en même temps de port de commerce (notons en passant que ce projet coïncide étrangement avec celui d'agrandissement vers l'Ouest). Il proposait le prolongement du chemin de fer d'Alger-Oran jusqu'à Mers-el-Kebir. Le Général Frossard sentant que sa proposition était inadmissible puisqu'elle allait à l'encontre du but poursuivi qui était la suppression du transport entre la rade et la ville, ajoutait : " La satisfaction donnée au commerce d'Oran sera incomplète, c'est vrai, mais rien ne s'opposera plus tard à la création d'un bassin, non plus seulement de 27 hectares, comme celui qui est proposé, mais de 50 et plus s'il le faut. "
Cette proposition, surtout basée sur des considérations militaires, fut également repoussée par la Commission mixte qui déclara que le port d'Oran devait être devant cette ville et non autre part.
Parmi les nombreux projets présentés, celui de M. Aucour, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées fut retenu. Les travaux de construction commencèrent en 1858 et se poursuivirent jusqu'en 1876. A ce moment le port d'Oran présentait l'aspect d'un parallélogramme de 30 hectares environ de superficie, ouvert à l'Est et enfermant l'ancien port qui se trouvait occuper son angle intérieur Ouest. Aucune modification n'y fut apportée jusqu'à la fin du XIXème siècle.
Dans le courant de l'année 1898 la Chambre de Commerce admit le principe d'un agrandissement du port. Il s'agissait de construire un nouveau bassin de 20 hectares, formé par le prolongement de la jetée du Nord et par une jetée perpendiculaire partant du fort Sainte-Thérèse. Ce bassin, qui offrirait en moyenne 12 mètres de fond, devait comporter une forme de radoub et une cale sèche avec 6 hectares de terre-pleins. Durant l'année 1899, une série de sondages furent opérés, pour servir à l'établissement de l'avant-projet que devait présenter le Service des Ponts et Chaussées.
L'Assemblée Consulaire réclamait également l'approfondissement général du port le long des quais Lamoune, de la Douane, du Centre Sainte-Marie, de la Gare et Sainte-Thérèse et offrait de prendre à sa charge la dépense évaluée à 365.000 francs.
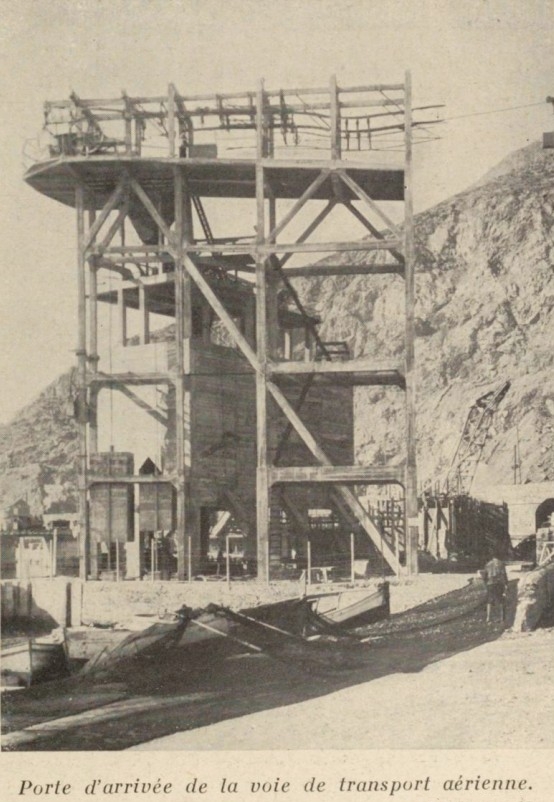
L'année suivante, la Chambre appelait l'attention de l'Administration sur- la nécessité d'établir d'urgence un projet d'ensemble susceptible de donner à la navigation et au commerce les surfaces d'eau et de terre rendues indispensables par le développement du trafic ; mais six années s'écoulèrent encore avant que l'on entrât dans la voie des réalisations.
En 1906 enfin était mise en adjudication la première partie du programme, comportant le prolongement de la jetée du large sur 1.280 mètres et l'établissement de deux jetées perpendiculaires à la rive de façon à créer deux nouveaux bassins : l'un servant d'avant-port, l'autre entouré de quais, de 15 hectares de superficie environ, destiné à l'accostage et aux opérations des navires.
Bien avant la terminaison des travaux qui prirent fin dans les derniers mois de 1914, leur insuffisance devint tellement évidente qu'il fallut songer à poursuivre sans délai les agrandissements. La nécessité impérieuse des améliorations projetées ne pouvait être mise en doute par quiconque prenait la peine d'examiner d'une part les courbes de développement du trafic depuis l'origine, de l'autre les progrès incessants de la colonisation dans le département d'Oran. Malheureusement la guerre survint. Une première satisfaction fut cependant accordée au commerce oranais par la déclaration d'utilité publique, en avril 1906, de l'élargissement du môle dit des Hauts-Fonds. Les travaux ne purent cependant être mis en adjudication qu'en décembre 1922. Ils sont, à l'heure actuelle, presque entièrement terminés, ainsi que le dérochement du bassin du Maroc, à une profondeur suffisante pour permettre l'accostage des navires de tout tonnage.
Le projet d'agrandissement vers l'Est approuvé dès 1912 et prévoyant la construction d'un nouveau bassin et d'un avant-port, le comblement de la baie Sainte-Thérèse et divers travaux accessoires portait sur une dépense totale de 34.500.000 francs. L'élévation du prix des matériaux et de la main-d'œuvre obligea à le réviser complètement : le chiffre de dépenses à engager fut élevé à 66.000.000 puis enfin à 95.000.000, soit 29.000.000 pour la construction du bassin Poincaré et le reste pour le prolongement de la jetée du large et de l'épi transversal de Gambetta.
L'estimation de ces travaux a été faite en 1921 ; l'exécution en a été ordonnée en 1924. La Chambre de Commerce d'Oran a accepté les relèvements précités. C'est grâce à sa participation unilatérale que les travaux - qui seront achevés dans 4 ou 5 ans - ont pu se poursuivre en attendant le vote des crédits.
Ce programme mené à bien, le port d'Oran, abrité au large par une jetée de 3 kilomètres, comprendra : un avant-port de 45 hectares environ avec fonds de 10 à 5 mètres ; un bassin de 16 hectares avec fonds de 7 m. 40 et les bassins du vieux port de 29 hectares. Les quais atteindront un développement de plus de 5 kilomètres et les terre-pleins s'étendront sur 400 hectares.
A ce moment, si le développement du département et de la ville d'Oran continue, la Chambre de Commerce a prévu et fait dresser un plan d'extension vers l'Ouest englobant toute la baie de Mers-el-Kebir et dont la réalisation répondra, pour un siècle, aux besoins du commerce et de la navigation. Le coût de ce projet est de l'ordre de 5 à 600 millions de francs, inférieur au coût du port de Casablanca dont le mouvement est cependant 10 fois inférieur.
La première tranche -- le projet en comprend quatre - coûtera environ 260.000.000 de francs, la Colonie prenant en principe à sa charge la moitié des dépenses prévues qui ont été approuvées par les Délégations Financières. Les plans sont actuellement à l'étude au Ministère des Travaux Publics qui y apportera les modifications jugées utiles.
Les raisons qui militent en faveur de l'agrandissement du port et de son extension vers l'Ouest sont de deux sortes :
a) des raisons correspondant à des besoins immédiats ;
b) des raisons correspondant à des besoins qui se font jour et se développent de plus en plus selon un rythme facile à prévoir.
En ce qui concerne les raisons immédiates, elles se justifient si l'on compare le trafic d'Oran avec celui d'autres ports.
Ces chiffres sont :
Global tonneaux 21.000.000
Marchandises tonnes ...... 4.000.000
Oran est le plus encombré de tous les ports français et étrangers parce qu'il est celui qui, pour la plus petite longueur de quai, manipule le plus gros tonnage de marchandises, très variées.
Pour 1.000 tonnes de marchandises manipulées, Oran dispose de 65 cm de quai;
En comparaison : Bordeaux dispose de 2 m. 10 ; Dunkerque de 2 m. 55 ; Marseille de 2 m. !
Le port d'Oran est donc absolument débordé et ce n'est que grâce à une organisation extrêmement rigoureuse et coûteuse qu'il fait face à son trafic.
Un autre chiffre donnera une idée de cette gène : chaque mètre carré de magasin et de terre-plein voit passer, année moyenne, plus de 30 tonnes de marchandises diverses alors que le maximum des ports les plus actifs va de 13 à 15 tonnes au plus !
On a vu 62 bateaux à la fois dans le port d'Oran, séjournant parfois de 45 à 50 jours. 11.581 navires entrés et sortis en un an (1930), cela représente en moyenne 31 mouvements par jour.
En supposant même que le trafic actuel ne soit pas dépassé une fois les travaux terminés, le port et le nouveau port en voie d'achèvement seront encore insuffisants.
Les dépôts de charbon et de mazout, la portion de quais, de terre-pleins pour charbonner ne subiront aucune modification et le trafic par mètre carré courant de quai restera encore excessif.
Mais l'hypothèse ci-dessus est peu probable et il faut tenir compte, au contraire, de l'accroissement régulier de la production et de la consommation du à l'augmentation du bien-être à celui du chiffre de la population, etc... On ne peut l'estimer à moins de 100.000 tonnes par an.
Mais avant de procéder à l'agrandissement du port et à son extension vers l'Ouest, la Chambre de Commerce d'Oran s'est souciée de tirer tout le parti possible de l'installation actuelle, en dépit de sa précarité. Elle continue à augmenter, le nombre des embarcations de servitude ; elle monte deux grues mobiles et doit en recevoir sous peu quatre autres à portique. La construction de nouveaux magasins est prévue ainsi que la surélévation de ceux existants. Un vaste silo à grains est en voie d'achèvement. Enfin sur le môle Jules Giraud une gare maritime sera installée et l'on a prévu l'acquisition d'un grand dock flottant.
En ce qui concerne l'extension vers l'Ouest, il convient d'envisager ici les motifs qui ont donné naissance à ce projet :
Des obstacles limitent l'extension vers l'Est : le musoir de la grande jetée plonge à une profondeur de 35 mètres. Si l'on allonge ce musoir en direction - du Nord-Est on atteint presque immédiatement des fonds de 40 mètres. Les fonds se relèveraient en suite pour revenir à la côte 30. On voit les dépenses considérables à engager !
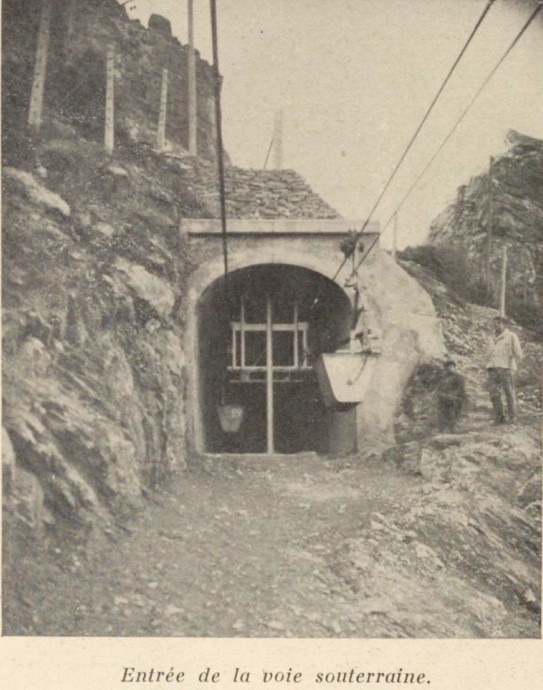 D'autre part, vers l'Est, la côte est accore et bordée par la haute falaise de Gambetta supérieur. Il s'ensuit que la construction des terre-pleins nécessaires entraînerait des terrassements coûteux. Voilà pourquoi l'on a repoussé l'extension vers l'Est et envisagé, celle vers l'Ouest qui offre, à tous points de vue, des facilités exceptionnelles. D'autre part, vers l'Est, la côte est accore et bordée par la haute falaise de Gambetta supérieur. Il s'ensuit que la construction des terre-pleins nécessaires entraînerait des terrassements coûteux. Voilà pourquoi l'on a repoussé l'extension vers l'Est et envisagé, celle vers l'Ouest qui offre, à tous points de vue, des facilités exceptionnelles.
Sans s'attarder sur les avantages naturels de Mers-el-Kébir, nul n'ignore que cette baie constitue un excellent mouillage bien abrité des vents d'Ouest et -du Nord.
Voici comment est envisagé l'avenir du trafic :
Oran conserverait les voyageurs, les marchandises générales qui font l'objet d'un commerce suivi entre la ville et le port, les vins, céréales, bestiaux.
Mers-el-Kebir serait affecté plus particulièrement au charbonnage, au ravitaillement des relâcheurs et au trafic des marchandises, soit pondéreuses comme les carburants, soit encombrantes comme les alfas, crins végétaux et pailles qui transitent du chemin de fer aux navires. Enfin Mers-el-Kékir constitue un admirable mouillage pour les escadres qui y relâcheraient plus aisément qu'aujourd'hui.
Le détail des travaux est le suivant :
La jetée naturelle que forme la pointe du fort de Mers-el-Kébir longue de 800 mètres, serait prolongée en direction de l'Est-Sud-Est par une jetée muraille de 450 mètres de longueur.
En retrait de cette jetée, au-delà d'une passe de 300 mètres de largeur, s'étendrait une autre jetée de 650 mètres de longueur dirigée Nord-Sud. Cette jetée se prolongerait sur 275mètres parallèlement à là côte, en direction du Sud-Est. Le plan d'eau de plus de 120 hectares ainsi esquissé serait fermé par une traverse de 825 mètres issue de la cote à Roseville et perpendiculaire à cette dernière. Une passe de 200 mètres resterait libre entre, cette traverse et le saillant de la jetée du large.
Dans ce nouveau port, les installations actuelles de la Société Algérienne d'Eclairage et de Force, celles de la Société Italo-Américaine des Pétroles, celles du Port de Pêche de Saint-André et la cale de halage en construction seraient respectées.
Par contre, le fond du vieux port de Mers-el-Kébir serait comblé pour les besoins des travaux eux-mêmes.
Enfin, un vaste terre-plein s'étendrait devant la route entre Roseville et Saint-André et s'avancerait de 400 mètres vers le large pour se terminer en un quai long de 800 mètres fondé à 12 mètres.
Ce quai permettrait l'accostage des plus gros types de navires. Les dimensions du terre-plein permettraient de faire des installations telles qu'en matière de charbonnage, notamment, Oran serait armé pour de longues années.
Et maintenant passons aux détails techniques qui démontrent que nos ingénieurs ont prévu les méthodes à la fois les plus rationnelles et les plus économiques.
Les jetées seront du type nouveau. Au lieu de la jetée faite d'un talus de quartiers de roches coiffé en son sommet seulement d'une muraille de blocs de béton, les techniciens adopteront le mur vertical fait d'énormes blocs de 450 tonnes chacun et reposant sur plate-forme d'enrochements. A longueur égale, la masse de matériaux à employer est trois fois moindre avec ce nouveau type qu'avec l'ancien. Il s'ensuit trois avantages fondamentaux :
1° Diminution du prix de la construction ;
2° Diminution du délai d'exécution ;
3° Entretien à peu près nul ;
avantages auxquels se joint celui d'ordre nautique.
Les navires pourront se ranger le long de la jetée du côté intérieur comme le long d'un quai. C'est le type de jetée récemment adopté à Alger et Marseille.
<
br> De l'avis de M. Vergniaud, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, les travaux que nous venons d'exposer pourraient être commencés vers 1936 ou 1937, sous réserve de l'approbation du Ministère des Travaux Publics et des Délégations Algériennes.
Et pour terminer, quelques chiffres qui confirment le développement du trafic du port d'Oran et justifient les prévisions d'avenir :
E. B.
Exécution des travaux de prolongement
de la jetée du port d'Oran
Ces travaux, en voie d'exécution, ont été confiés à la Compagnie de Dragage et d'Entreprises Maritimes d'Oran. Ils ont nécessité l'installation, par cette firme, de transporteurs aériens sur câbles montés par la Maison Monzies, de Paris.
La longueur de la ligne aérienne, qui permet de transporter les matériaux servant à fabriquer des blocs en ciment, est de 600 mètres et va du Cap Gros (carrière) au Vieux Port de Mers-el-Kébir.
Le débit horaire peut atteindre 80 tonnes de sable, gravier ou pierre concassée. Le chargement s'effectue en galerie creusée dans le roc et le déchargement des wagonnets, aériens a lieu dans un silo, au Vieux Port de Mers-el-Kébir. De là les matériaux sont rechargés directement sur des chalands qui les transportent ensuite à Oran.
A SUIVRE
|
|
PHOTOS de KIOSQUES
Envoyé par M. Remy Lafranque
|
|
| 11 NOVEMBRE : ARMISTICE
Envoyé Par Hugues
|

Quatre années et trois mois d'une guerre meurtrière,
Ont éprouvé la France, l'Europe toute entière,
Vingt millions d'invalides, les bras en bandoulière,
Et Dix millions de corps, inhumés au cimetière.
C'est le triste bilan de la folie des hommes.
Qui, s'ils ont le pouvoir, en monstres se transforment,
Leur ego envahit leur tête et leurs neurones,
Se croient maîtres du monde et ne craignent personne !
"L'armistice est signé", dit la Presse unanime,
Et " C'est la Der des Ders ", quand le Poilu s'exprime.
Ce n'est rien qu'un vœu pieux, avant que se ranime
Un esprit de revanche, auteur d'autres victimes.
Mais goûtons, un instant, la douceur que la paix
Apportait au "poilu" qui a participé
Aux assauts meurtriers dont il a réchappé,
Où des amis sont morts, d'autres handicapés.
Dans les familles Françaises et celles de nos Alliés,
Ce jour est l'occasion de ne pas oublier
Que la menace gronde, les risques multipliés,
Qu'il faut unir nos forces pour ne pas être spoliés.
Hugues JOLIVET
3 novembre 2014
|
|
|
RELATION DU
SIÉGE DE ZAATCHA
Paris. - Imprimerie COSSE et J. DUMAINE, rue Christine, 2. - 1863
Source Gallica
|
INSURRECTION SURVENUE
DANS LE SUD DE LA PROVINCE DE CONSTANTINE En 1849
Par M. le Général HERBILLON,
Commandant la province de Constantine de 1848 à 1850.
CHAPITRE IV.
Formation de la colonne expéditionnaire. - Départ de Constantine. - Arrivée à Batna. - Départ de Batna - La colonne à Biskra. - Services réglés. - Arrivée devant Zaatcha. - Projets présentés pour l'attaque de Zaatcha. - La Zaouïa, choisie pour un dépôt de tranchée. - Dispositions prises pour l'attaque de la Zaouïa. - Installation d'une place d'armes.- Occupation de la Zaouïa.- Guerre des oasis. - Description de l'oasis et du village de Zaatcha.
L'effectif des troupes qui se trouvaient à cette époque dans la province de Constantine n'était point en rapport avec toutes les difficultés du moment. Aussi, fut-il impossible de se conformer entièrement aux instructions de M. le gouverneur général, qui prescrivait : " d'être le plus fort possible pour obtenir des résultats significatifs, en infligeant à Zaatcha un châtiment exemplaire, seul moyen de faire rentrer les oasis rebelles dans l'ordre. " Pour atteindre ce but, il aurait fallu une très-forte colonne composée de manière à pouvoir frapper un de ces coups prompts et décisifs qui, en portant l'effroi dans les populations, font succéder soudain la tranquillité aux plus grands désordres. Mais une telle force ne pouvait être réunie qu'en prenant jusqu'au dernier homme de toutes les troupes de la province, dont la situation politique n'était point assez assurée pour qu'il fut prudent de laisser Constantine et Philippeville surtout, sans moyens de répression.
En effet, les Kabyles du Zouagha et de Collo étaient gens beaucoup trop mobiles pour que l'on pût avoir confiance entière dans leur soumission encore bien récente. Voisins de l'installation des colonies agricoles, ils étaient pour elles un sujet incessant d'inquiétude; il y avait donc nécessité d'y maintenir une active surveillance, et, pour le moment, on ne pouvait en retirer les détachements que l'on y avait envoyés. Ainsi forcé par les circonstances, le général laissa à Constantine et à Philippeville le nombre de troupes reconnu indispensable, et, après réduction faite dans les garnisons de Bône, de Guelma, il put former une colonne de 3,306 hommes, y compris le 5e bataillon de chasseurs qui était annoncé d'Alger et qui devait débarquer à Stora, du 18 au 20 septembre.
Elle devait être renforcée des troupes de Batna et de Biskra, et augmentée plus tard de celles que commandait le colonel de Barrai qui, après avoir installé un poste militaire à Bouçada, avait l'ordre, si besoin en était, de se diriger sur Zaatcha à la tête de sa petite colonne, composée de la garnison de Sétif et de 400 zouaves du régiment venus d'Alger.
Les troupes qui étaient destinées à l'expédition des Ziban et qui avaient reçu l'ordre de se rendre à Constantine y étant arrivées, le colonel Dumontet, du 43ème de ligne, en prit le commandement et se mit en route, le 24 septembre, pour se rendre à Batna, où le général commandant la province arriva le 28 septembre, escorté par tous les caïds, cheiks et grands de toutes les tribus du Tell qui avoisinaient la route.
Batna était le chef-lieu d'un vaste pays où le général, lorsqu'il était colonel du 61ème de ligne, avait été envoyé pour en prendre possession, l'organiser, l'administrer, et qu'il quitta en 1848 pour prendre le commandement de la province. Aussi, ce fut avec bonheur qu'il vit tous les caïds, tous les cheiks au milieu desquels il avait vécu et laissé d'honorables souvenirs, lui témoigner leur gratitude et l'assurer de leur fidélité. Ils furent sincères, car tous, à une très-petite exception, répondirent à la confiance que l'on avait mise en eux et plusieurs même en donnèrent des preuves manifestes pendant le cours du siège de Zaatcha.
Toutes les dispositions furent prises afin que le service des convois fût assuré. Des ordres furent donnés au commandant de la subdivision pour la politique à suivre dans le pays, pendant la durée de l'expédition, ainsi qu'aux chefs arabes, pour la conduite qu'ils avaient à tenir envers leurs administrés, sur lesquels ils devaient exercer la plus grande surveillance, et sévir sans crainte contre les turbulents. Le général Herbillon, commandant la province, se mit ensuite à la tête des troupes et quitta Batna le 6 octobre, à six heures du matin.
Le troisième jour de marche, la colonne après avoir passé le défilé d'El-Kantara, alla camper à El-Outaïa, où l'attendait le colonel Carbuccia.
Cet officier, qui avait été envoyé à Biskra, venait rendre compte au général de la situation politique des Ziban, qui était peu rassurante, et le prévenir que Zaatcha et les oasis voisines, soumises plus que jamais à l'influence de Bouzian, étaient devenues le réceptacle de tous les fanatiques, attirés par la guerre sainte.
A l'arrivée à Biskra, le 4 octobre, les troupes dressèrent leurs tentes dans l'oasis, sous les palmiers, et en vue des villages dont les habitants étaient arrivés à une certaine aisance, qu'ils devaient à notre administration, pour laquelle ils ne montraient aucune reconnaissance: car, animés du même esprit de fanatisme que leurs coreligionnaires rebelles, ils nous virent fouler leur territoire avec la rage concentrée de gens qui n'attendaient que le moment favorable pour secouer un joug abhorré.
A peine le camp fut-il établi au milieu de cette oasis, que l'on vit arriver les cheiks du Zab-Guebli et du Zab-Chergui, qui venaient faire acte de soumission, dont la durée dépendrait du succès de l'expédition. Il fallait donc s'attendre à ce que, dans le cas d'une retraite, tous ces chefs deviendraient des ennemis fort dangereux. Le général les reçut de manière à leur faire comprendre qu'il n'était pas dupe du peu de sincérité de leur démarche. Toutefois, il accueillit leurs plaintes, leurs réclamations, et, après avoir réglé quelques affaires en litige, il les congédia, en leur donnant l'assurance que force resterait à nos armes et que les coupables seraient sévèrement châtiés.
Pendant la durée de l'expédition, Biskra allait devenir le point sur lequel tous les convois seraient dirigés et où les malades et les blessés seraient envoyés, pour de là être transportés à Batna Des mesures furent prises afin d'obvier à toutes les difficultés qui pourraient survenir et en particulier à l'encombrement des malades qu'il fallait surtout éviter. Aussi les moyens de transport furent-ils assurés et une ambulance munie d'ustensiles d'hôpitaux fut installée de manière à suffire aux premiers besoins. Tous les services étant organisés et deux jours de repos ayant été donnés aux hommes, les troupes quittèrent cette oasis, le 6 octobre, en emmenant une partie de la légion étrangère sous les ordres du colonel Carbuccia; ce qui porta l'effectif de la colonne expéditionnaire à 4,493 hommes, au lieu de 3,306. Elle bivouaqua, le soir même, sur la droite de l'oued Mellili, et le lendemain, 7 octobre, elle arriva devant Zaatcha, à 8 heures du matin, au pied du Coudiat-el-Meïda, où le camp fut immédiatement établi (Emplacement du bey de Constantine en 1831).
(Planche II) Cette colline, en partie couverte de sable, sur laquelle les tentes furent dressées, fait face aux oasis de Lichana et de Zaatcha, commande le pays aussi loin que la vue peut porter et est située à cinq cents mètres de la Zaouïa ( École de Mnrebtiin.), groupe de maisons que domine un minaret assez élevé. A deux cents mètres en avant du camp, se trouve Rass-Aïn-Meïoub, source abondante, dont deux compagnies du 5e chasseurs à pied prennent possession, dès notre arrivée.
A la vue de cet horizon de palmiers que formaient les oasis de Bouchagroun, Lichana, Zaatcha, Farfar et Tolga, dont les séparations de loin échappaient à l'œil, on ne put douter de l'opiniâtre résistance qui serait opposée à une opération que l'on avait ordre de conduire avec la plus grande vigueur : mais ce n'était pas avec 4,500 hommes, qui n'étaient qu'un point noir au milieu de cette immensité, qu'il était possible d'empêcher les habitants valides des oasis voisines et les fanatiques d'accourir de toute part au secours de Zaatcha. Malgré les nombreuses difficultés qui parurent devoir s'opposer à l'accomplissement de la mission confiée au général commandant la province, celui-ci n'en prit pas moins la détermination de ne quitter le Coudiat-el-Meïda qu'après un succès complet. Ce fut la résolution du premier moment; rien ne put la faire changer.
La répression de la révolte de Zaatcha était devenue une affaire fort grave. On avait à lutter contre un monde d'oasis, et non contre une seule, les Ouied-Djellal, qui, en 1846, avaient reçu Bou-Maza. Une attaque de vive force, comme celles entreprises en 1831 par le bey Ackmet et en juillet 1849 par le colonel Carbuccia, n'était donc point à renouveler sans s'exposer à un échec certain. Aussi, ne voulant rien donner au hasard, plusieurs projets furent examinés avec soin.
D'abord, il fut immédiatement reconnu impossible d'investir toute l'oasis dans laquelle se trouvent renfermés les villages de Lichana et de Zaatcha, dont le périmètre a près de douze kilomètres. Ce n'était pas avec un petit corps d'armée de 4,493 hommes que l'on pouvait occuper une ligne de ce développement.
Le colonel du génie présenta un projet qui consistait dans l'établissement de trois dépôts de tranchée, d'où partiraient trois attaques : l'un entre Lichana et Zaatcha, le deuxième à la Zaouïa, le troisième entre Farfar et Zaatcha.
Ce projet du colonel, qui, sans doute avec des moyens d'action suffisants, aurait déterminé un succès plus rapide, était inexécutable en raison du trop faible effectif de la colonne. Avec aussi peu de monde, diviser ses efforts dès le début, avant tout établissement, c'était s'affaiblir sur tous les points, prêter partout le flanc aux attaques des populations révoltées et s'exposer à toutes leurs entreprises qui, en harassant les troupes, auraient surexcité encore l'audace des Arabes.
Tous nos efforts devaient donc se porter sur un seul point; et, après mûr examen, le général décida que le dépôt de tranchée serait à la Zaouïa, par les considérations suivantes :
1° On se serait très-difficilement établi et maintenu entre Lichana et Zaatcha; c'eût été une entreprise des plus périlleuses, car on aurait dû faire face à l'ennemi par-devant, par derrière, et cela au milieu de jardins, qui se prêtaient on ne peut mieux aux surprises et aux embuscades ;
2° L'établissement d'un dépôt de tranchée entre Zaatcha et Farfar ne pouvait être mis à exécution qu'en occupant cette dernière oasis qui, il est vrai, était abandonnée, mais où les Arabes se glisseraient certainement pour nous tenir dans une inquiétude continuelle; on aurait eu, en outre, le grave inconvénient de former deux camps éloignés l'un de l'autre de 1,400 mètres, ce qui aurait nécessité une plus grande surveillance et l'envoi journalier de convois pour le transport des vivres et des malades ;
3° Restait la Zaouïa; ce point remplissait toutes les conditions désirables pour l'établissement d'un dépôt de tranchée d'où partiraient les travaux d'attaque qui, conduits à travers les jardins, viendraient aboutir à la face Est des murs du village, que l'on pouvait considérer comme la base d'un triangle ayant pour sommet la Zaouïa; ce dernier point, n'étant qu'à 500 mètres du camp, offrait, en outre, tous les avantages d'une communication facile, et son occupation serait une prise de possession d'une partie importante de l'oasis.
L'attaque de cet avant-poste de Zaatcha fut donc décidée, et toutes les dispositions furent immédiatement prises pour en assurer le succès.
(Planche II.) Ainsi, le 7 octobre, jour de notre arrivée, à midi, l'ordre fut donné au cheik El-Arab de réunir ses goums, et de nèrent leur domicile et furent remplacées par les fanatiques de tous les environs et par des vagabonds venus de différents points de l'Algérie; ceux-ci n'ayant rien à perdre et pouvant se remplacer facilement, étaient des adversaires dangereux, entièrement soumis à l'influence de Bouzian, et dominés par sa volonté de fer.
CHAPITRE V
Parti que Bouzian tire des dépouilles des cadavres laissés entre les mains des Arabes. - Établissement d'une batterie, son tir.
- Reconnaissance faite par le commandant Bourbak, avec le bataillon de tirailleurs indigènes. - Construction de nouvelles batteries.-Le colonel Petit, du génie, blessé grièvement. - Commencement des travaux de siège. - Le capitaine Charles, du génie, prend la direction active des travaux. -
Le colonel Petit conserve celle des attaques. - Moyens employés pour se défiler des feux de l'ennemi. - Chasseurs d'autruche. - Le lieutenfaire le tour de l'oasis par le sud, pendant que la cavalerie, dirigée par le colonel de Mirbeck et appuyée par le bataillon indigène, se porterait entre Zaatcha et Tolga, ayant pour mission d'empêcher les gens de cette dernière oasis de venir en aide à leurs voisins. Le colonel Dumontet alla s'établir avec un bataillon du 43ème de ligne, sur la lisière orientale de l'oasis de Lichana, pour inquiéter les habitants; il ne devait pas s'engager.
- Contingents nombreux arrivant et se remplaçant sans cesse.
Le lieutenant-colonel Pariset, commandant l'artillerie, plaça les deux sections de la batterie de campagne et trois mortiers de 0,16 à hauteur d'Aïn-Meïoub et un peu en avant de la rive droite. Le tir des pièces avait pour but, en abattant quelques pans de muraille, de faciliter l'approche de la Zaouïa, d'en éloigner les défenseurs et de contenir les Arabes qui pourraient chercher à tourner l'attaque sur notre gauche.
Les mortiers devaient lancer des bombes dans les jardins environnants, pour en chasser les indigènes qui s'y étaient embusqués.
Trois compagnies du 5ème bataillon de chasseurs à pied, et un détachement de sapeurs du génie munis d'outils, d'échelles, de sacs de poudre, furent chargés de marcher droit sur le groupe de maisons qu'ils avaient .devant eux, de s'en emparer et de s'y établir solidement. Ils étaient soutenus dans ce mouvement offensif par deux compagnies du 3e bataillon d'Afrique et par six cents hommes de la légion étrangère, qui, agissant de concert avec eux, devaient les couvrir en occupant les jardins de droite et de gauche.
Une section d'obusiers de montagne fut placée à proximité de ces troupes, pour les appuyer en cas de besoin. Le commandement de cette colonne d'attaque fut donné au colonel Carbuccia avec l'ordre formel de ne pas dépasser les maisons groupées autour du minaret et surtout de ne pas poursuivre les Arabes dans des jardins dont l'issue nous était inconnue. Cet ordre fut communiqué et répété plusieurs fois à la troupe et à haute voix.
Toutes ces instructions ayant été données et chacun étant rendu à son poste, l'artillerie ouvrit son feu, et, aussitôt que quelques pans de murs se furent écroulés et les Arabes éloignés, les troupes s'élancèrent au pas de course, ayant à leur tête le colonel Carbuccia. En un instant, les maisons, les jardins qui faisaient partie de la Zaouïa (Cette Zaouïa fût bâtie en 1306 par le nommé Sada, de la fraction des Rhaman.) furent enlevés avec la plus grande vigueur, et le drapeau tricolore arboré sur le haut du minaret. La prise de ce poste important, qui avait eu lieu sans éprouver de résistance et sans qu'il y eût perte d'hommes, aurait été un véritable succès, si les ordres avaient été strictement exécutés. Mais, dans l'ardeur de l'action, les officiers et soldats les oublièrent totalement en s'engageant dans les jardins, où les Arabes, à l'affût derrière les murs, dirigèrent sur eux un feu meurtrier ; beaucoup d'entre eux, marchant en aveugles, allèrent même se heurter contre les murs crénelés du village où plusieurs trouvèrent la mort.
Assaillis de tous côtés par un ennemi invisible, ce chef de la secte des Sunnites, qui souleva les oasis contre le pouvoir de cette époque, fut défait et tué près de Mellili. 500 ans après, un autre imposteur fut la cause de la destruction de cette Zaouïa.
Ces nombreux imprudents, en présence d'un pareil danger contre lequel ils ne pouvaient rien, cherchèrent le salut dans une fuite précipitée qui fut arrêtée par la section de montagne; celle-ci s'étant placée sur une espèce de tertre déjà occupé par les sapeurs du génie, parvint, au moyen d'un feu bien dirigé, à refouler les Arabes qui s'étaient mis à la poursuite des fuyards, et servit en même temps de point de ralliement où vinrent se réfugier tous les hommes dispersés.
Cet emplacement situé à 70 mètres en avant de la Zaouïa, sur la route de Lichana, où l'artillerie s'était si heureusement placée, avait été reconnu, immédiatement après la prise de la Zaouïa, par le colonel Petit, du génie, comme pouvant servir à l'établissement d'une place d'armes; il fut bientôt entouré d'un épaulement de sacs à terre ; ce qui ne s'exécuta pas sans danger, car cette position, en vue du village, fut exposée à un feu très-vif. C'est là que le capitaine Thomas, du génie, et le lieutenant Pillebois, de la même arme, furent grièvement blessés. Ces deux officiers avaient été admirables de bravoure et de sang-froid.
Pendant que le combat se prolongeait dans l'oasis et que le colonel Petit faisait élever un épaulement, le lieutenant-colonel Pariset dirigeait le feu de ses pièces et le tir de ses mortiers de manière à empêcher des groupes d'Arabes de s'embusquer derrière les murs de clôture des jardins, qui étaient à droite et à gauche de la mosquée, d'où ils auraient pu nous prendre à revers et tirer sur les blessés qu'on portait à l'ambulance.
Le désordre qui avait été causé par le sauve qui peut de tous les hommes qui s'étaient trop avancés ou égarés, ayant été réparé, les deux bataillons du 43ème de ligne, sous les ordres de leur colonel, vinrent occuper la Zaouïa et s'y établirent solidement. Mais cette occupation ne produisit pas sur les habitants de Zaatcha l'effet que l'on attendait, et cela par suite de l'échauffourée déplorable qui nous coûta 25 tués, parmi lesquels le capitaine Jacquelin, du 3ème bataillon d'Afrique, dont le corps resta entre les mains des Arabes (Son corps fut trouvé, après la prise de Zaatcha, près du fossé ; il n'avait pas été mutilé.1, et 67 blessés y compris 11 officiers; pertes douloureuses faites sans nécessité, qui ne pouvaient être justifiées que par la trop grande ardeur des troupes, que l'on avait cru pouvoir maîtriser en leur fixant une limite d'action.
Tel est le récit exact de l'attaque de ce poste important, premier épisode du siège de Zaatcha, et prélude de toutes les difficultés que nous devions rencontrer dans cette guerre d'oasis, qui était encore inconnue, où nous allions avoir à lutter contre un ennemi fanatisé et décidé à se défendre avec d'autant plus d'acharnement qu'il avait à nous opposer des renforts continuels.
Cette première affaire était, en effet, une preuve de la résolution qu'avaient les Arabes de nous disputer pied à pied les approches de Zaatcha, en profitant de tous les avantages que leur donnaient les jardins, les fourrés d'arbres et les murs de clôture. Ce village était entièrement caché par des palmiers, et on le savait entouré d'un fossé, large et profond, rempli d'eau, qui en faisait une petite place d'armes réputée imprenable; ces notions résultaient de faits antérieurs et d'un plan par renseignements, qui était aussi précis qu'on pouvait le désirer. Il n'en était pas de même de l'oasis, que l'on n'avait pu parcourir pour en étudier toutes les parties, et qui, différant de toutes les autres, ne fut véritablement connue qu'après que tous les travaux des tranchées furent terminés et que l'on fut arrivé, au pied des murailles de Zaatcha.
Cette oasis avait l'aspect d'une haute futaie de palmiers ( Lichana et Zaatrha, renfermés dans la même oasis, comptent 10,000 palmiers ) ; elle était arrosée par deux sources abondantes, Aïn-Meïoub et Aïn-Fouar; cette dernière alimentait le fossé qui entourait entièrement le village et augmentait les moyens de défense de ce côté (nord-ouest) par la facilité de l'inonder. Le sol était coupé de canaux conduisant les eaux dans toutes les directions, et était hérissé de murs de jardins d'autant plus élevés qu'on avait plus abaissé le niveau du terrain pour assurer l'irrigation; quelques rues étroites et la base des murs étaient restées au niveau du sol. Les jardins étaient à deux ou trois mètres au-dessous de ce niveau. C'étaient de véritables trous de loup d'une grande dimension, où croissaient des figuiers et des abricotiers mêlés à des plantes rampantes, qui en faisaient un dédale inextricable : chaque jardin à enlever nécessitait un engagement plus ou moins meurtrier..
Quant à Zaatcha, il ressemblait à une petite place du moyen âge ; des tours carrées s'élevaient de distance en distance, reliées par des maisons percées de petits créneaux triangulaires destinés à faciliter la dessiccation des dattes par l'introduction de l'air extérieur, et les habitants s'en servaient contre nous comme de meurtrières.
Un chemin de ronde bordait un fossé plein d'eau, de 6 à 8 mètres de largeur sur 0,80 à 1 mètre 20 c. de profondeur, qui entourait entièrement le village, dans lequel on entrait du côté de l'ouest par une grande porte, précédée d'un pont en pierre. Les maisons communiquaient entre elles par des terrasses; l'entrée en était très-basse, il fallait se plier en deux pour y pénétrer. Les rues étaient très-étroites.
Ce massif de constructions, dominé par un minaret, était habité, avant notre arrivée, par cent cinquante familles qui abandonant-colonel Pariset. - Conduite de l'artillerie. - Sortie des rebelles; ils se jettent sur nos positions. - Résistance des assiégés. - Nécessité d'étendre les travaux d'approche vers la droite. - Reconnaissance faite par le sergent-major Jouvisse, de l'arme du génie. - Occupation de nouveaux jardins. - Attaque des Arabes. - Système adopté par les défenseurs de Zaatcha, pour arrêter les travaux.
L'attaque et l'occupation de la partie la plus saillante de l'oasis ne portèrent aucune atteinte au fanatisme et à l'hostilité des défenseurs de Zaatcha, qui, ne jugeant les faits que par l'impression qu'ils en ressentaient, virent une défaite dans une retraite d'un moment et dans l'abandon forcé de quelques hommes tués. Les cadavres de nos soldats produisirent parmi eux le plus grand enthousiasme, que Bouzian s'empressa de propager dans les oasis voisines, en y envoyant comme trophées les vêtements dont on les avait dépouillés. Ce spectacle, parlant aux yeux de tous, exalta les têtes, augmenta le nombre de ses partisans et affermit en même temps la confiance de ceux qui étaient déjà avec lui. Aussi, tous les Arabes réunis à Lichana et à Zaatcha en sortirent pendant la nuit, et, s'éparpillant autour du camp, l'assaillirent de coups de fusil, qui, tirés de loin, indiquaient plutôt le contentement d'un succès obtenu, que l'intention d'une attaque combinée. Les troupes y répondirent à peine.
L'audace et l'arrogance des habitants de ces deux villages, qui étaient encouragés dans leur résistance par leurs voisins et surtout par des Arabes étrangers au pays, venus à leur aide, provenaient évidemment du peu de crainte que leur inspirait une faible colonne, dont ils connaissaient l'effectif, et aussi de l'assurance que leur donnait l'enceinte de Zaatcha, véritable réduit où ils croyaient pouvoir braver impunément toutes nos attaques. Il était donc de toute nécessité de leur prouver le contraire, en dirigeant immédiatement le feu d'une batterie d'artillerie sur ce village, afin d'y faire brèche et d'ébranler par ce moyen la confiance que les rebelles avaient dans les murs de cette espèce de forteresse.
(Planche III.) Ce fut pour atteindre ce but que l'artillerie, dans la nuit du 7 au 8 octobre, construisit une batterie sur l'emplacement que le colonel du génie avait reconnu propre à l'établissement d'une place d'armes. De ce point, on apercevait à peine les murs des maisons qui formaient l'enceinte du village, dont on espérait voir la base après l'abatage de quelques palmiers. Cette batterie fut terminée le lendemain, au point du jour, malgré toutes les tracasseries des Arabes et malgré le manque de matériaux, auxquels il fut suppléé par des tronçons de palmiers et par les débris des portes arrachées des maisons de la Zaouïa.
Cette batterie prit le n° 1, fut armée de trois pièces (Un canon de S. un obusier de 0,15 et un de 12.) et à dix heures du matin elle ouvrit son feu, dont on ne pouvait juger l'effet que par les nuages de poussière qui, s'élevant à chaque coup, indiquaient que les projectiles atteignaient les constructions; mais les palmiers et les autres arbres qui les masquaient ne permettaient pas d'apprécier la justesse du tir. On était donc dans la plus grande incertitude sur le résultat de cette canonnade prolongée, lorsque tout à coup on aperçut une brèche et des lézardes. Celles-ci, vues de la batterie, paraissant d'une assez grande largeur, firent supposer que les Arabes, effrayés de l'effet produit par les boulets, ne prolongeraient pas davantage la défense de leur village et feraient leur soumission. Le général, sous cette impression, voulut s'assurer si vraiment les dégâts étaient tels que l'on pût espérer la reddition de la place ou bien tenter une attaque de vive force. Il chargea le commandant Bourbaki de cette mission.
Cet officier supérieur se porta avec une compagnie vers la droite de la batterie, dépassa les tirailleurs du 43ème de ligne, que l'on avait placés en avant pour couvrir l'abatage des palmiers; il reconnut que, de ce côté, la muraille était un peu endommagée dans sa partie supérieure, et que le canon n'avait nullement atteint la partie inférieure; toutefois, cette reconnaissance ne suffisant pas, le commandant se dirigea vers la gauche avec son bataillon pour se porter dans les jardins qui bordent la place, afin de juger de plus près quelle était la nature des dégâts et d'inspirer en même temps aux Arabes la crainte d'un assaut.
Cette tentative ne fut pas heureuse. Les tirailleurs indigènes ne pouvant être surveillés par leurs chefs se dispersèrent, les uns dans les jardins et les autres, en grand nombre, s'élancèrent avec élan sur le village, où probablement ils croyaient pouvoir pénétrer. Arrivés à peu de distance du fossé, ils furent reçus par un feu terrible parti tout à coup de tous les créneaux des maisons, auquel ils ne pouvaient répondre et qui les força à se retirer précipitamment. Les Arabes, à ce mouvement de retraite, sortirent de tous côtés et se mirent à leur poursuite; les tirailleurs ; s'arrêtant subitement, firent un retour offensif, leur tuèrent plusieurs hommes et arrachèrent de leurs mains les corps d'un officier et d'un soldat qui avaient succombé.
Dans cette reconnaissance, malheureusement interrompue, on put cependant s'assurer que le premier mur était écrôté, que quelques maisons étaient percées de boulets sans être sérieusement endommagées, et que la brèche, que l'on avait crue praticable, était à plus de deux mètres au-dessus du fossé. Ainsi, les nombreux projectiles lancés n'avaient fait que fort peu de dégâts et les murs atteints étaient restés intacts même à une grande hauteur.
La perte, dans ce combat d'un moment, fut, pour les tirailleurs indigènes, de 7 tués, dont 1 officier, et 43 blessés; ajoutée à celle de la veille, elle faisait un grand vide dans la colonne, déjà bien faible; elle démontrait, en outre, combien il était difficile, sinon impossible, d'empêcher les hommes de s'égarer dans le dédale de tous ces jardins, où cachés, dispersés, ils échappaient à la surveillance de leurs chefs et allaient imprudemment se livrer aux coups d'un ennemi invisible. Quant aux Arabes, bien qu'ils eussent été abrités, ils n'en eurent pas moins, dans ces deux journées, plusieurs des leurs tués et un assez grand nombre de blessés ; mais, comme la plus grande partie était étrangère à la localité, il n'en pouvait résulter aucun deuil, aucune désolation dans les familles de Zaatcha, ce qui fut une des principales causes de la longueur de cette guerre.
Le bataillon indigène, en se retirant, avait entraîné avec lui les compagnies qui avaient été placées dans les jardins les plus avancés; ces derniers furent abandonnés pour le moment avec l'intention de les reprendre, lorsque les positions que nous occupions seraient fortifiées, et qu'une nouvelle batterie aurait été construite à 40 mètres de la première, pour en protéger l'occupation. Ces travaux furent exécutés la nuit.
(Planche III.) Le lendemain 9 octobre, à la pointe du jour, le colonel Petit, qui mettait un grand zèle et une aptitude remarquable dans tout ce qu'il entreprenait, partit du camp avec une section du génie, une compagnie du 5e chasseurs à pied et une autre de la légion étrangère; ce détachement s'empara sans difficulté, sous la protection de la batterie n° 2, des jardins abandonnés la veille, dont on assura l'occupation en perçant des créneaux dans les murs d'enceinte.
Pendant que ce mouvement s'opérait, le colonel s'était porté en avant pour faire une reconnaissance des lieux et déterminer l'emplacement d'une nouvelle batterie qui pût prendre d'enfilade les tours du village. C'est au moment qu'il montrait cet emplacement à plusieurs officiers et qu'il se faisait donner des renseignements sur Zaatcha par le sous-lieutenant Séroka, attaché au bureau arabe, qu'une balle, partie d'un des créneaux de la place, vint lui briser l'épaule gauche, après avoir traversé le cou de M. Séroka.
La blessure grave que venait de recevoir le colonel Petit, et qui nécessita la désarticulation de l'épaule, porta la plus profonde tristesse dans le cœur des officiers et soldats de la colonne expéditionnaire ; elle était d'autant plus sensible que déjà, à l'affaire du 7, le capitaine Thomas et le lieutenant Pillebois avaient été évacués pour cause de blessures graves : ce qui avait réduit l'effectif des officiers du génie à quatre, dont deux capitaines (MM. Charles et Laberge.), nombre évidemment insuffisant pour répondre à toutes les exigences du service.
Le capitaine Charles prit alors la direction active des travaux, et le colonel Petit, malgré ses vives souffrances, voulut conserver celle des attaques. Il demanda à ce qu'on laissât, d'une manière permanente, au colonel Carbuccia le commandement des troupes d'infanterie de service à la tranchée; ce qui lui fut accordé, en adjoignant à cet officier supérieur le capitaine Collineau, de la légion étrangère ( Mort en Chine, général).
Cet événement malheureux fit sentir l'importance de se défiler au plus vite du feu des assiégés, qui venaient de nous donner une preuve bien cruelle de leur adresse. On ferma donc immédiatement les brèches faites aux murs des jardins, avec des sacs à terre ; on éleva des traverses en rondins de palmiers; on employa enfin tous les moyens possibles pour donner sécurité aux travailleurs, aux canonniers, ainsi qu'aux officiers et soldats que leur service appelait dans les tranchées.
Mais, parmi les gens que Bouzian avait réunis autour de lui, il y avait des chasseurs d'autruches, tireurs d'une extrême habileté ; on ne put, pendant toute la durée des opérations, éviter les effets meurtriers de leurs coups. Ces Arabes du désert restaient toute la journée immobiles sur les créneaux, les yeux fixés sur leur proie ; ils en épiaient les moindres mouvements , et tout homme qui se découvrait était frappé. Ils guettaient. aussi avec la plus grande attention le moment où l'on démasquait les pièces, et aussitôt arrivaient des balles tirées avec une précision remarquable, dont les tranches des pièces portaient de nombreuses empreintes; ce qui attestait le danger que couraient les canonniers.
L'emplacement dont le choix avait été si fatal au colonel du génie, ainsi qu'un autre point situé plus à gauche de 50 mètres, ayant été reconnus très-convenables pour l'établissement de deux batteries (Batterie Petit et batterie n° 3) destinées à prendre d'enfilade trois tours du village, le lieutenant-colonel Pariset les fit construire sans retard. Cet officier supérieur qui, dans le cours du siège, rendit de si grands services, n'avait pour le moment avec lui que 9 officiers et 276 artilleurs, dont le zèle ne se démentit pas un seul instant. Ils donnèrent tous de grandes preuves de dévouement et de courage, dans l'exécution de tous les travaux faits au milieu de massifs de palmiers qui leur masquaient la vue, et d'un fouillis de plantes rampantes et d'arbrisseaux qu'il fallait couper, arracher, sous le feu de la place, avant de donner un coup de pioche.
Le génie travailla en même temps à perfectionner le défilement, à partir de la Zaouïa jusqu'à ces dernières batteries, et, s'avançant avec prudence, s'empara, sans coup férir, d'un jardin ( n°8) situé vers l'extrême gauche, dont l'occupation fut importante parce que le terrain sur ce point dominait un peu les jardins environnants, et permettait de tenir les Arabes éloignés de nos positions.
Les autres troupes de la colonne expéditionnaire, comme celles du génie et de l'artillerie, étaient animées d'une grande émulation, d'une activité presque fébrile, et toutes ayant le plus grand désir d'en finir avec les défenseurs de cette petite forteresse, qui les provoquaient sans cesse, apportaient le plus grand zèle dans les différents services. Aussi, malgré leur petit nombre et les dangers auxquels elles devaient être exposées, le général n'hésita pas à faire continuer les travaux d'approche dans le but d'arriver au fossé que l'on voulait combler, au point où la brèche devait être faite.
La construction de ce cheminement fut très-souvent contrariée par les pierres que les Arabes jetaient sans relâche sur la tête de sape, et par les feux plongeants des maisons, que l'artillerie chercha à éteindre. Pour le faire avec plus d'efficacité , celle-ci construisit une nouvelle batterie ( n° 4.) qui, concurremment avec les deux dernières déjà établies, battit les points les plus élevés de la place; elle dirigea principalement son feu sur la tour sud-est, dont une partie du haut s'écroula. A la vue de cet éboulement, les sapeurs du génie débouchèrent dans cette direction ; mais ils furent arrêtés par les Arabes qui les rejetèrent dans les jardins, dont ils tentèrent même l'escalade. Cette attaque fut repoussée par la garde de tranchée et n'eut aucune suite fâcheuse.
Ce fragment de tour écroulé, et les sapeurs du génie débouchant pour se porter sur le bord du fossé, inquiétèrent tellement les rebelles que, le soir même, à 7 heures, ils se réunirent au nombre d'environ 300, et, s'animant les uns et les autres, vinrent se jeter avec fureur sur la gauche de nos positions pour nous en chasser. Deux fois ils furent reçus par les grenadiers du 43e et par ceux de la légion étrangère; les premiers qui se présentèrent furent tués sur place, ainsi que ceux qui vinrent pour enlever leurs corps. Après une lutte assez longue, ils furent enfin repoussés, en laissant 10 morts et en emportant leurs blessés. De notre côté, nous eûmes un homme tué et 22 blessés. Le chef de bataillon Plombin, de la légion étrangère, qui commandait ces deux compagnies d'élite, se fit remarquer par l'élan qu'il sut donner aux troupes.
(Planche III.) Jusqu'au 11 octobre, les travaux d'attaque furent dirigés sans interruption sur l'angle sud-est du village, et on les croyait suffisants pour déterminer la soumission des habitants qui, selon toute probabilité, ne voudraient pas s'exposer à une prise d'assaut. Les assiégés, au contraire, n'en devinrent que plus entreprenants, plus audacieux, et l'opiniâtreté de la résistance ne fit qu'augmenter au fur et à mesure qu'on s'approchait de la place. On sentit donc la nécessité d'étendre ces travaux vers la droite, pour ouvrir une deuxième brèche à l'angle nord-est, et d'approcher d'une maison que l'on croyait être celle de Bouzian ( L'emplacement réel de la maison de Bouzian n'a été connu que longtemps après.), et qui, jusqu'à ce moment, avait été à l'abri de nos projectiles. Une reconnaissance fut donc faite par le sergent-major Jouvisse, du génie, qui, suivi de six sapeurs, sut se dérober à la vue des Arabes et arriver dans un jardin, à 45 mètres de l'angle nord-est, qu'il reconnut propre à l'emplacement d'une batterie.
D'après son rapport, il fut décidé que l'on s'emparerait de ce jardin (n°12), et tous les matériaux nécessaires à cette occupation furent préparés, pendant la nuit.
Deux compagnies du 5e bataillon de chasseurs furent placées dans ce jardin, et dans un autre, un peu plus à gauche (N°13); tous les deux attenant au chemin qui conduisait de la Zaouïa au village ; et, le lendemain, à la pointe du jour, ils furent entièrement occupés, les murs crénelés et la rue barricadée. Les ronces, les abricotiers, les oliviers et les palmiers qu'il fallut arracher ou abattre pour se faire jour, rendirent le travail pénible et long. Heureusement pour les travailleurs que les murs élevés dont ils étaient entourés, les défilaient des feux de la place. Les Arabes, cependant, qui se doutaient de nos intentions, avaient l'oreille au guet, et, ne se trompant pas sur la direction donnée aux travaux, arrivèrent en nombre, lancèrent une grande quantité de pierres par-dessus les murs qu'ils ne pouvaient franchir ; et les plus audacieux, attaquant avec vigueur du côté de la tête de sape, y laissèrent cinq cadavres. Le travail fut interrompu et ne fut repris que lorsque les Arabes, après maints efforts inutiles pour nous chasser de ces nouvelles positions, se furent retirés.
Le système adopté par les défenseurs de Zaatcha, dès le début du siège, était de nous inquiéter sans cesse, de nous opposer audace et ruse, et de renouveler constamment les tentatives les plus hardies pour entraver et même arrêter nos travaux d'attaque. Aussi, ce cheminement de jardin en jardin était devenu un combat incessant, de jour et de nuit, où les Arabes, attaquant parfois de vive force, venaient se faire tuer au pied des retranchements. Très souvent, profitant de la connaissance qu'ils avaient de toutes les issues de l'oasis, ils faisaient une irruption tellement rapide que l'on était forcé, pour les repousser, d'abandonner une position nouvellement occupée.
Plus tard, ils allumèrent de grands feux, qui, éclairant les tranchées, assuraient leur attaque dont l'objet principal fut toujours les têtes de sape ; ils en incendiaient les blindages, enlevaient les masques et, s'acharnant au gabion farci, ils ne manquaient jamais de tirer à bout portant sur les sapeurs qui le posaient. Les travaux n'en étaient pas moins continués, les dégâts réparés; et ce fut ainsi qu'à force de patience, malgré des obstacles de toute espèce et des luttes continuelles, on parvint à construire les batteries de brèche et à s'établir solidement sur plusieurs points.
Cette guerre de chicanes ne laissait pas que d'être meurtrière, et était prolongée par la facilité avec laquelle les Arabes pouvaient s'introduire dans l'oasis par la partie ouest que nous ne pouvions occuper, et qui, entièrement libre, permettait à Bouzian d'évacuer les blessés et de les remplacer par de nouvelles recrues, formant parfois des contingents nombreux. Ainsi renouvelés, ces soldats improvisés arrivaient avec l'exaltation du fanatisme et avec l'ardeur guerrière du moment, dont ils se hâtaient de donner des preuves, soit en faisant des démonstrations hostiles sur le camp, soit en attaquant à l'improviste quelques parties des tranchées.
Ces nouveaux combattants nous étaient signalés le soir, à leur arrivée, par les cris des femmes, l'aboiement des chiens et par des coups de fusil tirés en signe de réjouissance; ils apportaient avec eux des vivres, de la poudre, et, après quelques jours passés à Lichana ou à Zaatcha, ils s'en retournaient dans leurs tribus pour être remplacés par d'autres. Ce n'était donc pas un ennemi fatigué et découragé que nous avions à combattre, mais bien des hommes pleins d'entrain et excités à la résistance par la voix d'un chef qui les fanatisait, leur répétant sans cesse: " que le chrétien n'entrerait pas plus dans " Zaatcha que dans la Mecque. " On se trouvait donc en face d'un adversaire décidé à ne céder qu'à la dernière extrémité.
CHAPITRE VI.
Arrivée du colonel de BarraI. - Nouvel effectif de la colonne expéditionnaire. - Les Arabes font une sortie et attaquent les tranchées. - Les gens de Tolga et de Lichana attaquent le camp.- Répartition des travaux du siège. - Moyens employés pour combler le fossé.-Mort du capitaine Besse. - Tir de l'artillerie sur l'angle nord-est de la place. - Difficultés que le génie éprouve dans les travaux d'approche. - Nouvelles inquiétantes concernant l'esprit de révolte des Arabes des subdivisions de Sétif et de Batna - Détermination prise de hâter l'assaut. - Réunion des chefs de service. - Brèche de gauche reconnue praticable. - Assertion du colonel Carbuccia.
- Brèche de droite jugée praticable. - Moyens proposés pour le passage du fossé.-L'assaut est décidé.-Ordre donné pour l'assaut. - Formation de deux colonnes d'attaque. Dispositions prises. - Insuccès de l'attaque de gauche.- Combat acharné à l'attaque de droite. -Difficulté du passage du fossé. - Efforts inutiles. - Retraite des troupes. - Pertes en tués et blessés.
La ténacité et l'audace que les Arabes mettaient dans la défense de Zaatcha avaient décidé le général à donner l'ordre au colonel de Barrai de le rejoindre aussitôt qu'il aurait terminé sa mission à Bouçada. Il arriva au camp le 12 octobre, avec une colonne de 1512 hommes de toutes armes. Ce renfort, quoique faible, répandit la joie et l'encouragement parmi les troupes, qui commençaient à se fatiguer; elles avaient en effet peu de repos : les travaux de tranchées, les gardes, les piquets, les convois et les corvées, les tenaient continuellement en mouvement, et les tracasseries incessantes des Arabes leur faisaient passer des nuits sans sommeil. Aussi, l'arrivée de cette colonne fut-elle un bienfait; elle augmenta l'effectif qui avait déjà éprouvé une perte de 200 hommes par le fait du feu de l'ennemi; elle le porta à 2000, force qui, certainement, n'était point encore en rapport avec la résistance que nous opposaient les Arabes.
Ce renfort, tout important qu'il était, ne changea rien à l'esprit de rébellion des habitants du Zab-Dahari, que des secours, récemment venus du dehors, exaltèrent au point que, le lendemain même de l'arrivée de la colonne de Bouçada (13 octobre), les défenseurs de Zaatcha en sortirent à sept heures du soir, dans le plus profond silence; se glissant le long des jardins, ils s'approchèrent sans bruit des tranchées; puis, se précipitant avec une espèce de rage, ils cherchèrent à enlever les gabions et les saucissons des ouvrages , à incendier la tête de sape et même à escalader une batterie. Les troupes les reçurent avec calme, tirèrent peu et repoussèrent ces forcenés de tous les points qu'ils assaillaient. Le colonel Carbuccia, qui remplissait les fonctions de major de tranchées, se fit remarquer par sa grande activité.
Au même moment, les gens de Tolga, excités par les cris des femmes, quittaient leur oasis, et, profitant de toutes les sinuosités du terrain, arrivaient à environ 400 mètres du camp, où ils essayèrent de jeter le désordre en dirigeant leurs feux sur l'emplacement qu'occupaient les bêtes de somme et les goums du cheik El-Arab. De leur côté, les habitants de Lichana, se dirigeant sur Aïn-Meïoub, firent une tentative pour enlever le poste qui y était placé, afin de couper la communication du camp à la Zaouïa. Les gardes avancées suffirent pour repousser ces attaques, et les Arabes, s'apercevant que leur feu n'avait causé aucun trouble dans le camp, se retirèrent en emportant, comme à leur ordinaire, leurs tués et blessés, dont nous ignorions toujours le nombre : notre perte fut de deux tués et huit blessés.
(Planche III.) Le détachement du génie, ayant reçu, par l'arrivée de cette colonne, deux officiers et vingt et un hommes; il fut alors possible de répartir la direction des attaques entre le capitaine Graillet, nouvellement arrivé, qui eut celle de droite, et le capitaine Charles, qui conserva celle de gauche (Le colonel Petit avait conservé la haute direction des travaux du siège). Cette répartition, tout en excitant l'émulation, donna plus de suite aux travaux de ce siège, que l'on était forcé d'entreprendre au milieu d'une oasis, où les difficultés inhérentes au sol étaient encore augmentées par l'insuffisance des moyens dont nous pouvions disposer.
De ces deux attaques, celle de gauche, qui avait été entreprise la première et sur laquelle au premier abord toute l'attention avait été portée, était arrivée sur la contre-escarpe, d'où l'on put reconnaître le fossé, dont la largeur fut trouvée de 8 à 9 mètres et ayant 1 mètre 60 c. d'eau. Ce travail d'approche vers le sud-est avait été souvent inquiété par le feu plongeant de la place et par les pierres que les assiégés lançaient sans cesse dans les tranchées; et comme, à mesure que l'on avançait, le danger devenait plus imminent, on avait été forcé, pour se mettre à l'abri de ces projectiles, de blinder la tête du cheminement, que l'on couvrit avec des fascines en branches de palmier.
Pendant que le génie poussait sans relâche ses travaux vers la place, l'artillerie avait construit une nouvelle batterie (N°5) et perfectionné celles déjà établies, dont le feu dirigé sur les constructions de l'angle sud-est déjà endommagées y causa des éboulements. Il en résulta une brèche, que l'on jugea praticable pour l'assaut; mais à laquelle on ne pouvait parvenir qu'après avoir comblé le fossé.
Cette opération, longue et pénible, fut immédiatement entreprise, et on se servit à cet effet des moellons et des briques provenant de la démolition des maisons de la Zaouïa, que l'on fit passer de main en main jusqu'à la tête de sape, dont on essaya d'écarter le masque pour les jeter dans le fossé. Cet essai fut abandonné, parce que les assiégés, qui s'étaient logés dans les parties basses des maisons abattues au milieu des décombres, profitèrent de cette ouverture pour faire un feu parfaitement dirigé, qui blessa grièvement plusieurs sapeurs du génie, et refoula dans les lignes tous les hommes qui occupaient la tête de sape; alors on disposa celle-ci, ainsi que le blindage, de manière à pouvoir jeter les pierres par-dessus le parapet, tout en se défilant des feux du rempart.
Les Arabes, qui voyaient les travaux d'approche arriver près de leurs murailles, tentèrent de nouveau une attaque assez vive qu'ils étendirent même jusque sur le camp, et, pour assurer leur tir, ils allumèrent de grands feux dans le but d'éclairer les tranchées. Les soldats ne s'en étonnèrent pas, s'abritèrent derrière les murs et la fusillade des assiégés ne produisit que très-peu d'effet. Le travail du comblement du fossé, ainsi que la construction d'un cavalier de tranchée, destiné à éteindre le feu de la mousqueterie de la place, n'en furent point arrêtés.
Quant aux travaux de l'attaque de droite, ils furent conduits avec la même activité que ceux de gauche, et s'ils n'arrivèrent pas jusqu'au fossé, cela provint du manque de matériaux et des grandes difficultés que l'on rencontra à chaque pas : car rien ne fut négligé pour rendre la partie nord-est de la place aussi accessible à l'assaut que celle du sud-est.
L'artillerie, aussitôt qu'il fut décidé qu'une batterie serait établie sur l'emplacement du jardin N°12 occupé le 12 octobre, se mit à l'œuvre, et, dès le 14, cette batterie construite et armée ouvrit son feu sur l'angle nord-est du village. C'est au moment où il allait commencer que le capitaine Besse, en examinant la direction donnée à la pièce de droite, fut frappé d'une balle au-dessus de l'œil gauche, qui le tua sur le coup. La batterie porta son nom.
Le tir de cette batterie fut dirigé sur une tour carrée, solidement construite, dont les quatre angles plus élevés lui donnaient l'apparence d'un donjon. Les feux de cette tour, dominant tous les environs, rendaient de ce côté tous les travaux d'approche extrêmement périlleux. Cette tour, étant masquée sur la moitié de sa hauteur par plusieurs maisons dont les murs étaient fort épais, l'artillerie dirigea des boulets et ensuite des obus à charges réduites, de manière à y causer de grands dégâts et des éboulements considérables. Une fois abattues, les décombres s'étendirent jusqu'au bord du fossé et la tour ayant fini par s'écrouler, la brèche fut jugée aussi praticable que celle de gauche.
Le génie, pendant ce temps, s'était emparé de deux nouveaux jardins pour couvrir la batterie Besse et celle n° 6, ainsi que ses propres travaux.
Après les avoir mis en état de défense il avait commencé un débouché près de la batterie Besse pour approcher de l'angle nord-est du village. Mais le manque de matériaux nécessaires pour l'établissement de la sape et les obstacles du terrain, planté d'arbrisseaux et traversé par une multitude de canaux d'irrigation, présentèrent des difficultés tellement nombreuses que le cheminement exécuté d'ailleurs sous les feux plongeants de la place et sous une grêle de pierres, ne marcha seulement que de un ou deux mètres par vingt-quatre heures. Il n'y a pas à s'étonner de cette lenteur, quand on pense que pour faire rouler le gabion farci, il fallait couper des arbres de toute espèce et que les parapets étaient faits en troncs de palmiers.
Les travaux d'approche de l'attaque de droite n'étaient point encore terminés, lorsque, le 18 octobre, des nouvelles plus ou moins inquiétantes arrivèrent au général sur l'esprit de révolte, qui se manifestait dans quelques parties de la subdivision de Sétif et principalement dans celle de Batna, où les Arabes, encouragés par la longueur du siège de Zaatcha, ne craignaient pas de donner des preuves ostensibles d'hostilité.
Ainsi, à Bouçada, dépendant de Sétif, une partie des habitants avait essayé un coup de main contre la faible garnison que l'on y avait laissée, et l'on apprenait que les Ali-ben-Sabors, du cercle de Batna, avaient assassiné des bûcherons français. Avis était aussi donné par les cheiks du Bélezma que, malgré les ordres du général, les nomades se disposaient à forcer le passage du Tell au Sahara, pour venir en aide à leurs frères des oasis. Le bureau arabe de Biskra le prévenait en même temps que l'on parlait de nouveau du chérif Abd-el-Afid, qui, depuis sa défaite de Sériana, s'était retiré à K'baich, et que les gens de l'Aurès se disposaient à intercepter la communication entre Batna et Biskra. Enfin, le caïd Ben-Chenouff, de Sidi-Okba, lui écrivait que Hamed-bel-Hadje, ancien khalifat d'Abd-el-Kader, travaillait les esprits des habitants de cette oasis, où il avait conservé des relations suivies. Toutes ces nouvelles, dont quelques-unes s'étaient déjà vérifiées, étaient beaucoup trop graves pour que le général ne s'efforçât pas de couper court à ces germes d'insurrection.
Les complications dans l'expédition des Ziban, qui devaient résulter du soulèvement de tribus situées sur ses derrières et surtout de l'arrivée des nomades dans le Sahara, déterminèrent le général à hâter l'assaut, malgré que les travaux d'approche ne fussent pas entièrement terminés. Cependant avant de prendre une décision définitive, il voulut s'assurer s'ils étaient assez avancés pour que le succès ne fût pas douteux. Dans ce but, le 19 octobre, tous les chefs de service furent réunis, et après leur avoir donné connaissance des nouvelles qu'il avait reçues, il leur fit part de ses intentions d'en finir immédiatement avec ce K'sour rebelle.
Le général demanda alors, si la brèche de gauche qui, le 14 octobre, avait été jugée suffisante, était réellement praticable. Le capitaine du génie, chargé des attaques de gauche, répondit affirmativement; il fut vigoureusement appuyé dans cette assertion par le colonel Carbuccia qui, comme chef permanent du service de tranchée depuis la blessure du colonel Petit, déclara avoir fait reconnaître la brèche. Quant à la partie du fossé qui faisait face à cette brèche, comme elle avait été entièrement comblée, le passage en était assuré.
La brèche de droite avait été également jugée praticable; mais les travaux d'approche n'étant encore qu'à 20 mètres de la contre-escarpe, il n'y avait pas de passage de fossé en avant de la brèche ouverte à l'angle nord-est, et l'on n'était pas en mesure de l'établir avant huit jours, à cause des grandes difficultés que l'on éprouvait pour avancer sur cet angle : laps de temps fort long, vu les événements ultérieurs qui pouvaient survenir, et le désir que chacun avait de voir la fin de ces combats de jardins, où le courage avait peine à lutter contre la ruse, et qui augmentaient journellement nos pertes en tués et surtout en blessés.
Cependant malgré tous les motifs qui portaient à l'assaut, il fallait avant de rien entreprendre, avoir la certitude de pouvoir atteindre la brèche en fit l'observation à laquelle le capitaine du génie chargé de l'attaque de droite, répondit : " que le passage du fossé ne devait pas nous arrêter, qu'il avait trouvé un excellent moyen, consistant dans une longue voiture à deux roues, appartenant à un voiturier civil, sur laquelle il ferait placer d'avance de longues planches, et qui jetée à travers le fossé, formerait un passage facile pour les troupes ". Cette assertion fit cesser toute hésitation, et tous les officiers, chefs de service, moins un (Le colonel du 2ème de ligne.), se prononcèrent pour l'assaut, persuadés d'ailleurs que s'il ne réussissait pas parfaitement de ce côté, il n'en serait pas moins une démonstration offensive, qui contribuerait au succès de l'attaque de gauche, dont on attendait le plus grand résultat. Cette question étant résolue, il fut décidé que l'assaut aurait lieu le lendemain, 20 octobre.
Ce parti une fois pris, des ordres furent donnés pour la formation de deux colonnes d'attaque.
Le commandement de celle de droite fut confié au colonel du 43ème de ligne, qui, après avoir franchi la brèche, devait faire tous ses efforts pour se loger dans la maison crénelée faisant face à ladite brèche, et lancer ensuite ses troupes dans le village. Il avait en outre reçu l'ordre de tourner Zaatcha par la droite, en faisant filer le long des jardins les hommes du bataillon d'Afrique, après les avoir prévenus que les tirailleurs indigènes exécutaient un mouvement analogue du côté opposé.
Le colonel Carbuccia, qui avait fait preuve de la plus grande activité depuis le commencement du siège, eut le commandement de la colonne de gauche, dont faisait partie le bataillon de son régiment (légion étrangère); il avait l'ordre de franchir la brèche qu'il avait fait reconnaître, et de ne se porter en avant qu'après s'être assuré d'un réduit.
Le commandant Bourbaki, des tirailleurs indigènes, devait partir au réveil, ayant pour mission de chercher à gagner par la gauche, dans les jardins, pour couper toute communication entre Lichana et Zaatcha, et investir momentanément cette dernière place en rapprochant sa gauche de la droite du bataillon d'Afrique.
Le colonel de Mirbeck, commandant la cavalerie, était chargé de parcourir les alentours de l'oasis pour surveiller les gens de Tolga et devait se porter partout où il croirait sa présence nécessaire. Les recommandations les plus précises avaient été faites aux goums, pour qu'ils ne se trouvassent pas en face des troupes, afin d'éviter toute méprise.
Le colonel de Barral, du 38ème de ligne, avait l'ordre de prendre le commandement du camp et des réserves, de disposer ses troupes dans la prévision que, pendant l'assaut, les gens du Zab-Dahari pourraient, comme ils l'avaient déjà fait, venir inquiéter le camp, se jeter sur nos flancs, et chercher à intercepter les communications avec les tranchées. Il devait aussi occuper l'attention des habitants de Lichana en envoyant de forts détachements le long de l'oasis et en lançant quelques bombes dans le village.
Tous les ordres ayant été donnés et communiqués aux troupes le 19 au soir; le lendemain, le général se rendit à la pointe du jour, au cavalier de tranchée près la batterie Besse, pour être à portée des deux attaques. Au même instant, le lieutenant-colonel Pariset fit ouvrir le feu de ses batteries et, a 5 heures et demie, les colonnes étaient rendues aux divers emplacements qui leur avaient été assignés. A six heures, l'artillerie augmenta l'intensité de son feu. et aussitôt que le général fut informé que le commandant Bourbaki avait achevé son mouvement d'investissement, il fit sonner la charge ; à ce signal, les troupes désignées pour monter à l'assaut se portèrent avec la plus grande rapidité vers les brèches qu'elles devaient franchir.
A l'attaque de gauche, l'élan des deux compagnies d'élite de la légion étrangère, commandées par le capitaine Padro, fut arrêté par le mantelet, ou masque, fermant l'entrée de la sape, qu'on ne pouvait renverser et qui, après même qu'il fut tombé, embarrassa le débouché au point que les hommes furent forcés de traverser le fossé un par un ; ils s'élancèrent ensuite sur la brèche, où ils furent accueillis par un feu très nourri et à bout portant. La compagnie de voltigeurs, sans s'arrêter, se précipita sur les décombres où, étant arrivée, elle ne trouva plus d'issue; ne sachant de quel côté se diriger, elle resta en but à un feu de flanc qui la décima. Dix voltigeurs, cependant, parvinrent à s'établir sur une terrasse, où ils furent presque entièrement engloutis par un éboulement, dont l'effet jeta le désordre parmi les assaillants qui se portèrent spontanément en arrière.
Ce mouvement rétrograde résultat de l'instinct naturel, n'aurait probablement pas eu lieu, si ces deux compagnies avaient été appuyées, lorsque arrivées sur la brèche elles cherchaient à s'y maintenir; mais ne se voyant pas soutenues et ayant eu dans une lutte d'un moment 13 hommes tués et 40 blessés, dont le brave capitaine Padro, elles se rejetèrent au pas de course dans la tranchée. Les Arabes, enhardis par cette retraite précipitée, sortirent de tous les trous où ils se tenaient blottis, et se mirent à leur poursuite; arrêtés d'abord à la tête de sape et ensuite repoussés par une compagnie du 5ème bataillon de chasseurs à pied, ils se retirèrent à la hâte, abandonnant quelques morts.
Si ce retour offensif avait été vigoureusement poussé, peut-être aurait-on pu arriver aux premières maisons, en même temps que les fuyards et s'y établir; mais il n'en fut pas ainsi, aucune impulsion n'ayant été donnée; et le colonel, chargé de l'attaque de gauche, au lieu de prendre l'initiative, vint lui-même, annoncer au général (M. le lieutenant-colonel Pariset, le capitaine Lebœuf, officier d'ordonnance, le capitaine Gresley, aide de camp, étaient avec le général.) la retraite des compagnies d'élite qui s'étaient portées bravement sur la brèche et demander des ordres. Cette nouvelle inattendue causa le plus grand étonnement et détruisit la confiance que l'on avait mise dans le succès de l'attaque de gauche.
Quant aux ordres à donner, le général se transporta de suite au pied de la brèche pour s'assurer quelle était la gravité de cet échec et voir s'il y avait moyen de le réparer. Il lui parut évident que le moment opportun pour un retour offensif n'ayant point été saisi, on avait perdu un temps précieux, et que c'était un second assaut qu'il fallait livrer pour atteindre les Arabes de nouveau retranchés dans leurs maisons. Opération fort grave, dont le succès était en ce moment douteux et à laquelle il dut renoncer ; car, à peine arrivé à l'attaque de gauche, il fut appelé à celle de droite, où il y avait un choc terrible entre les assiégeants et les assiégés. Ne pouvant se trouver en même temps aux deux attaques, il ordonna donc de se tenir prêt à tout événement, de relever les parapets, de rétablir le masque pour remettre la tranchée à l'abri de toute surprise de l'ennemi, et il se rendit à la brèche Nord.
A cette attaque de droite, les troupes d'assaut avaient un grand obstacle à surmonter dans le passage du fossé que les Arabes défendaient avec la plus grande énergie ; ce fossé n'ayant point été comblé, le génie avait cru, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il pourrait être franchi facilement en établissant une passerelle au moyen d'une charrette civile; cet essai n'avait pas été heureux, car, à sa descente dans l'eau, ce lourd véhicule ayant tourné sur lui-même, fut à demi renversé et placé parallèlement au mur d'enceinte. Cet obstacle imprévu ne put cependant pas arrêter l'élan des grenadiers du 43e de ligne, qui, n'écoutant que leur ardeur, se précipitèrent dans le fossé, malgré 1 mètre 30 cent. d'eau de profondeur, le traversèrent avec beaucoup de peine, gravirent l'escarpe et parvinrent à s'établir sur une berme de 1 mètre 50 cent. de largeur, où ils furent reçus à bout portant par des feux partant de tous les côtés, auxquels ils ne purent répondre, la plupart d'entre eux ayant leurs cartouches mouillées.
La passerelle projetée étant devenue inutile, l'artillerie, sans perdre de temps, essaya de la remplacer par un pont léger qu'elle avait préparé; mais les hommes qui le portaient furent tués ou blessés avant d'arriver au fossé. Alors le capitaine Graillet et le sergent-major Ribes, du génie, animés d'un entrain vraiment héroïque, se jetèrent à l'eau pour chercher un passage plus guéable que le premier ; ils en reconnurent un de 1 mètre 15 cent. de profondeur.
A la vue de cet acte de bravoure, les soldats du 43ème, entraînés par l'exemple, mettent leurs cartouches sur leurs épaules, prennent la direction qui leur est indiquée, traversent le fossé et arrivent sur le talus d'escarpe qu'ils trouvent très-roide et très-glissant ; cependant, ils finissent par le franchir, et, aussi vite que peuvent le permettre leurs vêtements mouillés, ils gravissent les pentes de la brèche, qui sont moins praticables qu'on ne l'avait cru. Aussi, ce n'est qu'après les plus grands efforts, que plusieurs de ces braves gens atteignent le sommet, où ils cherchent à se maintenir, bien qu'aucun débouché ne s'ouvrît devant eux.
Malheureusement, ils ne purent être appuyés, car, quoique les troupes fussent animées de la plus énergique volonté, leur élan et leur entrain s'épuisaient en peines inutiles; la rampe près du fossé, formée de décombres, était tellement détrempée qu'elle était devenue impraticable; en outre, leurs habits trempés d'eau paralysaient leurs mouvements, et ce n'était qu'en se cramponnant aux moindres aspérités qu'ils pouvaient avancer sous le feu d'un ennemi entièrement caché et dont les coups étaient d'autant plus meurtriers qu'ils étaient tirés de très-près.
Il y avait plus d'une heure que ce combat inégal durait, sans que le 43ème pliât, mais il n'avançait pas, et déjà il comptait 17 tués et 80 blessés, dont 4 capitaines, 2 lieutenants et le chef de bataillon Guyot, la plupart mortellement.
Tous, frappés en cherchant à gagner le haut de la brèche, étaient revenus tomber presque à nos pieds. Le général était sur le bord du fossé, du côté de la contre escarpe, ayant près de lui le colonel du 43ème, son chef d'état-major, le colonel de Bretzel, et le lieutenant-colonel Pariset.
Après des pertes aussi sensibles, le général étant convaincu des difficultés matérielles que présentait un pareil assaut, fit enlever tous les blessés et ordonna au bataillon du 43ème de se replier sous la protection du 1er bataillon de zouaves, dont une compagnie alla s'établir sur la contre scarpe.
Le commandant Bourbaki, pendant que ces combats avaient lieu, fut attaqué assez vivement par les gens de Lichana, qui furent repoussés par le bataillon des tirailleurs indigènes ; il y eut de part et d'autre quelques tués et blessés. Quant aux habitants de Farfar, et de Tolga, ils sortirent de leurs villages et se portèrent en armes sur la lisière de leurs oasis ; mais, quand ils virent la cavalerie du colonel de Mirbeck et les dispositions prises par le colonel de Barrai, ils hésitèrent un instant et finirent par se retirer après avoir échangé quelques coups de fusil.
Les pertes de cette journée s'élevèrent à 45 tués et 147 blessés. Le 43ème de ligne eut à regretter le commandant Guyot, les capitaines Berthe, adjudant-major, Héros et Prévost, tous quatre morts à la suite de leurs blessures.
Ce nouvel échec jeta une espèce de consternation dans le camp, et, sous cette impression, on l'attribua uniquement à l'énergie de la défense, sans trop tenir compte des difficultés du passage du fossé, qui, en empêchant les deux colonnes, au signal donné, d'agir simultanément, avaient arrêté leur impulsion et avaient contribué à la faiblesse de l'attaque. Ces causes déterminèrent le général à ne pas prolonger plus longtemps cette lutte déjà trop meurtrière, et à remettre à un autre moment la prise de Zaatcha.
Il n'y avait pas à s'abuser sur les conséquences ultérieures de cet insuccès, qui avait été le résultat de l'idée généralement répandue que jamais les habitants de Zaatcha ne s'exposeraient à la prise de leur village, et que leur résistance cesserait du moment qu'ils verraient quelques pans de murailles abattus.
Mais la soumission n'a pas eu lieu et, si la résistance a continué, c'est que la colonne expéditionnaire n'avait pas les moyens nécessaires pour cette guerre d'oasis et pour le siège d'un village retranché au milieu d'une forêt de palmiers et défendu avec un acharnement sans exemple.
L'effectif en infanterie était insuffisant pour tous les services à fournir ; le génie manquait de matériel et son personnel, surtout en officiers, était beaucoup trop restreint pour les travaux de cheminement que l'on avait à exécuter. L'effectif des sapeurs disponibles pour les travaux de sape, fut, après la réunion de tous les détachements, de 100 à 105; celui des officiers de 3 à 4. Cependant, ces braves officiers, quoique continuellement exposés aux coups d'un ennemi qui les guettait comme une proie, n'en étaient pas moins sur pied jour et nuit, donnant l'exemple d'une grande abnégation; et, si les travaux d'approche n'étaient ni achevés ni perfectionnés au moment de l'assaut, cela tenait à des obstacles imprévus, au manque de bras, de matériel et aussi à l'absence du brave colonel Petit, qui, dirigeant les travaux de son lit de douleur, ne pouvait rien voir par lui-même; sa grande expérience fit donc défaut, surtout dans les derniers jours.
L'artillerie avait, de son côté, fait preuve d'énergie dans la construction de ses batteries, et, si la grande quantité de projectiles lancés n'avait pas produit l'effet qu'on devait en attendre, on né doit l'attribuer qu'à un armement insuffisant, à des munitions qui, datant du siège de Constantine, s'étaient avariées dans les magasins (Des quantités de projectiles creux furent trouvés plus tard dans la place, n'ayant pas éclaté.), et à la difficulté de diriger le tir avec succès sur des murs qui étaient entièrement cachés par les palmiers.
L'assaut n'aurait pas été prématuré, si les brèches avaient été praticables, ainsi qu'on l'avait espéré. Du reste, on ne connaissait pas encore complètement, à cette époque, l'homme énergique qui, par son ascendant sur ses coreligionnaires, nous opposait une si grande résistance. Après le 20 octobre seulement, on put se convaincre qu'il ne fallait pas espérer de voir les Arabes se soumettre devant une énergique démonstration, et que, pour se rendre maître de Zaatcha, il fallait en aller chercher les défenseurs jusqu'au fond de leurs demeures.
CHAPITRE VII.
L'insurrection s'étend dans le sud. - Continuation du siège.- Dispositions prises pour donner du repos aux hommes - L'artillerie exhausse ses batteries. - Construction d'une galerie blindée. - Communication entreprise entre la ZaouÏa et l'angle nord-est de la place. - Les Arabes commencent à inquiéter les convois. - Le colonel de Mirbeck envoyé au défilé d'El-Outaïa. - Mesure prise pour assurer les communications. - Abatage des palmiers. -Précautions à prendre pour couvrir les travailleurs. - Arrivée du prince Pierre Bonaparte. Sa conduite le 26 octobre, son départ. - Mort du capitaine Graillet, du génie. - Le capitaine Charles est chargé de la direction des deux attaques.
Le premier assaut n'ayant pas réussi, les défendeurs de Zaatcha encouragés par ce succès, devinrent plus audacieux et leur fanatisme s'en accrut, ainsi que l'influence de Bouzian dont la sainteté ne fut plus mise en doute chez les Arabes qui le considérèrent comme le protégé du prophète et le véritable étendard de la guerre sainte. Aussi, dès que la nouvelle de notre insuccès se fut répandue dans la province, le nombre de ses partisans augmenta, et des intentions hostiles se manifestèrent hautement dans toutes les oasis qui avoisinaient le Zab-Dahari : alors commença une série d'événements qui, en compliquant les opérations du siège, rendirent la position de la colonne expéditionnaire très-difficile.
Le général n'ayant pas à hésiter sur le parti à prendre, réunit de nouveau MM. les chefs de service pour leur faire part de sa ferme résolution de ne se retirer de devant Zaatcha qu'après la destruction de ce foyer de tous les soulèvements qui avaient lieu; foyer qui, abandonné par ses habitants, n'était plus que le repaire de fanatiques exaltés et de gens sans aveu, accourus à l'appel d'un imposteur habile. II ne leur dissimula pas, que ce n'était pas seulement contre ces rebelles que l'on allait avoir à lutter, mais encore contre les tribus qui nous entouraient. Il les prévint qu'une demande était faite à M. le gouverneur général pour que des troupes fussent envoyées dans le plus bref délai, et que l'on avait écrit à Constantine pour que des vivres et des munitions fussent expédiés sans retard.
La continuation du siège étant résolue, le premier soin à prendre fut de mettre le nombre des hommes à fournir pour les différents services en rapport avec un effectif bien diminué par les maladies et par le feu de l'ennemi ; ce qui nécessita l'abandon d'une partie des jardins extérieurs au front d'attaque. Cette suppression, en retirant un grand développement de murs à garder, réduisit de beaucoup le nombre des factionnaires et permit de donner quelque repos à la troupe.
Il fut donc arrêté avec l'artillerie que, jusqu'à l'arrivée des munitions, un tir lent serait continué sur le village de manière à y entretenir l'inquiétude, et que ce tir aurait aussi pour but d'élargir et d'approfondir les brèches qui n'étaient point aussi praticables qu'on l'avait cru ; car il fut reconnu que les projectiles en frappant les murs des maisons, sans en avoir atteint le pied, n'avaient produit que des amas de décombres derrière lesquels s'étaient blottis les assiégés pour tirer sur les hommes montant à l'assaut. On constata en même temps que le calibre des pièces employées était trop faible pour agir efficacement sur des constructions aussi solides que celles de ce village et que les terrasses fort épaisses étaient à l'épreuve des bombes de 0,16 centimètres.
Il y avait donc eu erreur dans l'appréciation de la force de résistance des murs de cette espèce de château féodal, contre lesquels les projectiles n'avaient produit que peu d'effet ; l'artillerie chercha immédiatement à rendre son tir plus destructif, en exhaussant ses batteries, afin de mieux découvrir le pied des murs, le sommet des brèches et de battre plus au loin l'intérieur du village avec des pièces de 12 que le général avait demandées à Constantine.
(Planche 111.) Le génie reprit les travaux du siège, et bien qu'il ne pût, pour le moment, les avancer que lentement, il entreprit de suite, à l'attaque de gauche, la construction d'une galerie blindée pour aller placer deux fourneaux de mine sous les premières maisons du village d'où était parti le cercle de feu qui avait forcé les deux compagnies de la légion étrangère à se retirer rapidement. On commença en même temps un cheminement pour établir une nouvelle batterie (N° 7. La batterie N° 7 n'est pas indiquée sur la carte ; elle figure à gauche du jardin n° 2) destinée à contre-battre les feux de la place, qui gênaient beaucoup l'établissement de cette galerie. Ces travaux furent vigoureusement inquiétés par les Arabes, qui comprenaient quel en était le but.
A l'attaque de droite, le cheminement vers l'angle nord-est de la place fut continué malgré les difficultés du terrain ; il fut souvent retardé par le feu plongeant du village et par les pierres que l'ennemi faisait sans cesse pleuvoir dans la tranchée et dont on ne pouvait se mettre à l'abri que par un blindage fait avec des fascines en branches de palmiers. Ce travail pénible n'empêcha pas d'établir la grande communication à droite de la Zaouïa, pour faire arriver en face de la brèche de droite les pierres nécessaires au comblement du fossé, dont le passage avait rompu, dès le début, l'ensemble des troupes et neutralisé leur élan.
Le service des transports s'était toujours fait avec la plus grande régularité et n'avait point encore été inquiété ; lorsque le 22 octobre des groupes nombreux d'Arabes se montrèrent de tous côtés pour attaquer le convoi des malades et des blessés, dirigé sur Biskra; cachés derrière des plis du terrain, ou réunis sur la lisière des oasis, ils y attendaient avec la convoitise de la haine et du gain le moment de se jeter sur ce convoi, auquel s'étaient jointes des cantinières allant aux provisions: ils en furent empêchés par la bonne contenance de l'escorte qui rendit leur entreprise inutile.
Ce même jour 22 octobre le général apprenait par lettre du commandant de Batna que les montagnards de l'Aurès, au nombre de 4 à 500, étaient descendus dans la vallée d'El-Outaïa, pour guetter le passage des convois qu'ils avaient déjà plusieurs fois harcelés; il le prévenait en même temps qu'un envoi de poudre était dirigé sur Biskra, où il devait parvenir le 26 octobre, et qu'if serait urgent d'en assurer l'arrivée ; car les Arabes attachant beaucoup de prix à l'enlèvement d'un pareil transport l'attaqueraient probablement avec vigueur.
Il n'y avait donc pas de temps à perdre ; aussi à la pointe du jour le colonel de Mirbeck avec 150 chasseurs et 40 spahis partit du camp pour se rendre au défilé d'El-Outaïa, où il arriva presque en même temps que le convoi. Les Arabes, à la vue de cette cavalerie survenant inopinément, abandonnèrent leur projet et se retirèrent sans cependant s'éloigner beaucoup.
Les Chaouïas ( Les montagnards du Djebel-Aurès sont connus sous le nom de Chaouïas.):de l'Aurès, réunis à quelques groupes des Ben-Solthan et des Lakdars, étaient un voisinage très-dangereux pour la route, qu'ils pouvaient intercepter d'un moment à l'autre, et pour les convois dont ils épiaient le passage. Il fallait donc déjouer leur projet, en leur opposant la vigilance et la promptitude. Le colonel de Mirbeck fut chargé de cette mission, en l'investissant du commandement du peu de troupes laissées à Batna et à Biskra, et en l'autorisant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la route et la sécurité des alentours.
Toutes ces tentatives plus ou moins menaçantes, qui avaient pour but de couper les communications du camp à Biskra, et de Biskra à Batna, ou de les rendre très-difficiles, étaient de la plus grande gravité et compliquaient énormément les opérations du siège. Il fallut cependant faire face à ces nouvelles difficultés, tout en continuant les travaux entrepris pour abattre les obstacles matériels qui nous arrêtaient devant la place de Zaatcha, dont les défenseurs étaient plus que jamais secondés ostensiblement par les habitants des oasis les plus rapprochées, surtout par ceux de Lichana, qui alimentaient la résistance en recevant et en hébergeant les gens venant de tous côtés pour se joindre à Bouzian.
Cette conduite des plus hostiles, manifestée avec arrogance, était d'un exemple déplorable, et comme on ne pouvait atteindre les coupables qu'en les attaquant par leurs intérêts, le général prit donc le parti de faire abattre leurs palmiers, principale fortune du pays. Ce moyen, que les beys de Constantine avaient été forcés d'employer pour soumettre les oasis rebelles, ayant eu alors quelques succès, il espérait que cette mesure rendrait les Arabes de Lichana beaucoup moins audacieux et les engagerait peut-être à rompre avec ceux de Zaatcha.
L'abatage des palmiers n'était point chose nouvelle; on y avait eu recours dès le jour de notre arrivée, dans le but de déblayer le terrain sur lequel le génie entreprenait ses travaux de cheminement, de se procurer les bois nécessaires à la construction des batteries et de débiter des rondins pour remplacer les sacs à terre qui manquaient. On avait aussi abattu quelques groupes, les moins éloignés du camp, qui compromettaient la circulation. Ces diverses coupes s'étaient faites jusque-là sans difficultés; mais il n'en fut pas de même lorsqu'on s'éloigna du camp; les habitants propriétaires, se trouvant plus à l'abri de nos coups, se réunirent et ne laissèrent pas la hache frapper leurs dattiers, sans une vive opposition.
Chaque opération de cette nature devenait un véritable combat, si, avant de la commencer, on n'avait pas eu le plus grand soin d'occuper tous les murs qui entouraient le point où l'abatage des palmiers devait avoir lieu, et d'y placer avec intelligence des troupes, non-seulement pour protéger les travailleurs, mais encore pour fermer toute issue aux Arabes. Ces dispositions prises, le travail se faisait dans le plus profond silence ; on n'entendait que le bruit de la hache et celui de l'arbre, qui, coupé à sa base, tombait lourdement; mais si la moindre négligence avait été commise, l'indigène en profitait pour se glisser entre les travailleurs et les postes, et, au moment où l'on était le plus occupé, une vive fusillade éclatait; les hommes surpris quittaient le travail avec précipitation et les troupes destinées à les soutenir, prises entre deux feux, avaient alors une lutte à soutenir pour rentrer au camp.
Ce fut à cette époque que le prince Pierre Bonaparte rejoignit la colonne expéditionnaire; il prit le commandement du bataillon de la légion étrangère, et, le lendemain de son arrivée (22 octobre), il fut commandé de tranchée, où on le vit prendre son service avec un air de gaieté, d'assurance et de franchise qui plut à tous. Aussi, quand deux jours après, dans une circonstance très-difficile, il déploya la plus grande vigueur et qu'il donna l'exemple du plus grand sang froid, personne n'en fut étonné.
(Planche II.) L'ordre ayant été donné d'abattre le massif de palmiers le plus rapproché de la gauche du camp, le 25 octobre, à 7 heures du matin, 200 hommes de la légion étrangère et 200 du 3ème bataillon d'Afrique partirent de la tranchée sous les ordres du commandant Bonaparte et dirigés par le colonel Carbuccia. Ils occupèrent les jardins qui étaient à la tête de l'Oued Kelbi, pour de là être répartis de manière à protéger les travailleurs.
Le colonel, a près avoir pris toutes les dispositions qu'il crut nécessaires pour se garantir des coups de l'ennemi, fit commencer le travail que l'on continua quelque temps sans être inquiété.
Mais les Arabes s'étant cachés pour suivre tous nos mouvements, se réunirent peu à peu et principalement au saillant du mur qui s'étend jusqu'à la plaine, et, lorsqu'ils se virent en nombre, ils débusquèrent tout à coup et attaquèrent avec vigueur le poste chargé de la surveillance de ce point. Le capitaine Buttet, du 38ème bataillon d'Afrique, qui commandait ce poste, fut blessé dès les premiers coups de feu; deux chasseurs furent tués près de lui et plusieurs autres blessés. Cette position importante, assaillie de tous côtés, fut alors abandonnée, et les Arabes, n'étant plus arrêtés, s'élancèrent immédiatement sur le mur, parurent sur tous les points et se glissèrent entre les postes et les travailleurs.
Surpris d'une attaque aussi imprévue, les différents postes de la légion étrangère et du bataillon d'Afrique s'exagérèrent le danger et, par une retraite précipitée, laissèrent à découvert les travailleurs, qui, ne se voyant plus appuyés, cherchèrent à se mettre au plus vite à l'abri des coups de fusil, de pistolet, et à se garantir des pierres dont ils étaient atteints. Ce fut alors que le prince Bonaparte se mit à la tête de vingt-cinq grenadiers de la légion étrangère, qui formaient un peloton de réserve, commandé par le capitaine Niko; il rétablit l'ordre, soutint le détachement du bataillon d'Afrique, arracha le corps d'un grenadier des mains d'un Arabe qu'il tua d'un coup de pistolet, et alla ensuite prendre position dans un jardin à trente mètres du mur que nous avions quitté; il s'y maintint et arrêta l'ennemi. Dans le même moment le sergent Shmitter, placé à peu de distance sur un petit mamelon avec dix grenadiers, s'y faisait tuer en résistant bravement aux Arabes qui étaient venus l'attaquer.
Aussitôt que le général fut informé de ce qui se passait, il se rendit sur les lieux avec le bataillon du 1er zouaves et celui des tirailleurs indigènes qu'il fit dirigera droite et à gauche des jardins, pour cerner les Arabes, et, pendant que ce mouvement s'opérait, l'ordre fut donné au colonel Carbuccia de battre en retraite, ce qu'il fit sous la protection des deux bataillons qui étaient venus à son aide. Quant aux Arabes, ils se retirèrent lorsqu'ils virent de nouvelles troupes et la direction qu'elles prenaient. Les corps de deux soldats, une caisse de tambour et des outils restèrent dans leurs mains.
Notre perte fut de six tués et de vingt-deux blessés, dont trois officiers ; elle eût été plus considérable sans la présence d'esprit et le sang froid du prince Bonaparte, qui, quelques jours après, dut quitter la colonne expéditionnaire des Ziban pour se rendre à l'Assemblée nationale.
Cette interruption dans l'abatage des palmiers, les outils abandonnés et la retraite un peu trop prompte des troupes avaient donné aux Arabes une grande confiance dans leurs forces; le général ne voulut pas les laisser longtemps dans ces dispositions d'esprit, et le lendemain (26 octobre), à la pointe du jour, il fit reprendre cette opération sous la direction du chef de bataillon Bourbaki, qui plaça lui-même les postes, échelonna les tirailleurs et fit occuper les murs avec un tel soin, toutes les issues furent si bien fermées, que quand les Arabes, encouragés par le succès de la veille, se montrèrent pour nous inquiéter, ils furent reçus par un feu si vif qu'ils s'éloignèrent de suite et ne tirèrent que de fort loin. Les travailleurs purent donc remplir leur tâche avec sécurité, et 150 hommes du bataillon indigène, relevés d'heure en heure par le même nombre, abattirent en quatre heures et demie le rideau épais de palmiers qui permettaient aux gens de Lichana de venir tirer sur l'extrême gauche du camp et sur les hommes allant aux fontaines. Ce travail achevé, les troupes se retirèrent dans le plus grand ordre, et il n'y eut ni tués ni blessés de notre côté.
Pendant que l'on sévissait contre les gens de Lichana par l'abatage de leurs palmiers, les défenseurs de Zaatcha firent une sortie et vinrent se faire tuer sur les baïonnettes des hommes du 38e de ligne, de service aux tranchées. Exalté par le fanatisme, un des leurs, se glissant jusqu'au parapet de la galerie, voisine de la batterie Besse, introduisit le canon de son fusil entre deux rondins de palmiers, fit feu, et la balle, tirée à bout portant, tua roide le capitaine Graillet, du génie, au moment où il donnait des ordres pour la continuation des travaux. Cette mort fut d'autant plus regrettable que cet officier, plein de cœur et de dévouement, avait été chargé depuis 48 heures de la direction des attaques, en remplacement du colonel Petit, qui, après avoir été blessé grièvement le 9 octobre, n'abandonna les opérations du siège que lorsque des symptômes alarmants s'étaient manifestés et lui avaient fait comprendre la nécessité d'être évacué.
C'était le quatrième officier du génie que la colonne expéditionnaire perdait depuis notre arrivée devant l'oasis de Zaatcha, perte énorme pour cette arme, qui, comme on l'a déjà dit, avait à lutter contre des difficultés immenses.
Le capitaine Charles remplaça M. Graillet, et laissa la direction des travaux de l'attaque de gauche au capitaine Laberge.
A SUIVRE
|
|
POURQUOI CHOISIR D'ÊTRE INCINÉRÉ ?
Envoyé Par Mme Eliane
|
|
Au départ, nous sommes créés d'une « étincelle » d'amour.
La première année, nous sommes la « flamme » de nos parents.
On se fait ensuite « chauffer » les fesses jusqu'à notre adolescence.
Suit la période où un rien nous « allume ».
Et dans la vingtaine, on pète le « feu ».
Ensuite, on « buche » jusqu'à 65 ans.
À 75 ans, on est « brulé ».
À 80 ans, on se ramasse dans un « foyer ».
Puis à 90 ans, on « s'éteint ».
Alors, pourquoi demander à être incinéré ?
On est déjà « cuit » de toute façon.
Si tu choisis l'incinération, sache que ce sera ta dernière cuite !
Tandis qu'enterré, tu auras toujours une chance d'avoir un petit ver dans le nez
|
|
|
Commissaire politique stalinien du Viêt Minh,
Par M.José CASTANO,
|
« Les tortionnaires se ressemblent… Ils appartiennent à la sombre patrie des bourreaux et insultent d’abord à notre espèce avant de salir, au hasard des guerres, le drapeau de leurs victimes » (Pierre Moinot)
BOUDAREL, le monstre français du camp 113
Dès le déclenchement de la deuxième guerre mondiale l’Indochine fut envahie par l'armée japonaise qui occupait déjà la Chine et qui avait proclamé en 1938 sa volonté d'éradiquer toute présence d'homme blanc en Extrême-Orient, allant jusqu’à introniser, à son départ, le 2 septembre 1945, le gouvernement communiste Hô Chi Minh.
Lors des hostilités avec la France, le Viêt Minh effectua de nombreuses prises d'otages, incluant des civils. Beaucoup de prisonniers militaires français passèrent dans des camps d'internement situés dans les régions sous contrôle indépendantiste et furent soumis à une tentative de « rééducation marxisante » par des commissaires politiques au nombre desquels des communistes étrangers et français faisaient montre d’un zèle excessif… Ainsi le PCF, par la voix de ses responsables, Maurice Thorez, Jacques Duclos, le couple Joliot-Curie… joua un rôle essentiel, non seulement dans la conception, mais aussi dans l'exécution du lavage de cerveau.
Le sort des prisonniers dans ces camps de rééducation fut longtemps méconnu du grand public. L’affaire Georges Boudarel contribua à le rappeler à l'opinion dans les années 1990.
Militant du parti communiste français, progressiste et marxiste, Georges Boudarel naquit en 1926. En avril 1948, il s’embarqua pour l’Indochine comme professeur de philosophie et anima l'antenne indochinoise du PCF, le groupe culturel marxiste auquel Jean Chesneaux, l’historien communiste affilié au Viêt Minh, appartint.
Le 17 décembre 1950, refusant d’être incorporé dans l’armée française et considéré comme « insoumis » puis déserteur, il rejoignit le Viêt Minh et se rendit après une longue marche au Tonkin où, en 1953, il fut nommé commissaire politique dans un camp de rééducation de prisonniers, le camp 113.
Situé près du village de Nam Nahm, à 25 km à l'ouest du kilomètre 32 de la RC2 (60 kms au sud de la frontière chinoise et 30 kms au sud-ouest de B?c Giang) ce camp, insalubre, connut très vite une intense mortalité… Son cimetière débordait de cadavres que les grosses pluies d'automne déterraient. Les rats pullulaient et s'attaquaient aux mourants à l'infirmerie. Dès lors, la situation sanitaire devint telle qu’il fallut évacuer ce camp et le reconstruire 30 kilomètres plus à l'est, au nord de VINT-THUY, non loin de la RC2, près de LANG-KIEU.
Quelque 320 prisonniers, survivants d’un triste bétail pensant, abandonnés à leurs délires, à leurs rêves et à leur rancœur, tous d’origine européenne, officiers, sous-officiers et soldats, croupissaient dans ce camp dans des conditions d’alimentation, d’hygiène et de prophylaxie infâmes. A l’infirmerie, véritable antichambre de la mort, des squelettes vivants agonisaient, vaincus par la faim, la maladie et rongés par la vermine, sous un essaim de grosses mouches vertes. Ils étaient, en effet, vidés par la dysenterie, minés par le paludisme, l’avitaminose, les ascaris, la peau rongée par les champignons de la dartre annamite, de la bourbouille et du hong-kong-foot. Parmi ceux qui n’avaient plus aucune réaction et qui allaient mourir le soir même ou dans la nuit, certains avaient les lobes d’oreilles et la base des narines entamés par les rats.
Dans un endroit retiré, des latrines avaient été creusées où grouillaient des millions d’asticots qui donnaient naissance à des multitudes de mouches, vecteurs de toutes les maladies et véritable « pont aérien entre ce lieu et les cuisines » selon le mot même de Boudarel. Le taux de mortalité variait entre 25 et 40 décès par mois, et même plus, selon les saisons.
C’est en ce lieu sinistre que Boudarel, surnommé « Dai Dông », mit au point ses sévices chaque jour plus raffinés et excella dans le lavage de cerveau imprégné des doctrines du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien.
Dans ce « mouroir », sa spécialité : « La mise à mort sans toucher » consistait :
- à abreuver de cours de « rééducation politique » des hommes blessés, malades, éreintés, affamés
- à obliger les moribonds à se lever pour assister à ces séances, qui contribuaient à les achever
- à exploiter la pratique clé la « critique et de l’autocritique » pour créer un détestable climat de méfiance, de discorde et de délation
- à remettre au Vietminh des médicaments parachutés par la Croix Rouge Française et à les refuser aux malades abandonnés sans soins
- à réserver aux évadés repris un sort qui menait à une fin quasi certaine
- à établir lui-même la liste des « libérables », c’est-à-dire en s’attribuant le droit de vie et de mort
- à pousser la cruauté jusqu’à renvoyer au camp des prisonniers déjà sur le chemin de la libération : Certains en mourront de désespoir
- à détenir un record de mortalité, avec 1 à 8 décès par jour.
Boudarel étant devenu le « conseiller technique » pour l’action psychologique, les chefs des 130 camps Viêt Minh appliquaient avec zèle, sur ses indications, les séances de tribunal populaire destinées à juger ceux qui étaient considérés comme « fautifs ». Les prisonniers subissaient des traumatismes importants dus au viol psychologique de l’endoctrinement, des séances d’autocritique et d’encouragement à la délation.
Par ailleurs, en dépit de leur extrême faiblesse, tous ceux qui pouvaient tenir debout participaient aux corvées et aux activités du camp. « Si pas travailler, pas manger ! » Telle était la devise du surveillant général.
Ils furent, ainsi, victimes « d'agressions psychologiques découlant d'une doctrine monstrueuse, appliquée par un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique et d'intolérance active ». Tous les éléments du génocide constituant le crime contre l'humanité furent réunis, tel que le définit la Convention des Nations Unies du 9 décembre 1948 : « Atteintes graves à l'intégrité physique et mentale du groupe ; soumission intentionnelle de celui-ci à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle »… ce qui accrédite la théorie de Guglielme Ferrero : « Quand ils ne se servent pas des armées pour établir la tyrannie, les tyrans détruisent les armées afin de n’être pas détruits par elles ».
Parmi les punitions – identiques dans tous les camps- l’une des plus terribles était le séjour prolongé dans la sinistre « cage à buffles » sous une maison sur pilotis où le prisonnier, attaché à un poteau dans une eau putride sans pouvoir se protéger des piqûres d’insectes, était supplicié jusqu‘à la folie et la mort.
Durant l'année de son activité au camp 113, Boudarel reconnut lui-même un taux de mortalité atteignant les 70 %. Sur les 320 prisonniers Français, 278 moururent de mauvais traitements et de torture physique et psychologique. Dans ce cloaque pestilentiel, il avait fait sien « L’Enfer » de Dante, première partie de la « Divine Comédie » : « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ! »… (1)
Lorsqu’ils débarquèrent à Marseille, les survivants, squelettes ambulants ou morts-vivants portés sur civière, furent la cible des jets de boulons, de crachats et d’injures par des dockers communistes de la CGT rendant, de la sorte, vivants ces vers du Capitaine Borelli, Officier de Légion : « Quant à savoir si tout s’est passé de la sorte, et si vous n’êtes pas restés pour rien là-bas, si vous n’êtes pas morts pour une chose morte, Ô mes pauvres amis, ne me le demandez pas ! »
Inculpé de trahison Georges Boudarel fut condamné à mort par contumace en juin 1953. En 1964, il quittera le Vietnam pour Moscou où il prendra le nom de « Boris », puis Prague où, jusqu'en 1967, il exercera ses talents d'apparatchik communiste dans une filiale du Kominform, la Fédération syndicale Mondiale (FSM).
Après les accords de Genève, ce tortionnaire, bénéficiant de la loi d'amnistie gaulliste du 18 juin 1966 qui stipulait : « sont amnistiés de plein droit tous crimes et délits commis en liaison avec les évènements consécutifs à l’insurrection vietnamienne, et antérieurement au 1er octobre 1957 », revint en France et fut aussitôt coopté au CNRS par ses amis communistes et syndicalistes de l’Education Nationale pour y préparer une thèse de troisième cycle d’histoire à l’université Paris VII Jussieu. Il devint maître de conférences à Jussieu et ces mêmes communistes et syndicalistes feront ensuite valider ses années « d’expérience » en Indochine pour favoriser sa carrière…
Durant ces années, il fréquenta assidûment les milieux trotskistes, en particulier la ligue d’Alain Krivine et comptera parmi ses amis et « protecteurs » Gisèle Halimi, Suzan Sontag, Marianne Schaub, Laurent Schwartz, Marcel Kahn, Madeleine Rebérioux… tout le gratin de la gauche intellectuelle qui sera à l’origine de la création de la « Ligue Contre-Révolutionnaire ».
Le 13 février 1991, lors d'un colloque au Sénat sur le Vietnam auquel Boudarel participait, il fut reconnu et apostrophé par Jean-Jacques Beucler, ancien secrétaire d’État à la Défense et lieutenant en Indochine. Blessé sur la redoutable RC4, il fut fait prisonnier et interné de 1950 à 1954 dans le camp 113. Se plantant devant Boudarel, il l’apostropha en ces termes :
« Vous êtes un individu qui a trahi son pays pour se mettre volontairement, au service de l'ennemi et qui a spécialement maltraité ses compatriotes sur le plan matériel et sur le plan moral. Puisque vous bénéficiez sans doute d'une amnistie collective, nous ne pouvons pas vous poursuivre en justice mais nous tenons à vous dire publiquement, en mémoire des Morts pour la France en Indochine, que nous éprouvons à votre égard, le plus profond mépris, il faut que l'assistance sache à quel ignoble bonhomme elle a à faire. Vous êtes un criminel de guerre ! Vous avez du sang sur les mains. Votre présence à cette tribune est indécente ! ».
L’affaire fit grand bruit, d’autant plus que Boudarel adopta une attitude provocatrice, affirmant ne rien regretter et allant jusqu’à se moquer publiquement de ses anciennes victimes.
« Je consens que mon frère soit mort ; c’est la loi commune. Ce qui me révolte, c’est l’arrogance de ses assassins » écrivait Christopher Marlowe, dans « Edouard II »… Cette révolte, les anciens d’Indo la burent jusqu’à la lie…
D'autres témoignages furent déposés ensuite contre Boudarel qui fit l'objet en 1991 d'une plainte pour crimes contre l’humanité déposée par d'anciens prisonniers français du camp 113. Contre toute attente, articles et pétitions en faveur de Boudarel ne manquèrent pas dans le camp « progressiste » (Jean Lacouture, Pierre Vidal-Naquet qui soutiendra les tueurs du FLN en Algérie…) et la justice rejeta l‘accusation de crime contre l’humanité portée par une association d’anciens combattants, au motif que les faits étaient couverts par la loi d’amnistie de 1966.
Suprême dérision : Soutenu par l’ensemble de la gauche intellectuelle, il échappa également à toute sanction dans le cadre universitaire.
A 65 ans, l’ancien commissaire politique du camp 113 put en toute légalité faire valoir ses droits à la retraite. Il mourut paisiblement dans son lit le 26 décembre 2003 à l’âge de 77 ans.
« Et ton nom paraîtra dans la race future, aux plus cruels tyrans, une cruelle injure ! » - (« Britannicus » Jean Racine)
(1) - Le nombre des militaires français capturés durant le conflit indochinois, répartis dans une centaine de lieux de détention, s'élèvera à 37.979 dont 28% seulement survivront, soit 10.754. Leur mortalité sera donc très supérieure à celle des camps d'extermination nazis considérés comme la honte de l'humanité.
- De 1945 à 1954, il y eut environ 37 000 prisonniers militaires aux mains du Vietminh. 71% moururent en captivité, soit environ 26 200 personnes.
- Sur les 2000 soldats français capturés en 1950 lors du désastre de la RC4, il ne restait plus en 1952, au camp n°1, que 32 survivants. Le taux de mortalité fut donc de plus de 90%.
- Sur les 11 721 prisonniers de Diên Biên Phu qui durent endurer une marche de la mort pour regagner les camps, 70 % périrent en moins de 4 mois. Seuls, 3 290 d’entre eux reviendront de captivité.
- Le Viêt Minh ne reconnut jamais la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre et pendant toute la durée du conflit, la Croix Rouge ne reçut jamais l’autorisation de visiter les camps.
« L‘inhumanité des camps Viêt Minh rejoint et égale celle des camps nazis » (Capitaine Pierre MONTAGNON – Officier putschiste du 2ème REP – « Les parachutistes de la Légion »)
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
L’infâme Georges Boudarel
http://i19.servimg.com/u/f19/10/05/66/91/th/boudar10.jpg
Cliquez sur : boudarel 91 - Vidéo Dailymotion
(Manifestation unitaire de mars 1991 organisée par l'Action Française contre le tortionnaire Boudarel)
|
|
| PAPY ET LES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE ...
Envoyé par Eliane
|
|
Deux étudiants en médecine se promènent quand ils voient un vieil homme marcher
avec les jambes écartées, les jambes raides il marche lentement.
L'un d'eux dit :- "Je suis sûr que le pauvre homme a de l'arthrite.
Ces personnes marchent comme ça."
L'autre étudiant dit : "Non, je ne crois pas. Le vieil homme a surement de l'arthrose.
Il marche lentement et ses jambes sont écartées, tout comme nous avons appris en cours. »
En désaccord, ils décident donc d'interpeler le vieil homme.
S'approchant de lui et l'un des étudiants lui demande:
"Nous sommes étudiants en médecine et nous avons remarqué votre façon de marcher.
Nous ne partageons pas le même diagnostic vous concernant ..
Pourriez-vous nous dire de quoi vous souffrez ? "
Le vieil homme répond: « Je vais vous le dire, mais tout d'abord dites-moi
ce que vous en pensez, puisque vous avez étudié la médecine. »
Le premier dit : « Je pense que vous faites de l'arthrite. »
Le vieil homme répondit : « Vous pensiez ça, mais, vous vous trompez. »
Le second étudiant dit : « Je pense que vous avez de l’arthrose. »
Le vieil homme répondit : « Vous avez pensé ça, mais, vous vous trompez. »
« Eh bien, cher monsieur, quelle est donc votre pathologie ? »
Le vieil homme dit : « Eh bien, je pensais que c'était un petit pet,
mais moi aussi je me suis trompé !!!!! »
|
|
|
50ème Rassemblement des Bougiotes
au Lazaret à Sète 10, 11 et 12 novembre 2017
Envoyé par M. Louis Aymés
|
 Dès le vendredi des participants arrivent, ce sont les retrouvailles les embrassades et les discussions. L’hébergement se fait au Lazaret, village vacances depuis plus de 150.
Dès le vendredi des participants arrivent, ce sont les retrouvailles les embrassades et les discussions. L’hébergement se fait au Lazaret, village vacances depuis plus de 150.
La météo est de la partie, un soleil resplendissant nous accueille.
Yves Bodeur installe une exposition sur Bougie (création du port et autres documents). Vendredi soir, après un buffet aux spécialités régionales, le Président Yves Dubard, entouré de son comité donne aux premiers arrivants un compte rendu des activités de l »Association au cours de l’année.
Samedi : les Bougiotes éparpillés dans l’hexagone se retrouvent au Lazaret.
Le Centre de documentation historique de l’Algérie (CDHA) propose une exposition sur le thème « l’Armée d’Afrique » Dans l’après-midi parties de pétanque et en soirée bal animé par l’orchestre Henri Ben.
Dimanche : Les cloches de l’Eglise Saint Joseph de Bougie retentissent, Une messe très solennelle officiée par Christian Caruana nous réunit dans la Chapelle du centre.
Après la messe nous nous dirigeons vers notre olivier, symbole de nos souvenirs, où Yves Dubar prend la parole,
« Bienvenue à vous tous,
Avant d’évoquer le 50ème anniversaire de nos rencontres au Lazaret, je vous annonce que nous sommes aujourd’hui 206.
Dans le prolongement de l’Office religieux par notre ami Christian Caruana, ayons une pensée pour ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre pour de multiples raisons, auxquelles nous sommes tous confrontés plus ou moins, l’âge, la maladie, l’éloignement.
Partageons ce moment de souvenir sans oublier ceux qui nous ont quittés, dont les noms ont été cités au cours de la messe, et aux familles laissées dans la peine.
Pour eux je vous demande d’observer une minute de silence.
Sonnerie aux morts suivie d’un vibrant chant des Africains.
Le Président Yves Dubar de poursuivre : 50 ans.. Quel anniversaire !
Pour nous les Bougiotes et le Lazaret, nous pouvons parler de « noces d’or »….
En effet, en 1967 un couple se formait :
D’un côté un groupe de rapatriés déracinés, de l’autre une Institution déjà centenaire Le Lazaret. Une institution vouée à l’hospitalité et à la protection de familles en mal de repères et en grandes difficultés… Qui plus est, cette union, sous les auspices d’un ancien Pasteur de Bougie, le Pasteur Muller.
Solidarité, compréhension, les critères de réussite étaient réunis pour décider nos anciens à organiser dans ce Lazaret nos rencontres annuelles. Ils avaient le grand espoir qu’elles perdurent. Leur réussite sera à la hauteur de leurs ambitions puisque nous sommes ici, aujourd’hui pour commémorer 5 décennies d’une heureuse collaboration.
Au début, nous étions de « grands enfants » et nous assistions à ces réunions avec nos enfants, nos parents, nos grands-parents et pour certains nos arrière-grands-parents. Le Lazaret était devenu pour nous une maison de famille.
De ce site magnifique, face à notre méditerranée, nous retrouvions une corniche, une plage, les pins, les oliviers mais, aussi la chaleur de notre accent dans le partage de nos joies, de nos peines, de nos confidences, et de nos réussites.
Il faut se rappeler ces réunions à plus de 800 participants, dans des structures en perpétuel aménagement pour le bien de tous. Il faut se rappeler ces amis pour lesquels ce fameux WE du 11 novembre était une obsession, rien ne les arrêtait, ni la distance, ni même pour certains des situations délicates.
Hélas le temps n’a pas épargné nos générations : disparitions, maladie, âge, éloignement, des tas d’embûches qui ont marqué inexorablement les familles les plus assidues.
Nous ne pouvons commémorer ces noces d’or sans évoquer les protagonistes de cette union : les membres fondateurs de notre groupe Marcel, Louis, André et leurs épouses, le pasteur Muller et l’équipe dirigeante de l’époque qui leur a tendu la main, Mme Espérandieu.
Pour nous les plus « jeunes » dans les années 2000 et jusqu’à ce jour, ces mains tendues ce sont celles de nos amis David Coste, Hervé Vivaldi et aujourd’hui les vôtres M. Souvignet, celles de notre amie Sylvie et de toutes les équipes de ce Lazaret.
Au nom de tous les Bougiotes, je vous remercie tous pour l’accueil privilégié que vous nous avez toujours réservé.

Devant notre olivier symbole aussi de longévité, il faut souhaiter aux sexagénaires qui nous suivent, ainsi qu’aux jeunes du Lazaret de voguer sûrement vers le 55ème et pourquoi pas le 60ème anniversaire de notre présence ici.
 Quoiqu’il en soit, nous sommes en 2017, un WE de plus le 50ème ! S’il a un goût de nostalgie, il n’est pas moins festif puisqu’il est animé par Ben et ses musiciens avec lesquels nous partageons aussi un anniversaire : celui de 10 ans de fidélité.
Quoiqu’il en soit, nous sommes en 2017, un WE de plus le 50ème ! S’il a un goût de nostalgie, il n’est pas moins festif puisqu’il est animé par Ben et ses musiciens avec lesquels nous partageons aussi un anniversaire : celui de 10 ans de fidélité.
Nous avons débuté en célébrant des « Noces d’Or » nous festoyons avec des « Noces d’Etain »
Intervention de M. Souvignet, Directeur du Centre, BOUGIE/Le LAZARET 50 ans d’amitié,
Mesdames, Messieurs, Chers amis Bougiotes,

Dès 1962, après le traumatisme qu’a été l’arrachement à la terre qui vous a vu naître, vous avez eu l’idée de vous réunir pour que les souvenirs ne se perdent pas mais se partagent, et pour que votre vie de l’autre côté de la méditerranée continue dans vos pensées communes.
En 1967 cherchant un lieu pour se retrouver, vous avez choisi le Lazaret, un petit village de vacances un peu spartiate mais qui se trouvait au bord de cette mer qui vous est chère.

Et nous voilà, 50 ans plus tard, dans ce même village avec les mêmes visages et avec les mêmes souvenirs toujours vivaces. 50 ans de fidélité ce sont des noces d’or, 50 ans de fidélité c’est rare et cela fait chaud au cœur.
Aujourd’hui vous faites partie du Lazaret. Vous en faites partie par votre présence chaque mois de novembre, par cet olivier qui est le symbole même des deux rives de la Méditerranée, par ces relations chaleureuses nouées avec celles et ceux qui tout au long de l’année préparent ce rendez-vous : M. Dubar et votre équipe.
Alors au nom du Conseil d’Administration, au nom de l’équipe du Lazaret et en mon nom, je veux vous dire merci. Merci de cette fidélité, soyez-nous fidèles encore longtemps.
 Le Lazaret vous offre apéritif et champagne pour ce repas de fête. Longue vie aux amis de Bougie et longue vie au Lazaret.
Le Lazaret vous offre apéritif et champagne pour ce repas de fête. Longue vie aux amis de Bougie et longue vie au Lazaret.
Le comité offre les Merguez sous la pinède, moment festif où les discussions sont animées.
Après les merguez, c’est le repas officiel, qui se termine par un magnifique gâteau « fraisier » et le champagne.

Dans l’après-midi il faut penser au départ, mais que d’émotions vécues au cours de ce 50ème anniversaire d’amitié.
Envoi de Louis Aymes
|
AVIS DE RECHERCHE
envoyé par M. Jean-Claude Rosso
|
|
Bonjour les Amis
MERCI de bien vouloir m’aider à contacter la famille de Monsieur JUAN François, né le 09/06/1917 et disparu à TREZEL (département de Tiaret) le 09/04/1962.
Si vous pouvez amplifier cette recherche auprès de tous vos contacts on pourrait retrouver des membres de la lignée afin de leur communiquer une information importante.
Contact : Jean-Claude ROSSO
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens d'ajouter Petit, Clauzel, Guelât Bou Sba, Héliopolis, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Duvivier, Duzerville, Herbillon, Kellermann, Milesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Penthièvre, Randon, Kellermann et Millesimo, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
|
Mila : Des trafiquants de pièces de monnaie anciennes neutralisés
Envoyé par Gérard
https://www.liberte-algerie.com/est/breves-de-lest-282048
Par Liberté-Algérie 27/11/ 2017 l Par M. Kamel B
Un réseau de trafiquants de vieilles pièces de monnaie a été neutralisé, en fin de semaine passée, à Mila.
Les malfaiteurs, au nombre de trois, ont été arrêtés dans la commune de Grarem-Gouga, au nord de la wilaya. Originaires de Constantine, les mis en cause étaient en possession de 20 pièces de monnaie en cuivre issues de sites archéologiques de la région. Selon une expertise réalisée par la Direction de la culture de Mila, les pièces de monnaie saisies remontent à l’époque romaine. Les trois malfaiteurs ont été déférés dernièrement devant le procureur de la République près le tribunal de Mila. L’accusé principal dans cette affaire, un homme âgé de 33 ans, a été placé sous mandat de dépôt. Ses deux complices, âgés de 42 et 52 ans, ont été placés sous contrôle judiciaire, précise notre source. Signalons que les sites archéologiques de la wilaya de Mila, notamment ceux situés en zones isolées comme ceux des localités de Rouached et de Hamala, sont régulièrement ciblés par les trafiquants d’objets archéologiques qui y effectuent des fouilles sauvages.
Kamel B.
CRÉATION D’UN LIEU DE DÉBAUCHE
Envoyé par Etienne
https://www.liberte-algerie.com/est/48-immigrants-clandestins-arretes-a-la-cite-auzas-de-annaba-281962
Liberté Algerie l Par B. Badis - 26/11/ 2017
48 immigrants clandestins arrêtés à la cité Auzas de Annaba
Un important groupe d’immigrants clandestins, principalement des Subsahariens, versé dans la prostitution, a été démantelé à Annaba.
En effet, 48 mis en cause, des deux sexes, ont été interpellés à la cité Auzas pour création d’un lieu de débauche. Selon les résultats des investigations lancées par la BRI (Brigade de recherche et d’investigation) de Annaba, les Subsahariens s’adonnaient à la débauche dans une maison qu’ils avaient louée illicitement à des habitants du quartier. L’enquête a été diligentée sur ordre de la justice, suite à des plaintes du voisinage.
C’est ainsi qu’une descente policière a été programmée à 6h, ce qui a permis aux enquêteurs l’arrestation de ce beau monde, dont la plupart étaient sous l'emprise de l’alcool et de la drogue. Nos sources indiquent que des armes blanches, un lot de boissons alcoolisées et un laboratoire de confection de la fausse monnaie ont été découverts sur les lieux et ajoutent que les personnes arrêtées échappent à tout contrôle médical.
B. Badis
ABSENTE DEPUIS 30 ANS AU CHU IBN ROCHD À ANNABA l
Envoyé par Annie
https://www.liberte-algerie.com/est/la-chirurgie-orthopedique-et-traumatologique-relancee-280597
Liberté Algérie Par B. BADIS - 05/11/ 2017
La chirurgie orthopédique et traumatologique relancée
Quatre patients âgés entre 50 et 60 ans ont été opérés.
La relance de la chirurgie orthopédique et traumatologique entre dans le cadre de l’amélioration de la prise en charge des malades.
L’équipe du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du CHU Ibn-Rochd de Annaba a procédé, durant les journées des 28, 29 et 30 octobre 2017, à la pose de prothèses du genou avec succès.
C’est ce qui a été annoncé hier dans un communiqué de presse de la cellule de communication du CHU de Annaba. Ces premières poses ont été effectuées au profit de 4 patients, originaires des wilayas de Annaba et d’El-Oued, âgés entre 50 et 60 ans.
La même source souligne que la relance de la chirurgie orthopédique et traumatologique entre dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de la prise en charge des malades, dans le but de réduire les déplacements à l’étranger.
Notons que l’équipe administrative a fourni tous les moyens matériels et humains pour récupérer ce type d’opérations qui sont très chères et compliquées et en réponse des demandes des patients qui viennent au CHU de Annaba.
Menée par une équipe de chirurgiens en orthopédie de Annaba, et dirigée par Pr A. Menadi, assisté à l’occasion par Pr Bouhdiba d’Oran, cette opération chirurgicale a vu également la participation de 5 médecins spécialistes des établissements publics hospitaliers des wilayas limitrophes, Guelma, El-Tarf, Souk Ahras et Tébessa, dans le cadre de la convention de jumelage et de partenariat entre les EPH. Par ailleurs, la direction générale de CHU Annaba informe que des travaux de réhabilitation aux normes internationales sont toujours en cours au bloc opératoire de la chirurgie orthopédique, d'urologie et de neurochirurgie.
Le DG du CHU de Annaba a tenu personnellement à présenter ses excuses vis-à-vis des patients pour le retard du programme et confirme que le personnel médical du CHU assure les interventions d'urgence au bloc opératoire du service des urgences chirurgicales et de la chirurgie générale.
Il est vrai que, et de l’avis du milieu hospitalier, le directeur du CHU Ibn-Rochd de Annaba, Nabil Bensaïd, a réussi à insuffler dans un court laps de temps une véritable métamorphose sur le plan de la gestion du CHU, qualifié il n’y pas si longtemps de “malade”.
Notons que ce genre d’opérations n’a pas été effectué depuis 30 ans
B. BADIS
VIEUX BÂTI - LA COLONNE
Envoyé par Jean
http://www.lestrepublicain.com/index.php/annaba/item/9004120-certaines-parties-communes-non-concernees-par-les-travaux
L'EST Républicain Par Nejmedine Zéroug - 31 Oct 2017 Annaba
Certaines parties communes non concernées par les travaux
L’opération des travaux de restauration du vieux bâti est en cours dans le quartier la Colonne. Certains immeubles vétustes ou menaçant ruines et qui étaient concernés par cette opération de réhabilitation, dont les travaux ont débuté il y a quelques mois de cela ont été achevés au grand bonheur des résidents. “On peut dire maintenant que nous habitons dans un immeuble digne de ce nom grâce à sa restauration. Ses façades externes ont été bel et bien peintes et la couleur de la peinture choisie est impeccable.
Quant à l’intérieur, les travaux ont touché quelques parties telles que les murs, l’escalier, la porte d’entrée sinon tout le reste laisse à désirer. Puisque les locataires ne sont pas satisfaits du fait que les travaux n’ont pas touché de fond en comble toutes les parties communes de fond. Ces derniers n’ont pas les moyens de le faire. L’État en a les moyens et doit de ce fait de les restaurer comme il se doit. Sinon toutes les bâtisses seront à l’avenir menacées d’effondrement», nous a expliqué un occupant qui nous a fait savoir que l’entrepreneur qui refuse de faire les travaux à 100% de toute la bâtisse renvoie la balle à la direction de wilaya chargée de la restauration du vieux bâti.
Par ailleurs, les résidents d’un autre immeuble n°6 située sur l’avenue Benamiour Abdelkader ex-Garibaldi crient à l’injustice du moment qu’ils n’ont pas bénéficié de la même chose que les autres habitants occupant les autres bâtisses concernées par la restauration. Leur immeuble est tellement vétuste qu’ils ont vu ses murs effrités, ses tuiles détériorées, l’infiltration des eaux pluviales faire un dégât. « C’est un immeuble à rénover de fond en comble », nous ont-ils dit à l’unisson. Selon certaines informations que nous avons recueillies auprès de ces locataires, l’entrepreneur allait faire des travaux d’intérieur uniquement au niveau de murs de la cage d’escalier et du couloir, quant aux autres murs du patio qui font partie de la partie commune ils ne sont pas concernés. Pour cela, ils demandent à ce que tous les travaux extérieurs et intérieurs soient exécutés comme il se doit. Dans le cas contraire ils comptent interpeller le wali et le saisir officiellement par le biais d’une requête en bonne et due forme. Il serait donc souhaitable que la direction en charge de ces travaux de restauration qui ont touché plusieurs bâtisses vétustes et menaçant ruines situées dans le quartier la Colonne intervienne pour mettre fin à cette situation qui a suscité colère et indignation au sein des riverains.
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci-dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la Seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Novembre 2017
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
http://piednoir.fr/guelma
|
|
La vieille dame et sa banque
Envoyé par Eliane
|
Cher Monsieur le Directeur,
Je vous écris pour vous remercier d'avoir refusé le chèque qui m'aurait permis de payer le plombier le mois dernier.
Selon mes calculs, trois nanosecondes se sont écoulées entre la présentation du chèque et l'arrivée sur mon compte des fonds nécessaires à son paiement.
Je fais référence, évidemment, au dépôt mensuel automatique de ma pension, une procédure qui, je dois l'admettre, n'a cours que depuis 26 ans.
Il me faut d'ailleurs vous féliciter d'avoir saisi cette fugace occasion et débité mon compte des 30 euros de frais pour le désagrément causé à votre banque.
Ma gratitude est d'autant plus grande que cet incident m'a incitée à revoir la gestion de mes finances - après tout, je n'ai QUE ÇA à faire.
A partir d'aujourd'hui, je passerai dix (10) fois par jour au guichet de votre agence (nous sommes voisins) et notamment à 11H50 et 16H50 pour retirer 2 EUR ; je déposerai aussi des espèces (1 EUR) et demanderai un reçu.
Je paierai TOUS mes achats (même ma baguette de pain) par chèque.
A ce propos, veuillez m'envoyer immédiatement cent (100) chéquiers.
Comme il m'arrive d'OUBLIER de signer certains chèques ou de noter des montants chiffres et lettres différents, je vous demanderai de faire très attention puisqu'il s'agirait d'une faute de votre part.
Bien entendu, je préviendrai mes commerçants et leur demanderai de faire une copie de mes chèques, avant de les porter.
Je vais interrompre TOUS mes prélèvements automatiques, je paierai par chèque.
TOUS mes courriers seront déposés à votre banque et adressés au directeur avec la mention "CONFIDENTIEL NE PAS OUVRIR".
Je compte changer tous les mois ma signature légale : avec tous ces vols de chéquiers on n'est jamais assez prudent.
Dorénavant, si vous me téléphonez :
Vous entendrez "appuyez sur la touche étoile de votre téléphone"
Vous devrez choisir la langue :
1, 2, 3 ou 4 (eh oui, à 86 ans je parle 4 langues)
Une fois la langue sélectionnée, vous devrez :
Taper 1 pour prendre rendez-vous avec moi
Taper 2 pour toute question concernant un retard de paiement
Taper 3 pour me laisser un message
Taper 4 pour me parler
Taper 5 pour retourner au menu principal et tout recommencer
ENFIN, avant de me parler, vous entendrez une belle musique, chantée par moi (pas de droit SACEM) que vous connaissez sûrement et qui s'intitule :"Le petit bonhomme en mousse".
Je vous souhaite une bonne soirée, et vous dis donc A DEMAIN ...
Respectueusement.
Moralité :
Faut pas faire chier les vieux!
|
|
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
|
|










 BONE (D.n.c.g.). - les terroristes ont opéré hier soir, en plusieurs endroits de la banlieue bônoise. Alors que Ia nuit descendait lentement, vers 17 h. 30, un groupe de terroristes embusqués rue de Bélisaire, non-Ioin du Ruisseau d'Or, dans le quartier des Cités, ouvrit le feu sur des Européens. Une jeune fille, qui circulait, fut mortellement blessée et devait succomber peu après l'agression. II s'agit de Mlle Josette Gauci, âgée de 20 ans.
BONE (D.n.c.g.). - les terroristes ont opéré hier soir, en plusieurs endroits de la banlieue bônoise. Alors que Ia nuit descendait lentement, vers 17 h. 30, un groupe de terroristes embusqués rue de Bélisaire, non-Ioin du Ruisseau d'Or, dans le quartier des Cités, ouvrit le feu sur des Européens. Une jeune fille, qui circulait, fut mortellement blessée et devait succomber peu après l'agression. II s'agit de Mlle Josette Gauci, âgée de 20 ans.

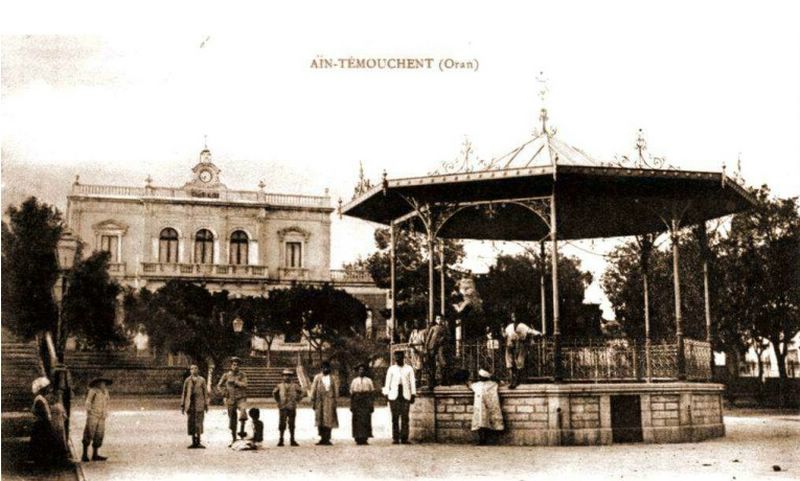


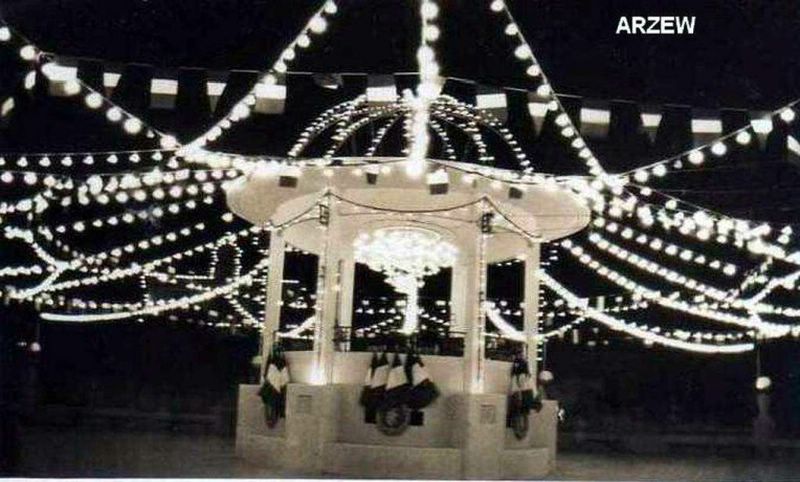

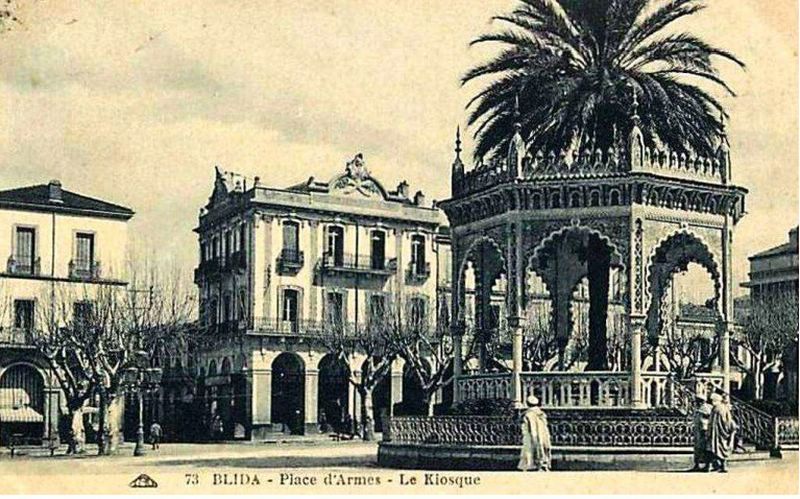






















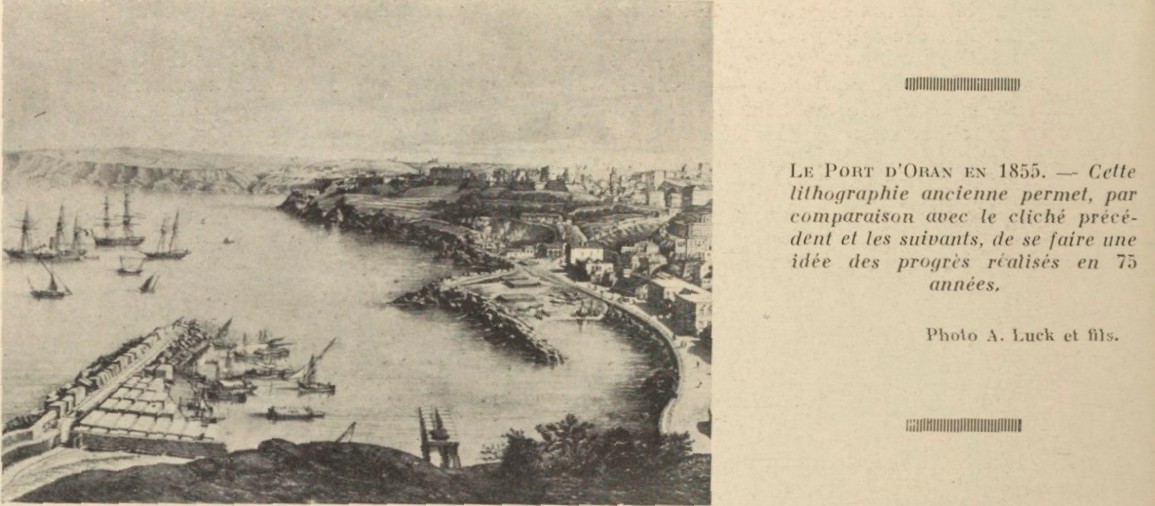

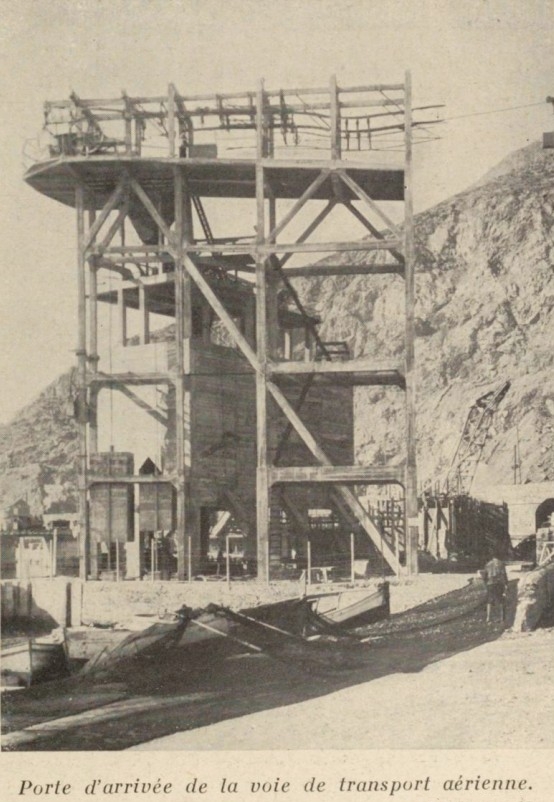
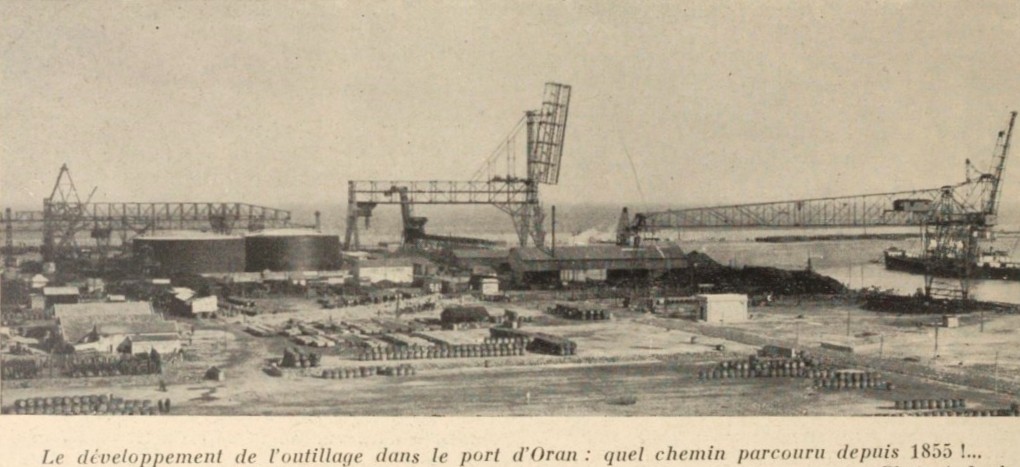
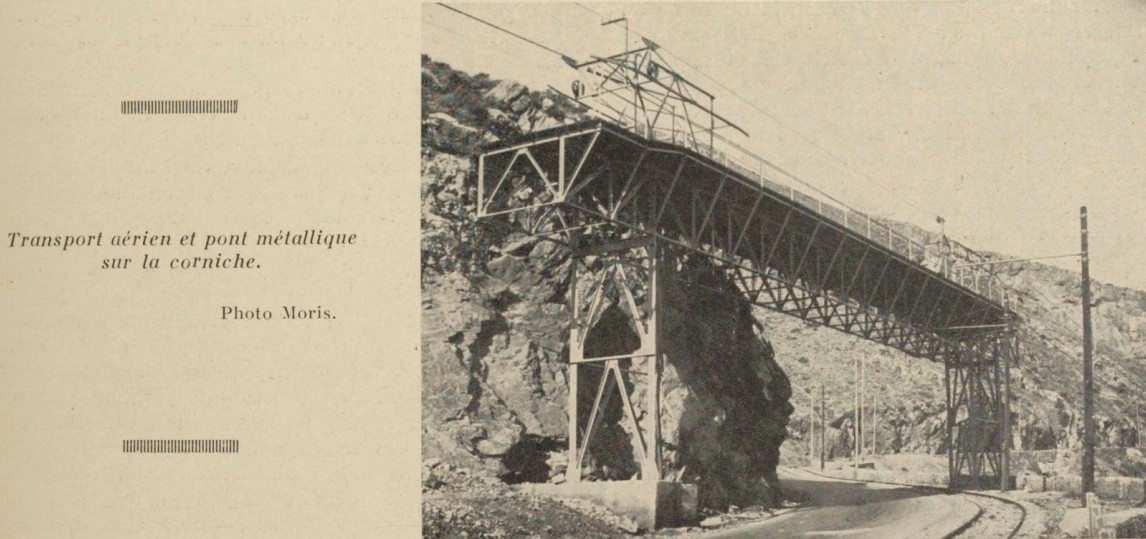
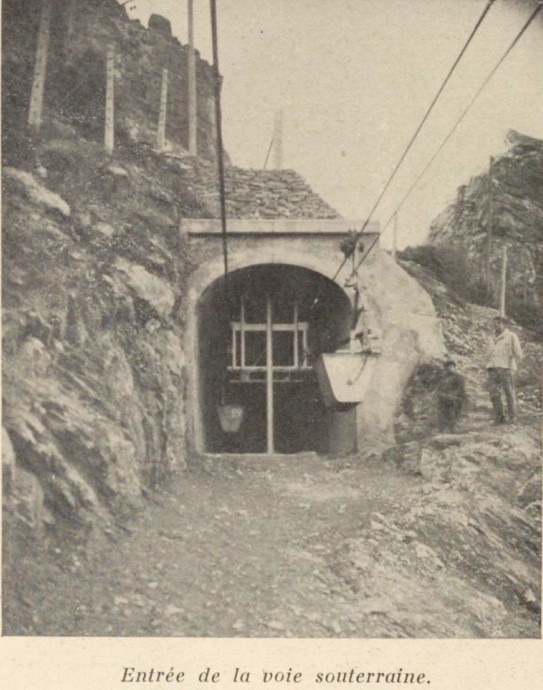 D'autre part, vers l'Est, la côte est accore et bordée par la haute falaise de Gambetta supérieur. Il s'ensuit que la construction des terre-pleins nécessaires entraînerait des terrassements coûteux. Voilà pourquoi l'on a repoussé l'extension vers l'Est et envisagé, celle vers l'Ouest qui offre, à tous points de vue, des facilités exceptionnelles.
D'autre part, vers l'Est, la côte est accore et bordée par la haute falaise de Gambetta supérieur. Il s'ensuit que la construction des terre-pleins nécessaires entraînerait des terrassements coûteux. Voilà pourquoi l'on a repoussé l'extension vers l'Est et envisagé, celle vers l'Ouest qui offre, à tous points de vue, des facilités exceptionnelles.
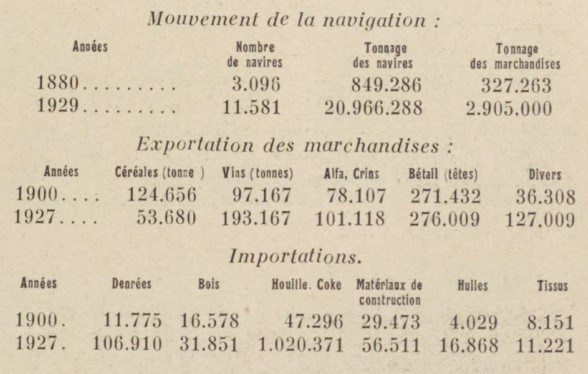


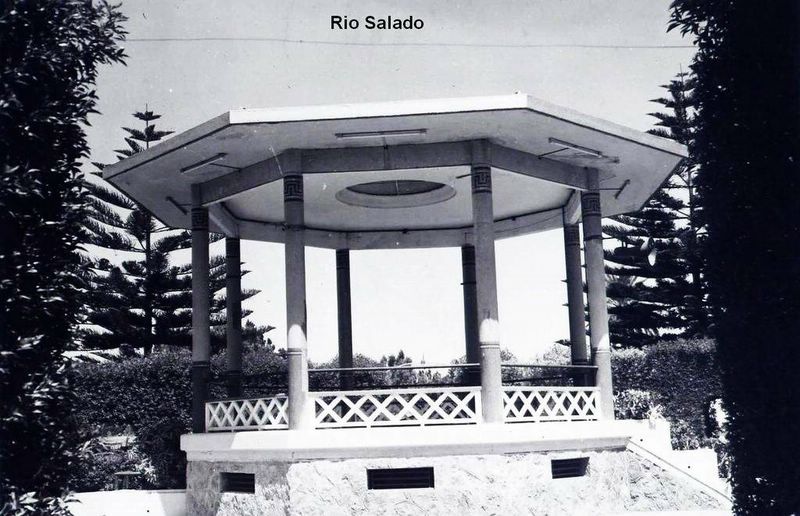

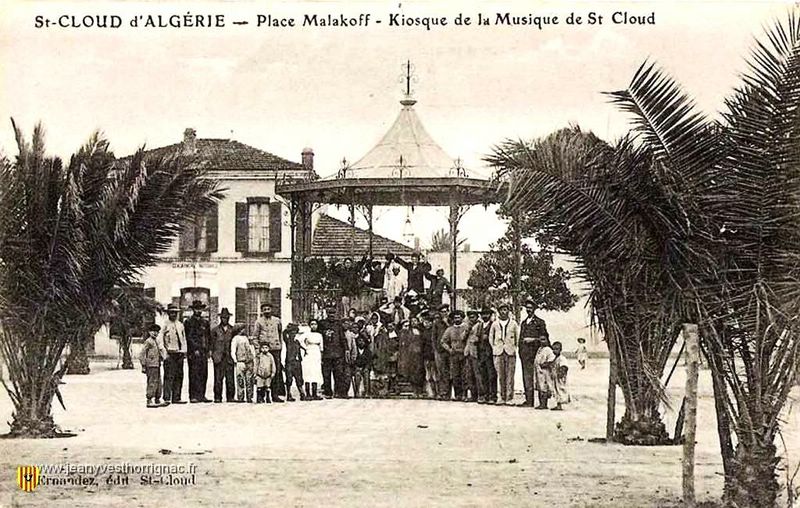
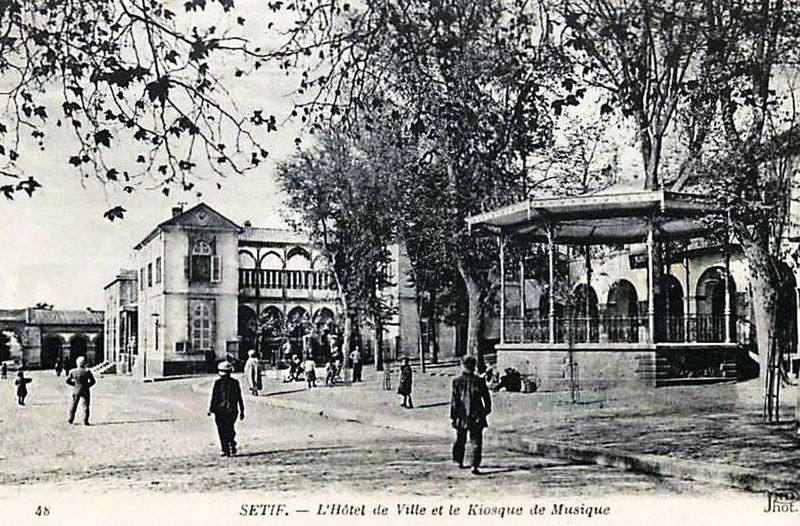


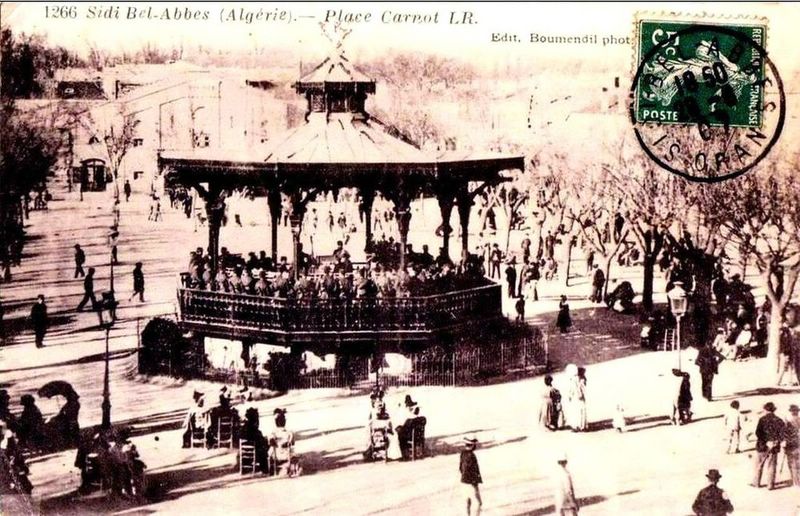
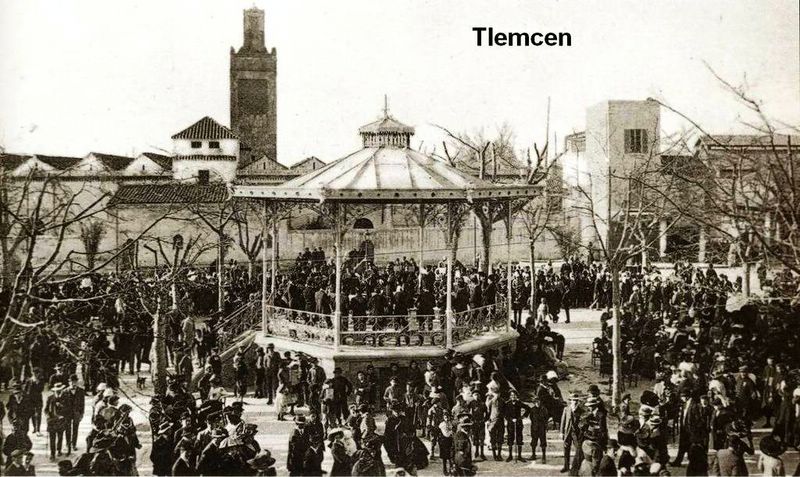



 Dès le vendredi des participants arrivent, ce sont les retrouvailles les embrassades et les discussions. L’hébergement se fait au Lazaret, village vacances depuis plus de 150.
Dès le vendredi des participants arrivent, ce sont les retrouvailles les embrassades et les discussions. L’hébergement se fait au Lazaret, village vacances depuis plus de 150.

 Quoiqu’il en soit, nous sommes en 2017, un WE de plus le 50ème ! S’il a un goût de nostalgie, il n’est pas moins festif puisqu’il est animé par Ben et ses musiciens avec lesquels nous partageons aussi un anniversaire : celui de 10 ans de fidélité.
Quoiqu’il en soit, nous sommes en 2017, un WE de plus le 50ème ! S’il a un goût de nostalgie, il n’est pas moins festif puisqu’il est animé par Ben et ses musiciens avec lesquels nous partageons aussi un anniversaire : celui de 10 ans de fidélité.


 Le Lazaret vous offre apéritif et champagne pour ce repas de fête. Longue vie aux amis de Bougie et longue vie au Lazaret.
Le Lazaret vous offre apéritif et champagne pour ce repas de fête. Longue vie aux amis de Bougie et longue vie au Lazaret.
