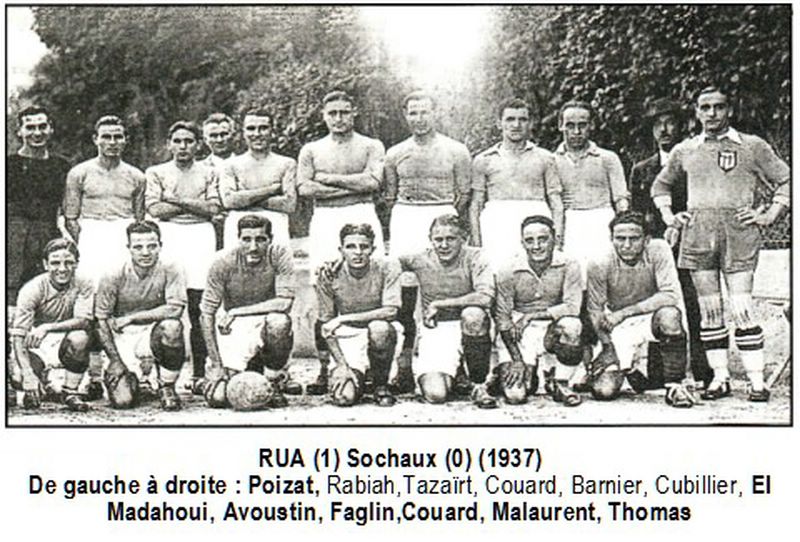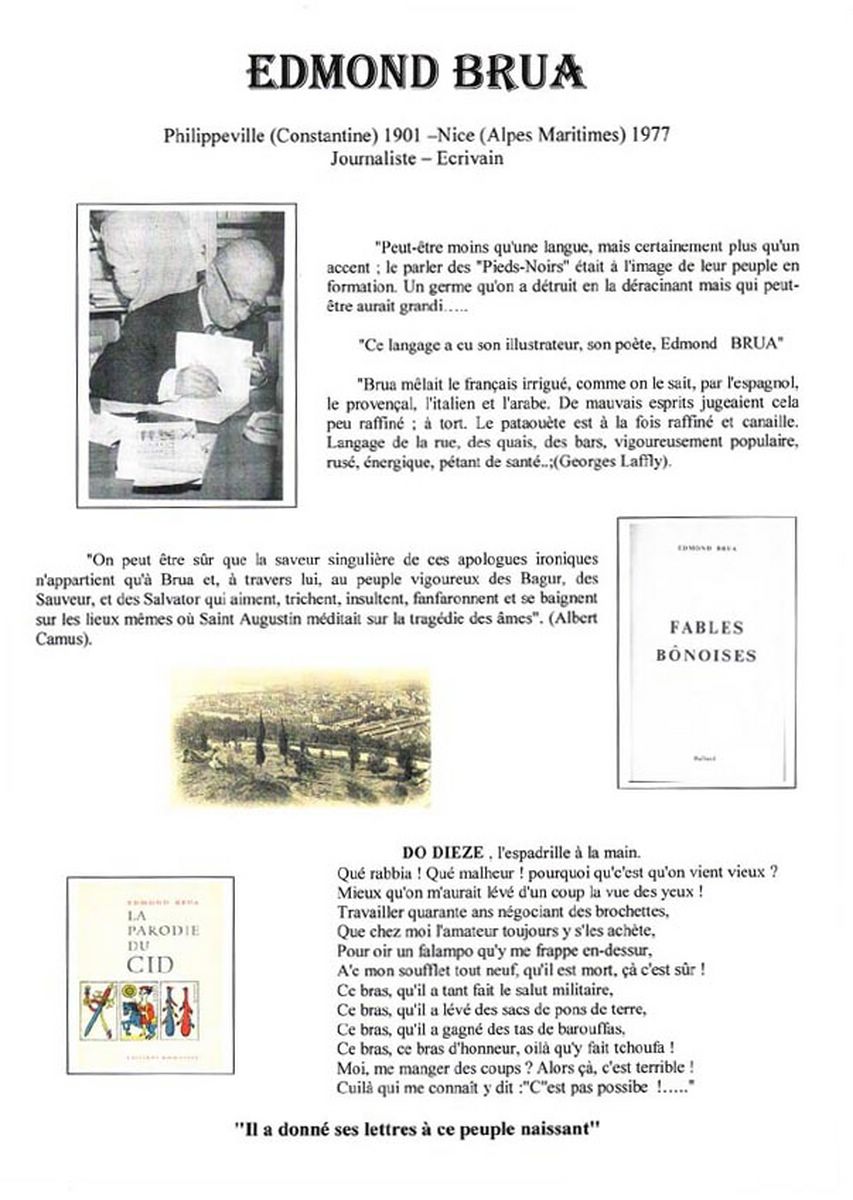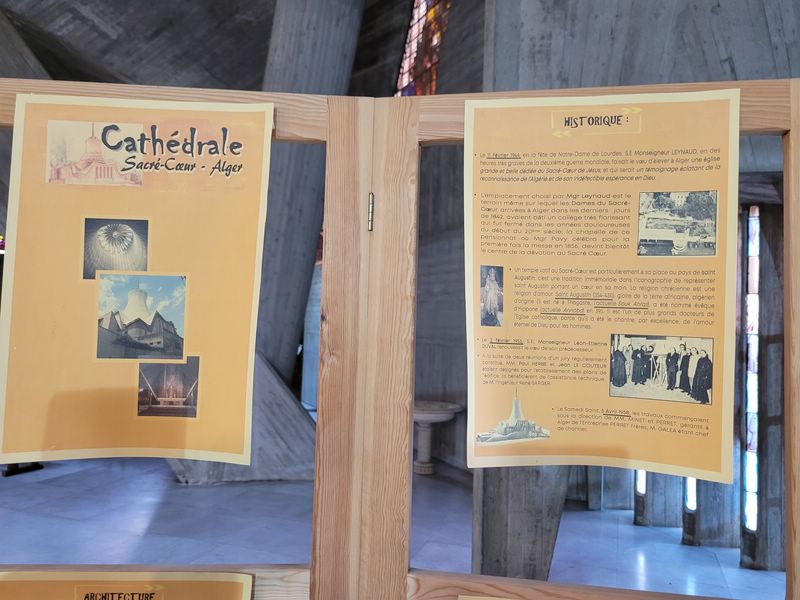|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Avertissement :
Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-PierreBartolini.
Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m’adresser une demande écrite par lettre ou par mel.
Merci.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
239,
240, 241, 242,
243, 244, 245,
246, 247, 248,
| |
Le joli mois de mai
Chers Amies, Chers Amis,
Le cinquième mois de l’année civile. Le joli mois de mai. Issu du latin Maius (mensis), proprement « mois de la déesse Maia ». Rose de mai, rose pompon qui fleurit au mois de mai.
1er mai, fête du travail, fête des travailleurs. 1er mai fête du muguet. 1er mai seul jour de l’année où il n’y a pas de quotidiens.
Belle fête du 1er mai à tous dans l’amitié partagée.
Beaucoup se rappelleront que le mois de mai est convié à la Vierge Marie.
Les syndicats ouvriers vont se retrouver pour défiler dans les rues des villes, avec un certain nombre de slogans et de revendications pour une vie meilleure, se situant ainsi dans la longue chaîne des « 1er mai », marqués par la célébration des acquis sociaux à pérenniser et/ou à revendiquer.
Tout au long de la journée du muguet sera offert, signe de bonheur et de bonnes choses à venir ! Chaque amoureux ira chercher ou acheter ce brin pour l’offrir à sa belle, aux siens, à celles ou ceux qu’on aime ... « Il est revenu le temps du muguet » chanté par Francis Lemarque ou Danièle Darrieux.
Le mois de mai, ses jours fériés et ses ponts annoncent le retour des beaux jours pour le plaisir de tous…
C’est le moment ! Le moment de faire ce qu’il nous plait !
Ayez la fièvre au mois de mai, vous serez, tout l'an, sain et gai.
Bon mois de Mai à tous et toutes
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
| Les Spectres du Passé.
Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.
|
|
- Je m'étonne
Que ? La plupart des hommes
Aient si peur des spectres,
Eux, Qui acceptent si facilement,
De parler aux morts dans leurs songes.
Empereur HADRIEN
( 1er et 2ème Siècle après J.C. )
- S'il m'arrive très souvent, de songer à mille choses à la fois, je voudrais cependant, m'arrêter un instant sur l'une d'entre elles, qui me tient particulièrement à cœur, ce sont ce que j'appellerais = les Spectres du Passé !
- Mais, que penser de ces Spectres, qui viennent le plus souvent « chatouiller ma mémoire » et me faire revivre par leur présence, toutes ces âmes disparues ou non et parfois, depuis bien longtemps déjà. A l'automne de mon existence, je ne puis faire aujourd'hui le calcul exact, de tous ces gens, que j'ai bien connus et fréquenté de leur vivant et côtoyés de très près ou de loin au cours de ma vie. Mais, quand, dans ma mémoire, surgissent les images de ces trépassés ou, de ceux encore de ce monde, avec très souvent la perception du son de leur voix, c'est là que je m'autorise à parler de ces Spectres du Passé, qui, s'en viennent parfois, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, pour envahir mon cerveau et garder tous mes sens en éveil. Alors, il me semble, les avoir tout près de moi, comme s'ils avaient vraiment ressuscité.
- Mais, quels sont ces "Spectres"- dont je veux parler ?
Eh bien ! Je vais commencer par évoquer, un spectre de quelqu'un je n'ai pas connu, puisque, décédé à l'âge de 33 ans, alors que je n'avais que 6 mois = mon Père ! J'ai pu le connaître, en regardant d'anciennes photographies et ainsi, me faire une idée précise de son visage. Il m'arrive quelque fois de côtoyer son spectre souriant et de l'imaginer bien vivant près de moi. Cependant, je n'ai jamais pu entendre le son de sa voix toujours silencieuse, peut-être ? Parce que, je ne l'ai jamais entendue étant bébé. Il m'arrive parfois, de le voir évoluer dans la boulangerie où, avec son frère Ninou ils travaillaient pour leur mère. Le spectre de mon Père revient parfois me hanter, puis, il s'évapore comme par enchantement, me laissant souvent bien pensif, mais, heureux tout de même, d'avoir pu un instant, me l'imaginer comme dans un rêve éveillé.
Une rencontre que je fais très souvent et qui me permet, de m'adresser au Spectre qui se présente à moi = celui de Ginette + ma regrettée petite épouse, disparue depuis longtemps déjà. C'est surtout le soir, que, je l'aperçois faisant face à moi, toujours souriante et assise dans mon grand fauteuil. Elle me dit des paroles, d'une voix que j'ai déjà entendues autrefois et qui viennent frapper tous mes sens en éveils. Souvent, je lui reproche gentiment, de ne pas venir plus souvent, pour me retrouver dans mes rêves, alors elle me sourit et disparaît de ma vue, puis, un vide fait place à cette belle image de ma chère petite épouse.
Parfois, c'est le spectre souriant de ma chère maman, qui s'en vient me visiter à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Je la vois parfaitement, vacant à ses occupations culinaires, dans notre cuisine à La Calle ou, à son travail, au sein de l'hôpital de la cité. Je l'aperçois assez souvent se rendant à l'église où, elle aimait aller prier. J'entends encore distinctement le son de sa voix et je perçois sa grande gentillesse, qui s'échappe toujours de sa personne. C'est alors que très souvent, je lui demande pardon, pour n'avoir quelque fois pas été gentil avec elle. Toujours elle me sourit et me tend les bras, alors je pense qu'elle m'a depuis longtemps pardonné. Ma chère maman, vient donc souvent me retrouver et même dans mes rêves, lorsque je dors du sommeil du juste. Autrefois, elle m'avait dit =" tu verras, tu me pleureras lorsque je serais partie !" Comme elle avait raison ma maman chérie.
Il m'arrive parfois de rencontrer Pétronille et Vincenzo, mes grands-parents depuis longtemps décédés. J'entends leurs voix dont je perçois les accents venus d'Italie, dits avec les mêmes mots entendus jadis. Mon grand-père fume tranquillement sa pipe, assis sur les marches des escaliers de notre immeuble et ma grand-mère toujours active, vaque à ses occupations ménagères. Parfois, elle s'installe tout près de moi, dans son grand fauteuil d'osier pour me raconter son pays ou, d'autres histoires, qui me reviennent alors à l'esprit. Après avoir tournoyé dans ma tête, ils disparaissent comme par enchantement, me laissant bien nostalgique de leur présence.
Il est bon de noter, que tous ces spectres ne concernent pas que les défunts, es vivants en font aussi partie intégrante, mais, quelque fois se sont des objets inanimés, qui viennent parfois s'offrir à ma vue et qui me projettent dans le passé ; des images connues, qui surgissent souvent dans ma mémoire, comme par exemple, un souvenir ancien que j'ai pu vivre autrefois... Ainsi, c'est tantôt les uns et parfois les autres, qui, viennent à moi, pour me dire des phrases et des mots déjà entendus, ou bien, se borner au silence. Ils passent brièvement dans ma tête, mais, parfois, ils s'attardent pour causer un moment avec moi, du bon temps où La Calle était un petit paradis. C'est aussi des images de lieux connus, en particulier La Calle d'autrefois, que je revois distinctement et qui me permet, de déambuler librement dans les rues de mon village. Parfois, c'est un plat de macaroni, qui vient chatouiller ma vue et mes narines et je me revois attablé dans la cuisine familiale, aux côtés de mes grands-parents et de ma mère. C'est aussi une chanson ancienne, qui s'en vient parfois bourdonner dans mon oreille. Mais, il ne faut surtout pas oublier, toutes ces choses inanimées, que l'on a pu ramener avec nous, lors du grand départ de là-bas. Tous ces objets, qui, silencieux dans leurs recoins, viennent aussi discrètement me rappeler une histoire de jadis.
Toutes ces images du passé, me laissent à la fois de la joie, mais aussi parfois de la tristesse.
Je dirais, que, je n'ai jamais pu comprendre, les personnes qui ont peur des morts, eux, qui rencontrent et parlent aux défunts dans leurs rêves. Mais, si on peut rêver en dormant, on peut aussi rêver avec les yeux grands ouverts et apercevoir ces spectres du passé défiler dans nos mémoires.
La religion chrétienne nous enseigne, que lorsque la mort survient, l'hypothétique âme quitte le corps pour rejoindre le ciel ? Mais à mon humble avis, la mort ne peut être que le néant et ce n'est seulement que les souvenirs, qui, tels des spectres, s'en viennent parfois frapper la mémoire des vivants, tel un film, qui se déroule chaque fois devant les yeux.
Spectres du passé, c'est dans les souvenirs que vous apportez à l'homme, que, vous vous manifestez, pour lui rappeler ceux qui ne sont plus ou, sont encore de ce monde. Aussi, revenez me voir autant que vous le voudrez, je serais toujours là pour vous accueillir.
Docteur Jean-Claude PUGLISI
de La Calle de France
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Giens- 83400 HYÈRES.
Le 29.11.2022.
|
|
|
LE 22 A DUZERVILLE
( Un plagiat du 22 à Asnières de F.Raynaud )
Envoyé par M. Georges Barbara
|
 Angelo petit maraîcher maltais Bônois du Pont Blanc, décide d’aller vendre ses légumes au marché à bestiaux qui se tient le mardi à Duzerville.
Angelo petit maraîcher maltais Bônois du Pont Blanc, décide d’aller vendre ses légumes au marché à bestiaux qui se tient le mardi à Duzerville.
Pour ce faire, il se rend à la Poste de La Colonne avenue Garibaldi, pour réserver une place par téléphone ! Là il est en terrain conquis car c’est Lulu un de ses anciens flirts, qui tient le guichet !
*- » BONJOUR!!!!!!…. OH, HE….. BONJOUR LULU !….. O Luuluuuu…. je t’ai dis bonjour !
*- » Mamamille ! o tchoutche j’ai pas des z’haricots de mer dans les oreilles tout d’un coup, te peux pas crier un peu moins fort non, matsame que j’tai laissé et matsame t’yes resté ! Diocane j’te croyais que c’était les chacals de la route d’Bugeaud ... J’suis comme ma pauvre mère a m’a fait, te sais ? Mets-toi bien ça dans la tête, et si tu t’es levé t’sur la jambe gauche ce matin, va te prendre un bain en bas le lever d’l’aurore ça te calmera hen !. Et pis o l’homme te ‘ois pas qu’je suis entrain de faire mes totaux, non ? La madone de toi, laisse tomber o Angelo !
*- » Ah ! Bon alors je m’excuse de te demander pardon, hein ! Mais com’ moi j’suis devant la porte depuis 8 heures à attendre comme un Babalouke de peur de te trouver du monde, et que vous main’an c’est seulement à 9 heures que vous ouvrez votre fondouk, alors que t’sur la porte c’est écrit……. Bon passons, mieux que je dis rien. Et moi que je me suis dit agas qu’y lui soit pas arrivé quelque chose de mal à cette pastèque de la poste ! Et Oila le romerciement !
*- » Alors main’nan, ah, ah ….. ça y est ! T’le ‘ois ce mal appris de mes deux, rogards moi ça qu’j’ai devant mes yeux ,,,,,, et t’yes venu à la fraîche a’c tes yeux secs, et ta bouche en cœur, pour nous faire venir la fin du monde non ? O le daindalon de mes rêves….Tiens les cornes pour ta fugure, madone comme tu peux t’être cherche merde toi, Tu ‘ois pas si pour une fois on peut pas profiter, comme le receveur y l’est parti pour la journée à Constantine qu’il a une réunion ? Si c’est pas normal, agas que t’oublies pas que c’est aussi la fête de St Anne ? Ou c’est que nous s’en allons diomadonne ? Dans quel monde on vit, dis moi un peu, dans quel monde ? C’est la jalouserie qui vous étouffe ! Pour une t’chose qu’on peut même pas appeler du rotard !
*- » Bon on va pas en faire un plat de paste e fazoule Lulu, pour une heure par-ci une heure par-là….. Du moment que vous vous payez a’c nos impôts. Si on commence à chercher midi à quatorze heures Diocane c’est pas demain la veille que j’aurais mon numéro du téléphone. Alors quand t’yauras fini toi avec tes totaux, comme tu dis si bien, agas si te peux me passer le 22 à Duzerville
*- » Le 22 a Duzerville, atso et comment ? Qu’est ce que je ferai pas pour te faire plaisir, o figure de galinette, du moment que te le demandes pas avec les necks, et pis o tchoutche, te peux pas aller à pied à ton Duzerville ? Que c’est la porte à coté non ? Attends ,….. Allo le standard de la grande Poste, bonjour ? Ici c’est la poste d’la colonne ? Je voudrais un numéro si c’est pas trop vous demander madame. Mais qui c’est cette voix… ? Ca me dit quèque chose…. C’est toi Christiane ? Ouille’man t’yes de service ? Je t’ai vite roconnue,,,,,
Comment tu vas, on t’a pas vu au bal t’sur la place de l’église d’la Colonne hier au soir ? Toi que te manques pas une fête de St Anne ! Ah t’yavais d’la famille ah bon ! Dis moi CriCri si tu savais comme on s’est bien amusées avec ma sœur, y’avait même cet’ patelle de Titin te sais celui a’c qui je sortais avant... Ouais mon ancien béguin c’est ça ! Et ben j’te dis pas, parcequ’en plusque, laisse le qu’y me tourne après cette sangsue. A tous les tangos y se pointait, cet obsédé textuel. C’est pas la honte qui va t’lui monter à la fugure à ce mal appris !
*- » Eh Oh Lulu et mon 22 à Duzerville ? Te pense ou quoi ?
*- » Qu’est ce que tu me dis là Cricri ? T’yentends parler darrière moi ? … A oui j’allais oublier c’est Angelo qui veut ….Heuuu ( Dieu en préserve, je m’arrapelle plus déjà le numéro ),C’était quoi Angelo que te voulais déjà ?
*- Le 22 à Duzerville !
*- Le 22 à Duzerville ouais c’est ça ! Alors après quand t’yauras un moment o Christiane te me passes le 22 à Duzerville, oui c’est ça le 22 belle ! Mais y’a pas le feu o Fi !Te mange pas le sang pour ça ! Et pis quand te seras pas de service, viens faire un tour, l’apremidi c’est bon ya pas grand monde !
*-« Lulu par St Augustin, ça va être long mon Duzerville ?
*-« Te crois que j’suis le marabout de Sidi Brahim moi ? J’suis pas dans le téléphone o fils !…. A’c toi je commence bien ma journée tiens ! Attends, voila Alfredo Amalfitano le marchand de fromage qui rentre Bonjour Alfredo c’est pour quoi ?
*- » Loulou comment tou vas ? Moi jé voudrrrrais le 241 à Palerma, c’est oune type qué m’a achété do fromage, c’est pour asavoir quand je va t’lui faire c’ta madone dé colis.
*- » Une minute Alfredo... Allo... Allo Palerme,….. Palerme Italie ? A non pardon où j’ai la tête moi ce matin avec ce genre de Paris Soir qui m’a tout troublée ! Palerme Sicile oui, j’avais oublié.. Si vous plait, passez moi le monsieur qui l’achète le Fromage,,,,, c’est pour Alfredo…. A c’est votre frère... Alfredo cabine 5 ! 6 moins 1 !
*- » Salute o paysanou, comé sta, va bene,,,,,,
*-» Lulu et zeck eux.., enfin, diocane mieux je dis rien, je me le garde pour moi….... Et moi que c’est seulement le 22 à Duzerville…. Tu t’arrapelles ! Que je suis obligé de retenir une place au marché mardi pour me vendre ces 4 légumes du jardin ! Je vais être en retard encore une fois.
*- » Je le sais Angelo te sais le téléphone moderne, mais toi à debon avant que tu comprends, c’est seulement une question de distance !
*- » Si C’est comme tu dis alors, mais qui cats y va comprendre queque chose avec toi !
*- » Bon alors attends un peu et soit un peu poli. Laisse passer le monsieur qu’y l’est derrière toi lui il est en vacances …. C’est pourquoi cher monsieur ?
- » Je voudrais madame la personne qui s‘occupe des congés aux contributions à Alger ! Que je sais pas quand je dois reprendre mon travail !
*- » De suite Monsieur, vous savez nous les gens qui viennent en vacances à chez nous, c’est eux qui z’ont tous les droits, c’est comme si vous êtes d’la famille !….Allo le central de Bâb-el-oued ? Passez moi les contributions pour voir avec les congés des estivants. Ah justement vous l’avez en ligne ? Monsieur l’estivant cabine 7 ! Trois fois 2 plus 1 !!
*- » Que vous êtes charmante madame, quelle ville accueillante que ce Bône la Coquette ! …..Ah Allo c’est vous monsieur le directeur, c’est pour vous dire que j’avais oublié de poser mes congés avant de partir ; et alors…..!
*- » Dis o Lu pour l’âme de tes morts, sois gentille, j’en peux plus, j’ai le cœur qui tape, oilà que je transpire, y va me venir une crise de l’adrénaline. Je crois que je fais de la tapicardie... Essaies de me passer si te peux le 333 à Sidi-Bel-Abbes ?
*- » A Sidi-Bel-Abbès ? Et comment de suite mon Angelo ! Allo…. Allo...C’est la légion étrangère ?...Ya un mec qui veut vous parler….Quoi ? Non c’est pas pour s’engager, y tient tout juste debout michkine, c’est une vraie esquelette, et je sais ça qu’je dis, je l’ai tellement fréquenté vous savez ! Et pis si vous le jetez en parachute lui, et ben vous allez le chercher à Tamanrasset ! Mais c’est sûrement pour des choses sérieuses, je crois que c’est pour des légumes ; Merci !….. Angelo, t’ya Bel Abbes cabine 6 oui le 6,,,, 4 et 1 plus 1!
*-» Allo Bel Abbes ? Oui c’est bien Bel Abbes ?….Adebon, Zètes surs ?…. ,
Je fais pas une horreur non ? Pour l'âme de vos morts, enlevez-moi tout ce contrariage que j’ai t’sur moi, Monsieur le caporal VOUS POUVEZ PAS ME PASSER LE 22 A DUZERVILLE…. ! OUI LE VINGT DEUX ;….LE VING DEEDEUUUUXXX !
• ALLO DUZERVILLE ??????
Georges Barbara, janvier 2024
|
|
ADIEU L’ETE, ADIEU LES VACANCES
Par Camille BENDER
Echo de l’Oranie N° 265
|
Avec les premiers frissons de l'automne, nous avons compris que le temps béni des vacances était terminé. Finies les promenades et les randonnées en montagne, fini les baignades, le farniente et la « bronzette » sur les plages, finis le temps des loisirs et le plaisir de ne rien faire, sinon de profiter des petites joies de l'existence sans consulter sa montre à tout bout de champ : lire, se promener, retrouver des amis, oublier le temps enfin !
Je me souviens d'une vieille institutrice qui me disait « moi, le premier juillet, j'arrête toutes les pendules de la maison, je ne veux plus savoir l'heure jusqu'à la rentrée » C'est vrai que cette course après le temps est devenu l'une des causes majeures de notre stress... Sommes-nous donc si pressés de mourir ?
Avec les beaux jours de l'été était arrivé le temps des festivals, et pas seulement dans les grandes cités comme Aix ou Avignon, mais dans de nombreuses petites villes et villages qui voulaient participer à ce développement culturel de notre pays, si bien que la France était devenue une immense salle de spectacles où chacun trouvait, selon ses goûts, de quoi se divertir, vibrer ou s'émouvoir. Festival de musique sacrée qui a enchanté les admirateurs de Bach ou Mozart, attirant une foule immense dans les églises et cathédrales.
Festival de jazz dans les arènes de Cimiez, à Juan les Pins et dans les villages environnants, pour le plus grand plaisir des jeunes, fans de Sidney Bechet et d'Armstrong. Festival de musique classique avec les orchestres philharmoniques sous la direction de maître, comme Marcello Panini, Philippe Bender, Gian Carlo Del Monaco et avec des solistes remarquables : Gabriel Tacchino ou Aldo Ciccolini.
Festival de chœurs régionaux rassemblant des centaines de chanteurs, pour la plus grande joie des amateurs de chorales, sous la direction de chefs d'orchestre comme Michel Piquenal.
Festival de théâtre, celui d'Avignon, bien sur, qui, depuis Jean Vilar est l'un des plus côtés; cette année la pièce de Shakespeare : Henri V, peu connue en France, a été créée et a valu un triomphe à sa vedette : Philippe Torreton.
Festival d'œuvres lyriques, à Aix en Provence ou "La flûte enchantée" de Mozart est toujours accueillis avec plaisir par les admirateurs du grand Amadéus tout comme le célèbre Don Giovanni, du même auteur.
Festival de musique de chambre au monastère de Cimiez et sur le parvis de l'église St-Michel de Menton.
Je ne pourrais pas vous citer tous les festivals qui ont embelli notre été à travers la France, le journal tout entier n'y suffirait pas, mais il y en a un qui me tient à cœur et dont je voudrais vous dire quelques mots : c'est le festival du livre, il y a en a eu d'assez nombreux dans plusieurs régions, mais c'est celui de Nice qui m'a paru le plus réussi.
Pour sa quatrième édition, il s'est ouvert au début de l'été (25-26 et 27 juin) au jardin Albert 1er, transformé en grand livre ouvert, sous un soleil radieux avec un prestigieux parterre d'écrivains (250) et des milliers de visiteurs. On y a retrouvé, avec plaisir, "les écrivains d'ici", ces niçois auxquels la carrière littéraire a souri : Louis Nucéra, Raoul Mille, Alfred Hart, Alain Lefeuvre, Didier Van Cauwelaert (qui cumule les prix littéraires et le marathon des signatures) et puis ceux faisant partie du panthéon littéraire : Robert Sabatier, Jean-Marie Rouart, Irène Frain, Denis Tilinac, Vladimir Wolkoff, Alphonse Boudard, Yvan Audouard, Geneviève Dormann, Yves Berger, Edouard Manet, le merveilleux Jean-François Deniau dont le dernier livre "Tadjoura" est un pur chef d'œuvre. On y trouvait aussi quelques hommes politiques qui se lancent dans l'écriture : Robert Vigouroux, Alain Laville, Pierre Péan, Jean-Louis Debré ( très décontracté en chemisette à manches courtes, il est vrai que dans les stands, il faisait une chaleur de bain maure) quelques artistes aussi, attirés par la plume, se mêlaient à eux, les comédiens : Anaïs Janneret, Christophe Malavoy, Marie-Christine Barrault, quelques chansonniers comme Laurent Ruquier et, surtout, Jean Amadou qui dédicaçait à tour de bras ses deux derniers ouvrages; "De quoi je me mêle" et "Vous n'êtes pas obligés de me croire". J'ai l'habitude d'écouter Amadou, voix familière aux auditeurs d'Europe 1 qui, presque chaque jour, nous donne une chronique sur l'actualité. Il les a regroupées dans ses deux livres pour notre plus grand plaisir, pourfendant les travers des technocrates, qu'ils soient hexagonaux ou européens, les hommes politiques, les incohérences de l'administration et les comportements irrationnels de nos contemporains. C'est impertinent, c'est léger, pétillant, et pourtant c'est grave. Voltaire n'est pas loin. Quel esprit possède ce grand diable d'homme et quelle érudition ! Mais ses critiques pleines d'humour ne sont jamais méchantes ni cruelles. Si l'auteur scrute l'actualité, il dresse un tableau souriant un peu acide, des faits divers et des évènements de notre vie quotidienne au fil des jours.
Seize auteurs Anglo-Saxons ont été présents cette année au festival du livre de Nice et succèdent ainsi aux écrivains italiens, invités l'an dernier. La plupart réunis sur un même stand, sous les tentes blanches dressées tel un camp du " Drap d'Or " nous sont peu familières en dehors de Leldin et Dresdon - Quel écho leur présence éveillera-t-elle auprès du grand public ?
La Côte d'Azur qui a hébergé, autrefois : Wells, Virginia Woolf, Joseph Conrad, Scott Fitzgerald, Hemingway, Somerset Maugham, reste fidèle à son image : ouvert à des écrivains venus d'ailleurs, qui savent la redécouvrir et lui ouvrir d'autres horizons.
Outre cet hommage rendu à la littérature anglo-saxonne, une rétrospective de l'ensemble des albums de Tintin, a attiré beaucoup d'amateurs de B.D - la nostalgie `"Hergé" se porte bien, merci. La nostalgie "Colette" aussi. Pendant le festival, on a rappelé le grand talent de cette femme hors du commun : conférence, table ronde autour de ses livres, cinéma, gastronomie, pour magnifier son œuvre.
Je m'en voudrais vraiment, si je ne mentionnais pas, moi, une oranaise, le stand de l'Algérie ex-Française. J'y ai rencontré beaucoup de mes compatriotes attirés par les livres de nos écrivains "Pieds-Noirs", et parmi ces ouvrages "L'Agonie d'Oran" de Geneviève de Ternant - Remarqué aussi, les magnifiques albums illustrés sur Alger, Oran, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès (celui de Mostaganem est en préparation) Ce sont de magnifiques photos de notre pays : ses rues, ses maisons, ses monuments, ses écoles, ses universités, ses églises et chapelles, ses campagnes, ses ports, ses jardins, tout ce que nous avons crée et que nous avons laissé, qui sont autant de souvenirs vivants nous rappelant notre pays perdu.
L'été n'a pas été seulement celui des festivals et des vacances joyeuses, le tremblement de terre de Turquie, de Grèce, de Taïwan, du Mexique, les typhons sur les côtes des Etats-Unis ont fait des milliers de morts et de blessés, sans parler des dégâts matériels incommensurables et, comme si les catastrophes naturelles n'avaient pas assez fait de victimes, les massacres au Timor Oriental ont ajouté à l'horreur de tous ces sinistres. Bien sûr, ce n'était pas la réalisation des prophéties de Paco Rabanne qui annonçaient la destruction de Paris pendant l'éclipse, avec la chute de la station Mir (il a, d'ailleurs, avoué, avec beaucoup d'humilité, s'être trompé) mais, tant de malheurs sur notre planète Terre, se juxtaposant, avaient un goût de fin du monde.
Rassurons-nous, ce n'est pas encore pour demain. Nous voilà en automne ... l'été n'est plus qu'un souvenir ! Autrefois là-bas, en Algérie, à la même époque les vendanges étaient presque terminées et, dans les campagnes, une odeur de moût et de vinasse flottait dans l'air. C'était l'aboutissement d'une année de travail et dans les vignobles, les feuilles de vigne prenaient des teintes mordorées avant de tomber, comme toutes les feuilles mortes.
Les vacances n'étaient pas achevées, les écoles n'ouvraient qu'au 1er octobre mais on sentait, déjà, l'odeur de la rentrée des classes, avec l'animation dans les librairies et papeteries, où l'achat d'un cartable neuf, d'une ardoise et de cahiers, préoccupaient déjà les futurs écoliers. Le temps des vacances était fini ... Ici aussi, la vie quotidienne a repris son rythme normal avec ses soucis et ses problèmes.
« Pourquoi ce n'est pas toujours l'été ? » m'a demandé ma petite Isabelle qui va avoir bientôt six ans – Parce que les enfants, qui sont plus sensibles à la fragilité, ne comprennent pas pourquoi ce qui vit pendant les vacances, ne se poursuit pas au-delà des vacances.
Adieu l'été, adieu les vacances ! ne soyons pas tristes, dans quelques mois nous les retrouverons, et les apprécierons d'autant plus qu'ils nous auront manqué. En attendant, bonne rentrée à vous tous et que le soleil brille dans vos cœurs, même s'il est absent du ciel.
Septembre - Octobre 99, Camille BENDER
| |
BÔNE ET SON RAYONNEMENT FERROVIAIRE
par
ACEP-ENSEMBLE N° 292
|
Histoire et histoires de BÔNE par Louis ARNAUD
On a pu voir, tout au début de ce livre de souvenirs, que les diligences qui assuraient le service d'Aïn-Beïda, partaient de Bône, du Cours National, d'un café, qui connut à l'époque la grande vogue : le " Café Couronne ", ainsi nommé parce qu'il avait été ouvert et tenu par M. Couronne ou plus exactement par M. Corona qui avait francisé son nom.
Ce café occupait à l'origine, un vaste local, à l'angle formé par le Cours et la rue Saint-Augustin. Il a, plus tard, cédé l'angle à un commerce de lingerie, mercerie et bonneterie qui avait pour enseigne " Au Petit Paris ", et pour propriétaire, le claudicant, jovial et sympathique M. Cerf pour se cantonner dans ses trois dernières devantures qui donnaient sur le Cours.
La " Société Générale " vint, un four, prendre la place du " Petit Paris " pour ouvrir une succursale de sa banque à Bône. Finalement, la " Société Générale " et ce qui restait du vieux café abandonnèrent ensemble les lieux au profit du " Grand Bon Marché ", magasin de confections, qui s'installa dans le vaste local originairement occupé par le " Café Couronne ".
Le café " Couronne " avait toujours été le lieu où se retrouvaient tous les groupes (ils étaient nombreux et divers) qui combattaient la Municipalité quelle qu'elle fut, de Prosper Dubourg ou de Jérôme Bertagna.
De l'autre côté du Cours, était le café St-Martin (actuellement : café de Paris), quartier général des amis de la Municipalité.
Aux grandes journées de fièvre électorale, les habitués de ces deux cafés étaient dressés les uns contre les autres.
De chacune des terrasses qui s'opposaient en diagonale, partaient des huées ou des acclamations, des injures, des cris, des quolibets, des rires et de ces onomatopées grasseyantes et pétaradantes, qui sont, dit-on, une véritable spécialité bônoise.
Il en partait même des fusées lancées horizontalement qui, soit en rasant le sol, soit en traversant les feuillages du " Pot de Chambre du Père Dubourg ", venaient heurter la devanture du café d'en face, après avoir jeté l'effroi parmi les consommateurs attablés à l'extérieur.
" Le Pot de chambre du Père Dubourg " : on nommait ainsi, irrévérencieusement pour le maire de Bône qui l'avait placée là, juste devant le théâtre, une grande et belle vasque toute recouverte par les larges feuilles des nénuphars sur lesquelles retombaient la fine pluie de jets d'eau rafraîchissants.
Il n'y avait naturellement pas, à cette époque le monument élevé à la mémoire de Jérôme Bertagna.
Jérôme Bertagna, jeune et vigoureux, était certainement, ces journées-là, à la terrasse du café St-Martin, en chair et en os, dominant son entourage par sa parole énergique, son regard droit et sévère et sa belle et fière prestance.
Donc, dès 1885, lorsque Aïn-Beïda n'était desservie par aucune voie ferrée, le chemin le plus direct et le plus normal pour aller de la côte jusqu'à ce centre, partait de Bône qui était le débouché naturel de cette région au Sud-est constantinois.
On venait d'Alger, de Tunis, et de Philippeville, prendre à Bône, la diligence pour Aïn-Beïda. Aïn-Beïda, faisait vraiment partie de l'hinterland du port de Bône, et sa région était presque toujours représentée à l'Assemblée départementale par une personnalité bônoise.
C'est assez dire combien les intérêts de Bône et d'Aïn-Beïda étaient liés entre eux.
Les Bônois avaient tout lieu de penser que lorsque viendrait l'heure de la construction d'une voie ferrée pour des-servir Aïn-Beïda, cette voie viendrait, tout naturellement, suivant les routes que les nomades, les marchandises et les diligences avaient toujours suivies depuis les temps les plus reculés, rejoindre Oued-Zénati et aboutir à Bône par le chemin de fer de Bône-Guelma qui, depuis 1877, avait été prolongé jusqu'au Kroubs.
Hélas, dans ces spéculations d'avenir, si faciles parce qu'elles étaient conformes à la logique même, les Bônois ne tenaient aucun compte des sombres desseins que nourrissaient à leur endroit les Constantinois et les Philippevillois.
La récente construction, si difficilement et si onéreusement réalisée, de la ligne directe de Constantine à Philippeville aurait dû les tenir en éveil.
Ils savaient bien que cette ligne n'était pas naturellement rentable, pour employer une expression chère au monde des affaires, puisqu'il avait fallu employer l'argument, suprême et impérieux, de la défense nationale pour décider le Parlement à autoriser son établissement.
Ils auraient dû penser, dès lors, que pour alimenter son trafic, on allait tenter d'arracher, tant à l'Ouest qu'à l'Est du Département, les marchandises et les produits agricoles nécessaires à assurer son trafic.
Ils auraient même dû comprendre - connaissant le désir du chef-lieu, de ne point permettre à leur Ville de prendre une trop grande importance - que Constantine n'avait poussé à la construction de ce chemin de fer, et, secondé ainsi les efforts des habitants de Philippeville, que pour parvenir à ses fins en créant, tout près de Bône, un port concurrent vers lequel on pourrait ensuite amener, de gré ou de force, des produits agricoles ou miniers que l'on enlèverait au port de Bône, ce qui était la meilleure façon de freiner sa croissance. Ce manque de vigilance allait coûter cher aux Bônois. Il est vrai qu'ils avaient des raisons, et même d'excellentes raisons, d'avoir confiance dans l'avenir.
En 1871, en effet, à la suite d'une pétition signée par tous les habitants de Bône, le Gouverneur général à qui elle était adressée, s'était nettement rangé de leur côté et avait adopté le tracé d'un chemin de fer allant de Bône à Tébessa, en passant par Guelma, Sédrata et Aïn-Beïda que cette pétition préconisait.
Il n'y avait, à l'époque de cette pétition, aucune ligne d'intérêt secondaire dans le Département, et, c'était la première fois que la question des chemins de fer était posée à Bône.
Le tracé de cette ligne de Bône à Tébessa que proposaient les pétitionnaires, était certainement le plus rationnel. Il pénétrait dans le Sud-Est constantinois sans avoir à escalader, pour aller à Tébessa, les monts de Souk-Ahras et atteignait des centres, comme La Meskiana et Sédrata qui n'ont pas encore de chemin de fer et qui n'en auront probablement jamais, en raison des progrès que font journellement les transports automobiles routiers.
Le Gouverneur général, comme de juste, avait cru devoir demander l'avis du Conseil général de Constantine.
Le Préfet de Constantine, M. Desclauzas avait donc soumis la question au Conseil général qui, dans sa séance du 19 avril 1872, avait émis d'emblée un vote favorable à la prise en considération du vœu unanime des habitants de Bône.
Ces derniers étaient donc en droit de s'estimer satisfaits, et ils attendaient, sans aucune appréhension, que le Parlement fut saisi de la question, comme c'est la règle en matière de création de nouvelles lignes de chemin de fer.
En 1874, la construction de la ligne de Bône à Guelma avait permis aux Bônois de penser qu'il s'agissait de la réalisation de la première étape de leur projet de 1871.
Le prolongement jusqu'au Kroubs, en 1877, de cette ligne n'avait pu que les maintenir dans cette idée puisque de Oued-Zénati ou Aïn-Abid, pouvait par-tir un embranchement vers La Meskiana-Aïn-Beïda et Tébessa.
II n'y avait donc rien eu d'anormal dans le déroulement des faits depuis la séance du Conseil général du 19 avril 1872 qui pu susciter la moindre méfiance de leur part.
Tandis que les Bônois s'endormaient dans les délices de Capoue, en faisant de beaux rêves d'avenir, les Constantinois et les Philippevillois s'apprêtaient au combat :
Les gens de la région d'Aïn-Beïda réclamaient toujours le chemin de fer qu'on leur avait promis depuis longtemps et qui leur était indispensable pour évacuer leurs produits.
Le 15 mars 1879, la question des futures lignes ferroviaires à créer en Algérie, vint enfin devant le Parlement.
Parmi elle figurait la ligne qui devait relier Aïn-Beïda à Aïn-Abid, dernier tronçon du tracé qui avait fait l'objet de la pétition unanime de la population de Bône et qui avait déjà reçu l'adhésion du Gouverneur général de l'Algérie, en 1871, et du Conseil général de Constantine, le 19 avril 1872.
Les partisans du port de Philippeville avaient naturellement présenté un contre-projet qui reliait Aïn-Beïda à la gare des Ouled-Rahmoun, et, ce qui était mieux, ils avaient travaillé sourdement dans les couloirs en faveur de leur projet.
Ils furent si diligents et si adroits que la Commission des Travaux publics que présidait M. Albert Grévy, frère du Président de la République, et futur Gouverneur général de l'Algérie, se prononça en faveur du tracé Aïn-Beïda-Ouled-Rahmoun.
 La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, pour parvenir à cette décision, n'avait envisagé que le seul intérêt du port de Philippeville, alors qu'elle aurait dû se soucier uniquement de celui de la région d'Aïn-Beïda et avoir le souci de ne pas contrarier les lois naturelles. La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, pour parvenir à cette décision, n'avait envisagé que le seul intérêt du port de Philippeville, alors qu'elle aurait dû se soucier uniquement de celui de la région d'Aïn-Beïda et avoir le souci de ne pas contrarier les lois naturelles.
Aïn-Beïda, de par ces lois, était indiscutablement tributaire du port de Bône. Elle est placée à l'extrémité d'une ligne droite exactement perpendiculaire à la côte partant du port de Bône et les vallées de l'Oued-Cherf et de la Seybouse indiquaient, tout naturellement, la route à suivre pour arriver à ce port.
En outre, le trajet d'Aïn-Beïda à Ain-Abid, sur la ligne de Bône au Kroubs, était appelé à desservir les importants centres agricoles de La Meskiana et de Sédrata.
Aucun de ces arguments n'avait cependant retenu l'attention de la Commission des Travaux publics qui avait chargé l'un de ses membres, M. le Député Journault, de rédiger et déposer sur le bureau de la Chambre, un rapport concluant à l'adoption de la variante Ain-Beïda-Ouled-Rahmoun.
Voici les termes exacts du passage de ce rapport concernant l'adoption proposée
" Aïn-Beïda renferme dans ses environs des mines et des forêts importantes. Philippeville et Bône sont donc intéressées à s'en disputer le traf'.
" Votre commission a pensé que Constantine et Philippeville devaient avoir la préférence, comme compensation de la perte que fera nécessairement subir à ces deux Villes, la construction de la ligne Sétif-Bougie.
" Elle écarte donc la variante qui aboutirait à Aïn Abid ",
Pouvait-on dire plus clairement que l'on spoliait Bône pour compenser un dom-mage éventuel que subirait la ligne de Constantine à Philippeville, lorsqu'on construirait le chemin de fer de Sétif à Bougie ?
Pouvait-on mieux faire apparaître la parfaite inutilité de la construction de la ligne Constantine-Philippeville, puisque le Sétif-Bougie, qui figurait au premier rang du programme des voies ferrées à établir dans le Département, aurait suffi à évacuer vers la mer toute la production agricole et minière de l'Ouest constantinois, en même temps que le port de Bône, avec le chemin de fer de la Cie Bône-Guelma, assurerait l'écoulement des pro-duits de l'Est ?
Ce rapport de M. Journault est aussi très intéressant pour établir la véritable raison de l'établissement de la ligne Constantine-Philippeville, et de l'agrandissement du port de cette Ville.
En effet, M. Journault, parle " de la perte que fera nécessairement subir à ces deux Villes (Constantine et Philippeville) la construction de la ligne Sétif-Bougie ".
Pourquoi, parler de Constantine, puisque la variante proposée par la Commission n'aboutissait qu'à la gare des Ouled-Rahmoun, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres de Constantine ?
S'il ne s'était agi que d'une question d'embranchement plus ou moins rapproché du chef-lieu pour favoriser l'expansion des voyageurs vers lui, le choix de la gare d'Aïn-Abid n'aurait pas été moins avantageux pour Constantine.
Aïn-Abid n'est, en effet, qu'à quarante kilomètres à peine de cette Ville, c'est-à-dire, à dix kilomètres de plus de Oued-Rahmoun. Ce n'est certainement pas la question d'allonger d'une dizaine de kilomètres le parcours à accomplir par les voyageurs, où les produits venant au chef-lieu qui a pu être déterminante dans la prise en considération de la variante Aïn-Beïda-Ouled-Rahmoun.
Non, à vrai dire, il ne s'agit que d'un lapsus calami de l'honorable rapporteur de la Commission qui, étant donné l'insistance particulièrement intéressée des Constantinois en faveur de la variante Ouled-Rahmoun, avait dit croire sincèrement que la Ville de Constantine allait économiquement pâtir d'une orientation de trafic autre que celle qui le ferait transiter par Ouled-Rahmoun.
Si M. Journault avait connu la topographie des lieux, il se serait certainement rendu compte que le chef-lieu n'aurait matériellement pas du tout été atteint par l'adoption du projet se raccordant à la gare d'Aïn-Abid sur la voie principale.
Le chef-lieu n'avait donc, pour lui-même, aucune raison d'ordre matériel et économique, pour soutenir le tracé Aïn-Beïda-Ouled-Rahmoun.
S'il le soutenait, ce n'était que pour enlever à la région bônoise l'appoint particulièrement notable du Sud-Est constantinois et, cela toujours, dans le but d'empêcher la croissance trop rapide de Bône que tout paraissait prédestiner au plus florissant avenir.
Je viens de dire " l'appoint du Sud-Est constantinois ", alors qu'il peut paraître à certains qu'il aurait fallu dire de la région d'Aïn-Beïda.
Non, c'est bien de tout le Sud-Est constantinois qu'il s'agissait. On ne trouve la preuve dans les deux premières lignes du passage du rapport cité plus haut : " Aïn-Beïda renferme dans ses environs des mines et des forêts importantes".
Des mines ? Quelles sont ces mines ? Y en avait-il une, seulement, dans la région d'Aïn-Beïda?
Non, mais on savait déjà que la région voisine, celle de Tébessa, Morsott, renfermait, elle, de nombreux gisements miniers que les Romains avaient autrefois exploités et peut-être connaissait-on déjà l'énorme richesse phosphatine du Kouif, du Djebel-Dir, du Djebel-Onk et du Thashent
Comme il n'y a aucune mine, aucun gisement, d'aucune sorte, dans l'alentour d'Aïn-Beïda, on est contraint de penser que le port de Philippeville avait déjà, avec la complicité du chef-lieu, jeté son dévolu sur les richesses minières de Tébessa à Morsott.
On verra plus loin que c'était bien là l'intention de nos voisins, lorsqu'il s'agira des projets de chemin de fer à créer entre Aïn-Beïda et Tébessa et entre Guelma et Gastu dont il sera parlé dans les chapitres suivants.
L'émotion de la population bônoise fut intense, comme bien on pense.
Le Conseil municipal de Bône éleva une protestation unanime et solennelle contre les propositions de la Commission des Travaux publics de la Chambre.
Un mémoire rédigé par trois membres qualifiés et parfaitement idoines à tous les points de vue du Conseil, MM. Chaix, Duportal et Sistach, fut joint à la protestation.
M. Chaix, dont la famille, l'une des plus honorables et estimées de la Ville, est encore à Bône, était ancien élève de l'Ecole Centrale ; M. Duportal qui sortait de Polytechnique, était ingénieur en chef, directeur de la Compagnie de chemin de fer " Bône-Guelma et prolongements ", et M. Sistach était docteur en médecine et président de l'Académie d'Hippone.
L'Assemblée départementale qui s'était prononcée, le 19 avril 1872, en faveur d'un tracé Bône-Guelma-Ouled-Zénati-Aïn-Beïda-Tébessa, fut à nouveau saisie de la question à la demande des Bônois.
Le Conseil général de 1879, oublieux du vote unanime par lequel le Conseil général de 1872 avait, d'accord avec le Gouverneur général, adhéré à ce projet, se prononça à une voix de majorité pour le rejet de la protestation bônoise, pourtant si légitime en elle-même.
Et ce qui fut plus cruel encore pour les habitants de Bône, c'est que ce rejet ne fut dû qu'à l'absence de la séance du Conseil général, de deux conseillers généraux de Bône et sa région, M. Pasquier et M. Lagrange, qui, s'ils avaient pu assister à la séance, eussent naturellement apporté leurs voix à la protestation de la Ville de Bône qui aurait ainsi été adoptée.
Il paraît utile d'ajouter que le projet de construction du Sétif-Bougie s'est enfoncé de plus en plus dans l'oubli et qu'il n'en est officiellement plus question aujourd'hui.
Déjà, en 1920, le Conseil général de Constantine lors d'une nouvelle discussion relative au classement des lignes à construire, par ordre d'urgence, qui occupa trois longues séances, les 20, 21 et 23 novembre, avait retiré à cette ligne, malgré la protestation énergique de M. Dussaix, Conseiller général de Kerrata, le premier rang qu'elle avait occupé jusque là.
Les Constantinois avaient certainement prévu cela depuis longtemps, depuis, sans doute, qu'ils avaient entrepris de réaliser la liaison Constantine-Philippeville par une voie ferrée si difficile à construire, et surtout si coûteuse.
Ainsi, s'est déroulé le deuxième épisode de la lutte livrée par les Constantinois et les Philippevillois pour entraver le développement normal et naturel de la prospérité de la Ville de Bône.
| |
|
MUTILE N° 194, du 22 mai 1921
|
PRUSSIENS ET BOCHES
Les souvenirs de 1870, autant que ceux de la guerre récente doivent, entrer, en ligne, de compte dans le règlement de la dette des Boches.
Pourquoi ne dévoilerions-nous pas le fond de notre cœur et ne ferions-nous pas entrer en ligne de compte, carrément, dans cette question du règlement de la dette boche, les souvenirs cruels que tant d'entre nous ont conservés et dont il me semble qu'on ne parle plus assez.
Ce sont les souvenirs de 1870 et ceux de la guerre récente."
Depuis deux ans, et ces jours-ci encore, les Gouvernements alliés tournent en quelque sorte « en rond », de conférence en conférence. Celle dernière entrevue de Lympne, c’est très bien, pour la cordialité entre alliés qui est nécessaire, et notre Gouvernement a été bien inspiré en y prenant la part que l'on nous dit y avoir été prise par lui. On aboutirait, en somme, à un renforcement de l'Alliance et à l'approbation, par celle-ci, d'une attitude énergique que nous aurions le 20 mai, si les Boches ne nous paient pas les 12 milliards mark-or et ne nous donnent pas les gages que nous sommes en droit d'exiger.
Mais nous voyons en même temps, tout autour de la Conférence, et, surtout dans les journaux anglais, percer des sentiments qui nous froissent.
Il paraît que des délégations d'hommes politiques importants sont allés à Londres trouver le Premier Anglais et lui ont demandé encore de se prêter à une nouvelle tentative de conciliation vis-à-vis des Boches ; on pourrait faire, ont dit ces délégués, une dernière manifestation persuasive ayant d'agir.
Ces démarches seraient dictées par la perception de là situation intérieure de l’Angleterre et aussi par certaines considérations que l'on appelle «d'ordre philosophique », qui tendraient à presque pardonner à l'ennemi vaincu.
Eh bien, nous, Français, nous protestons de tout notre être meurtri contre cette politique d'intérêts locaux, d’intérêts nationaux et de mansuétude.
A la veille du jour, où nous exigerons le paiement de la dette, nous ne voulons plus étaler des colonnes de chiffres, mettre en avant nos souffrances matérielles, etc.. Nous déclarons franchement à nos amis anglais que nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux, du point de vue «sentimental »
C'est ce point de vue que l'on a trop oublié par une espèce de pudeur ou de légèreté d'esprit. Il nous plait d'y revenir et de dire qu'il doit tenir une grande place, sa place vraie dans nos préoccupations. Les Anglais, quelles qu'aient été leurs pertes en hommes et en argent, auxquelles nous compatissons, n'ont, pas souffert en 1870 comme les générations qui ont précédé celle-ci. Nous sommes en France un certain nombre, sexagénaires, qui, si nous ne portons pas le ruban des glorieux combattants de la première guerre, avons pourtant, conservé le souvenir des sévices que les Prussiens exercèrent contre nos parents, contre nous-mêmes, tous petits enfants, à celle époque où la France fut à deux doigts de sa perte.
Les Prussiens, nous les avons exécrés ; nous avons pris comme significatif de pillages, d'incendies, de rapts, leur nom qui, à l'école primaire ou au collège, a fait naître dans nos cœurs une haine — eh oui, une haine ! — une répulsion profonde à l'égard des oppresseurs de nos familles.
Pendant cinquante ans, nous avons courbé la tête ; nous l'avons relevée, on sait comment, contre des. hordes qui n'étaient plus surtout, composées de Prussiens, mais qui étaient pour nous, voici trois ans seulement, des BOCHES et qui seront toujours des BOCHES.
Malgré les tentatives de conciliation imprudentes et inutiles, malgré les efforts de quelques commerçants et industriels Français, qui admiraient ou feignaient d'admirer les fameuses méthodes allemandes, le fond de notre Nation est demeuré anti-prussien et anti-boche.
Nous avons vu se reproduire, durant ces quatre ans de guerre, les scènes tragiques ou ignobles qui s'étaient déroulées sous nos yeux d'enfants, en 1870, quand, habitants proches des frontières, nous fuyions l'envahisseur dans des charrettes remplies de paille. Nous avons par bonheur, écrasé les boches, alors que nos pères n'avaient pu que limiter les dommages de leur invasion ; mais, encore une fois, nous nous souvenons d'avant-hier, nous nous souvenons d'hier.
Nous ne sommes pas des impérialistes ou des « buveurs de sang » ; nous ne poursuivons pas, à proprement parler l'écrasement ou l'endettement de l'Allemagne, mais, il y a entre elle et nous tant de cadavres, tant, et tant d'incendies, de viols, d'infamies de tous genres que notre sang, en ce moment, bouillonne de colère et. nos poings se crispent. Nous en avons assez de ces discussions sur de pointes d'aiguilles, de ces finasseries qui cachent une cruauté et une fourberie, générique, toujours les mêmes.
Nous sommes les petits-fils des vaincus glorieux de 1870. Nous sommes les vainqueurs dont trop de mères et de filles portent les "effroyables deuils. Prussiens ou Boches, c'est la même chose. Il faut qu'ils s'inclinent devant les tombes et les ruines qu'ils ont creusées ou accumulées autour de nous.
PAUL BLUYSEN.
Député
6 avril 1921
| |
PHOTOS d'ALGER Sacré-Coeur
ACEP-ENSEMBLE 289
|
|
| La parade de la kémia
par Jean Claude PUGLISI,
|
|
Quand on ne se soucie plus de l'origine d'un mot, c'est qu'il a pris sa place dans la langue, accédant à la dignité de substantif, il a reçu son bâton de maréchal et ses lettres de noblesse.
Ainsi en est-il du mot kémia.
L'Académie lui servira une place, n'en doutons pas, quant au bout de sa longue patience elle abordera, vers 5000, la discussion de la lettre " K ". Mais il est encore temps d'en fixer l'histoire.
D'où vient le mot kémia ?
M. le professeur Berger-Vachon, arabisant distingué, m'a expliqué que le verbe " kem " exprimait en arabe, le geste des fumeurs de narghilé qui se passaient la pipe de bouche en bouche, pour en tirer une petite " bouffée ".
Puis le mot " kem " a pris le sens de petite chose….Et par extension dans le grand passage des langues, qui a présidé à la naissance de Bab-el-Oued, le mot " kem " a été appliqué " aux petites choses ", que l'on mangeait dans les bars avec l'apéritif.
Enfin le mot a été " latinisé ". Il est devenu " kémia ".
Et le voici candidat à une place officielle dans le Larousse…
Je vous offre cette explication, comme on n'a bien voulu me l'offrir.
Jouez avec, le but sera atteint.
La multitude des soucoupes alignées sur les comptoirs des cafés et remplies d'un assortiment hétéroclite de " petites choses " comestibles a toujours éveillé confusément dans mon esprit l'image des baraques des forains dont les rayons croulent sous les vaisselles entassées.
C'est une sorte de loterie. Mais à cette loterie de la gourmandise, tout acheteur d'une assiette est assuré de gagner au moins un rapprochant … et telle est la variété des lots proposés que le gagnant a toujours un peu l'impression de reprendre au pauvre cafetier à peu près toute sa mise.
Ici le plaisir du palais se double de la joie des yeux, la longue file des " kémia " alignées compose un accord riche en couleurs, une gamme somptueuse au milieu de laquelle triomphent :
- les jaunes vernissés = des tramousses,
- les noirs veloutés = des olives,
- les rouges corail des sauces où baignent :
- les escargots
- les gris feutré des fèves,
- l'argent cru des sardines patinées par l'huile bouillante,
- l'ocre fanée des moules, posées au fond de l'écrin noir de leur coquille,
- les verts durs des crudités.
Le buveur passe. Il cueille quelques notes dans la gamme selon : ses goûts, ses habitudes ou ses caprices et il s'en va.
La " kémia " fait partie des choses, qui le patron lui doit avec l'affabilité c'est le bonjour silencieux du comptoir, mais j'ai voulu savoir :
- Quelle part elle occupait dans les soucis du cabaretier modèle.
- Quelle charge elle représentait dans le budget du patron de café.
- Enfin quelles quantités des buveurs de Bab-el-Oued absorbaient chaque jour, tout en commentant devant un verre les évènements politiques et les potins du quartier. Voici un essai statistique sérieux sur ce problème léger.
Il serait bien vain d'établir une liste rigoureuse des différentes sortes de " kémia ".
Elle ne serait jamais complète parce qu'à côté des " kémia " classiques, immuables, il y a la foule des trouvailles individuelles. Tout ce qui manque, peut-être proposé au titre de la kémia et chaque cafetier accomplit des prodiges d'ingéniosité, pour tenter de retenir les passants par une recette inédite.
La " kémia " c'est le «broumitche ( l'amorce )» indispensable, avec lequel on prend toujours ce gibier bien difficile qui s'appelle le buveur.
On peut toutefois avancer qu'il y a en moyenne, une cinquantaine de kémias dites classiques parmi lesquelles :
- les olives,
- les tramousses,
- les cacahuètes,
- les bliblis figurent toute l'année sur tous les comptoirs.
Car il y a des " kémias " saisonnières :
- les tomates,
- artichauts,
- les betteraves,
- les poivrons,
- les fèves figurent dans cette catégorie.
Il y a aussi la " kémia " courante et la kémia rare … Celle que l'on offre à discrétion et celle que l'on rationne minutieusement.
- Les sardines,
- les petits rougets,
- les escargots et
- les moules composent la noblesse de la " kémia. "
Ce sont des cadeaux qui l'on mesure.
Chaque buveur a droit à deux sardines par verre ou un rouget.
Nul ne songe à transgresser cette règle rigoureuse. Mais les clients irascibles, ou simplement facétieux trouvent là une belle matière à protestations sonores et réclamations violentes qui n'étonnent personne mais présente à l'ambiance un cachet irremplaçable.
Et maintenant que consomme-t-on chaque jour à Bab-el-Oued ?
Voici des chiffres de ces mercenaires, qui servent indifféremment aux savants austères et aux journalistes factieux.
On mange en moyenne, un kilo de tramousses par jour dans les cafés par les clients.
Si le patron sert des tomates, la consommation quotidienne atteint quatre kilos.
Le samedi et le dimanche, les assoiffés dévorent en moyenne dans chaque café de Bab-el-Oued :
- un kilo d'anchois,
- deux kilos d'olives
- cinq kilos d'artichauts.
Si l'on aborde la " kémia " de luxe on atteint des chiffres effarants.
- Cinq kilos d'escargots
- Dix kilos de sardines, disparaissent chaque jour devant les comptoirs.
Si l'on veut établir une moyenne, on peut dire, qu'il y a une centaine de cafés à Bab-el-Oued dans chacun desquels, on consomme de deux à quatre kilos de " kémia " tous les jours, ce qui donne au bout de l'année le chiffre fabuleux de près de douze tonnes.
Il est difficile de chiffrer le prix de cette consommation.
Tous les articles n'ont pas la même valeur.
- Les tramousses par exemple viennent d'Espagne et valent 55 francs le kilo,
- les rougets sont chers,
- les artichauts plus abordables.
La " kémia " représente cependant une dépense moyenne de mille francs par jour pour le patron du café ou le gérant soucieux de sa réputation.
Ainsi plus de cent mille francs s'envolent chaque jour à Bab-el-Oued en " kémia " multicolore.
C'est la rançon d'une vieille habitude méditerranéenne … d'une coutume que chacun observe selon :
- son sens commercial,
- sa coquetterie et peut-être aussi
- sa personnalité.
Dis-moi la " kémia " que tu offres, je te dirai qui tu es !...
Bab-el-Oued raconté à Toinet. Jean Brune le journaliste. 1955
Docteur Jean-Claude PUGLISI,
de La Calle de France -
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage
Giens en Presqu'île - HYERES ( Var ).
|
|
|
Algérie catholique N° 2, février 1937
Bibliothéque Gallica
|
La Paroisse de Mers-el-Kébir
Le touriste qui, laissant la trépidante cité oranaise, s'engage sur la route du littoral, vers l'ouest, parvient au bout de 2 kilomètres, à Monte-Cristo. Là, un magnifique panorama s'offre à sa vue. Face à lui, l'immensité bleue de la Méditerranée. A sa droite, les falaises rocheuses, qui se terminent à la Pointe de l'Aiguille ; derrière lui, la montagne du Murdjaja, que couronne la chapelle de Santa-Cruz et un vieux fort historique. A sa droite, une baie immense, splendide, la baie de Mers-el-Kébir. Au fond de cette baie, au pied de la montagne du Santon, blottie, ramassée sur elle-même, se détachant admirablement en blanc, sur un fond de verdure, la petite ville de Mers-el-Kébir et tout le long de la corniche, des maisons, des hôtels, où viennent passer l'été, s'ébattre dans l'eau, de nombreux étrangers.
Il faut remonter dans l'antiquité pour trouver la première mention de Mers-el-Kébir. Connaissant le caractère, judicieux, pratique, utilitaire des Romains, il est évident qu'ils ont eu tôt fait de repérer, au cours de leurs voyages et en vue de la colonisation de ces pays, l'immense baie naturelle de Mers-el-Kébir, si bien protégée contre les vents et les courants.
Ils l'appelèrent : « Portus-Magnus » (Grand Port) alors qu'ils donnèrent au Port d'Arzew le nom de : « Portus-Déorum » (Port des Dieux. Il est certain que les Romains, peuple très religieux, avec leur civilisation, implantèrent, comme partout ailleurs, leur religion ; et leurs divinités durent être honorées ici, comme elles l'étaient à Rome. Toutefois, aucune trace, aucun vestige retrouvé à Mers-el-Kébir, ne permet de se faire une idée du culte rendu aux faux dieux à Portus-Magnus.
Pendant quelques siècles, après le départ des Romains, Mers-el-Kébir tombe dans l'oubli.
On peut s'imaginer sans peine, que vue sa situation géographique et sa proximité d'Oran, Mers-el-Kébir a joué un rôle important dans les luttes que se sont livrés les différents chefs arabes, turcs ou marocains, qui voulaient imposer leur domination dans la province d'Oran et avoir des débouchés sur la mer. Notre port n'était pas non plus ignoré des pirates qui venaient ou s'y réfugier ou y opérer des coups de mains. Au point de vue religieux, c'est le règne de l'Islam ; il est probable qu'aucune mosquée n'a été édifiée dans cette baie. En tout cas, on n'en trouve nulle trace. Les documents historiques de cette époque mentionnent à plusieurs reprises notre port. C'est à partir surtout du XVe siècle, que l'histoire de Mers-el-Kebir prend une tournure nouvelle, par l'entrée en scène de belligérants nouveaux : les Portugais et les Espagnols, ce sera désormais la lutte de la Croix contre le Croissant.
Oran, était devenu le repaire le plus important de la piraterie, dans l'Ouest. Et cela n'était pas sans inquiéter le Portugal, qui subissait les conséquences fâcheuses d'un tel état de choses. Aussi le roi Jean 1er, décida d'en finir. Le 14 août 1415, ses troupes s'emparaient du fort de Mers-el-Kébir, construit par les maures, de la baie et d'Oran. Malheureusement, il ne put pas conserver ses conquêtes et fut obligé d'abandonner les 2 places.
L'audace des pirates redoublant, le roi Don Manuel du Portugal résolut de porter un coup décisif. En 1501, il envoya une escadre formidable s'emparer de Mers-el-Kébir. Mais il échoua dans sa tentative, ce qui ne fit qu'accroître la hardiesse de ses ennemis, des pirates, qui allèrent, de plus belle, rançonner alors les côtes d'Espagne. Mal leur en prit, car le roi Ferdinand d'Aragon, envoya une armée de 5.000 hommes pour les combattre.
Le 23 octobre 1505, après un siège de 50 jours, la forteresse de Mers-el-Kébir tombait entre les mains des Espagnols, commandés par Don Diego de Cordova. Délire, prières, reconnaissance à Dieu pour une telle victoire. La Croix triomphait des Croissant..
C'est à cette époque que se place un des épisodes les plus importants de l'histoire d'Oran et de Mers-el-Kébir en particulier : la prise d'Oran par le Cardinal espagnol Ximenès et son séjour à Mers-el-Kébir.
Lorsque l'Espagne, entreprit de détruire le nid et repaire des pirates d'Oran et en même temps de planter la croix du Christ et ses bienfaits, sur ce sol africain, ravagé par la barbarie et où avait déjà coulé du sang des martyrs, où plusieurs expéditions avaient échouées, elle se servit comme base de départ de Mers-el-Kébir, occupée auparavant par Don Diego de Cordova. Cette formidable expédition contre Oran, avait été minutieusement préparée par un grand Cardinal, en même temps que grand politique, le Cardinal Ximenès. Elle fut dirigée par le Cardinal en personne.
La flotte espagnole quitta le port de Carthagène, le 16 mai 1509, en direction de Mers-el-Kébir. Favorisée par un temps propice, elle arriva le lendemain, jour de l'Ascension dans la rade.
Le Cardinal Ximenès, décida le débarquement immédiat des troupes, afin de commencer dès le lendemain, à l'aube, l'attaque d'Oran.
Savamment et rapidement menée, cette attaque fut couronnée de succès. Malgré la bravoure et les ruses des Maures et des Arabes, Oran tomba en quelques heures entre les mains des soldats de Ximenès. Le cardinal, heureux de cette victoire, fit rendre grâce à Dieu, à qui il attribuait ce succès «Non nobis, Domine, non nobis sed. Nomine tuo da Gloriam » répétait-il. Comme tous les vainqueurs à l'âme magnanime, le Cardinal Ximenès se montra plein de bonté, plein de charité à l'égard des infidèles qu'il désirait convertir au christianisme. Il organisa aussitôt le culte, transforma des mosquées en églises, établit un clergé régulier, installa des religieux Franciscains et Dominicains, qui avaient suivi l'expédition, dans de vastes bâtiments, fit bâtir un hôpital, etc..., etc... Le cardinal Ximenès avait de vastes projets, et voulait pousser plus loin sur la côte et à l'intérieur du pays, afin d'y implanter la croix du Christ et la domination espagnole. Mais, des circonstances impérieuses l'obligèrent à quitter précipitamment Oran. Il revint à Mers-el-Kébir et s'embarqua pour l'Espagne, le 23 octobre 1 509.
Cette mémorable expédition avait duré 7 jours. C'est donc un grand honneur pour Mers-el-Kébir, d'avoir hébergé dans sa forteresse, le cardinal Ximenès. Il y a dit la messe, car le Fort possédait une chapelle dont on voit encore l'emplacement. Le culte y était assuré, un chapelain était affecté aux servies et besoins religieux de la garnison. On a conservé pendant longtemps la plaque de granit qui avait servi de table d'autel au cardinal.
Plusieurs fois perdue et plusieurs fois reprise, la forteresse de Mers-el-Kébir fut définitivement abandonnée par les Espagnols en 1792. On voit actuellement sur diverses parois du Fort, encastrées dans les murs, de nombreuses inscriptions relatant les faits les plus saillants de l'histoire de Mers-el-Kébir, depuis 1505 jusqu'en 1792, certaines sont très bien conservées, en particulier celle qui est placée au fronton dé la porte d'entrée et qui consacre les améliorations apportées dans la défense du Fort par le général Argain, sous le roi catholique Ferdinand VI (année 1751) et cette autre, surmontée des insignes de la Toison d'Or, qui rappelle le fameux siège de Mers-el-Kébir, par Hassan Pacha, et qui se trouve sur la paroi de l'ancienne chapelle du Fort (Année 1563).
D'autres inscriptions, rongées par les intempéries, sont incomplètes ou inintelligibles, mais la plupart on y lit «l'an du Seigneur : 1566, 1670, 1698, 1669.»
On a peu de documents sur l'histoire de Mers-el-Kébir depuis 1792, date du départ des Espagnols, des Chrétiens consacrant la victoire éphémère de l'Islam et du Croissant, jusqu'en 1830, date de la conquête de l'Algérie, par la France. Les Turcs s'étant rendus maîtres d'Oran, ils occupèrent également Mers-el-Kébir, point stratégique de premier ordre et abri sûr pour leur flotte. Le croissant turc, remplaça, sur le Fort, l'étendard du Roi Catholique d'Espagne et une mosquée, la chapelle des chrétiens.
 Nous sommes en 1830. En vue d'obtenir la réparation d'un affront infligé par le dey d'Alger, Hussein Pacha, à notre Consul, M. Deval, le roi Charles X décida d'occuper Alger. Une expédition fut préparée à cet effet. Débarqué le 14 juin 1830, à Sidi-Ferruch, le corps expéditionnaire, sous le commandement du général de Bourmont, s'emparait d'Alger, le 5 juillet. Après Alger, ce fut le tour d'Oran. Des négociations pour la reddition pure et simple d'Oran, par le bey Hassan, furent entreprises. Quelques bricks de la flotte française, le Ruse, le Dragon, le Voltigeur, l'Endymion, vinrent mouiller au large de Mers-el-Kébir et d'Oran. Sur l'un d'eux, le Dragon, se trouvait le capitaine de Bourmont, fils du maréchal, chargé des négociations. Nous sommes en 1830. En vue d'obtenir la réparation d'un affront infligé par le dey d'Alger, Hussein Pacha, à notre Consul, M. Deval, le roi Charles X décida d'occuper Alger. Une expédition fut préparée à cet effet. Débarqué le 14 juin 1830, à Sidi-Ferruch, le corps expéditionnaire, sous le commandement du général de Bourmont, s'emparait d'Alger, le 5 juillet. Après Alger, ce fut le tour d'Oran. Des négociations pour la reddition pure et simple d'Oran, par le bey Hassan, furent entreprises. Quelques bricks de la flotte française, le Ruse, le Dragon, le Voltigeur, l'Endymion, vinrent mouiller au large de Mers-el-Kébir et d'Oran. Sur l'un d'eux, le Dragon, se trouvait le capitaine de Bourmont, fils du maréchal, chargé des négociations.
Hassan Bey, assiégé dans Oran avec 700 à 800 Turcs fidèles, par les Arabes qui ne voulaient pas de l'occupation française, hésitait cependant, car lui, désirait cette occupation qui lui assurait certains avantages.
Sur le conseil de chefs turcs, De Bourmont se décida, malgré les ordres de l'amiral Duperré, à occuper le Fort de Mers-el-Kébir, qui serait un point d'appui, une base de départ merveilleuse, pour s'emparer d'Oran ; c'était la reproduction du plan de campagne exécuté, un peu plus de trois siècles plus tôt, par le grand cardinal Ximenès.
Le 26 juillet, vers les 3 h. 30, de l'après-midi, les trois bricks : le Dragon, le Voltigeur et l'Endymion rasèrent les fortifications du Fort et vinrent successivement sous les batteries, sans crainte des 42 canons qui pouvaient les détruire en un instant. Avant que la garnison ait eu le temps de dessiner la moindre attaque ou le moindre geste de défense, les capitaines Le Blanc et Ropert, commandant, le premier, le Dragon, et le second le Voltigeur, et l'Endymion à la tête de 110 marins, sautent à terre, s'emparent de la forteresse et réduisent l'ennemi à l'impuissance. Le lieutenant de vaisseau, Estienne, remplaçait sur le Fort, le pavillon turc, par le drapeau du roi de France. La prise du Fort de Mers-el-Kébir avait durée une demi-heure.
Le capitaine de Bourmont partit aussitôt pour Alger, annoncer à son père ce brillant fait d'armes et hâter l'envoi du corps expéditionnaire.
Il avait laissé la garde du Fort au capitaine de frégate Ropert. Cet habile et ferme officier s'organisa contre les attaques possibles et prépara les conventions pour la remise d'Oran.
Les renforts attendus arrivèrent le 13 août avec la division navale, sous les ordres du capitaine de vaisseau Massieu de Clerval. Mais deux heures avant que la « Sirène », frégate que montait Massieu de Clerval, fut au mouillage, le commandant Robert était mort d'épuisement. Il fut enterré sur la plus haute plate-forme de la forteresse. Sa tombe, très simple, surmontée d'une croix en fer forgé, porte sur une petite colonne de granit, l'inscription suivante : «Ropert, Capitaine de frégate, Commandant les Bricks, Voltigeur et Endymion, mort le 13 août 1830 après avoir pris possession du Fort de Mers-el-Kebir. Requiescat in pace. »
Cette tombe, qui rappelle un si glorieux souvenir, n'a jamais cessé d'être pieusement entretenue ; chaque année, le 1er novembre, une simple et touchante cérémonie s'y déroule, en présence des autorités civiles de Mers-el-Kébir et des autorités militaires du fort, d'un officier de marine et d'un détachement de marins d'Oran. Beaucoup de touristes ou de visiteurs de marque viennent voir cette tombe s'y agenouiller et remercier Dieu, d'avoir accordé la victoire à la croix du Christ grâce à l'héroïsme des enfants de la France.
Une des pénibles conséquences de la révolution de juillet, fut qu'on songea à abandonner les projets de conquête de l'Algérie. Les troupes françaises se retirèrent donc de Mers-el-Kébir après avoir fait sauter les hautes murailles qui surplombaient la mer. Bientôt on regretta l'abandon d'une position aussi stratégique et le haut commandement décida de la réoccuper. Le 14 décembre 1830, le général Damrémont débarqua avec de nouvelles troupes et s'empara définitivement de la forteresse de Mers-el-Kébir, clef de sûreté de la baie et du port d'Oran. C'est de Mers-el-Kébir que partit, le 16 décembre, le colonel Le Fol, à la tête du 21ème de ligne, pour aller occuper le Fort Saint-Grégoire, qui dominait Oran, première étape vers la prise de cette ville.
Telle est, succinctement retracée, l'histoire glorieuse de la rade et du fort de Mers-el-Kébir, jusqu'à l'occupation française. Depuis 1831, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Le fort, occupé par une petite garnison, passe au second plan. Un village se crée au fond de la rade, au pied de la montagne du Santon, Saint-André de Mers-el-Kébir. La rade, dont l'exceptionnelle situation géographique, n'a pas échappée à nos gouvernants, est en passe, comme je le disais au début, de prendre un essor magnifique, de devenir un port de guerre de tout premier ordre, complément du grand port commercial d'Oran, base importante de défense des côtes Marocaine et Algérienne.
Histoire religieuse
Après l'occupation française et la pacification du littoral, de nombreux pêcheurs espagnols et italiens, ces derniers originaires de l'île de Procida, vinrent s'installer à Mers-el-Kébir. Ces pêcheurs connaissaient déjà ces endroits, car ils y venaient pêcher le corail.
Quelques fonctionnaires français complétaient la population. Les débuts furent, comme partout ailleurs, très durs. De nos jours, dotés de toutes les facilités et de toutes les commodités, nous avons tendance à croire qu'il en a toujours été à peu près ainsi. Les premiers habitants durent défricher, peiner, pour bâtir quelques misérables masures.
Beaucoup n'avaient pour toute maison, que leur pauvre barque. Ils vivaient donc pauvrement. Le gouvernement français, ému d'une installation si primitive, décréta la création d'un village qui s'appellerait Saint-André-de-Mers-EI-Kébir. Construit en amphithéâtre, au pied et sur les flancs de la montagne du Santon, qui domine la rade, il fut érigé officiellement, en 1841.
La colonie italienne était de beaucoup la plus importante. Elle comptait 1.200 membres environ. Tandis que de nos jours, les Espagnols ont presque tous abandonné la pêche, les Italiens, pour la plupart, continuent le rude métier de pêcheurs avec des engins et des barques qui n'ont guère évolués.
 Cette colonie italienne, venant de l'île de Procida, avait gardé toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la foi de leur patrie. Cette colonie italienne, venant de l'île de Procida, avait gardé toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la foi de leur patrie.
Longtemps, ils sont restés fermés à toute influence étrangère, vivant jalousement repliés sur eux-mêmes, ne se mariant qu'entre eux, ne parlant que leur dialecte, leur patois propre. C'est ce qui explique en grande partie, qu'ils sont restés profondément religieux, croyants et pratiquants, qu'ils ont conservé, chose assez rare à notre époque, des manifestations publiques de piété, telles que les processions de la Fête-Dieu, et de Saint-Michel, qui attirent chaque année des milliers de personnes. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces grandioses manifestations de piété.
Gens profondément croyants et pratiquants, les pêcheurs italiens, sitôt arrivés à Mers-el-Kébir, s'organisèrent pour leurs exercices de piété. Au début, ils ne purent pas, et cela se comprend, satisfaire pleinement leur dévotion. Il fallait un prêtre. En guise d'église et de presbytère, ils se servirent tout d'abord d'un pauvre magasin — un prêtre venait d'Oran, assurer le culte.
Ce magasin, petit à petit, ils l'aménagèrent, l'embellirent, Dieu sait au prix de quels sacrifices, et en 1843, Mgr Dupuch, évêque d'Alger, érigeait le village de Mers-el-Kébir, en paroisse et le dédiait à Notre-Dame du Bon-Secours, dont lui-même avait béni la statue, au milieu d'un grand apparat, grâce au concours des équipages de la Flotte d'Etat et de toute la population.
Il aurait voulu également, à cette occasion, bénir de nouveau l'ancienne chapelle espagnole du fort de Mers-el-Kébir, celle-là même dans laquelle le grand cardinal Ximénès avait dit la messe, trois siècles plus tôt ; mais ce fut impossible. Cette chapelle avait été transformée en écurie et Mgr Dupuch ne put pas obtenir qu'elle fut rendue à sa première et sainte destination.
Le premier curé de Mers-el-Kébir, fut M. l'Abbé Martinez, remplacé peu de temps après, par M. l'Abbé Cases, à qui succédait en 1846, M. l'Abbé Capriles.
Au mois de juin 1839, Mers-el-Kébir avait reçu la visite de Mgr Dupuch, qui était venu exprès d'Oran, apporter à la population chrétienne et laborieuse, ses paternels encouragements. Ce culte fut assuré jusqu'en 1879, dans un magasin qui avait été petit à petit embelli, afin d'être un peu moins indigne du Dieu tout-puissant, qui descendait là tous les jours.
Il est vrai que le Christ est né dans une étable, a vécu pauvrement et nous a laissé l'exemple d'une grande humilité' et pauvreté. Pendant cette période, Mers-el-Kébir a eu successivement comme curés, MM. Lloret (1850-1864), Malbec (1864-1868), Lachet (1868- J 878).
A plusieurs reprises, le Conseil de Fabrique de la paroisse, s'était plaint de l'exiguïté et même de l'insalubrité du magasin-église, et avait demandé la construction d'une nouvelle église, mieux située, plus spacieuse, et plus digne de Mers-el-Kébir. Ce n'est qu'en 1874 que l'on entreprit la construction de cette nouvelle maison du Bon-Dieu, celle-là même qui sert aujourd'hui au culte. On doit convenir, à la vérité, que les paroissiens de Mers-el-Kébir, n'ont rien perdu à attendre, car l'édifice est vraiment splendide ; un des plus beaux du diocèse d'Oran — vaste, puisqu'il peut contenir plus de 600 places assises, bien éclairé, bien aéré, il est d'une élégance rare — style roman, nef centrale avec bas-côtés, six arceaux, avant-chœur, permettant d'évoluer à l'aise pour les grandes cérémonies, autel et table de communion en marbre blanc, vaste sacristie, escalier monumental lui donnant un air de petite cathédrale, le tout formant un bel ensemble, ravissement des nombreux touristes qui viennent le visiter.
Ce n'est qu'à Pâques 1875, l'église n'était pas encore complètement achevée (elle devait l'être à la fin de l'année), que pour la première fois, on y célébra les Saints Mystères, à la grande joie de tous les paroissiens. Dès lors, la vie paroissiale prit un essor nouveau. Les Napolitains purent plus facilement donner libre cours à leur désir de grandes cérémonies.
Le 30 septembre 1883 eut lieu la fête de la Saint-Michel ; Mgr Pierre Marie-Etienne Ardin, évêque d'Oran, venait à Mers-el-Kébir, bénir la grosse cloche, celle-là même qui encore aujourd'hui, de concert avec sa jeune sœur, lance à tous les échos, ses notes joyeuses ou tristes, selon les circonstances.
Autre événement important dans l'histoire religieuse de Mers-el-Kébir : c'est l'arrivée et l'installation, le 6 décembre 1893, dans la paroisse, des religieuses de Notre-Dame Auxiliatrice, appelées Sœurs salésiennes. Dieu sait le bien immense qu'elles ont fait dans la paroisse, depuis bientôt 43 ans — s'occupant principalement du patronage des enfants, de l'ouvroir, des Enfants de Marie; elles ont contribué, pour une large part, non seulement au maintien, mais encore à l'accroissement de la piété. Précieuses auxiliaires du curé, elles s'occupent également du chant des jeunes filles et du catéchisme des petites filles ; elles vont apporter au chevet des malades, avec l'espérance chrétienne, la résignation et les douces consolations. Combien de moribonds doivent à ces charitables religieuses, leur départ dans l'éternité munis des derniers sacrements.
On ne peut pas parler des Religieuses Salésiennes de Mers-el-Kébir, sans évoquer le souvenir de l'une d'elles, Sœur Louise Cecottino, et connue uniquement sous le nom de Sœur Elise. Pendant 27 ans, animée d'un zèle inépuisable, elle s'est prodiguée à ses chers enfants : petites et grandes, aux mères chrétiennes, aux anciennes élèves, aux pauvres, aux malades. Elle était de toutes les familles, de toutes les joies, de toutes les peines ; sa mort a été un deuil paroissial, et son magnifique enterrement a été une preuve indubitable de l'affection qu 'on lui gardait. Encore maintenant, on parle de Sœur Elise, et avec quelle admiration, avec quelle reconnaissance !
La paroisse de Mers-el-Kébir, a eu successivement comme pasteurs, depuis la construction de la nouvelle église : MM. Poux (1878-1884), Huertas (1884-1886, Succare (1886-1889), Gilloux (1889-1898), Guinefoleau ( 1898-1902), Record (1902-1912), Royère (1912- 1919), Rouchaleou (1919- 1931) Mahs (1931-1932) et Cellier (1932-1935) qui ont apporté leur contribution à l'embellissement matériel du Temple de Dieu, mais surtout au bien des âmes et de la vie paroissiale. Car la vie paroissiale est très intense à Mers-el-Kébir. L'église est vaste et pourtant, elle se remplit tous les dimanches aux deux messes.
Les offices, en particulier les Adorations, sont très suivis. Les dimanches, et surtout les fêtes, sont marqués par de nombreuses communions.
Les groupements religieux sont nombreux, tout d abord : les Mères chrétiennes, les Anciennes Elèves des Religieuses, les Enfants de Marie, les Aspirantes, les Croisés (garçons et filles) ; puis, Association Saint-Pierre (jeunes gens), la Confrérie Saint-Michel — un Syndicat catholique de Patrons et Marins pêcheurs fondé par Son Excellence Mgr Durand avec l'aide de M. le curé Rouchaléou. Il reste cependant encore beaucoup à faire, surtout si Mers-el-Kébir prend de l'extension.
Mais, un trait particulier de cette paroisse, unique en Oranie et peut-être même en Afrique du Nord, ce sont les splendides et imposantes processions qui s'y font avec un grand éclat. On y accourt en foule, par milliers, d'Oran et des villages environnants.
A tout seigneur, tout honneur : la procession de la Fête-Dieu se déroule dans les rues du village, pavoisées et décorées. Le Saint-Sacrement est porté par Son Excellence, Mgr I'Evêque d'Oran, qui se fait un plaisir de présider ces fêtes pour témoigner à ces braves pêcheurs, le paternel intérêt qu'il leur porte.
Le long ruban de la procession se déroule jusqu'à la Marine et revient à l'Eglise, en passant par le quartier Saint-Michel, après une halte à cinq reposoirs.
La procession de la Saint-Michel attire beaucoup plus d'étrangers, et le cortège est plus long. Avant de décrire cette impressionnante cérémonie, il faut dire que les Napolitains ont une très grande dévotion à Saint Michel qui est le protecteur de leur petite patrie d'origine, l'île de Procida. Plus d'une fois ce saint Archange, leur a témoigné sa protection, une fois, en particulier, dans des circonstances tragiques.
De tout temps, les côtes de la Méditerranée, nous l'avons vu plus haut, étaient mises en coupe réglée, par les pirates barbaresques. Peu de contrées eurent autant à souffrir de ces pirates que les îles du golfe de Naples et l'île de Procida, en particulier. Barberousse et Dragut, deux fameux corsaires, ravagèrent à plusieurs reprises, l'île de Procida, mettant tout à feu et à sang, déterrant même les cadavres pour en jeter les cendres au vent, en haine du nom chrétien.
C'est dans une de ces incursions, que les Procidiens furent l'objet d'une protection visible de la part du glorieux Saint Michel, patron de l'île.
En 1535, Barberousse fait une nouvelle apparition dans les eaux de Procida, à la tête d'une flotte considérable. Saisis d'épouvante, les survivants de la précédente invasion, s'enferment dans la «Terra» (enceinte fortifiée), mais comment résister à la fureur d'ennemis aussi nombreux et aussi farouches ? Ils supplient, avec larmes, leur puissant et céleste protecteur de prendre leur défense. Leur confiance ne fut pas déçue. Au moment où Barberousse et ses corsaires s'apprêtaient à livrer l'assaut, ils aperçurent d'innombrables défenseurs sur les remparts, à la tête desquels se trouvait Saint Michel ; saisis d'effroi, ils s'enfuirent aussitôt vers leurs vaisseaux, regagnèrent le large et disparurent à l'horizon. En reconnaissance et en souvenir de cette intervention miraculeuse, les habitants de Procida, chaque année, célèbrent avec enthousiasme la fête de Saint Michel. La statue de ce grand Archange est portée processionnellement de l'église à l'endroit où, selon la tradition, apparut Saint Michel. La bénédiction est alors donnée à l'île avec la statue et le cortège reprend le chemin de l'église au milieu d'innombrables détonations et au chant de cantiques et d'hymnes de reconnaissance.
Les Procidiens de Mers-el-Kébir, continuent ici, ce geste pieux et reconnaissant de leurs ancêtres et ils donnent à cette procession annuelle un tel éclat, que l'on vient de très loin pour la voir et même y participer.
Cette procession se déroule le dimanche qui suit la Saint-Michel (29 septembre). Le village est en fête, les rues pavoisées. Malgré les grands soucis de la pêche qui n'est guère rémunératrice, on lit, sur le visage de ces rudes travailleurs, la joie simple et reconnaissante.
C'est la fête de leur grand patron, et pour qu'elle soit belle, grandiose, que ne donneraient-ils pas ?
Présidée par M. le Vicaire Général, représentant Son Excellence, et entouré de plusieurs prêtres, la longue procession sort de l'église et se dirige vers la Marine. La statue de Saint Michel, toute rutilante d'or et d'argent, dans une attitude de vainqueur, terrassant le démon, est portée par quatre solides Napolitains, revêtus du costume de la confrérie Saint-Michel, longue robe blanche avec ceinture et mosette bleu de ciel.
A la marine, après le sermon de circonstance, il y a une première bénédiction de la mer, avec la statue.
La procession revient à l'église, en passant par le quartier Saint-Michel, où a lieu une deuxième bénédiction. Enfin, arrivée à l'église, avant d'entrer, une troisième et dernière bénédiction de la mer et du village est donnée avec la statue. Cette splendide cérémonie qui a été admirée par des milliers de curieux, se termine par une solennelle bénédiction du Très Saint Sacrement. Pendant toute la procession, la musique fait entendre ses meilleurs morceaux, les Enfants de Marie, les Jeunes gens de l'Association Saint-Pierre, chantent avec cœur, la foule prie avec ferveur.
A chaque bénédiction, se sont d'innombrables dénotations, tout comme à Procida. La cérémonie terminée, ces laborieux pêcheurs s'en vont aussitôt à leurs barques et partent, confiants en la bonté de leur Grand Protecteur, gagner leur pain. Et, parfois, Saint Michel, récompense, par des pêches vraiment miraculeuses, la foi ardente, la confiance filiale, de ces napolitains. On raconte qu'une année, et le fait est authentique, la pêche était déficitaire depuis plusieurs mois ; c'était la gêne, même la misère dans bien des foyers, c'était la consternation, l'angoisse chez bien des pêcheurs. Ils ne se découragent point. La fête de Saint Michel arrive ; ils participent à la procession avec une piété, une foi profonde, la foi de la Chananéenne, suppliant leur saint Patron, d'avoir pitié d'eux et de leur famille.
Après la cérémonie, ils partirent comme d'habitude, et, 0 prodige ! la mer est grouillante d'anchois. C'est avec des dizaines de quintaux de ce poisson, que chaque barque rentre au port, et avec cette pêche miraculeuse, la joie et la reconnaissance.
D'ailleurs, ce n'est pas la première et la seule fois que la piété des Napolitains a arraché au ciel de vrais miracles. Il en est un, en particulier, obtenu dans des circonstances tragiques, et qui n'est pas près de s'effacer du souvenir de ceux qui en ont été témoins.
Le soir du 19 novembre 1900, les pêcheurs sortirent comme d'habitude pour aller placer leurs filets. La mer était calme, et rien ne faisait prévoir la terrible tempête qui allait se déchaîner. Vers minuit, le ciel s'obscurcit, un vent violent, véritable cyclone, soulève les flots, des vagues énormes s'écrasent sur le rivage, menaçant de tout engloutir. Les barques veulent rentrer. Impossible. Dans la nuit noire, au milieu des fracas assourdissant de la mer, dans les rafales de vent, on entend des cris de «Au secours ! Au secours ! Seigneur sauvez-nous, nous périssons, Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre-Dame Auxiliatrice, sauvez-nous !»
Hélas ! du côté de la terre, aucun secours à espérer et les pauvres marins à demi-morts de fatigue et de froid, luttent désespérément.
On ne les voit pas, mais on entend leurs cris et leurs prières qui redoublent. Mais la tempête redouble, elle aussi, de violence. Sur le rivage, les femmes, les enfants pleurent, crient, prient, encouragent. C'est un va-et-vient ininterrompu entre la chapelle des religieuses, l'église et le quai. Vraiment, le cœur le plus endurci, se serait ému devant un si tragique spectacle. Les cloches sonnent à toute volée, apportant un peu d'espérance à ceux qui commencent déjà, à bout de forces, de désespérer. Ils savent où ils sont, ils savent qu'on prie pour eux.
Mais le ciel semble sourd à tant d'angoisses, à tant de souffrances, à tant de supplications. Il est huit heures. Les ténèbres ont disparues ; le ciel est toujours sombre, mais on distingue une douzaine de barques, ballottées comme des coquilles de noix, sur la mer en furie. Ce calvaire va-t-il durer encore longtemps*? Va-t-on assister, impuissants, à l'agonie et à la mort affreuse de ces infortunés ? Humainement, on pourrait le croire, car le cyclone souffle toujours avec autant de violence, et les marins à demi-morts d'épuisement ne réagissent presque plus.
Le curé de la paroisse, M. Guinefoleau, est au milieu de ses paroissiens, priant avec eux, les encourageant, donnant une suprême absolution à ceux qui sont en péril. Au moment suprême où tout semblait perdu, dans un élan magnifique de foi, il prend une poignée de médailles bénites et les jette à la mer en disant : «Seigneur, ayez pitié de nous ».
Aussitôt la terrible tempête s'apaise, la mer se calme, et les barques en détresse, abordent sans peine. Miracle Sauvés ! tel est le cri qui s'échappe de toutes les lèvres. On y voit l'intervention divine et tous d'aller aussitôt à l'église rendre gloire à Dieu et assister à une messe solennelle d'actions de grâces.
Telles sont esquissés dans ses grands traits, et l'historique du fort de Mers-el-Kébir et l'histoire religieuse de cette laborieuse et chrétienne population. Après un passé si brillant, que nous réserve l'avenir ? Le magnifique essor qu'est en passe de prendre, au point de vue militaire notre petit port de pêcheurs, ne sera-t-il pas préjudiciable à la mentalité, aux mœurs et coutumes, à la foi enthousiaste et agissante de nos marins ? Mers-el-Kébir, au cachet local si curieux et si particulier, ne perdra-t-il pas, par suite de son agrandissement et de l'afflux de nombreux étrangers, son charme et son calme ? C'est le secret de Dieu ! Quoi qu'il en soit, il faut espérer et souhaiter que les descendants de ces vaillants pêcheurs de Procida, chrétiens éprouvés, garderont toujours intactes leur dévotion envers Notre Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame du Bon-Secours, patronne de la paroisse, le Grand Saint Michel, patron de l'île de Procida, et second patron de la paroisse ; que malgré son évolution, son développement,
Mers-el-Kébir restera toujours ce qu'il a été par le passé et est encore ! une des paroisses, sinon la paroisse la plus chrétienne, du diocèse d'Oran.
| |
L'AVIRON BONOIS
BONJOUR N°1, 6 octobre 1932
journal satyrique bônois.
|
|
Nous apprenons la fondation d'un nouveau club de rowing à Hippone, le 8ème en Algérie.
Il s'appellera « L'AVIRON BONOIS ». Son but principal est de créer, dans notre Ville, l'émulation indispensable à la prospérité de ce sport si complet, par la pratique, aussi exclusive que possible, de l'outrigger. (Bateau fin de rivière. )
Notre belle Seybouse constituera un champ d'entraînement et de courses uniques pour les nouveaux adeptes du "bout de bois".
Il faut féliciter les créateurs de ce groupement. Ils viennent de mettre Bône sur un pied d'égalité avec Alger et Oran qui sont les seules villes possédant déjà deux clubs de rowing.
Le bureau a été constitué ainsi qu'il suit :
Président : M. Marcel Cossé.
MM. Petit, Secrétaire-Trésorier Général
M. Boivieux, Secrétaire- Trésorier Adjoint.
Et MM. Théodosopoulos Arthur et Géo Vallé sont préposés à l'entraînement et au matériel.
Siège social : 1, Cours Bertagna, Bône.
Tous nos plus vifs compliments. La présence de M. Cossé à la présidence est pour tous les sportifs une garantie que l'on fera, dans le nouveau club, des choses sérieuses et intelligentes.
| |
De l'utilité du chapeau
EFFORT ALGERIEN, N° 368, 9 août 1935
|
Vous allez nu-tête... et sans chapeau ? Vous avez tort, car vous vous privez d'un symbole de puissance ???
Et la preuve la voici. Je ne demandais quel pouvait bien être le symbole de la puissance parlementaire !
Or, en y réfléchissant beaucoup maintenant que les chambres sont en vacances, j'ai fini par trouver : le symbole de la puissance parlementaire c'est un chapeau. Et ne croyez pas que j'ai l'intention de galéger : je parle très sérieusement et maintiens que le symbole de la puissance parlementaire est le chapeau du Président.
Preuve : lorsque la Chambre, qui ressemble si souvent à la petite classe, entonne le chahut des grands jours, le président agite sa sonnette, le président lance des apostrophes, le Président donne avec son coupe-papier des coups violents sur l'arête de son bureau présidentiel, mais il est telles vociférations contre lesquelles le coupe-papier, la voix et la sonnette s'avèrent impuissants. Alors, que fait le Président ? Il prend son chapeau, un huit-reflets premier modèle, il l'agite au-dessus de l'orage, une fois à droite, une fois à gauche, et quand la vue du couvre-chef ne calme pas le gros des agités, il s'en coiffe, descend noblement l'escalier de la tribune, et se retire. La séance est suspendue.
Le chapeau du Président reste donc bien le symbole de la puissance parlementaire, ce qu'il fallait démontrer.
Je me suis alors demandé ce qui arriverait si le chapeau venait à manquer ? Car, enfin, si les parlementaires ne sont pas drôles, un loustic aurait bien pu, par accident, se glisser parmi eux, et subtiliser le chapeau du président.
Dans ce cas, qu'arriverait-il ?
Eh bien, dans ce cas, le Président n'aurait plus de puissance.
C'est pourquoi, renseignements pris sur place, son chapeau n'est jamais éloigné de sa tête. Il est déposé sur une planchette, à droite de son bureau, et deux huissiers veillent sur lui, je vous prie de le croire.
M.
| |
Les progrès de la science !!!
Envoyé par Eliane
|
|
Marie-Berthe, grâce aux progrès de la science, vient d'avoir un enfant à l'âge de 75 ans.
Ses voisines, Odette et Suzanne, viennent lui rendre visite et voir le gamin.
- Vous le verrez plus tard ! ..pour le moment ce n'est pas possible. Je vais vous faire du café en attendant.
L'après-midi avance et les voisines lui redemandent de voir le bébé.
- Non , non, c'est toujours pas possible.
Alors Odette demande :
- Mais .. pourquoi ce n'est pas possible ?
- J'attends qu'il pleure, j'me rappelle plus où je l'ai mis.
| |
LES 3 ET 4 AOUT 1914
Par M. Louis Arnaud
|
|
Le mois de juillet s'était traîné dans la torpeur, et la désolation.
Le mouvement des affaires qui s'était ralenti, de jour en jour, ne paraissait pas, en ce début d'août brûlant, devoir sortir bientôt de sa léthargie.
La vie de la Cité était comme suspendue ; la pensée de chaque habitant était uniquement préoccupée par les événements qui se déroulaient en Europe Centrale depuis le 28 juin, jour où avait été assassiné, à Sarajevo, l'Archiduc François Ferdinand, héritier de la Couronne d'Autriche - Hongrie.
L'Allemagne qui recherchait la guerre n'attendait que l'occasion de la faire éclater,
Deux ans auparavant, le coup d'Agadir avait fait long feu. Mais cette fois, Guillaume II entendait lui-même mener la discussion relative aux sanctions que devait entraîner l'atteinte portée au prestige de sa voisine et alliée.
Tous les efforts de l'Empereur Nicolas II de Russie pour éviter un conflit, demeuraient vains.
Après un long mois d'alternatives, l'Autriche allait déclarer la guerre à la petite Serbie. Ce geste devait fatalement entraîner la Russie à venir au secours de son alliée et, du même coup, obliger la France, par le jeu des Alliances, à se ranger aux côtés de la Russie.
Sans attendre que la France ait fait, de quelque façon que ce fut, acte de belligérante, et alors même que pour prouver les intentions pacifiques de notre pays et permettre la poursuite de pourparlers pacifiques, le Gouvernement ordonnait le recul de toutes nos troupes à dix K. en deçà de la Frontière Franco - Allemande ; Guillaume II adressait un ultimatum à la Belgique pour qu'elle l'autorisât à passer sur son territoire, afin de venir attaquer la France, sous le faux prétexte que des avions français avaient survolé Nuremberg.
Les choses en étaient là, en ces premiers jours du mois d'août, et c'est ce qui expliquait la profonde inquiétude qui étreignait tous les cœurs.
On comprenait que la décision de l'Allemagne était déjà prise, mais on voulait espérer, quand même, qu'on parviendrait à éviter la guerre.
Ce premier lundi d'août avait été particulièrement angoissant.
En Ville, tout était morne et silencieux, tout paraissait inerte. Des groupes allaient lentement par les rues, comme s'ils étaient las, comme s'ils avaient le pressentiment d'un malheur tout proche.
Vers la fin de l'après-midi, les affiches surmontées de deux petits drapeaux tricolores entrecroisés, étaient placardés sur les murs de la ville.
C'était la mobilisation.
La mobilisation n'était pas la guerre, avait dit aussitôt le Président Poincaré, sans doute, pour calmer encore les esprits et éviter l'affolement de la population.
Craignait-on quelque réaction hostile chez le peuple déjà si accablé par le marasme des affaires et l'angoisse de tout ce mois de juillet ?
Ceux qui avaient pu avoir une telle crainte, s'étaient largement trompés.
L'annonce de la mobilisation eut un effet contraire. Les cœurs inquiets depuis un mois furent spontanément galvanisés par cet appel aux armes.
De ces affiches blanches aux petits drapeaux tricolores qui préludaient au sinistre drame qui devait durer cinq ans et causer tant de deuils et de misères, il y en avait partout à travers la Ville.
Toutes étaient entourées par une foule avide de les voir, et d'entendre les réflexions et les commentaires provoqués par la grave décision qui venait d'être portée à la connaissance de la Nation.
Il y en avait une, tout près des boîtes aux lettres de la Poste Centrale, située, alors, Près du Palais Consulaire, dans l'actuelle Maison de l'Agriculture, le rassemblement qui s'était formé, à cet endroit, était vite devenu très important.
La petite place aux palmiers, la chaussée, la terrasse de la Brasserie Gambrinus, avaient rapidement été envahies par des groupes discutant et échangeant leurs impressions sur la situation. Poste Centrale en 1914.
Partout, ce n'était qu'une adhésion complète à la décision du Gouvernement, partout, c'était l'affirmation vibrante de la certitude de la Victoire.
Puis, brusquement, les rues et les cafés furent déserts et silencieux.
C'était la fin du Jour, l'heure du souper familial, et chacun avait hâte de se retrouver au milieu des siens pour leur faire le récit de tous les faits qui s'étaient déroulés au cours de ces heures tragiques et historiques qui venaient de marquer le dénouement d'une trop longue angoisse.
Le repas du soir terminé, la foule eut tôt fait de reprendre Possession de la rue et des cafés. C'était une foule loquace, bruyante, dégagée de tout souci, presque heureuse de vivre et de pouvoir, enfin, parler de revanche. Car, il n'était question que de cette revanche que, selon Juliette Adam, Gambetta avait beaucoup trop facilement abandonnée, après s'en être tant servi pour parvenir aux honneurs.
La Brasserie Gambrinus, dans la rue du 4 Septembre, en face de la Grande Poste, était, en tout temps, pour ainsi dire, le centre de réunion, des officiers de Garnison. Cet établissement, tenu par un ancien Adjudant du 3ème Tirailleurs, se trouvait, au surplus, sur le parcours que les militaires étaient obligés de suivre pour aller de l'Hôtel de la Subdivision, aux bureaux de la Place et de l'Intendance et autres services militaires.
C'est, sans doute, à cause de la présence d'officiers en cet endroit, que la foule était plus dense là qu'ailleurs.
Il y avait sur la petite place et dans les rues adjacentes, plusieurs centaines de Personnes qui à un moment entonnèrent la « Marseillaise », puis le « Chant du Départ ».
Oh ! cette « Marseillaise », dans la nuit, chantée par tant d'exécutants animés de la Plus belle foi patriotique, s'exhalant, en accents chauds et vibrants, de toutes ces poitrines françaises prêtes à s'offrir pour la défense du pays.
Je n'ai jamais rien entendu de plus émouvant, de plus exaltant.
J'étais à la terrasse de la brasserie, à la même table que le Commandant Raynal et sa femme, dans le bout de rue qui va rejoindre le Cours Bertagna.
Le Commandant Raynal devait prendre le train pour Alger, avec le 3ème Tirailleurs, dans la même nuit, pour aller s'illustrer au Fort de Vaux.
La magnifique résistance du Fort de Vaux est une des plus belles pages de notre Histoire militaire. Elle a provoqué l'admiration des Allemands eux-mêmes qui, lorsque le Fort est tombé, le 7 juin 1916, se sont refusés à désarmer son Commandant fait prisonnier.
Il était fort tard lorsque nous nous séparâmes. Je rentrai chez moi, à l'extrémité de la Colonne, aux Quatre-Chemins, et je m'endormis en rêvant à des lendemains victorieux.
J'étais endormi depuis une heure à peu près, lorsque des bruits sourds, semblables à des grondements de tonnerre, me réveillèrent.
Dans mon esprit confus, il me fut impossible d'identifier exactement la nature de ce fracas qui troublait la nuit. Etait-ce un orage ? le tonnerre ? Non. Je me rappelais aussitôt combien la nuit était belle et douce, et le ciel tout brillant d'étoiles, une heure auparavant.
Mais voici que des bruits de voitures, de carrioles, plutôt, roulant sur les pavés de la rue Sadi-Carnot au galop effréné des chevaux, venaient s'ajouter aux grondements confus et lugubres qui passaient au-dessus du toit de la villa.
J'ouvris ma croisée, le jour commençait à peine, et je vis des voitures de maraîchers qui revenaient de la Ville avec leur chargement de légumes, intact.
Les chevaux avaient parcouru le chemin de retour en une galopade folle.
Au carrefour des Quatre-Chemins, les Jardiniers affolés avaient arrêté leurs attelages pour les faire souffler et reprendre haleine eux-mêmes.
Ils racontèrent, alors, qu'étant autour du marché aux légumes de la Place de Strasbourg, attendant son ouverture pour y livrer, comme tous les matins, leurs produits, ils avaient été, soudain, terrifiés Par un bombardement intense et une épaisse fumée qui envahissait les alentours du port, vers le bas du Cours.
Pris de panique, ils n'avaient pensé qu'à fuir les parages du marché de toute la vitesse de leurs pauvres attelages.
Bône venait, en effet, d'être bombardée par un croiseur allemand, alors qu'on ne connaissait officiellement la déclaration de guerre par un télégramme de l'Amirauté d'Alger, que depuis deux heures du matin.
Voici, extrait d'une étude parue dans « L'Armée d'Afrique », de septembre -octobre 1924, dix ans après, sous la signature du Général Lebel, les conditions dans lesquelles cette attaque inattendue s'est déroulée:
« Le 3 août, vers 14 heures, le sémaphore du Cap « de Garde signale que deux croiseurs allemands, dont « la présence en Méditerranée était connue, le « Goeben » « et le « Breslau » croisent en vue de la Côte.
« Le 4 août, à trois heures, le guetteur du pilotage signale un navire de guerre venant de l'Est, le cap sur la Mafrag, lentement tous feux éteints ; à 3 h. 30, il se trouvait à environ trois milles et demi du port, en dedans du Cap Rosa.
« Une embarcation du pilotage, croyant avoir affaire à un bâtiment français, sort du port pour aller à sa rencontre ; elle est à deux cents mètres du navire, lorsqu'à 4 heures, celui-ci mettant le cap sur le Cap de Garde, et présentant bâbord à la passe, ouvre le feu en longeant très lentement la jetée Babayaud, arrivé par le travers de Saint-Cloud, il oblique sur tribord et augmente sa vitesse, en passant sous le Fort Génois à raser la côte, il ralenti et tire cinq salves sur le sémaphore du Cap de Garde, puis fait route au nord. Itinéraire suivi par le " BRESLAU " devant Bône.
« Environ, 140 coups de 105 (dont 65 points de chute ont été relevés) avaient été tirés sur le port et ses « abords » (parc à fourrage, voisin de la gare, usine à gaz, quais, vapeur « St-Thomas » amarré dans la grande darse à la racine de « la jetée Sud », et 25 sur le sémaphore.
« Un employé des Ponts et Chaussées qui allait éteindre le feu du Môle, avait été tué, 2 matelots du « St-Thomas » et 5 autres personnes blessées, une barque de Pêche coulée, le « St-Thomas » et quelques immeubles avariés, le mécanisme du mât sémaphorique mis hors de service.
« La gare où se rassemblait le bataillon de Tirailleurs, qui devait partir à 5 heures pour Alger, n'avait pas été atteinte ».
Le but poursuivi par le « Breslau » était certainement de jeter le trouble dans la population et de détruire les convois, qui devaient, selon lui, transporter les troupes d'Algérie en France. Car il avait été question de diriger, par le port de Bône, sur la Métropole, les troupes de la région. Mais ce plan avait été modifié au dernier moment, et aucun transport de troupes ne devait plus être effectué par notre port.
De ce côté là, le « Breslau » n'avait abouti à aucun résultat pratique ou utile.
Ses premiers obus, sur le port, n'avaient atteint que l'angle du Palais Calvin, en face du Palais Consulaire, et les vieux bâtiments de notre archaïque Manutention militaire.
Une modeste plaque de marbre marque droit sur lequel fut tiré, le 4 août 1914, le premier obus allemand de la guerre.
En Allemagne, une médaille en argent fut frappée et distribuée aux marins du « Breslau » pour commémorer « Le glorieux fait d'armes » du 4 août qui ne fut, en réalité, qu'un fiasco complet et une pitoyable agression.
Poursuite du Goeben et du Breslau
Envoyé Par M. Henri Lunardelli
Navires britanniques poursuivant les navires allemands.
La poursuite du Goeben et Breslau fut une action navale qui s’est produite en mer Méditerranée au déclenchement de la Première Guerre mondiale lorsque des éléments de la flotte britannique en Méditerranée tentèrent d'intercepter la Mittelmeerdivision allemande composée du croiseur de bataille SMS Goeben et du croiseur léger SMS Breslau. Les navires allemands échappèrent à la flotte britannique et franchirent le détroit des Dardanelles pour atteindre Constantinople, où ils furent finalement remis à l'Empire ottoman. Rebaptisé Yavuz Sultan Selim, l’ancien Gœben fut commandé par son capitaine allemand pour attaquer les positions russes, poussant ainsi l'Empire ottoman dans la guerre du côté des empires centraux.
Bataille sans effusion de sang, l'échec de la poursuite britannique eut d'énormes conséquences politiques et militaires. À court terme, cela mit fin à la carrière des deux amiraux britanniques chargés de la poursuite. Plusieurs années plus tard, Winston Churchill, qui avait été premier Lord de l'Amirauté, écrivit son opinion qu'en forçant la Turquie à entrer dans la guerre, le Goeben avait apporté « plus de massacre, plus de misère et plus de ruine que ce qui n’avait jamais été porté par la boussole d'un navire »1.
Prélude
Dépêchée en 1912, la Mittelmeerdivision de la Kaiserliche Marine (Marine impériale), comprenait seulement le Goeben et Breslau, sous le commandement du contre-amiral Wilhelm Souchon. En cas de guerre, le rôle de l'escadron était d'intercepter les transports de troupes français amenant des troupes coloniales d'Algérie en France.
Lorsque la guerre éclata entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie le 28 juillet 1914, Souchon était à Pola en Adriatique, les chaudières du Goeben étaient en train d’être réparées. Ne voulant pas être pris au piège dans l'Adriatique, Souchon se précipita pour terminer autant de travail que possible, et conduisit ses navires dans la Méditerranée avant que toutes les réparations ne fussent achevées. Le 1er août, il atteignit Brindisi, mais les autorités portuaires italiennes trouvèrent des prétextes pour éviter de charbonner le navire. En effet, le gouvernement italien avait décidé de rester neutre. Le Goeben fut rejoint par le Breslau à Tarente et la petite escadre embarqua pour Messine où Souchon put obtenir 1800 t de charbon de navires marchands allemands.
Routes suivies par les combattants.
Pendant ce temps, le 30 juillet, Winston Churchill, le premier Lord de l'Amirauté, avait chargé le commandant de la flotte britannique en Méditerranée, l'amiral Sir Archibald Berkeley Milne, de protéger les transports de troupes français emmenant le XIX Corps d'Afrique du Nord en France, à travers la Méditerranée. La flotte britannique en Méditerranée basée à Malte comprenait trois croiseurs de bataille, rapides et modernes (les HMS Inflexible, Indefatigable, et Indomitable), ainsi que quatre croiseurs cuirassés, quatre croiseurs légers et une flottille de 14 destroyers.
Les instructions de Milne étaient « d’aider les Français dans leur transport de leur armée d'Afrique en couvrant, et si possible, engager les navires rapides allemands, en particulier le Goeben, qui pouvait interférer dans ce mouvement. Qu’[il] ser[ait] avisé par télégraphe lorsqu’[il] pourr[ait] consulter l'amiral français. À ce stade, de ne pas engager d'action contre des forces supérieures, sauf en combinaison avec les Français, dans le cadre d'une bataille générale. La vitesse de [se]s escadrons était suffisante pour [lui] permettre de choisir le moment. [Ils] dev[aient] espérer renforcer la Méditerranée, et qu’[il] dev[ait] économiser [ses] forces dès le départ. »2. Les ordres de Churchill ne précisaient pas explicitement ce qu'il entendait par « forces supérieures ». Il affirma plus tard qu'il faisait allusion à « la flotte autrichienne et de ses cuirassés dont il n’était pas souhaitable que [les] trois croiseurs de bataille [britanniques] fussent engagés sans le soutien d’un cuirassé »3.
Milne rassembla sa force à Malte le 1er août. Le 2 août, il reçut des instructions pour prendre en filature le Goeben avec deux croiseurs de bataille tout en maintenant une veille sur l'Adriatique, susceptible de connaître une sortie des Autrichiens. L’Indomitable, l’Indefatigable, cinq croiseurs et huit destroyers commandés par le contre-amiral Ernest Troubridge furent envoyés pour couvrir l'Adriatique. Le Goeben était déjà parti, mais fut aperçu le même jour à Tarente par le consul britannique, qui informa Londres. Craignant que les navires allemands ne pussent essayer de s’échapper vers l'Atlantique, l'Amirauté ordonna que l’Indomitable et l’Indefatigable soit envoyés à l'ouest vers Gibraltar4. L’autre tâche de Milne, à savoir protéger les navires français fut compliquée par l'absence de communications directes avec la marine française, qui avait entre-temps reporté la traversée des transports de troupes. Le croiseur léger HMS Chatham fut envoyé pour rechercher le Goeben dans le détroit de Messine. Cependant, à ce moment-là, dans la matinée du 3 août, Souchon avait quitté Messine, cap à l’ouest.
Premier contact
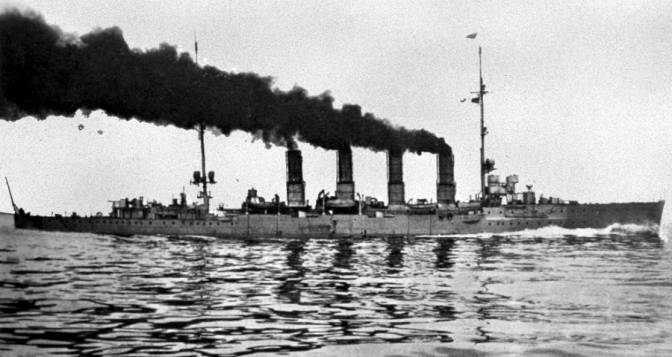
Le croiseur léger allemand SMS Breslau.
Sans ordres spécifique, Souchon avait décidé de placer ses navires au large des côtes africaines, prêts à combattre lorsque les hostilités commenceraient afin d'attaquer les navires de transport français, qui se dirigeaient vers les ports provençaux. Il avait prévu de bombarder les ports d’embarquement de Bône et de Philippeville en Algérie française. Le Goeben se dirigea vers Philippeville, tandis que Breslau fut détaché pour faire face à Bône.
Le 3 août à 18 h, alors qu’il naviguait vers l'ouest, il reçut l’information que l'Allemagne avait déclaré la guerre à la France. Puis, tôt le 4 août, Souchon reçut des ordres de l'amiral Alfred von Tirpitz : « Alliance avec le gouvernement du Parti Union et Progrès conclu le 3 août. Mettez immédiatement le cap sur Constantinople ». Si près de ses objectifs, Souchon ignora l'ordre et accéléra, battant pavillon russe lors de son approche, et pour échapper à la détection, il bombarda la côte à l'aube avant de retourner à Messine pour se réapprovisionner en charbon5.
En vertu d'un accord d’avant-guerre avec la Grande-Bretagne, la France était en mesure de concentrer toute sa flotte en Méditerranée, laissant la Royal Navy assurer la sécurité de la côte atlantique française. Trois escadrons de la flotte française couvraient les transports de troupe. Cependant, supposant que le Goeben continuerait cap à l’ouest vers Gibraltar, le commandant français, l'amiral de Lapeyrère, envoya le "Groupe A" de sa flotte à l'ouest afin de prendre contact, mais nous savons maintenant que Souchon avait, à ce moment-là, mis le cap à l’est et pouvant ainsi s’échapper.
Le 4 août à 09 h 30, Souchon prit contact avec les deux croiseurs de bataille britanniques, l’Indomitable et l’Indefatigable, qui croisèrent les navires allemands allant dans la direction opposée. La Grande-Bretagne n’avait à ce moment pas encore déclaré la guerre à l'Allemagne (la déclaration ne serait faite que plus tard ce jour-là, après le début de l'invasion allemande de la Belgique neutre). Les Britanniques commencèrent à suivre le Goeben et le Breslau, mais furent rapidement dépassés par les Allemands.
Milne rapporta le contact et la position, mais négligea d'informer l'Amirauté que les navires allemands se dirigeaient à l'est. Churchill s’attendait donc encore à ce qu’ils menaçassent les transports français et autorisa Milne à engager les navires allemands s’ils attaquaient. Toutefois, une réunion du Cabinet britannique décida que les hostilités ne pouvaient pas commencer avant une déclaration de guerre, et à 14 h Churchill fut obligé d'annuler son ordre d'attaque6.

Le SMS Goeben.
Poursuite
La vitesse nominale de Goeben était de 27 nœuds (50 km/h) mais ses chaudières endommagées le limitaient à 24 nœuds (44 km/h) et cela n'était possible qu’en poussant les hommes et les machines à leurs limites ; quatre chargeurs de chaudières furent tués par des brûlures de vapeur. Heureusement pour Souchon, les deux croiseurs britanniques souffraient également de problèmes avec leurs chaudières et étaient incapables suivre le rythme du Goeben. Le croiseur léger HMS Dublin maintint le contact, tandis que l’Indomitable et l’Indefatigable accumulaient du retard. Dans le brouillard et la lumière déclinante, le Dublin perdit le contact au large du cap San Vito sur la côte nord de la Sicile à 19 h 37. Le Goeben et le Breslau retournèrent à Messine le lendemain matin ; à ce moment-là la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient en guerre.
L'Amirauté ordonna à Milne de respecter la neutralité italienne et de rester à une distance de 9,7 km (5,2 milles nautiques) de la côte italienne, qui interdisait l'entrée du passage du détroit de Messine. En conséquence, Milne posta des gardes aux sorties du détroit. S’attendant encore que Souchon s’attaque aux transports et passe dans l'Atlantique, il plaça deux croiseurs de bataille, l’Inflexible et l’Indefatigable pour couvrir la sortie nord (qui donnait accès à la Méditerranée occidentale), tandis que la sortie sud du détroit était couverte par un seul croiseur léger, le HMS Gloucester. Milne envoya l’Indomitable à l’ouest pour charbonner à Bizerte, au lieu du sud vers Malte7.
Pour Souchon, Messine n’était pas un abri. Les autorités italiennes insistèrent pour qu’il parte dans les 24 heures et retardèrent la fourniture de charbon. Ravitailler ses navires nécessitait d’ouvrir le pont des bateaux marchands à vapeur allemands dans les ports et de pelleter manuellement leur charbon dans ses soutes. Dans la soirée du 6 août, malgré l'aide de 400 volontaires issus des équipages des marchands, il n’avait chargé que 1 400 t, ce qui était insuffisant pour atteindre Constantinople. D'autres messages de Tirpitz rendirent sa situation encore plus désastreuse. Il fut informé que l'Autriche n’apporterait aucune aide navale en Méditerranée et que l'Empire ottoman était encore neutre et par conséquent, il ne devrait plus faire route vers Constantinople. Face à l'alternative de chercher refuge à Pola, et probablement d’y rester coincé pour le reste de la guerre, Souchon choisit de se diriger vers Constantinople de toute façon, son but était « de forcer l'Empire ottoman, même contre son gré, de porter la guerre dans la mer Noire contre leur ancien ennemi, la Russie »7.
Milne fut chargé le 5 août de continuer à surveiller la mer Adriatique à la recherche de signes de la flotte autrichienne et afin d’empêcher que des navires allemands les rejoignissent. Il a choisi de garder ses croiseurs de bataille à l'ouest, envoyant le Dublin rejoindre l'escadron de croiseur de Troubridge dans l'Adriatique, qui, selon lui, devait en mesure d'intercepter le Goeben et le Breslau. Troubridge reçut pour instruction « de ne pas se retrouver engagé sérieusement avec des forces supérieures », un avertissement contre un engagement contre la flotte autrichienne. Lorsque le Goeben et le Breslau entrèrent en Méditerranée orientale le 6 août, ils étaient attendus par le Gloucester, qui, étant surpassé sur le plan de la puissance de feu, commença suivre les navires allemands8.
L'escadre de Troubridge est composée des croiseurs cuirassés les HMS Defence, Black Prince, Warrior, Duke of Edinburgh et huit destroyers armés de torpilles. Les croiseurs avaient des canons de calibre 230 mm (alors que le Goeben disposait de canons de calibre 280 mm) et avaient un blindage d’une épaisseur maximale de 15 cm, contre 28 cm pour le croiseur de bataille allemand. Cela signifiait que l'escadre de Troubridge était non seulement surclassée en termes de portée mais aussi vulnérable vis-à-vis des puissants canons du Goeben, alors qu'il était peu probable que les canons de ses croiseurs pussent sérieusement endommager le bâtiment allemand, même à courte portée9. De plus, les navires britanniques étaient plus lents, de plusieurs nœuds, que le Goeben, même avec ses chaudières endommagées10, ce qui signifiait qu'il pourrait dicter la distance de la bataille, s’il repérait l'escadre britannique en premier. Par conséquent, Troubridge considéra que sa seule chance était de localiser et d’engager le Goeben avec une lumière favorable, à l'aube, avec le Goeben à l’Est de ses navires, et idéalement de lancer une attaque à la torpille avec ses destroyers. Cependant, au moins cinq des destroyers n’avaient pas assez de charbon pour suivre les croiseurs naviguant à pleine vitesse. Le 7 août à 4 h, Troubridge réalisa qu'il ne serait pas en mesure d'intercepter les navires allemands avant le lever du jour et après délibération, il signala à Milne ses intentions de rompre la poursuite, conscient de l'ordre ambigu de Churchill d’éviter d'engager une « force supérieure ». Aucune réponse ne fut reçue jusqu'à 10 h, heure à laquelle il se replia en direction de Zante pour se réapprovisionner en combustible11.
Évasion
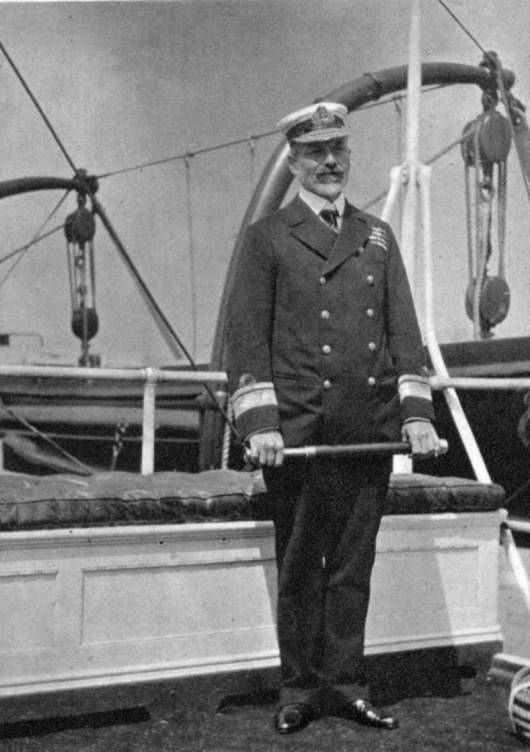
L’Amiral Milne
Milne ordonna au Gloucester de se désengager, s’attendant toujours à ce que Souchon mit cap à l'ouest, mais il était évident pour le capitaine du Gloucester que le Goeben fuyait. Le Breslau tenta de harceler le Gloucester en rompant, Souchon avait un charbonnier l’attendant au large des côtes de la Grèce et devait secouer son poursuivant pour le faire lâcher prise avant son rendez-vous. Gloucester engagea finalement le Breslau, espérant que cela obligerait le Goeben à faire demi-tour pour protéger le croiseur léger. Selon Souchon, le Breslau fut touché, mais sans créer aucun dommage. L’engagement fut rompu sans que d'autres coups au but furent enregistrés. Finalement, Milne ordonna au Gloucester de cesser la poursuite au cap Matapan.
Le 8 août, peu après minuit, Milne ordonna à ses trois croiseurs de bataille et au croiseur léger HMS Weymouth de mettre cap à l’est. À 14 h 00, il reçut un message incorrect de l'Amirauté indiquant que la Grande-Bretagne était en guerre avec l'Autriche; la guerre ne serait pas déclarée avant le 12 août et l'ordre fut annulé quatre heures plus tard, mais Milne choisit de garder l'Adriatique plutôt que de chercher le Goeben. Enfin, le 9 août, Milne donna des ordres clairs pour « chasser le Goeben qui avait passé le cap Matapan le 7, cap au nord-est ». Milne ne croyait toujours pas que Souchon se dirigeait vers les Dardanelles, et donc décida de garder la sortie de la mer Égée, ignorant que le Goeben n'avait pas l'intention de sortir.
Souchon avait reconstitué son stock de charbon au large de l'île égéenne de Donoussa le 9 août, et les navires de guerre allemands reprirent leur voyage vers Constantinople. Le 10 août, à 17 h 00, il atteignit les Dardanelles et attendait l'autorisation de les traverser. L'Allemagne courtisait depuis quelque temps le Parti Union et Progrès du gouvernement impérial, et utilisait maintenant son influence pour faire pression sur le ministre turc de la Guerre, Enver Pacha, pour que le passage du navire soit autorisé, un acte qui indignerait la Russie, les Dardanelles faisant partie de sa route maritime principale ouverte toute l’année. En outre, les Allemands réussirent à convaincre Enver de faire feu sur les navires britanniques le poursuivant. Au moment où Souchon reçut la permission d'entrer dans les détroits, ses vigies pouvaient apercevoir de la fumée de navires britanniques à l'horizon se rapprocher.
La Turquie était encore un pays neutre lié par un traité l’empêchant de laisser passer le détroit aux navires de guerre allemands. Pour contourner cette difficulté, il fut convenu que les navires devraient faire partie de la marine turque. Le 16 août, après avoir atteint Constantinople, le Goeben et le Breslau furent transférés à la marine turque lors d’une petite cérémonie, devenant respectivement le Yavuz Sultan Selim et le Midilli, mais ils conservèrent leurs équipages allemands avec Souchon à leur tête. La réaction initiale en Grande-Bretagne fut de la satisfaction, la menace avait été retirée de la Méditerranée. Le 23 septembre, Souchon fut nommé commandant en chef de la marine ottomane12.
Conséquences
En août, l’Allemagne, s’attendant encore à une victoire rapide, était contente que l'Empire ottoman restât neutre. La simple présence d'un navire de guerre puissant comme le Goeben dans la mer de Marmara suffirait à occuper un escadron naval britannique pour garder les Dardanelles. Cependant, à la suite des revers allemands lors de la première bataille de la Marne en septembre, et avec les succès russes contre l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne commença à considérer l'Empire ottoman comme un allié utile. Les tensions commencèrent à dégénérer quand l'Empire ottoman ferma les Dardanelles à tous les navires le 27 septembre, bloquant la sortie de la mer Noire à la Russie, la route de la mer Noire représentait alors plus de 90 % du trafic d'importation et d'exportation de la Russie.
Le don des deux navires de guerre modernes de l'Allemagne eut un impact positif énorme sur la population turque. Lors du déclenchement de la guerre, Churchill avait provoqué l'indignation des Turcs quand il « réquisitionna » deux cuirassés turcs presque terminés dans les chantiers navals britanniques, le Sultan Osman I et le Reshadieh, qui avaient été financés par une souscription publique pour un coût de 6 000 000 £. Il fut offert à la Turquie une compensation de 1000 £ par jour aussi longtemps que la guerre pourrait durer, à condition qu'elle reste neutre. (Ces navires furent intégrés aux effectifs de la Royal Navy respectivement sous les noms de HMS Agincourt et de HMS Erin). Les Turcs étaient neutres, bien que la marine fût pro-britannique (ayant acheté 40 navires de guerre aux chantiers navals britanniques) tandis que l'armée était en faveur de l'Allemagne, de sorte que les deux incidents l’aidèrent à sortir de l'impasse, l'Empire ottoman se joignant aux empires centraux13.
Engagement ottoman
Les diplomaties française et russe tentèrent de garder l'Empire ottoman hors de la guerre, mais l'Allemagne poussait pour qu’elle engageât. Dans la foulée de l'audacieuse arrivée de Souchon à Constantinople, le 15 août 1914, les Ottomans annulèrent leur accord naval avec l'Angleterre et la mission de la marine royale de l'amiral Limpus (en) quitta l’Empire ottoman de 15 septembre. Enfin, le 29 octobre, le point de non-retour fut atteint lorsque l'amiral Souchon avec le Goeben, le Breslau et un escadron de navires de guerre turcs passèrent dans la mer Noire et effectuèrent un raid sur les ports russes de Novorossiisk, d’Odessa et de Sébastopol. Pendant 25 minutes, les canons principaux et secondaires du Goeben tirèrent sur Sébastopol. En réponse, deux obus de 300 mm furent tirés d'un fort russe à plus de 16 km (8,7 milles nautiques), à l’extrême limite de portée, et perforèrent le navire à l'arrière tuant 14 hommes. Sur le chemin du retour, le Goeben toucha le destroyer russe Leiteneat Pushchin avec deux obus de 150 mm et coula le mouilleur de mines russe Prut, qui avait 700 mines à bord destinées à un champ de mines devant être établi en travers de la route de retour du croiseur de bataille.
L'attaque sur Novorossiysk fut également un succès remarquable, avec 14 bateaux à vapeur coulés dans le port par les canons du Breslau, tandis que 40 réservoirs de pétrole furent incendiés, libérant un flux de pétrole en flamme qui engloutit des rues entières. La Russie déclara la guerre à l'Empire ottoman le 2 novembre, la France et la Grande-Bretagne suivirent le 5 novembre. Les premières batailles terrestres étaient attendues dans le Caucase et les navires de transports à vapeur commencèrent à transporter des troupes turques vers l'est le long de la côte anatolienne à Samsun et à Trébizonde. La flotte russe de la mer Noire coula trois de ces navires ainsi, lorsqu’un autre convoi fut envoyé le 16 novembre, le Breslau l’escorta tandis que le Goeben, qui avait situé et sectionné le câble sous-marin Sébastopol-Odessa dans la nuit du 10 au 11 novembre, croisait au milieu de la mer Noire.
Rencontre en Crimée
Le 18 novembre, dans un banc de brouillard dense, le Breslau rejoignit son frère d’arme. Les deux navires allemands étaient presque au devant de la Flotte russe, quand le brouillard se leva et soudainement les antagonistes furent en vue l'un de l'autre à une distance de moins de 3 700 m. Instantanément, les canons des deux côtés ouvrirent le feu. Le Goeben, avec le Breslau s’abritant derrière, passa devant toute la ligne de la Flotte de la mer Noire. Un obus de 300 mm d’un cuirassé russe perfora le blindage épais de 150 mm du Goeben, tuant les six hommes d'équipage responsables d'un canon et faisant exploser les munitions. Seule une inondation rapide du magasin empêcha une plus grande explosion, mais l’Evstafi, navire étendard de la Russie, fut touché quatre fois par le Goeben, tuant 33 hommes. Le cuirassé russe Rostislav fut également gravement endommagé. La flotte de la mer Noire se dissimula rapidement à nouveau, mais continua de menacer la côte turque de la mer Noire pendant le reste de la guerre.
Transports de troupes
En novembre et décembre, le Breslau et le croiseur léger Hamidie escortèrent fréquemment des transports de troupes vers le Caucase, mais le Goeben consommait trop de charbon pour ce genre de tâche, bien que le 10 décembre il tira quinze obus de 280 mm sur les défenses côtières russes de Batoumi. Un intense trafic radio russe, le 23 décembre, rendit évident le fait que la flotte de la mer Noire avait appareillé. Le Goeben et le Breslau furent envoyés pour fournir une escorte à certains transports et, comme la nuit tombait sur une mer houleuse, battue par les vents, le croiseur léger allemand fut détaché en reconnaissance vers le Nord-Est. Les radios russes avaient fait silence, et le sort de la flotte de la mer Noire était inconnu. À 04 h 00, le Breslau rencontra la flotte russe. Son projecteur illumina un transport, qui fut coulé avec une seule salve, puis la silhouette d'un cuirassé russe fut pris dans son faisceau. Une deuxième salve du Breslau encadra le puissant navire avant que le croiseur léger ne cherchât refuge dans l'obscurité.
De retour d'une mission d’escorte d’un autre transport de troupes le 26 décembre, le Goeben heurta une mine dans le Bosphore. La première mine explosa à tribord sous la tourelle de commandement, qui provoqua immédiatement une gîte de 30° sur bâbord. Deux minutes plus tard, le navire heurta une deuxième mine, cette fois au niveau de la barbette, et 540 t d'eau rendirent inutilisable la tourelle n°3 et inondant le navire. Le croiseur de bataille dévasté fut à peine capable d'atteindre la crique de Stenia. Les dégâts étaient sérieux et maintinrent le Goeben au port pendant trois mois, à l'exception de deux brèves sorties destinées à dissuader des cuirassés russes qui apparemment s’approchaient de Constantinople.
1915 Seconde rencontre
Lorsque la distance descendit à environ 14 000 m, le Breslau se glissa entre son navire frère et l'escadre russe et disposa un écran de fumée dense. À l’abri de l’écran, les navires allemands rebroussèrent chemin, mais conservèrent une vitesse suffisamment basse afin de ne pas décourager la poursuite. Les Russes les chassèrent ardemment, les cuirassés lourds à leur vitesse maximum de 25 nœuds (46 km/h). À un moment donné, le Breslau se rapprocha suffisamment pour attirer le feu de la ligne russe, mais il jaillit hors de portée avant qu’un coup ne toucha au but. Comme la nuit tombait, le Goeben et le Breslau commencèrent à s’éloigner de leurs poursuivants, le Hamidié transmit par radio qu'il était presque rentré au port, mais dans l'obscurité les destroyers russes près du Goeben, le traquaient dans sa fumée. Mais leurs bavardages à la radio les trahirent et le quatre projecteurs arrière de 1,5 m du Goeben illuminèrent les silhouettes de cinq destroyers à seulement 180 m à l'arrière.
Les canons de Breslau ouvrirent le feu, et le premier destroyer flamba, mortellement touché. Le deuxième dans la ligne de mire connut un sort similaire, tandis que le reste fit demi-tour et s’enfuit. Aucune de leurs torpilles ne trouva son but, et le lendemain à midi le Goeben et le Breslau étaient une fois de plus hors du Bosphore.
Royal Navy
Alors que les conséquences de l'échec de la Royal Navy pour intercepter le Goeben et le Breslau n’étaient pas apparues immédiatement, l'humiliation de la « défaite » aboutit aux rappels des amiraux de Lapeyrère, Milne et Troubridge. Milne fut rappelé de la Méditerranée et ne prit plus aucun autre commandement jusqu'à sa retraite (à sa demande) en 1919, son accession planifiée au commandement Nore ayant été annulée en 1916 en raison d’«autres exigences». L'Amirauté déclara, à plusieurs reprises, que Milne avait été exonéré de tout blâme14. Pour son échec à engager le Goeben avec ses croiseurs, Troubridge fut traduit en cour martiale en novembre sous l'accusation selon laquelle « il s’était abstenu de chasser le navire de Sa Majesté impériale allemande le Goeben, et d’avoir fui ». L’accusation ne résista pas à l'épreuve des faits, au motif qu'il avait des ordres « clairs » de ne pas engager une « force supérieure ». Cependant, il ne reçut jamais d'autre commandement à la mer mais il apporta de précieux services, coopérant avec les Serbes dans les Balkans et recevant le commandement d'une force sur le Danube en 1915 contre les Austro-Hongrois. Il prit finalement sa retraite comme amiral15.
Même si cette « action » est relativement mineure et n’est peut-être pas un événement historique très connu, l'évasion du Goeben vers Constantinople et son passage sous pavillon ottoman précipita finalement certaines des poursuites navales les plus spectaculaires du XXe siècle. Elle contribua également à aider à façonner la future scission de l'empire Ottoman en de nombreux États, que nous connaissons aujourd'hui.
Le général Ludendorff déclara dans ses mémoires qu'il croyait que l'entrée des Turcs dans la guerre avait permis aux empires centraux, en infériorité numérique, de se battre deux ans de plus que qu'ils n'auraient pu le faire seuls; une opinion partagée par l'historien Ian F.W. Beckett16. La guerre fut étendue au Moyen-Orient avec les principaux fronts de Gallipoli, du Sinaï et de la Palestine, de la Mésopotamie et du Caucase. Le cours de la guerre dans les Balkans fut également influencé par l'entrée de l'Empire ottoman du côté des empires centraux. Si la guerre avait pris fin en 1916, certains des engagements parmi les plus sanglants, comme la bataille de la Somme, auraient été évités. Les États-Unis n’auraient pas été forcés de rompre leur politique d'isolement pour intervenir dans une guerre étrangère.
En s’alliant avec les empires centraux, la Turquie partagea leur sort dans la défaite. Cela donna l'occasion aux Alliés de dépecer l'Empire ottoman défait en zones d'influence. Beaucoup de nouvelles nations furent créées dont la Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite et l'Irak, et l'idée d'un état kurde, ainsi que celle d'un état juif en Israël furent envisagées pour la première fois.
Dans la fiction
L'histoire courte alternative Tradition, écrite par Elizabeth Moon, imagine l'amiral Christopher Cradock à la place de l'amiral Troubridge comme commandant de la force de croiseurs et de destroyers à l'Est du détroit de Messine17. Dans l'histoire, Cradock ignore les instructions de l’amiral Milne de garder la mer Adriatique et au lieu de cela intercepte le Goeben et le Breslau au nord de la Crète. Dans la bataille qui s’ensuit, sa flotte perd deux des quatre croiseurs cuirassés et six de ses huit destroyers, mais parvient à détruire les deux navires allemands avant qu'ils n’atteignent leur objectif, Constantinople. En réalité, Cradock n’était pas présent en Méditerranée, mais mourut trois mois plus tard à la bataille de Coronel après avoir affronté une force allemande supérieure, une décision possiblement prise en partie parce qu'il voulait s'éviter l'ignominie de la disgrâce présumée de Troubridge pour avoir permis au Goeben et au Breslau de s'échapper.
Notes et références
1. ↑ Tuchman 1962, p. 187.
2. ↑ Lumby 1970, p. 146.
3. ↑ Churchill 1930, p. 252–253.
4. ↑ Massie 2007, p. 31, citant McLaughlin 1974, p. 49.
5. ↑ Massie 2007, p. 34.
6. ↑ Massie 2007, p. 36.
7. ↑ Massie. Castles of Steel, p. 39.
8. ↑ Massie 2007, p. 40-41.
9. ↑ Van Der Vat 2001, p. 140-141.
10. ↑ Van Der Vat 2001, p. 135-136.
11. ↑ Massie 2007, p. 44.
12. ↑ Massie 2007, p. 48–49.
13. ↑ Massie 2007, p. 22-23.
14. ↑ (en) « rubrique nécrologie : Admiral Sir A. B. Milne », The Times, no 48039, 6 juillet 1938, p. 18.
15. ↑ (en) « rubrique nécrologie : Admiral Sir Ernest Troubridge », The Times, no 44183, 30 janvier 1926, p. 12.
16. ↑ (en) Ian F.W. Beckett, « Turkey’s Momentous Moment [archive] », HistoryToday, 2013 (consulté le 1er novembre 2014).
17. ↑ (en) Elizabeth Moon, « Tradition », dans Alternate Generals, Harry Turtledove, 1996.
Bibliographie
· (en) Winston S. Churchill, The World Crisis, Thornton Butterworth Ltd., 1930
· (en) David Fromkin, A Peace to End All Peace : Creating the Modern Middle East 1914-1922, Owl Books, 1989, 635 p. (ISBN 0-8050-0857-8)
· (en) John Keegan, Intelligence in War, Hutchinson, 2003, 468 p. (ISBN 0-09-180229-6)
· (en) Esmond Walter Rawson Lumby, Policy and operations in the Mediterranean, 1912-14, Londres, Navy Records Society, 1970 (ISBN 0-85354-004-7)
· (en) Robert K. Massie, Castles of Steel : Britain, Germany and the winning of the Great War at sea, Londres, Vintage Random House, 2007 (1re éd. 2003), 865 p. (ISBN 978-0-099-52378-9)
· (en) Redmond McLaughlin, The escape of the Goeben, Scribners, 1974
· (en) Gallipoli, Wordsworth Editions, 1956, 319 p. (ISBN 1-85326-675-2, lire en ligne [archive])
· (en) Barbara Tuchman, The Guns of August, Constable, 1962 (ISBN 0-333-69880-0)
· (en) Dan Van Der Vat, The Ship that Changed the World, Birlinn, 2001, 2e éd., 252 p. (ISBN 978-1-84158-062-3)
|
|
Mac Mahon Aïn Touta
Par Maurice VILLARD
ACEP-ENSEMBLE N°290
|
|
A la demande de M. Henri MEYERE. Né à Mac Mahon. Maurice VILLARD
Mac Mahon, Maréchal de France Né à Sully (Saône et Loire) (1808-1893). Il se signala pendant les guerres de Crimée, prise de Malakoff et celle d'Italie victoire de Magenta. Il fut Gouverneur Général d'Algérie de 1830 à 1864. Pendant la guerre de 1870 il fut écrasé par le nombre à Foeschwiller. Bien que monarchiste, il accepta la Présidence de la République en 1873. mais démissionna en 1879.
Ain Touta
Nom arabe désignant une source plantée d'un mûrier.
Le Centre de peuplement de Mac Mahon situé à 33 kms au Sud- Ouest de Batna et à 80 Km au Nord de Biskra, d'une altitude de 980 m, fut créé en 1872 sur une surface de 921 h provenant de la suppression de la Smala des Spahis antérieurement installée sur ce territoire appartenant à l'Etat.
Il est le siège de la Commune mixte d'Ain Touta. Il fut implanté dans une zone marécageuse, entièrement recouverte de genêts et de roseaux lieu de prédilection de panthères noires.
Travaux entrepris pour la réalisation du lotissement comprenant 30 lots agricoles.
Assiette du village, réalisation des mes et trottoirs, assainissement et plantations.
Alimentation en eaux, réservoir, bornes fontaines et abreuvoirs et lavoir.
Construction d'un réduit défensif.
Construction de bâtiments communaux : école, mairie, église, presbytère, clôture du cimetière
Coût total : 218.036 f.
Les premières surfaces emblavées ont été de : 164 ha de blé, 194 h d'orge, 25 h furent consacrés aux jardins et 5 ha furent plantés en vigne.
Deux moulins à mouture indigène furent créés.
Un hôpital avec la nomination d'un médecin de colonisation fut construit.
DE 1881 à 1911 la population européenne est passée de 74 habitants à 195 composée de 162 français, 7 israélites naturalisés 26 étrangers et 203 indigènes.
DE 1884 à 1902, 212 naissances et 147 décès furent enregistrés.
Le village de Mac Mahon s'est peu développé, la rigueur du climat, la pluviométrie quasi nulle, la surface des concessions ridiculement réduites, l'état sanitaire qui a laissé à désirer pendant un certain temps, sont les principales causes qui ont nui à sa réussite.
D'autre part les familles d'Alsaciens Lorrains qui ont été installées sur ce point n'étaient pas préparées à ce climat, à cette nouvelle vie à laquelle on les appelait. L'aide qui leur fut apportée était tellement insuffisante, pour réussir dans cette région comme dans l'ensemble des Hauts Plateaux. Il est nécessaire de cultiver de grandes surfaces qui seules per-mettent l'élevage du bétail principalement des moutons, ainsi que de développer l'irrigation qui sont les seules sources de profits.
1907 —Un réseau urbain téléphonique avec abonnés et une cabine publique sont mises en service.
1915- Le docteur Bisquerra est nommé médecin de colonisation.
Août 1916 —Les Chaouïas sont en ébullition, ils envahissent le village pillent et incendient les maisons, détruisent le Bordj administratif de la Commune mixte où le Sous-Préfet et l'Administrateur sont tués. Les Zouaves cantonnés à Mac Mahon interviennent pour rétablir l'ordre. A la suite de ces émeutes, la plu-part des familles juives quittent la région, seul restera le propriétaire de l'hôtel-restaurant. Mais cette révolte n'aura pas d'incidence sur l'évolution de la vie locale.
1917 —la dernière panthère noire est abattue par Maurice Haékel.
1927 —Construction de caniveaux pavés tout au long de la route nationale N°3 traversant le village.
1929 — La Commission municipale de Mac Mahon est composée de trois membres
Des circuits téléphoniques sont réalisés entre Mac Mahon et El-Kantara
1940 —Le responsable de la défense du centre en temps de guerre est : le Chef Tacon Eugène, son adjoint : Meyere Gabriel
1946 — le village de Mac Mahon compte une population de toutes confessions de 340 familles de 1.707 personnes.
L'eau potable provenant de deux sources captées, alimente plusieurs fontaines publiques, abreuvoirs et lavoir et toutes les habitations.
Plan d'action Communal de 1948 à 1960.
Le Plan d'action communal va permettre la réalisation de :
Un groupe scolaire de six classes avec les logements d'instituteurs.
Un Centre professionnel rural complétement équipé.
Un Centre artisanal de tissage avec logement
Un hôtel des Postes –une Mairie et une Justice de paix.
Un hôpital disposant de 30 lits. Une caserne de Gendarmerie
Vingt- cinq logements pour le personnel administratif
Un lotissement de villas, boulevard Caminelli, afin de loger le personnel communal : secrétaire de mairie, architecte, médecin de colonisation et tout le personnel médical.
Construction des bâtiments de la SIP, comprenant les bureaux, les logements, les dépendances, un garage et un silo à céréales.
Les principaux services administratifs avec un Administrateur et adjoints.
Hôpital civil
Médecin de colonisation Constructions diverses : justice de paix
Société Indigène de Prévoyance (S I P)
Chemin de fer
Défense et restauration des sols
Mairie et services municipaux L'Eglise et son presbytère
Un magnifique complexe sportif avec en autres un terrain de football, jeu de boules, tennis, croquet.
Le marché hebdomadaire se tient le lundi. En dehors des bestiaux et des étalages habituels communs à tous les villages des environs, on peut remarquer des artisans potiers qui présentent leur production ocrée, ornée de motifs géométriques, destinées à l'usage domestique, également des couvertures, des musettes aux couleurs vives. Toutes ces productions d'origine berbère sont confectionnées dans les douars environnants.
Les dernières familles européennes natives de Mac Mahon furent : Tacon Eugène, hôtel-restaurant, Haeckel Maurice, Meyere Louis et Meyere Gabriel, Meyere Paul, Clapiers Mural, agriculteurs.
Après le départ du docteur Deloy Christian, dernier médecin de colonisation qui avait pour adjoint Ali Mokrani et une infirmière diplômée, Madame Maraval, de nombreux médecins militaires se succédèrent dans la commune.
Témoignage de Mauricette et Marcel Haéckel.
 La Commune mixte d'Ain Touta tient son nom d'une source bordée d'un mûrier. Ce dernier a effectivement existé à proximité de la gare à 1 km du centre du village. Cette source s'est tarie vers 1950 à la suite de l'approfondissement des puits de la Commune mixte. Quant au mûrier, il a séché en deux années, il était d'une variété très rare, que les indigènes dénommaient « Toute Michel - du nom de celui qui l'avait planté. La Commune mixte d'Ain Touta tient son nom d'une source bordée d'un mûrier. Ce dernier a effectivement existé à proximité de la gare à 1 km du centre du village. Cette source s'est tarie vers 1950 à la suite de l'approfondissement des puits de la Commune mixte. Quant au mûrier, il a séché en deux années, il était d'une variété très rare, que les indigènes dénommaient « Toute Michel - du nom de celui qui l'avait planté.
La région était constituée de hautes plaines, terres propices à la culture des céréales, mais la pluviométrie déficiente en rendait aléatoire leur culture, seul l'élevage des moutons et surtout l'irrigation des terres avec les cultures de pommes de terre, de fourrage artificiel, de luzernes pouvaient rentabiliser les exploitations. Les collines environnantes boisées, couvertes de genévriers, de pins étaient très giboyeuses. Trois oueds descendant de l'Aurès, traversent la région, l'Oued El-Ksour à l'Est, l'Oued Fedala et l'Oued Berrichi à l'Ouest. L'Oued El Ksour coule à 800 m environ de la gare, un barrage dérivatif permet d'actionner le moulin hydraulique à mouture indigène de M. Bacri et plus loin une importante minoterie. Un barrage construit à la création du village, avec une retenue d'eau permet l'irrigation des terres, des jardins autour du village.
Dans les années 1910, un gisement de mercure, situé dans la région de T`iourist dans l'Aurès était exploité. Le transport se faisait à dos de mulet dans de très lourds conteneurs en plomb sous la direction de M. Clapier (père).
A l'origine deux écoles furent ouvertes, l'une mixte, l'autre de 2 classes pour les garçons indigènes.
La gare d'Ain Touta sur la ligne de chemin de fer Batna Biskra avait une certaine importance avec un chef de gare et de district. Une centrale électrique locale fournissait le courant à l'agglomération.
Plusieurs personnes ont marqué de leur empreinte le village. L'Administrateur Maglioli, qui lui a donné une structure, créant entre autres un magnifique square, plantant un nombre très important d'arbres particulièrement des pins et des frênes. Plus tard fut construit un très joli Bordj remplaçant celui qui avait été incendié en 1916. Le docteur Joseph Tramini, grâce à son dévouement a éradiqué les épidémies, le typhus qui faisait d'énormes ravages dans la population indigène, le paludisme, en traitant tous les points d'eau stagnante. Mesdames Fiama (mère) et Joséphine Haèckel furent les seules femmes de la région à être décorées de la médaille du Mérite agricole.
La création du village, les lots de colonisation attribués comportaient :
1 lot urbain avec un lot de jardin, 8 ha de terres irrigables et 16 h de terres de culture. Il eut été nécessaire que ces surfaces furent pour le moins triplées afin d'assurer la survie des premiers colons. Certaines familles, les Bacri, Ben Redah et Nasri obtinrent des surfaces plus importantes. Des lots furent attribués à la commune, loués en adjudication triennale. Ne pouvant subsister de nombreuses familles de la première heure furent dans l'obligation de céder leurs concessions.
L'implantation des Romains dans la région se situe à 6km à l'Ouest du village, certainement à cause des marécages. La piste dallée qui relie Lambèse, Timgad, via El-Outaya, la montagne de sel gemme, traverse le site. A l'Est de nombreuses ruines, de nombreux sarcophages principalement d'enfants furent découverts à 3 kms au col des « juifs » ainsi dénommé car à cet endroit, des commerçants juifs, en convoi, furent attaqués et massacrés par les indigènes.
D'importants travaux de drainage permirent l'assainissement de cette plaine marécageuse et l'irrigation des concessions situés rive gauche de l'Oued El Ksour, il faut noter que lors de la construction de la ligne de chemin de fer de Batna à Biskra, ces lots furent amputés chacun d'un demi-hectare. Les lots de la rive droite étaient irrigués par un barrage construit à la création du village.
Un syndicat d'irrigation en assurait la gestion, le dernier Président fut Marcel Haèckel qui réalisa des travaux très importants afin d'améliorer le débit des eaux avec l'aide et les conseils de M. Fourcade, ingénieur de l'hydraulique de Batna.
Afin de palier l'érosion des terres, des travaux considérables furent entrepris par la Défense et restaurations des sols (DRS), sous la direction de M. J. Ortoli, sa compétence permit la construction de banquettes avec des plantations dans tout le bassin de la commune allant de l'Oued Fedala à l'Est, au pied de l' Aurès à l'Oued Berriche à l'Ouest.
Les commerçants du village : Boulangerie-épicerie : Matassent, Clapier.
Travaux publics : Haèckel Bastien-Travaux agricoles : Meyere.
Les principaux Administrateurs : Maglioli, Mombertrand, Laborde, Mougeot, Oberdorff Guy, Guisolfi.
|
|
|
Bonjour chers amis,
Abordons aujourd'hui les sports sous le soleil d'Afrique.Et ça va peut être vous étonner mais on était déjà METOO c'est pas beau ,qui l'eeut cru?
Je vous souhaite une bonne lecture et eventuellement entre amis reconnaitre quelques gloires de cette époque
En vous esperant en forme je vous souhaite une bonne lecture
Amitiés, Bernard
Cliquer CI-DESSOUS pour voir les fichiers
SPORT 1
SPORT 2
A SUIVRE
|
|
La belle-mère arrive à la maison et trouve son gendre furieux en train de faire ses bagages.
- Mais qu'est-ce qui arrive ?
- Qu'est-ce qui arrive ? Je vais vous le dire !
"J'ai envoyé un mail à ma femme en disant que je rentrais de voyage aujourd'hui.
J'arrive chez moi et devinez ce que je trouve ?
"Votre fille, oui votre fille, ma femme quoi, à poil avec un mec dans notre lit conjugal !
C'est fini, je la quitte !
- "Du calme" dit la belle-mère ! "Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire"
- "Ma fille ne ferait jamais une chose pareille ! Attends, je vais vérifier ce qui s'est passé".
Quelques instants plus tard, la belle-mère est de retour avec un grand sourire
- "Je te l'avais dit qu'il devait y avoir une explication simple :
" Elle n'a pas reçu ton mail !"
|
| |
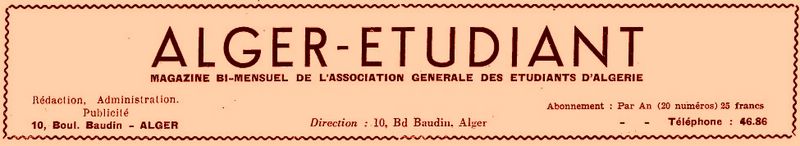 Source Gallica - N° 146
Source Gallica - N° 146 |
Visages du Turf
A la manière de... . André Thibault
Une heure moins le quart. Devant le square Bresson, j'attends l'autocar qui va mec conduire au Caroubier. Comme chaque dimanche beaucoup de Monde. Mon voisin de droite lit l'Hippique.
Moi. — Belle journée, n'est-ce pas
Moi. — Difficile cependant, surtout le Grand Prix.
Mon voisin. — Eh ! Monsieur, toutes les journées sont difficiles, sauf pour certains connaisseurs dont je suis...
Moi. — Ah ! vous êtes...
Mon voisin. — Oui, Monsieur, j’ai la prétention de connaître la question. J'ai plus de vingt ans de pelouse et j'ai vu gagner Gerboa, et il faudrait être un idiot pour...
A ce moment l'autocar arrive. Prise d'assaut. Mon nouveau voisin de banquette a entendu la conversation précédente.
Mon second voisin. — Mon cher Monsieur, tous les mêmes ces gens de courses. Pour eux il suffit d'avoir fréquenté les hippodromes pendant un certain nombre d'années, pour être capable, non seulement d'y gagner sa vie, mais encore d'en discerner les mécanismes et d'en parler en connaissance de cause.
Moi. -- Cependant, Monsieur, il faut convenir que l'expérience...
Mon second voisin. — Ne suffit pas, Monsieur. Il faut ce que j’appellerai, le don. Vous avec entendu le type de tout à l'heure ? Eh bien c'est un pauvre homme qui n'y a rien compris. La journée d'aujourd'hui est très facile. Seulement voilà, il faut voir les courses. Moi, Monsieur, je ne vais pas depuis vingt ans aux courses...
Moi. — D'ailleurs vous êtes plus jeune...
Mon second voisin.-- Mais rependant j'ai la prétention de connaître la question et de la connaître à fond. C'est ainsi que je peux dire...
Je ne saurai jamais ce qu'il pouvait dire car nous étions arrivés et nous nous précipitions pour ne pas manquer la première.
Devant le Café du Caroubier je rencontre alors mon vieil ami Malin qui me dit : « La première est courue, viens prendre un bock ».
Moi. - Mais tu es tout pâle, serais-tu monade ?
Malin. — Ah non ! Mais c'est mon portefeuille qui l'est. Et pourtant je ne suis pas joueur.
Moi. -- Cependant les courses.
Malin. — Les courses ne sont pas un jeu, mon cher, mais une véritable science.
Moi. — Oh ! Tu sais, une science bien incertaine cependant, et le Hasard y joue néanmoins pour beaucoup.
Malin. — Non, c'est une science, mais une science dans laquelle la succession des faits qui la constitue, n'obéit à des lois que tu ignores, des lois que seuls peuvent discerner et appliquer des êtres supérieurement intelligents.
Moi. — Toi par exemple, n'est-ce pas ?
Malin. -- Peut-être ne penses-tu pas si bien dire. En tout cas j'ai la prétention de connaître la question.
Moi.— Est-ce bien l'avis de ton portefeuille ?
Malin (haussant les épaules avec un sourire de mépris). — Garçon, payez-vous ? Garçon, pariez-vous aux courses ?
Le Garçon. — Comme tout le monde. Monsieur.
Malin. — Eh bien, continuez, mais n'écoutez pas les ballots qui voient du hasard et de la chance dans cette institution.
Malin s'en va plus que fâché.
Le Garçon. — C'est un piqué le frère. Il croit peut-être que moi j'ai besoin de ses conseils pour toucher un gagnant. Non. mais des fois... J'ai la prétention de connaître la question, moi...
Je me sauve car j'entends la cloche de la deuxième.
Je rencontre devant le Paddock mon jeune ami Jeannot, néophyte et un peu hésitant dans ses paris.
Jeannot. - - Que voyez-vous, aujourd'hui ?
Moi. — Pas grand-chose de bon, mais un Conseil, jouez la forme du moment.
Jeannot. — Vous croyez ? On dit toujours ça et finalement...
Moi. — Je vous dis la forme du moment, ne sortez pas de là. Croyez-moi cher ami, j'ai la prétention de connaître la question...
Tiens, moi aussi !!!
TIGRE ROYAL
|
|
PHOTOS d'ALGER Sacré-Coeur
ACEP-ENSEMBLE 289
|
|
DE LA PÊCHE DU CORAIL.
BERTEUIL L’ALGERIE FRANCAISE
1856 pages 385 à 387
|
|
ANCIENNES POSSESSIONS FRANÇAISES DE LA CALLE.
- DE LA PÊCHE DU CORAIL.
Avant la guerre de 1830 contre Alger, comprenant une soixantaine de lieues des côtes de Barbarie, notre prise de possession datait de 1520. Les établissements eurent à souffrir plusieurs vicissitudes jusqu'au moment où les Français furent chassés définitivement de la Calle, ville incendiée par les Arabes, d'après l'instigation des Turcs, le 18 juin 1827.
L'est de ces parages, où se trouvent nos anciennes possessions de la Calle, du cap Rosa, du bastion de France et du cap Roux, était affecté à la pêche du corail, ainsi que le golfe de Bône et les environs du cap Ferrat, près d'Oran. L'autre partie des côtes de la province de Constantine, objet des concessions commerciales, était exploitée par une compagnie française, qui y faisait un commerce exclusif sur les grains, les cuirs, la laine, le miel, la cire, la soie et l'huile.
L'avantage de ce monopole coûtait à la France une redevance annuelle de deux cent mille francs, payée au dey d'Alger. Le trésor rentrait dans ses avances en accordant des patentes de pêche aux bâtiments corailleurs, a raison de mille francs pour la saison d'été, et de cinq cents francs pour celle d'hiver.
L'expression de concession, à force d'être répétée, remplaça celle de possession, consacrée dans plusieurs traités des dix-septième et dix-huitième siècles.
Souvent le même bateau prenait une patente tunisienne, afin de pouvoir pêcher dans les eaux de Tabarca : elle coûte moitié moins que celle de France.
On compte jusqu'à deux cents bateaux corailleurs en mer ; leur réunion dans un petit espace offre un coup d'œil agréable.
La compagnie commerciale n'était assujettie à aucune rétribution.
Le gouvernement français, ayant voulu exploiter ce commerce, ne put couvrir ses frais : il l'abandonna à une compagnie française, avec la condition, avantageuse pour elle, de fournir aux corailleurs les objets de consommation.
La dernière était connue sous la raison Paret et compagnie.
La ville maritime de Bône était le centre des pêcheries et des opérations commerciales. Un consul français y résidait, et la compagnie d'Afrique y avait formé ses plus grands établissements.
Ce n'était qu'éventuellement qu'elle faisait des achats dans les ports de Stora, de Collo et de Bougie.
Lorsque la France déclara la guerre au dey d'Alger, il n'existait plus de distinction entre les concessions commerciales et les anciennes possessions territoriales, limitées par la Seybouse et le cap Roux. Aussi avait-on laissé tomber en ruine nos fortifications du cap Rose, du bastion de France et du cap Roux. Ce ne fut qu'accidentellement que celles de la Galle furent réparées.
Comme, pendant mon premier séjour à Oran en 1831, j'ai résidé pendant un an au fort de Mers-el-Kébir, j'eus occasion de voir constamment les bateaux corailleurs, et j'eus la curiosité de les visiter et d'aller voir comment se faisait cette pêche ; je fus plusieurs fois en mer avec eux pour jouir de ce coup d'œil, et j'étais loin de m'imaginer comment s'opérait cette pèche ; ainsi je crois très à propos d'en donner ici au lecteur la description.
La pêche du corail est faite par des balancelles, bateaux pontés du port de quinze à vingt-cinq tonneaux, ayant de huit à douze hommes d'équipage et deux mousses constamment occupés à faire ou à réparer les filets.
La voilure est fort basse, soutenue par un seul mat ; elle se compose d'une voile latine et d'une brigantine.
Les filets de pêche sont formés par deux forts madriers placés en croix, longs d'un mètre cinquante centimètres. A leur réunion est une grosse pierre carrée et un câble assez long pour laisser descendre le filet jusqu'à quatre-vingts brasses de profondeur (quatre cents pieds), et quelquefois plus. Aux quatre extrémités des madriers, sont fixés des paquets de réseaux en grosse ficelle.
Cet appareil, fort simple, est jeté à la mer et retenu au moyen du câble fixé à un petit cabestan. En entrant dans l'eau, les réseaux du filet s’étendent, et, parvenus au fond, ils s'étalent autour des madriers, qui, agités par tes flots, cassent les branches des coraux. Quand on suppose qu'une quantité suffisante a été détachée des rochers sous-marins, ou enlève les filets au moyen du câble : alors les réseaux se rapprochent par leur propre poids et accrochent les morceaux de corail cassés par les madriers.
Les filets étant parvenus sur le pont, on cherche dans les réseaux les coraux qui s'y trouvent. On ne conserve que les morceaux qui résistent à la cassure qu'on cherche à faire avec les doigts.
Cette pêche n'est exploitée que par des Sardes et des Napolitains.
Un bateau bien équipé pêche pour dix ou douze mille francs de corail, avec une dépense de six à sept mille francs. On le transporte à Livourne, où il est vendu de trente à cinquante francs la livre.
Les gros morceaux de corail, propres à tailler des médaillons, se vendent à la pièce jusqu'à mille francs et au-delà. Ce n'est que dans ce port et à leur retour que les patrons s'acquittent du prix de leurs patentes auprès du consul français.
Depuis que nous occupons Alger, cette pêche a repris une activité plus grande que jamais; car, à l'époque où j'étais à Oran, c'était la saison d'été, il y avait au moins une trentaine de bateaux corailleurs qui, tous les matins, partaient du port de Mers-el-Kébir et se dirigeaient ver le cap Ferrat, où étaient leur point de mire et la réunion des autres bateaux, qui cependant se tenaient à distance des uns et des autres, lorsqu'ils commençaient leur pêche. Je les examinais tous les matins de Mers-el-Kébir, car on les voyait parfaitement de ce point, et toute cette réunion de petits bateaux formait une petite citadelle fort agréable à la vue, qui donnait une activité étonnante à ces parages.
|
|
LES CHOUA (brochettes
ACEP-ENSEMBLE N°291
|
Préparation : 2 heures. Cuisson : 10 minutes (Pour 6 personnes)
 Ingrédients: Ingrédients:
500 g. de filet de bœuf ou de mouton coupé en morceaux de 2 à 4 cm de côté ;
250 g. de graisse de bœuf ou de mouton coupée en morceaux;
2 oignons finement coupés ;
Persil haché ; sel, poivre
1 quinzaine de brochettes
1 Brasero à charbon de bois.
Mélangez dans un plat les morceaux de viande, de graisse, l'oignon, le sel et le poivre. Pétrissez à la main jusqu'à incorporation des épices et laissez mariner quelques heures.
Enfilez 6 morceaux de viande par broche en les intercalant avec les morceaux de graisse.
Bien saisir à feu vif. La cuisson ne prend que quelques minutes. Les brochettes se mangent chaudes.
BROCHETTES DU KROUBS
 Ingrédients : Ingrédients :
100gr par personne de foie ou de rognons d'agneau;
sel, thym, cumin (Kamoun), harissa ail,
Citron et coriandre selon les Bouts).
Préparation: le foie ou le cœur est coupé en dès de 2,5 cm environ, le 1/2 rognon coupé en longueur et enfilé sur 2 piques parallèles ou coupé en 1/4 et enfilé sur une pique. Des morceaux de graisse de rognon, de bouts de côtes et de gigot, de taille légèrement plus petits, sont intercalés avec les morceaux d'abats; Posées comme telles sur la braise du Kanoun, la cuisson, de courte durée, 3 à 5 mn, se fait à feux vif en retournant chaque pièce autant que de besoin.
Dés les premières colorations saupoudrer de sel, de thym éventuellement de cumin. A coloration parfaite, (2 mn après), retirer du feu.
Les brochettes sont prêtes à être déguster avec un saupoudrage de cumin ou trempées dans le mélange harissa, citron, thym, ail et coriandre pilés ou coupés en fine particules ( debcha).
Sous l'appellation de "melfouf" les pièces de foie, de cœur ou de rognon peuvent être légèrement enveloppées de bandes de voilette d'agneau et cuites, comme ci-dessus, dans cet enveloppement.
Dans ce cas il n'est pas recommandé d'y intercaler les morceaux de graisse.
|
|
MES SOUVENIRS
Du GENERAL DU BARAIL
|
AUX SPAHIS.
Yusuf.— Un sauvetage.— Troupes indigènes.— Prise de Bône.-
A Constantine. — Le colonel de Thorigny. — A la cantine. — Maurice Persat. — Duel à cheval. — Le lève trompette. — Avec les Nègres.— A la chambrée.
Ma dix-neuvième année allait sonner. J'étais un homme et même, j'ose le prétendre, un assez vigoureux gaillard.
Dire que j'avais la vocation militaire serait trop peu. Je ne comprenais pas qu'on pût être sur cette terre autre chose que soldat. Cependant, je ne pouvais pas songer, un seul instant, à entrer à Saint-Cyr, puisque depuis de longues années déjà mes études classiques avaient été forcément suspendues. Je n'avais donc pas d'autre ressource que de m'engager comme simple soldat, et mon pauvre père, qui redoutait les débuts de son rude métier pour un garçon habitué à toutes les douceurs de l'existence, hésitait à me donner son consentement.
 Je l'obtins cependant, à force de supplications, et un jour vint où je n'eus plus qu'à choisir mon régiment. Je voulais, bien entendu, servir dans la cavalerie, et j'avais à opter entre les spahis et les chasseurs d'Afrique. Je l'obtins cependant, à force de supplications, et un jour vint où je n'eus plus qu'à choisir mon régiment. Je voulais, bien entendu, servir dans la cavalerie, et j'avais à opter entre les spahis et les chasseurs d'Afrique.
Les chasseurs d'Afrique, et en particulier le 2e régiment commandé par le colonel Randon, m'offraient incontestablement, au point de vue militaire, une meilleure école ; mais ils étaient encombrés de fils de famille, de sous-officiers de France qui avaient démissionné pour y entrer, de jeunes gens à l'esprit aventureux, venus en Afrique pour y chercher fortune, prêts à tous les coups d'audace. L'avancement y eût été fort long.
— Tu auras peut-être la chance de mourir dans la peau d'un vieux capitaine retraité, me disait invariable-ment mon père, quand je lui parlais des chasseurs d'Afrique. J'optai donc pour les spahis.
Eux non plus ne manquaient pas cependant de sujets d'élite. J'allais y trouver, comme sous-officiers, des maréchaux des logis de la Garde royale, portant le double galon : Reboulet de Louvinières des grenadiers à cheval, Fonblanc des lanciers, Créton des dragons, etc. Quant aux jeunes gens de famille, on ne les comptait pas. Je me rappelle Bruyère, le fils du général de division de l'Empire, de Revel, fils d'un colonel de la Garde, un fils de Talma, le maréchal des logis Fleury, le futur grand écuyer de Napoléon III, Curély, le fils du fameux cavalier, sans compter une foule de sous-officiers d'avenir, qui devaient être de redoutables rivaux pour mes jeunes ambitions.
Mais j'avais déjà quatre années d'Afrique. Je commençais à parler la langue des Arabes. J'étais familiarisé avec leurs habitudes. C'était une petite spécialité qui pouvait attirer sur moi l'attention des chefs, en attendant que je méritasse leur intérêt par ma bonne conduite.
Enfin, mon père avait eu jadis sous ses ordres un chef d'escadrons qui commandait en second le régi-ment : le commandant de Montauban, et il croyait pouvoir compter sur lui, pour me faciliter ces débuts si rudes qui influent sur toute une carrière militaire.
Voilà pourquoi je m'engageai aux spahis d'Oran, qui portaient alors le nom de : corps de cavalerie indigène, et qui formaient un régiment de quatre escadrons, commandé par le fameux lieutenant-colonel Yusuf.
Le nom de ce grand soldat est déjà venu plusieurs fois sous ma plume. Je m'en voudrais de ne pas m'y arrêter un instant, au moment où je commence à servir sous ses ordres, car il fut bon pour moi, et sa glorieuse figure a plané, bienveillante et protectrice, sur les premières années de ma vie militaire.
Populaire, entouré d'amitiés chaudes dans la province de Bône, qu'il venait de quitter et où il avait rendu des services considérables, il était encore peu connu et mal apprécié dans la province d'Oran.
Sa situation comme chef de corps était assez délicate, en face des cadres français qui se cabraient sous le commandement, quelquefois inégal et capricieux, d'un officier étranger. Tout en rendant justice à ses mérites, bien des officiers déjà blanchis sous le harnais, et qui portaient l'épaulette dix ans avant qu'il fût même question de lui, comparant leur carrière lente, régulière, laborieuse, avec son élévation rapide et irrégulière, en avaient conçu une jalousie qui n'allait pas jusqu'à l'insubordination déclarée, mais qui les entretenait dans l'irritation et la mauvaise humeur. Tel était en particulier le cas du commandant de Montauban, désolé d'avoir vu son ami, le lieutenant-colonel de Thorigny, remplacé à la tête des spahis d'Oran par ce romanesque personnage qui ne devait pas tarder, d'ailleurs, à faire taire toutes les susceptibilités, toutes les rancunes, à force de mérite et de courage.
Yusuf était né vers 1810, dans une ville du littoral de l'Italie, près de Livourne. Dans une traversée qu'il fit en bas âge, il fut enlevé avec sa mère par des corsaires barbaresques. Comme il ne dédaignait pas la légende, il laissait volontiers entendre, en se rajeunissant d'au moins cinq années, qu'il était né à l'île d'Elbe, à la suite du court séjour et de l'éphémère souveraineté de Napoléon. Mais il suffit de rapprocher les dates pour rejeter cette version. Quoi qu'il en soit, la mère et l'enfant furent conduits à Tunis. Il ne fut plus question de la mère, mais l'enfant fut élevé dans le palais du Bey, qu'il charma par sa gentillesse, avant de mériter sa faveur quasi paternelle, par une rare intelligence et une adresse merveilleuse à tous les exercices du corps. Le Bey lui fit donner une éducation supérieure. Yusuf parlait fort bien l'italien et suffisamment le français. En arabe, c'était un lettré. Enfin, il avait un véritable talent de calligraphe dont il se montrait très fier.
A dix-neuf ans, il avait déjà été nommé deux fois aux fonctions de bey du camp, c'est-à-dire chargé d'aller, à la tête d'une troupe régulière, lever l'impôt dans les tribus. Ces missions procurent de grands avantages pécuniaires, sans compter l'habitude du commandement, le prestige et la connaissance de toutes les mœurs et de toutes les ruses africaines.
Ce fut l'amour qui perdit ce beau garçon, ou plutôt qui fixa ses destinées futures. Yusuf devint l'amant d'une princesse parente du Bey. Leurs rendez-vous, qui se passaient la nuit, dans un jardin, furent surpris par un serviteur nègre qui, d'ailleurs, paya fort cher, dit-on, son excès de zèle, car la princesse reçut le lendemain un bouquet symbolique contenant, au milieu des fleurs, une oreille, un oeil humains, et par lequel Yusuf la rassurait, en lui apprenant que le nègre était pour toujours condamné au silence.
Mais les musulmans ne plaisantent jamais avec ces escapades, et Yusuf reçut des avis secrets qui lui annonçaient une punition exemplaire, la seule usitée là-bas : la mort.
Le consul de France à Tunis s'appelait alors de Lesseps. C'était le père de Ferdinand de Lesseps. Yusuf courut se mettre sous la protection du drapeau français. L e consul lui refusa l'hospitalité. On était en 1830. On venait de prendre Alger. Il fallait éviter soigneusement toute affaire qui eût compliqué notre situation délicate.
— Je ne peux pas vous prendre au consulat, dit le consul au jeune Yusuf, mais je puis écrire au commandant du stationnaire français d'envoyer demain, à un endroit convenu, une embarcation, sous prétexte de faire de l'eau, en le prévenant qu'il s'agit de recueillir un fugitif. Ce fugitif sera vous, qui serez exact au rendez-vous. Dès que vous aurez mis le pied dans le canot, vous serez sur la terre française, où personne n'ira vous chercher.
Yusuf accepta — comme bien l'on pense — et le lendemain matin il quittait Tunis, monté sur son plus beau cheval et suivi d'un écuyer qui portait, dans une cassette, quelques bijoux précieux devant servir de poires pour les soifs à venir.
Le canot était bien là, attendant à quelque distance de la côte le fugitif. Mais les matelots ne pouvaient reconnaître dans ce cavalier, arrivant en superbe équipage, un malheureux fuyant la vengeance du Bey.
« J'avais beau multiplier les signes désespérés racontait Yusuf, les marins ne bougeaient pas, et leur inaction me semblait d'autant plus fâcheuse que, derrière moi, arrivait à fond de train une troupe de janissaires chargés de s'emparer de ma personne.
« Enfin, on me comprit, et je vis la barque s'approcher. J'étais entré à cheval dans la mer pour aller au-devant de mes sauveurs, avec les janissaires derrière moi. Au moment où je sautais du cheval dans la barque, un d'eux mettait déjà la main sur le plat-bord, pour arrêter à la fois l'embarcation et le fugitif.
Yusuf ne racontait pas ce qu'était devenu son écuyer, mais il laissait entendre que la cassette avait été sauvée.
Yusuf arriva à Alger, au lendemain de la conquête. Il accepta d'abord une place d'interprète. Nous n'avions alors, pour remplir cet office difficile, que d'anciens officiers des mameluks de la Garde, et encore étaient-ils assez peu initiés aux habitudes du pays où ils avaient vécu sans contact intime avec la population.
Yusuf parut un aigle au milieu d'eux. Jeune, beau, intelligent, actif, infatigable, l'esprit toujours éveillé, connaissant les Arabes comme sa poche, c'est le cas de le dire, puisqu'il avait été employé à vider les leurs, il séduisit rapidement le maréchal Clausel, qui l'attacha à sa personne et lui demanda plusieurs fois des avis.
La prise foudroyante d'Alger avait frappé les Arabes de stupeur, et, si nous avions eu un plan, si nous avions su ce que nous voulions, si la révolution de Juillet n'avait pas tout bouleversé, nous aurions pu profiter de leur découragement pour asseoir solidement notre domination. Mais le corps expéditionnaire fut bientôt réduit à une division d'occupation, qui fut elle-même réduite à un très faible effectif. On tenta bien quelques expéditions dans la Mitidja. On alla à Blidah, on poussa même jusqu'à Médéah. Mais c'étaient là des sorties, des reconnaissances, des voyages d'exploration, en quelque sorte, et non des promenades de conquérant à travers sa conquête.
D'ailleurs, ces premières tentatives ne furent pas toutes heureuses, et les Arabes des tribus voisines d'Alger, reprenant confiance en nous voyant tâtonner, vinrent bientôt jusqu'aux fossés mêmes de la ville porter le meurtre et la désolation.
Alors, on regretta la faute qu'on avait commise, au lendemain de la prise d'Alger, en licenciant et en rapatriant la milice turque du Dey : les mameluks, qu'il eût été possible et même facile de gagner à notre cause et de retenir à notre service. O n avait détruit toute l'administration indigène sans rien mettre à sa place, et si imparfaite qu'elle fût, elle eût été préférable à l'anarchie que nous apportâmes avec nous.
Il y avait encore pourtant, à Alger, quelques éléments qu'on pouvait utiliser. Je veux parler des Coulouglis, fils de Turcs et de femmes indigènes, dont les pères avaient servi sous le Dey. Yusuf proposa au gouverneur général d'organiser, avec quelques-uns de ces jeunes gens, une sorte de gendarmerie locale qui ferait la police de la plaine et assurerait la tranquillité dans les environs d'Alger. L'essai réussit parfaitement et Yusuf, élargissant son champ d'opérations, se chargea d'aller porter un convoi de munitions à Médéah, où nous avions jeté une garnison qui manquait de cartouches. Il fit franchir à ses mulets les montagnes qui séparent Médéah de la plaine de la Mitidja, par un sentier que les Arabes jugeaient impraticable et qu'ils ne gardaient pas. Ces services le mirent en lumière. On ne parlait plus que du capitaine Yusuf et de ses intrépides cavaliers.
L'idée d'appuyer notre corps d'occupation par un contingent indigène prit faveur. Des officiers distingués de l'armée française avaient conçu de l'enthousiasme pour notre nouvelle conquête et ne demandaient qu'à s'y consacrer avec un parfait dévouement. On commença timidement par organiser, sous les ordres d'un officier d'état-major, le commandant Maumet, un bataillon d'infanterie dans lequel l'élément arabe fut mélangé à l'élément français; et, comme on tirait ses recrues de la Kabylie, habitée par la puissante corporation des Zouaouas, on lui donna le nom de bataillon des zouaves.
Au milieu d'un peuple de cavaliers, il eût été extra-ordinaire qu'on ne tentât pas pour la cavalerie ce qui venait de réussir pour l'infanterie. Comme je n'écris pas l'histoire de la conquête de l'Algérie, je n'ai pas à m'occuper de l'organisation des chasseurs numides, ni de celle des chasseurs algériens, qui se fondirent dans le corps magnifique et définitif des chasseurs d'Afrique. Je m'en tiens à la troupe où je fis mes premières armes. On décida la création d'un régiment de spahis, dont la base fut le corps des volontaires du capitaine Yusuf, qui se trouva admis dans l'armée française avec le grade de capitaine dont il portait déjà le titre. D'ailleurs, les chasseurs d'Afrique avaient permis de voir ce qu'on pouvait faire avec le cavalier arabe. Le 2e régiment de cette arme possédait une division (deux pelotons), composée d'indigènes avec des cadres mi-partie français, mi-partie indigènes. Cette troupe était admirable. Dans les premiers combats dont la province d'Oran fut le théâtre, elle était toujours engagée en tête. Elle servit de modèle à nos cavaliers français.
Ses sous-officiers possédaient une réputation extra-ordinaire de bravoure et d'audace, et ses soldats, qui avaient fait partie de l'ancien Maghzen turc, avaient l'habitude de traiter l'Arabe en peuple conquis, et avaient sur lui un ascendant considérable dont nous profitâmes.
Quand elle fut versée, avec les hommes de Yusuf, aux spahis, elle avait perdu presque tous ses excellents sous-officiers.
Le premier régiment indigène de cavalerie que l'Afrique nous ait donné fut confié à un officier d'artillerie sorti de l'École polytechnique, un homme excellent et original que j'ai beaucoup connu.
Petit-neveu du savant Monge, comte de Péluse, dont il releva le nom et le titre, le colonel Marey appartenait à une riche famille de Bourgogne.
Il était propriétaire du Clos-Vougeot et possédait, cela va sans dire, une cave célèbre. C'était un cœur d'or et une âme tendre, enfermés dans une boîte longue et sèche.
Très grand, très maigre, la figure osseuse, la joue creuse, l'œil fixe, presque sans regard, Marey ressemblait à un moine poitrinaire et austère, découpé dans l'angle d'un portail d'église par le ciseau d'un sculpteur. Je ne l'ai jamais vu rire. Il écoutait et disait les choses les plus énormes sans sourciller. Il ne parlait pas ; il psalmodiait avec une lenteur extrême, en tenant perpétuellement, entre le pouce et l'index de la main gauche, une tabatière que les doigts de sa main droite faisaient virer, par un geste automatique et doux. Un des premiers, il s'était passionné pour l'Algérie et pour ce peuple dont il avait la gravité sévère. Il en avait étudié les mœurs et appris la langue.
Les premiers gouverneurs de l'Algérie avaient pris le système de faire administrer directement le pays soumis, par des officiers remplacés aujourd'hui, désavantageusement, j'ose le dire, par des agents civils. Le colonel Marey avait été nommé agha de la Mitidja, pendant que le lieutenant Vergé exerçait les fonctions de caïd des Beni-Khélil.
Ce fut donc sous les ordres du colonel Marey que Yusuf fit son apprentissage du métier militaire. Il fut dur, car le colonel, très méthodique, exigeait de lui les mêmes connaissances techniques et professionnelles que de ses camarades sortis de l'École ou du rang. Mais Yusuf n'était pas homme à rester en arrière, et moins de deux ans après son entrée au service régulier, il enlevait le grade de chef d'escadron par une action d'éclat.
En 1831, nous avions essuyé un échec devant Bône. On avait mal conçu et mal préparé l'expédition. On avait mis à terre des troupes qu'on avait du rembarquer précipitamment, et le gouverneur général ne pensait qu'à réparer le tort porté au prestige de nos armes par cet insuccès.
Yusuf, par les relations qu'il avait conservées à Tunis, s'était ménagé des intelligences dans la garnison turque qui occupait la citadelle de Bône, et tranquillement il vint, un jour, proposer au gouverneur d'aller prendre cette citadelle, accompagné seulement de son ami, le capitaine d'artillerie Buisson d'Armandy.
Les deux compères débarquèrent d'une frégate devant la place, et moitié de gré, moitié de force, Yusuf, appuyé par ses amis de la garnison, se fit ouvrir les portes de la citadelle. Un détachement des marins de la frégate s'installa derrière lui, dans ce poste qui dominait les défenses de la place. Elle se rendit et les Français y entrèrent.
Chef d'escadron, Yusuf entrevit une carrière illimitée, un trône, tout simplement. Il rêva de devenir bey de Constantine et de se servir de ce premier marchepied pour devenir ensuite bey de Tunis, sous la suzeraineté de la France. Le maréchal Clausel, qui ne voyait que par ses yeux et qu'il avait positivement fasciné, l'institua bey de Constantine, au lieu et place d'Ahmed, dont la déchéance fut proclamée.
Yusuf, en attendant qu'il pût prendre possession de ses nouveaux États, établit son quartier général et le siège de sa souveraineté in partibus au fameux camp de Dréan, et s'offrit tous les honneurs et toutes les prérogatives de sa dignité nouvelle. Il eut sa petite armée beylicale, composée des escadrons de spahis réguliers et irréguliers, de deux sections d'artillerie de montagne servies par des indigènes, et d'un bataillon d'infanterie commandé par un Italien nommé Allegro, élevé comme lui à Tunis, père du général tunisien de ce nom, qui a joué un rôle considérable dans les événements qui ont rangé récemment la Tunisie sous notre protectorat.
Il eut ses drapeaux, sa musique, ses bourreaux, en un mot, tout ce qu'il faut pour être monarque. Et alors commença une guerre d'intrigues entre le bey Ahmed et le bey Yusuf.
Ahmed, comme tous les pachas turcs, ne se souciait que médiocrement de l'amour de ses sujets, qu'il tyrannisait et pillait à plaisir. Yusuf attisait les mécontentements et cherchait à se ménager des intelligences semblables à celles qui lui avaient si bien réussi à Bône.
Yusuf avait des espions auprès d'Ahmed, et Ahmed avait des espions auprès de Yusuf qui, un jour, surprit une lettre écrite par son kodja (secrétaire), ne laissant subsister aucun doute sur les relations de ce confident avec l'ennemi.
Yusuf, sans laisser soupçonner sa découverte, continua à dévoiler ses pensées les plus intimes au traître, et quand le malheureux se fut enferré jusqu'à la garde dans ses protestations de dévouement et de fidélité, il lui passa la lettre révélatrice. Aucun mot ne fut échangé entre eux. Le secrétaire se leva, salua, sortit de la tente, s'agenouilla, impassible, devant le chaouch (bourreau), qui, moins d'une minute après cette petite scène muette, lui faisait tomber la tête entre les genoux, sur le sol. Tout cela s'était passé avec une tranquillité, une correction parfaites.
On connaît l'insuccès de la première expédition dirigée contre Constantine, en 1836. Yusuf resta jusqu'à la fin de sa vie parfaitement convaincu que, si cette expédition avait été préparée et conduite dans des conditions moins déplorables ; si l'armée s'était présentée devant Constantine abondamment pourvue de tout, pouvant attendre l'effet des trahisons que l'impopularité d'Ahmed et les manœuvres de Yusuf avaient préparées; si nous n'avions pas été obligés de compter sur des heures pour éviter un désastre que le manque absolu de vivres suffisait à lui seul à provoquer, l'entreprise eût réussi. Et il avait probablement raison. Tandis que l'insuccès de la première expédition, en décourageant nos partisans, en raffermissant le pouvoir d'Ahmed, en augmentant la confiance et le courage de nos adversaires, rendit la seconde infiniment plus difficile et plus meurtrière.
Le maréchal Clausel, tout en croyant au succès, jugeait tout à fait insuffisants les moyens qu'on avait mis à sa disposition. Il aurait pu ne pas commander lui-même, et laisser au général Damrémont, désigné éventuellement pour le remplacer, la responsabilité d'une défaite dont son renom militaire eût profité par un choc en retour. Et le maréchal, pour ne pas partager avec son lieutenant un peu de gloire, lui épargna, en somme, un affront.
Mais un vétéran des grandes guerres, comme lui, un maréchal de France, ne pouvait rester sous le coup d'une faute ou d'une erreur ! Il fallait un bouc émissaire. Yusuf fut choisi pour ce rôle ingrat. On l'accusa d'avoir trompé le gouvernement sur les dispositions des habitants de Constantine, d'avoir réuni des moyens de transport insuffisants pour les approvisionnements.
Yusuf aurait pu répondre péremptoirement que ce qui avait surtout nui à l'expédition, c'était le mauvais temps, qui avait rendu la marche de l'infanterie et de l'artillerie des plus pénibles et des plus longues, et qu'on aurait évité le mauvais temps si on était parti plus tôt, comme il l'avait conseillé qu'alors on aurait pu attendre devant la place les résultats de ses intelligences et de ses menées. Il aurait pu répondre enfin, en ce qui concernait les bêtes de somme, qu'il en avait réuni plus qu'il n'en fallait pour les besoins de l'armée, mais qu'il n'avait pu les garder, parce qu'on l'avait fait attendre un mois, sans lui donner de quoi nourrir bêtes et conducteurs ; que, malgré tous ses efforts, il avait dû subir la désertion d'un grand nombre de ces gens affamés.
En dépit de ces bonnes raisons, enveloppé dans la disgrâce du maréchal Clausel, Yusuf, tout en conservant son grade de chef d'escadrons et le commandement de ses spahis, fut mandé à Paris et y fut retenu pendant près de dix-huit mois, dans une situation équivoque. Du reste, il n'eut pas à se plaindre de son séjour dans la capitale. Il y obtint des succès de tous genres. Il y accomplit de douces razzias et il ravagea peut-être plus de boudoirs parisiens qu'il n'avait jamais ravagé de douars arabes.
Avec sa beauté physique, rehaussée par la sobre élégance de son costume oriental, avec son esprit original, ses idées toutes personnelles, pas banales du tout, avec son langage ardent et imagé, il devait devenir et il devint la coqueluche des salons, le convive des hommes d'État et l'attraction des fêtes royales.
Il circulait dans la haute société parisienne comme s'il n'en fût jamais sorti, et lorsque, aux Tuileries, parlant du temps passé à Tunis, il disait : « Quand j'étais à la Cour », on eût pu croire qu'il arrivait de Versailles et qu'il sortait du petit lever du Grand Roi.
On a prétendu, et c'était peut-être vrai, que Yusuf ne fut retenu si longtemps à Paris que pour le soustraire aux intrigues qui auraient pu se nouer autour de lui, au moment de la seconde expédition de Constantine, et à la tentation de reprendre d'une façon effective, cette fois-ci, son rôle de bey.
Enfin, cette place que la nature semblait rendre imprenable venait d'être prise, et le succès de ce second effort avait remis en faveur ceux qui avaient tenté le premier.
Yusuf avait plu au Château. Il avait plu au monde politique. Il avait plu au ministre de la guerre, avec lequel il avait plusieurs fois traité des problèmes de la conquête, en homme tout à fait compétent. On reconnut qu'il était absurde de se priver de ses services et on décida qu'il retournerait en Algérie, avec un grade plus élevé, pour l'indemniser de la disgrâce momentanée dont il avait à la fois souffert et profité.
On lui donna le grade de lieutenant-colonel et le commandement des spahis de la province d'Oran, corps formé le ter octobre 1836, et établi dans l'ancien palais du bey d'Oran, appelé Misserghin, situé à trois lieues environ de la ville d'Oran, sur la route de Tlemcen.
Yusuf succédait là au colonel de Thorigny, qui commanda le premier les spahis d'Oran. Beau-frère de M. Édouard Bocher, le sénateur actuel, époux d'une très jolie femme, homme d'action et de plaisir, le colonel de Thorigny tenait un peu du héros de roman. On a même raconté qu'il servit de modèle à Alexandre de Lavergne pour le personnage du commandant de Saint-Phal, dans un roman célèbre : La recherche de l'inconnue. Grand ami du général l'Étang, il fut intimement mêlé aux querelles de toute nature qui signalèrent, comme je l'ai raconté, les premiers jours d'existence du 2e de chasseurs d'Afrique. Il se battit même en duel au pistolet, à trente pas, avec le médecin-major du régiment qui l'avait provoqué. Ce médecin était tellement myope qu'il n'aurait pas vu un bœuf à dix pas. Il tira le premier, et le hasard conduisit sa balle dans la joue de Thorigny. La blessure faillit être mortelle. Elle guérit pourtant, grâce aux soins dévoués de celui qui l'avait faite.
En 1837, le colonel de Thorigny dut demander un congé pour raisons de santé. Il comptait bien revenir en Afrique, mais il dut y renoncer et entra avec son grade dans un régiment de lanciers.
Et maintenant, après cette randonnée à travers l'histoire, il est temps de revenir au nouveau soldat du colonel des spahis d'Oran, à la recrue de Yusuf, c'est-à-dire à moi-même.
Dès que j'eus arraché à mon père son consentement, je partis de Mostaganem comme j'y étais venu, c'est-à-dire sur un petit caboteur. Nous étions deux passagers : un sous-officier nommé Cayrolles et moi. Cayrolles venait de perdre un bras, le bras droit, dans de fâcheuses circonstances.
Il faisait partie d'un détachement de deux escadrons de spahis qui avaient escorté le général de Guéheneuc venant visiter Mostaganem. Les deux escadrons étaient allés camper à matamore, où les Arabes leur avaient volé pendant la nuit plusieurs chevaux, en pratiquant tout bonnement un grand trou dans le mur de leur écurie. Cayrolles revenait de Matamore à Mostaganem, à la nuit tombante; il touchait déjà la porte de la ville, lorsqu'une balle partie du ravin lui brisa le coude.
A cette époque, pour une blessure semblable, on ne connaissait qu'un remède : l'amputation.
L'aide-major qui était seul chargé du service de la garnison et qui procéda à cette opération, le docteur Mothès, avait, ce jour-là, trop bien dîné. Bacchus pourtant guida sa main aussi bien que l'eût fait Esculape, et l'amputation réussit à merveille. Cayrolles, privé de son bras, rejoignait son escadron. Il allait obtenir une place de surveillant aux Tuileries.
Nous arrivâmes à Mers-el-Kébir, trop tard pour entrer à Oran le soir même. J'invitai Cayrolles à dîner et nous allâmes prendre notre repas à la cantine du fort.
Je mentirais si je disais que ce premier contact avec la vie militaire me plongea dans le ravissement.
Établie dans une casemate du fort, au pied du rocher dont la paroi lui servait de mur de fond; triste, sombre, à peine éclairée par un quinquet fumeux, meublée seulement de quelques lourdes tables graisseuses et de quelques bancs grossiers, la cantine n'avait rien de folâtre pour un décor de prologue, et surtout pour un acteur qui sortait encore tout chaud du duvet du nid de famille et qui, élevé dans le bien-être, se présentait, un peu troublé par l'appréhension de l'inconnu, au pied et au gradin le plus infime de la dure échelle militaire. Là dedans, s'agitait un monde tout nouveau pour moi, composé de braves gens, mais de gens qui ne brillaient point, il faut le reconnaître, par l'aménité des formes, la délicatesse du langage et l'élégance de la toilette.
J'eus un accès de découragement que dissipa, d'ailleurs, le beau soleil matinal du lendemain, 26 mai 1839. Ce jour-là, j'entrai de mon pied léger à la mairie d'Oran pour signer mon engagement. Il ne fallait pas beaucoup de cérémonies pour faire un soldat, et, en quelques minutes, toutes les formalités étant remplies, je me trouvai bien et dument lié au service de la patrie pour sept ans. Sept ans ! quand on n'en a pas vingt, ou toute la vie, c'est la même chose ! J'aurais signé, sans plus d'hésitation, un engagement pour mon existence entière. D'ailleurs, sept ans, est-ce qu'on s'imagine en voir la fin ?
Hélas ! on la voit. Les sept ans ont passé. Ils ont passé plus de sept fois, saupoudrant de neige la tête et la moustache du spahi, et aujourd'hui il n'a qu'un regret : c'est de ne pas pouvoir recommencer. Il ne choisirait pas autre chose, et il ne choisirait pas mieux.
J'ai dit que toutes les formalités étaient accomplies. Eh bien, elles n'étaient pas accomplies du tout. Le maire d'Oran n'avait pas qualité pour recevoir mon engagement qui, pour être valable, aurait du être enregistré par un maire régulier d'une commune de France, et non par un officier de l'état civil faisant fonction de maire. J'ignorais cela, le maire aussi, et bien d'autres personnes aussi, dont c'était le métier pourtant d'être ferrées sur les questions administratives. De sorte que je n'ai jamais été lié régulièrement au service militaire, car, lorsque j'eus l’âge de la conscription, comme j'étais en Afrique, le maire de Versailles, qui aurait dû tirer un numéro pour moi, n'y pensa pas. Nous étions cinq ou six dans le même cas, aux spahis. Au bout de trois ans, on se demanda, au ministère de la guerre, ce que c'étaient que ces six spahis, sortis, on ne sait d'où. Le général commandant la division fut invité à nous mettre en demeure de régulariser notre situation, ou à nous envoyer promener en nous rayant des contrôles de l'armée. Quand arriva cet ordre péremptoire, j'étais en train de galoper à travers les tentes des tribus du Sud. On en renvoya l'exécution à mon retour. Sur ces entrefaites, je fus nommé sous-lieutenant, ce qui mit fin à l'irrégularité signalée comme une énormité par les bureaux de la guerre.
Avant de me rendre au quartier des spahis, à Misserghin, j'allai présenter mes devoirs à quelques officiers de la garnison d'Oran dont j'avais fait la connaissance chez mon père et qui me firent un accueil très aimable. L'un d'eux, M. Gély de Montcla, adjudant-major au 1er de ligne, que je connaissais plus particulièrement parce que nous avions pris ensemble des leçons d'arabe chez le même taleb (lettré), me retint à déjeuner. Il avait précisément alors pour commensal un ancien compagnon d'armes de mon père, M. Persat, échoué à Oran comme adjudant de place, après la plus romanesque de toutes les carrières militaires. Nous déjeunâmes tous les trois.
« Mauvaise tête et bon cœur », telle aurait pu être la devise de Maurice Persat, qui gâcha comme à plaisir sa vie.
En 1814, il était déjà capitaine de cavalerie. C'était le type du cavalier de guerre. Il maniait la lance avec une vigueur et une adresse incomparables, et, pendant la campagne de France, il donnait journellement à ses camarades le spectacle d'un combat singulier avec un Cosaque ou un uhlan, qu'il allait tranquillement défier, sur le front des escadrons ennemis, et qu'il transperçait invariablement.
Un jour, à la suite d'une de ces prouesses, l'Empereur se le fit présenter et lui attacha, de sa propre main, la croix sur la poitrine. Depuis ce jour mémorable, Persat, fanatique du grand homme, ne signait plus, même les lettres les plus insignifiantes, même les billets doux les plus intimes, que : Maurice Persat, décoré par l'Empereur. Et tout le monde, en parlant de lui, avait pris l'habitude de joindre ce qualificatif à son nom.
A la seconde Restauration, Maurice Persat « décoré par l'Empereur », qui faisait partie des brigands de la Loire, fut mis en demi-solde, au licenciement de l'armée. Il chercha aussitôt d'autres dangers, un autre Napoléon. Il n'était bruit, à ce moment, que du fameux Champ d'Asile et du non moins fameux Bolivar. Un mirage attirait au-delà de l'Océan les infatigables grognards. Persat, qui n'avait pas le sou, eut vite fait de mettre ordre à ses affaires et partit, sac au dos, pour s'embarquer.
Le hasard voulut qu'en route, il croisât un régiment de la garde royale dans lequel se trouvaient plusieurs de ses anciens camarades, qui le reçurent à bras ouverts et, désireux de venir en aide à sa détresse, firent entre eux une collecte.
Cette collecte produisit mille cinq cents francs, qu'ils comptaient lui remettre, au dessert d'un grand dîner qu'ils lui offrirent.
Persat accepta le dîner, mais refusa l'argent et, détail qui peint l'homme, qui peint aussi l'époque, il n'avait plus, à ce moment, que quarante francs dans sa poche.
On sait quel fut le sort lamentable de l'établissement tenté, au Texas, par les officiers de l'ancienne armée impériale, sous la direction du général Lallemand.
Quand Persat quitta l'Amérique, la Grèce venait de se soulever. Il ne laissa pas échapper cette excellente occasion, et, transformé en philhellène, il alla trouver Fabvier. Il assista à la prise de Missolonghi et au sac de Tripolitza, où il sauva une jeune Grecque qu'il épousa sur l'heure.
Mais ce modèle des guerriers n'était probablement pas le modèle des maris, et le bonheur conjugal ne tarda pas à déserter son foyer. Plantant là sa femme, ou planté là par elle, il se remit à guerroyer contre les Turcs. A la suite de la campagne de Morée, le maréchal Maison, qui l'avait vu à l'œuvre, obtint sa réintégration dans les cadres de l'armée française.
C'était peu de temps avant la chute du gouvernement de Charles X, auquel la révolution de Juillet le trouva si bien rallié qu'il refusa avec horreur de manquer à son serment. Et voilà mon Persat remis en non-activité, pour fidélité à cette Restauration que, pendant quinze ans, il n'avait pas voulu servir.
Heureusement, quand le général de Cuéheneuc, beau-frère du maréchal Lannes et dernier aide de camp de l'Empereur, fut nommé au commandement de la province d'Oran, il se souvint du pauvre Persat et l'emmena comme adjudant de place. Il occupait ce poste quand je le connus. C'était un homme de quarante-cinq ans environ, plein de force et de santé, une sorte de géant, un peu épaissi par l'âge, mais pas du tout assagi par les aventures.
Après déjeuner, il me mena chez lui et me montra ce qu'il appelait son « petit musée ». Très curieux, le « petit musée ». Si les personnages qui s'y faisaient vis-à-vis avaient pu s'animer un instant, la concorde n'y eût certainement pas régné. Il y avait là toutes les idoles de Persat, se faisant pendants et jurant d'être ensemble : l'Empereur et Charles X, le roi de Rome et le duc de Bordeaux, Marie-Antoinette souriant à Joséphine, et Louis XVI contemplant d'un air débonnaire Robespierre.
Pour en finir tout de suite avec cet original, je dirai que, s'il était éclectique en politique, il n'était pas le moins du monde commode dans la vie privée, et il fallait au pauvre de Montcla une patience d'ange pour supporter les discussions que Persat soulevait sur tout et à propos de tout.
Un jour, Montcla n'y tint plus et il manqua de patience. Il en manqua absolument, car il envoya promener son ami, Maurice Persat, « décoré par l'Empereur », en ces termes un peu vifs : « Je me f... de vous à pied comme à cheval.
- Comme à cheval ! dit Persat, je le veux bien. C'est à cheval, demain, que nous continuerons cette conversation. »
Le lendemain, tout Oran alla assister à cette rencontre épique. Persat fut vainqueur, mais il fut généreux, car ce fut le cheval de son adversaire qui supporta tous les frais de la guerre.
A la première passe, il lui abattit une oreille, d'un coup de sabre. A la seconde, il lui découpa une escalope dans la croupe. A la troisième, enfin, d'un coup de revers sur le bras, il fit tomber l'arme de la main de son adversaire, et on alla déjeuner, pendant que le cheval entrait à l'infirmerie.
Non, Maurice Persat, « décoré par l'Empereur », n'était pas aimable. A Oran on ne l'avait pas vu accomplir ses prouesses; on ne le connaissait que par les aspérités de son caractère, et on en avait assez.
Le général de Guéheneuc, pour tout concilier, lui donna le commandement de l'île de Rachgoun, à l'embouchure de la Tafna. La garnison se composait d'une compagnie de zéphyrs, et on était obligé de lui apporter jusqu'à l'eau qu'elle buvait. Là, un beau matin de 1840, Maurice Persat, « décoré par l'Empereur », proclama la République. Il partait huit ans trop tôt. Le général de Guéheneuc, que toutes ces excentricités n'avaient pu détacher de lui, le nomma adjudant de place à Mazagran. C'était une sinécure, et c'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. C'était, au fond, un très brave homme et un homme très brave, mais il n'était supportable que lorsqu'il chargeait, ou que lorsqu'il chantait des chansons du Caveau. Il savait par cœur Béranger et Désaugiers. C'était, avec les coups de sabre, sa seule spécialité.
Enfin me voilà à Misserghin, chez les spahis, chez moi. L'installation de notre quartier général était assez confortable. L'ancienne maison de campagne du Bey avait été aménagée en logement pour les officiers. Elle communiquait, par une longue caponnière, avec la maison du colonel, et, le long de la caponnière, on avait dressé des hangars qui servaient d'écurie à tous les chevaux du régiment. Les baraquements pour la troupe remplissaient une vaste redoute, et autour, quelques spahis indigènes vivaient sous la tente avec leurs familles. Il y avait eu là, jadis, de très beaux jardins, irrigués par des eaux courantes qui se réunissaient en plusieurs bassins, servant de bains froids. Les officiers avaient leurs bassins spéciaux, ainsi que les sous-officiers, et aussi les simples spahis qui nageaient tous comme des poissons. On y jouait à la Rahba, une sorte de lutte en grand honneur chez les gens de l'Ouest et qui consiste à se surprendre mutuellement, au son du tambourin, par des coups de talon appliqués de préférence derrière l'oreille. C'est beaucoup plus amusant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Dans l'eau, c'est évidemment moins dangereux que sur le sol. Mais, pour en jouer proprement, il faut n'avoir rien à envier aux otaries.
Les spahis ne pouvaient recevoir comme simples cavaliers français que des spécialistes, maréchaux-ferrants, ordonnances d'officiers ou trompettes. Je ne pouvais pas être ordonnance. Je n'avais pas non plus une vocation bien déterminée pour la maréchalerie. On m'admit donc comme élève trompette. Il est vrai que mes aptitudes musicales m'interdisaient tout espoir d'avancement dans la musique. Par bonheur, mon emploi n'était que fictif.
Engagé sous les auspices du commandant de Montauban, qui me montra toujours une bienveillance dont je lui suis resté profondément reconnaissant, j'avais emporté de la maison paternelle, à défaut d'argent, les recommandations les plus sévères. Mon père, qui connaissait la mésintelligence profonde existant entre le commandant de Montauban et le colonel Yusuf, m'avait bien conseillé d'être prudent, d'être sourd, d'être aveugle, pour n'être pas broyé entre les chefs.
A vrai dire, quoiqu'on sentît dans le régiment qu'il y avait le parti du commandant et le parti du colonel, les simples cavaliers indigènes, rompus par tempérament national à l'obéissance, ne pensaient même pas à cet antagonisme. Mais il n'en était pas de même des sous-officiers et surtout des officiers, et, quoique simple soldat, j'allais me trouver mêlé à leur existence, puisque je les avais presque tous connus à la maison paternelle. Il fallait donc me tenir scrupuleusement en dehors de leurs passions.
Ce n'était pas que je dusse trouver dans le corps des officiers, en dehors de Montauban, qui fut toujours charmant pour moi, de bien chaleureux protecteurs. Mon père n'avait pas toujours le commandement débonnaire, et plusieurs de ces officiers, qui avaient passé sous ses ordres, lui gardaient une rancune dont il était assez humain qu'ils me fissent sentir le contre-coup. Je n'ose pas dire que ce fut à un aussi misérable sentiment qu'obéissait le capitaine de Montebello, commandant le quatrième escadron, dans lequel je fus placé. Mais je dois constater que cet officier ne me montra jamais la moindre bienveillance, tant que je restai sous ses ordres, et je dus les subir dans des situations très diverses, car, bien des années plus tard, je commandai une brigade de cavalerie dans une division de la Garde dont il était le chef, et nos rapports ne furent guère plus cordiaux. Il n'a jamais été pour moi un supérieur affectueux. Je me suis contenté d'être pour lui un subordonné correct et strict, jusqu'au jour où, devenu ministre de la guerre, j'ai pu me venger, en lui rendant, avec un empressement particulier, tous les petits services qu'il réclamait.
A mon entrée au corps, les officiers de spahis portaient le costume turc, qu'ils ont échangé, trois ans plus tard, en 1842, contre une tenue française. Ce costume comportait la veste turque rouge, soutachée de noir, sur le gilet bleu de roi, la large culotte bleue, arrêtée aux genoux, la botte molle avec éperon vissé, le turban de fantaisie et le burnous rouge. C'était très joli, quand on avait de la ligne, de la désinvolture; mais quand on prenait du ventre, cela vous donnait tout de suite l'air d'un marchand de pastilles de la rue de Rivoli.
Et puis, cela prêtait un peu trop au caprice et à la dépense. Un cachemire autour de la tête, un harnachement arabe, avec housse brodée, suffisaient à manger la solde d'une année et à endetter pour longtemps leur possesseur.
La troupe portait la tenue arabe, à peu près semblable, avec le turban rayé bleu et blanc. Tous les samedis, on nous faisait une théorie sur la manière d'enrouler et de porter le turban, et jamais nous n'arrivions à l'uniformité rêvée.
Pour armement, le sabre et le fusil.
Maintenant que je viens de faire le croquis de mes chefs, il convient, j'imagine, de crayonner les camarades de mon peloton. Je peux le faire à la plume et avec de l'encre : ils étaient tous des nègres.
En France, ce qui manque le moins pour toutes choses, ce dont nous avons fait une provision inépuisable, ce sont les systèmes. Nous possédions, cela va sans dire, à cette époque déjà, de nombreux systèmes sur le rôle et sur le recrutement des corps indigènes.
Malheureusement, les circonstances ne se plient pas toujours aux systèmes; elles obligent les hommes à passer souvent de l'un à l'autre. Au début, on avait déclaré sur le papier que les spahis formeraient un corps aristocratique, recruté surtout parmi les cavaliers des grandes tentes, appartenant aux familles de la noblesse. C'était très séduisant. Mais, quand les cavaliers des grandes tentes ne suffisaient pas à remplir les escadrons, on acceptait tous ceux qui se présentaient, et alors les cavaliers des grandes tentes, mécontents d'avoir pour égaux, ou même pour supérieurs, des hommes qu'ils jugeaient situés plus bas qu'eux dans la société, s'en allaient.
Au moment où j'arrivai, le cavalier des grandes tentes donnait fort peu. Abd-el-Kader, qui se préparait à rompre la paix, surexcitait partout le fanatisme religieux qui devait éloigner les Arabes du service des chrétiens ; et la paix elle-même, en faisant croire aux populations que l'Émir était le souverain du pays, nuisait à notre prestige et éloignait de nos rangs les indigènes.
Dans ces conditions, on était réduit à accepter tous ceux qui se présentaient. On éludait même l'ordonnance qui obligeait chaque cavalier à amener avec lui son cheval, et le régiment fournissait des chevaux aux pauvres diables qui n'en avaient pas, et qui les payaient au moyen d'une retenue mensuelle sur leur solde.
On avait enrôlé jusqu'à des nègres, et le colonel en avait formé deux pelotons, attribués au 4e escadron, n'est dans un de ces pelotons que je fis mes débuts. Je n'ai jamais eu à me plaindre de ces braves gens ; au contraire, pour eux j'étais toujours le fils du colonel (Ouled-el-Colone), c'est-à-dire un être d'une essence supérieure, et ils me montraient une prévenance que je n'aurais certainement pas rencontrée chez mes compatriotes dont je heurtais les habitudes. On consommait énormément de liqueurs fortes, dans l'armée d'Afrique, et je n'ai jamais pu sentir l'alcool. C'était l'usage dans la cavalerie d'aller, dès le réveil, boire la goutte à la cantine, et cette première consommation était la tête d'un chapelet de verres de rhum, d'absinthe, etc., qui s'égrenait jusqu'à l'extinction des feux. Moi, quand je me croyais obligé, le matin, d'accompagner les camarades chez le cantinier, je me faisais apporter une tasse de lait chaud. Au début, on me servit quelques plaisanteries en guise de sucre; mais, comme je ne prenais pas la mouche, comme on savait aussi que je faisais très gentiment des armes, ça n'alla jamais trop loin.
Ce soir-là, je partageai, pour la première fois, le domicile de mes frères d'armes noirs : une grande baraque séparée en deux, dans le sens de la longueur, par une cloison de grosses tiges de fenouil maçonnées en torchis. Pour lit, un des hamacs de toile à voiles suspendus à deux barres parallèles qui couraient le long de la baraque . Pour plancher la terre nue. C'était assez propre; mais il paraît que les puces et les punaises se complaisaient dans cette propreté. Il en courait des légions sur nous, et je fus probablement un vrai régal pour ces animaux, habitués à se nourrir de peau noire.
Quant aux rats, ils avaient élu domicile dans notre cloison, où ils faisaient un vacarme d'enfer. On passait la lame du sabre entre deux tiges de fenouil, on allait jusqu'à l'extrémité de la rainure, et on ramenait toujours un de ces rongeurs, fléaux de nos effets d'équipement. Mes nègres, étant tous célibataires, logeaient tous dans la baraque et n'avaient pas de prétexte conjugal pour vivre sous la tente, comme certains de leurs camarades Arabes. Ils se conduisaient tous fort bien, excepté deux ou trois, et parmi ces derniers, une façon de colosse nommé Belloul, fort comme un bœuf et méchant comme un âne rouge. Encore celui-là n'était guère à craindre, car il était toujours en prison. On ne le lâchait que les jours de combat, où il faisait merveille.
Si, maintenant ! on veut bien songer que l'élève trompette qui s'endormit, ce soir de mai, muni de son fourniment dont il était jaloux comme d'une fortune, au milieu d'un peloton de nègres, a fini par devenir ministre de la guerre, on conviendra, j'espère, que le métier militaire n'est pas positivement une carrière fermée, et qu'avec un peu de chance, à la condition de s'aider aussi un peu, on arrive encore à y faire son petit chemin.
|
PAUL BARNIER
LE GRAND DU RUA
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°205 - Mai 2012
|
 Paul Laurent Barnier naît dans la bonne ville de Saïda le 10 mars 1909. C'est dans le pittoresque marché arabe aux odeurs épicées que le "déjà grand pour son âge", Paul dispute ses premiers matches de football avec les camarades du quartier. Malgré des aptitudes certaines pour le sport, il doit à l'instar des autres enfants du quartier, se contenter de ces rencontres de la rue car le championnat d'Oranie de l'époque commençait seulement dans les catégories "juniors". Heureusement, le Grand Lycée d'Oran fournit à toute cette jeunesse privée de compétition officielle une épreuve à la hauteur de son ambition. Paul Laurent Barnier naît dans la bonne ville de Saïda le 10 mars 1909. C'est dans le pittoresque marché arabe aux odeurs épicées que le "déjà grand pour son âge", Paul dispute ses premiers matches de football avec les camarades du quartier. Malgré des aptitudes certaines pour le sport, il doit à l'instar des autres enfants du quartier, se contenter de ces rencontres de la rue car le championnat d'Oranie de l'époque commençait seulement dans les catégories "juniors". Heureusement, le Grand Lycée d'Oran fournit à toute cette jeunesse privée de compétition officielle une épreuve à la hauteur de son ambition.
Paul Laurent est déjà une "belle plante" et les entraîneurs de l'époque utilisent une formule simple mais efficace. "Tu es grand et fort, tu joueras arrière central ou avant centre". C'est ainsi que le jeune Barnier disputera tout le championnat avec le n°9 dans le dos car il préfère marquer des buts plutôt que d'en encaisser. Le n° 9 lui colle tant à la peau que le Gallia Club Oranais l'enrôle l'année de ses dix huit ans. Deux saisons qui lui permettront de se faire un nom et une réputation telle que muté à Alger pour effectuer son service militaire, il sera accueilli à bras ouverts au Racing Universitaire Algérois alors en difficulté. L'année suivante, le RUA accède à la première division. Après un intermède de deux ans au Stade Marocain de Rabat, il revient chez les ciel et blanc pour une période de plusieurs années durant lesquelles il verra sa carrière auréolée de plusieurs titres
- Meilleur buteur de la Ligue d'Alger en 1935
- Vainqueur de la Coupe d'AFN contre l'Italia de Tunis (1936-1937)
- Champion d'Algérie (1936-1937)
- 1 sélection de la ligue d'Alger
- 1 sélection d'AFN contre l'équipe de France au Stade Alenda d'Oran.
Officier de carrière, le professionnalisme ne le tentera point et c'est au RUA qu'il terminera une carrière riche de souvenirs et d'amitié. Souvenir comme la victoire sur le FC Sochaux, le match homérique contre l'Italia de Tunis, face à une formation portée par l'ensemble du public d'origine italienne sous une pluie d'enfer, le "match-poursuite" contre l'AS Boufarik avec une bagarre générale à la clé et une poursuite en voiture jusqu'à l'entrée d'Alger. De l'amitié plein le cœur et la tête aussi bien du Maroc que des anciens du RUA qu'il retrouve chaque année pour le repas des anciens (Couard, Faglin, Poizat, Jasseron, Samuel et consorts).
Alors pour une journée, Paul Barnier laisse aller sa formidable joie de vivre pour animer ces retrouvailles pimentées de nostalgie et d'accent pataouète.
H. Zakine
La mémoire du Football
d'Afrique du Nord
|
|
ANNALES NOUVELLES
N° 2, 1838
|
|
Hammam Meskoutine
ou les bains maudits en Algérie.
Un ouvrage mensuel donne sur les sources thermales, appelées par les Arabes Hammam Meskhoutine, une notice intéressante dont nous allons reproduire les principaux détails.
On connaît par les bulletins de l'armée de Constantine, l'endroit appelé Medjez-el-Hamar où nos troupes ont campé pendant plusieurs semaines. A une petite lieue et à l'ouest de ce camp, le sol montueux présentait un aspect singulier. La roche, d'une teinte grisâtre y est formée de sédiments calcaires, comme auprès des sources thermales en France ; mais ce que la localité africaine a de particulier, ce sont des roches en forme de cône, par lesquelles les eaux ont jailli autrefois, et qui ne sont également que le produit des dépôts de l'eau.
En effet, ces cônes se composent de couches placées les unes sur les autres et diminuant de circonférence à mesure qu'elles s'élèvent. II est évident que ces dépôts ont fini par fermer l'issue aux eaux souterraines, et par les forcer à se frayer d'autres issues pour sortir de terre. Quelquefois l'eau a jailli à côté de l'endroit qui venait de se boucher. Dans ce cas les cônes se touchent, ils se confondent ; d'autrefois ils sont isolés et atteignent une hauteur de 1 à 5 mètres. Quelques cônes fermés aux eaux laissent encore échapper des vapeurs.
Il y a des endroits où les eaux en déposant leur sédiment pendant la chute ont formé des gradins curieux à voir. La roche qui constitue la montagne n'est elle-même qu'un produit des sédiments calcaires ; or, cette roche se prolonge bien au-delà de Guelma. Tous les plateaux de la contrée ont la même origine. Quel temps il a fallu pour produire une masse aussi énorme de sédiments calcaires!
Les sources thermales qui jaillissent à Hammam Meskhoutine ont 76 à 80° de chaleur au thermomètre de Réaumur. Elles contiennent de la chaux carbonée, du fer carbonaté, et laissent échapper du gaz acide carbonique, ainsi, qu'un peu d'hydrogène sulfuré. Les Romains ont connu la vertu de ces eaux, et en ont fait usage, ainsi que le prouvent les restes de constructions antiques qu'on voit au bas du plateau, et dont l'examen donnera peut-être lieu à des découvertes intéressantes. Mais depuis longtemps les eaux ne jaillissent plus à l'endroit où sont les bains antiques elles se rayent sans cesse de nouvelles issues à mesure que les anciennes se bouchent. Deux orifices nouveaux se découvrirent pendant le séjour des troupes au camp de Medjaz-El-Hamar.
Les Arabes appellent cet endroit d'un aspect si étrange, Hammam-Meskoutine ou les Bains maudits à cause de la tradition d'un miracle qui se serait opéré dans ce lieu. Un homme riche de la contrée, au mépris des lois divines et humaines, voulut contracter un mariage incestueux avec sa sœur ; le festin était préparé, et la noce allait être célébrée, quand la colère du ciel éclata, et changea tout en roche.
Les cônes qui s'élèvent ce sont les convives du festin ; les chaudières dans lesquelles bouillaient les viandes se sont enfoncées dans la terre ; c'est de ces chaudières maudites qui sort l'eau bouillante que l'on voit couler à la surface du sol.
|
|
Où naissent les idées ? Ce serait au cerveau ?
En y plantant leur clou, avec ou sans marteau ?
Elles y sont maltraitées par nos propres neurones
Qui souvent les combattent, les tuent ou les détrônent.
« Autant on a de mots et donc autant d’idées »,
Nous disent les Larousse, les Robert, les Littré.
L’idée serait peut-être un arrêt de pensée ?
Les pensées de passage, on peut les épingler...
Pour moi, j’ai l’impression qu’il m’en vient de partout
Peut-être bien du foie, du cœur... ou des genoux ?
De derrière la tête, il m’en arrive aussi,
Mais qui, à cache cache, aiment rester tapies.
Des idées, j’en ai trop et ne sais plus qu’en faire ;
J’en ai des quantités et voudrais les faire taire.
Je me sens harcelé et cherche à les ranger,
Sans savoir les classer ni pouvoir les stocker.
Si quelqu’un en cherchait, j’en céderais volontiers
Et même supplierais de m’en débarrasser.
En s’engageant, bien sûr, à les emmener loin
Et les faire disparaître en de sombres recoins,
Afin d’être certain qu’aucune ne revienne
Me retomber dessus en nouvelle rengaine.
Par contre, je n’aime pas partager mes idées,
Et tiens à ce qu’elles restent entières et non scindées.
Les idées lumineuses sont-elles affaire d’optique ?
Et faut-il des lunettes pour en jauger l’éthique ?
Avoir des idées fixes, n’est pas toujours l’indice
D’opinions « arrêtées » ou manipulatrices ;
Et quant aux idées noires, plus courantes qu’on ne croit,
Pas seulement pour les deuils, on en est tous la proie.
Est-ce pour cette raison qu’on parle « matière grise »,
Couleur, pour le moral, toujours bien mal comprise?
L’idée n’a pas d’odeur : miracle d’habileté !
Sinon, l’humanité eut été asphyxiée…
Pour les « idées reçues », là aussi, la prudence :
Maladies contagieuses, elles virent en sentences...
Comme nous, les idées, vieillissent parfois mal.
Tout en les soignant bien, elles s’usent, c’est normal,
Et même les plus saines choppent des rhumatismes
Voire des religions, des guerres ou des wokismes.
Faut-il les modifier, rapiécer, adapter ?
Ou bien les rénover et les moderniser ?
Carrément les changer et balancer les vieilles ?
Qui nous dit que les neuves feraient plus de merveilles ?
Les mots, en général, ne manquent pas aux pensées
Mais les idées, souvent, aux mots font des ratés,
Car on prend moins de soin à bien les exprimer.
Mais encor, là peut-être, « je me fais des idées »…
Jacques Grieu
|
| |
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
|
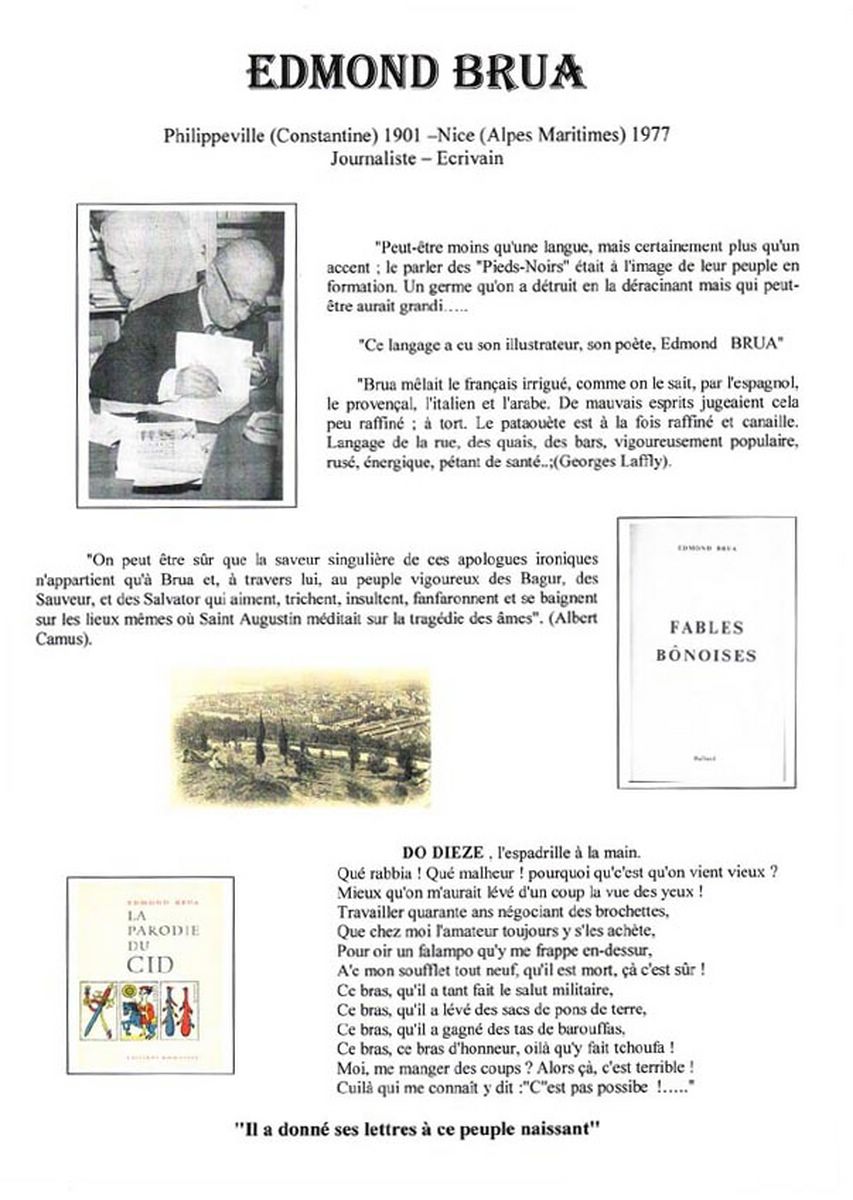 A SUIVRE
A SUIVRE
|
|
Les relations franco-algériennes
de 1492 à 1830
Par le Général Jean Fleury
Envoyé par M. A. Hamelin
|
Des différends franco-algériens marquent souvent l’actualité mais pour aborder la question avec objectivité, il est souhaitable de regarder ce qui s’est passé en Méditerranée occidentale durant les siècles qui ont précédé l’arrivée des Français en Algérie.
1492 marque la fin de la Reconquista. L’Espagne, et par là l’Europe occidentale, ont retrouvé l’intégrité de leurs territoires. Mais les musulmans d’Afrique du Nord viennent marauder sur les côtes espagnoles, puis progressivement étendent leurs exactions. Les rivages de l’Espagne et de l’Italie sont désolés par des raids de pillards. Pour s’y opposer, le cardinal Ximénès, alors archevêque de Tolède, lance des expéditions contre les principaux ports d’où partent les agresseurs. Mers-el-Kébir est pris en 1505, Oran en 1508 (qui, en dehors d’une courte période au début du 18e siècle, reste espagnol jusqu’en 1792) et Bougie en 1510. Alger, effrayé, se rend et les Espagnols construisent une forteresse sur une île en face de la ville, le Peñon. Sous la menace de celle-ci, les pirates ne peuvent plus exercer leur activité et la ville s’appauvrit.
En 1516, les habitants d’Alger appellent le pirate Barberousse à leur secours. Celui-ci, pour atteindre son objectif demande l’aide des Turcs et, pour plus de sécurité, se place sous l’autorité lointaine de la Sublime Porte. Il est ainsi le représentant officiel du sultan. Avec l’aide des Ottomans, il devient le maître d’Alger. En 1529, il reprend le Peñon et étend son domaine pratiquement à toute l’Algérie et la Tunisie.
Alger est ainsi libre de ses mouvements et va vivre de la piraterie pendant trois siècles. Les marins barbaresques attaquent tous les navires marchands en Méditerranée. Les cargaisons sont saisies, les équipages et les passagers sont vendus comme esclaves, les passagères, quand il y en a, vont dans les harems. La chrétienté s’émeut et le rachat des victimes s’organise. Captifs et captives sont délivrés contre un bon prix par leur famille ou plus généralement par des organisations charitables. En France comme en Espagne, des ordres religieux, les pères de la Merci ou de de la Sainte Trinité par exemple, sont créés pour recueillir des fonds et payer la libération des prisonniers. Cela a une certaine efficacité mais fait grimper les prix. La torture des otages est aussi utilisée pour faire monter les enchères. Comme les butins enlevés en mer ne suffisent pas, des razzias sont organisées sur les côtes espagnoles, françaises et italiennes. Ainsi Cervantès, le futur auteur de Don Quichotte, est pris en 1575 mais libéré en 1580 par le paiement d’une rançon. Saint Vincent de Paul est capturé en 1605 mais il réussit à s’échapper de Tunis en 1608.
Côté européen, le commerce avec les tribus arabes d’Afrique du Nord, ainsi que la pêche du corail, a toujours intéressé les marchands. Des redevances sont versées aux chefs locaux algériens ou tunisiens, parfois indépendants, pour obtenir l’ouverture de comptoirs et ceci pour des périodes plus ou moins longues. Dès le XIIIe siècle, la France et comte de Provence ont ainsi, au gré d’accords de durée variable, des possessions sur la côte. La plus importante est établie à La Calle (60 kilomètres à l’est de Bône devenu Annaba), suite à l’autorisation de la pêche du corail donnée à la France par Constantinople en 1540. Un riche négociant obtient vers 1553 l’autorisation d’y installer la Compagnie marseillaise des concessions d’Afrique. Au fil des ans le comptoir se développe et devient une véritable ville avec garnison militaire, entrepôts, hôpital et même une église. Mais les installations sont détruites 11 fois, la dernière en 1827, puis reconstruites !
La piraterie conduite par les barbaresques irrite en permanence les nations chrétiennes. En 1535, Charles Quint, roi d’Espagne sous le nom de Carlos 1er, débarque en Tunisie et marche sur Alger mais il échoue et ses troupes doivent rembarquer en 1541.
En Europe pour sa guerre contre Paris, Charles Quint s’allie à Henri VIII d’Angleterre. Pour rétablir l’équilibre des forces, François 1er s’unit aux Ottomans en 1536. Le sultan, Soliman le magnifique, écrit ainsi au roi « Il est commandé à l’amiral Barberousse qu’il mène la guerre contre l’ennemi à votre vouloir ». Cette alliance entre le crucifix et le croissant fait grincer bien des dents dans les nations catholiques mais elle établit un certain équilibre et va permettre aux Français de ne plus être inquiétés en principe par les barbaresques. Il leur faut cependant, comme indiqué ci-dessous, intervenir périodiquement pour rappeler au dey d’Alger, les engagements pris par la Sublime Porte.
Régulièrement les pays européens, avec ou sans la France, viennent demander des comptes au dey. Parfois les flottes sont victorieuses et le dey se soumet pour quelques années ; parfois, c‘est l’échec. Ainsi en 1665 la France détruit à Tunis les navires des pirates. Le calme revient pour un temps mais en 1681, il faut recommencer. En 1775, ce sont les Espagnols qui interviennent mais ils échouent.
En 1798, la France est en guerre avec l’Angleterre depuis 1793. Cette dernière a une réelle supériorité maritime ce qui rend impossible un débarquement sur ses côtes. Le Directoire estime alors que lui interdire la route des Indes serait une bonne façon d’abattre sa puissance ; la conquête de l’Égypte est décidée et le général Bonaparte quitte Toulon le 19 mai 1798.
Le dey d’Alger, à la demande du sultan d’Istamboul mécontent de l’attaque des Français contre l’Égypte, nous déclare la guerre et s’empare de nos installations à La Calle. Mais les relations franco-algériennes, bien qu’officiellement conflictuelles, n’empêchent pas les affaires. Les finances françaises ont été mises à mal avec la Révolution et une partie des approvisionnements destinés aux troupes partant en Égypte sont achetés à crédit chez des commerçants d’Alger. Un prêt est également accordé par le dey.
Le général Bonaparte, devenu premier consul fait la paix avec la Porte et le 17 décembre 1801 un traité est signé entre Paris et Alger. Les concessions sont rétablies et les Français ne peuvent plus être retenus comme esclaves. Mais les dettes sont là et en 1802, le dey envoie un courrier rappelant les créances de 1798. Les autorités françaises ne font rien pour honorer leur signature. Aussi, en 1807, nos privilèges nous sont enlevés et donnés aux Anglais moyennant une redevance annuelle de 267 000 francs.
Devenu empereur, Napoléon s’en inquiète mais l’Empire tombe sans que rien ne soit tenté. Les puissances réunies à Vienne pensent à agir pour mettre fin aux pirateries des barbaresques mais l’Angleterre, soucieuse de ses intérêts, s’y oppose arguant de l’existence des traités en vigueur et des difficultés d’une opération contre Alger.
En juin 1815, une flotte américaine arrive devant Alger. Les États-Unis ont en effet décidé de ne plus payer de tribut au dey pour assurer la sécurité de leur commerce. Ce dernier, effrayé par la démonstration de force signe un traité par lequel il renonce à la piraterie. Mais l’encre à peine sèche, les exactions recommencent. À leur tour, les Anglais interviennent en 1816. Après des combats violents, le dey signe un traité avec Londres abolissant l’esclavage et libérant les captifs. La paix ne dure pas longtemps et une escadre anglo-française intervient en septembre 1819 pour exiger, de la part des nations européennes, la fin du brigandage des pirates barbaresques. Le dey fait la sourde oreille.
Mais les négociations entre la France et Alger se poursuivent et le 28 octobre 1819 une convention est signée. Quatre millions et demi sont versés aux commerçants algériens et une somme de deux millions et demi est mise en réserve en garantie des contestations à régler devant les tribunaux français. En 1826, les tribunaux n’ont pas encore tranché et le dey s’énerve. Il écrit au roi exigeant ce qu’il avait simplement demandé jusque-là. Charles X refuse de répondre au chef des pirates ! Le ministre des Affaires étrangères charge notre consul, monsieur Deval, de dire au dey que ses demandes ne sont pas admissibles.
Conformément aux traditions locales, la veille de l’Aïd, le 30 avril 1827, notre porte-parole va saluer le dey. Il en profite pour lui parler d’un navire du Saint-Siège, couvert par le pavillon français, qui avait été capturé. La piraterie n’a pas cessé. Mais l’Algérien ne veut rien entendre. Il veut avoir une réponse écrite à sa lettre. Le ton monte et exaspéré, il frappe notre représentant avec son chasse-mouches et lui ordonne de sortir. Nous ne sommes plus en conformité avec les usages diplomatiques. L’affront est intolérable. Charles X exige des excuses officielles. Une division navale quitte Toulon début juin pour transmettre la volonté du roi. Le dey refuse de s’y soumettre. Un blocus d’Alger est instauré mais une fois encore, le dey rejette toute idée de compromis. En octobre, ses navires tentent de forcer le passage. Un combat s’engage mais les Algériens doivent se replier dans leur port. La situation est bloquée.
Une tentative de dialogue est tentée en août 1829 mais en vain, les parlementaires sont reçus à coups de canon. Le blocus coûte cher, sept millions par an. Il ne sert à rien de continuer ainsi, il faut donc intervenir par la force. Après l’examen de plusieurs solutions un débarquement à Sidi-Ferruch (environ 20 kilomètres à l’ouest d’Alger) est proposé au roi. Le port d’Alger est trop bien défendu pour une attaque directe et un débarquement à l’est aurait fait marcher les troupes dans des terrains marécageux pouvant devenir des bourbiers en cas de pluie ; Charles-Quint en avait fait la triste expérience en 1541.
Fin janvier 1830, le roi Charles X décide l’opération et le 2 mars 1830, il l’annonce dans le discours de la couronne aux Chambres.
Au plan international, l’Europe continentale est très favorable au projet français. Les nations du nord ne veulent plus entendre parler de la piraterie barbaresque et se réjouissent des services que la France va rendre ainsi à l’humanité entière. À l’exception de l’Angleterre, elles obtiennent chacune même la participation d’un officier les représentant au sein du corps expéditionnaire. L’Espagne autorise l’installation d’un hôpital français à Minorque et ouvre ses ports des Baléares à notre flotte. Seul Londres est résolument opposé au débarquement sur la côte algérienne. Il voit la perte des avantages qu’Alger lui a consentis et surtout il ne veut pas voir la France en position de force pour contrôler la partie occidentale de la Méditerranée avec la voie maritime entre Gibraltar et Malte. Ses manœuvres comme ses protestations diplomatiques sont très fermes mais sans effet.
La Sublime Porte, qui détient une autorité de principe sur le dey d’Alger, est bien évidemment hostile à l’entreprise du roi de France. Mais dans le cadre de l’indépendance de la Grèce, sa marine a été défaite à Navarin le 20 octobre 1827 par la coalition franco-russo-anglaise. Ses protestations manquent de vigueur.
Les souverains d’Afrique du Nord ne payent un tribut à Constantinople que par crainte ; le succès espéré des armées françaises leur fait perdre tout esprit de fidélité. La France n’a donc rien à craindre de leurs côtés.
Le 11 mai les troupes embarquent et le 18 la flotte quitte Toulon. Après une escale aux Baléares, le 14 juin 1830, au lever du jour les troupes sont mises à terre à Sidi-Ferruch. Des combats ont lieu contre les soldats arabes mais ceux-ci sont mis en déroute. Après la prise du seul fort qui protège la capitale d’une attaque terrestre, Alger ne peut plus résister. Le dey refuse d’abord de traiter mais après négociation, il accepte de capituler.
Le 5 juillet, les troupes françaises entrent dans la ville. Les équipages des navires pirates sont faits prisonniers et les esclaves sont enfin libérés. Une nouvelle page de l’histoire de l’Algérie s’ouvre.
Ainsi, du XVIe au XIXe siècle des échanges commerciaux importants ont eu lieu entre la France et l’Algérie avec en particulier la création de comptoirs sur la côte africaine comme à La Calle. Mais le commerce des esclaves, avec l’attaque des navires marchands en mer et les razzias sur les côtes européennes, est un des problèmes majeurs auquel les nations chrétiennes ont dû faire face durant trois siècles. À de nombreuses reprises, elles ont essayé d’y mettre fin par des attaques directes contre Alger mais elles ont toutes échoué. La crise créée par l’impécuniosité française concomitante avec un acte de piraterie a conduit au débarquement des Français à Sidi-Ferruch en 1830 et, par là, a mis fin à trois cents ans de brigandage.
|
|
Algérie : toute la vérité sur le putsch des généraux
PAR MANUEL GOMEZ
Envoi de M. Georges
|
 Generaux Algerie
Generaux Algerie
Il faut que les Français, surtout les plus jeunes, ceux qui n’ont pas vécus cette époque, soient éclairés sur les évènements qui se sont déroulés avant, pendant et après cette nuit du 20 au 21 avril 1961, date du « putsch » des généraux, aussi bien à Alger qu’à Paris car ce n’est pas auprès des historiens « officiels » qu’ils approcheront la vérité.
Le 8 janvier 1961 se déroule le référendum sur l’autodétermination, offerte à l’Algérie par De Gaulle. 75,25% des suffrages exprimés en métropole l’approuvent. Lors de sa conférence de presse du 11 avril 1961, le chef de l’état justifie la décolonisation de l’Algérie « parce qu’elle coûte très chère à la France, déjà bien endettée. »
Dans sa très grande majorité les officiers supérieurs de l’armée française sont hostiles à cette politique d’abandon.
Les colonels Argoud, Gardes, Godard et Lacheroy demandent au général Challe de s’y opposer par la force, si nécessaire. Le général Challe hésite. Il n’est pas convaincu de l’opportunité de cette « rébellion patriotique », mais fini par accepter d’y participer, (mais surtout encouragé par le colonel de Boissieu, cousin du gendre de De Gaulle, qui aussitôt en réfère au chef de l’Etat).
Dans la nuit du 20 au 21 avril, les paras du 1er REP, sous les ordres du commandant Hélie Denoix de Saint-Marc, s’emparent des points stratégiques à Alger, notamment le Gouvernement Général, l’Hôtel de Ville, Radio-Alger et l’aéroport de Maison Blanche et neutralisent les plus hauts responsables civils et militaires sans la moindre effusion de sang.
Le 21 avril à 19 h. le général Challe s’exprime sur Radio-Alger : « Je suis à Alger, avec les généraux Zeller et Jouhaux et en liaison avec le général Salan, pour tenir notre serment, le serment de l’armée française de garder l’Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Un gouvernement d’abandon s’apprête aujourd’hui à livrer définitivement l’Algérie à l’organisation extérieure de la rébellion. L’armée ne faillira pas à sa mission et les ordres que je donnerai n’auront jamais d’autres buts. »
18 régiments se mettent immédiatement aux ordres de ces quatre généraux : 1er REP – 1er REC – 5e REI – 2e REP – 14e et 18e RCP – 2e et 5e RCI – 13e DBLE – 1er Cuirassiers – 6e RCA – 9e RCP – 13e DBLE – 13e Dragons – 2e et 6e RPIMA – Groupement de commandos parachutistes – Commando de l’Air. 6 régiments rallieront le mouvement dès le lendemain : 27e Dragons – 7e RTA – 1er RIM – 8e RPIMA – 94e RI – 1er RCP.
Egalement la Harka du Commandant Guizien, composée de supplétifs musulmans et basée à Edgar-Quinet. (Dès le lendemain du cessez-le-feu, le 20 mars 1962, plus de 1000 supplétifs musulmans, ainsi que leurs femmes et enfants, seront massacrés dans des conditions effroyables par l’ALN, parce qu’ils avaient choisi de rester « avec la France ».)
Mais ce que les généraux et les officiers ignorent c’est qu’ils sont surveillés et mis sur écoute depuis plusieurs mois par les services du renseignement militaire, le SDECE de Constantin Melnik et la Préfecture de police de Maurice Papon.
Ce dont ils ne se sont pas méfiés, par manque d’expérience « putschiste », c’est que depuis plus d’un an des transistors sont fournis, pratiquement gratuitement, aux appelés du contingent afin qu’ils reçoivent en priorité RMC (Radio Monte-Carlo) aux ordres du gouvernement gaulliste.
Tenu donc informé par le premier ministre, Michel Debré, l’homme de tous les complots, De Gaulle sait qu’il se prépare un complot en Algérie et cela ne l’inquiète pas, bien au contraire. Il suit les évènements heure par heure et a déjà envisagé comment en tirer parti, afin de cimenter un pouvoir qu’il ne possède pas encore totalement, à cause de l’opposition systématique de toute la gauche.
En décembre 1960, il a réclamé les « pleins pouvoirs » qui lui ont été refusés par le Président du Conseil Constitutionnel, Léon Noël, puisque les institutions en France n’étaient pas menacées par les évènements d’Algérie.
Dans la semaine qui précède le 20 avril 1961, la veille du putsch, De Gaulle a en sa possession une liste presque complète des officiers engagés dans cette « mutinerie », aussi bien en Algérie qu’en métropole et nous en aurons très bientôt la preuve.
Quand il se « fait réveiller » au cours de la nuit, ce n’est pas une surprise, en ce qui le concerne. Dès 6 h. du matin, il fait appréhender en métropole, à Paris, le général Faure et 6 officiers.
Il a toutes les cartes en mains pour chasser de l’armée les officiers qui, dans leur grande majorité, sont hostiles à sa politique d’abandon de l’Algérie.
Dès lors, c’est à lui de jouer, de déployer sa stratégie, afin d’obtenir les «pleins pouvoirs» de l’article 16, qui lui permettront de réformer la Constitution, notamment sur l’élection du Président de la République au suffrage universel : le but qu’il veut atteindre.
Lorsqu’il prend la parole, le 23 avril, au journal télévisé de 20 h, revêtu de son uniforme de général, De Gaulle sait déjà que le « complot » a échoué, mais « il faut que la France métropolitaine ait peur ! »
De Gaulle défère à la justice militaire tous les chefs de cette mutinerie.
Il n’a jamais été question une seule seconde, à Alger, d’une action militaire des putschistes sur Paris, ou en un autre lieu de la métropole, mais il est indispensable de le faire croire aux Français. La leçon des « barricades » en 1960, a bien été retenue.
De Gaulle s’adresse aux Français avec son sens inné de la dramatisation et son talent de comédien. C’est un grand numéro d’acteur.
Maître dans l’art de la rhétorique, il affiche son mépris pour un : «Pronuncamiento militaire» organisé par un quarteron de généraux en retraite et un groupe d’officiers partisans, ambitieux et fanatiques. L’état est bafoué, la nation bravée, et par qui ? Par des hommes dont c’était le devoir, l’honneur, la raison d’être, de servir et d’obéir. Françaises, Français, aidez-moi ! Devant le malheur qui plane sur la patrie et devant la menace qui pèse sur la république, j’ai décidé de mettre en œuvre l’article 16 de notre constitution. »
Dès qu’il lâche le micro, à 0 h 45, c’est le premier ministre, Michel Debré qui s’en empare. Il complète le scénario catastrophe : « De nombreux renseignements, précis et concordants, nous informent d’une très prochaine action militaire en métropole ». Il dramatise la situation en faisant croire que l’on s’attend à des parachutages, ou des atterrissages, de troupes factieuses pour tenter de s’emparer du pouvoir “Il supplie tous les « patriotes » français, de quelque bord qu’ils soient, de se rendre « à pied ou en voiture » vers les aéroports, sur la place de la Concorde, dès que les sirènes retentiront, afin de s’opposer aux paras, aux «putchistes», qui menacent de sauter sur Paris ».
Les radios et la télévision émettent sans interruption durant 3 jours, diffusant alarmes et fausses nouvelles.
Les partis de gauche, les communistes, les socialistes, les syndicats, la Ligue des droits de l’homme, se mobilisent et appellent à descendre dans les rues. Des dizaines de milliers de personnes, environ un million en métropole, sont volontaires pour soutenir De Gaulle et sauver la Patrie en danger.
Une douzaine de vieux chars « Sherman » se positionnent autour de l’Assemblée Nationale, non armés, uniquement pour de la figuration.
La capitale est pratiquement en état de siège. C’est la guerre !
C’est surtout une « intox » distillée avec un machiavélisme hors du commun par un maître en la matière.
Ce que la France ignorait, ce que toute la gauche ignorait, c’est qu’ils avaient été magistralement manipulés dans l’unique objectif de faire obtenir à De Gaulle les pleins pouvoirs que lui accordait l’article 16, promulgué dans la foulée le 25 avril par l’Assemblée Nationale.
De Gaulle sait pourquoi le putsch a échoué. Le colonel de Boissieu l’a tenu informé directement que le général Challe, refusant d’armer les civils, a quitté « le quarteron de généraux factieux » et qu’à l’exception d’environ deux mille paras, l’armée, les « appelés » surtout, ne s’impliquait pas. (Dans un précédent article j’ai démontré que si les IUT (250.000 hommes armés) n’avaient pas été dissoutes, lors des « barricades », en 1960, ce « putsch » aurait très certainement imposé ses droits.)
De Gaulle purge aussitôt l’armée :
*220 officiers sont relevés de leur commandement.
*114 traduits en justice.
*3 régiments ayant pris part active au « putsch » sont dissous, (le 1er REP, les 14 et 18e RCP) ainsi que le groupement des commandos de l’air.
*Plus de 1000 officiers démissionnent par hostilité à la politique du chef de l’état.
Les généraux Challe et Zeller sont condamnés à 15 ans de réclusion (Ils seront amnistiés et réintégrés).
Les généraux Salan et Jouhaux disparaissent. Arrêtés plus tard ils seront condamnés : Salan à perpétuité et Jouhaux, sans doute parce qu’il était « Pieds Noirs », à la peine de mort (commuée par la suite).
Les généraux Salan, Jouhaux, Bigot, Faure, Gouraud, Mentré, Nicot et Petit, ainsi que les officiers, seront réintégrés dans l’armée par la loi d’amnistie de novembre 1982, sous la présidence de François Mitterrand.
Le commandant Hélie Denoix de Saint-Marc, dont une rue de Béziers porte dorénavant son nom, a écrit dans « L’Aventure et l’espérance » : « L’honneur est-il dans l’obéissance absolue au pouvoir légal, ou dans le refus d’abandonner des populations qui allaient être massacrées à cause de nous ? J’ai choisi selon ma conscience. J’ai accepté de tout perdre, et j’ai tout perdu. Je connais des réussites qui me font vomir. J’ai échoué, mais l’homme au fond de moi a été vivifié. »
En 1970, lorsque paraîtront ses « Mémoires d’espoir » De Gaulle ne dissimule pas qu’il était certain que les mobiles de ce « quarteron » n’étaient pas la prise du pouvoir en métropole. Mettant en parallèle son action en juin 1940 et celles du « quarteron » en 1962, il constatera : « La rébellion devient héroïque quand elle réussit et trahison quand elle échoue ! ».
Le général de Pouilly, un fidèle parmi les fidèles à De Gaulle, n’hésitera pas à écrire : « J’ai choisi la discipline mais choisissant la discipline, j’ai également choisi avec mes concitoyens et la Nation Française la honte d’un abandon et, pour ceux qui n’ayant pas supporté cette honte et se sont révoltés contre elle, l’Histoire dira peut-être que leur crime est moins grand que le nôtre. »
|
|
PHOTOS d'ALGER Sacré-Coeur
ACEP-ENSEMBLE 289
|
|
Beignets de semoule
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°205 - mai 2012
|
Préparation : 10 minutes Cuisson : 10 minutes

Ingrédients : 4 oeufs,
1 paquet de levure,
25 g d'amandes en poudre,
de la grosse semoule,
de l'huile pour friture,
1 bol de miel,
2 cl d'eau de fleur d'oranger ou une goutte d'essence de rose.
Préparation :
Commencer par battre de façon énergique les oeufs et la levure pendant au moins 5 minutes.
Ajouter la poudre d'amandes ainsi que la semoule pour avoir une belle pâte à crêpe épaisse.
Ensuite prendre à l'aide d'une cuillère en bois des petits paquets de pâte et les verser dans l'huile bien chaude.
Égoutter, puis tremper les beignets dans le miel fondu et parfumé selon le goût avec de l'eau de fleur d'oranger ou de l'essence de rose.
|
|
Le Mari du Médecin
Tirailleur Algérien, N°510, octobre 1900
Source Gallica
|
|
Je me mariai en 1880. Je ne pourrai plus vous dire exactement le mois ni le jour. Ma femme venait de passer avec la plus grande distinction son premier examen.
A dix-sept ans elle passait toutes ses journées à l’amphithéâtre au lieu de se promener, de danser, de jouer du piano ou de faire de la broderie.
Je l'avais connue dans des circonstances très singulières. Un jour je glissai de façon bien maladroite. Je m'étais écorché à vif.
On alla la chercher pour me donner les premiers soins. Elle s'y prit avec tant de délicatesse que je ne cru pas pouvoir faire autrement, des que je fus guéri, de lui offrir ma main.
Elle accepta avec empressement, à la condition pourtant que le mariage n'aurait lieu qu'après son dernier examen. C'était une fille et étudieuse, elle ne voulait pas être distraite de ses chères études.
Pendant les premiers mois de mon mariage, je fus très amoureux ; je crois que ma femme éprouvait pour moi une certaine affection. Mais, comme elle avait beaucoup étudié, elle savait mieux que moi les dangers de la passion,
— Mon ami, me disait-elle continuellement, je ne veux pas que vous soyez amoureux... cela donne des maux d'estomac.
Je persistai. Elle me dit alors que si je ne devenais pas plus raisonnable, j'aurais certainement avant peu une maladie de la moelle épinière ou un ramollissement de cerveau.
On a beau être amoureux de sa femme, on est effrayé quand on entend son médecin tenir de tels discours. Je me calmai beaucoup.
Nous n'étions pas maries depuis trois mois qu’éclata une épidémie.
Je voyais très peu ma femme dans la journée, Elle passait toutes ses matinées à l’hôpital, l'après-midi et le soir, elle faisait ses visites. Elle avait fort affaire. Les médecins des deux sexes étaient sur les dents.
Elle rentrait, vers neuf ou dix heures habituellement. Je dois déclarer que n'étant pas tout il fait calmer à cette époque, j'attendais ce moment avec impatience. Nous soupions, et nous montions tranquillement à notre chambre... Mais nous n'étions pas plutôt au lit qu'on venait sonner à notre porte.
— Vite, madame le médecin, il faut venir pour sauver un voisin qui vient d'être, atteint de l'épidémie...
Les premières fois, je me mis à la fenêtre, et je déclarai aux importunes qui venaient me troubler, que ma femme avait autre chose à faire que d'aller, la nuit soigner des malades.
Mais le lendemain, les malades firent insérer dans les journaux des lettres où ils accusaient ma femme d’avoir manque à ses devoirs professionnels.
Il fallut bien se résigner ; et dorénavant quand on vint encore sonner la nuit, elle se leva et je restai seul.
Je ne vous ai pas dit encore, je crois, que ma femme était excessivement jolie. De grands yeux bruns, bien ouverts, bien éveillés. Des cheveux noirs légèrement ondulés. Un teint de lys et de rose. La bouche petite et vermeille. Une taille de guêpe. Une main et un pied d'enfant. Et avec cela, dans la tournure, je ne sais quoi de provocant.. Les dames ne l’aimaient pas ; mais tous les messieurs voulaient être soignés par elle.
Je ne m'inquiétai pas d'abord. Mais pourtant un jour, je fis la remarque qu'elle ne soignait que des hommes.
Je la connaissais ; je savais que pour un médecin, les malades ne sont ni hommes ni femmes, qu'ils sont uniquement malades. Mais je n'étais pas tout à fait content. Je suis certain que vous comprenez : car enfin, on a beau être sur de sa femme, on craint toujours quelques surprises...
Certes, je ne la croyais pas capable de commencer. Mais il y a des malades si indélicats ! Etais-je bien certain qu'un jour ou l'autre, elle ne se laisserait pas entraîner par l'amour de la science ?
Je crus devoir lui faire quelques remontrances ; elle me répondit que ces idées chagrines et inquiètes dénotaient chez moi un état maladif et exigeaient des soins. J'insistai. Elle insista, de son côté, me fit montrer la langue me tâta le pouls, et déclara que j'avais la jaunisse.
La jaunisse ! Etait-ce une insultante plaisanterie ?
J'eus beau m'insurger, je dus subir un traitement. Ma femme me soignait très attentivement, mais elle n'était jamais à la maison ; sa clientèle l’occupait au dehors du matin au soir, et, seul dans mon fauteuil, je faisais de bien tristes réflexions.
Cela dura ainsi plusieurs années. Je souffrais beaucoup.
Un jour j'appris que ma femme venait d'être nommée médecin de Carrues. Je me fâchai. Elle se fâcha. Elle me fit soigner pour la fièvre.
Au sortir de mon lit, je recommençai ma scène. Elle me regarda fixement dans le blanc des yeux, écrivit quelques mots sur une feuille de papier, et le soir j'étais enfermé comme atteint de monomanie jalouse dans une maison de santé où l'on me donna des douches pendant six mois...
Dieu bénisse ceux qui ont voulu que les femmes fussent médecins !
X.
| |
| OUBLIANCES
De Jacques Grieu
|
|
À nonante quatre ans (si ma mémoire est bonne)
Je m’agite et m’inquiète en cherchant mes neurones.
J’en avais cent milliards, me dit mon médecin :
Je sens bien qu’il m’en reste, au moins pour quelques-uns uns !
Ah ! La mémoire ! Il en faut ! Il faut se rappeler !
Et pour rentrer chez soi, savoir où sont ses clefs.
Mais trop plein de mémoire peut parfois vous freiner ;
S’il est bon d’en avoir, il faut la modérer.
La mémoire, c’est passé, mais redevient présent.
C’est une sorte de brume qui s’épure dans le temps.
La meilleure des mémoires est bien souvent la pire ;
Elle empêche d’oublier et des fautes se blanchir.
Car l’oubli de nos fautes est sûre absolution ;
C’est parfois une grâce qui est une solution.
La route du bonheur serait celle de l’oubli ?
La mémoire est pourtant sentinelle de l’esprit !
Ce qu’on nomme « expérience » n’est que vaste mémoire.
Pour combattre la mort, la vie est sans victoire,
Mais contre le néant, c’est la mémoire qui gagne,
Qui puise dans son stock et sa petite épargne.
La meilleure des mémoires serait celle d’éléphant.
Serait-ce la raison pour laquelle, il boit tant ?
S’il boit pour oublier, on comprend maintenant
Pourquoi dame souris ne peut en faire autant !
L’optimiste est quelqu’un qui rit pour oublier
Son frère, pessimiste, oublie l’hilarité.
A trop bas se pencher pour revoir son passé,
On « tombe » dans l’oubli comme en un défilé.
Quand on veut oublier quelque chose ou quelqu’un
C’est encore y penser qu’effacer son dessein.
Et donc, pour oublier, interdit d’y penser !
Voilà qui n’est pas simple à bien sélectionner...
Que faut-il préférer : le chagrin ou l’oubli ?
L’oubli est une éponge qui absorbe et ternit.
On cherche à oublier où le chemin nous mène…
Oublier d’oublier n’est pas issue certaine.
A trop délibérer, on oublie de vouloir.
Alors, mémoire, oubli ? On reste dans le noir ;.
La réponse, je l’avais, comme un souffle d’espoir,
Mais suis soudain victime d’un grand trou de mémoire.
Jacques Grieu
|
| |
LES CHEVAUX DU SAHARA
Par M. le général DAUMAS
Gallica : Revue orient 1853-1 pages 257-264
|
Ce livre est écrit à bonne intention. L'auteur, pénétré de cette parole de Fontenelle : Toute erreur qui a vécu cent ans passe pour vérité acquise, a compris que dans la question de l'élève du cheval, le moyen le plus efficace pour combattre les fausses doctrines était de laisser parler les fils d'Ismaël.
En exposant fidèlement les méthodes de ces maîtres fameux dans l'art d'élever et de conserver, pure de tout mélange, cette race, source et principe de toute amélioration, M. le général Daumas s'est proposé de nous ramener aux saines traditions.
Il y a tout à l'heure quarante ans que l'anglomanie, devenue à la mode, pousse les éleveurs français dans une voie diamétralement opposée à celle suivie par les éleveurs anglais.
Emerveillés à la vue du cheval de pur-sang dont ils avaient été privés sous l'empire, les éleveurs et cultivateurs se sont persuadé qu'ils allaient, de prime-saut, créer le cheval de race.
Cette prétention, non moins exagérée que celle de la grenouille voulant imiter le bœuf, et les nombreuses déceptions n'ont pas encore, à cette heure, dessillé les yeux d'amateurs très-influents, et fait rechercher comment avaient procédé nos voisins.
Maures passés dans l'art de transformer les races, de les approprier suivant leurs besoins et d'en faire un commerce lucratif, ils n'ont pas eux bâti sur le sable, ils ont assuré les fondements de l'édifice en observant une sage progression.
En effet, Fitz-Stephen nous apprend qu'un demi-siècle après la bataille de Lincoln, en 1141, la race chevaline était sensiblement améliorée, et le marché de SmithField devenu célèbre.
Sous Henri VII et Henri VIII, eut lieu l'importation de chevaux orientaux destinés à la race légère.
Élisabeth introduisit des étalons persans.
Jacques 1er fit venir de Barbarie un certain nombre de juments de race pure que l'on nomma juments royales (royal-mares).
Enfin, les pères de cette race tant vantée, de ces chevaux dits de pur-sang (torang-bred), Godolfin-Arabian et Darley-Arabian, ne furent amenés en Angleterre que sous le règne de la reine Anne.
C'est donc, ce fait mérite d'être étudié, seulement après quatre siècles employés à relever, à l'aide d'espèces particulières, la race de leurs chevaux, qu'ils recoururent au sang le plus riche au type améliorateur de toute l'espèce, au sang arabe.
La modestie dont l'honorable général avait fait preuve en s'effaçant, le conduisit naturellement, avant de publier son livre, à le soumettre au jugement d'hommes dont les noms font autorité.
M. le général Oudinot lui répond :
Les hommes qui se consacrent à la science hippique reconnaissent aujourd'hui que la propagation du sang oriental est le véritable principe régénérateur auquel il est urgent de recourir.
M. le général de Lamoricière écrit :
II serait à désirer que le gouvernement fit imprimer cet ouvrage, où nos éleveurs trouveraient tant d'utiles enseignements.
M. le général Descarrières, chef de service de la cavalerie au ministère de la guerre, à son tour s'exprime ainsi :
C'est d'après nature qu'ils (les Arabes) dépeignent le cheval de race, le buveur d'air, et le portrait qu'ils en font est bien celui d'un cheval essentiellement propre aux combats et susceptible de fournir des courses longues et rapides.
Puisque ces chevaux existent dans l'étendue de nos possessions d'Afrique, il faut les trouver, dût-on les aller chercher jusqu'aux dernières limites du désert ; ce sera un service de plus que nous aura rendu l'armée d'Afrique ; transportés sur notre sol, ces chevaux précieux deviendront le type d'une race pure indigène.
Ces témoignages en faveur de l'œuvre que je me propose d'examiner rendent ma tâche facile, me dispensent de recourir à de nombreuses autorités et me confirment dans la pensée que les principes rappelés au monde hippique par M. le général Daumas, toutes conditions de climat et de culture réservées, sont les seuls qui doivent guider les éleveurs.
Quoi qu'il en soit, je crois utile, indispensable même, tant il a été écrit et professé de doctrines erronées et désastreuses au point de vue de l'élève du cheval, de rappeler l'opinion d'un homme qui, lui aussi, s'était inspiré à la source même des bonnes traditions ; on ne contestera ni son expérience, ni la sûreté de son jugement :
J'ai nommé Napoléon 1er.
C'était en 1813, l'empereur visitant le haras de Pau, dit à M. de Lastic, directeur de cet établissement :
Vous avez soixante étalons et vingt juments arabes, sachez en faire un bon emploi. Les Anglais ont commencé avec moins. Un bon étalon arabe, s'il est judicieusement employé, peut à lui seul améliorer toute une contrée. L'Arabe est le meilleur cheval du monde, les Anglais se vantent de l'avoir surpassé ; mais (en montrant son mameluk) feraiton du meilleur cheval d'Angleterre ce que cet homme peut faire du sien ? Nos, limousins et nos navarrins sont mille fois préférables pour la guerre à l'anglais de pur-sang. Ce n'est point l'extrême vitesse qui fait le bon cheval de guerre, s'est la souplesse, l'adresse, l'intelligence, la docilité ; voilà les qualités éminentes de l'arabe, comme la vitesse est celle du cheval anglais. Ainsi, vous pouvez, l'aide d'un cheval arabe, obtenir une prompte amélioration, surtout avec notre race navarrine, qui en trouve le principe dans le sol même qui l'a créé.
Le livre de M. le général Daumas aussitôt ouvert, laisse échapper un parfum de poésie. Ce cachet qui distingue les Orientaux nous apparaît comme une empreinte de seconde vue.
A chaque page, on se sent inspiré par ce feu sacré pour ainsi dire oublié en France ; il n'est plus, comme autrefois, un des apanages des éleveurs. On en chercherait vainement la trace dans les livres nombreux et la multitude de brochures écrits sur cette question, le plus souvent dans une pensée d'amour-propre ou d'intérêt particulier.
L'oubli de ce sentiment accuse suffisamment pourquoi nous sommes déchus de notre ancienne supériorité ; pourquoi nous sommes inhabiles à nous relever.
A leur retour des croisades, les seigneurs ayant ramené nombre d'étalons précieux et s'étant occupés avec ardeur de l'élève du cheval, nos races acquirent de la distinction, et la production supérieure à la consommation permit une exportation considérable qui se continua jusqu'au règne de Louis XIII.
Le cheval français était encore, à cette époque, renommé par son élégance, sa durée, et recherché par nos voisins d'outre-mer et du continent.
Henri IV envoya à Élisabeth, comme un présent digne de cette souveraine, quarante étalons et un nombre assez considérable de juments pris dans les haras du Berry.
Que sont devenus ces haras du Berry, et d'autres encore?
Sans amour, sans passion, on ne saurait avec art, manier, diriger, transformer les races comme les plantes, retourner le sillon et s'imprégner des beautés de la nature qui, se revêtissant tour à tour des formes les plus gracieuses, ramène l'homme à Dieu et verse souvent plus de poésie et même de philosophie dans l'âme d'un vulgaire paysan que l'on ne saurait en rencontrer chez certains types émérites des grands centres de population.
M. le général Daumas, loin de faire un abus de la poésie des Arabes, a été très-sobre à cet endroit. Il pouvait, à son gré, ornementer son oeuvre, y ajouter de nombreuses légendes, retracer l'hymne de l'Arabe Omaja à son cheval, ce chant qui rappelle le Cantique des Cantiques.
Les lecteurs de la Revue de l'Orient me sauront gré de le mettre sous leurs yeux.
« Te voilà, noble coursier, préparé pour la course, éclatant de blancheur comme un rayon du soleil.
« Les mèches qui flottent sur ton front ressemblent à la chevelure soyeuse de la jeune fille agitée par le vent d'ouest.
« Ta crinière est le nuage ondulé du midi qui vole dans les airs.
« Ton dos est un rocher que polit un ruisseau qui coule doucement.
« Ta queue est belle comme la robe flottante de la fiancée du prince.
« Tes flancs brillent comme les flancs du léopard qui se glisse pour saisir sa proie.
« Ton cou est un palmier élevé sur lequel se repose le voyageur fatigué.
« Ton front est un bouclier qu'un habile artiste a poli et arrondi.
« Tes naseaux ressemblent aux antres des hyènes.
« Tes yeux, aux astres des deux jumeaux.
« Ton pas est rapide comme celui du chevreuil qui se rit des ruses du chasseur.
« Ton galop est un nuage qui porte la tempête et qui passe sur les vallées avec un roulement prolongé de tonnerres.
« Ton port ressemble à la verte sauterelle qui s'élève du marécage.
« Viens, cher coursier, les délices d'Omaja ! bois le lait du chameau.
« Pais les herbes odoriférantes.
« Et si je meurs, meurs avec moi.
« Ton âme ne descendra pas dans la terre, elle s'élèvera aussi en haut, et alors je parcourrai avec toi les espaces du ciel »
Évitant le merveilleux, l'auteur des Chevaux du Sahara s'est abstenu de rappeler les splendeurs passées des disciples de Mahomet.
Si, en plus d'une circonstance, l'histoire ne les mentionnait, nous révoquerions en doute assurément :
Que Hescham l'Ommiade nourrissait 4000 chevaux dans ses écuries ;
Que Maleckschah le Seljieucide en entretenait 4000 pour sa garde et sa vénerie ;
Que le calife Motassem l'Abasside, qui ne se servait que de chevaux pies, tigrés ou truités, en entretenait 130,000.
Il est à croire que le Sahara n'a jamais été illustré par de semblables possessions ; la vie nomade des tribus ne l'a pas permis. La tradition leur a conservé le souvenir de ces fabuleuses richesses, nous n'en pouvons douter ; il eût été deux fois intéressant de recueillir de la bouche de ces farouches sectateurs du Koran des détails précis, circonstanciés sur cette phase brillante de l'élève de ce cheval fameux entre tous.
Nous nous prenons également à regretter que l'honorable général n'ait pas été assez heureux pour obtenir des détails sur l'origine de la race arabe, et en particulier sur le point de départ de l'espèce barbe.
A cette question, nous dit-il, ils désignaient l'Orient et répondaient : « Ils viennent de la patrie du premier homme, où ils ont été créés un jour ou deux avant lui. »
Suivant la version la plus accréditée, le cheval aurait eu son berceau dans la haute Tartane, et de là se serait répandu jusqu'aux bords du Nil et dans les déserts de l'Arabie.
La Perse, l’Inde, l’Egypte et l'Arabie paraissent avoir possédé la même espèce de chevaux.
L'Écriture-Sainte nous montre, 1650 ans avant Jésus-Christ, que le cheval était, chez les Égyptiens, un animal domestique.
Lorsque Joseph transporta les restes de son père à Chanaan, il se fit accompagner de chariots et de cavaliers.
La Bible nous apprend, en outre, que l'Arabie n'a pas été le berceau de l'espèce ; 600 ans après l'époque dont nous venons de parler, elle ne possédait pas encore de chevaux.
Quand Mahomet, dans le septième siècle de notre ère, attaqua les Koreish, près de la Mecque, il ne possédait que deux chevaux dans toute son armée.
Burckhardt, qui a fait un voyage de trois ans en Arabie, nous dit dans sa relation traduite par Eyriès
« Que les Arabes comptent cinq races de chevaux nobles descendant, suivant eux, de juments du prophète ; c'étaient Tanaiffé, Ma'nekeié, Koheil, Saklouié et Djulfé. »
La bibliothèque orientale rapporte que le maître d'écurie et médecin du sultan Kelaoun, roi d'Égypte, nous a laissé un ouvrage curieux intitulé Kamel-al-Sanatein, dans lequel il enseigne les deux arts de dresser et de guérir les chevaux.
Il parle de dix races de chevaux à chacune desquelles il donne l'épithète qui lui convient. Il dit que des trois races qui se trouvent en Arabie, ceux de la province de Hegiaz sont les plus nobles ; ceux de Negid les plus sûrs ; et ceux de l'Yemen les plus durs au travail et les plus patients.
Il passe ensuite dans la Syrie et prétend que ceux de Damas ont le plus beau poil, et ceux de Mésopotamie la plus belle taille et sont les mieux tournés.
En Afrique, les chevaux d'Égypte sont les plus légers ; ceux de Barcah les plus rudes et les plus difficiles à dompter ; ceux de Barbarie les plus propres à faire race.
Cette assertion, comprenant le cheval barbe dans cette grande famille répandue sur deux continents , suffirait pour réfuter une erreur que M. le général Daumas a pu partager en écrivant son livre, à savoir :
Que la race barbe n'était pas d'origine arabe.
Cette croyance, qui a longtemps retardé en France et même en Algérie l'emploi des étalons barbes, l'a conduit à consulter l'émir Abd-el-Kader : il avait été à même d'apprécier ses connaissances profondes sur tout ce qui touche à l'histoire aussi bien qu'aux questions chevalines de son pays.
Il reçut cette réponse :
Vous me dites que l'on soutient que les chevaux de l'Algérie ne sont poins des chevaux arabes, mais des chevaux berbères (barbes).
C'est une opinion qui retourne contre ses auteurs. Les Berbères sont Arabes d'origine.
Un auteur célèbre a dis : « Les Berbères habitent le Moghreb, ils sont tous fils de Kais-benGhilan. On assure qu'ils sortent des deux grandes tribus hémiarites, les Sanhadja et les Kettama, venus dans le pays lors de l'invasion de Ifrikech-el-Malik. D'après ces deux opinions, les Berbères sont bien des Arabes.
La race barbe victorieusement réhabilitée, empressons-nous de méditer la pratique des Arabes.
Où trouverions-nous de meilleurs types que là où tout a été fait pour les améliorer, non au seul point de vue des besoins matériels de l'homme, mais au point de vue de sa gloire.
Fd. DE CHALLEMAISON.
(La suite au prochain numéro.)
| |
LES NAUFRAGÉS
SINTES Isabelle née BERTIN
PNHA N° 208, novembre 2012
|
Quartier d'Alger, Saint-Eugène, tu étais si gai.
Tous ceux de Bab-El-Oued aimaient s'y promener.
Du haut de ton boulevard Pitolet, tes plages ils admiraient.
L'air de la mer leur parvenait sous ton ciel ensoleillé.
Dans ton stade, nous allions encourager
Les sportifs qui à fond se donnaient
Dans toutes les disciplines n’ont jamais démérité.
Près de ton stade, les cirques s'installaient
A chaque représentation Bab-El-Oued accourait
Petits et grands, tous savaient que sur la piste,
Ils verraient le spectacle qui les enchantait,
Hélas près de ton stade durant la guerre, que d'hélicoptères
Sont venus déposer civils et militaires morts ou blessés.
Fini ta gaieté Saint-Eugène, car nous vivions la guerre...
Cette atrocité dont nous sommes tous imprégnés.
Enfin, Saint-Eugène, tu étais le dernier voyage.....
Où ceux de Bab-El-Oued accompagnaient leurs morts.
C'était à Saint-Eugène notre grand cimetière
C'était à Saint-Eugène nos tombes ancestrales.
C'était à Saint-Eugène le carré militaire.
C'était à Saint-Eugène le carré des enfants
Où dort mon petit frère.
Sa tombe était petite, il n'avait que six mois.
Nous ne manquions jamais pour toi mon petit frère
De venir sur ta tombe poser fleurs et baisers.
Maintenant sur ta couche plus rien de déposé
Car la guerre et I'exode nous ont fait te laisser
Tu dors à Saint-Eugène, mon mignon petit frère
Dans ce beau cimetière, reposes à jamais !
Seule Notre Dame d'Afrique veille encore sur toi
De sa basilique surplombant Saint-Eugène
Et le cimetière où tu dors petit frère.
Dors mon petit frère. Dors petit René
Car Notre Dame d'Afrique les mains tendues vers toi
Doit te prendre toujours dans ses bras.
SINTES Isabelle née BERTIN (I.B.S.) de B E O
|
|
C’était en mars
par M. Robert Charles PUIG.
|
M… comme mars 1962
M… comme Macron 2024
C’est évident. Au fil des événements que nous vivons, de cette inquiétude des français entre la guerre Russo-Ukrainienne, la rage des combats entre Israël et le Hamas palestinien dont les soubresauts se répercutent sur notre territoire sous forme de menaces islamistes, il me semble nécessaire de revoir mon projet initial d’un livre, de lui donner une forme plus conforme aux événements vécus. Les idées finalement peuvent varier, se modifier, se transformer. C’est ce qui m’arrive après le commencement de mon récit où je comptais m’attacher à ce deuxième mandat d’Emmanuel Macron.
En vérité, je l’affirme, je n’étais pas prêt à envisager une suite à mon essai sur le précèdent rôle de chef de l’État de 2017 à 2022 : « Un président… en Marche » c/o Les « Impliqués », une filiale d’Harmattan. Non ! Je croyais avoir clôturé un chapitre peu enrichissant et politiquement nul pour le pays. Je me suis trompé. La guerre entre la Russie et l’Ukraine donna une nouvelle chance à Macron.
J’allais donc m’atteler à un deuxième tome des élucubrations du président et mes premiers écrits sur son nouveau règne s’engageaient dans ce sens. Observer, écouter, noter ce que cette nouvelle présidence qui débutait en 2022 apportait d’enrichissement, de nouveautés et de gloire à notre pays. Hélas, trois fois hélas ! – comme le dirent Coteau ou le général, dans d’autres circonstances – Au fil des jours, des premiers mois de ce nouveau mandat marqué par les législatives, « Renaissance », le nouveau nom « d’En Marche », le parti de Macron n’avait plus la majorité. Un dur combat s’annonçait pour régler le sort des français au parlement. L’insécurité, le pouvoir d’achat, les manifestations des agriculteurs et les grèves… Que des dossiers brûlants traités à coup de 49.3, entre la contestation dangereuse des banlieues et les universités prises dans l’engrenage du salafisme ou celui des frères musulmans se greffait un surendettement faramineux pour un pays qui avait été en équilibre bien des années passées vers 1970 par exemple.
Aujourd’hui, sans être devin il est facile de deviner que la Nation vacille entre les guerres, une Europe progressiste et une politique gouvernementale plus à la hauteur, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur. Chez nous, ça chauffe, ça conteste et nous avons les faux pas de Macron au Liban où ses propositions d’aides seront contestées, nos échecs en Afrique, des affronts face à Vladimir Poutine qui le reçoit sur le bout d’une longue table comme un personnage sans intérêt et enfin Israël ! Notre président de la république, les fesses entre deux chaises ne sait plus s’il doit prendre la défense d’un pays sauvagement agressé par une bande de tueurs assoiffés de sang, de viols et de meurtres ou soutenir le Hamas et Gaza pour couvrir ses forfaits et le kidnapping de civils israéliens en sus des 1300 victimes de leur razzia. Restons français !
Ce qui me trouble, m’agace – je ne suis pas le seul – c’est le rôle que joue Macron accompagné de son parti « Renaissance » vis-à-vis de l’Algérie contre la France depuis 2017. Ce que j’écris, ce que je pense, chacun a pu peut-être le remarquer, en être étonné, c’est la sollicitude, l’empressement d’une partie de nos gouvernants, de Macron même à s’incliner devant les exigences algériennes. Un sentiment de soumission, d’amour » a osé dire le président français avec mille façons de satisfaire l’appétit grandissent de Bouteflika puis de Tebboune nous prenant pour des vaches à lait à défaut de cochons payeurs. C’est le rôle favori des algériens. Toujours réclamer, exiger de nos instances politiques en nous faisant ressentir que nous sommes redevables des événements passés. En vérité, ils sont vexés que nous ayons été les constructeurs de cette partie du Maghreb, d’avoir laissé mille constructions, des villes, des ports, des infrastructures, une histoire. Ils se vengent et veulent l’ours et la peau de l’ours, la viande et la peau du mouton, si je peux m’exprimer par une image plus traditionnelle, pour définir la position d’un pays quémandeur, outrageusement mendiant.
Cela dure depuis plus de soixante an, depuis ce temps où la gauche et De Gaulle, acceptèrent de faire croire aux algériens qu’ils avaient gagné la guerre en 1962, alors que la rébellion était quasiment pacifiée et les willayas prêtes à se rendre. A partir de là, la roue a tourné dans un mauvais sens et il faut croire que le général avait d’autres priorités, d’autres envies de grandeur et que l’Algérie française qu’il brada, était comme une pierre dans sa botte d’ex-militaire qu’il fallait éliminer. Cependant, il avait sa petite idée en un sens bien française et croyait qu’en abandonnant l’Algérie à une autre destinée, la France resterait la France et que l’église de son village ne deviendrait pas une mosquée. Il se trompait. C’était sans compter avec ses suivants. Des présidents qui en ce qui concernait l’Algérie oubliaient les massacres du FLN sur les civils européens et musulmans. Ils avaient les yeux de Chimène pour l’Algérie et Rodrigue ne combattait pas le barbare. Pas un ne mit des frontières aux arrivées massives d’algériens. Pas un ne décida qu’il fallait réviser ces fameux accords d’Évian et nuancer une trop large possibilité aux algériens de venir sur notre territoire. Souvenons-nous des tragédies grecques et de l’épopée d’Ulysse pour retrouver son village. Dans son périple, le chant des sirènes l’attirait avec ses hommes sur un île enchantée.
C’est bien ce que subissent nos élus depuis 1962, aveuglés par le désir de plaire à l’Algérie FLN ou subjugués par l’odeur du couscous au mouton ou la dance aux seins nus des femmes des monts de l’Ouled-Naïl, sans jamais l’accuser de tous ces assassinats perpétrés à partir de 1954 et surtout ce lynchage abject de victimes innocentes à partir des trop désespérants accords de 1962, avec le massacre d’Oran et les tueries qui suivirent le renvoi en Algérie des Harkis qui croyaient trouver refuge en France. Non ! Non ! Nos élus oublièrent cette Saint Barthélémy terroriste en acceptant de serrer une main FLN imprégnée du sang de milliers de victimes, tout en accusant une résistance patriotique – celle de l’O.A.S. – qui ne dura qu’une petite année et qui continue à être montrée d’un doigt comme la prolongation d’une extrême droite qui n’était pas dans le cœur de ces résistants. Ils souhaitaient juste garder au pays une province algérienne depuis 1830.
Ainsi, nous pouvons affirmer que nos dirigeants sont toujours sous le charme, la domination des sirènes du Maghreb algérien. Est-ce le couscous au mouton ou les zalabias au miel de Tizi-Ouzou qui les rendent « accro » de ce pays ? Toutes les mesures prises sont pour multiplier les liens avec cette terre, ouvrir nos frontières à l’envahissement algérien et à chaque fois qu’un coup de semonce est tiré d’Alger, bien qu’il n’y a plus dominant le port, ce fameux « Baba Merzouk » devenu la « Consulaire », nous nous plions, nous nous soumettons et acceptons les ordres, les règles des dictateurs algériens en les aidant à conserver un pouvoir qu’ils ne possèdent que par les armes. Chaque fois, le nombre de visas et des accords permettent la libre circulation sur notre sol des algériens comme les nouvelles directives de 1968, justifiant l’ascendance d’Alger sur notre sol et nos lois. Ne l’oublions pas. Ils sont plus gourmands que le péché du même nom de nos offrandes, de nos directives qui les avantagent. Ils sont insatiables de nos bons soins sans jamais en contrepartie nous tendre une main amicale.
Les exemples sont nombreux de leur mauvaise foi. Ils refusent de recevoir notre premier ministre Castex… Ils interdisent à notre aviation de survoler leur territoire et cerise sur les loukoums, leur « dernière volonté » – tenons-nous à notre vieille branche occidentale – ils décident de remplacer en deuxième langue le français par l’anglais en arguant que notre langue est celle des perdants. Voilà le dernier camouflet qui est du même type que le coup de l’éventail à notre représentant au temps de Barberousse ! En vérité, devons-nous « rigoler », comme le chantait Henri Salvador de cette épisode lamentable ? C’est plutôt triste cette soumission de nos dirigeants à cette censure algérienne et ce qui est inquiétant en ce mois de mars, c’est cette espèce de peur de nos députés, cette terreur anormale et maladive de croire à la révolution de nos banlieues abandonnées depuis longtemps dans les griffes du salafisme, de l’islamiste. Ils se vendent à l’Orient mais continuent de craindre que nos villes soient prises d’assaut par les rebelles des banlieues, comme le Hamas a réussi à le faire en Israël.
Cela fait plus de soixante ans que des patriotes, ceux qui connaissent la mentalité arabe comme les Pieds-noirs souvent insultés, rejetés et bannis par les instances socialo-progressistes et le macronisme maintenant, donnent l’alerte et demandent de prendre des mesures pour juguler une immigration qui amène avec elle la propagande des frères musulmans et du salafisme en tentant de faire de notre pays une terre du Coran. Que se passe-t-il sur notre territoire pour accepter de se déculotter à ce point ? Est-ce véritablement un esprit de gauche qui anime nos représentants et les incite à être aussi serviles avec l’étranger et à accepter des normes si différentes de nos lois occidentales ou nationales ? Est-ce une forme de repenti ? Ce que l’on nomme le « complexe des colonies »
Est-ce parce que le pays a trop attendu de ses valeurs humanistes : « Liberté, égalité, fraternité » et se rend compte trop tard que des limites sont dépassées et qu’il ne faut plus jouer le rôle des « Bourgeois de Calais » mais réagir, être à la hauteur de ce que demande le peuple : « ordre et sécurité ! » Ces phrases sont mes mots, mes illusions car nos élus ont peur. Ils craignent le futur et pour se protéger ils se vendent à l’Orient pour pas cher !
L’Occident a déjà connu cela au XVIII au temps où le Maghreb et Alger détenaient le triste monopole de l’esclavage avec les frères Barberousse. Des êtres humains considérés comme un bétail que l’on trainait aux marchés d’Orient les fers aux pieds en les privant de liberté. Doit-on subir le même affront ? Pourquoi remuer ce temps passé, cette période de terreur où la Méditerranée était sous la domination des corsaires d’Alger et faire de même avec les événements de 1954 / 1962 ? Pourquoi cette soumission, cette angoisse, cette peur qui fait que le 28 mars 2024 – juste deux jours après que des patriotes, des Pieds-noirs se soient réunis pour commémorer le massacre des algérois ce 26 mars 1962 par l’armée française – massacre qui précéda celui d’Oran le 5 juillet – l’assemblée nationale vote une proposition de loi indiquant qu’il fallait reconnaître et condamner le « massacre » – c’est le mot employé – des algériens le 17 octobre 1961, sous l’autorité du préfet de police, Maurice Papon durant cette période où l’Algérie était encore française et où la guerre sévissait contre le terrorisme FLN.
Un texte, une proposition de Mmes Sabrina Sebaihi, députée écologiste et Julie Delpech de Renaissance, avec l’accord de l’ Élysée. Une résolution qui met à mal le rôle de la France gaulliste en 1961, comme s’il fallait, une fois de plus transformer en flammes une histoire jamais apaisée et redonner à l’Algérie de nouvelles cartes pour nous contraindre et nous soumettre. Un jeu du « Ni-ni » et du « En même temps » où Macron montre que son idéologie anti-pied-noire ne faiblit pas. Elle se complait dans ce besoin d’effacer la trace de 132 ans de présence française au Maghreb. En vérité, rappelons le conteste, à cette date de 1961, c’est le mouvement terroriste FLN qui avait décidé contre l’interdiction gouvernementale de défiler à Paris dans un esprit de tension et d’échauffourées où on attribua à la seule police parisienne un certain nombre de blessés et de morts. La réalité de cette journée de manifestation, c’est qu’il y avait face au FLN, le parti MNA de Messali Hadj – cet opposant à la France dans un contexte plus réaliste et qui avec son épouse française dessina le drapeau algérien avant l’heure. Un drapeau aux trois couleurs que l’on retrouve souvent dans nos manifestations comme pour narguer encore la France – stades ou tour de France – le vert, couleur de l’Islam et du Paradis ; le blanc symbole de la paix et de l’espoir ; le croissant rouge héritage ottoman et l’étoile symbole du sang des martyrs.
Il est évident que les partisans de Messali Hadj étaient là pour jouer leur rôle face au FLN, d’où des affrontements et des morts. Une certaine vengeance de leur part, parce qu’ils n’oubliaient pas qu’au début de la révolte en 1957 un village entier partisan du MNA subit l’agression des terroristes FLN et que 300 hommes furent massacrés à Melouza, un village du bled algérien. Voilà la réalité de la situation ce jour-là et il est anormal d’accuser seulement la police qui par ailleurs subissait des attentats dans les commissariats obligés de se protéger derrières des sacs de sable. Les drames de cette journée avec la propagande socialo-communiste furent « gonflés » d’un nombre de disparus hors le contexte de la manifestation. François Hollande s’empressa de prendre ces chiffres pour valoriser ses rapports pro-arabe et pro-algériens. En fait, il y eut au pire 200 morts affirmèrent certains journalistes. Morts de quelle main ? FLN, MNA, police ? Une question non résolue ! Le nombre fut en revanche grossièrement multiplié pour plaire au pouvoir algérien. Des chiffres astronomiques qui vidaient les quartiers parisiens de la Goutte d’or et de Barbès, sentant le mouton de l’Atlas, de tous ses habitants s’ils avaient été réels.
Je reviens au présent et à cette proposition de loi présentée par les opposants à une France glorieuse et fière d’être encore dans le camp occidental. Cette résolution, hélas, correspond bien aux intentions du gouvernement qui blanchit de ses exactions criminelles le FLN et l’Algérie depuis des années au détriment des Pieds-noirs toujours accusés « de crime contre l’humanité », avec l’armée et les anciens combattants de ce temps de guerre.
Aujourd’hui où va-t-on avec cette envie de punir l’Histoire ? On s’incline, on plie, on se prosterne ! Quelle est cette trouille qui habite l’ Élysée, nos députés, nos élus, notre gouvernement « Renaissance » minoritaire, pour qu’ils se déculottent une fois de plus et offrent leur soumission à l’Algérie par cette décision odieuse pour la république et notre histoire, en reniant et abaissant une France qui fut grande. C’est pour cette raison que j’ai écrit dans mon titre « M… comme mars en 1962 » et « M… comme Macron en 2024 ». Deux lettres de l’alphabet qui reflètent la grandeur passée oubliée et le sort déshonorant où le pays se trouve actuellement ! Cela va-t-il continuer ? Nos députés ne se sont-ils pas assez agenouillés face à la Mecque ? Ils sont la honte d’une France qui souffre de son insécurité, des attentats et des victimes d’un l’islamiste qui gangrène nos banlieues, sans se préoccuper de l’endettement colossal et du pouvoir d’achat qui sont les maux à ajouter à nos peines, dans ce contexte de guerre entre la Russie et l’Ukraine où les couards, les couilles molles de la république jouent les « va-t’en-guerre » inutiles, au lieu d’être les initiateurs de PAIX.
Finalement irais-je au bout de mon projet. Écrire les élucubrations, les turpitudes de Macron ? Elle est si triste cette France ! Faut-il encore attendre 3 ans pour que nous retrouvions la fierté d’une Nation responsable ?
Robert Charles Puig / 7 avril 2024
| |
L’insolite silence de l’Elysée face aux inacceptables « exigences » algériennes
Par M. Bernard Lugan.
Envoyé par Mme Annie Bouhier
|
|
En parlant de la colonisation comme d’un « crime contre l’humanité », Emmanuel Macron a ouvert une boite de Pandore qu’il ne pourra plus refermer. Déjà, le 15 juillet 2019, Mohand Ouamar Bennelhadj, secrétaire général par intérim de l’ONM (Organisation nationale des moudjahidines, les anciens combattants), avait appelé les députés algériens à voter une loi criminalisant la colonisation française.
Maintenant qu’il y a tout à craindre du rapport de la « commission Stora » sur la « mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie » qui devrait être remis au début de l’année 2021, voilà déjà les demandes de « réparations » qui s’accumulent. Certaines exigent la remise des archives de l’Algérie française, d’autres formulent des demandes de « dédommagement » s’élevant à 100 milliards de dollars !!!
L’Etat semblant avoir renoncé à défendre l’image de la France et ses intérêts face à ces exigences à la fois surréalistes et insupportables, il ne reste donc que la réaction citoyenne et la mobilisation du « pays réel » à travers les réseaux sociaux. Tel est le but de cette analyse.
Puisque le « Système » algérien veut faire les comptes, nous allons donc lui présenter l’addition de ce que l’Algérie a coûté à la France entre 1830 et 1962…sans parler du coût colossal de l’immigration depuis cette dernière date…
Au mois de juillet 1962, au terme de 132 années de présence, la France avait créé l’Algérie, lui avait donné son nom, l’avait unifiée et lui avait offert un Sahara qu’elle n’avait, et par définition, jamais possédé puisqu’elle n’avait jamais existé auparavant. La France avait drainé ses marécages, avait bonifié ses terres, avait équipé le pays, avait soigné et multiplié par dix ses populations. Elle avait également fait entrer dans la modernité des tribus jusque-là dissociées qui n’avaient jamais eu conscience d’appartenir à un tout commun supérieur.
La France laissait en héritage à l’Algérie indépendante :
– 70.000 km de routes,
– 4300 km de voies ferrées,
– 4 ports équipés aux normes internationales,
– une douzaine d’aérodromes principaux,
– des centaines d’ouvrages d’art (ponts, tunnels, viaducs, barrages etc.),
– des milliers de bâtiments administratifs, de mairies, de casernes, de gendarmeries,
– 31 centrales hydroélectriques ou thermiques,
– une centaine d’industries importantes dans les secteurs de la construction, de la métallurgie, de la cimenterie,
– des milliers d’écoles, d’instituts de formation, de lycées, d’universités, d’hôpitaux, de maternités, de dispensaires, de centres de santé, etc.
Tout cela avait été créé par la France, pensé et réalisé par des ingénieurs et des architectes français, et payé par les impôts des contribuables français.
En 1959, toutes dépenses confondues, l’Algérie engloutissait à elle seule 20% du budget de l’Etat français, soit davantage que le budget de l’Education nationale ou ceux, additionnés des Travaux publics, des Transports, de la Reconstruction et du Logement, de l’Industrie et du Commerce.
Et cela, en pure perte car, économiquement, l’Algérie n’avait pas d’intérêt pour la France. Qu’il s’agisse des minerais, du liège, de l’alpha, des vins, des agrumes etc., toutes les productions algériennes avaient en effet des coûts supérieurs à ceux du marché. Ainsi, alors que le vin comptait pour près de 54% de toutes ses exportations agricoles vers la métropole, le prix de l’hectolitre qu’elle vendait à la France était largement supérieur à celui produit en Espagne, ce qui n’empêcha pas la métropole de se fermer au vin espagnol pour s’ouvrir encore davantage au sien…
En 1930, le prix du quintal de blé était de 93 francs alors que celui proposé par l’Algérie variait entre 120 et 140 f, soit 30 à 50% de plus.
Quant au pétrole, il avait lui aussi été subventionné par la France. Découverts en 1956, les hydrocarbures du Sahara furent mis en production entre 1957 et 1959, avec une exploitation qui débuta véritablement en 1961, quelques mois donc avant l’indépendance. Or, comme Daniel Lefeuvre l’a clairement montré, l’Etat français fut quasiment contraint d’imposer à des compagnies réticentes de s’investir dans cette production. En effet :
– Le pétrole algérien devait obligatoirement être vendu sur le marché mondial car il était trop léger pour la transformation en fuel dont avait alors besoin l’industrie française.
– A cette époque le marché mondial était saturé. L’URSS bradait ses huiles à bas prix et les gros producteurs du Moyen-Orient limitaient leur production.
– L’Algérie et la Libye arrivant en même temps sur le marché la chute des cours allait être accélérée, d’autant plus que le pétrole libyen était plus facile à exploiter et à écouler que celui d’Algérie.
– Le brut algérien était cher : 2,08 $ le baril contre 1,80 $ au cours mondial.
Résultat : là encore, la France a surpayé un pétrole dont elle avait pourtant financé les recherches et la mise en exploitation, phénomène qui se poursuivra d’ailleurs après l’indépendance.
Quant à l’immigration algérienne en France, et là encore, contrairement à tous les poncifs, elle n’a correspondu à aucune nécessité économique, l’absence de qualification et de stabilité de cette main-d’œuvre nécessitant la mise en place de mesures d’adaptation inutilement coûteuses. De plus, contrairement à la vulgate, l’afflux d’Algériens en métropole, dans les années 1950, n’a pas répondu aux besoins en main d’œuvre de l’économie française au cours des années de reconstruction ou des « Trente Glorieuses » puisque, sur 110 000 Algériens recensés en 1950 dans la région parisienne, Daniel Lefeuvre a montré que 50 000 n’avaient pas de moyens d’existence réguliers. De même, en 1957, sur 300 000 Algériens vivant en France le nombre de sans-emploi était de 100 000…
En Algérie où tout était plus cher qu’en métropole, année après année, la France a comblé la différence. Par comparaison avec une usine métropolitaine, l’ensemble des dépenses, salaires et accessoires était ainsi de 37% plus élevé en Algérie, ce qui faisait qu’une usine qui y était construite n’étant pas rentable, il lui fallait donc, non seulement un marché subventionné par la France, mais en plus un marché protégé…
Au lieu d’avoir pillé l’Algérie comme l’affirment contre la vérité historique et économique les dirigeants algériens, les culpabilisateurs et les « décoloniaux », la France s’y est au contraire ruinée.
Par le labeur de ses colons la France avait également permis à l’Algérie d’être alimentairement auto-suffisante. Aujourd’hui elle est le premier importateur africain de biens alimentaires pour un total annuel moyen de 12 à 14 milliards de dollars (Centre national algérien de l’informatique et des statistiques-douanes-CNIS).
Pour mémoire, en 1961, l’Algérie exporta 600.000 quintaux de grain et 700.000 quintaux de semoule. Aujourd’hui, la moyenne annuelle des importations de ces produits se situe entre 5 et 30 millions de quintaux par an.
L’Algérie n’exporte plus d’oranges alors qu’avant 1962, les exportations étaient de 200.000 tonnes. Elle n’exporte plus de tomates (elle en exportait 300 000 quintaux avant 1962), de carottes, d’oignons, de petits pois, de haricots verts, de melons, de courgettes etc., toutes productions qui faisaient la richesse de ses maraîchers avant 1962. Avant cette date, les primeurs algériens débarquaient à Marseille par bateaux entiers. Notamment les pommes de terre nouvelles dont les exportations annuelles oscillaient entre 500.000 et un million de quintaux alors qu’au 4e trimestre 2020, rien qu’en semences, et pour la seule France, l’Algérie en a importé 4300 tonnes (Ouest-France 14 décembre 2020). Toujours avant 1962, l’Algérie exportait 100.000 hectolitres d’huile d’olive et 50.000 quintaux d’olives tandis qu’aujourd’hui, la production nationale ne permet même pas de satisfaire la demande locale. La seule facture de lait en poudre et de laitages atteint en moyenne annuelle quasiment 2 milliards de dollars.
Alors que la moitié de la population a moins de 20 ans, le pays est dirigé par des vieillards dont la seule « légitimité » repose sur le mythe de la résistance à la colonisation et sur d’auto-affirmations « résistancialistes » le plus souvent imaginaires. Quant aux nombreuses associations d’ « ayants-droit » auto proclamés acteurs ou héritiers de la « guerre de libération », dont les Moudjahidines ou Les enfants de martyrs, elles bloquent la jeunesse sur des schémas obsolètes qui tournent le dos à la modernité. Avec 6% de toutes les dotations ministérielles, le budget du ministère des Anciens combattants est ainsi supérieur à ceux de l’Agriculture (5%) et de la Justice (2%)…
La cleptocratie d’Etat qui, depuis 1962 a fait main-basse sur l’Algérie indépendante a dilapidé l’héritage laissé par la France avant de détourner des dizaines de milliards de dollars de recettes gazières et pétrolières sans songer à préparer l’avenir. Après avoir ruiné le pays, il ne lui reste donc plus que son habituelle recette : accuser la « France coloniale ».
Et pourquoi cesserait-elle d’ailleurs de le faire puisque, à Paris, les héritiers des « porteurs de valises » boivent avec tant volupté au calice de la repentance…encouragés en cela par le président de la République lui-même…
Pour en savoir plus, voir mon livre : Algérie l’histoire à l’endroit.
Plus d’informations sur le blog de Bernard Lugan.
Illustrations : DR : [cc] Breizh-info.com, 2020, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
https://www.breizh-info.com/2020/12/24/156110/linsolite-silence-
de-lelysee-face-aux-inacceptables-exigences-algeriennes/
|
|
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
| |
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
|
Algérie – France
Envoyé par Gérard
https://www.tsa-algerie.com/algerie-france-sabrina-
sebaihi-la-deputee-qui-fait-avancer-les-choses/
lestrepublicain.com - Par: Rafik Tadjer —18 Févr. 2024
Sabrina Sebaihi, la députée qui fait avancer les choses
La députée d’origine algérienne, Sabrina Sebaihi, est une figure bien connue à l’Assemblée nationale française.
La Grande mosquée de Paris lui a rendu, ce jeudi 18 avril, un vibrant hommage pour tout ce qu’elle fait pour la reconnaissance par la France de son passé colonial en Algérie, condition capitale pour des relations apaisées entre les deux pays. « Un travail formidable », reconnaît le recteur Chems-Eddine Hafiz dans une déclaration à TSA.
Députée des Verts (écologistes) des Hauts-de-Seine depuis 2022, Sabrina Sebaihi ne fait pas que porter la cause de l’environnement dans les travées du Parlement français.
Sa voix, en fait, elle l’a prêté à toutes les causes justes. Avec ses collègues de gauche, notamment de La France Insoumise (LFI), elle a défendu sans relâche la cause du peuple palestinien, appelant notamment à un cessez-le-feu depuis le déclenchement de la guerre dans cette enclave palestinienne, il y a plus de deux mois.
Elle a été aussi rapporteure de la commission d’enquête parlementaire sur les défaillances dans le sport français, notamment les agressions sexuelles, le harcèlement et les salaires trop élevés de certains dirigeants.
Sabrina Sebaihi fait parler d’elle aussi pour les actions qu’elle mène pour faire admettre en France les crimes de la colonisation.
Née à Ivry-sur-Seine en 1981 de parents immigrés Algériens installés en France après l’indépendance, la femme politique qu’elle est devenue est restée très attachée au pays de ses origines.
Elle est surtout consciente que le rapprochement entre les deux rives et l’apaisement des relations entre la France et l’Algérie passe par un travail de mémoire réel et la vérité assumée sans calculs.
Son action dans ce sens-là, plus retentissante, donc la plus médiatisée, remonte à quelques semaines seulement.
Jeudi 28 mars, l’Assemblée nationale française a adopté, un peu à la surprise générale, une résolution condamnant la répression de manifestants algériens par la police française le 17 octobre 1961.
Derrière la résolution, se trouvait Sabrina Sebaihi qui l’a déposée avec la députée « Renaissance » Julie Delpech.
Adoptée par 67 voix pour et 11 contre (celles de députés du Rassemblement national), la résolution condamne dans des termes sans équivoque « la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l’autorité du préfet de police Maurice Papon » le 17 octobre 1961, appelle à « l’inscription d’une journée de commémoration » de ce massacre et invite le gouvernement français à « travailler en commun avec les autorités algériennes pour appréhender leur histoire commune ».
Algérie – France : la députée Sabrina Sebaihi honorée par la Grande Mosquée de Paris
Cette résolution fera date parce qu’elle constitue un autre pas important vers la reconnaissance officielle de ces massacres, après les gestes faits par le président François Hollande en 2012 puis Emmanuel Macron en 2021.
Pour la faire passer, la députée franco-algérienne a dû batailler contre le courant extrémiste et les nostalgiques de l’Algérie française, présents aussi à l’Assemblée à travers certains députés du Rassemblement national.
Que ce soit en coulisses ou plénière, les débats ont été houleux. Un député RN a même qualifié dans son intervention les massacres du 17 octobre de « fake News ».
« Il ne faut rien céder à ceux qui veulent réécrire l’histoire pour se racheter une vertu sur le dos des morts », a estimé en plénière Sabrina Sebaihi qui a fait de ce vote une plaidoirie pour la reconnaissance des crimes de la colonisation et un réquisitoire contre ceux qui, hier les ont commis et ceux qui aujourd’hui les défendent.
Au final, le texte a été voté. « VICTOIRE ! », s’est écriée Sabrina Sebaihi sur les réseaux sociaux, immédiatement après le vote de la résolution qui, désormais, portera son nom.
Moins d’un mois après cette action retentissante, la Grande mosquée de Paris l’a honorée de fort belle manière, en organisant un déjeuner en son honneur, en présence d’une autre députée d’origine algérienne, Fatiha Keloua-Hachi qui a défendu, elle aussi, le texte sur les massacres du 17 octobre.
Une position qui lui a valu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux de la part des nostalgiques de l’Algérie française et tous ceux qui veulent nuire aux relations franco-algériennes.
La députée Sabrina Sebaihi n’a pas échappé, elle aussi, aux menaces et ce déferlement de haine. Mais les deux députées s’assument. Tout en étant françaises, elles revendiquent avec fierté leurs origines algériennes.
« Je suis très honorée d’être reconnue par les siens. Je ne m’attendais pas à ce que la Grande mosquée de Paris organise un déjeuner en mon honneur. C’était une belle surprise pour moi », réagi Sabrina Sebaihi dans une déclaration à TSA.
Pendant le déjeuner, elle a détaillé la démarche qu’elle a entreprise depuis un an et demi pour faire adopter le texte sur le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, notamment les négociations avec l’Élysée. Mais pour elle, la bataille n’est pas terminée. Elle compte aller jusqu’au bout pour que ce massacre soit reconnu comme un crime d’État.
« Je tenais à inviter la députée Sabrina Sebaihi pour le formidable travail qu’elle est en train de réaliser notamment la dernière action qu’elle a menée auprès de l’Assemblée nationale sur la fixation d’une date de commémoration pour le 17 octobre », a déclaré à TSA le recteur de la GMP, Chems-Eddine Hafiz, lui aussi d’origine algérienne.
« Le peuple algérien a énormément souffert pendant la colonisation et, aujourd’hui, cette députée est en train de faire un travail formidable pour qu’il y ait véritablement ce travail de mémoire », a ajouté le recteur.
Pour lui, cette mémoire doit être « apprise par tout le monde et vulgarisée », car, explique le recteur de la Grande mosquée de Paris, « pour l’apaisement des relations entre la France et l’Algérie, nous avons besoin de ce genre d’actions qui sont capitales ».
« Je voulais lui montrer que la Grande mosquée de Paris est à la fois honorée de l’inviter ici et en même temps la soutient dans toutes ses actions », a conclu Chems-Eddine Hafiz à propos de la députée franco-algérienne.
Fayza Lamari
Envoyé par Germain
https://www.tsa-algerie.com/fayza-lamari-la-
mere-de-kylian-mbappe-en-superstar-en-algerie/
- tsa-algerie.com - Par: Rafik Tadjer —14 Avril 2024
Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, accueillie en superstar en Algérie
Fayza Lamari, la mère du footballeur international français, Kylian Mbappé, est en visite en Algérie, le pays de ses origines. La femme a été accueillie chaleureusement partout où elle s’est rendue, de la Casbah d’Alger à Béjaïa, la région natale de ses parents.
La surprise est pour ainsi dire des deux côtés : Fayza Lamari a constaté de visu qu’elle est très appréciée sur la terre de ses parents et les Algériens ont été agréablement surpris de découvrir qu’elle ne partage pas que les origines communes avec eux. À Béjaïa, la mère et agent du célèbre footballeur s’est exprimée spontanément dans un kabyle parfait, qui plus est avec l’accent spécifique à cette partie de la Kabylie.
Fayza Lamari est très médiatisée et tout le monde tant en France qu’en Algérie connaît son rôle dans le succès de son fils, d’abord en tant que mère, puis comme agent qui gère sa carrière avec l’efficacité que l’on sait. Vendredi, à la célèbre place Gueydon de Béjaïa, elle a vite été reconnue par des passants qui n’ont pas manqué l’occasion de l’approcher.
L’un d’entre eux a témoigné auprès du site Visa Voyages, assurant que Faïza Lamari est « accessible » et parle couramment le kabyle. Pour lui, c’est la preuve que si elle est née en France, ses parents, originaires de Oued Amizour, n’ont pas manqué de lui transmettre leur culture et leur langue ancestrales.
Fayza Lamari, la mère de Mbappe, accueillie comme une star à Béjaïa
Pour rester dans le football, un supporter du club local du Mouloudia de Béjaïa (MOB), propriétaire d’une salle de fêtes à Amizour, a organisé un évènement en son honneur.
La mère de Mbappé a pu ainsi rencontrer des femmes, des hommes et des enfants de la région. En prenant la parole, elle s’est exprimé en français, mais aussi avec beaucoup d’aisance en Kabyle. « C’est le début de quelque chose avec Tizi, puis Béjaïa. J’espère que c’est le début d’une longue histoire et qu’on va écrire plein de choses ensemble », a-t-elle dit.
Elle a aussi posé avec le maillot vert et noir du MOB, offert par le président du club. L’autre cadeau qu’elle a reçu pendant la soirée, c’est un portrait de son illustre fils, dont elle est aussi le manager.
Fayza Lamari en visite à Bejaia, la région natale de ses parents
En cette qualité, elle a été évidemment interrogée dans les rues de Béjaïa sur l’avenir de Kylian Mbappé, annoncé à chaque fois au Real Madrid sans toutefois quitter le Paris Saint-Germain. Évidemment, elle a été moins prolixe, se contentant de sourire à chaque fois qu’elle est interpellée sur le sujet.
La visite de Fayza Lamari en Algérie pourrait être suivie par celle de son fils. Lors de son déplacement en juillet dernier au Cameroun, pays d’origine de son père, Kylian Mbappé avait indiqué qu’il se rendrait aussi en Algérie, sans toutefois fixer de date précise.
Le joueur est né de l’union de l’Algérienne Faiza Lamari et du Camerounais Wilfried Mbappé. Faiza Lamari, ancienne handballeuse, est née en 1974 à Bondy (France) de parents originaires de Oued Amizour (Béjaïa). Deux autres grands footballeurs français sont originaires de la région. Il s’agit de Zinedine Zidane et de Karim Benzema.
Rafik Tadjer
| |
|
L'amant richissime
Envoyé par Eliane
|
|
Dans la vie il faut savoir faire des choix.
Un homme rentre de voyage d'affaire, un jour plus tôt. Il est tard et il prend un taxi.
Près de la maison, il demande au chauffeur s'il veut être témoin parce qu'il pense que sa femme le trompe et qu'elle est en ce moment avec son amant .
Ce dernier accepte, contre 150 Euros .
Ils entrent sans bruit, ouvrent doucement la porte de la chambre, le mari allume la lumière et enlève la couverture du lit.
Il découvre sa femme avec l'amant. Hors de lui, il sort le pistolet et le braque contre la tête de l'amant.
Sa femme hurle :
"- Ne tire pas, ne tire pas ! Je t'ai menti ! Je n'ai pas hérité l'argent de ma tante...
C'est LUI qui a acheté la Ferrari que je t'ai offerte, notre yacht aussi, la maison au bord du lac et tous les billets des grands matchs auxquels tu assistes ! Il paye même nos impots !"...
Le mari, désemparé, baisse le pistolet et se tourne vers le chauffeur de taxi :
- Tu ferais quoi à ma place?
- Moi ? Je remettrai la couverture pour qu'il ne prenne pas froid !
|
| |
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|
 Je l'obtins cependant, à force de supplications, et un jour vint où je n'eus plus qu'à choisir mon régiment. Je voulais, bien entendu, servir dans la cavalerie, et j'avais à opter entre les spahis et les chasseurs d'Afrique.
Je l'obtins cependant, à force de supplications, et un jour vint où je n'eus plus qu'à choisir mon régiment. Je voulais, bien entendu, servir dans la cavalerie, et j'avais à opter entre les spahis et les chasseurs d'Afrique.





 La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, pour parvenir à cette décision, n'avait envisagé que le seul intérêt du port de Philippeville, alors qu'elle aurait dû se soucier uniquement de celui de la région d'Aïn-Beïda et avoir le souci de ne pas contrarier les lois naturelles.
La Commission des Travaux publics de la Chambre des Députés, pour parvenir à cette décision, n'avait envisagé que le seul intérêt du port de Philippeville, alors qu'elle aurait dû se soucier uniquement de celui de la région d'Aïn-Beïda et avoir le souci de ne pas contrarier les lois naturelles.












 Nous sommes en 1830. En vue d'obtenir la réparation d'un affront infligé par le dey d'Alger, Hussein Pacha, à notre Consul, M. Deval, le roi Charles X décida d'occuper Alger. Une expédition fut préparée à cet effet. Débarqué le 14 juin 1830, à Sidi-Ferruch, le corps expéditionnaire, sous le commandement du général de Bourmont, s'emparait d'Alger, le 5 juillet. Après Alger, ce fut le tour d'Oran. Des négociations pour la reddition pure et simple d'Oran, par le bey Hassan, furent entreprises. Quelques bricks de la flotte française, le Ruse, le Dragon, le Voltigeur, l'Endymion, vinrent mouiller au large de Mers-el-Kébir et d'Oran. Sur l'un d'eux, le Dragon, se trouvait le capitaine de Bourmont, fils du maréchal, chargé des négociations.
Nous sommes en 1830. En vue d'obtenir la réparation d'un affront infligé par le dey d'Alger, Hussein Pacha, à notre Consul, M. Deval, le roi Charles X décida d'occuper Alger. Une expédition fut préparée à cet effet. Débarqué le 14 juin 1830, à Sidi-Ferruch, le corps expéditionnaire, sous le commandement du général de Bourmont, s'emparait d'Alger, le 5 juillet. Après Alger, ce fut le tour d'Oran. Des négociations pour la reddition pure et simple d'Oran, par le bey Hassan, furent entreprises. Quelques bricks de la flotte française, le Ruse, le Dragon, le Voltigeur, l'Endymion, vinrent mouiller au large de Mers-el-Kébir et d'Oran. Sur l'un d'eux, le Dragon, se trouvait le capitaine de Bourmont, fils du maréchal, chargé des négociations.
 Cette colonie italienne, venant de l'île de Procida, avait gardé toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la foi de leur patrie.
Cette colonie italienne, venant de l'île de Procida, avait gardé toutes les coutumes, toutes les mœurs, toute la foi de leur patrie.



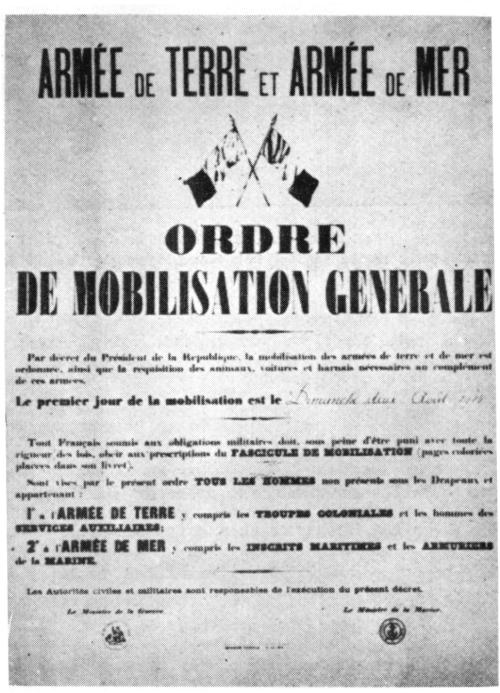
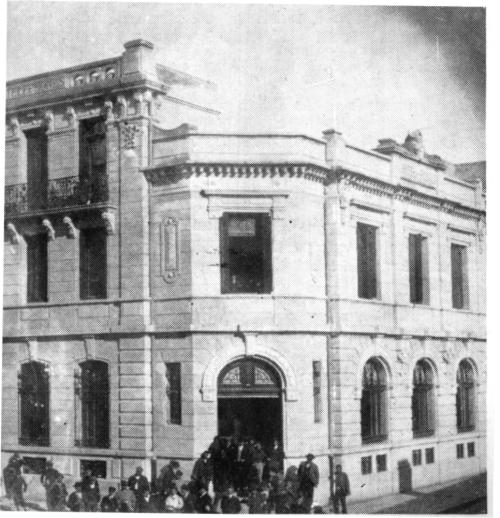






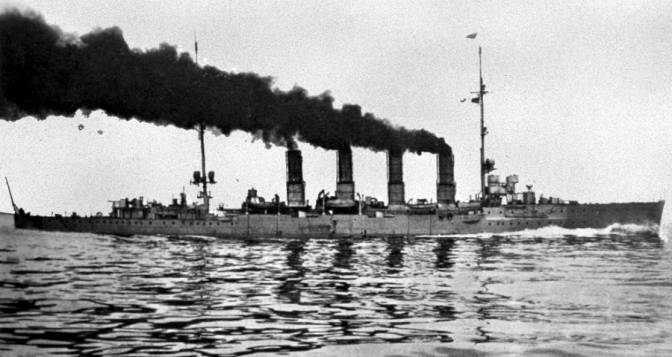

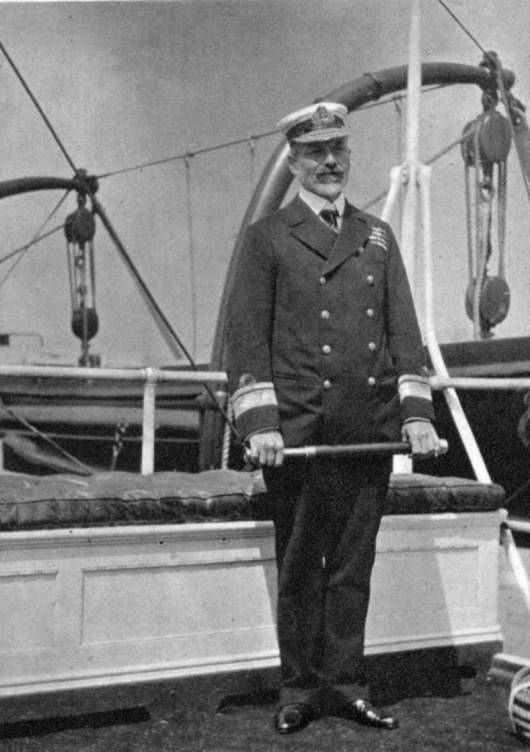



 La Commune mixte d'Ain Touta tient son nom d'une source bordée d'un mûrier. Ce dernier a effectivement existé à proximité de la gare à 1 km du centre du village. Cette source s'est tarie vers 1950 à la suite de l'approfondissement des puits de la Commune mixte. Quant au mûrier, il a séché en deux années, il était d'une variété très rare, que les indigènes dénommaient « Toute Michel - du nom de celui qui l'avait planté.
La Commune mixte d'Ain Touta tient son nom d'une source bordée d'un mûrier. Ce dernier a effectivement existé à proximité de la gare à 1 km du centre du village. Cette source s'est tarie vers 1950 à la suite de l'approfondissement des puits de la Commune mixte. Quant au mûrier, il a séché en deux années, il était d'une variété très rare, que les indigènes dénommaient « Toute Michel - du nom de celui qui l'avait planté.

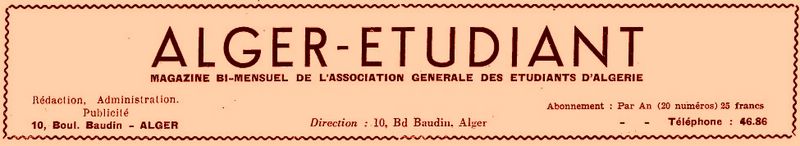 Source Gallica - N° 146
Source Gallica - N° 146





 Ingrédients:
Ingrédients:
 Ingrédients :
Ingrédients :
 Paul Laurent Barnier naît dans la bonne ville de Saïda le 10 mars 1909. C'est dans le pittoresque marché arabe aux odeurs épicées que le "déjà grand pour son âge", Paul dispute ses premiers matches de football avec les camarades du quartier. Malgré des aptitudes certaines pour le sport, il doit à l'instar des autres enfants du quartier, se contenter de ces rencontres de la rue car le championnat d'Oranie de l'époque commençait seulement dans les catégories "juniors". Heureusement, le Grand Lycée d'Oran fournit à toute cette jeunesse privée de compétition officielle une épreuve à la hauteur de son ambition.
Paul Laurent Barnier naît dans la bonne ville de Saïda le 10 mars 1909. C'est dans le pittoresque marché arabe aux odeurs épicées que le "déjà grand pour son âge", Paul dispute ses premiers matches de football avec les camarades du quartier. Malgré des aptitudes certaines pour le sport, il doit à l'instar des autres enfants du quartier, se contenter de ces rencontres de la rue car le championnat d'Oranie de l'époque commençait seulement dans les catégories "juniors". Heureusement, le Grand Lycée d'Oran fournit à toute cette jeunesse privée de compétition officielle une épreuve à la hauteur de son ambition.