|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Écusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Avertissement :
Il est interdit de reproduire sur quelque support que ce soit tout ou partie de ce site (art. L122-4 et L122-5 du code de la propriété intellectuelle) sans autorisation expresse et préalable du propriétaire du site..
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyright et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Webmaster de ce site.
Les utilisateurs du site ne peuvent mettre en place de liens hypertextes en direction du site susvisé sans l'autorisation expresse et préalable du propriétaire du site, M. Jean-PierreBartolini.
Pour toute demande de reproduction d'éléments contenus dans le site, merci de m’adresser une demande écrite par lettre ou par mel.
Merci.
Copyright©seybouse.info
Les derniers Numéros :
238, 239,
240, 241, 242,
243, 244, 245,
246, 247,
| |
Chers Amies, Chers Amis,
Premier Avril, Rameaux et Pâques sont à peine passés, l’activité calendaire suit son cours, ignorant totalement les activités et les absurdités du monde gouvernemental actuel.
Le réveil de la végétation, l’explosion des fleurs, les journées plus longues, la proximité de la mer ou de la montagne et du spectacle changeant offert chaque jour, ne peuvent que nous inciter à chasser nos ennuis et nos interrogations actuels.
Je ne doute pas que Pâques a apporté son lot de Saints-Couffins avec Gazadiels, les Mounas, etc… Cela est notre mémoire et c’est elle qui nous a tenu en vie et qui le fera encore très longtemps, je l’espère.
Nous sommes en avril, avec les poissons traditionnels et où il ne faut pas se découvrir d’un fil, surtout avec un temps plus malade que jamais mais pas aussi atteint que les affaires de l’Etat.
Alors Bon mois d’avril et bonheur pour Tous et Toutes.
Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
| |
| Pour une Amourette qui passait par-là.
Envoyé par Jean-Claude PUGLISI.
|
( à toute ma bande de copains d’enfance
et en particulier à Vincent Defilippi héros de mon histoire )
Les fantômes du Bastion de France
sont venus me dire l’autre soir :
« les mythes, les rêves et les envies,
servent à écrire des romans »
Alors je me suis plu à remonter le temps :
Vieux mythes, vieux rêves, vieilles envies.
C’était au cours de la saison chaude et torride d’un certain été Callois et à cette époque je dois bien aujourd’hui l’avouer, les caractères sexuels dits secondaires qui déjà nous chatouillaient le corps et l’esprit, ne cessaient de nous pousser irrésistiblement et d’une manière toute naturelle, vers les jeunes beautés de notre âge issues de la cité et de ses environs, sans omettre un seul instant de négliger les petites étrangères de passage, que le hasard des vacances familiales amenait en villégiature à La Calle.
S’entendre dire que l’on draguait à cette époque, la très charmante et toute gracieuse gente féminine de notre âge, avec une certaine effronterie et quelques impertinences, et cela, sans aucune retenue ni la moindre réserve, avec une totale abstraction de toutes les règles de bienséance, serait, je vous l’assure, pour le moins exagéré - sinon, franchement fallacieux. Nous, nous bornions seulement d’admirer de loin avec beaucoup de discrétion, les jolis petits minois et bien-sûr le reste de ces charmantes et fraîches jeunes-filles en fleurs, objet de nos ardents désirs d’adolescents et de nos rêves fous de jouvenceaux. Pour les voir de plus près et les admirer en toute quiétude, avec parfois la chance et le rare bonheur de croiser leur regard, voire même, de les côtoyer un tout petit instant, il se trouvait que la fidèle complicité de nos belles plages ensoleillées et de l’esplanade du cours Barris était pour se faire à la belle saison, des lieux de rencontre parmi les plus privilégiés de la cité calloise.
A la plage dés le matin et se dorant au soleil comme des lézards alanguis par la chaleur, on pouvait régulièrement apercevoir nombre de damoiseaux nonchalamment allongés sur le sable immaculé, à l’instar des minets guettant à l’affût la souricette de passage, avec dans le verbe et dans le geste un petit semblant de désinvolture, ou bien arborant parfois pour la circonstance des yeux faussement clos, mais, qui à aucun moment, ne perdaient de vue une seule des belles images de toutes ces mignonnes et croquantes petites sirènes, lesquelles, n'arrêtaient pas de s’ébattre joyeusement dans les flots, toutes baignées par l’or du soleil et le bleu tendre et profond de la Méditerranée Calloise. Alors notre petit cœur d’adolescent n’arrêtait pas de faire boum, devant toutes ces sublimes petites créatures de rêve - merveilles des merveilles de la nature.
Certains d’entre-nous adoptaient alors naïvement une stratégie particulière, dans le but inavoué de se faire remarquer de la toute belle et jeune déesse sur laquelle ils avaient jeté leur dévolu : c’était par exemple, se faire admirer en arpentant avec élégance le bord de la plage par petits groupes, tout en veillant de bien mettre en évidence carrure et bronzage en passant devant sa dulcinée, sans omettre un seul instant de rouler parfaitement des épaules avec beaucoup d’ostentation.
C’était aussi jouer à l’exhibitionniste pour espérer épater la gente féminine, en effectuant des plongeons impeccables et bruyants toujours suivis d’un crawl à la Johnny Wesmuller - le Tarzan vénéré et à la mode de cette époque… D’autres tentaient de se faire remarquer, en se mettant en vedette aux commandes des avirons de leur frêle périssoire, ou à bord d’une modeste petite barque amenée depuis le port pour la circonstance…
Toutes ces subtiles et laborieuses manœuvres d’approche, conduisaient parfois les plus chanceux à venir échanger avec beaucoup de bonheur, quelques mots rares et furtifs avec l’autre sexe et comme toujours sous le regard méfiant de la famille, auxquels, venaient souvent s’ajouter, la curiosité et les sourires malicieux de bien des occupants de la plage.
C’est sur les coups de midi marqués régulièrement par le carillon harmonieux des cloches de Saint-Cyprien, que prenait fin le premier épisode du beau rêve inachevé de tous ces tourtereaux énamourés et voyait le flot des baigneurs regagner lentement et à regret leur domicile assommé par les ardeurs du soleil - peut-être ? Mais le cœur tout rempli d’un fol espoir : celui de d'apercevoir de nouveau sa petite déesse adorée sur le cours Barris, lorsque, bien fatigué de sa rude journée, l’astre ardent consentira enfin de partir pour s’en aller se coucher derrière les divins monts du Boulif.
Dans la fraîcheur du soir, le Cours Barris se voyait alors tout parfumé par les odeurs de merguez et brochettes, qui n’en finissaient plus de griller sur d’ardentes braises, mais aussi, noyé au beau milieu de la rumeur locale, toujours très animée par les cris des marchands de pizza, de cacahouètes et d’oublies… C’était alors l’heure bénie de la soirée pour goutter à la douceur qui descendait sur la cité. Dés la tombée de la nuit le Cours Barris s'illuminait par ses multiples lampadaires, qui, avec bonheur, mettaient en exergue ses éternels et légendaires palmiers... A cette heure du soir naissant, l'esplanade se comblait lentement de promeneurs de tous âges qui allaient et venaient sans se lasser, au rythme entraînant de la musique et des chansons en vogue du moment, que répandaient avec générosité les puissants haut-parleurs du Bar des Palmiers ainsi que ceux du Brisants bar… Alors là débutait le deuxième épisode de la journée pour tous les fringants petits coquets de notre âge, et à l‘instar de nos aînés, l’éternel et toujours fidèle va et vient sur la scène du Cours, en observant furtivement comme de bien entendu et à chacun de leur passage - l’objet de toutes nos douces pensées et de nos rêves juvéniles les plus fous.
Un peu comme ces jeunes et charmants mannequins qui pour se faire admirer, s’exhibent en se déhanchant harmonieusement sur une longue estrade, nous n’avions à aucun moment négligé d’arborer aux yeux de nos belles, une tenue vestimentaire choisie pour la circonstance : pantalons fuseaux à la mode et chemises bariolées toujours flottantes et à manches courtes, qui laissaient apparaître pour la galerie tout l’éclat du plaqué or d’une lourde gourmette, qui sur le poignet pendait négligemment et un col largement ouvert pour faire virile et montrer le balancement d’une croix pieusement suspendue par son collier... Nous poussions même le raffinement à l’extrême, jusque dans la façon particulière de nous pomponner : chevelure abondante aux crans majestueux et luisant de brillantine Roja - visage net et brillant, très soigneusement débroussaillé à la lame Gillette de tous ses duvets disgracieux - peau abondamment parfumée à l’eau de Cologne Forvil de chez Auguste le coiffeur… etc.
C’était ainsi et comme cela dans la douceur de tous les soirs de l’été, où sans se lasser nous usions de nos jeunes et vigoureuses jambes pour aller et venir sans se lasser, au rythme de la musique et des chansons avec un semblant de nonchalance non dissimulé, pour enfin espérer croiser et apercevoir brièvement l’être aimée à chacun de ses passages et en avalant tous les soirs sans même nous en rendre compte, quelques bons kilomètres strictement à pieds .
Parfois le Bar des Palmiers organisait avec bonheur sur la partie attenante du Cours, un gentil petit bal en plein air au son du pick-up. La piste était alors savamment délimitée par quelques tables et leurs chaises à l’intention des danseurs et autres accompagnateurs. Quelle aubaine pour les plus audacieux d’entre-nous, car, ils pouvaient alors au cours d’une danse échanger quelques mots complices et serrer l’espace d’un moment, l’objet de tous leurs désirs dans leurs bras tremblotants. Bien souvent la jolie pervenche était de la soirée, mais, comme on s’en doute, toujours bien encadrée par des parents particulièrement attentifs. Pour les moins hardis et les plus timides - dont votre serviteur ! - qui étaient présents, faute de savoir correctement danser et d’avoir le courage de traverser la piste pour aller inviter sa dulcinée à faire quelques pas de danse, ils se contentaient alors la mort dans l’âme de jouer faussement au beau ténébreux. Ils faisaient hélas tapisserie en demeurant toute la soirée assis à leur table, essayant de tuer le temps à consommer des boissons fraîches et à fumer quelques cigarettes en affectant comme toujours pour se donner bonne contenance, un air de coq du village qui se voulait très détaché des choses de ce monde.
Voilà ce que parfois je me raconte surtout par certains soirs d’été, où, nostalgie aidant, je me propulse les yeux fermés vers ce pays de mon enfance, qui m’a vu autrefois ressentir d’une façon toute platonique, les premiers émois d’une tendre amourette d’adolescent. Mais aujourd’hui c’est chemin faisant dans ces lignes et sur le sentier lumineux de mes rêves de jadis, que je rencontre mon ami et néanmoins cousin Vincent Defilippi le fils de Carmello et Rosette Samouère, et ce faisant, tout à coup ! j’éclate alors gentiment de rire, tout en me remémorant l’histoire de la plus belle et naïve amourette, qu’il m’est arrivé de vivre au cours de ma trop courte jeunesse calloise et que je ne puis m’empêcher aujourd’hui de vous raconter :
C’était me semble-t-il autour des années 1954 / 1955 et à cette époque nous devions avoir atteint l’âge mémorable de 16 ou 17 ans. Dans notre bande de jeunes adolescents il y avait entre-autre : Jean-pierre et Vincent, les jumeaux Defilippi - Hubert Hisselli alias Christelli le ferblantier - Norbert et Henri Tortora, fils de tsapadoures - Louis Casalta, fils de marin-pêcheur - Gilbert Ajello, petit frère des schcarparelles Francis et Jeannot - et moi, le fils de Louise, la cuisinière de l‘hôpital…
Comme tout le monde pendant la saison de l’été, nous fréquentions tous les jours - la plage de l’usine - le cours Barris - les bals… Sans négliger un seul instant et à l’instar des autres adolescents, de reluquer discrètement et avec convoitise les charmantes petites jeunes-filles de la cité, en laissant libre cours à notre imagination en ébullition qui n’arrêtait pas de nous tourmenter, en bâtissant à l’infini quantité de fantasmes extraordinaires que nous vivions - au beau milieu de fabuleux châteaux en Espagne.
C’est ainsi que nous nous retrouvions très régulièrement en bande, pour vivre ensemble ce fantastique cinéma paradiso de l’été.
Lorsque au terme d’une chaude soirée, alors que le Cours était devenu désert et que les commerces s’apprêtaient à fermer, on s’installait calmement assis sur le parapet, pour deviser consciencieusement et faire le bilan de la journée. Alors chacun disait sérieusement la sienne et parlait naïvement avec passion de ses exploits, en introduisant dans ses envolées lyriques moult fioritures dans le genre :«tu as vu comme elle m’a regardé ? Tu as vu comme elle m’a souri ? Je vous jure sur ma sainte communion ! Ma parole, je me l’ai amorcée sans même lui jeter du brometche…» et patati et patata… et schpake comme on disait là-bas… et pourtant dans ces moment de confidences, tour à tour chacun enrichissait son histoire à sa manière, sans que jamais l’un ou l'autre d’entre-nous n’aurait pensé à ironiser !
Un soir tard alors nous tenions notre habituelle conférence sur un coin du parapet, il s’est trouvé que l’un des nôtres nous est apparu soudain bien émoustillé et le cœur tout gonflé d’un fol espoir ? Il est vrai que ce soir-là nous l’avions aperçu causant un court instant, en charmante compagnie d’une belle et très mignonne jeune personne - que nous ne connaissions pas… Le fidèle parapet de ces fins de soirée faisant également office de confessionnal et puisque dans notre bande de copains, il était de tradition sacrée de ne jamais rien se cacher, nous eûmes tôt fait d’entourer le Casanova du jour pour entreprendre consciencieusement et avec curiosité, un interrogatoire qui se voulait en règle : «Alors ! Tu as fait une touche ce soir ? Mais qui c’est celle-là ? On la voit parfois sur le Cours, mais c’est pas une calloise ! Tu sais d’où elle est ? Elle est pas mal du tout cette petite : élancée, des cheveux longs presque blonds, enfin disons châtains, un beau visage attirant et surtout de beaux yeux…» etc. etc.
Loin d’être agacé par nos questions l’heureux élu - ou supposé tel ! - était aux anges et nous répondait d’une voix pleines de mystérieux sous-entendus. Alors l’interrogatoire reprenait de plus belle, pour essayer de tirer les vers du nez à notre ami qui du reste ne demandait que cela. Au bout d’un moment il cracha le morceau en articulant bien ses mots, afin que nous puissions en saisir parfaitement tout le sens, ce qui devait jeter comme on s'en doute un profond trouble parmi nous. Il nous dit alors en substance et sans se démonter : «demain à onze heures, elle m’a donné rendez-vous !!! » Un rendez-vous ! Pas possible ? Oui, parfaitement ! la petite caille lui avait bien donné rendez-vous le lendemain... Et alors ! Et alors ? Malgré notre insistance et le serment collectif sur la sainte communion de ne rien révéler à personne, il resta fermement sur sa réserve refusant obstinément de nous confier le lieu de cette rencontre. Peut-être craignait-il que nous entreprenions de le suivre en catimini et par cela même lui casser le travail, alors qu’il n’en était qu’aux prémices de sa petite amourette ?
Il était passé de minuit lorsque la voix cristalline de Saint-Cyprien, nous renvoya sans discussion dans chacun nos foyers… Mon Dieu que la nuit fût longue et hantée par tous ces rêves fous, qui sentaient bon toute la passion de notre jeunesse. Chacun de nous était à se demander pourquoi ? Il n’avait pas la chance de vivre une petite aventure amoureuse - à l’instar ce veinard de copain ? !
Dés le lendemain, arrivés sur la plage un peu moins frétillants que d’habitude, nous fîmes le constat que notre illustre Casanova de la veille et néanmoins ami de toujours - manquait à l’appel : le héros du jour avait proprement disparu sans laisser de traces, ni laissé le moindre message… Pour toute la bande abasourdie le coup était dur à encaisser et pour l’heure il ne nous restait plus qu’à se borner de faire tout le long de la journée, les plus fantastiques et mystérieuses conjectures.
Au coucher du soleil il devait subitement réapparaître sur le Cours Barris, en affectant avec beaucoup d’ostentation un air tout guilleret qui manifestement nous paru des plus malicieux et ressemblait fort à un profond bonheur. C’est naturellement par discrétion bien artificielle mais enclin d’une curiosité non contenue, que personne de la bande ne lui demanda comment s’était passé le fameux rendez-vous avec sa belle. Ce n’est que bien tard en fin de soirée et dans le secret du vieux parapet qu’il devait sur le ton de la confidence, nous entretenir du succès incontestable qu’il avait acquis auprès de sa conquête… Alors il devait nous instruire en détail sur tous ses faits et gestes de ces dernières heures, mais aussi des péripéties concourant à l’heureuse rencontre avec l’élue de son cœur.
Comme nous le savions déjà cette jeune et charmante enfant n’était pas de La Calle, mais résidait au Tarf tel que notre copain nous l’avait enfin révélé. Mais il faut dire que ce petit village situé sur la route de Bône, se trouvait à une distance notable de près de 18 km de notre cité. A cette époque compte-tenu des moyens de communication, on peut dire sans exagérer que ce n’était pas la porte à côté, surtout, pendant la chaleur torride de l‘été, ce qui pour autant n’avait pas empêché notre valeureux Roméo, de partir ce jour-là perché courageusement sur une vieille bécane dite de course empruntée à son frère aîné.
Mais il est utile de revenir un instant en arrière, pour admirer combien à cette époque de notre jeunesse, l’imagination d’un adolescent amoureux pouvait l’entraîner à réaliser certains exploits, qui feraient peut-être sourire les jeunes d’aujourd’hui : la nuit portant conseils notre héros dormit très mal, mais, dans le clair-obscur et le silence de sa chambrette, il devait mettre à profit ce semblant d’insomnie pour dresser consciencieusement dans sa tête, toutes les plus belles et subtiles stratégies à employer le lendemain, pour se faire aduler éternellement par sa délicate pervenche.
Les coqs du bastion venaient à peine de se mettre à chanter et le soleil commençait seulement à poindre derrière l’horizon, lorsque sans faire de bruit le jeune-homme quitta discrètement son logis en poussant son vélocipède devant lui. Il devait alors prendre la direction des petits quais au lieu-dit en bas la marine, avec la ferme intention de se mettre en quête de coquillages, afin de pouvoir fraîchement les cueillir de grand matin au bord de l’eau. Car il faut dire, que sa Juliette lui avait indiqué la veille au soir, qu’elle entretenait depuis toujours un fol amour pour les arapelles, qui malheureusement manquaient dans son village du Tarf. Qu’à cela ne tienne, c’est avec l’empressement qu’on peut s’imaginer, que notre ami se proposa de lui en apporter sans faute dés le lendemain matin... Tel était l’objet du fameux rendez-vous galant : livrer quelques coquillages tout frais pour être agréable à sa belle et ainsi l’approcher de plus près dans l’espoir d’être peut-être un jour prochain l’élu de son cœur.
A la grande et totale satisfaction de l’adolescent, la récolte des fruits de mer tant convoités devait s'avérer excellente et pour assurer leur transport par route dans de bonne conditions, notre compère les avait soigneusement rangé à la façon des pêcheurs, c’est à dire, dans un grand et solide mouchoir à carreaux, dont il avait soigneusement noué les quatre coins. C’est ainsi qu’il devait prendre la route en direction du Tarf avec la précieuse marchandise suspendue au guidon de son vélo, alors que déjà le soleil commençait à darder de ses rayons toute la nature environnante et accabler d’une chaleur torride tous ceux de ses habitants, qui oseraient le défier - ce qu’un enfant du pays ne pouvait ignorer !
Autant dire que notre vaillant cycliste ne fut pas épargné par la canicule, laquelle, devait rendre le chemin particulièrement long et laborieux. Mais notre ami tout gonflé du bonheur qui l’attendait, pédalait toujours de plus belle en transpirant tant qu’il pouvait. Dans sa tête surchauffée par le soleil de l'été, il répétait sans cesse tous les scénarios que pendant la nuit, il avait soigneusement montés à l’intention de sa belle. Il était fin près à affronter l’aventure sentimentale qu'il espérait, lorsque au loin devait apparaître les clochers du village. Arrivé à destination il s’empressa à la manière des coureurs du tour de France qui battait alors son plein, de faire une entrée très remarquée par un tour de ville triomphant, pour repérer les lieux que lui avait indiqués la veille au soir la douce et charmante donzelle.
Enfin ! Le moment tant attendu arriva : il stoppa net devant une maison du village, pour loucher un moment sur la boite aux lettres qui figurait sur la porte d’entrée. A cette heure tout était silencieux dans le quartier et il était bien devant le château de sa belle au bois dormant. C’est le cœur battant la chamade qu’il entreprit enfin de toquer discrètement sur l’huis, qui devait alors s’ouvrir lentement pour laisser apparaître le frais minois de l’objet de ses amours d’adolescent. Surprise d’abord de voir ce garçon avec qui elle avait à peine causé la veille, elle devait malgré tout le gratifier d’un beau sourire.
Après les salutations d’usage sur le pas de la porte, notre Éros Callois entama sans transition et sur le terrain, le premier chapitre du scénario qui lui paru convenir le mieux à la situation présente. Sans bégayer un seul instant puisque récitant les phrases qu’il avait déjà concoctées pour sa belle, il fit sur un air détaché une entrée en matière sur son trajet qu’il avait dit-il bouclé sans aucune peine, par deux coups de pédales de son fidèle vélocipède spécialement taillé pour la course - disait-il avec un semblant de modestie, mais aussi avec quelques fierté…
Puis vint le moment de la remise des présents à la princesse adorée, dont le déroulement officiel était aussi très bien codifié au chapitre second du scénario choisi : le grand mouchoir à carreau encore humide et tout gonflé de ses fraîches arapelles, fut décroché du guidon et remis cérémonieusement entre les douces et blanches mains de la jeune fille, qui devait d’abord manifester quelque étonnement, faisant vite place à la gourmande satisfaction de découvrir ses fruits de mer préférés.
Toujours maintenu sur le pas de la porte, notre illustre cycliste attendait la suite des évènements, pour sortir enfin le troisième chapitre du scénario concocté. Les préliminaires et le reste de la pièce étant épuisés, la belle pervenche demanda au joli-cœur ce qu’elle pouvait bien lui offrir en remerciements. Comme la chaleur qu’il avait subie sur la route l’avait manifestement quelque peu desséché, c’est avec beaucoup de délicatesse et conformément à son scénario, qu’il sollicita modestement un grand verre d’eau bien fraîche si possible aromatisé de sirop.
La dernière goutte de ce frais breuvage pris sur le pas de la porte de la maison qui abritait l’aimée, devait sonner alors la fin du rendez-vous galant, puisqu’il était déjà près de midi lorsque mettant un terme à la conversation, la douce tourterelle donna poliment congé à son pigeon voyageur. Au moment de refermer lentement la porte elle devait lui dire en clignant malicieusement de son œil de velours :«Et maintenant, je vais me régaler !…» Sur ces dernières paroles, il ne restait à plus à notre Tristan de quitter son Iseult bien-aimée et de reprendre courageusement le chemin du retour sous un soleil de plomb.
Lorsqu’il arriva enfin à son domicile près de la caserne, le jeune-homme était notablement déshydraté par la canicule, mais aussi épuisé par l’effort déployé pour faire avancer sa fameuse bicyclette de course. Comme un amant qui s’est beaucoup dépensé avec sa belle au cours d’une nuit brûlante et chaude, il devait s’affaler à même la douce fraîcheur du sol pour une sieste qui se voulait réparatrice.
La nuit était peut-être sereine et le fidèle parapet témoin habituel de nos conciliabules enflammés ne disait mot. Mais à nous, ceux de la bande, qui avions écouté sans interrompre un seul instant la narration de notre ami, il appartenait de mettre notre grain de sel dans cette affaire, autrement dit - jouer à tour de rôle l’avocat général, pour quelques bonnes objections bien placées.
Le premier qui ouvrit le bal devait lui lancer la première flèche :«Ton aventure est belle Vincent, mais dis-moi un peu - tu appelles ça un rendez-vous ! ?»
Sans même lui donner le temps de répondre le deuxième lui dit :«Tu t’es cassé les reins sur les rochers à ramasser comme un pauvre esclave, une poignée d’arapelles pour une fille que tu ne connais pas et qui n‘habite même pas chez nous à La Calle ! ?
Et ouais ! dit le troisième :«C’est des fleurs qu’on apporte à sa béguine, quand on lui donne rendez-vous ! Moi je n’ai jamais entendu dire que c’était des arapelles !»
Approbation quasi générale de la bande et le quatrième lui dit sans ambages : «Oh, cousin ! Par hasard, tu crois pas qu’elle t’a peut-être pris pour un calamar ! ?»
Sans même lui laisser le temps de se défendre, le cinquième rua dans les brancards en ajoutant sentencieusement : «Comment ! ? Tu te tapes en plein soleil tout ce chemin sur le vieux vélo de ton frère et elle te laisse comme un mendiant devant la porte, sans même t’inviter à rentrer un instant dans la maison familiale ! ?»
Le sixième intervenant c’était moi et comme je remarquais qu’il commençait à s’affliger, je lui susurrais très gentiment : «Si tu ne lui avais pas demandé un verre d’eau fraîche, elle aurait eu le courage de te faire partir sans rien t’offrir ! Pour moi, l’amour c’est pas ça !»
Alors à l’unissons et à la queue leu leu chacun de lui dire avec solennité : «Tu vois pas qu’elle t’a pris pour un con et qu’elle a profité de ta gentillesse pour se faire passer l’envie des arapelles !»
Un autre il lui lance d’un air courroucé : «J’espère que ces putains arapelles elles avaient le goût du mazout et que ça lui a donné la cagarelle pendant une bonne semaine ! ?»
Son voisin encore plus en colère que l’autre, il conclut la plaidoirie générale en clamant dans le silence de la nuit : «Porca misère ! La prochaine fois porte-lui un sac de gatsoumarines pour qu’elle se les mette quelque part !»
Assis tristement sur le parapet du cours Barris, notre vieux copain d’enfance déjà fourbu par sa randonnée nous est apparu soudain bien abattu, par toutes les vérités qui fusaient de sa bande d’amis de toujours. Il savait très bien que ce n’était pas par un sentiment de jalousie, que nous lui avions tous donné notre avis sur l’épopée qui l’avait conduit au Tarf, pour y rencontrer ce qu’il croyait naïvement être - le grand amour de sa jeune vie… C’est ainsi que très rapidement chacun d’entre-nous dédramatisa la situation, pour redonner enfin le sourire à notre ami et compagnon d’infortune. Car il faut bien le dire, ce qui lui était arrivé en ce jour funeste devait aussi arriver à chacun de nous, un jour ou l’autre au cours de notre belle jeunesse Calloise. C’est pourquoi, dans les suites immédiates de cette affaire de cœur au parfum de fruits de mer, nous avions alors manifesté beaucoup de solidarité et de compassion pour notre cher et estimé copain, en lui affirmant avec beaucoup de sincérité dans la voix que toute compte fait, cette fille - n’avait aucune classe - qu’elle n’était sûrement pas faite pour lui et qu’il méritait mieux - qu’elle était un peu maigrichonne sur les bords - que son nez paraissait un peu long et crochu - par ailleurs elle n’avait même pas de jolis yeux et que son sourire était bien fade... En quelque sorte nous voulions lui dire à l’instar de M. Jean de La Fontaine, que : «Les raisins étaient trop verts et bons pour des goujats !» Alors pour tenter de le consoler, on s’est empressés de lui inventer gentiment et sans aucune ironie plein de béguines, dont on lui affirmait le plus sérieusement du monde, qu’il ne s’était même pas aperçu qu’elles n’avaient des yeux que pour lui. Puis chemin faisant, on terminait toujours notre sermon sur un air docte, en lui soufflant doucement dans les oreilles une vérité proverbiale, à laquelle et ceci dit entre-nous, il nous était quand même difficile d’adhérer pleinement : « Guaglione ! laisse tomber et oublie-la ! Une de perdue, c’est cent de retrouvées !»
Et pourquoi ne pas en retrouver mille - porca misère ! ? Et schpake que je te schpake abondamment et le mot de la fin revenait toujours au fils de Cyprien le plombier, lequel, apparemment très instruit sur la question, se mettait à déclamer avec une passion toujours affirmée : «Une femme est une cigarette que l’on fume et que l’on jette !» Alors en définitive les sourires revenaient sur les lèvres et tout le monde était satisfait sous le ciel étoilé d’une belle nuit de l’été. D’ailleurs dés le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil réparateur du corps et de l’esprit, tous les Casanova en herbes du Bastion de France le cœur tout rempli d’une folle espérance, étaient de nouveau prêts à descendre dans la même arène, pour affronter de nouvelles aventures sentimentales et bâtir de nouveaux châteaux en Espagne.
C’était ainsi autrefois pendant l’été dans ces temps heureux notre jeunesse folle. Combien de ces tendres amourettes et de ces touchants chagrins d’amour d’adolescent n’avions-nous subis ! ? Il faut dire cependant, que ces naïves et puériles idylles amusaient toujours gentiment nos aînés, lesquels, bien que songeurs, souriaient au passage noyés dans leurs souvenirs, qui peut-être leurs faisaient revivre un moment leur jeunesse avec nostalgie. Alors discrètement et à leur tour, ils s’empressaient autant que faire se peu pour venir paternellement nous consoler, en essayant de dédramatiser la situation - qu’ils qualifiaient d’enfantillages.
Cette petite histoire s’adresse à tous ceux de chez nous, parce qu’elle est certainement arrivée un jour à bien d’entre-nous. Je n’oublie pas non plus d’avoir une pensée pour les douces et frileuses petites amourettes, j'ai nommé celles des soirs d’hiver ventés et pluvieux de jadis. Mais ça, voyez-vous ! c’est une autre histoire que pourrait discrètement vous conter le célèbre cours des saucisses, alias, rue de Verdun... mais aussi avec beaucoup plus de discrétion, le coquin parapet toujours tapi dans l’ombre complice des brisants.
Pour terminer ma petite histoire d‘un autre temps, il me semble que j’entends chanter d’une voix de velours, mon cher et estimé cousin Francis di Jacomino +, quelque part dans le lointain de sa Presqu’île de France en Barbarie et pour conclure ma petite histoire en souvenir de toutes les belles et petites amourettes d’antan, voilà ce que devait me répondre en écho sa douce et tendre romance :
J’avais 20 ans.
J’avais 20 ans pour les yeux d’une femme
Un mot d’amour faisait battre mon cœur
Pour être aimé j’aurais donné mon âme
Et de mon sang j’eus payé ce bonheur.
Je vous voyais mesdames toutes belles
Je confondais l’automne et le printemps
Je vous croyais aussi toutes fidèles
Que je voudrais encore avoir 20 ans.
De la beauté je chantais vos louanges
J’avais 20 ans je les chante toujours
Moi qui croyais n’adorer que les anges
Aujourd’hui j’aime à chanter leurs amours
Tout compte fait vous êtes bien aimantes
Et vos atours sont toujours séduisants
Plus je vieillis plus je vous vois charmantes
Que je voudrais encore avoir 20 ans
Plus je vieillis plus je vous vois charmantes
Mais je voudrais mais je n’ai plus 20 ans.
Mais avant de tirer avec regret, les rideaux qui masquent la fabuleuse scène du passé, j’ai très envie de hurler un moment à la lune, pour dire en me faisant bien entendre à la ronde, que moi aussi : «Pour une amourette qui passait par-là, j’ai un jour perdu la tête…»
Avouons-le enfin mes amis, mes compagnons, mes frères du Bastion de France et laissez-moi un seul petit instant m’interroger à votre place, pour demander : «Qui d’entre-nous aujourd’hui encore, peut-il se targuer d’avoir effacé de ses souvenirs d’antan, une seule petite amourette qui était bien trop jolie, pour être à jamais oubliée dans un coin sombre de sa mémoire ? !»
En tous cas pas moi je vous l’assure et sûrement pas vous je vous le jure !
Que celui qui gentiment me contredira, puisse me jeter la première pierre s’il ne craint pas de faire un horrible sacrilège et de s'attirer toutes les foudres des Dieux du Bastion de France.
Douce et tendre amourette de ma jeunesse Calloise. Ah ! si tu pouvais un jour revenir tout près de nous, pour rafraîchir l’âme des exilés que nous sommes.
Docteur Jean-Claude PUGLISI
de La Calle de France
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage.
Giens- 83400 HYÈRES.
Le 24 février 2005.
|
|
|
OÙ SONT PASSEES NOS FENETRES D’ANTAN !
Envoyé par M. Georges Barbara
|
 NA: NANO... Ancien docker
NA: NANO... Ancien docker
PA: PACHCALE ... Garçon de Café dans sa jeunesse
.
C’est par un beau dimanche après-midi, en attendant d’aller faire leur éternelle partie de cartes, que nous retrouvons deux vieux Bônois, assis sur un banc du petit jardin de la colonne.
Issus de parents venus en son temps de Sicile…et de Calabre, Nino et Pachcale d’une génération de nos jours presque entièrement disparue, discutent d’une chose et d’autre pour tuer le temps. Et y fait beau bien sur, comme toujours chez «NOUZOTE ! »
NA *- » Dis moi Pachcalou, j’sais pas si t’le sens com’moi, mais : ( en italien ) « Non siamo piu una grande famiglia « …...on a plus cette familiarité entre Bônois comme on avait avant, y nous manque c’te poesie à nous qu’on avait tous les jours à La Colonne ! Te sais comme y te disent à la télé « ce théatre à la Pirandello ….. Notre théâtre à la Pirandello !. Cet endroit où on te passait not’vie, c’était une grande famille. Et ben tout ça ,o frade il a adebon disparu !
PA*- » Ouille m’an qu’est-ce te vas chercher là Nano Diomadone. Et pis d’abord, qui c’est ce cats de Pirandello ? Y te viens des fois au Café le dimanche ? On s’le connaît ?
NA*- »Diocane, attends que j’ t’esplique, ô Gougoutse de mes deux ! Pour nous les anciens, ça qui nous permettait cette vie de famille et ben c’était les fenêtres, ouais les fenêtres mais les fenêtres d’avant, qu’elles étaient beaucoup plusse mieux. Pas comme celles de métenan. Celles a’c les persiennes en bois, faites par le munusier Fiténi. Y t’les ont remplacées par un truc à quatre sous en PCV, a’c le volet qui te monte et qui te descend tout seul, mais que ça veut rien dire. Et en plusque, leur machin y te fait un madone de bordel quand y te souffle le bafougne !! Nous dans notre quartier d’la rue des Prés salés à la Colonne et ben y’avait à bloc des fenêtres. Un peu comme les arènes qui z’ont laissé les Romains à Hippone.. On se parlait par la fenêtre, on s’envoyait des choses par la fenêtre, on t’entendait Tino Rossi qui te chantait Marinella par la fenêtre de Lilou, et c’est vrai aussi des fois on se disputait par les fenêtres, les canemourtes y te volaient de fenêtres en fenêtres !.
Deux z’ou trois fois y’en a même qu’y se sont jetés de la fenêtre,,, et oui, qu’esce tu rigoles toi c’est vrai, on se suicidait à l’ancienne nous. Et entention les yeux quand les pastèques a te faisaient la lessive a te venait blanche blanche dessur les fils de fer des balcons que t’yaurais dit les voiliers du sport nautique !! Et en plusque la fenêtre de ce temps c’était l’endroit où tout le monde y communiquait. C’était notre internet de main’nan et ça qu’y z’appellent VINDOSSe eux les jeunes, et ben ce mot à la 6 4 2 lui y te descend du mot Bônois fenetre, . Et oui VINDOSSE, Nano mon petit fils lui qu’y l’a le cerfiticat et qui connaît tout, y m’a dit que ce mot des anglais y veut dire fenêtre. Donc pour leur fenêtre à eux y z’ont fait ni une ni deux, ces effrontés y z’ont copier t’sur note mot Bônois !
Mais oujourd’hui leur fenêtre c’est pas plusse mieux, a veut plus rien dire, te sais ?.. Dans le temps quand t’youvrais une fenêtre le matin t’sur la rue, diocane la vie la vraie vie….. a te reprenait vie comme j’te dis !
J’te jure je m’arrappelles et on dirait que j’t’l’entend encore en dedans les oreilles … Qand la Fifine a te criait pour faire monter le moukouze de son fils Jojo.« Tu montes Ô daindalon de mes deux ou je descends et je te démonte »
PA- » C’est com’tu dis, t’youblie pas aussi la Titine, celle la la qu’on appelait « Persi » toujours au milieu d’la farce,,, curieuse comme une canule à lavement,,, pour elle Diocane et ben la fenêtre c’était comme une télé sauf que c’était elle c’te Galinette des grands fonds qui faisait les commentaires. Et tu t’arrapelles o frade quand y venait monsieur Xicluna le facteur a’c ses mains en porte voix qui criait « Ô MADAME BELLEVISO VOUS AVEZ UNE LETTRE DE VOTRE FILS TOINOU ! ». Si je sais que c’est lui c’est que j’ai roconnu son écriture qu’il écrivait a debon comme un docteur t’sur les ordonnances, que te comprends rien. Et pis j’étais dans la même classe que lui ! » Alors la vieille a’c une simple lettre a te faisait sortir tout ton monde à la fenêtre, pour te partager sa joie ! Tout le monde y z’étaient contents pour elle michkinette.
NA*- » Et tu t’arrappelles quand y te passait le marchant d’journaux a’c toute cette smallah des petits autour, et qu’y criait « DEPECHE DE L’EST » « DEPECHE DE L’EST ! « Alors toutes les têtes penchées aux fenêtres y z’écoutaient comme à la messe madame Attanasio que c’était la seule qu’y t’achetait le journal, qu’elle te lisait les dernières décisions du conseil municipal qu’y z’allaient te couper l’eau deux heures par jour ! Et quand elle avait fini, la rue çà devenait comme à l’assemblée Algérienne.
Chaque Gougoutse y te mettait son grain d’sel. Et laisse qu’elles te balançaient les calembours « Et cats ça rocommence pour l’anisette y te trouvent bien de l’eau tous ces bras cassés, ces fainiants qui sont à la mairie».
PA*- » OUAIS ? OUAIS ! Et quand y passait le vitrier te sais le Gitan d’la cité aux z’as, çula que son beau frère Manouel y te vend les bons z’oublies enbas t’sur la place des gargoulettes !, Et ben ce tchoutche y criait tellement fort qui te faisait trembler les vitres et dieu préserve si t’yen avais une qu’elle était félée,,, Diocane entention les ‘oitures !
Et pis te sais quand t’ youvrais ta fenêtre pour la 1ère fois le matin, grâce à dieu qui fait bien les choses, on se croirait vraiment à la campagne t’yentendais les poulets du marchand arabe qu’y te descendait des beignets ramassés pour vendre ses poules vivantes. Métenant pour te trouver des poulets vivants comme y disait Binguèche, y te faut aller au commissériat d’la rue Garibaldi. Et encore, y te faut attendre qu’y te finissent la sieste !
NA*- » Et c’est comme pour les invitations, arappelle toi o Frade, on se les donnaient par la fenêtre de bouche à oreilles, main’nant y te leur faut un tas des salémalekes, avec des papiers qui z’ont les lettres dorées, tu te rends compte toi !
C’était« « o martine tu descends ce soir, on va à Joanonville ya la fête des Concombres « Non ma Fi vas y avec ta sœur comme ca vous serez les reines du bal ! ». C’est comme la solidarité même ça on se la faisait par la fenêtre, tu t’arrapelles de Fifine qui criait « Ô madame Patalane vous avez besoin de queque chose oujourd’hui ? Moi Je vais envoyer Mahmoud le p’tit arabe à l’epicerie de chez lolo Attard le maltais,,,, ?
« Oui belle achète moi 4 zeus et une livre de pommes de terres et rogards si Lolo y peu te faire cadeau d’un bouquet de persi ! j’ai les petits à midi, comme ça et ben je leur ferai une omelette. Alors la mémé a te descendait le panier par la fenêtre, avec une ficelle et endedans le panier, yavait le porte monnaie !!! Le porte monnaie ? Qui cats de nos jours y va te mettre le porte monnaie non seulement ils te le volent le porte monnaie mais en plusque ils te tirent sur la ficelle pour te faire tomber la vieille, ces mal appris, de nos jours où c’est que nous s’en allons dis moi un peu. Dieu préserve o frade !
Arappelle toi aussi vers 10 h du matin pour la fête de Sainte Anne, quand y l’arrivait dans le quartier Monsieur Vento le beau père à Jeannot a’c sa fanfare des cors de chasse des pompiers, qui venait chaque année jouer pour la fête. Au fond de la rue ma Fi, t’yaurais dit un moment magique t‘yavais toutes les fenêtres qui s’ouvraient une par une, tout le monde y se penchait et y tapaient dans les mains ! Mais t’yavais toujours cette cherche merde de Titine qui avait le courage de crier : »
« Et o toi le musicien tu peux pas jouer un peu moins fort que c’est jeudi et que j’ai le petit qui dort » ! O celle là, à 11 heures elle a son petit qui dort encore et ben si yen a qui disent que la musique elle t’adoucit les mœurs, va fangoule !
PA » Et pis les soirs d’été a’c toutes ces fenêtres ouvertes c’était le bien de dieu qu’y l’était dans la rue un vrai cinéma. Que nous entrain de prendre le frais on t’entendait cogner les cuillères dans les assiettes, la vieille chcouniatte de conchette au rez de chaussé qui s’affoguait quand elle mangeait, la musique au 2ème chez Luluce, le petit macro de Cissou qui voulait pas dormir et surtout la bagarre tous les soirs de Marceau qui l’était toujours de gaz après manger. Et comme y disait Paris Soir « çuilà y l’est capable de te boire une bouteille de vin sans la déboucher ! » Et enfin et surtout les soupirs à plus finir de cette bella gamba de Chounette ….. celle là alors tous les soirs…. Enfin c’est son droit non ?. Et ben tout ça o frade ça me manque et à toi, o daindalon y te manque rien ? Non ?
NA- » Et Diocane bien sur que ça me manque aussi ! Et souvent je me dis si je pourrais encore ouvrir ma fenêtre comme avant, c’est que mes rumatises y seraient partis !
PA*- » Tiens ouallioune métenan aramasse ton calot, je crois que notre ami Tchitche y l’est rentré au café pour la partie de cartes qu’on doit se faire, et oujourd’hui fais un peu entention quand tu joues, que la dernière fois te m’a fais manger le sang, parc’qua debon on se serait cru dans le film de Marcel Pagnol !…
Allez que nous s’en allons et que Saint Augustin y te fait que ce temps des fenêtres y te rovient !
Georges Barbara, janvier 2024
|
|
SOUVENIRS DE LA-BAS
Par Henri PEREZ
Echo de l’Oranie N° 267
|
|
LA LESSIVE DE CHEZ NOUS
OU "C'EST BEN VRAI ÇA"
Tout d'abord comment les appelaient-on: blanchisseuses, laveuses ou lavandières comme au Portugal ? La différence était minime mais elle existait. La blanchisseuse était simplement la personne chargée de laver et blanchir le linge, la lavandière faisait le même travail avec un plus, car elle blanchissait le linge avec de la lavande : essence très recherchée autrefois et du bleu de Prusse. C'était une poudre d'indigo qui s'achetait par petits sachets chez les droguistes de la ville et était placé au bout d'une ficelle dans l'eau de rinçage. Certes, nos braves laveuses n'ont pas été chantées comme au Portugal, mais elles ont marqué pendant plusieurs décennies, certaines durant toute leur vie, la vie de nos familles. C'était les "Madame Propre" d'Oran, de Bel-Abbès ou de Saida et certainement d'autres villes et villages de chez nous et toutes ces travailleuses étaient de condition modeste, veuves très souvent sans pension naturellement mais toujours à la tête d'une famille nombreuse.
Avant la guerre de 14-18, toutes nos villes étaient dotées d'un lavoir municipal avec deux ou trois bassins en pierre de taille ou cimentés.
Les "mères Denis" ne manquaient pas et si ces bassins pouvaient parler, ils nous raconteraient les histoires drôles et salées que se contaient nos grands-mères et arrière-grands-mères d'alors !.. Des vertes et des pas mûres comme dirait ma mère !.. Il parait que ces travailleuses arrivaient avec des brouettes pleines de draps et de gros linges et repartaient le soir, harassées par le travail et traînant les pieds dans des galoches en hiver ou des « karkabs » en été, le linge mouillé en équilibre parfois sur leurs têtes quand elles n'avaient pas ou plus de place dans leur véhicule de portage !..
Plus proche de nous, avant la mère Denis et sa machine à laver, nos mères et nos laveuses faisaient la lessive à domicile dans de grandes cuves ou baquets en bois de plus de 50 litres. Sur le bord du baquet, un crochet plat permettait de placer la planche à laver. Cette fameuse planche avait des cannelures dans le sens de la largeur et elle avait plus d'un mètre de long. Les cannelures étaient légèrement arrondies ce qui permettait une meilleure prise au savon de Marseille et une bonne adhérence au linge mouillé. Dans le haut de la planche, un petit compartiment permettait de placer une brosse en paille de riz et le savon. Mouillage, trempage, savonnage, frottage, brossage et bis répetitam se succédaient jusqu'au moment de la corvée du rinçage dans un ou deux baquets d'eau claire ... C'est dans le dernier baquet et eau de rinçage que se trouvait le petit sachet de bleu, suspendu au bout de sa ficelle. C'était cette eau bleuie qui donnait au linge "un blanc plusse que blanc" et puis le soleil faisait le reste!...
Mais attention, ce n'était pas terminé, les pièces trempées et retrempées étaient sommairement essorées et mises à part en attendant le grand essorage ! Alors là, imaginez ma mère et la laveuse se faisant face, jambes écartées, un drap tout boudiné dans leurs mains, chacune tournant la pièce pour extraire le maximum d'eau pareilles à deux lutteuses ! La plupart de nos parentes faisaient ces travaux seules ou aidées de la fille aînée lorsque celle-ci atteignait l'âge et la force de donner un coup de main. Je peux vous assurer pour avoir aidé parfois ma mère qu'il n'était pas facile de tourner et retourner un drap mouillé, de l'essorer à la main, l'étendre sur le fil de séchage que l'on appelait familièrement - je ne sais pourquoi – la corde alors qu'il s'agissait d'un fil de fer galvanisé !
Ma corvée ce jour là consistait à passer un linge sur ce fil de fer qui laissait une trace noire sur le chiffon.
La corde !.. Traversait la cour ou la terrasse ou le patio... cher à Madame Angoustias et dans les grandes cours à plusieurs locataires était sujet à discussion comme les jours de buanderie d'ailleurs.
Bref, il fallait que la fameuse corde ait assez de battant pour que le linge soit convenablement suspendu, à hauteur des épaules et retenu par des pinces à linge. Dès l'étendage convenablement terminé, il fallait soulever cette corde à l'aide d'une longue perche en bois. Ainsi, le linge ne touchait pas le sol, profitait de tous les courants d'air, et du maximum de soleil ! Les pièces comme les mouchoirs, les chemises, les tricots de peau voisinaient avec les torchons et les serviettes d'où la fameuse expression familière de ne pas mélanger ces pièces ! Les draps prenaient un dernier tour sur le fil d'étendage après que toutes les autres lingeries aient été empilées dans de grand paniers en osier. Et cela séchait rapidement tant le soleil était chaud et de là-haut une odeur de propreté, de javel emplissait la cour, tandis que les canaris dans leurs cages, enivrés par le bruit de l'eau et par ces parfums à base de savon de Marseille lançaient leurs trilles en hommage à ces vraies fées du logis !
C'est avec nostalgie et respect que je pense et me souviens de ces laveuses qui tous les matins se présentaient chez les uns ou les autres.
Quelle que soit leur confession, elles arrivaient de bon matin, une dans sa robe noire et son fichu noué sous le menton, espagnole la plupart du temps, la musulmane enroulée dans son haïk, ou seul l'œil était visible, les pieds dans des babouches jaunes.
Que ce soit l'une ou l'autre, lorsqu'elles arrivaient chez nous, elles se débarrassaient de leur veste, tricot ou voile, se déchaussaient pour enfiler des bottes en caoutchouc, un gros tablier imperméable, et manches retroussées vérifiaient la température de l'eau. D’un coup d'œil, elles jugeaient la quantité de linge à laver, mais avant, un petit déjeuner copieux leur était servi, dans la cuisine. Puis, le travail commençait et ne s'arrêtait que pour la pause casse-croûte ou le repas de midi qu'elles prenaient près du feu en hiver ou dans la cour en été, à l'ombre d'une bonne vieille treille... Dès cinq heures, les derniers draps étendus, elles nettoyaient la buanderie, les baquets étaient vidés et rincés, la lessiveuse placée, le feu éteint. C'était fini pour la journée. Mais pour elles, il leur restaient leurs propres travaux domestiques les concernant. Elles repartaient chez elles, les mains ridées par l'eau de lessive et si l'une serrait dans un vieux portefeuille noir les billets de sa paye, l'autre attachait son argent dans un grand mouchoir à carreaux qu'elle enfouissait dans la poche de son sarouel...
Le progrès a chassé ces travailleuses et les machines à laver ont remplacé Paquita, Meriem ou Sarah...
Chacun faisant sa lessive mais, rares sont les familles, dans les villes, qui peuvent étendre leurs linges comme là-bas.. Avec la tchatche de la voisine et le soleil qu’il convient de surveiller, car il est rare que le jour de la lessive ici, il ne se mette pas à pleuvoir!..
A toutes ces travailleuses du temps passé, pour les sacrifices qu'elles subissaient et la dose de courage qui leur fallait pour faire vivre leur famille, je leur souhaite une retraite heureuse entourée de leurs familles...sans rhumatismes et les pieds au chaud..
Henri PEREZ
| |
FORESTIERS EN ALGERIE
par Régis Exbrayat
ACEP-ENSEMBLE N° 290
|
La plus grande partie des forêts d'Algérie est domaniale. Des maisons forestières ont été implantées dans les zones sensibles et sur certains sites.
Elles sont plus ou moins desservies par des chemins muletiers, des pistes, des routes. Les gardes forestiers les habitent avec leurs familles, leurs logements pour la plupart datent de la conquête, sans eau courante ni électricité. Ils ont comme principale mission la protection de la faune et de la flore. Ils doivent surveiller les chantiers de coupes, de reboisement, les charbonnières, s'opposer aux coupes clandestines, aux pacages destructeurs des caprins, surveiller les règles de la chasse, etc.
Ces hommes à I'habit vert parcourent chaque jour à cheval, souvent à pied l’immensité des massifs montagneux dont ils ont la garde. Leurs moyens sont dérisoires, un cheval pour monture, leur armement réglementaire se compose d'un pistolet 92, d'un mousqueton et d'un sabre. Aucun moyen moderne n'est à leur disposition, ils doivent souvent parcourir de longues distances pour téléphoner et s'approvisionner.
Leurs épouses mènent une action bénévole d'aide médicale auprès des indigènes Nous devons rendre l’hommage qu'ils méritent à ces hommes et à leurs épouses, isolés dans leurs montagnes, menant une vie rude et dangereuse avec courage et abnégation, afin de protéger nos belles forêts. Leur tâche est la plupart du temps mal comprise par les populations montagnardes, Chaouïas et Kabyles qui peuplent les massifs forestiers.
Souvenirs
Afin d'aider sa famille, des paysans assez pauvres, mon père avait travaillé dans les mines de Saint-Etienne, avec les papiers de son frère plus âgé. Ensuite, sous les ordres de Lyautey, il s'était engagé, pour trois ans, au Maroc où la pacification était difficile dans le Riff. Dès la fin de son engagement il fut aussitôt mobilisé en août 1914 et participa à la Grande Guerre, dont la bataille de Verdun, agent de liaison entre le fort de Vaux et Douaumont, puis six mois en occupation en Allemagne. Blessé et gazé, il a eu deux citations. Son frère Régis fut tué près de Commercy en 1916, Pierre son aîné mourut en 1926 à la suite des terribles blessures reçues pendant la guerre. Johannes, bien plus jeune que ses autres frères, prisonnier en 1940, resta en captivité jusqu'en mai 1945.
Revenu à la vie civile, mon père fut nommé en 1920 « Garde Domanial des Eaux et Forêts » au cantonnement de Collo. Il s'est marié en 1921.
Je me souviens de cette maison forestière de Demnia, sans eau ni électricité, du brouillard chaque matin, de l'Oued Guebli à environ deux kilomètres. Un chemin reliait la maison forestière à la route Philippeville-Collo. Nous avions un sanglier apprivoisé qui suivait notre chien Stop. Ce dernier fut écrasé par le seul autocar assurant le service des voyageurs et le courrier et ce fut pour moi une grande tristesse.

Mon père pour ses tournées avait un cheval Sultan. Il se rendait pour le démasclage des lièges à environ trente kilomètres de son poste et couchait alors sous la tente. En période d'incendie, du 1er mai au 30 septembre, il ne fallait pas s'éloigner de son poste, sauf en cas de travaux ailleurs. Il y avait des postes de vigies sur les hauteurs pour signaler les incendies. En 1926, il fallut évacuer la maison forestière très rapidement. Des militaires avec des branchages près de la route essayant d'éteindre le feu. Cette année là, 18,000 hectares brûlèrent au douar Tokla, à environ 20 kilomètres de la maison forestière.
A cette époque un grand nombre de postes étaient isolés. Chaque maison forestière était dotée d'une cantine à pharmacie, on donnait des médicaments et particulièrement de la quinine. Les forestiers aidés de leurs épouses soignaient les indigènes, désinfectaient les plaies, faisaient des pansements. Dans les cas plus graves les malades ou blessés étaient transportés à dos de mulet pour recevoir les soins d'un docteur. Lors du ramassage des figues de barbarie, les disputes étaient nombreuses, des rixes qui se terminaient par des coups de « boussaadi ». D'une mechta à I'autre il existait un antagonisme féroce.
Tous les dimanches se tenait un grand marché à Tamalous à environ six kilomètres.
Mon père à cheval, traversait l'oued Tamanart, soit pour poster les plis ou se rendre à un chantier MF de Tegziren et El Ala. Dans cet oued il y avait des truites. C'est un inspecteur des Eaux et Forêts, au début du siècle, qui apporta des alevins de la métropole. La côte était très poissonneuse et les fruits de mer abondants. Les indigènes à cette époque mangeaient le gibier, mais peu de poissons qu'ils vendaient.
Quand j'étais plus grand j'allais à la plage, il était facile de prendre des petits poissons, et sur les rochers, commencement de la grande presqu'île, beaucoup de coquillages. C'était une période heureuse, j'écoutais, comme les autres enfants des récits de la Grande Guerre. Cela nous impressionnait beaucoup.
Je remarquais en grandissant dans le village des personnes invalides. Près de la mer, le climat était humide, ma mère souffrait des nerfs, après ce fut le paludisme.
Je me souviens du décès de notre voisin. Il y eut beaucoup de monde aux obsèques : des fonctionnaires militaires, un grand nombre de musulmans, le cimetière était à plus de trois kilomètres.
Mon père assurait I'intérim. La commune mixte en plus de la commune de Collo représentait une étendue très importante, très peuplée, difficile d'accès, ses limites allaient jusqu'à 30 à 40 kilomètres de Collo.
A proximité de la maison forestière, il y avait une grande place de dépôt, pour les lièges stockés, venant des différents triages. Les piles de lièges stockés très longues étaient alignées et bien empilées. Une plaque indiquant ses qualités et origines. La production était importante et provenait des triages de la brigade. Les postes étaient situés à environ vingt à trente kilomètres de Collo, dans l'Atlas Tellien.
Mon père m'emmenait parfois en me faisant monter sur son nouveau cheval Pompon, en tournée à proximité. La forêt contenait de nombreux oliviers, mon père chassait quelques grives. Le gibier était très abondant dans la région.
Le contact avec la population indigène était excellent, les forestiers étaient apprécies car ils procuraient beaucoup de travail. La population française était composée de deux tiers d'origine maltaise, italienne, espagnole d'un tiers de métropole.
La forêt était très surveillée. Dans ses tournées mon père recherchait toutes sortes de délinquants ; pacages nombreux de chèvres qui détruisaient les jeunes pousses, charbon de bois transporté frauduleusement, comme le bois.
En rentrant la nuit, il fallait rédiger les procès-verbaux en trois exemplaires. Le lendemain les porter dans le bled à cheval, car les facteurs ne sortaient pas en dehors de la localité.
Lors du démasclage des lièges on ne tenait pas compte de la distance du poste jusqu'au chantier où travaillaient de trente à quarante ouvriers. Le garde couchait sous la tente sur place. En cette période il faisait très chaud, pour combattre le paludisme nous prenions de la quinine. Nous étions obligés de transporter sur un âne l'eau nécessaire dans de petits tonneaux, cela dura plus de vingt cinq années. Les chantiers fonctionnaient toute la semaine, avec un peu moins de présence le vendredi.
Les forêts particulières étaient également contrôlées. Tous les produits forestiers, bois, charbon, lièges, souches de bruyère ; ébauchons pour pipes, vendus à I’unité après un contrôle des stocks étaient soumis à un permis de débardage et de colportage. Il fallait indiquer le numéro du véhicule ou tout autre moyen de transport avec la durée du trajet, à la maison forestière.
Les environs, Bougaroune était desservi par une piste où l'on ne se déplaçait qu'en mulet. Mais en période de beau temps, il y avait la possibilité d’être ravitaillé par mer. Bessembourg est construite sur les ruines romaines entourée de vignes et d’une grande forêt de chênes liége et de pins maritimes appartenant à la société « La petite Kabylie.
C'est vers 1924 que commença son expansion avec le traitement du liège, la fabrication de bouchons etc.
Une route forestière fut construite entre Bounougraph, après le col de Terras en passant par Elala, la maison forestière de Tegziren et au cap Bougaroune, pour seuls outils : pelles, pioches, dynamite, des mulets, des ânes pour le transport des matériaux. Le chantier était surveillé par mon père et un autre collègue qui couchaient dans un gourbi à proximité du chantier.
Nous sommes allés avec ma mère rejoindre mon père en passant par un lieu dit Guelmane. La route en travaux était entourée d'un grand massif de pins maritimes et de chênes lièges. Le paysage était très beau, au lointain on voyait la mer et parfois de rares navires qui longeaient la côte. Une source d’eau très fraîche coulait à proximité du chantier.
La nuit on entendait les animaux de la forêt et du bétail égaré à proximité du gourbi.
En hiver les forestiers s’occupaient à construire des tranchées pare-feux. Ils brûlaient la végétation dans certaines zones avec de grandes précautions pour éviter tous débordements. L'incendie était très redouté, le forestier était tenu en été, même en cas de congé de naissance (quatre jours) de rejoindre immédiatement les lieux, Les forestiers avaient le pouvoir de réquisitionner la population pour combattre le leu.
Les forestiers avaient droit, tous les deux ans, à un passage gratuit en bateau, en troisième classe, pour se rendre en métropole. Il était cumulable et durant deux mois. Le terme « permission » était employé comme dans l'armée.
Pour me permettre d'aller à l'école, mon père demanda le poste de Collo, la maison forestière était à environ un kilomètre de la localité. La mer était à cent mètres, il y avait une grande plage déserte appelée « la baie des jeunes filles ». La maison avait l'eau mais point d'électricité avant 1932. Le poste était double. Chacun avait son jardin avec des arbres fruitiers, des fleurs et aussi une vache et des volailles, etc.
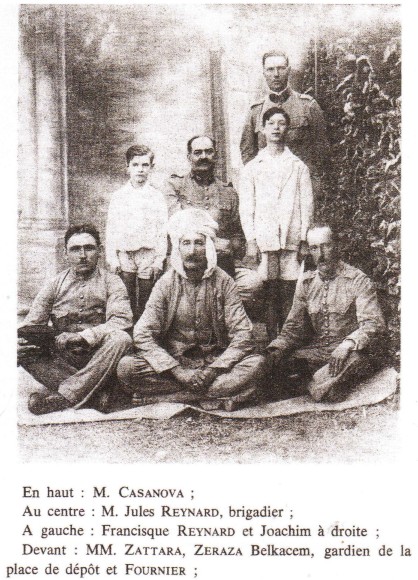
La maison forestière était adossée à la montagne, devant deux cascades, au débit très important. Le sommet de la montagne « Sidi Achour » (540 mètres ) était couverte « d'un burnous blanc » en hiver. Au début de la grande presqu'île il y avait un cimetière arabe. Une construction peinte en blanc indiquait la sépulture d'un marabout. Une lois par an, des familles y apportaient des vivres, la nuit les chacals venaient se servir. Les Arabes disaient : « Le marabout pour sa fête a tout mangé !.. » Dans les rochers, à quelques mètres de la mer jaillissait une source d'eau douce « Aïn Doula »
D'après les indigènes cette source était miraculeuse. En hiver les hommes de plus de soixante ans venaient avec leurs épouses de quinze à vingt ans, afin de provoquer une grossesse. Les femmes étaient plongées dans la mer, j'entends encore leurs cris jusqu'à la limite de l'évanouissement, puis ramenées sur la plage et réchauffées avec des braises.
Collo.
Un court descriptif.
C'est le roi Pierre III d'Aragon qui débarqua en 1282 avec son armée, son but était la prise de Constantine.
Il fit construire des murs, des fortifications et des retranchements non loin d'un puits nommé Piccaz Boralta. Il se heurta à l'époque aux Sarrasins qu'il tailla en pièces. Mais il échoua pour la conquête de Constantine. Alors, il décida le pillage complet de Collo qu'il détruisit et fit brûler. En se retirant, il emporta deux mille têtes de bétail il avait envoyé des émissaires pour constituer un royaume en Sicile. Finalement les Siciliens lui offrirent leur royaume.
Dès 1450 des Marseillais avaient obtenu une concession de dix lieues que l'on appelait : « Concession d'Afrique », puis « Bastion de France » pour commercer et pour la pêche au corail.
Les indigènes attachaient une lanterne entre les cornes d'une vache pendant la nuit et trompaient ainsi les navigateurs qui venaient dans sa direction et se perdaient sur les rochers. Les cargaisons étaient pillées, l'équipage prisonnier n'était rendu que contre une rançon. Ce fut le cas du navire italien Falmar à l'embouchure de l'oued Zhor.
Une mosquée se trouve à l'entrée du port. Elle fut construite en 1756 par Ahmed ben Ali Roumani bey de Constantine. Les Turcs furent chassés par les Colliotes en 1820, le comptoir supprimé. Mais les habitants réduits à la misère, menacés de bombardement par la flotte, acceptèrent à nouveau une garnison turque. Lors de la conquête française, nos troupes commandées par le général Baraguay d'Hilliers, découvrent un pays misérable, une population affamée sur le site dénommé Chullu, les indigènes utilisaient l'appellation El Khol,
Peu à peu la vie redevint normale : constructions modernes, routes, commerces, emplois etc. dans son ensemble la population oeuvrait pour la tranquillité.
Les musulmans acceptaient la scolarité sauf pour les filles. Il y avait dans les douars au début du siècle dans un rayon de 20 kilomètres de Collo, cinq écoles.
A la sortie de Collo sur la route menant à la maison forestière il y avait une fabrique de bouchons, également une usine de traitement d'ébauchons (souches de bruyères) pour pipes. Non loin de la mer il y avait une salaison pour la préparation de sardines en boîtes.
Sur la grande presqu'île il y avait une importante carrière de granit dénommée Cambon.
Cette pierre était utilisée principalement pour les bordures de trottoir. Les ouvriers : Italiens, Russes blancs se rendaient sur les lieux à plus de cinq kilomètres, à pied en empruntant des sentiers, des chemins. La pierre dénombrée se vendait à l'unité de produits.
L'enlèvement se faisait en période de beau temps par balancelles qui contournaient la petite presqu'île et déposaient leur chargement au port de Collo.
Au centre, la presqu'île de la Djerbda, le chemin de ceinture fait deux kilomètres ; il y a un phare à l'extrémité. Cette presqu'île abritait à son entrée une caserne de troupes sénégalaises, une mosquée fut construite à droite sur un ancien temple romain,
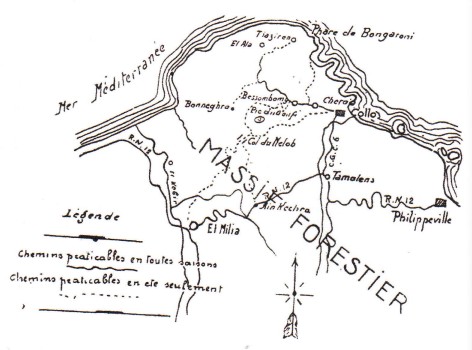
Sur la route de Bessombourg, à l'Ouest de Collo, le village de Cheraia à 524 mètres d'altitude, est aussi entièrement sur les ruines romaines. Les vignes et les prairies qui entouraient I'agglomération offraient l'aspect des beaux villages de France. Son vin était très réputé. De la verdure, de la fraîcheur, I'air pur. L’eau y est abondante, elle provient des sources du Djebel Baabèche à 600 mètres d'altitude. La plage de Tamanart à 17 kilomètres de Cheraïa est située entre la grande presqu'île et le Cap Bougaroune.
Venant du douar Djezia coule l'oued Zour, l'unique rivière de I'Algérie où se trouvaient des truites. Cette anomalie, pour un pays réputé chaud, avait frappé les premiers explorateurs qui le mentionnaient dans leur récit de voyage.
Les forestiers de la région, malgré leur faible rémunération vivaient convenablement, Ils étaient respectés par les indigènes, l'Administration des Eaux et Forêts leur assurait du travail, malgré la lutte continuelle contre la délinquance.
En 1933, 1934, un recensement indiquait à Collo 3.733 habitants musulmans et 792 européens.
J'avais grandi, mon père parlait de mes études après le CEP, je me souviens surtout de ce qu'il m'avait dit « ne fais pas mon métier ». Ma mère, après la mort de mon père disait : « toujours en tenue, il était rarement à la maison »
L'inspecteur adjoint Bismut décida la réfection des escaliers en bois du grenier. Ce fonctionnaire d'origine maltaise faisait passer les économies avant tout, fit le maçon en prenant comme manœuvre le brigadier et le garde. Le résultat du travail n'était pas merveilleux, il y avait beaucoup de pente, les marches très étroites, il fallait faire preuve de prudence pour accéder au grenier.
Le mur d'enceinte de la maison forestière était garni de meurtrières. Entre mes deux logements composés chacun de trois pièces, cuisine comprise, au centre une grande pièce meublée appelée « chambre d'agent » cette pièce était destinée aux supérieurs de passage. Le garde ou plutôt son épouse, était chargée de l'entretien de cette pièce correctement meublée. J'ai toujours le souvenir de ces maisons forestières très rudimentaires, avec parfois une pièce de plus, une seule maison forestière avait un certain confort afin de permettre un agréable séjour aux supérieurs, celle d'Ain-el-Ksar.
La baie de Collo, située à l'est, débute à environ un kilomètre de la localité, après le lieu-dit :
« La fontaine des sangliers ». Elle a une longueur d'environ 6 kilomètres et se termine au marabout de Sidi Benzoult grand lieu de pèlerinage situé dans le douar Tokla. La grande plage était peu fréquentée, non loin des rochers, des débris et des épaves de navires de guerre jonchaient le sable.
L'unique route venant de Constantine arrivant à Collo, longe la mer sur environ un kilomètre, souvent I'hiver les vagues se heurtant aux rochers inondent ma route.
Mon père mourut à 42 ans, je retiens à cette époque un commencement d’animosité des jeunes arabes de Collo : « les Allemands sont avec nous » disaient-ils, des camarades isolés étaient agressés.
Le décès de mon père, beaucoup d'indigènes des douars nous ont exprimé leur sympathie Certains disaient : ton père était juste".
Ensuite nous sommes allés habiter à Philippeville avec ma grand-mère maternelle. Pendant trois ans j'ai continué mes études, ma mère percevait une faible retraite. J'ai donc été obligé de travailler dans un bureau pour aider les miens. J'étais peu payé pour un travail excessif.
Comme j'avais la charge des miens il fallait tout accepter !
Les forêts de chênes lièges de la région étaient très importantes : Beni-Touffout 18.000 hectares, Ouled-el-Hadj 8.000 hectares et Oued-Guebli 3.000 hectares, Il y avait beaucoup d'oliviers, la surface productrice augmentant après les greffes. Ils produisaient une bonne huile utilisée dans les sardineries et dans l'alimentation. En bordure des grandes routes, on remarquait des rangées de platanes ou de frênes. Les arabes prétendaient que certains gros arbres avaient été plantés par les romains. Un ancien agent des concessions d’Afrique de Marseille, M. Raimbert, chargé de réorganiser la pêche au corail écrivait en 1805 : « A moins d'une demi-heure du port de Collo, il y a une immense forêt de hautes futaies : ormes, chênes blancs et frênes, aussi anciens que le monde. A une lieue à l'ouest de là se trouvaient des sapins ; les goudrons, Ies résines provenant de la forêt de Collo alimentaient autrefois I'arsenal de I'ex-Régence d'Alger. »
Comme beaucoup de mes camarades après l'armistice de 1940, je me suis engagé : Campagne de Tunisie, débarquement du 15 août 1944, libération de la France et campagne d'Allemagne. J’ai été démobilisé en janvier 1946 avec une prime de 1.000 F, soit de quoi vivre environ quinze jours. Il n'y avait pas à cette époque d'indemnité de chômage. Il était difficile de trouver du travail, telle était en cette période, la situation des anciens combattants rendus à la vie civile.
Les forestiers et leurs familles ont payé un lourd tribut lors de l’insurrection du 8 mai 1945, tous attaqués et assassinés par traîtrise.
A Zéralda dans la forêt des Planteurs: M. Renier et son épouse sont assassinés, leur fille va subir les pires outrages.
A Biabel, commune mixte de Lafayette : M. Georges Feuvrier est abattu en pleine forêt à coups de fusil.
A Tamsout, commune mixte d'Oued Marsa : M. Marceau Lambert, sa femme Gabrielle Lucas furent assassinés dans la cour du poste, cette dernière ayant subi les pires outrages.
A Tamentout, commune mixte de Djidjelli : le brigadier Dupont Raphaël et le garde Monelli sont assassinés, leurs cadavres sont retrouvés au fond d'un ravin.
A Aïn Settah, commune mixte de Takitount : M. Dezève est abattu en forêt, le corps de sa femme n'a été retrouvé que six jours plus tard à 4OO mètres de la maison forestière.
De Nombreux gardes ne durent leur salut soit par leur absence, soit qu'ils avaient été informés et avaient pu à temps se réfugier dans des lieux sûrs.
De nombreuses maisons forestières furent incendiées.
Pendant mon « septennat « il y eu cinq collègues tués dont Maerten Raoul, tué devant sa maison forestière, son épouse réussissant à s'enfuir avec leur enfant au poste voisin à environ 1 km,
Danti Robert, a été tué à la maison forestière de Beni Loulou, dans la région de Collo, attaqué par une vingtaine d'individus, il s'est défendu farouchement cela se passait en 7955.
A ma connaissance, dans mon ancien district, le restant du personnel s'est replié et il n'y a pas eu d'autres victimes.
La vie de forestier
en Algérie de juin 1946 à juin 1953
Il fallait aimer ce métier, et au début de cette période difficile, pour vivre, accepter ce qu'il était possible d'obtenir. En qualité de fils de préposé, je passais un examen spécial au Gouvernement général à Alger. L'examen n'était pas difficile, nous étions tous anciens combattants, sur 72 candidats, il y eut 23 reçus, j'ai eu le numéro 17. Après l'examen, nous étions reçus individuellement par le Directeur général. Il m'avait demandé si je n'étais pas fiancé. Après m'avoir serré la main, il m'a souhaité bonne chance.
D'abord par un premier arrêté, j'ai été nommé à la maison forestière d'Aïn-Hadar, à environ 40 kilomètres de Philippeville. C'était accessible par un mauvais chemin à 10 km d'El Arrouch, un chef lieu de Canton. Heureusement après quelques semaines parut un rectificatif à ma nomination. (Si je trouvais un logement à Sldi-Mesrich, je résiderais dans cette localité (poste NL), nœud de communication pour surveiller les transports routiers. Cela signifiait colportage : lièges, bois, charbon et gibier en délit. Tous les produits forestiers étaient soumis à notre contrôle. En sus de toutes les forêts soumises au régime forestier il y avait également toutes les forêts particulières.
Avant de rejoindre mon poste, je me présentais au Brigadier à El Arrouch, il m'a remis un pistolet et quelques cartouches.
Il y avait dans ce village une gendarmerie, un bureau de poste, deux cafés, six colons européens et un grand nombre d'indigènes . le logeais dans une habitation communale constituée de deux pièces, presque une baraque. Il y avait I'eau et l'électricité. Mon traitement était de 5.400 F par mois, pour ma nourriture il me fallait presque 4.000 F, pourtant j'aidais un peu ma famille. Comme mon poste était motorisé, un an après mon arrivée, on m'a attribué une moto Peugeot 5 CV, déjà poussive ; cela facilitait mes tournées et me permettait d'approcher les forêts.
La forêt soumise la plus proche était à environ six kilomètres, la plus éloignée à trente. Avant d'avoir la moto je faisais du stop, puis j'allais à pied pour pénétrer à l’intérieur des boisements montagneux sans accès. Les délits étaient nombreux et fréquents particulièrement pacages de chèvres, charbonnières, coupes de bois, etc. Mon odorat me permettait de surprendre la fabrication clandestine du charbon de bois. Cette marchandise se vendait bien, elle était à l'époque très utilisée, j'étais obligé de prévoir mes tournées, emportant un peu de nourriture et connaître, dès les chaleurs, les sources d'eau.
L’exploitation en règle comprenait le bois de boulange à la tâche, et les lièges. Dans mon triage, l'exploitation c'est à dire le démasclage, ne durait qu'environ un peu plus d'un mois. Mais pour le bois de boulange, une grande partie de l'année. Il fallait partir très tôt, la journée était de dix heures au chantier.
La régie (bois de boulange) était très rentable, le liège à la journée également pour l'Administration. En 1951 dans la conservation de Constantine, on a vendu pour un milliard de flancs de liège et cent millions pour le ramassage ( chablis). Dans certains triages, il y avait également la fabrication du charbon de bois.
Gare aux forestiers à qui on volait la marchandise. Pour le liège le risque était moindre car il était griffe. Mon triage, sur route, facile à surveiller était aussi vulnérable. Il fallait avoir des renseignements sur certains camions qui se servaient au bord des routes du bois de chauffage.
Non loin de Sidi Mesrich en direction de Constantine se trouvait le douar Beni-Ouelbane qui lut érigé en Centre Municipal avec la construction d'une mairie et d'une école,
A 294 mètres d'altitude, des ruines romaines appelées El Marabaa s'étendant sur une cinquantaine d'hectares commençaient à être explorées. c'était certainement la ville romaine de Celtiane.
C'est dans ce douar qu'eurent lieu lors de la conquête de violents combats. Les indigènes, déterraient nos soldats tués pour les mutiler. Le général Baraguay d'Hilliers en avril 1854 ordonna de brûler les cadavres près de l'oued Zadra. Le camp fut appelé : « Camp de l'Enfer ».
Les limites de la forêt étaient très giboyeuses : perdreaux, cailles, grives, bécasses, lièvres, c'était le début d'un massif forestier qui s'étendait jusqu'à la côte, la montagne Sidi Dris à environ dix kilomètres de mon poste. En 1956, des fellaghas venus de Tunisie y tendirent une embuscade à un détachement militaire français.
Nous plantions des oliviers, comme la DRS sur des banquettes. Hélas, bien souvent les troupeaux allaient sur les lieux. Les olives produisaient une excellente huile, on donnait pour la cueillette le quart de la récolte et bien souvent les ramasseurs camouflaient un supplément. Au village l'huilerie était moderne, mais dans les campagnes, on écrasait encore les olives avec les pieds. Inutile de dire qu'à la cuisson il se dégageait une forte odeur.
En 1949, j'avais dressé 96 constatations de délits ; pâturages, transports sans permis de colportage, labour en forêt, coupes de bois, etc.. Noté 14, l'Ingénieur avait ajouté : « devra faire preuve de plus d'activité dans la surveillance de son triage ». Jamais dans mon service, je n'ai jamais été l'objet de menaces de la part des arabes. La mentalité de ceux des douars, moins instruits, était bien meilleure que celle de ceux du village. Ils appréciaient nos chantiers, le prix de la journée était fixé par arrêté gubernatorial, celui de la tâche suivant une directive, les ouvriers étaient payés régulièrement avec équité.
L'eau qui alimentait le village et la région provenait d'une source très froide située à Sidi Dris ( 837 m). L'hiver le sommet était recouvert de neige quelquefois jusqu'à lin avril. Le printemps était très court, l'été très chaud
La chefferie se trouvait à Philippeville à environ 40 km. Etant stagiaire , on me brimait un peu ; j'avais hâte d'être titularisé et reclassé avec mes annuités de guerre.
J'étais favorisé pour la campagne des lièges, assez courte, ce n'était pas de même pour certains collègues. A cheval il fallait partir très tôt pour rentrer tard. Le soir pour se doucher, certains n'avaient même pas assez d'eau, pourtant certains qui faisaient en régie du charbon de bois n'en sortaient pas très propres, lors des grosses chaleurs il fallait la restreindre. Un grand nombre de maisons forestières ne disposaient que d'une citerne. Les épouses, ne pouvaient exercer aucun emploi, elles soignaient bénévolement et faisaient des pansements à ceux qui se présentaient à la maison forestière. II existait encore des postes où les femmes se déplaçaient à dos de mulet. Pour les congés les célibataires n'avalent pas le choix de la période.
Nous étions mal rémunérés, moins que d'autres corps de l'Etat ( gendarmerie, police). Il n'existait pas de frais de déplacement pour les tournées, sauf, une indemnité journalière pour les travaux en régie. Pendant presque deux années, j'utilisais ma mobylette personnelle, ayant eu un grave accident avec ma moto administrative, je ne percevais pas d'indemnité kilométrique. Il est vrai qu'à cette période nous avions le tiers colonial, cela était avantageux, une petite compensation pour un service chargé et le climat pénible dans le bled.
L’habillement, abondant, n'était pas du tout moderne pour notre prestige. Les arabes nous le faisaient remarquer.
En 1952, suite à une insertion dans le « Réveil Forestier »j'avais trouvé un permutant en Creuse. Les démarches durèrent plus d'un an. Il fallait sept années de service et une bonne note. C'est en lisant le journal local que j'ai appris la décision de ma permutation dans la Creuse. Avant mon départ, on m'a remis un billet de passage gratuit (taxes à payer) sur le Sidi Okba. Comme célibataire j'avais droit à 30 kg de bagages. Tout le reste et le chemin de fer à mes frais.
En arrivant en Creuse, il a fallu m'adapter aux essences différentes de celles de l'Afrique du Nord. J'ai été l'objet de quolibets de la part de collègues et j'ai dû me débrouiller seul sans qu'un seul supérieur ne m'aide.
Bibliographie : Les Forestiers en Algérie –
Régis Exbrayat
| |
PHOTOS de CONSTANTINE
ACEP-ENSEMBLE 289
|
|
Le retour de L’hirondelle
I
J'attends la petite hirondelle.
A qui je parlai l’an dernier...
Où peut-elle être et que fait-elle ?
Pour sembler ainsi m'oublier ?
Il
J'attends ma petite hirondelle,
Comme, elle tarde, à revenir...
Que l’attente est longue, et cruelle...
Va-t-elle encore se souvenir ?
III
Enfin! voilà mon hirondelle,
Je la vois volant dans les cieux,
A son vieux nid toujours fidèle,
Elle, s'en va, d'un air joyeux !
IV
Par pitié, petite hirondelle,
Qu'ont vu les sœurs ! Vile, dis-moi.
Ne m'a-t-elle oublié... vit-elle ?..
Oui... Mais ne pense plus à toi !
Ct. L. LARDINOIS.
6 avril 1921
| |
| La Cuisine du Bastion de France.
par Jean Claude PUGLISI,
|
| Le Couscous aux Seiches
de Parasol mon Cousin.
Depuis La Calle où il a vu le jour, tous ses amis le surnomment très affectueusement - Parasol ! Alors, pourquoi ce curieux sobriquet ? Seriez-vous tentés de dire. A cette question pourtant pertinente, je répondrai sans hésiter un seul instant : «Mystère ! Car personne à ce jour n’en sait que trop rien.» Surtout mes amis, n’allez pas lui demander de vous fournir quelques explications, parce que pour toute réponse il vous gratifiera d’abord de son beau et éternel sourire, pour ensuite franchement s’esclaffer et vous dire - qu’il n’en sait rien lui-même !
C’est à l’occasion d’une recherche personnelle, sur les divers sobriquets de la jeunesse Callois d’antan, que j’ai interrogé tous les copains de là-bas, pour avoir quelques précisions en la matière. Je devais alors en déduire, que l’attribution habituelle de surnoms, relevait surtout des traditions ancestrales établies de longue date et constituait en quelque sorte un titre de noblesse particulier, qui, la plupart du temps, cadrait avec beaucoup de précision et de charme, la personnalité réelle de chacun des individus. Ainsi, certains étaient mieux connus par un surnom, que sous leur identité véritable. Ne pas avoir de surnom, était presque synonyme - d’absence de toute identité… Mais pour revenir à notre ami Parasol, plusieurs hypothèses ont été émises sur l’origine de son beau sobriquet :
La première est que pendant l’été, pour s’en aller entre copains goûter aux joies de la plage de l’usine, c’était toujours lui qui était chargé de porter le parasol.
La deuxième est que pour animer la galerie, il restait toujours debout alors que bien allongés sur le sable, tous les copains goûtaient béatement aux plaisirs du dolce farniente. Un jour peut-être, l‘un d‘eux lui aura crié : «oh, Jean-Paul ! Tu te prends pour un parasol ?»
Et voilà comment là-bas, on pouvait récolter un sobriquet en héritage !
Mais qui donc ? A bien pu lui donner ce surnom… Là encore le mystère demeure mais qu’importe, puisque ce n’est pas pour l’heure l’objet principal de mes propos. Ce que je désire surtout en ces fêtes de Pâques, c’est de vous révéler que notre ami Parasol, fut un moment embarqué sur un chalutier, au bon temps de sa prime jeunesse Calloise. Cependant et depuis, malgré les outrages du temps, comme tous les marins du monde, il n’a jamais pu oublier la mer. Alors, parfois pour lui rendre hommage et se souvenir de la Méditerranée Calloise, il lui arrive de se mettre résolument devant les fourneaux, pour régaler les copains avec des produits de la mer, qu‘il se fait un devoir de pêcher lui-même. Il faut dire, que c’est toujours avec un plaisir renouvelé, qu’il improvise tout simplement mais avec tendresse, quelques divines recettes qui brillent par leur authenticité et surtout par leur excellence.
Quant à moi, l’éternel fouineur de ces choses d’autrefois, je vous l’assure sans lui tendre une embuscade, je viens de lui emprunter sans vergogne et pour la circonstance, une délicieuse préparation marine de sa composition. J’ai alors pensé à vous tous, en me disant qu’au-delà de la saveur et des parfums connus de ce plat, c’est un véritable retour aux sources que vous allez refaire en mémoire… Mais pour l’heure, écoutons le grand Parasol qui aujourd’hui et pour nous faire plaisir, a mis de côté ses parties de boules et autres tournois de belote, pour vous ouvrir largement sa parenthèse culinaire.
Recette du COUSCOUS aux Seiches
A l’ombre d’un Parasol.
Ingrédients : ( pour 6 personnes.)
2 kilogrammes de Seiches fraîches.
6 Courgettes moyennes.
6 Carottes moyennes.
6 petits Navets dits marteau.
1 boite 4/4 de Pois chiches au naturel.
1 Oignon moyen.
2 à 4 gousses d’Ail.
1 boite de 140 gr de concentré de tomate.
1 boite de 500 g de tomates au jus coupées en dés.
Huile sans goût.
Sel et poivre.
1 piment de Cayenne ( facultatif ).
1 bouquet de persil.
Harissa - pour la sauce accompagnant.
PREPARATION :
Nettoyer et rincer abondamment les seiches à grandes eaux.
Les débiter en morceaux réguliers de 10 à 15 mm d’épaisseur.
Ciseler finement l’oignon et écraser les gousses d’ail.
Couper les courgettes en tronçon de 30 à 40 mm.
Débiter les carottes en trois parties égales.
Couper les navets en deux, dans le sens de la hauteur.
Hacher le persil.
Verser l’huile dans le fond du couscoussier.
Faire dorer les seiches, afin qu’elles jettent leur eau (à garder ).
Ajouter : l’ail + l’oignon + le concentré de tomate + sel et poivre.
Laisser mijoter un petit moment.
Rajouter les dés de tomate et leur jus, puis couvrir largement d’eau tiède.
Dés l’ébullition, verser dans la préparation : les pois chiches + les carottes + les navets + le persil + 1 petit piment de Cayenne, dit oiseau.
Laisser mijoter doucement à petits feux 45 minutes environ.
Rajouter les courgettes débitées en tronçons.
Cuire encore 15 minutes environ.
Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
PREPARATION des grains de Couscous :
Vous pourrez toujours préparer les grains à l’ancienne, mais, pour ma part, je conseillerais d’utiliser de préférence un couscous moderne et vite préparé, qui à mon humble avis est tout aussi excellent : j’ai eu l’occasion de glaner un jour chez ma copine Nicole GIORDANO née BARBARA, l’identité d’un excellent couscous - prêt en 5 minutes. Depuis, je l’ai définitivement adopté et c’est bien pourquoi je vous le propose aujourd’hui, et cela, sans aucune restriction de ma part, il s’agit du :
Couscous TIPIAK - parfumé aux épices du monde
( en paquet de 2 x 250 g ).
CONSEILS culinaires :
Ne pas éliminer l’eau jetée par la cuisson des seiches.
Un petit verre de vin blanc sec pour le fond de sauce, ne serait pas de trop en début de préparation.
Préparer une sauce à part dans un bol : 2 louches de sauce + Harissa dosée à votre convenance.
Pour les seiches il est possible, soit, de les choisir de préférence grosses, soit, d’en utiliser des petites. Des calamars pourraient faire aussi bien l’affaire.
Pour bien nettoyer et rincer les seiches sans ôter leur saveur marine, faire comme notre ami Claude Desjardins - grand maître-queue devant l’éternel : à l’eau de mer ! Tout simplement.
Ah ! Mes chers amis et amies, laissez-moi le privilège de rêver encore un petit peu, afin de me projeter au bord de la mer et me précipiter jusqu’au pieds du Boulif pour passer comme autrefois, un beau lundi de Pâques lumineux et serein. Allez-donc savoir pourquoi ? Dans ma rêverie je viens d’apercevoir mon cousin Parasol, qui s’active près d’un feu entre deux rochers… Ne serait-il pas en train de nous préparer une Saint-Couffin, avec un bon couscous aux seiches dont il a le secret ? ! Alors, plongé une fois de plus dans mes fantasmes, je lui crierai bien fort : «Parasol, mon frère ! N’oublie surtout pas l’anisette, avec les poulpes en salade, les arapelles et quelques oursins pour la kémia.»
Merci, Monsieur Jean-Paul TORTORA, alias, Parasol, pour cette bonne recette et surtout pour l’amitié fidèle, que tu ne cesses de répandre depuis toujours dans ton sillage. Lorsque parfois, il nous arrive comme là-bas d’être assis tous ensembles, surtout, si tu veux nous faire encore plaisir, continue de rester debout planté comme un Parasol, pour nous apporter un peu de ton ombre bienfaisante et nous éclabousser joyeusement par les éclats de ton rire particulier…
Mais puisque le 21 mars est la date de ton anniversaire, au nom de tous et de toutes, permets-moi cher cousin, de te souhaiter un bon et heureux anniversaire.
Docteur Jean-Claude PUGLISI,
de La Calle de France -
Paroisse de Saint Cyprien de Carthage
Giens en Presqu'île - HYERES ( Var ).
|
|
|
Algérie catholique N°1, 1937
Bibliothéque Gallica
|
LE COIN DES PETITES
Les babas à la crème
Chez M. et M"" Tilleul on attend pour le déjeuner des vieux amis d'enfance qui ont annoncé leur passage : « Il faut inviter aussi M. l'Abbé, dit M. Tilleul, il sera heureux de revoir notre camarade de collège.»
On a donc commandé des desserts supplémentaires, ce qui réjouit Monique, la petite gourmande : « Chic ! Dit-elle à ses frères, j'aime bien quand on a du monde à dîner ! Pourvu que maman ait demandé des babas à la crème !
J'aime mieux les dattes et les bananes, dit Jacques...
Moi je préfère les tartes aux cerises, répond Jean.
Oui, répond Monique, les dattes, les cerises, tout ça c'est très bon, mais les babas... c'est succulent ! appuie-t-elle en se frottant l'estomac...
Lorsque le petit pâtissier arrive avec sa corbeille,
Monique se précipite et... saute de joie en apercevant ses gâteaux favoris : « Maman n'a pas oublié !... Il y a des babas !... Quel bonheur !
Quelle veine, dit Jean, il y a des tartes !»
Merveilleux dessert en perspective !... Il s'agit maintenant d'être sage à table pour ne pas risquer de se faire priver de dessert. Car M. et M'"" Tilleul sont intraitables sur la bonne tenue à table ; quand il y a des invités, la consigne formelle pour les enfants est de ne pas parler à moins qu'on leur adresse la parole.
Le repas commence et la joie du revoir provoque une conversation animée, bruyante. On a tant de choses à se raconter depuis la sortie du collège, tant d'anecdotes à rappeler sur la vie d'écoliers !
Souvenirs qui provoquent souvent de francs éclats de rire !...
Aux deux bouts de la table, les enfants sont admirables de sagesse. Du reste on ne fait guère attention à eux ; on ne les questionne pas, ils n'ont donc qu'à observer le silence. La bonne s'occupe de les servir : hors d'œuvre, entrée, rôti, légumes défilent sur la table et dans les assiettes.
«Tout cela est très bon, se dit Jacques, mais ça ne vaut pas les dattes et les bananes »...
«C'est long ce dîner, pense Jean, si je pouvais prendre ma tarte aux cerises et m'en aller ! »...
Et Monique à l'autre extrémité, lance à la dérobée des yeux doux aux babas à la crème ; plus que la salade et le fromage à passer et ce sera enfin ces fameux babas ; aujourd'hui ils semblent encore plus appétissants que d'habitude !...
Enfin, voici le dessert ! La fillette suit des yeux l'assiette de babas qui circule dans les mains des invités et qui arrivera à elle la dernière... Mais, désagréable surprise ! La bonne distraite par la conversation si animée, oublie de passer les babas à Monique et les remet au milieu de la table... Pauvre petite ! devant cette amère déception elle sent ses larmes sur le point de jaillir et pourtant n'ose pas réclamer puisqu'elle connaît la défense de causer...
Alors, en petite fille chrétienne qui se prépare pieusement à sa première communion cette année, Monique se recueille et offre son sacrifice au Bon Dieu...
Un seul convive s'est aperçu que l'assiette de Monique reste vide.
C'est M. l'Abbé ; mais, sachant que l'enfant est souvent punie pour ses désobéissances, il ne veut pas réclamer en sa faveur de peur de lui attirer un affront de la part de sa mère ; d'un autre côté, il connaît son penchant pour la gourmandise, ce qui atteste évidemment que si Monique ne demande pas c'est qu'elle subit une punition méritée. Il garde donc le silence, se réservant de tirer la chose au clair lorsqu'il pourra s'expliquer avec elle... Cette fois, ce sont les tartes aux cerises et les fruits qui circulent, Monique n'est pas oubliée ; mais tout cela ne vaut pas les babas à la crème.
Après le dîner, M. l'abbé réussit à se trouver seul avec l'enfant et lui dit : «Eh bien ! Monique ! Vous avez donc encore désobéi à votre Maman ?
Non, Monsieur l'Abbé !
Mais vous étiez bien privée de babas à la crème, ces fameux babas que vous aimez tant ?
Pas du tout, c'est qu'on m'a oubliée.
Alors pourquoi n'avez-vous pas réclamé ?
J'ai voulu faire ce sacrifice. Je me suis dit :
« Monsieur l'Abbé a célébré sa messe ce matin, il a communié par conséquent le Bon Dieu est dans son cœur, près de nous à cette table... Alors, petit Jésus, afin de vous faire plaisir, j'accepte cette privation pour les agonisants qui doivent mourir aujourd'hui ; vous aviez soif sur la Croix, eh bien moi je peux bien me passer de baba...»
C'est bien cela, Monique ; en effet, le Bon Dieu que je porte toujours dans mon cœur de prêtre est là au milieu de cette réunion et ce sacrifice lui aura été agréable... N'en dites rien à personne ; ignoré de tout le monde il n'en aura que plus de poids pour les pauvres mourants... »
Les conversations continuent, bruyantes, animées ; nul ne se doute de ce dialogue et de ce qui s'est passé au sujet des fameux babas à la crème, dont chacun, inconsciemment, a vanté la succulence devant cette pauvre Monique mortifiée.
Mais le Bon Dieu a sans doute sauvé des âmes repentantes en retour de ce sacrifice si généreusement accepté...
Et l'Abbé, ému, en rend grâces au Seigneur...
Edmée PILLETTE.
| |
Les Promenades d'un Solitaire
BONJOUR N°1, 6 octobre 1932
journal satyrique bônois.
|
|
Janus bônois
Janus était un dieu des Romains. La légende disait qu'il avait été le premier roi du Latium. Les statues le représentaient avec deux visages. A droite, il était refrogné, à gauche, il souriait.
Il y a, par la ville et depuis quelque temps, un ou deux quarterons de Janus bônois. Ces gobe-la-lune font de l'histoire sans le savoir, mais comme leurs visages manquent d'exercice autant que leurs cervelles d'érudition, ils ne savent point sourire et être sévère tout à la fois. Ils y parviendront après des études sérieuses et variées
Tel qui, naguère, venait à mon devant, la bouche en tirelire et la main tendue, se croit tenu, aujourd’hui que je suis devenu un traître à prendre, dès qu'il me rencontre, la figure énigmatique et vaporeuse d'un faux témoin qu'on a mal rémunéré. Des visages, épanouis jadis, sont frappés, aussitôt qu'au loin ils m'aperçoivent, de constipation foudroyante.
C'est un mal bien connu. Les psychiatres lui ont donné un nom bizarre. C'est la « froussite responsabilitas » parasitaire et intermittente. Cette maladie, est, quelquefois, congénitale. Elle ne sévit que par périodes. C'est comme un vent qui passe.
Elle revêt, parfois dans des cas assez rares, un caractère plus pernicieux. Elle devient « l'insultite aiguë ou l'insultite grave » On la traite alors, par la manière forte.
Moi, grâces en soient rendues aux dieux, j'ai échappé à l'épidémie et je suis demeuré sain de corps et d'esprit. C'est pourquoi, de tous ces gens, je ris !
Et puis, me voilà tout à fait à mon aise. J'aime mieux serrer la rude poigne d'un ouvrier qui me regarde dans les yeux que la main doucereuse et molle d'un bourgeois qui se défile.
A chacun ses goûts.
| |
Histoires enfantines
EFFORT ALGERIEN 1935, N° 368
|
Ces chers petits enfants, il en est de si délicieux ! Voyez donc ce petit garçon :
Dans une boutique de confiseur, on peut lire cette annonce alléchante : 50.000 sucettes vendues à pertes
Comme disait un petit garçon arrêté devant la boutique :
On ne peut vraiment se refuser ça.
Mais que direz-vous de la philosophie et de l'arithmétique de ce petit maraudeur :
Le propriétaire d'un verger surprend un petit Parisien à la campagne en train de voler des prunes, encore vertes d'ailleurs.
Il le prend par le bras et lui administre cinq coups de canne.
Voilà, dit-il, c'est payé, un coup de canne par prune.
La correction donnée, il voit l'enfant qui tend la main.
Qu'est-ce que tu veux ?
Vous me devez deux prunes, je n'en avais pris que trois.
ALAIN N’EST PAS TRÈS GÉNÉREUX
Alain (cinq ans) a bon cœur. Il partage tout avec ses amis, mais il garde la plus grosse part pour lui.
On lui avait donné de grosses dragées. Il y en avait dix
Sa bonne, Adèle, cousait auprès de lui. Alain prit sa boite de dragées et l'offrit à Adèle.
Est-ce que tu n'en voudrais pas une, dit-il. Alors il m'en restera neuf et cela suffit pour moi.
JEAN EST LOGIQUE
Petit-Jean (cinq ans) se promène avec son papa. Il voit passer une vieille femme qui marche très, très lentement.
Pourquoi, qu'elle marche comme ça ? demande-t-il.
Tu comprends, répond le papa de Petit-Jean, elle est très vieille. La promenade continue. Un peu plus loin, on rencontre en banlieue un train, qui, à l'approche d'une gare a ralenti son allure.
Alors, demande Jean à son papa, ce train-là, il est très vieux ?
| |
Promenade cycliste
Envoyé par Eliane
|
|
Il y a que des JEUNES COMME NOUS qui pouvons comprendre !!
"Nous étions vingt sans Scotto, absent, Jean, du jardin, sortit avec son beau vélo, et Thierry, l'ermite, sortit enfin de chez lui.
Nous sommes parti tranquillement, Jean-Paul roulant au train, mais à la première côte, Edith piaffe d'impatience, et Sophie démarrait, Claude sautait dans sa roue, Françoise, hardie, les suivait, alors que derrière Charles trainait.
Je voyais Yves montant à sa main, Jean-Jacques debout sur les pédales, et Alain, de long en large zigzaguait sur la route.
Je dis à mon copain, allez André, pousse. Olivier, mine de rien, suivait tranquillement, Sylvie, têtue, s'accrochait et Simone s'ignorait d'un tel talent de grimpeuse.
Puis la descente arriva. Ayant peur, Pierre freinait, et, malheureusement, il y eu une chute, Georgette plana par dessus son vélo, Mathilde saignait au genou, Paul, vers l'aine, avait mal à la jambe, David, douillet, gémissait et Colette brossait son beau maillot.
C'est alors que Jonhy a l'idée de s'arrêter, Alice donna à boire à ses amis, Casimir, Perrier à la main, se désaltérait, quant à Gérard, de par Dieu, jura qu'on ne l'y reprendrait plus.
Mais puisque Dieu le veut, tout se termina pour le mieux .."
Dédé Marrage
| |
Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
Séance du 14 février 2011
Envoyé par Mme Bouhier
|
|
Colons en Algérie
Histoire d’une famille ordinaire
par Claude LAMBOLEY
MOTS-CLÉS
Algérie - Colonisation - Mahonnais - Vesoul-Benian - Villages départementaux et francs-comtois - Alsaciens et Lorrains.
RÉSUMÉ
L’auteur, à partir de l’histoire de sa propre famille, présente en Algérie depuis 1834, rappelle les conditions dans lesquelles des Mahonnais, des Francs-Comtois et des Lorrains sont devenus colons en Algérie.
“L’enfance est un pays perdu.
Et quand on est d’Algérie,
C’est un pays deux fois perdu.”
N. Garcia
Évoquer la colonisation en Algérie est toujours une entreprise délicate, tant ce sujet, malgré le temps passé, réveille de rancœurs ou de douleurs. Je tiens à souligner d’emblée qu’il ne s’agit pas dans cette communication de pleurer une Algérie perdue ou de s’appesantir sur des regrets que peut légitimement susciter une évolution historique douloureuse, mais prévisible. Je comprends que la déchirure provoquée par l’exode ne se soit pas encore refermée. Je comprends qu’on puisse évoquer avec nostalgie ce paradis perdu, paradis d’autant plus embelli que le recul du temps, cinquante ans en 2012, le pare de toutes les qualités. Cependant, la page s’est désormais tournée, le temps a fait son œuvre... Surtout, je me garderai bien de discuter des bienfaits ou des erreurs de la colonisation. Il s’agit d’un sujet bien trop sensible pour que je puisse l’évoquer, d’autant que je n’aurai certainement pas l’impartialité nécessaire.
Comme je l’ai souvent souligné, je ne prétends par être un historien. Mon propos sera seulement de témoigner et de rappeler le souvenir de ces hommes et de ces femmes au caractère bien trempé, doués d’un esprit d’aventure, qui ont peuplé l’Algérie après 1830. Il se trouve que certains d’entre eux furent mes aïeux. Ces derniers sont arrivés par vagues successives dès 1834. D’origines diverses, ils m’ont paru être suffisamment représentatifs pour qu’ils fassent l’objet de cette communication. Parmi les différentes souches, qui constituent cette “famille ordinaire”, présente en Algérie pendant près de 130 ans et sept générations, j’en ai retenu trois.
La racine la plus ancienne est d’origine mahonnaise ; elle est arrivée dans la foulée de l’armée française lors de l’expédition d’Alger, en juillet 1830. Une deuxième a participé à la tentative de peuplement avec la création des villages départementaux, en 1853. Ce sujet a fait l’objet d’une communication à l’Académie(1), mais j’apporterai, ici, des renseignements nouveaux à partir de documents que je n’avais pas exploités. Enfin, une autre racine illustrera la colonisation par les Alsaciens-Lorrains, ce qui me permettra d’évoquer ceux qui ont refusé l’annexion de leur province par la Prusse, en 1871.
La colonisation par les Mahonnais
Très vite, après le débarquement de Sidi-Féruch et la prise d’Alger, en 1830, de nombreux aventuriers avaient afflué : négociants marseillais espérant tirer profit de la mise en valeur du pays, ouvriers français, mais aussi allemands ou suisses pensant faire fortune, et surtout maltais qui disputaient aux Juifs le petit commerce.
Mais les pouvoirs publics hésitaient déjà sur la politique à suivre en Algérie. Aussi, cette première colonisation, non voulue par le gouvernement parisien, spontanée, réduite et inorganisée, fut-elle un échec. Beaucoup de ces premiers arrivants, déçus, retournèrent rapidement dans leur pays d’origine.
La première tentative notable de colonisation fut le fait des colons en gants jaunes (2). Elle fut réalisée, dès 1831, par des hommes jeunes, entreprenants, le plus souvent de naissance aristocratique et d’opinion légitimiste, à l’étroit dans la France de Louis-Philippe(3). Ce sont eux qui entreprirent la mise en valeur de la plaine de la Mitidja, laquelle, marécageuse et source de fièvres, s’étendait au sud d’Alger.
Profitant de vides juridiques et d’absence de politique bien affirmée de l’Administration, ils s’étaient établis soit sur les domaines du Dey ou sur des terres de certaines tribus confisquées pour des raisons diverses, soit sur des terres achetées dans des conditions de spéculations souvent douteuses(4). Néanmoins, leur implantation fut facilitée par le fait qu’ils cherchèrent d’emblée, par goût, à s’approprier la culture arabe. Pourtant, l’insécurité régnait et les fermes, qui furent construites, étaient toutes fortifiées. Cette première colonisation faillit être emportée définitivement, lors de l’insurrection du 19 novembre 1839. Pourtant, si on excepte l’entreprise du prince de Mir qui aboutit à la ruine de ce dernier en quelques années(5), cette implantation fut une réussite, mais une réussite très limitée car elle ne fut le fait que de quelques familles ou individus.
Dans ces premiers temps de présence française en Algérie, seule une implantation exogène fut un réel succès, celle des mahonnais, terme générique désignant les habitants de Minorque ayant émigré en Algérie.
Cette île, pauvre, ingrate, à la terre caillouteuse, aride, balayée par la tramontane qui en accentue la sécheresse, n’avait comme ressources qu’une agriculture traditionnelle et une petite industrie textile essentiellement artisanale qui avaient été stimulées par la présence anglaise, au XVIIIe siècle(6). Les Anglais avaient favorisé le commerce et protégé l’île des incursions barbaresques. Cela avait amené une réelle prospérité. Mais, au traité d’Amiens de 1802, l’Espagne avait récupéré les Baléares. En 1820, la décision malheureuse du pouvoir royal espagnol de prohiber, sous la pression des producteurs de blé castillans, tout échange commercial de blé entre la métropole, l’étranger et les îles, avait provoqué une grande dépression économique avec son cortège de ruines et de misère. Minorque comptait, en 1830, 38 983 habitants. Ses ressources étaient devenues incapables de subvenir aux besoins de cette population. Les pauvres, les ouvriers agricoles étaient les premiers à souffrir de la faim et de la misère, amenant des manifestations de protestation, ici ou là. Le manque absolu de commerce depuis la prohibition, ajouté à la raréfaction du trafic maritime, avait conduit à la ruine beaucoup de négociants et d’armateurs. Les propriétaires subissaient une forte dévaluation des terres et étaient la proie des usuriers. En bref, toutes les classes sociales se ressentaient de la crise.
Par ailleurs, l’instauration du tirage au sort pour le service militaire avait provoqué un fort ressentiment. Des tensions politiques entre “modérés” et “progressistes”,avec la création de milices armées, entretenaient un climat d’inquiétude(7).
Les Minorquins découvrirent l’opportunité d’une émigration en Algérie, lorsque les troupes françaises de la conquête établirent à Mahon leur base d’intendance et leur hôpital arrière. D’emblée, cette expédition, censée être justifiée pour mettre fin à la piraterie, bénéficiera de l’accueil favorable des autochtones.
Ces derniers y verront surtout un moyen d’échapper à leur misère. Très vite, quelques Mahonnais tenteront l’aventure. Et bientôt, le mouvement s’amplifiera.
Le 2 février 1832, l’agent consulaire français à Ciudadella, Juan Olivar, écrit au consul de France aux îles Baléares : Je me vois dans l’obligation d’attirer votre attention au sujet des travailleurs voulant passer à Alger... Depuis que l’armée française a pris Alger, ils ne cessent de me harceler pour savoir si le gouvernement français de cette place veut bien qu’ils s’y établissent... Sachant que de Majorque et de Mahon ont embarqué plusieurs personnes pour Alger, depuis il me vient tous les jours une quantité d’hommes, la majeure partie mariés avec des enfants pour aller là-bas, me disant qu’ici ils meurent de faim, ne mangent plus qu’un morceau de pain d’avoine, que bien souvent il manque même cet aliment. Ils veulent aller voir si, avec leur travail et celui de leur famille, ils peuvent gagner de quoi subsister (8).
La réponse du général Clauzel, commandant à Alger, sera favorable, ajoutant qu’il est disposé d’accorder le passage gratis sur les bâtiments de l’État, sous réserve qu’on lui fournisse une liste de candidats justifiant de leur moralité(9).
Une disposition aussi propice ne sera pas toujours affirmée. Le gouvernement français fera souvent preuve d’atermoiements. Ces migrants seront fréquemment qualifiés, à l’époque, “d’écume méditerranéenne”, voire par Bugeaud de “rebut de la Méditerranée”. Tantôt, le pouvoir facilitera cet exode. Tantôt, il le restreindra, en imposant des critères d’exclusion. Pourtant, une émigration, légale ou illégale, se poursuivra et on évaluera à 781, dès 1832, le nombre de Mahonnais travaillant à Alger dans la reconstruction.
Ainsi, de 1830 à 1835, on assiste à une première vague d’émigrés, inorganisée et anarchique. Ils embarquent à Ciudadella ou à Mahon sur des bateaux jaugeant 10 à 60 tonneaux, trabuques, javêques, barcos ou balancelles, faisant le transport de produits divers : fromages, vins, tuiles, briques ou gargoulettes, vers Alger. Le nom de certains de ces petits navires avec leur cargaison et la liste des passagers nous est parvenu : la Victoria (capitaine Francesc Canet), El Caballo, (patron Jaume Fornaris), El Guerrero ( capitaine Joan Stellato) et bien d’autres(10)... Si les jardiniers minorquins sont accueillis à bras ouverts, car ils apportent leur expérience de la culture méditerranéenne, si les terrassiers sont recherchés pour effectuer les travaux d’assainissement que réclame la plaine insalubre de la Mitidja(11), si les femmes, jeunes de préférence, sont demandées, car on manque de femmes dans ces premiers temps de l’Algérie, en particulier à Bône(12), beaucoup de ces émigrés sans travail vont connaître, dans les premières années, une vie misérable, source de difficultés.
Concentrées dans de petites agglomérations plus ou moins informelles près des camps militaires entourant la ville, ces petites communautés mahonnaises sont enregistrées par l’Histoire comme le premier établissement de civils dans ce qui est alors appelée “Possession française dans le Nord de l’Afrique” et qui deviendra officiellement, en 1838, l’“Algérie”(13). On ne parle pas encore de “colons” mais d’“étrangers” plus ou moins bien acceptés.
Une deuxième vague, en 1835-1836, sera le fait du baron de Vialar et amènera essentiellement des travailleurs de la terre, anciens jardiniers dans les huertas de l’île.
Ils seront employés dans des propriétés appartenant à des citoyens français, travailleront dur et économiseront pour acheter leur propre parcelle de terre. Ils contribueront, malgré les réticences du gouvernement français, mais avec l’aide du baron de Vialar, à créer des villages comme Fort-de-l’eau, Aïn-Taya, Cap-Matifou ou Aïn-Beida. À Alger, ils cultiveront la plaine côtière du Hamma, entre le Champ de manœuvre et le Jardin d’Essai. Tous les témoins de cette époque vantent les qualités du Mahonnais. L’un écrit : Il est cultivateur de naissance ; il est sobre, économe dans son ménage et dans ses outils de culture, il est laborieux ; en outre il aime la vie de famille et a toutes les qualités de l’homme rangé et moral (14).
Un autre précise : aux environs d’Alger, des mahonnais, habiles jardiniers, exploitent ces terres et les louent sur le pied de 1000 à 1500 francs l’hectare ; le voisinage du marché et la quantité d’engrais de la ville leur permettent d’assez beaux bénéfices (15). Grâce à ces qualités, les terres qu’ils cultivaient allaient vite acquérir une valeur considérable(16).
Ayant surtout colonisé l’Algérois, les statistiques montrent un nombre croissant de Mahonnais à Alger, qui passent, entre 1833 et 1843, de 981 à 8 164(17).
En 1880, on compte plus de 10 000 Mahonnais dans l’Algérois, mais, dès 1864, le flux migratoire avait commencé à se ralentir. Au total, c’est 42% de la population minorquine qui avait émigré spontanément et volontairement en Algérie.
Deux de mes racines familiales sont d’origine minorquine. L’ancêtre la plus ancienne, mon aïeule à la sixième génération, est décédée, en 1835, à l’hôpital d’Alger. Veuve d’un jardinier, elle avait quitté Ciudadella, accompagnée de sa fille âgée de 20 ans. Il est possible qu’elle ait fait partie de ce groupe d’émigrés dont parle le vice-consul de cette ville dans une lettre datée du 5 février 1834 : Il s’agit, écrit-il, de quelques veuves avec leurs filles ; des gens de conduite exemplaire qui désirent aller là-bas pour voir si, avec leur travail, elles peuvent gagner de l’argent car ici le travail manque. Elles voudraient partir avant d’achever le petit capital qu’elles possèdent (18) . C’est probablement dans un certain dénuement qu’elle a succombé précocement, après son arrivée à Alger, en septembre 1835. Sa fille, qui exercera l’activité de commerçante, convolera, en 1838, avec un autre minorquin, jardinier de son métier. Leur propre fille se mariera, avec un de mes ancêtres lorrains, natif de Chalaines, dans la Meuse.
L’autre racine est formée d’un couple originaire de Mahon, arrivé en 1842. Le mari était menuisier et l’épouse sans profession. Ils avaient juste 21 ans et s’étaient mariés à Mahon. Leur fille, née à Alger, se mariera avec un autre de mes ancêtres lorrains, originaire d’Attilloncourt, dans l’ancien département de la Meurthe.
Ces ancêtres habitaient l’Alger barbaresque. C’était alors une petite cité construite sur un escarpement face à un îlot, le Peñon, avec une ville haute couronnée par la casbah, habitée par les Maures, et dont la blancheur triangulaire la faisait parfois comparer à la “voile d’un hunier de vaisseau”(19), et une ville basse où se trouvaient palais des corsaires, marchés et résidences des consuls. Mes ancêtres habitaient la ville basse, près de la Djenina, l’ancien palais du Dey, qui dominait la Place du Gouvernement. Celle-ci avait été dégagée après destruction d’un bloc compact de maisons et de souks qu’irriguait un réseau de ruelles étroites et qu’aéraient le Badestan, le Marché aux esclaves, où furent vendus Cervantès, Jean-François Regnard, le peintre Fra Filippo Lippi, Emmanuel d’Aranda, Diégo de Haédo et tant d’autres, et deux minuscules placettes, la place des Caravanes ombragée d’un figuier et la place du Jet d’eau devant la Djenina(20). Un Guide de 1836(21) en fait ainsi la description : Sur cette place, tous les matins, se tient le marché où les colons et les indigènes, après qu’à la porte Bab-Azoun, ils ont fait coucher leurs chameaux et attacher leur chevaux et baudets par les deux pieds de devant, apportent les produits de leurs jardins, de leurs basses-cours et de leurs chasses. Et le soir, quand le soleil a disparu, et que le canon de la station a annoncé l’heure de la retraite, des chaises sont disposées, un cercle brillant de femmes françaises, espagnoles et anglaises, et d’officiers, viennent se former pour entendre le concert des musiciens de la garnison, tandis que les maures et les juifs se promènent de long en large, pêle-mêle avec les négociants européens, et que les juives et les mauresques couvrent les terrasses des maisons qui entourent la place.
Devenue, en 1841, place Royale, désormais entourée de maisons européennes et ornée de la statue équestre du duc d’Orléans, c’était là que dorénavant, selon le rédacteur du Courrier d’Afrique cité dans un Guide de 1848(22), se promenaient pêle-mêle des Italiennes avec leurs robes aux couleurs tranchantes ; des Andalouses au petit pied cambré ; des Mahonnaises à la taille si souple, des Françaises de toutes sortes et de toutes qualités ; des femmes juives avec leur sarmah pyramidal (23) ; des jeunes Israélites couvertes de dorures, de soie et de velours ; des Mauresques enfin, qui ne laissent voir, sous les mille plis de la gaze qui les enveloppe, que leurs yeux ardents et la chair nue de leurs jambes. Puis des Mahonnais aux chapeaux pointus ornés de velours, des Maltais, des Allemands, des Français, des Nègres, des Arabes...
Les maisons de ces ancêtres étaient dans le quartier des Consuls, respectivement rue des Trois Couleurs où ils étaient voisins de l’élégant studio-atelier d’un éditeur d’art que fréquentaient des écrivains comme François Coppée, Pierre Louys ou les frères Margueritte(24), que peut-être ont-ils croisés, et rue de Navarin où avait été créée, en 1832, une école de dessin(25). Ce quartier était parcouru d’un lacis de ruelles étroites, ombreuses et fraîches que ventilait la brise iodée du large. Ces venelles étaient bordées de maisons copieusement blanchies à la chaux, qu’étayaient des rondins de thuya, et de palais turcs dont les magnifiques portes sculptées protégeaient des regards indiscrets les patios entourés de portiques à arcades ogivales outrepassées que supportaient de fines colonnettes. C’était là, qu’étaient concentrées, jusqu’à la fin du XIXe siècle, les institutions officielles comme la Préfecture, l’Ecole des Beaux-Arts, le Génie ou les Archives départementales. Plusieurs de ces palais avaient servi de résidences pour les consuls, au temps des turcs. C’est dans ce quartier très cosmopolite que résidaient les hauts fonctionnaires, les personnages marquants de la cité, mais aussi tout un petit peuple modeste et travailleur. Là, dans une ambiance encore barbaresque, s’était développée la vie européenne de l’Alger naissant. Mais, dès la fin du XIXe siècle, avec le déménagement des institutions officielles, le quartier se délabrera et prendra le nom de quartier de la Marine. Il n’en reste que peu de traces.
Au fil du temps, la mémoire familiale avait occulté ce passé minorquin. Ce n’est que grâce à mes recherches généalogiques que leur oubli a pu se dissiper.
La colonisation par les Franc-Comtois
et les villages départementaux
“L’armée est tout en Afrique, disait Bugeaud, elle seule a détruit, elle seule peut édifier. Elle seule a conquis le sol, elle seule le fécondera par la culture et pourra par les grands travaux publics le préparer à recevoir une nombreuse population civile”. Conduisant, dès 1841, la conquête de l’Algérie avec une brutalité qui lui sera reprochée, Bugeaud, dont la devise était “Ense et aratro”, se posant en héritier de la tradition romaine, souhaitera compléter sa conquête guerrière par l’établissement de colons militaires, soldats libérés ou libérables, construisant des villages dans un souci plus stratégique qu’économique. Cette tentative de peuplement, limitée, fut quasiment un échec, d’autant que la classe politique en France s’opposait, souvent avec virulence, à cette idée de colonisation(26).
Alors que les gouvernements précédents n’avaient su que faire de ce territoire conquis, c’est la seconde République qui essaya, après l’échec de Bugeaud, d’aborder la question du peuplement colonial. Dès le 19 septembre 1848, les députés avaient voté l’ouverture au ministère de la guerre d’un crédit de 50 millions de francs qui devait servir spécialement à l’établissement de colonies agricoles dans les provinces de l’Algérie et aux travaux d’utilité publique destinés à en assurer la prospérité. Sur ce crédit, la création de quarante-deux colonies fut entreprise dans les derniers mois de 1848 et douze autres dans l’année suivante, sur les même fonds.
Parmi ces dernières figurait Aïn Benian, près de Miliana. Les premiers villages furent utilisés pour résoudre la crise engendrée par la mise au chômage des ouvriers parisiens, lors de la fermeture des ateliers nationaux, en 1848(27). Pour éviter une révolte, le gouvernement libéral envoya en Algérie les ouvriers les plus turbulents et les plus dénués de ressources. Parmi eux, se trouvaient des ouvriers de la métallurgie, du textile ou de l’imprimerie, mais également des artisans charpentiers ou maçons, des commerçants et des employés. Ce fut le premier cas officiel d’importation massive de population française. Ce fut l’échec. On ne transforme pas un ouvrier citadin en paysan, dans un pays hostile(28).
La deuxième tentative eut lieu en 1852, après le coup d’état du Prince Président, le 2 décembre 1851. Les républicains révolutionnaires furent condamnés à l’exil en Algérie. Ce fut un nouvel échec. Rares sont ceux qui firent souche.
C’est dans ce contexte que naquit, en 1848, l’idée des villages départementaux. Celle-ci fut étudiée et propagée par un juge au tribunal de commerce d’Alger, M. Cœur de Roy, qui, dans un mémoire de la “Société agricole de l’Algérie”(29), fit appel au concours du gouvernement et des administrations préfectorales. Dans l’esprit des initiateurs, la seule manière efficace pour peupler l’Algérie et y apporter le progrès était de créer des villages à l’image des comptoirs fondés, dans l’antiquité, par les cités grecques de l’Asie Mineure. Une campagne de presse, favorable à ce projet, fut lancée On lit dans une chronique de mars 1853(30) : Un écrivain, M. Fr. Ducuing, a émis une idée féconde pour l’avenir de l’Algérie ; cette idée est de coloniser l’Algérie par départements (31) ... Cette idée, à peine émise, a pris faveur dans le public. Presque tous les journaux de Paris et de province ont reproduit et commenté la lettre de M. Fr. Ducuing, publiée d’abord par le Pays.
Ainsi pouvait-on lire dans Le Journal des Débats (32), sous la plume d’Armand Bertin : L’idée des villages départementaux dont M. Fr. Ducuing s’est fait le propagateur le plus actif consiste à prendre dans chaque département un contingent de colons volontaires et à l’installer en Afrique en centre de population distinct, conservant son appellation départementale... Cette idée aurait au moins l’avantage de substituer aux efforts individuels, impuissants jusqu’ici, des efforts collectifs et d’ensemble, nécessaires pour triompher du sol fécond mais rebelle de l’Afrique...
François Ducuing(33) expliquait ainsi son projet : Limitons à trois cents familles par département le contingent de chaque groupe colonial... On a calculé, en moyenne, à 4500 F l’établissement de chaque colon installé isolément en Algérie.
Cette moyenne peut être facilement réduite à 3000 F pour le colon pris collectivement... Dans certains départements, les centimes additionnels seuls combleraient toute la dotation du colon... Plus loin, il ajoute, un tant soit peu cynique : J’ai parlé des enfants trouvés. D’après les statistiques officielles on en pourrait distribuer au moins 8 000 tous les ans dans les divers villages départementaux [sic !]... Parlant de ces futurs colons, notre journaliste concluait, lyrique : Offrez leur un coin de terre qui leur rappelle leur patrie et vous les y verrez tous accourir comme un essaim d’abeilles dispersées par l’orage (34).
Le Sénat examina avec attention la pétition de Fr. Ducuing. Le rapporteur écrivait : Ce système de colonisation offrirait de grands avantages, mais il faudrait qu’il soit plutôt encouragé que prescrit par l’administration, et qu’il se produisit par la libre initiative des colons. Il faudrait surtout qu’il perdit le caractère trop rigoureux que voudrait lui donner le pétitionnaire (35) . La pétition fut renvoyée au ministre de la guerre.
La Haute-Saône se trouvait, alors, en grande difficulté. Y sévissaient le choléra, la maladie de la pomme de terre, l’insuffisance des récoltes(36). Ému par ces misères qui poussaient les paysans de son département à émigrer, le préfet de la Haute-Saône, Hyppolite Dieu(37), fut séduit par le projet. Il fut donc décidé de créer un village franc-comtois. Le ministre de la guerre affecta aux futurs émigrants un village tout bâti, Aïn Benian, qui faisait partie des “colonies agricoles” de 1849 et allait se trouver libre par suite du départ des déportés politiques. Désormais, le futur village prendrait le nom symbolique de Vesoul Benian. La propagande fut très active dans les campagnes, sur les marchés, sur les champs de foire. Le résultat fut que, en un mois, quarante huit familles déposèrent leur candidature. Je suis originaire de deux de ces familles qui s’allieront plus tard, en Algérie. L’une, réunissant le grand-père, Jean-Claude Lamboley, qui était veuf et déjà âgé de 78 ans, son fils, Jean-François Auguste, et son épouse, ainsi que leurs deux garçons, habitait le village de La Lanterne-et-les-Armonts, dans le canton de Luxeuil. L’autre, formée de Romain-Joseph Grand’haye, son épouse et leurs deux filles, demeurait à Fleurey-lès-St-Loup, dans l’arrondissement de Lure.
Pour réaliser cette aventure ils vendirent tous leurs biens qui étaient modestes. Chaque famille possédait un patrimoine représenté par une maison, un jardin, des prés et des vergers, d’une superficie de 3 hectares, d’une valeur d’environ 1500 francs(38). Répertoriés depuis le XVIe siècle comme propriétaires ou laboureurs, parfois maires de leur village, certains même qualifiés dans des actes de seigneurs d’une terre, ils avaient vu leurs biens s’amenuiser progressivement et dramatiquement, depuis le début du XIXe siècle, en raison des partages successifs qu’imposaient les règles successorales mises en place par le Code Napoléon. Sous la pression des exigences économiques, ils estimèrent que la seule chance de donner un avenir décent à leurs enfants était de s’expatrier et de tenter leur chance en Algérie.
D’abord favorable au projet, le gouvernement marqua très vite beaucoup de réticence, freinant la fondation de deux autres colonies franc-comtoises, à l’initiative de Lure et de Gray, que souhaitait le préfet Dieu, et bloquant la création de villages souhaitée par d’autres départements (39). La crainte de créer des communautés homogènes susceptibles de s’opposer au régime impérial et l’influence des milieux indigènophiles furent cause de cet arrêt(40). Mais, comme l’entreprise de Vesoul Benian était trop avancée, on la laissa se poursuivre en veillant à éviter tout échec.
L’autorité militaire s’étant intéressée à la création de cette nouvelle colonie, elle dépêcha sur place un officier, le lieutenant Durand(41), pour accompagner cet exode.
Le premier convoi arriva à destination le 7 septembre 1853 ; les autres s’échelonnèrent les 14 et 23 septembre, les 6 et 17 octobre, les 5 et 17 décembre. 48 familles, soit 274 émigrants, 5 personnes en moyenne par famille, participaient à l’aventure.
Dans une lettre non datée (42) dont l’orthographe et la syntaxe ont été conservées, un colon raconte le déroulement du voyage et l’accueil à Vesoul Benian : Je vais vous raconter, en général, ce qui s’est passé depuis notre départ. Ainsi, nous sommes arrivés à Marseille avec une fatigue encore supportable, mais embarqué le 25 septembre, comme vous le savez, ç’a été le commencement des peines que nous avons eu à supporter. Je ne peux vous faire comprendre l’influence que cette malheureuse eau de mer a sur certains individus... Arrivé à Alger, nous avons été reçus dans une maison, nourris et couchés aux frais de l’Etat. Nous nous y sommes reposés cinq jours. De là, nous sommes repartis pour notre nouvelle demeure. Nous y avons été transbordés sur de grosses charrettes traînées par des mulets. Nous avons restés trois jours pour faire ce trajet. Donc nous avons couchés deux nuits, l’une dans une écurie sur la paille, l’autre, à la belle étoile au milieu des broussailles.
Nous avons restés deux jours pour 50 km de Blida à chez nous où nous avons couché dehors... En arrivant, on nous a donné une maison, mais il y avait dans cette maison ni pain, ni pâte, ni vin, ni eau, pas même de quoi se mettre assis, à plus forte raison pour se coucher et réparer ses forces affaiblies... on nous a donné cependant quelques tréteaux et des planches pour mettre dessus afin que nous soyons pas obligés de coucher sur le carreau... Nous avions seulement une couverture, une paillasse vide et un drap pour coucher douze personnes. On nous a délivré nos concessions qui ne sont pas aussi régalantes [sic] que nous le pensions d’abord. On m’a donné une maison à trois chambres, je viens d’en faire bâtir une. En plus de tout cela, le Gouvernement, par l’intermédiaire de notre Directeur, vient de nous donner à chacun un bœuf, une charrue, une herse et 26 double décalitres de blé pour ensemencer. Tout cela gratis. J’ai acheté un bœuf pour 120 F, donc j’en ai deux et un mulet pour 250. Depuis notre départ nous n’avons pas eu de pluie. Donc il nous tarde qu’il pleuve pour pouvoir commencer les semailles.
Le village, que les émigrants découvraient, se situait dans une zone montagneuse, à 86 kilomètres d’Alger. Il possédait 27 maisons doubles et 9 maisons simples, toutes construites sur le même modèle par le génie militaire. Elles se composaient d’un carré de construction de 24 mètres de long et 4 mètres de large, coupé par un mur de refend en deux parties égales destinées à loger deux ménages ; chaque moitié comprenait deux à trois pièces, l’une formant cuisine, les autres chambres à coucher. Sept maisons doubles étaient réservées pour l’église, le presbytère, la maison commune, la salle d’asile, l’école, la maison des sœurs et le logement du médecin. Le village était protégé par une enceinte rudimentaire faite d’un talus en terre, d’un fossé et de quatre portes. Sa forme était celle d’un rectangle de 513 mètres de long sur 305 mètres de large. Il était percé de sept rues, bien alignées, se coupant à angle droit ; les rues principales et les boulevards extérieurs étaient plantés de mûriers(43). La configuration était celle du plan type préconisé par le génie militaire pour les villages agricoles(44).
Le 3 décembre 1853(45), le même colon détaille les conditions d’existence en ce début de colonisation : Description du pays : ce n’est qu’une montagne, mais montagne énorme... La terre est une terre de sable tirant sur la terre forte, de sorte que par beau temps vous diriez marcher sur de la terre mêlée à moitié de sable.
Quand il pleut, vous diriez marcher sur cette bonne terre à turquie (46) qui prend aux chaussures comme la poix [sic]. Enfin, on a tiré les concessions au sort, le lot qui nous est arrivé est passablement en plaine : il y a de quoi y faire champ et pré. Enfin, nous avons encore un autre petit lot de 2 hectares ou 23 quartes, puis un autre de 3 quartes que l’on dit être pour un jardin : c’est celui que je crois le plus difficile et le plus mauvais. Encore un autre de 4 quartes que je crois très bon. De plus, on nous a prêté dans l’enceinte du village un beau et bon petit jardin, mais il n’est à nous que jusqu’à ce qu’il vienne du monde pour y bâtir...
Ce sont les colons, à la fois agriculteurs et commerçants, qui sont les plus satisfaits. L’un d’eux, boulanger, écrit : Nous sommes parfaitement logés...
Nous n’avons pas eu la moindre maladie. Nous sommes dans un village bien sain ; nous avons de la bonne eau et suffisante pour la consommation du village... Nous vendons tous les jours 50 à 60 miches de pain ; j’ai fait mon compte au bout de 8 à 6 jours, j’ai trouvé un bénéfice de plus de 80 F (47). Pendant longtemps, la création de Vesoul Benian fut considérée comme une réussite, à tel point que, lorsque le couple impérial se rendit à Miliana, lors de son voyage officiel en Algérie, il fit un détour pour visiter ce village, le 7 mai 1865. Nous en avons une description circonstanciée du temps :
A la hauteur de Vesoul Benian, la route dans les capricieux méandres qu’elle décrit à travers ravins et montagnes, laisse sur sa droite ce village pittoresque, aux blanches maisons, entourées de belles plantations, et si coquettement accrochées au flanc d’un large mamelon, dont le regard aperçoit de loin la luxuriante végétation.
Vesoul Benian, dont les habitants s’adonnent avec un succès remarquable à la culture de la vigne, à la production des céréales et à l’élevage du bétail, représente, sur une échelle restreinte, la réalisation pratique d’une idée déjà ancienne, et qu’on a voulu systématiser, celle des villages départementaux. Les habitants, qui, on le sait, empruntent leur nom au chef-lieu du département dont ils sont originaires, étaient tous accourus sur la route, où ils avaient dressé un arc de triomphe d’un caractère rustique, mais dont la décoration ne laissait rien à désirer, sous le rapport du bon goût. A peine arrivée parmi eux et saluée avec enthousiasme des cris de Vive l’Empereur ! Vive l’Impératrice ! Vive le Prince Impérial ! Sa Majesté a daigné s’entretenir de leurs intérêts et de leurs besoins avec les autorités municipales ; puis, après avoir reçu de leurs mains quelques pétitions, elle a repris sa route suivie de leurs acclamations (48).
Cependant, Victor Demontès dressait, en 1903, un bilan plus que mitigé(49). Pour différentes raisons que j’ai déjà analysées(50), la réussite était loin d’être éclatante. Du fait des difficultés de la vie de colon, certains des enfants issus des pionniers, devenus adultes et ayant fondé une nouvelle famille, quittèrent, très tôt, le village pour s’installer dans d’autres contrées réputées plus riches ou des villes plus attrayantes, comme Alger. Cet exode, c’est indéniable, aggrava la décadence du village. Ce fut le cas de mes arrière-grands-parents. Dès 1866, peu de temps après leur mariage, convaincus que rester au village conduirait à une vie médiocre, Joseph-Sylvain Lamboley et son épouse, Marie-Catherine Grand’Haye, enfants des pionniers, abandonnèrent leur famille restée au village pour tenter leur chance à Alger. Cependant, malgré les difficultés, d’autres enfants de ces pionniers s’accrochèrent à leur terre. Ce fut le cas de certains membres de ma famille qui restèrent sur place. A la fin du siècle, un de mes parents apparaîtra comme un des plus gros propriétaires des lieux avec 41 hectares, ce qui, compte tenu des conditions locales, était loin d’être rémunérateur, mais témoignait de son acharnement au travail. Leurs descendants luttèrent jusqu’à l’Indépendance. Ce n’est que dans ces circonstances dramatiques que, la mort dans l’âme, ils consentirent à quitter le village, où ils avaient tant peiné, pour s’expatrier, certains en métropole, d’autres plus aventureux au Maroc ou au Canada. Ils avaient tout perdu...
La colonisation par les Lorrains et les Alsaciens
La migration venue du nord de la Lorraine et de l’Alsace vers l’Algérie a été relativement importante, et cela dès 1845, pour des raisons à la fois démographiques et économiques. Le pays est, à cette époque, au bord de la famine ; en causes les récoltes de blé désastreuses en 1845 et 1846 par suite des grands froids hivernaux, les inondations dans le centre de la France qui empêchaient l’acheminement des céréales étrangères, bloquées dans les ports, et la maladie de la pomme de terre provoquée par le mildiou qui sévit dans toute l’Europe(51). Cette immigration s’est faite en deux vagues.
La première vague, entre 1830 et 1860, correspond à la conquête militaire puis au peuplement systématique. Entre 1846 et 1856, on estime à environ 7 600 le nombre d’Alsaciens ayant émigré en Algérie. Ces migrants Alsaciens-Lorrains ont constitué, alors, entre un cinquième et un quart de la population française d’Algérie(52). Un ralentissement se produira dans les années 1860 à 1870, avec la colonisation capitaliste voulue par Napoléon III. Je descends de tout un bouquet de gens de l’Est, originaires de Lorraine, qui illustrent cette première vague. Ils sont natifs des villages de Bazincourt-sur-Saulx, Aulnois-en-Perthois, Triaucourt, Vaubecourt, qui se situent dans un rayon de quelques kilomètres autour de la ville de Bar-le-Duc, ou du village de Chalaines, près de Vaucouleurs. On peut suivre leur trace depuis le XVIIe siècle. Ce sont, pour la plupart, des laboureurs. Mais on retrouve aussi, pêle-mêle, des vignerons, des artisans, un commissaire aux poudres, des procureurs fiscaux, un receveur de l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne, des employés au service du Roi et même un capitaine du château de Triaucourt anobli, le 7 février 1667, par Charles IV, duc de Lorraine. Ils ont survécu aux bandes d’Écorcheurs en 1437, aux épidémies de peste en 1585 et en 1630, aux famines de 1626, aux invasions protestantes pendant les guerres de religion, aux horreurs de la guerre de Trente ans... Mais, au XIXe siècle, il est manifeste qu’ils ont subi de49 Académie des Sciences et Lettres de Montpellier sévères revers de fortune. C’est donc, poussés par des nécessités économiques, qu’ils décident d’émigrer en Algérie, dès 1851. Ils seront parmi les pionniers qui participeront à la création de Rovigo, village de la Mitidja à 25 kilomètres au sud d’Alger.
Rovigo fait partie des 19 centres nouveaux, nés dans la Mitidja, faisant suite à la création des “colonies agricoles” de 1848. Décidée le 26 septembre 1845, cette création n’aboutira qu’en 1849 du fait de la difficulté que rencontra l’Administration dans la constitution du territoire de ces centres, en raison du retard pris dans les expropriations. Ces dernières ne furent approuvées par le ministre que le 31 août 1851.
A l’origine, ce village devait comprendre soixante concessions de six hectares en moyenne avec au moins un hectare de terres irrigables, mais comme les prélèvements nécessaires pour l’emplacement du village, du cimetière, des routes, des chemins, réduisaient les concessions à environ cinq hectares, le projet fut remanié et comporta vingt-six concessions de six à sept hectares, quinze concessions de cinq à six hectares et dix-neuf concessions de quatre à cinq hectares. Sur le modèle traditionnel, le plan de Rovigo était carré avec cinq lots réservés à la Mairie, l’école, la gendarmerie, une fontaine et un abreuvoir. La prise de possession eut lieu dans les premiers jours de novembre 1851. Les familles qui, au début, habitaient de simples baraques se mirent immédiatement au travail. Dès la fin de décembre, Rovigo comptait déjà une population de deux cent soixante-sept personnes. Trois mois plus tard, toutes les familles étaient installées dans le nouveau centre, six maisons en maçonnerie étaient achevées et cinq autres commencées. Bien que leur établissement ait eu lieu à une époque où les travaux des champs étaient déjà commencés, les colons avaient pu néanmoins ensemencer quarante-cinq hectares en céréales et planter mille six cents arbres ; de son côté, l’Administration en avait planté mille cents sur les places, les boulevards et les routes situées aux abords du village. A la fin de 1854, Rovigo s’était bien transformé : deux cent trente-neuf hectares sur quatre cent cinquante-sept étaient mis en culture, deux cents hectares ensemencés en céréales et dix plantés en tabac.
Mais, comme à Vesoul-Benian et comme dans beaucoup de ces villages mal préparés où les colons furent souvent livrés à eux-mêmes, ces derniers sont confrontés aux mêmes difficultés. Les fièvres, des mauvaises récoltes, l’insuffisance des concessions en décourageront plus d’un. Malgré des accroissements successifs par l’administration des superficies allouées, le village se dépeuplera. En 1860, il restait moins de deux cents habitants, dont trente-huit concessionnaires ; à la suite de mutations ou d’acquisitions, vingt-deux d’entre eux possédaient moins de quatre hectares de terre, douze de vingt à trente. Les autres propriétaires n’habitaient pas la localité et louaient leurs terres soit à des colons du village, soit à des fermiers. Le dépeuplement ne fit que s’accentuer par la suite : on relevait, en 1867 (53), 277 Français et 79 étrangers, il ne restait plus que vingt-six anciens concessionnaires en 1868. Mes ancêtres, pour la plupart, quitteront Rovigo pour s’établir à Alger, dans les années 1860. Mon aïeul s’unira, à cette date, avec une jeune fille dont les parents étaient originaires de Minorque.
La seconde vague est consécutive à l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine par la Prusse, en 1871(54). C’est en raison du fait qu’il y avait déjà un premier noyau d’Alsaciens-Lorrains que le cardinal Lavigerie, archevêque d’Alger et ancien évêque de Nancy, lança un appel, relayé par la presse catholique, pour l’accueil des exilés qui optaient pour la nationalité française. Les députés parisiens voteront, le 21 juin 1871, des crédits pour installer sur 100 000 hectares confisqués en Algérie, suite au séquestre des insurgés de 1871, plus de 6 000 émigrants, entre 1871 et 1874. La loi du 15 septembre 1871 prescrivit les modalités d’acheminement vers l’Algérie et d’installation dans les centres des nouveaux émigrants. Les premiers départs eurent lieu dès l’été 1871 ; mais ces premiers émigrants furent victimes de nombreuses difficultés et désillusions. Les causes en étaient multiples : l’absence de préparation de la part du gouvernement français et de l’administration algérienne, une évidente résistance de celle-ci, à quoi on peut ajouter une certaine anarchie dans l’émigration. Effet, au départ de celle-ci, surgissait une difficulté décisive : l’administration n’était pas en mesure d’informer efficacement les Alsaciens-Lorrains placés dans les territoires annexés sous l’autorité hostile de la Prusse. Par ailleurs, il s’avérait impossible de le faire au moment où les émigrants entraient en France ; beaucoup, en effet, ne jugèrent pas utile de se signaler à une quelconque autorité.
Enfin, les terres qui devaient revenir aux colons n’étaient pas encore toutes saisies officiellement à cette date. Aussi, à la fin de juin 1872, fort peu de colons étaient convenablement installés. Ce n’est qu’au décours de l’été 1872 que la période d’hésitation et d’improvisation prit fin. Désormais, la colonisation sera menée avec plus de méthode et plus de moyens.
Un rapport de 1873(55) évaluait à 2 500 le nombre d’Alsaciens-Lorrains ayant émigré en Algérie après la guerre, soit 449 familles dont seules 32, qui pouvaient justifier d’un capital de 5 000 francs, avaient reçu des concessions en toute propriété, dans la mesure où elles se portaient garantes de leur mise en valeur ; les 417 autres, qui étaient sans ressources, bénéficiaient de l’aide de riches associations comme la “Société de protection des Alsaciens-Lorrains demeurés français”. Pour ces derniers, les concessions se transformaient en un bail de neuf ans, au-delà duquel la résidence et la mise en valeur conféraient le droit de propriété. Le mouvement ne se tarira que progressivement jusqu’à la fin du siècle. Au total, entre 1874 et 1914, l’Algérie accueillera 12 000 à 15 000 Alsaciens-Lorrains. Cette migration donnera naissance à un mythe politique et nationaliste, identifiant l’Algérie à une nouvelle Alsace-Lorraine, mythe d’abord dirigé contre l’Allemagne, puis, plus tard, récupéré contre le nationalisme algérien séparatiste(56).
A l’évidence, cette installation ne s’est pas faite toujours sans déconvenue, soit que les émigrants aient été escroqués comme ces strasbourgeois qui, avaient acheté, en 1863, à Strasbourg, des terres alloties au village d’Oued Seguin, qui n’étaient pas à vendre(57) ; soit que, prenant possession de lots appartenant à l’État, ils ne trouvent pour y vivre que des gourbis rudimentaires en roseaux pour y loger famille et bétail, comme dans le village de l’Alma(58) ; soit qu’ils se découragent du fait d’une succession de mauvaises récoltes ou d’une insuffisance relative des concessions. Cependant, dans l’ensemble, cette implantation fut une réussite.
Une souche lorraine familiale, plus récente, illustre la volonté des Lorrains de refuser l’annexion de leur région par la Prusse. Elle était originaire d’Attilloncourt, dans l’ancien département de la Meurthe. Mon ancêtre, orphelin d’un père tisserand, à l’âge de 10 mois, et de sa mère, à l’âge de 4 ans, élevé par sa grand-mère, sera pris par la conscription en 1855 et incorporé au 19e bataillon des chasseurs à pied. Le 4 juin 1859, il participe, sous les ordres du commandant Le Tourneur, à la bataille de Magenta. Le lendemain, à l’aube, dans un court mais violent combat à Ponte di Magenta, il est blessé d’un coup de feu au menton et d’un coup de baïonnette à la face. Ces blessures lui éviteront de participer à la boucherie de Solferino, mais pour son courage, il sera décoré, par décret impérial en date du 17 juin, de la médaille militaire nouvellement créée. La campagne d’Italie, commencée le 25 avril, se termine le 31 juillet 1859. Il reçoit, par décret de l’Empereur en date du 11 août 1859, la médaille commémorative de la campagne d’Italie. Sans famille, sa grand-mère étant morte, il décide de rengager au terme de son service militaire. Au gré de ses affectations, il monte en grade.
La guerre de 70 le trouve en Algérie. Le 31 octobre 1872, à la suite de l’annexion du département de la Meurthe par la Prusse, en application des traités du 10 mai et du 11 décembre 1871, il opte pour la nationalité française. Il s’unit, alors, avec une jeune fille minorquine et se fixe définitivement à Alger, où il prend sa retraite et fera souche.
Ces trois racines formeront un tronc dont certains des derniers représentants choisiront, dès 1957, de se replier définitivement en Métropole, à Montpellier. Grâce à la clairvoyance de mon père, cet exode se fit, pour nous, à temps et sans drame particulier si ce n’est notre déracinement. D’autres attendront le terme ultime pour s’expatrier. Les “colons”, qu’ils étaient, devenaient, à leur insu, des “pieds-noirs”, dénomination qui s’imposera après l’Indépendance(61).
Longtemps abusés par le mythe fallacieusement entretenu que l’Algérie était la France, ces pieds-noirs subirent l’exode après l’Indépendance dans un dénuement dramatique et une détresse profonde. Cette expatriation fut vécue comme une déchirure douloureuse, un nouveau déracinement après celui qu’ils avaient accepté en venant en Algérie. Mais pour certains, ce fut bien pis. Les étrangers, maltais, italiens, espagnols qui, depuis plusieurs générations, avaient acquis la nationalité française en venant en Algérie, qui avaient témoigné de leur loyauté pendant les deux guerres mondiales, qui avaient versé leur sang pour défendre la France, eurent l’impression de perdre leur identité. D’autant que l’accueil, en Métropole, du fait d’amalgames injustes et d’une désinformation démagogique, fut parfois très hostile(62). Ce double rejet, de l’Algérie et de la France, les marquera durablement.
“On ne voulait pas de nous !” reste encore le leitmotiv d’une grande majorité des rapatriés !
Bien sûr, il y a eu quelques gros colons, comme il y avait, en métropole, de grandes familles. Leur influence politique n’a pas toujours été heureuse et l’image de grands latifundiaires qui leur était accolée, fut grandement néfaste. Mais la colonisation fut essentiellement le fait de gens modestes et travailleurs, à l’image de cette “famille ordinaire”, qui s’acharnèrent à féconder une terre ingrate. Motivés par une volonté d’entreprise, animés d’un esprit d’aventure, ils ont tous en commun d’avoir choisi l’inconnu et l’espoir de liberté et de progrès, plutôt que la précarité et la médiocrité, et cela malgré les difficultés, les maladies, les désillusions, voire les découragements. On est loin du cliché que certains ont voulu répandre du riche colon exploitant les autochtones. C’étaient des hommes enracinés et leurs villages possédaient son cimetière où ils reposaient, leur vie de labeur terminée. Ce sont eux qui ont défriché un sol ingrat, assaini des marais, planté de la vigne, semé du blé, là où il n’y avait que terres incultes ; ce sont eux qui ont construit des routes, des voies ferrées, des barrages, des hôpitaux, des écoles, là où il n’y avait rien ; ce sont eux qui ont rêvé d’un peuple nouveau fusionnant races, langues et culture(63). Mais ce n’était qu’un rêve qui s’est fracassé contre une dure réalité : la fusion essentielle, celle avec les indigènes, ne s’est jamais faite. Une guerre est née d’un sentiment de frustration de ces derniers, d’un reproche de spoliation, d’une accusation d’injustice.
Peut-être aurait-elle pu être évitée, mais cela n’est-il pas un autre rêve ?
Certes, ces colons, et tout particulièrement mes ancêtres, n’ont pas fait l’Histoire, mais ils y ont participé et surtout ils l’ont subie. Par cette communication, j’ai souhaité leur rendre hommage.
NOTES
(1) LAMBOLEY C. : Une colonie franc-comtoise en Algérie au XIXe siècle. Bull. Académie des sciences et lettres de Montpellier. NS. 2004,35, 183-199.
(2) L’expression désigne, sous Louis Philippe, les hommes distingués, les aristocrates. Ainsi, Alphonse Karr écrivait en 1841 : “Il n y a plus que deux classes d’hommes en France... ceux qui portent des gants jaunes et ceux qui n’en portent pas. Quand on dit d’un homme qu’il porte des gants jaunes, qu’on l’appelle un gant jaune, c’est une manière concise de dire un homme comme il faut. C’est en effet tout ce qu’on exige pour qu’un homme soit réputé comme il faut”.
(3) Une des figures les plus marquantes de ces “colons en gants jaunes” fut le baron de Vialar, d’origine languedocienne, installé à Kouba. Il faut également signaler les de Tonnac-Villeneuve, installés à Tixeraïn, les Coput, les de Bonnevialle, les de Croizeville, les de Franclieu, les de Lapeyrière, les de Saussine, les Delpech, les de Montaigu, les Dupré, les Mercier, les Rosey, les de Saint-Maur, les de Saint-Guilhem, les Tabler, les Ventre.
(4) C’est à eux que fut attribué primitivement le dénominatif de “colon”, c’est-à-dire de propriétaire autodidacte, cultivateur et tenancier d’une terre à l’image des grands propriétaires des Amériques françaises, exploitants d’esclaves, qu’ils ne furent jamais. Le terme sera ensuite élargi à tous les civils européens peuplant l’Algérie.
(5) Dès 1835, une concession de 3000 ha avait été attribuée, à la Rassauta, au prince Mir Mirsky, chassé de son pays par la révolution polonaise. Criblé de dettes, le prince dut rétrocéder, en 1843, sa concession qui fut reprise par l’administration, en septembre 1849.
(6) MONBEIG P. : Vie de relations et spécialisation agricole au XVIIIe siècle. Annales d’histoire économique et sociale. 1932, vol. 4, n° 18, 538-548.
(7) TUDURY G. : La prodigieuse histoire des Mahonnais en Algérie. De Minorque en Algérie à partir de 1830. Lacour, éd., Nîmes, 2003, pp. 86.
(8) Archives du vice-consulat de France à Ciudadella, citées par Tudury G., Op. cit., supra note n° 7, p. 48.
(9) Lettre du consul de France aux îles Baléares, du 5 février 1831. Archives du vice-consulat de France à Ciudadella, citée par Tudury G., Op. cit., supra note n° 7, p. 48.53 Académie des Sciences et Lettres de Montpellier
(10) Liste d’embarquement des espagnols migrants vers l’Algérie : V.
http://lecapmatifou.free.fr/passagesCiutadella.
(11) Lettre du consul de France aux îles Baléares, du 28 septembre 1841. Archives du vice-consulat de France à Ciudadella, citée par Tudury G., Op. cit., supra note n° 7, p. 57.
(12) Lettre du consul de France aux îles Baléares, du 6 décembre 1832. Archives du vice-consulat de France à Ciudadella, citée par Tudury G., Op. cit., supra note n° 7, p. 54.
(13) Le nom officiel de “Possession française dans le nord de l’Afrique” apparaît pour la première fois dans une ordonnance du 22 mars 1832, et celui d’ “Algérie” dans une lettre officielle du Maréchal Soult, ministre de la Guerre, au général Valée, en 1838, que confirmera l’Ordonnance du Roi des Français n° 7654 de 1838 relative à “L’administration civile en Algérie”.
(14) TOUZET J. : La France d’Afrique ; du mode d’aliénation des titres de colonisation en Algérie. Alger, chez les principaux libraires. 1856. pp.76. p. 16,
(15) FORTIN D’IVRY T. : L’Algérie, son importance, son organisation, son avenir. Rignoux, impr. de la Société Orientale. Paris. 1845. pp. 44.,
(16) Une propriété de moins de deux hectares se loue jusqu’à 2.000 francs. “Les fermiers Mahonnais paraissent faire très bien leurs affaires” in Tableau de la situation des Etablissements Français dans l’Algérie. Paris, 1841, p. 147.
(17) LESPÈS R. : Alger. Étude de géographie et d’histoire urbaine. Coll. du centenaire de l’Algérie. Paris. Lib. Félix Alcan. 1930, pp.860., p. 568.
(18) In Tudury G., Op. cit., supra note n° 7, p. 21.
(19) PEYSONNEL J.-A. : Relation d’un voyage sur les côtes de Barbarie fait par ordre du Roi en 1724 et 1725. Paris. Dureau de la Malle éd.. 1838, p. 415.
(20) LESPÈS R. : Op. cit., supra note n°17, p.165 et s.
(21) PIGNEL A. : Conducteur ou guide du voyageur et du colon de Paris à Alger et dans l’Algérie. Paris chez Debecourt, libr-édit., septembre 1836, pp. 249, p. 123.
(22) QUETIN E. : Guide du voyageur en Algérie. Itinéraire du savant, de l’artiste, de l’homme du monde et du colon. Paris. L. Maison impr. édit., 1848, p. 151-152.
(23) Le sarmah est une coiffure conique, proche du hennin, en or, argent ou cuivre découpé en filigrane qui coiffait les femmes juives.
(24) Jules Gervais-Courtellemont éditait, entre autres, la collection de l’Algérie Artistique et Pittoresque.
(25) GAUTHIER F. : Le quartier de la Marine. Conférence faite le 16 juin 1941. Feuillets d’El-Djezaïr. N.S. juillet 1941. p. 16-33.
(26) DEMONTÈS V. : La colonisation militaire sous Bugeaud. Larose. Paris/Alger 1917.
(27) DEMONTÈS V. : Les colonies agricoles de 1848. Congrès de la colonisation rurale. Monographies algériennes 3. Alger 26-29 mai 1930. Alger, anc. impr. Victor Heinz. p. 1-24.
(28) LARDILLIER A. : Le peuplement français de l’Algérie de 1830 à 1900 - Les raisons de son échec - Editions de l’Atlanthrope - 1992. pp. 108.
(29) CŒUR DE ROY : Mémoire tendant à appeler le concours du gouvernement et des administrations départementales pour l’exécution du projet d’établissement en Algérie de 86 colonies agricoles et industrielles sous la dénomination de colonies départementales. Alger, Impr. de A. Bourget.1853. pp.27.
(30) ESCHAVANNES E. d’: Chronique du mois. Revue de l’Orient,. Bulletin de la Société orientale de France. Mars 1853, T. 13. Paris. Au bureau de la Revue, chez Just Rouvier, libr., p. 192.
(31) DUCUING F. : Les villages départementaux en Algérie. Paris, 1853, Schiller Aîné, impr.-libr., pp. 48.
(32) BERTIN A. : Journal des Débats du lundi 14 février 1853.
(33) François Ducuing (1817-1875), journaliste économique du Second Empire et homme politique de la Troisième République, collaborateur au Pays, puis à plusieurs journaux républicains de Paris comme la Réforme, le National et la Liberté. Fondateur du journal économique le Conseiller, en 1852. Député des Hautes-Pyrénées, en 1871.
(34) DUCUING F. : Villages départementaux en Algérie. Revue de l’Orient, de l’Algérie et des colonies. Bulletin de la Société orientale de France. Juillet 1853, T. 14. Paris. Au bureau de la Revue, chez Just Rouvier, libr., p. 29-36.
(35) PEY A. : Chronique politique. Revue contemporaine, Paris, 1864, 2° série, T38, vol. 73, p. 655.
(36) DUVAL J. : L’Algérie et les colonies françaises. Paris, Lib. Guillaumin et Cie, 1877, pp. 354, p. 33.
(37) Hyppolite Dieu (1812-1887). Ancien journaliste puis avocat, secrétaire du gouvernement provisoire de la République en 1848, préfet de Mayenne puis de la Haute-Saône de 1850 à 1860. Dictionnaire biographique de la Haute-Saône. Salsa 2005.
(38) Archives familiales.
(39) Onze départements s’étaient portés volontaires : la Haute-Saône, le Dauphiné, la Meuse, la Seine-Inférieure, l’Orne, le Morbihan, la Charente-Inférieure, le Cantal, la Nièvre, le Gers et l’Ariège.
(40) BELHASENE T. : La colonisation en Algérie : processus et procédures de création des centres de peuplement. Institutions, intervenants et outils. Thèse Université Paris VIII. 2006, pp. 619., p. 375.
(41) V. sa biographie in Le soldat laboureur. Revue patriotique, militaire et agricole, numéro du 2 mai 1880. p. 40.
(42) Lettre probablement écrite en octobre ou novembre 1853. Archives privée.
(43) FRANC J. : Les premiers colons Franc-comtois en Algérie. Revue Franche-Comté, Monts Jura et Haute Alsace. Février 1930, n° 127, p. 25-26.
(44) CAOM Aix-en-Provence, Archives du gouvernement général L6 et L32.
(45) Archives privée.
(46) Selon Littré : terre à turquie : terre à blé de Turquie, nom donné improprement au maïs.
(47) FRANC J. : Op. cit., supra note n°43.
(48) F. (signé) : Voyage de S.M. Napoléon III en Algérie contenant l’histoire du séjour de S.M. dans les trois provinces... avec des notices géographiques. Alger. Bastide édit. Juillet 1865. p. 82-90.
(49) DEMONTÈS V. : Vesoul Benian, une colonie franc-comtoise. Bull. de la soc. géogr. d’Alger et de l’Afrique du nord. 1903, 8e année, 1er trimestre, p. 365-427.
(50) LAMBOLEY C. : Op. cit., supra note n° 1.
(51) PERCEBOIS G : La maladie de la pomme de terre en 1845. Ses aspects en Lorraine. Mémoires de l’Académie nationale de Metz. 1984, p.175-191.
(52) FISCHER F. : Migration séculaire et émigration mythique : la colonisation alsacienne-lorraine en Algérie de 1830 à 1914, Thèse, Aix en Provence, 1994 - Alsaciens et Lorrains en Algérie. Histoire d’une migration. 1830- 1914. Serre Editeur et Editions Jacques Gandini. Nice. 1999, 174 pp.
(53) BÉRARD V. : Description d’Alger et de ses environs. Alger. Bastide libr.-édit. 1867, p.106-107.
(54 WAHL A. : L’option et l’émigration des Alsaciens-Lorrains (1871-1872). Paris, Orphys1974, pp. 276. Thèse Strasbourg soutenue sous le titre : “Les Problèmes de l’option et de l’émigration des Alsaciens-Lorrains en 1871-1872”
(55) GUYNEMER M. : Situation des Alsaciens-Lorrains en Algérie. Mars 1873. Paris, Impr.centr. des chemins de fer. A. Chaix et Cie. 1873
(56) PERVILLÉ G. : L’Alsace et l’Algérie : de la réalité au mythe. Bull. de l’Association, mémoire du mouvement social. 2003, n°4, p. 5-7.
(57) Le Petit Journal, n° 3361 du 10 mars 1872, p. 3.
(58) GUYNEMER M. : Op. cit., supra n°55, p. 23.
(59) DEMONTÈS V. : Le peuple algérien. Essais de démographie algérienne. Imprimerie algérienne. Alger 1906. 619 pp., p. 189-240.
(60) MANDEVILLE G. et DEMONTÈS V. : Études de démographie algérienne. Les populations européennes. Leur accroissement, leur densité et leurs origines. Revue des Questions diplomatiques et coloniales. Paris. T 10. 15 août 1900. p.193-211.
(61) Expression réservée aux seuls européens, majoritairement français, installés en Algérie, de 1830 à l’Indépendance. Aucune explication définitive n’existe à l’heure actuelle sur l’origine de cette dénomination.
(62 V. l’interview de Gaston Deferre, maire de Marseille : “Que les pieds-noirs aillent se réadapter ailleurs” , in Paris-Presse l’Intransigeant ‘Dernière Heure’ du jeudi 26 juillet 1962.
(63) BERTRAND L. : Le sang des races. C.F.E.D. Robert Lafont, Tchou édit. 1978, pp. 301.
|
|
IL Y A MILLE ANS
Par Maurice VILLARD
ACEP-ENSEMBLE N°290
|
|
DES KABYLES DE LA REGION DE SETIF S'EMPARAIENT
DE L'EGYPTE ET FONDAIENT LE CAIRE
Cela vous étonne peut-être, mais c'est vrai. Cette histoire ressemble à un conte, un conte oriental bien entendu.
Il y fort longtemps un homme traqué fuyait en se cachant à travers le Maghreb ; il se nommait Obéid Allah et descendait de Mahomet par Ali et Fatima. Or selon la croyance populaire, un imam caché envoyé de Dieu, un mahdi, descendant du Prophète devait apparaître pour prendre le pouvoir.
Obéid Allah représentait un danger potentiel pour le Calife, celui-ci le faisait donc rechercher afin de l'exterminer.
Le fugitif avait déjà traversé l'Egypte, la Tripolitaine et la plus grande partie du Maghreb lorsqu'il parvint à l'oasis de Sidjilmessa dans le sud marocain où le seigneur des lieux le mit en prison.
Le Mahdi avait un homme de confiance, un daï, qui avait pu s'échapper. Ce serviteur fidèle, nommé Abou Abdallah, se rendit à la Mecque afin de prier pour la libération de son maître. L'histoire ne dit pas si c'est en tournant autour de la Ka'ba qu'il fit connaissance avec des kabyles Kotomas venus en pèlerinage, toujours est-il qu'ils les accompagna lorsqu'ils revinrent dans leur pays.
Le pays Kotomas était compris entre Mila, Djidjelli et Sétif ; son centre vital, Ikdjan, se trouvait selon Georges Marçais au voisinage de Chevreul. Il s'agissait donc bien de Kabyles de la région de Sétif, laquelle dépendait à l'époque du sultanat arabe de Kairouan.
Le daï Abou Abdallah devait avoir des dons de prédicateur car il convertit la tribu à la cause chiite d'Obéid Allah. Le sultan apprenant la présence d'un agitateur sur son domaine envoya une armée pour le saisir et remettre de l'ordre.
Ce fut un échec, les Kabyles enhardis par leur succès foncèrent à leur tour sur Kairouan et après quelques péripéties s'en emparèrent en 909. Toute l'Ifriqiya, que nous appelons maintenant la Tunisie, fut conquise.
L'Ifriqiya pacifiée et leurs arrières étant assurés, les Kotomas, avec Abou Abdallah à leur tête, allèrent à Sidjilmessa délivrer le Mahdi et le ramenèrent à Kairouan où ils l'installèrent sur le trône ; La dynastie fatimide commençait. Le nouveau sultan n'eut rien de plus pressé que d'éliminer le fidèle daï qui lui faisait de l'ombre. Selon l'historien arabe Ibn Kaldoun, lorsque les exécuteurs se présentèrent à Abou Abdallah ils lui dirent : « L'homme à qui tu nous as demandé d'obéir, nous commande de te tuer », et ils lui coupèrent la tête. Dans toute l'Ifriqiya le sultan ne pouvait compter que sur les Kotomas. Il leur confia donc les commandements de l'armée et les charges de l'administration et comme il ne se sentait pas en sécurité à Kairouan il fonda Mahdia, la cité du Mahdi une ville forteresse.
Obéid Allah restait un arabe, son regard se tournait vers l'Orient. C'est un demi-siècle plus tard, sous son petit-fils, qu'une armée de Kotomas, sans doute grossie de voisins de petite Kabylie, s'empara de l'Egypte et sur sa lancée envahit la Syrie et prit Damas. Les vainqueurs, selon une coutume bien établie, fondèrent près du Nil une nouvelle capitale qu'ils nommèrent El Qâhira, le Caire, c'était en 970.
Le Fatimide quitta Kairouan 3 ans plus tard pour s'installer au Caire où la dynastie régna pendant deux siècles. Une civilisation brillante se développa alors en Egypte et s'étendit jusque dans le Maghreb.
Mais que devint la tribu Kotoma ? S'étant totalement investie dans le destin des Fatimides, elle disparut dans les combats, les honneurs et le luxe. Les vieillards et les éclopés des premiers combats retournés au pays n'étaient pas assez nombreux pour la perpétuer. Il n'en resta que le mot vulgaire et injurieux de « K'Tem », résultant, selon les historiens Féraud et EF. Gautier, de la trahison religieuse des Kotomas qui avaient rejeté le sunnisme pour le chiisme des Fatimides. Si on considère leur fantastique épopée il faut admettre que nos kabyles méritaient mieux que ce piètre souvenir, car en parcourant en sens inverse le chemin des grands conquérants arabes ils ont renversé le cours de l'histoire. Après eux, les Arabes ne les commanderont plus jamais au Maghreb et jusqu'à la venue des Turcs les Berbères seront maîtres de leur destinées.
Maurice VILLARD
|
|
| EXPOSITIONS
Par M. Bernard Donville
|
|
Bonjour chers amis,
Nous continuons l'inspection des panneaux de l'exposition toulousaine par ceux de l'enseignement.
En vous esperant en forme je vous souhaite une bonne lecture
Amitiés, Bernard
Cliquer CI-DESSOUS pour voir les fichiers
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT 1
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
A SUIVRE
|
|
| LE PERROQUET ET FIDO
De M. Hugues
| |
Le lave-vaisselle de Juliette tombe en panne. Elle appelle un réparateur.
Elle doit partir travailler et elle lui précise :
"Je laisserai la clef sous le paillasson. Réparez la machine, laissez la facture sur la table, je vous enverrai un chèque. Au fait, ne vous inquiétez pas pour mon chien Fido, il ne vous fera aucun mal .
"Mais quoi qu'il arrive, ne parlez pas au perroquet !"
J'insiste bien : NE PARLEZ JAMAIS À MON PERROQUET !!!
Lorsque le réparateur arrive à l'appartement, il est accueilli par un énorme chien qui n'a vraiment pas l'air commode du tout.
Mais, comme Juliette l'avait dit, le chien est resté couché dans son coin sans se préoccuper de lui.
Le perroquet, par contre, le rend complètement dingue.Il crie sans arrêt, lance des jurons et le traite de tous les noms.
Au bout d'un certain temps, le réparateur qui n'en peut plus, lui crie
"Ta gueule, connard de volaille !"
et le perroquet de répondre :
"Vas-y Fido, attaque !"
Les hommes n'écoutent jamais ce qu'on leur dit !
|
| |
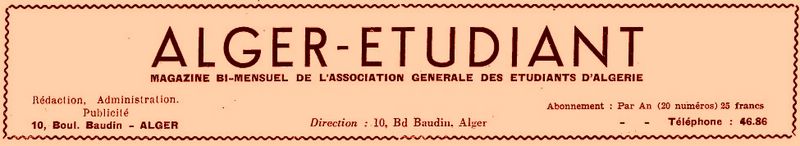 Source Gallica - N° 146
Source Gallica - N° 146 |
LE NOUVEL ALGER
J'ai exercé, pendant de nombreuses années, la profession assez imprécise de mâchoiron. Par ce terme, qui est de dénigrement, les marins désignent le passager. Ce risible individu, à bord, passe le temps à se promener, à bavarder, à manger, à poser des questions saugrenues, à gêner la manœuvre, à encombrer les entreponts et à acheter des curiosités absurdes dans les escales. Par timidité naturelle, par crainte aussi de m'ennuyer en société, je ne frayais d'ordinaire que peu avec mes compagnons d'ignominie. J'éprouvais cependant un sentiment de fierté outrecuidante de les entendre prononcer l'éloge de ma ville natale et vanter le charme d'Alger et les charmes des Algériennes. Nous escalions souvent dans ce port. Ils se promettaient à l'avance d'y goûter des plaisirs sans doute peu innocents, et, aussi de se mêler à une foule aux costumes bariolés, d'errer dans les labyrinthes de venelles à l'ombre bleue, de s'attarder, aux frondaisons épaisses du Jardin d'Essai, de contempler du haut des collines, le panorama de la baie, de déjeuner de rougets de la roche à la Pêcherie, de boire aux terrasses des brasseries l'anisette forte et la bière mousseuse. Leur amour pour la cité africaine était de la nature de celui qu'un bambocheur voue à l'estaminet. C'était tout de même de l'amour. .
En Alger, ils considéraient la cité d'Orient, l'endroit où il se passe des choses terribles et ignorées, et qui plaît par son mystère, peuplé de nobles Arabes aux burnous à beaux plis, d'Espagnols dont la cape à la mode d'Hermani dissimule une guitare et une navaja, d'Italiens énamourés et de Français lâches et méchants à mentalité de bagnards. Les romanciers du XIXe siècle ont fait aux Algériens bien du tort à opposer la dignité du fellah dépossédé à l'horrible avidité du colon. Et ceux des passagers qui possédaient quelques souvenirs de lectures illustraient leurs discours d'exemples empruntés à des textes célèbres, citaient Alphonse Daudet, Maupassant, Pierre Loti, Fromentin, Isabelle Eberhardt et Dinet, qui se donna corps et âme à l'Islam, fut excellent dessinateur et bon marabout.
Je souriais et négligeais, par paresse, goût du mutisme et mauvaise honte, de dissiper ces erreurs.
Alger n'est point, en effet, une ville langoureuse endormie au bord de l'eau comme la courtisane biblique fatiguée au bord du chemin. Elle a renié son passé de piraterie et oublié la poignée de janissaires qui la réduisit à la servitude la plus brutale. Elle est la cité de la peine, l'être qui bande ses muscles pour essayer ses forces et n'est inquiète que de préparer les victoires du futur. Les Algériens sont des hommes d'action, des oseurs, et non les tenanciers d'un vieux claquedent. Ils sont ambitieux de vivre, de prospérer et de s'accroître. Leur travail est de dompter une nature rebelle, de se cramponner au sol ingrat, de se perfectionner par la lutte sans trêve contre Ies éléments indociles, contre le paludisme, la sécheresse, les sauterelles, l'administration et les journalistes.
Leur personnalité est forte et ils ne tyrannisent en aucune façon les indigènes qui, en nombre croissant, suivent leurs traces. La grande guerre a eu des réactions bienfaisantes dans le Nord de l’Afrique. La fraternité des champs de bataille a dissipé les plus tenaces des préjugés. L’amélioration indéniable de la situation économique de l’autochtone fut un énergique facteur d’européanisation des masses musulmanes. Celles-ci savent maintenant que leur sort dépend du nôtre. Le sentiment de cette solidarité crée peu à peu le peuple algérien, qui est fort attaché à ses intérêts, bien plus qu'à ses gouverneurs généraux.
L'ère de l'ancien malentendu est révolue. Alger, comme maintes agglomérations algériennes, se libère de l'emprise d'Orient II est à sa façon une grande cité méditerranéenne, la capitale d'une patrie de rudes paysans, et sera peut-être un des principaux ports marchands du monde. Il se prépare à cet avenir, établit de nouveaux bassins pour les bateaux de commerce et s'ingénie de se débarrasser de l'encombre que lui léguèrent les défunts Etats de forbans et l'imprévoyance du conquérant français au, début de l'occupation, quand il estimait que celle-ci serait provisoire.
Ses remparts turcs craquèrent d'abord, puis ceux à la Vauban où l'enserra le Génie Militaire. Il annexa le territoire de Mustapha, la plus importante des communes voisines : bientôt il dévorera les communes de St-Eugène et d'Hussein-Dey, auxquelles le reliera un Métropolitain.
Depuis plus de vingt ans des quartiers supplémentaires se construisent, s'ajoutent l'un à l'autre, couvrent les terrains vagues, escaladent les collines, encerclent les amas de bicoques vétustes qui disparaissent peu à peu sous la pioche des démolisseurs. Le nombre des habitants ne cesse de s'accroître.
Le pire obstacle que rencontre Alger dans sa progression fut suscité par la nature. Cette cité maritime occupe le flanc d'un mont à pentes prononcées, contraires à l'aménagement des larges voies rectilignes indispensables au négoce intensif. Entre les hauteurs et le littoral, l'espace est étroit et s'allonge en croissant dans la direction du Cap Matifou, le long de la grande baie. Ces terres basses furent autrefois marécages ou dunes. C'est de ce côté que se produit la plus grande poussée de la ville. Là s'élèvent les quartiers industriels qui se transforment en quartiers bourgeois au fur et à mesure qu'avancent les travaux des nouveaux ports.
Dans notre enfance, il n'existait, entre Mustapha et Maison-Carrée (centre important à 11 kilomètres d'Alger, près de l'embouchure du ruisseau Harrach) que des jardins maraîchers cultivés par les Mahonnais et les Maltais. A cette heure. la route est bordée d'une double file presque ininterrompue de maisons.
ROBERT RANDAU.
|
|
DJEMILA L’ANCIENNE CUICUL DES ROMAINS
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°204 - Mars 2012
|
|
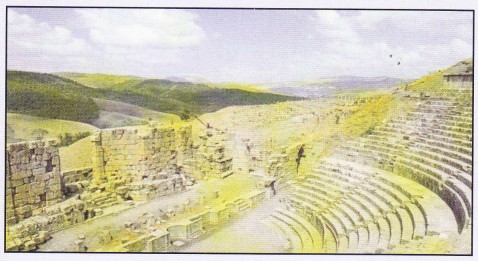 La ville antique de Djemila est située à 48 Kms au Nord-est de Sétif, à 900 m d'altitude, dans le paysage de collines accidentées et pelées des monts Sud de la Petite Kabylie. Le Centre de colonisation ne fut jamais réalisé, quelques fermes furent créées ainsi que des moulins à mouture indigène sur I'Oued Deheb, dont celui ayant appartenu à Henry Dunant. le futur créateur de la Croix Ronge. Sous l'égide de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts - Antiquités et monuments historiques, un immense chantier fut ouvert, des fouilles entreprises dans la cité antique. Le chantier de Djemila a été dirigé, avec énergie et dévouement, jusqu'en 1941 par Mme de Crésolles, qui avait assisté son mari au début des fouilles en 1909. La ville antique de Djemila est située à 48 Kms au Nord-est de Sétif, à 900 m d'altitude, dans le paysage de collines accidentées et pelées des monts Sud de la Petite Kabylie. Le Centre de colonisation ne fut jamais réalisé, quelques fermes furent créées ainsi que des moulins à mouture indigène sur I'Oued Deheb, dont celui ayant appartenu à Henry Dunant. le futur créateur de la Croix Ronge. Sous l'égide de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts - Antiquités et monuments historiques, un immense chantier fut ouvert, des fouilles entreprises dans la cité antique. Le chantier de Djemila a été dirigé, avec énergie et dévouement, jusqu'en 1941 par Mme de Crésolles, qui avait assisté son mari au début des fouilles en 1909.
Puis il a été confié, depuis 1942, à Mademoiselle Y. Allais, agrégée de I'université. Avec une remarquable compétence et un dévouement inlassable, Mademoiselle Allais poursuit sur ce site des recherches qui sont très loin d'être terminées, les travaux de fouilles, en cours, que dirigent, M. et Mme Querard, le prouvent suffisamment, après 1/2 siècle d'activité, un bon quart de la ville antique est encore sous terre. Un musée a été créé, un hôtel ouvert, géré par M. et Mme Boissel
1843. - Le 9 Janvier, le Duc d'Orléans admirant ce superbe monument édifié à la gloire de I'empereur Romain Caracalla, émit le désir de le faire transporter à Paris. Une maquette réalisée en plâtre et pesant près de 300 kilos devait, dans un premier temps, être transportée à dos de mulets à Constantine. Mais à cause des difficultés du chemin, écrasés, sous une telle charge, les deux mulets succombèrent, la maquette se brisa, le projet fut abandonné faute de route et de moyens pour transporter des pierres de plus d'une tonne chacune.
1883. - Alger le 6 Janvier, renseignements relatifs au Centre projeté de Djemila.
En 1868, le Capitaine Dorange, détaché au bureau arabe de Djidjelli. Fut désigné pour aller à Djemila. faire un travail de délimitation des terres appartenant au Beylick et devant servir, à la création d'un Centre important. Il fut également chargé, de proposer aux indigènes des échanges de terrain, de façon, à éviter autant que possible, que leurs terres, fussent enclavées dans celles destinées aux colons. Après plusieurs mois d'un travail considérable et consciencieux, le capitaine Dorange, avait réussi à réunir d'un seul tenant, 48.000 à 50.000 ha, d'excellentes terres de labour.
 Djemila est une ancienne ville romaine, les ruines qui couvrent une très grande surface, démontrent, que c'était un centre très important. Bloqué en 1838 avec le 3° bataillon de zéphir, on fut forcé pour ne pas s'exposer aux balles des assiégeants kabyles d'établir des tranchées servant de chemins couverts; ces travaux firent découvrir une superbe mosaïque, des statuettes et divers objets romains. Les ruines éparses en très grande quantité sur le sol, fourniront les pierres nécessaires à la construction des maisons et des édifices publics. La terre pour la culture est de première qualité, on pourra y cultiver des céréales et y planter des arbres fruitiers, I'eau abonde, le climat est salubre, c'est un pays privilégié pour la culture, comme savaient en choisir les Romains. Djemila est une ancienne ville romaine, les ruines qui couvrent une très grande surface, démontrent, que c'était un centre très important. Bloqué en 1838 avec le 3° bataillon de zéphir, on fut forcé pour ne pas s'exposer aux balles des assiégeants kabyles d'établir des tranchées servant de chemins couverts; ces travaux firent découvrir une superbe mosaïque, des statuettes et divers objets romains. Les ruines éparses en très grande quantité sur le sol, fourniront les pierres nécessaires à la construction des maisons et des édifices publics. La terre pour la culture est de première qualité, on pourra y cultiver des céréales et y planter des arbres fruitiers, I'eau abonde, le climat est salubre, c'est un pays privilégié pour la culture, comme savaient en choisir les Romains.
Après I'insurrection de 1871, il y avait, par suite du séquestre prononcé contre les insurgés, plus de 70.000 ha disponibles, on a eu la malencontreuse idée de relever du séquestre la majeure partie des insurgés. En 1868, tout le travail était réalisé pour la création d'un Centre important à Djemila. En 1872, après I'insurrection le séquestre double le chiffre des terres pouvant être affectées à la colonisation, au lieu de ce1a, on ne s'en préoccupe même pas, on rend aux indigènes les terres séquestrées, peut être même celles appartenant au Beylick Voilà comment on entendait la colonisation en 1872 et 1873 !...
Aujourd'hui, qu'on paraît vouloir entrer dans une voie nouvelle. Plus rationnelle, je crois devoir signaler au Gouvernement de I'Algérie, la création de ce Centre, dont l'importance est incontestable.
CUICUL
Enserrée dans un cadre austère de montagnes, on découvre Cuicul. La secrète. D'origine militaire, elle a été établie, en pays berbère, sur un carrefour de voies. Sa prospérité est due à I'olivier qui couvrait jadis les pentes de ces collines et montagnes. aujourd'hui complètement dénudées. Sa construction s'échelonna sur trois siècles, sur un sol peu favorable à la croissance d'une grande cité. C'est de cette adaptation de la ville, de I'habilité à bâtir sur des pentes abruptes, à occuper des espaces limités et resserrés par de profonds ravins, qu'elle tire un caractère assez pittoresque, curieux et plaisant.
L'art avec lequel toute la ville se dispose en gradins, la composition de la grande place du Temple Septimien que l'on peut considérer comme le plus bel ensemble architectural de l'Afrique du Nord, le théâtre creusé en entonnoir au flanc de la colline, les thermes, le forum, les temples, tout cela constitue un charme pour la vue, un régal de l'histoire. Le marché est harmonieux dans ses proportions, des maisons privées qui possèdent à la fois I'espace et I'agrément avec des colonnades et des dallages. Sur I'une de ses voies, une fontaine érige un cône de pierre que I'on peut imaginer surmonté d'un panache d'eau. Cet art d'utiliser un terrain difficile, ce souci de l'ensemble, éclatent aussi dans l’immense quartier chrétien: urbanisme et mystique y trouvent une conciliation. Par une entrée monumentale, une allée à colonnades bordée d'églises, de chapelles et de logis, mène au baptistère qui domine l'ensemble, véritable chef d'œuvre de I'architecture chrétienne. De toutes ces tendances aussi bien païennes que chrétiennes, le musée offre un incomparable reflet, avec ses mosaïques d'un intérêt documentaire extrême et d'une rare valeur décorative, avec ses petits bronzes, débris précieux, avec ses statues de marbre ou de pierres d'une qualité parfois exquise.
Un peu d'Histoire
Les débuts d'une colonie romaine. La ville romaine fondée à la fin du 1er S., par I'empereur Nerva, prit le nom de Cuicul. Etablie au carrefour des routes Est-Ouest et Nord-Sud de I'Afrique romaine, elle surveillait les turbulentes tribus voisines. Elle fut peuplée à I'origine d'anciens soldats originaires d'Europe centrale et de Syrie. La forme triangulaire de l'éperon sur lequel elle fut bâtie n'a pas permis à ses urbanistes d'employer ici le carré en damiers d'autres villes romaines.
 La fertilité du sol, l'abondance des sources contribuèrent à faire de Cuicul une ville riche. Les cultures de céréales et d'oliviers, l'élevage des moutons, de chèvres, d'ânes et de bœufs, ne tardèrent pas à donner naissance à une industrie importante : huileries. poteries et tissages. La fertilité du sol, l'abondance des sources contribuèrent à faire de Cuicul une ville riche. Les cultures de céréales et d'oliviers, l'élevage des moutons, de chèvres, d'ânes et de bœufs, ne tardèrent pas à donner naissance à une industrie importante : huileries. poteries et tissages.
L'Essor
- Dès le 2e S., le forum, centre de la ville, fut entouré de bâtiments administratifs et religieux: temple, curie, basilique judiciaire, tandis que, les thermes et d'autres temples s'élevaient dans les quartiers voisins.
Bientôt I'enceinte qui épousait la forme triangulaire de l'éperon devint trop étroite, la paix romaine s'étendant sur l'Afrique du Nord, poussait les habitants à la déborder. De nouvelles maisons s'élevaient au-delà des remparts, le long des ravins ou sur le plateau vers le Sud, Le 3e S., voit abattre la partie Sud du rempart à I'emplacement duquel s'étend un nouveau forum, situé entre la vieille ville et ses nouveaux quartiers. Un temple est dédié aux Sévère et un arc de triomphe à l'empereur Caracalla et à sa famille. Mais la fin du 3e S., marque I'arrêt de l'essor de Cuicul. Une série de mauvaises récoltes ruinent les petits propriétaires, les troubles rendent précaires les communications et paralysent le commerce. Le 4e., voit une renaissance générale, des édifices publics sont restaurés, de nouvelles adductions d'eau créées. Mais surtout il est le siècle du développement du christianisme, libéré par l'édit de Constantin des persécutions dont il avait été l'objet.
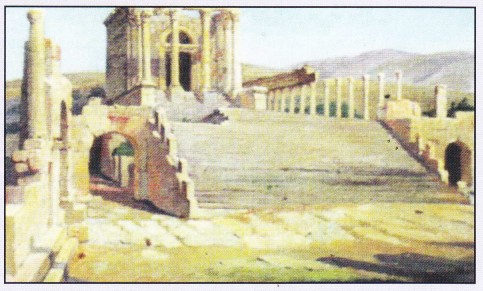 La destruction de Cuicul. - Les traces d'incendie que révèlent les ruines de Djemila, les statues et les divers objets découverts généralement brisés, I'absence presque totale de métaux précieux ou d'objets de valeur dans les ruines, font penser que la ville fut anéantie par I'incendie et pillée par les tribus montagnardes de la petite Kabylie qui s'étaient à plusieurs reprises, déjà soulevées contre l'autorité romaine. Quelques heures suffirent pour rendre à sa désolation sauvage tout ce pays que quatre siècles de civilisation romaine avait conduit à la prospérité. La destruction de Cuicul. - Les traces d'incendie que révèlent les ruines de Djemila, les statues et les divers objets découverts généralement brisés, I'absence presque totale de métaux précieux ou d'objets de valeur dans les ruines, font penser que la ville fut anéantie par I'incendie et pillée par les tribus montagnardes de la petite Kabylie qui s'étaient à plusieurs reprises, déjà soulevées contre l'autorité romaine. Quelques heures suffirent pour rendre à sa désolation sauvage tout ce pays que quatre siècles de civilisation romaine avait conduit à la prospérité.
Visite Rapide
Une visite rapide d'une durée d'environ 1h 1/l2 permet de voir I'essentiel de la cité : Le Baptistère, le monument le plus beau de tout le quartier chrétien. Le Théâtre, creusé dans le flanc oriental de la colline, comprend un bel hémicycle en gradins, large de 70 m et pouvant contenir 3.000 spectateurs. Le Forum Sud, son superbe revêtement de dalles et d'édifices qui I'entourent en font l'un des plus beaux de I'antiquité. Le Temple de Septime Sévère, élevé en l'honneur des Sévère, famille africaine parvenue à I'Empire, ce temple est le plus beau et le mieux conservé de Djemila. Un escalier monumental donne accès à une terrasse où s'élève un portique de six belles colonnes corinthiennes. Le Forum Nord, il date du 1er et du 2e S., cette vaste place, centre de la vie, est bordée de trottoirs qui couraient sous une vaste colonnade protégeant les promeneurs des ardeurs du soleil en été et des chutes de neige en hiver.
Cardo-Maximus, grande voie Nord-Sud de la ville qui recouvre un important canal d'égouts. Temple de Vénus Génétrix, les ruines de ce petit édifice comptent parmi les plus charmantes de Djemila, Porte Sud, elle limitait la ville romaine avant son extension vers le Sud. Elle a été conservée sous forme d'arc.
Arc de Caracalla, élevé en 216 en l'honneur de l'empereur Caracalla et de sa famille, cet arc dont ne subsiste que la base des statues au faîte du monument est un des chefs-d'œuvre de Djemila. Grands Thermes, cet établissement, très fréquenté est magnifiquement conservé avec ses salles chaudes et froides à plusieurs piscines, ses vestiaires, salles de réunions aux murs revêtus de marbres polychromes et au sol couvert de mosaïques. Autres curiosités : Musée - Fontaine - Basilique chrétienne - Chapelle chrétienne Basilique de Cresconius, la plus grande des églises du quartier chrétien qui comptait 5 nefs pavées de mosaïques - Maison d'Europe, riche demeure qui comptait 18 pièces doit son nom à une mosaïque qui représente I'enlèvement d'Europe - Marché de Cosinius - Porte Nord.
1838 - LA BATAILLE DE DJEMILA
Que s'était-il exactement passé à Djemila ? On sait que ce point fut un des gîtes d'étape de la colonne Galbois, se rendant à Sétif afin de relier Alger en passant par le défilé des Portes de Fer qui n'avait jamais été franchi, ni par les Romains, ni par les troupes Françaises. A défaut de renseignements officiels, il est curieux de constater que ce fut Alexandre Dumas, qui, de passage à Constantine, rendit compte le premier de I'affaire de Djemila, un des plus beaux faits d'armes ayant honoré notre armée d'Afrique, ont relaté, plus tard tous les auteurs qui le firent. Alexandre Dumas a accompli, en 1845, un voyage en Afrique du nord.
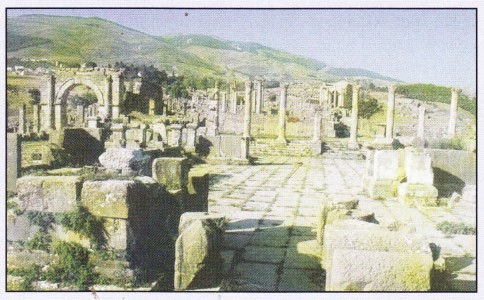 Il est arrivé avec quelques amis à Bône, puis à Philippeville et à Constantine où il reçut I'hospitalité de l'Etat Major de la Division. C'est là qu'il recueillit de la bouche même des valeureux combattants de ce drame, les détails, jusque là inédits, qu'il a rapporté dans son livre« Le Véloce» nom du navire de guerre sur lequel il avait traversé la Méditerranée.. Le récit imagé que nous a transmis le grand romancier n'a pas la valeur d'un compte-rendu officiel. Il peut, cependant, être considéré comme un témoignage de I'importance donnée, à cette bataille, par des chefs dont l'appréciation ne peut être récusée. Nous ne retiendrons de ce récit que les parties essentielles. Il est arrivé avec quelques amis à Bône, puis à Philippeville et à Constantine où il reçut I'hospitalité de l'Etat Major de la Division. C'est là qu'il recueillit de la bouche même des valeureux combattants de ce drame, les détails, jusque là inédits, qu'il a rapporté dans son livre« Le Véloce» nom du navire de guerre sur lequel il avait traversé la Méditerranée.. Le récit imagé que nous a transmis le grand romancier n'a pas la valeur d'un compte-rendu officiel. Il peut, cependant, être considéré comme un témoignage de I'importance donnée, à cette bataille, par des chefs dont l'appréciation ne peut être récusée. Nous ne retiendrons de ce récit que les parties essentielles.
Le 13 Décembre 1838, à huit heures du matin, toute la colonne se trouvait réunie sur le plateau, au milieu des ruines de Djemila. Dans l'après-midi, le Général Galbois passait une grande revue de toutes ses troupes, et groupés sur les montagnes voisines, les Kabyles, comme des degrés d'un amphithéâtre, assistaient à cette revue. Le soir venu, les coups de fusil recommencèrent, mais cette fois, bien plus nombreux, beaucoup plus proches que la nuit précédente.
Le 14, avant le départ de la colonne expéditionnaire pour Sétif, il fut décidé que trois cents hommes du Bataillon d'Afrique, un détachement d'Infanterie et un détachement du Génie occuperaient la position de Djemila. On choisit le point du plateau le moins vulnérable, et la colonne se mit en marche, laissant la garnison peu confiante dans l'abri des ruines qui I'entouraient, et surtout dans I'amitié des peuplades voisines. Par malheur, le pittoresque de la localité ne pouvait racheter le précaire de la situation. Il en résulta qu'à peine abandonnés à eux-mêmes, soldats et officiers se mirent à élever à l'envi le pan de murailles en pierres sèches qui devait les protéger, couchés ou assis, contre les balles de I'ennemi. Avant la nuit on était à l'abri d'un coup de main, le soleil se coucha, puis I'obscurité descendit rapide et épaisse.
Alors, excités par les cris de leurs femmes, les Kabyles se répandirent sur le plateau où, en nombre supérieur, ils abordèrent avec impétuosité nos avant-postes qui, trop faibles pour leur résister, durent se replier sur le camp retranché. Dans ce mouvement de retraite plus d'un soldat, poursuivi ou saisi par les bretelles de son sac, ne dut son salut qu'à la promptitude avec laquelle il laissa ce sac aux mains de celui qui le poursuivait.
Le 15, dans la journée, tous les abords du camp prirent I'aspect d'un marché arabe, sous prétexte de vendre à nos soldats des feuilles de tabac, des figues et des noix sèches, les Kabyles observaient nos travaux de fortifications. La nuit venue, le marché se transforma en blockhaus, les marchands en ennemis. Nos soldats tendirent une embuscade, mais un pauvre diable, qui ne put s'empêcher de tousser, dévoila le traquenard.
L'embuscade était formée de cinquante hommes commandée par le Lieutenant Trichardou, un amphithéâtre à ciel ouvert, composé de gradins en magnifiques pierres de taille, qui servait de lieu de refuge. Avertis par cette toux, les Kabyles prirent avec des cris sauvages la fuite à travers les ruines de Djemila n'essayant même pas de se défendre, nos soldats les y poursuivirent avec acharnement. Deux Kabyles furent tués, aucun de nos hommes ne fut blessé.
ATTAQUE DES KABYLES
Pendant tout le reste de la nuit, les Kabyles revinrent à la charge, se glissant à travers les pierres d'un pas aussi léger et aussi silencieux que celui d'un chacal, et poussant des cris aussi aigus que ceux de ces animaux, aussitôt qu'ils étaient découverts. La fusillade, du côté des Kabyles, était ininterrompue, très fournie, c'était tout le contraire de notre côté, il fallait ménager la poudre. La petite redoute, avec ses flots d'ennemis qui venaient se briser contre ses murailles, ressemblait sur tous les points à un vaisseau attaqué à I'abordage. L'acharnement fut tel que pendant une demi-heure, on se battit corps à corps, nous les frappions à coups de baïonnette, ils ripostaient à coup de pistolets et avec des pierres, qu'ils arrachaient aux retranchements pour les lancer sur nos soldats.
L'approche du jour mit fin à ce combat, l'un des plus acharnés que l'on eût soutenus, les Kabyles se retirèrent poussant des cris hostiles, nous adressant comme adieu des coups de fusil mal ajustés, nous avions eu à déplorer six blessés.
Le 15, même marché que la veille, même innocence dans les relations.
Les deux Kabyles tués avaient été exposés sur la place la plus apparente. Mais le but qu'on s'était proposé ne fut pas atteint, les Kabyles n'y prêtèrent aucune attention. La nuit fut un nouveau combat, mais à distance. La lutte précédente avait donné à réfléchir à nos assaillants. Le 16, au jour, le marché s'ouvrit comme les jours précédents, mais les deux cadavres avaient disparu. Pendant la soirée, la colonne de retour de Sétif arrivait avec une vingtaine de blessés. Une demi-heure plus tard, parurent trois cents hommes venant de Mohallah arrivant avec un convoi de vin qu'ils avaient été chargés d'attendre et d'escorter. La nuit ne fut pas calme, les kabyles continuant leur harcèlement jusqu'au matin. Il entrait dans les plans du Général, malgré l'éloignement de Constantine et malgré la mauvaise saison, de garder la position de Djemila. Le bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique, un détachement d'Artillerie et un détachement du Génie, au total six cent soixante-dix hommes, fut désigné pour accomplir cette mission avec seulement trente cartouches par homme, on en obtint quinze de plus, seulement le Commandant Chadeysson, prévoyant, afin d'obtenir un emploi raisonné de ces faibles ressources, tint cette réserve supplémentaire secrète.
La colonne s'éloigna en direction de Constantine, abandonnant les six cent soixante-dix hommes au milieu des ruines de cette ville romaine. Elle fut poursuivie par les tirs des Kabyles qui promettaient à ceux qui restaient une suite de combats aussi féroces que ceux déjà subis. L'ambulance de l'armée enlevait nos blessés des trois nuits précédentes, et nous laissaient deux des siens mortellement frappés. Le reste de la journée fut employé à fortifier, par des travaux liés aux précédents, les trois cents hommes du bataillon d'Afrique arrivés de Mahallah. Toute la garnison prit part à ces travaux, il n'y avait pas de temps à perdre.
BATAILLE ACHARNEE
Le 18, les Kabyles qui, la veille, s'étaient contentés de venir nous observer du haut de leurs montagnes, descendirent en foule et commencèrent, vers dix heures du matin une fusillade qui, à partir de ce moment, ne devait plus être interrompue que le 22, au coucher du soleil. En moins d'une demi-heure, le plateau tout entier de Djemila fut envahi, et un siège Kabyle en règle commença. Les femmes qui n'étaient point occupées à préparer les aliments, se faisaient spectatrices et animaient les combattants à grands cris. Il était facile de voir, au mouvement et à l'agitation qu'elles se donnaient pour pousser en avant ceux que nos balles éloignaient de nos murailles, que dans le cas où notre camp serait forcé, nous ne trouverions en elles aucune pitié. Mais à ces attaques, plus bruyantes que sérieuses, nos soldats parfaitement commandés, opposaient un silence et une discipline dans laquelle chaque individu comprenait que devait résider la force générale. Les officiers, qui observaient les moindres mouvements de I'ennemi, lorsque ces derniers étaient à portée de nos armes, donnaient I'ordre de tirer. La fusillade des assaillants se ralentit dans la journée mais sans s'interrompre. Nous avions parmi nous un chef arabe qui s'était chargé de maintenir nos bonnes relations avec les populations qui s'étaient faites marchandes le jour et guerrières la nuit. Cet homme n'avait pas eu l’intention de nous trahir, il s'était trompé voilà tout, le seul point qu'il avait prévu c'était I'opiniâtreté que les Kabyles devaient mettre à poursuivre les hostilités, une fois engagées. Sur ces instances on expédia un courrier à Constantine.
Le 19, les premiers rayons du jour montrèrent à nos soldats des forces doubles de la veille ; à vingt lieues à la ronde tous les kabyles étaient prévenus et accouraient. Les montagnes environnantes n'étaient plus que les degrés d'un immense cirque chargés d'ennemis qui venaient nous attaquer, ou de spectateurs qui venaient assister à notre extermination. À un moment donné, toute cette multitude, roulant des montagnes jusqu'au plateau, vint se ruer sur notre parapet, que leur choc eût certainement renversé, si à la distance de vingt pas une fusillade bien ajustée n'en eût jeté une vingtaine à terme. La chute de ceux-ci, l'éclat de nos baïonnettes qui brillaient à un rayon de soleil, décidèrent chez les Kabyles une retraite au pas de course.
Cependant cette fuite éternelle de nos ennemis qui, en réalité, ne nous avaient abordé corps à corps qu'une seule fois, nous donnait une grande confiance en nous-mêmes. Comme on le voit, cette journée du 19 commençait bien, et tout espoir n'était pas perdu si notre courrier arrivait à Constantine. Cependant une grande préoccupation pour notre petite garnison, le manque d'eau. À cinquante mètres de nos murailles passait un ruisseau assez large mais peu profond, dans lequel on ne pouvait pas puiser, il fallait donc remplir les bidons, qui contenaient chacun neuf litres avec de petites gamelles qui rendaient l'opération longue et difficile. A chaque corvée d'eau, il fallait se battre corps à corps, abandonner les blessés sur place, user beaucoup de cartouches, or, presque autant que I'eau, la poudre nous manquait.
RESISTANCE HEROIQUE
Le Chirurgien-major du régiment, le docteur Philippe nous décrit cette situation, où il s'agissait de se passer d'eau ou bien d'acquérir au prix de sacrifices humains, la valeur d'un verre d'eau par jour pour chacun des hommes. Sur I'interrogation du Commandant sur le nombre de jours pendant lesquels l'homme pourrait se passer d'eau, le chirurgien-major répondit que, s'il était possible de faire une distribution d'eau-de-vie par jour, on pouvait demeurer huit jours sans boire autre chose que quelques gouttes d'eau-de-vie. La confiance dans les chefs était telle, que ces paroles firent un effet magique. et sur la promesse de trois petits verres d'eau-de-vie par jour, chacun fit son deuil de I'eau et resta ferme à son poste. L'ennemi grossissait à vue d'œil, une estimation pertinente portait leur nombre à environ trois mille assaillants leur fusillade était, jour et nuit, incessante. La situation devenait de plus en plus inquiétante, aussi pendant la nuit du 19 au 20, un second courrier fut expédié à Constantine.
Pendant la journée du 19, on avait commencé les terrassements pour la sûreté des communications dans le camp, la tranchée fit découvrir, à un mètre de profondeur, une magnifique mosaïque, mais comme l'eau manquait, ce fut avec l'urine des travailleurs qu'elle fut lavée. Chacun put admirer la variété de ses couleurs et la régularité de ses dessins. Le 20, plusieurs chefs à cheval tentèrent de pousser une colonne d'assaillants sur nous, mais ils ne réussirent pas à les convaincre de nous attaquer en plein jour. Les coups de yatagan et de bâton ne suffirent pas à leur faire quitter leurs postes à l'abri de nos balles.
Cinq ou six hommes, qui paraissaient des chefs, s'avancèrent pour donner l'exemple jusqu'à soixante à quatre vingt pas de nos retranchements, vociférant des paroles inintelligibles qui ne pouvaient être que de grosses injures ou de provocantes menaces. C'était une cible pour nos meilleurs tireurs qui les abattirent tous.
Lorsqu'un des leurs tombait, une vingtaine d'hommes se précipitaient pour enlever le cadavre, ce qui donnait à nos soldats une occasion de tirer à coup sûr, plus d'une centaine de Kabyles furent ainsi tués. De son côté, malgré notre couvert, l'ennemi, grâce à son feu roulant, nous tuait et nous blessait quelques hommes.
Malheur à l’imprudent que sa curiosité poussait à se lever debout dans sa tente ou derrière les fortifications, qui n'avaient qu'un mètre de hauteur. En pareille circonstance et lorsqu'il a pu gagner la confiance des soldats, le rôle de l'officier de santé a quelque chose de providentiel et même de surhumain. Ainsi, malgré leurs souffrances, les blessés suppliaient-ils le Docteur Philippe de ne pas exposer ses jours.
«- Major, lui criaient les hommes en tombant, ne vous inquiétez pas, et attendez la nuit pour venir, nous banderons nos blessures avec nos mouchoirs. Qu'arriverait-il de nous si ces gueux-là allaient vous tuer ou vous blesser gravement ? Nous serions tous perdus ».
Effectivement, et à moins de blessures graves qui ne pouvaient attendre, le Docteur Philippe suivait ce conseil.
Nous avons dit que deux soldats grièvement blessés avaient été abandonnés par la colonne à Djemila, l'un d’eux mourut bientôt, le second, plein de constance, supportait avec beaucoup de courage la douleur mais par contre souffrait énormément de la soif. De neuf litres d'eau conservés par le chirurgien, il n'en restait que deux, la tisane et les pansements en avaient absorbés sept. L'ennemi tenait bon, le blocus était total, de sorte que le pauvre agonisant avait beau demander à boire, tantôt avec le cri de rage, tantôt avec l'accent du désespoir, comme il était condamné avec aucun espoir de surie, c'eût été un crime que de distraire à son profit une partie de cette eau qui pouvait servir à d'autres moins. gravement atteints. Le chirurgien fut donc dans l'obligation de l'abandonner à son triste sort ne pouvant lui offrir qu'un citron qui lui restait, le malheureux mourut les lèvres collées à l'écorce, suçant le jusqu'à la dernière goutte. Les deux derniers litres d'eau qui restaient devaient donner naissance à bien d'autres scènes du même genre, hélas ! que celle-ci, et cependant trois jours seulement s'étaient écoulés depuis que I'on manquait d'eau. Pour bien apprécier cette situation, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut avoir vu une fois combien le besoin de la soif est impérieux pour le soldat qui a les lèvres séchées par ses cartouches, surtout si cet homme est blessé et a perdu du sang. C'est ainsi qu'un blessé se traînant sous la tente du chirurgien pour se faire panser, et à la vue de l'eau rougie de sang, dans laquelle le Docteur Philippe trempait son éponge, ne songeant plus à sa blessure :
«- Docteur, lui dit-il, à boire, je vous en supplie.
- Mais, répondit le Docteur, si tu bois cette eau, il n'en restera plus pour panser les blessés.
- Laissez-moi boire. je vous en supplie, et ne me pansez pas répondit le blessé.
- Mais les autres ? demanda le Docteur.
- Eh bien ! laissez-moi sucer l'éponge, les autres la suceront à leur tour.
Cette demande fut accordée, et bientôt, comme les soldats savaient qu'en allant se faire panser le docteur leur laisserait sucer l'éponge, ils s'exposèrent à de nouvelles blessures, espérant que, par ce nouveau moyen, ils pourraient adoucir leur soif. »
Au milieu de ces scènes de désolation, un épisode curieux fera ressortir I'intelligence suprême du soldat. Le Capitaine Montauban avait un chien nommé Phanor, lequel souffrant de la soif, avait fini par se décider à sauter les murailles et à aller boire au ruisseau. Dans ses premières tentatives, les coups de fusil I'avaient effrayé, mais la soif étant plus forte que la crainte, il prit librement son parti, et, à travers une grêle de balles, il bondit jusqu'au ruisseau, là il but à pleine gueule. L'impunité l'ayant enhardi, les jours suivants, Phanor alla se désaltéré tout à son aise deux à trois fois par jour. Deux zéphyrs eurent I'idée de lui attacher une éponge au bout du nez, Phanar en buvant, trempait son nez dans l'eau et l'éponge s'imbibait, Phanor en revenant rapportait dans son éponge la valeur d'un verre d'eau qui permettait aux deux zéphyrs de supporter plus patiemment que leurs camarades la détresse dans laquelle on se trouvait.
On remarqua aussi que pendant la nuit la rosée abondante formait des gouttelettes sur les canons des fusils, les soldats au lieu de les abriter les exposaient à l'air ainsi que les lames de leurs sabres et en les léchant se procuraient quelque soulagement.
Un des Capitaines, le Capitaine Maix, avait dressé sa tente vis-à-vis de celle du Docteur Philippe. Il faisait fonction de sous-intendant, comme sa tente était entièrement exposée au feu, le Docteur voulut lui offrir la sienne, mieux abritée. Mais c'était un mauvais moyen pour convaincre le Capitaine Maix, aussi le chirurgien lui proposa-t-il une partie de piquet.
Un soldat de la compagnie se porta volontaire pour aller creuser le terrain sous la tente afin de faire un escarpement dans lequel le Capitaine en s'allongeant serait à l'abri, mais au premier coup de pioche qu'il donna, une balle lui traversa le cœur. A partir de ce moment, il ne fut plus permis au Capitaine de regagner sa tente, il resta I'hôte du Docteur Philippe jusqu'à la fin du blocus. Les Kabyles travaillaient aussi activement, ils avaient entouré le camp de postes retranchés, disposés sur deux lignes circulaires concentriques, 1e plus grand nombre était sur la ligne extérieure. Chaque poste était fortement occupé et, de là l'ennemi ouvrait un feu terrible et ininterrompu sur les points découverts du camp. Les Kabyles avaient renoncé aux attaques de vive force, qui leur avaient coûté très cher et étaient demeurées sans résultats, convertissant le siège en blocus, se proposant de nous réduire en nous interdisant l'eau. ne nous le laissant pas ignorer, nous criant de toutes parts: « El-ma ma cach roumi ».
Dans la nuit, un quatrième émissaire fut envoyé, il était à cheval. On avait enveloppé les pieds de sa monture avec des chiffons, à la pointe du jour on le vit revenir, comme le troisième, il lui avait été impossible de passer.
La journée du 21 et la nuit du 21 au 22 avaient été terribles. Déjà, depuis deux ou trois jours lorsqu'on saignait un bœuf ou un mouton les hommes attendaient avec impatience pour se disputer le sang qui sortait de I'artère, pendant les dernières heures de cette dernière nuit, quelques-uns s'étaient ouvert les veines pour se désaltérer à leurs propres blessures. aussi une morne tristesse s'empara-t-elle des assiégés lorsqu'ils virent, le matin, revenir le quatrième messager, dont le retour leur ôtait une dernière chance de salut.
Un instant on eut l’idée de lever le camp et de passer à la baïonnette à travers cette nuée de Kabyles, mais pour cela il fallait abandonner les blessés à la merci de l'ennemi, et cette proposition, faite par quelques-uns, ne fut pas prise comme sérieuse.
LA DELIVRANCE
On en était pourtant arrivé à cet instant à envisager une solution extrême. Le chirurgien n'avait plus d'eau pour laver les blessures, plus de linge pour les pansements. Pourtant I'eau coulait à cinquante pas, au fond d'un ravin, on l'entendait bruire sur les cailloux, mais au-dessus, dans la broussaille, on apercevait plusieurs rangées de très longs fusils, c'était le supplice de tantale. L'aspect du réduit était curieux, au-dessus du niveau déterminé par le parapet, toutes les tentes étaient criblées de balles, au-dessous, la toile était pratiquement intacte. Tout à coup, on vit apparaître au Nord-Est. sur la montagne des Ouled Jacoub, une nombreuse troupe de cavaliers précédée par un homme enveloppé d'un burnous blanc, et qui paraissait être son chef. Nos soldats crurent qu'il arrivait un renfort aux ennemis et, enchantés d'en finir par une bataille décisive, ils préparèrent leurs armes, mais à leur grand étonnement, ils s'aperçurent qu'à la vue de ce chef, placé comme une statue équestre sur le piton le plus élevé de la montagne, la fusillade avait cessé comme par enchantement. Ce n'était pas suffisant, car le chef fit un signe en déployant largement son burnous, le faisant flotter comme une voile qui s'échappe du mât. Alors Kabyles, hommes, femmes, enfants, cavaliers, commencèrent un mouvement de retraite, puis comme ce mouvement ne s'opérait pas assez vivement, on vit partir des pieds de ce cavalier une trentaine d'hommes qui, à grands coups de plat de yatagan et de bâton, chassèrent les Kabyles devant eux comme feraient des pasteurs, avec leur houlette, des plus petits et des plus obéissants des troupeaux. Puis, quand la place fut déblayée, cet homme mit son cheval au galop, et seul, sans suite, il s'approcha du camp, et montrant le chemin de Constantine: «- Allez, dit-il à nos soldats, et si I'on veut vous arrêter encore, répondez que vous êtes des amis de Bou-Askhaz. »
C'était en effet le cheik du Ferdj'Ouah, qui ayant appris que nos soldats couraient, sur une de ses douze tribus qui lui appartenaient, le danger que nous venions de décrire, avait traversé les onze autres et était venu, d'un seul geste de son burnous chasser cette nuée de Kabyles, comme d'un souffle, le Seigneur disperse les nuages du ciel. Ce témoignage du Docteur Philippe, qui accompagnait I'expédition de Sétif, a été la première version du drame de Djemila. Il y a tout au moins une erreur d'appréciation sur le rôle du cheik Bou Askaz. Ce dernier habitait aux Sources Chaudes du Ferdjioua, à 6 kilomètres à I'ouest de Fedj M'Zala, à 15 kilomètres de Djemila en ligne droite. Il savait donc ce qui se déroulait à Cuicul et il aurait dû intervenir plus tôt. Mais ayant appris qu'une colonne de secours arrivait de Constantine, à marches forcées, afin de délivrer le camp, il prit cette initiative de peur des représailles et afin de se faire valoir auprès de notre commandement. Des clameurs, la joie fut très vive au camp, quand soudain on vit descendre des hauteurs, en bon ordre, une colonne d'infanterie, le 26e régiment. Soudain tous les soldats parurent à I'entrée des tentes, portant bidons, marmites, gamelles, en un mot tous les vases susceptibles de contenir de l'eau, et une corvée fut organisée pour aller en chercher au ravin le plus proche. Entre temps le Commandant de la colonne, le Colonel d'Arbouville, laissant à ses officiers le soin de faire camper ses hommes, accourut vers nous, nous allâmes à sa rencontre, dans notre piteux accoutrement d'assiégés. Il en fut ému. Les deux chefs s'entendirent, et I'on décida que la journée du 23 nous serait accordée, pour nous remettre un peu en ordre, et que I'on partirait le lendemain, ce qui fut fait.
«La défense de Djemila » estime I'historien M. Ernest Mercier, est un des plus glorieux faits d'armes des guerres d'Afrique, cependant il est resté peu connu. Le gouverneur s'abstint de le faire valoir comme il le méritait, car son idée fixe était de prouver à la France que I'Algérie était soumise.
Pourtant cette défense d'un poste ouvert est un des plus beaux faits d'armes de la guerre d'Afrique, supérieur à la fameuse défense de Mazagran, mais Mazagran était près de la mer, en face de Marseille, sous I'œil d'une presse tenue au courant. tandis que derrière la masse énorme des montagnes Kabyles, qui donc, parmi les journalistes, connaissait Cuicul la romaine ? Plus tard, un grand conteur, Alexandre Dumas, y prit intérêt, mais c'était trop tard. La popularité de l'écrivain ne réussit pas à populariser, à l'égard des Zéphyrs de 1840, les Zéphyrs de Décembre 1838, c'est dommage.
Maurice Villard
Les villages des Hauts-Plateaux sétifiens
ACEP
|
|
PHOTOS de CONSTANTINE
ACEP-ENSEMBLE 289
|
|
EN HOMMAGE
ACEP-ENSEMBLE N°290
|
|
A TOUTES LES FAMILLES
DE NOTRE PAYS
Si, ayant dû quitter cette terre d'Algérie
Où tu avais tes peines, tes joies et ta raison,
Tu as pu, dans l'angoisse, repartir dans la vie,
Et, sans dire un seul mot reconstruire ta maison,
Si ton sang est Lorrain, Franc-Comtois,
Sicilien, Corse, Basque, Alsacien ou Maltais,
Mais que tu n'oublies pas tous les Anciens,
Avec eux dans le soleil, en chantant tu allais,
Si tu revois encore Sétif, l'Idéal et le Bou-Sellam,
B.B.A., le cours du Chevron et les joncs de St-Rame,
St Arnaud, le Pain de Sucre et les rives de Mansouria,
Ampère, Béhagle, Bel-Imour et El-Ouricia,
Si tu gardes bien en toi l'image du passé
Si toujours fidèlement,
Sétif de l'Hexagone tu reçois,
Et qu'à Nino, ta cotisation tu envoies.
Si tu sais applaudir cent fois la même histoire,
Et ne pas t'exclamer « tiens mais je la connais »,
Si tu sais cultiver ton accent coloré,
Si tu peux t'esbaudir sans nulle vulgarité,
Si tu sais déguster l'anisette sans tomber dans l'ivresse,
Si tu sais tendre la main à l'ami en détresse,
Et regarder le ciel en louant le Seigneur,
Et qu'en étant Français, tu restes toujours Pied-Noir,
Alors mieux que tous ces prétendants,
Pied-Noir tu deviens mon frère
|
|
DÉCOUVERTES
Homme préhistorique 1913, tome XI, N° 12
|
Préhistoriques dans les Oasis Sahariennes
Par P. BERTHIAUX (Montereau, S.-et-M.).
Pendant le cours de ces dernières années, de sérieuses recherches ont donné lieu à de nombreuses et importantes découvertes préhistoriques, qui sont venues jeter de nouvelles lumières sur l'époque quaternaire et lever en même temps une partie du voile qui recouvre encore cette nouvelle science. Nous avons suivi, avec un vif intérêt, tous les travaux d'archéologues éminents, dont le nom tait autorité, et; bien que tous leurs travaux aient modifié nos idées sur certains faits ou sur certaines conséquences, il n'en est pas moins vrai que chaque préhistorien signale toutes les trouvailles qui lui semblent intéressantes, afin d'aider à l'avancement de la préhistoire.
Aujourd'hui donc je suis heureux de porter à votre connaissance la découverte d'une nouvelle station, située dans l'extrême Sud-Oranais, à 100 kilomètres au sud-est de Timimoun, « Les Oasis sahariennes ». Les objets que je vais décrire m'ont été adressés par un de mes amis, Léon Girod, sergent-major et greffier-notaire à Timimoun, auquel je suis heureux de rendre hommage et de remercier publiquement.
Ces objets ont été ramassés par lui, au cours de ses tournées de police ; et c'est de cette région complètement inexplorée qu'ils proviennent tous.
Ces «riens» préhistoriques ont été trouvés à l'air libre sur des terrains de « reg », c'est-à-dire des plaines caillouteuses, qui s'étendent autour de Timimoun et Semjane et également à Tabelbala, « oasis située à l'ouest de l'Oued Saoura ».
Leur authenticité ne peut être douteuse, attendu qu'aucun préhistorien européen n'a pensé à explorer ces régions désertes et que, de plus, tous ces objets ont été ramassés par un Français !
Je vais donc commencer par décrire les pointes de flèches dont la majorité ne diffère pas des types africains récoltés jusqu'à ce jour (Fig. 1).
Type de Flèches.
N° 1. — Pointe en feuille de laurier, très finement taillée des deux côtés et translucide en raison de sa minceur ; son poids est de 2 g B.
N° 2. — Pointe à bords latéraux, taillée également des deux côtés ; les encoches latérales sont régulières, mais plus nombreuses d'un côté que de l'autre.
N° 3. — Pointe taillée d'un seul côté, à base rectiligne ; poids 2 g
N° 4. — Pointe losangée ; ressemble au n° 1, mais taillée plus grossièrement.
N° 8. — Pointe à pédoncule et ayant deux faibles barbelures.
N° 6. — Pointe à base triangulaire, finement taillée : flèche d'une régularité parfaite.
N° 7 et 8. — Pointes à pédoncule, sans barbelure, très minces et taillées à grands éclats.
N° 9. — Pointe à pédoncule très fin, sans barbelure, retouches régulières
N° 10. — Pointe à base concave très resserrée; encoches latérales régulières et très finement taillées.
N° 11. — Pointe taillée d'un seul côté et ébauche d'une barbelure.
N° 12. — Pointe à base triangulaire, d'un fini remarquable.
N° 13. — Eclat lamellaire avec retouches à grands éclats.
N° 14. — Pointe retouchée régulièrement des deux côtés et assez belle.
N° 15. — Pointe à base concave, remarquable comme travail ; son poids est de 1 g 5 ; les encoches sont régulières.
N° 16 et 17. — Eclats superbes, retouchés assez finement.
N° 18. — Pointe en losange, d'un fini très soigné; les retouches sont merveilleuses.
N° 19. — Pointe sans pédoncule; la base est rectiligne, et, sur un côté, figure une barbelure; les retouches sont belles.
N° 20. — Pointe interchangeable, ressemblant au perçoir multiple. Cette pièce est plus rare, son taillage est habilement fait.
Les pointes de flèches sont très nombreuses ; on peut du reste en juger par la diversité des gravures ci-dessus (Fig. l), et se rendre compte exactement de la variété des formes. La plupart sont taillées avec une telle perfection et une telle finesse qu'il faudrait beaucoup de peine et d'adresse pour les produire aujourd'hui, même avec nos instruments perfectionnés. Il ressort par induction de ces admirables pointes de flèches, que, si chaque objet était destiné au tir à l'arc, nos ancêtres devaient avoir une adresse extrême, car sans doute ils comptaient retrouver dans le corps des victimes une arme d'une exécution aussi longue que délicate.
Cette période antéhistorique de l'homme est particulièrement intéressante. Elle est loin d'être l'état sauvage, car elle nous présente, dans tous ces endroits, les premières agglomérations humaines organisées, et par suite les premiers rudiments de la Civilisation.
L'homme, pour ainsi dire privé de tout, s'ingénue alors à tirer parti de tout ce que lui offre la nature, pour parer tant à ses besoins personnels qu'aux nécessités de la vie. C'est à ce moment que l'on voit l'initiative individuelle aux prises avec les difficultés incessantes de l'alimentation et de la sécurité personnelle et collective : d'où la fabrication des pointes décrites ci-dessus.
Néanmoins, chez ces premiers hommes, est né le luxe des ornements; et nous trouvons ci-dessous les premiers objets de parure, en pierres, coquilles fossiles, jais, bois ou os, dents, etc., dont ils aimaient se parer (Fig. 2).
Amulettes.
N° 1. — Dent percée d'un trou de suspension, pour servir de partie de collier.
N° 2.— J'insiste très spécialement sur cette pièce en nacre. Un curieux spécimen de l'art de la sculpture est la FIGURATION HUMAINE qu'elle représente ; l'œil de cette tête servait de trou de suspension. Cette amulette, je crois, doit être très rare.
N° 3. — Objet en nacre, percé d'un trou.
N° 4. — Perle percée pour collier; ce grain a probablement été sur une coquille assez forte, car, dans les stries, on distingue très bien la nacre.
N° 5 et 6. — Pierres percées pour amulette ou pour collier.
N° 7 et 8. — Rondelle très fine, en os, percée d'un trou de suspension.
N° 9. — Très petite pierre, finement retouchée et percée d'un trou.
A ce qui précède, je n'ajouterai plus qu'un mot : c'est d'espérer que, dans cette région, non étudiée en préhistoire, d'autres découvertes nous réservons des surprises en nous faisant connaître les mœurs de nos précurseurs.
Il m'a semblé curieux et intéressant de montrer encore une fois ces objets préhistoriques, et de mettre sous les yeux du public ces vestiges de l'époque quaternaire.
|
VICTOR HUGUET
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°205 - Mai 2012
|
|
LE MEILLEUR ARTISTE ORIENTALISTE PROVENÇAL
Victor Huguet est né au Lude en 1835 et est décédé à Paris à 1902. Il étudia avec Émile Loubon à Marseille, puis avec Eugène Fromentin à Paris. Bien que Fromentin n'ait jamais eu un atelier d'enseignement à proprement parler, il réunissait quelques jeunes artistes autour de lui, et les premiers travaux de Huguet montrent une certaine influence du maître orientaliste dans le choix des sujets et la palette sobre. En 1852, âgé de 17 ans, Huguet alla en Égypte et, en 1853. il accompagna le peintre de marine J.B.H. Durand-Brager en Crimée, avant le siège de Sébastopol.
Il est profondément marqué par les paysages qu'il traverse et qui vont influencer son inspiration vers l'Orientalisme, où il se fait rapidement un nom.
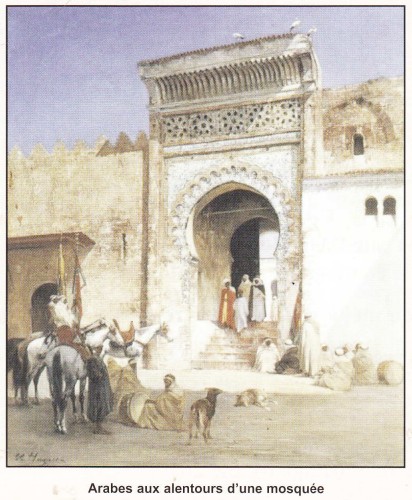 Découvrant l'Algérie quelques années plus tard, il y puisera de nombreuses sources d'inspiration. Débutant aux Salons de Marseille et Paris en 1859, il exposa régulièrement aux Artistes Français avec des oeuvres telles que Halte de bicharis dans le désert de Libye, 1861, Halte sur les murs à Constantine, I865 et Dans les douars du sud de l'Algérie, 1877.Il exposa trois tableaux, dont l'un appartenait au marchand Durand-Ruel, au premier Salon de la Société des Peintres Orientalistes Français, qui fut organisé en même temps qu'une exposition d'art musulman au Palais de l'Industrie à Paris, en 1893. Il continua à envoyer des oeuvres à ce Salon pendant les années 1890. Découvrant l'Algérie quelques années plus tard, il y puisera de nombreuses sources d'inspiration. Débutant aux Salons de Marseille et Paris en 1859, il exposa régulièrement aux Artistes Français avec des oeuvres telles que Halte de bicharis dans le désert de Libye, 1861, Halte sur les murs à Constantine, I865 et Dans les douars du sud de l'Algérie, 1877.Il exposa trois tableaux, dont l'un appartenait au marchand Durand-Ruel, au premier Salon de la Société des Peintres Orientalistes Français, qui fut organisé en même temps qu'une exposition d'art musulman au Palais de l'Industrie à Paris, en 1893. Il continua à envoyer des oeuvres à ce Salon pendant les années 1890.
Les toiles de Huguet se situaient en général en Algérie, Libye, Égypte ou, parfois, à Constantinople. Il excellait dans les chevaux et ses tableaux de campements, de chasses au faucon, de cavaliers abreuvant leurs montures, traversant des oueds ou arrêtés devant des portes monumentales connurent très tôt la faveur des collectionneurs. Bien que ses oeuvres ne soient pratiquement jamais datées, sa technique devint, au fil des années, plus impressionniste, et ses couleurs se firent plus lumineuses et plus riches, avec des harmonies d'ocres, de roses, de rouges, de bleus.
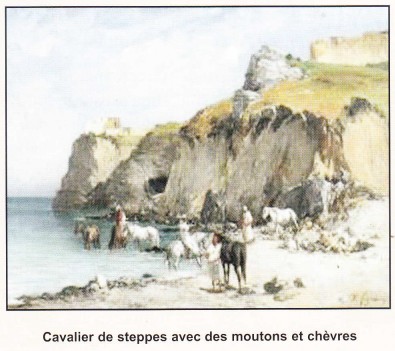

On trouve des oeuvres de Huguet dans les musées de Nîmes (un marchand d'esclaves traversant le désert de Suez), de Rouen (Ruines d'aqueduc romain, environs de Cherchell), de Montpellier (Halte d'Arabes en Afrique), d'Aix (Cavaliers algériens) et de Marseille (Le Minaret et Caravane).
Les Orientalistes, peintres voyageurs
De Lynne Thornton
ACR Edition
|
|
ANNALES NOUVELLES
N° 4, 1842
|
|
L’Algérie. Des moyens de conserver et d’utiliser cette conquête ;
Par le général Bugeaud, gouverneur général de l'Algérie.
Paris, 1842, vol.1. Chez Dentu, au Palais-Royal.
Les Français prirent Alger en 1830. Depuis cette époque, les idées ont paru varier parmi eux sur le parti qu'ils embrasseraient relativement au pays dont cette ville est la capitale. La majorité penchait pour le conserver ; ce sentiment est aujourd'hui général à très-peu d'exceptions près. Mais, si l'on est généralement d'accord à cet égard, on ne l'est pas autant sur les meilleurs moyens employés pour parvenir sûrement à cette fin. Nous sommes naturellement impatients ; nous voulons jouir très promptement du résultat de nos efforts, et cependant chacun sait que pour faire un travail solide, il faut de la persévérance.
Le général Bugeaud, fort de l'expérience que lui ont donnée deux séjours en Afrique, et notamment le second, offre, en bon citoyen, le fruit de ses méditations elles lui ont démontré la nécessité de dominer le pays, afin de pouvoir y fonder une grande colonie qui ait de la durée.
Plusieurs personnes avaient pensé que l'armée d'occupation pourrait être diminuée après la conquête ; C'est une erreur que mon patriotisme m'ordonne de combattre, s'écrie le général Bugeaud, je n'hésite point à le dire, les mêmes forces, ou à peu de choses près, qui auront effectué la conquête, seront indispensables pour la maintenir.
Les Arabes sont fiers et belliqueux la guerre de tribu à tribu est leur état normal ; dés leur enfance, tous les hommes sans exception s'exercent au maniement des armes et des chevaux ; les entreprises hasardeuses les occupent sans cesse. Pensera-t-on qu'on puisse diminuer nos forces en présence d'un peuple ainsi préparé ? Nous ne tarderions pas à payer cher une pareille imprudence. L'histoire des Arabes nous apprend combien ils sont prompts à la révolte, leur antipathie pour nous et pour notre religion durera des siècles ; restons donc forts au milieu d'eux, sous peine de perdre en quelques jours le fruit de tant de travaux. Nous le devons d'autant plus que c'est, à mon avis, le seul moyen d'éviter que l'occupation soit onéreuse. Une armée »suffisante administrera le pays, recevra l'impôt et favorisera de nombreuses spéculations commerciales. Les contributions de l'intérieur, les revenus de douanes et d'octrois, les ressources que les troupes pourront se créer dans leurs stations, par la culture de quelques parties de terrains très-riches, défrayeront, en peu d'années de toutes les dépenses de l'occupation telle est la conviction que j'ai acquise par l'expérience des résultats déjà obtenus, et par suite des observations que j'ai faites en parcourant le pays dans tous les sens.
Le général Bugeaud prouve que l'armée n'est pas moins nécessaire pour mettre la conquête à profit que pour la conserver, qu'elle est et sera longtemps le seul agent sérieux des grands travaux qui doivent ouvrir à la France les voies commerciales de l'Algérie, et même celles de l'intérieur de l'Afrique.
Après avoir exposé en détail la tâche que l'armée doit accomplir pour l'avantage réciproque de la colonie et de la métropole, il développe habilement l'effet moral et physique que cette détermination suivie avec constance, produira sur les Arabes.
La durée de la guerre a révélé le meilleur système à suivre pour dompter les Arabes, il convient d'y recourir également pour les maintenir dans la soumission c'est par la mobilité constante de nos forces et leur concentration sur un petit nombre de points bien choisis que l'on y réussira. Le général indique ces stations ; elles sont au nombre de sept dans l'intérieur et d'autant sur la côte. Une armée de 80,000 hommes est nécessaire pour les occuper ; si l'on veut opérer avec sécurité et avec la rapidité désirable.
Le gouvernement, les chambres, le public, observe le général, vont se récrier sans doute sur l'énormité de ce chiffre, je m'y attends et je m'y expose. J'ignore l'art de tromper le pays ou de caresser ses erreurs ; j'aime mieux heurter ses illusions et lui dire sans ménagement les conditions du succès de son entreprise, que de le livrer dans l'avenir à des mécomptes désastreux.
A ceux qui trouveraient cette quantité de soldats trop considérable, le général dit qu'ils doivent prendre en considération les faits suivants l'Algérie à 240 lieues de longueur sur 50 de largeur sa superficie offre fréquemment de grandes inégalités ; la population y est plus forte qu'on ne l'avait supposée, très-belliqueuse, très-active ; ses guerriers rassemblés en corps de troupes, ne forment que de petites armées qui sont dans un mouvement continuel.
Or, l'armée ne devant se partager qu'en portions capables de vaincre tous les rassemblements ennemis, doit être nombreuse pour se diviser d'une manière convenable, et dominer les hommes éparpillés sur cette immense surface. Les moyens d'exécution, conseillés par le général Bugeaud sont très-sages il a bien étudié son sujet on le reconnaît sans peine. On s'instruit en lisant ce qu'il dit sur la colonisation il préfère comme la meilleure celle qui résultera de l'établissement de militaires qui auront passé quelques années sous les drapeaux.
Il fait voir que, dans l'état actuel des choses, la colonie doit être régie par un gouverneur militaire. Les essais que l'on a tentés de lui adjoindre un administrateur civil, à peu près égal en pouvoirs, n'ont pas été heureux. Le gouvernement militaire n'exclut pas l'action de l'administration civile pour les colons ; mais en présence des Arabes, il est indispensable que l'autorité militaire n'éprouve aucun empêchement, aucun retard le salut de toute la communauté dépend de la promptitude avec laquelle la force se montre.
Quelques personnes seront peut-être surprises d'apprendre que l'Algérie pourra, en peu d'années, produire un revenu suffisant pour entretenir et solder l'armée qui l'occupera. Le général Bugeaud s'en est convaincu par ses excursions répétées dans le pays dont les historiens anciens n'ont point parlé par hyperbole, en disant que cette partie de l'Afrique était le grenier de l'empire romain. Il a vu fréquemment des terrains fertiles qui donnent d'abondantes récoltes, et cependant les Arabes ne peu vent consacrer qu'un temps très-court à leurs travaux agricoles.
Notre ennemi Abd-el-Kader a pu, avec les ressources que lui fournissait le pays, faire face a des dépenses énormes pour soutenir la guerre. Ce fait est de bon augure pour nous, mais il faudra le temps.
Malgré la guerre, l'état des choses s'est amélioré sensiblement dans l'Algérie en 1831, la population européenne, indépendamment de l'armée était de 3,228 individus ; en 1842, elle s'élevait à 40,000.
Le produit des revenus publics fut en 1831 de 1,048,479 f. 12c. ; il a été de 5,633,863f. 80 c. dans les six premiers mois de 1842.
Le général Bugeaud explique avec beaucoup de clarté comment l'Algérie ne peut être colonisée comme l'ont été d'autres contrées du globe; la terre y étant féconde, mais mal cultivée ; le sol nu, raboteux, inégal, et presque dénué de villes, la population pauvre, guerrière, intrépide, ignorante, et dans cet état de civilisation qui, laissant à l'homme toute sa sauvage indépendance, le rend plus difficile à dompter.
Il montre ensuite comment l'armée en soumettant le pays, y établissait la domination politique de la France et ouvrait ainsi à la civilisation, l'intelligence et à l'activité européenne un champ nouveau où elles allaient s'élancer comme force protectrice, elle y faisait naître peu il peu la sécurité ; comme réunion de travailleurs, sous une direction unique elle sillonnait le pays de ces routes, immenses bras qui l'enserrent et l'empêcheront de nous échapper.
Les premières richesses créés par l'armée, ou à sa cause d'elle, n'ont pas tardé à en développer du de nouvelles ; elle a été le premier germe de la colonisation, elle en est, elle en sera encore la souche principale. Ces quarante mille européens, établis aujourd'hui en Algérie, et qui augmentent en nombre tous les jours, sont prêts à entreprendre la conquête commerciale du pays.
Abd-el-Kader avait jugé sainement la haute importance des relations que le négoce établit entre les hommes. A vous la mer, à moi la terre, disait-il avec un accent de confiance puisé dans la conviction de sa force.
Depuis 1834, il a été fidèle à ce principe, ses efforts ont constamment tendu à nous séparer de la population arabe ; il voulait le commerce pour lui seul, parce que c'était un sur moyen qu'il avait de s'enrichir, et de plus, il comprenait que les Arabes une fois convaincus des avantages qu'ils trouveraient à trafiquer directement et paisiblement avec nous, ne tarderaient pas à être sourds à la voix des passions religieuses ou politiques, et se soustraire à son influence et à son pouvoir.
Les Arabes ne sont nullement inaccessibles à l'intérêt, l'espoir de gagner de l'argent avec nous sera un appât qui les déterminera promptement à se rapprocher de nous. « Chaque Arabe qui s'enrichira, observe le général Bugeaud, deviendra notre partisan : c'est un ennemi de moins et un allié de plus. Le joug de la force auquel ils se résignent si facilement, servira de prétexte à leur soumission l'intérêt en sera le véritable mobile, et, la concurrence s'établissant, les prix rentreront bientôt dans leurs limites normales.
Un tableau présente le mouvement de la navigation pendant les années 1840 et 1841. La valeur des importations qui, durant la première période, a dépassé la somme de 54,872,000 fr., s'est élevée durant la seconde, à plus de 64,894,000 fr. La France a pris la part la plus considérable à ce commerce. L'Angleterre n'y est pas restée étrangère ; après elle vient la Toscane.
En faisant disparaître la piraterie qui désolait la Méditerranée, dit le général Bugeaud, en rendant l'Algérie au monde civilisé, la France a ouvert cette partie du globe au commerce de toutes les nations, et a ajouté un intérêt de plus a tous ceux qui tendent à maintenir la paix universelle.
L'ouvrage que nous venons d'examiner est celui d'un brave militaire, éclairé par l'expérience, et d'un bon citoyen animé du vif désir d'être utile à sa patrie, il parle avec ce ton de conviction intime qui la porte dans l'âme de ses lecteurs. En conseillant d'entretenir dans l'Algérie une force militaire, considérable pendant les premières années qui suivront la conquête, il recommande de choisir, pour commander les arrondissements militaires, des généraux aussi jeunes que possible, et de préférence ceux qui ont servi en Afrique ; Car il est de la plus haute importance, ajoute-t-il, qu'ils connaissent la topographie, les mœurs, les usages, et, s'il se peut, la langue du pays. Point de ces généraux de faveur peu méritée ils perdraient tout : point de ces hommes à qui l'on veut faire une grande situation, sans être assuré qu'ils auront la force de supporter cet énorme fardeau. Il faut, en un mot l'élite de l’état-major de l'armée ; mais en même temps, sachons faire à ces hommes une belle position qui puisse les dédommager de rester loin de la patrie, privés des douceurs de l'existence et de toutes les affections de famille.
Cette franchise ne peut que plaire à tous ceux qui liront le livre du général Bugeaud ; et quand même ils ne partageraient pas sa manière de voir, ils ne pourront s'empêcher de rendre justice à la pureté et à la droiture de ses intentions.
E. S.
|
|
| FORCERIES
De Jacques Grieu
| |
Quand l’homme ne comprend pas, plein d’interrogations,
C’est « la force des choses » qui lui sert d’objection.
Parmi toutes les forces aux noms avantageux,
C’est cette force-là qui le rassure le mieux :
Moins rude à cultiver que la force de l’âme,
La force de l’exemple ou « à force de rames ».
Car la « force des choses », répète ma concierge,
Explique à peu près tout : même ce qui diverge ;
« Pourquoi quatre saisons, pourquoi les jours, les nuits,
Pourquoi la neige est froide, pourquoi le soleil luit,
Pourquoi la terre est ronde, pourquoi la lune aussi.
Pourquoi monsieur Poutine dirige la Russie... »
L’importance de la force qu’en pays évolués,
Après les guerres mondiales on croyait atténuée,
Fait un retour… en force sur toute la planète.
La force envahit tout, nous tient sous sa houlette.
Entre force de frappe et la force publique,
Ou les forces de l’ordre, la force devient basique...
On voit que la violence tout comme la mystique
N’est que force du faible et sa suite tragique.
La force de toute foi, c’est juste qu’on y croit,
Alors qu’on craint bien peu la force de la loi.
Mais à force de croire, on oublie de douter !
A force de choisir, on va, sûr, se tromper.
Pour forcer l’avenir, il faut beaucoup… forcer
Et forcer le passé est souvent plus aisé.
Faiblesse qui conserve vaudra toujours bien mieux
Que force qui détruit à grand bruit belliqueux.
La force de la chaîne est dans chaque maillon
Mais sa faiblesse aussi quand l’un fait défection.
Parmi les grandes forces, on a force majeure,
La force centrifuge ou de la pesanteur,
Mais de toutes les forces qui sévissent sur terre,
La force d’inertie est la plus délétère.
« Force de la nature », pour les écologistes,
Elle devient forcément la plus préservatrice.
Si « forcer la serrure », de force, ne requiert pas
Le « de gré ou de force » est plus près d’un combat.
Pour « forcer l’attention » d’un homme politique,
Le « travailleur de force » n’est pas le plus logique.
À force de gîter, souvent le bateau coule.
Force de dictateur est l’ignorance des foules.
La pensée de nos bras vaut force de l’esprit :
A-t-on assez de force pour suivre nos avis ?
Si « l’union fait la force », c’est la force de qui ?
Est-ce toujours la force de ceux qui ont uni ?
Ce principe convenu, je le remets en cause ;
On en revient toujours à la « force des choses »…
Jacques Grieu
|
|
|
MON PANTHÉON DE L'ALGÉRIE FRANÇAISE
DE M. Roger BRASIER
Créateur du Musée de l'Algérie Française
|
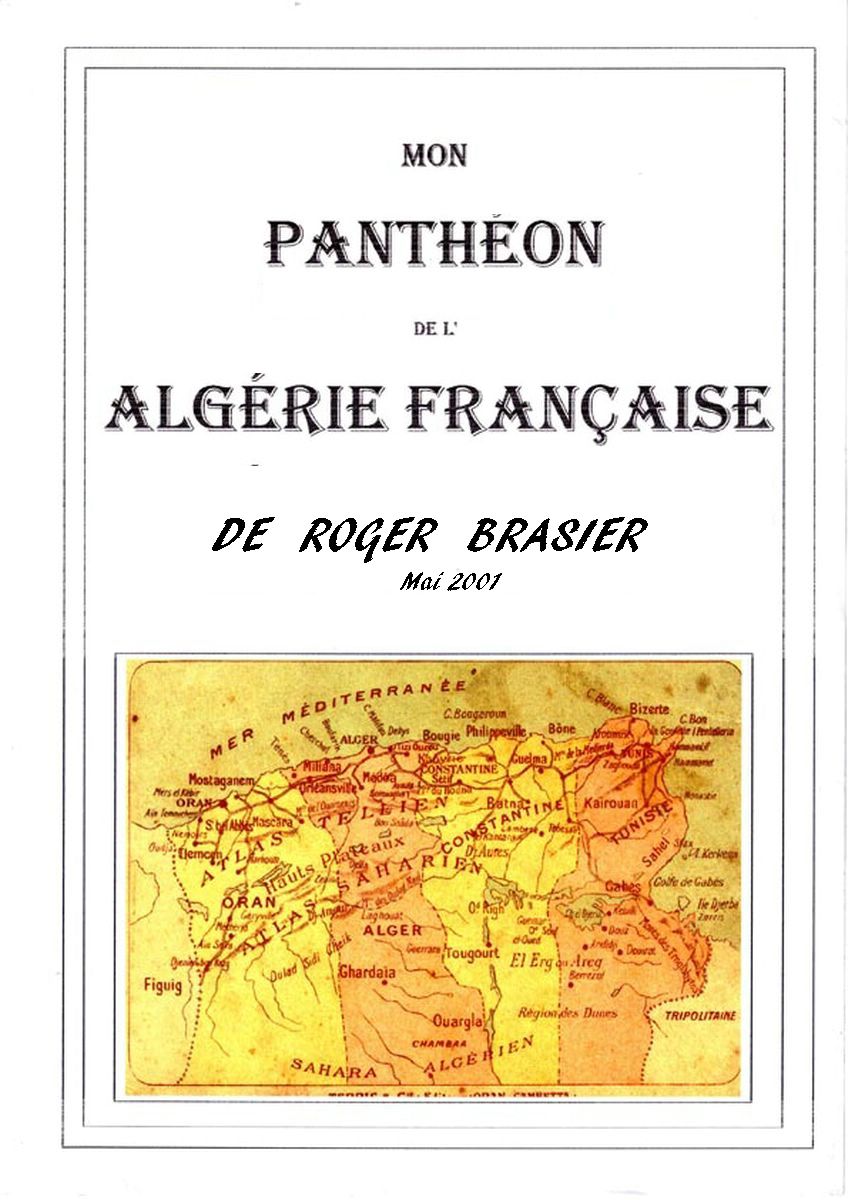 Le 1er octobre 2006, j'avais commencé la diffusion de ce Panthéon, mais par suite de la perte de mon fichier scanné de ce livre, je n'ai pas pu continué.
Je viens de retrouver ce fichier sur un vieux disque dur et je reprends cette diffusion.
Le 1er octobre 2006, j'avais commencé la diffusion de ce Panthéon, mais par suite de la perte de mon fichier scanné de ce livre, je n'ai pas pu continué.
Je viens de retrouver ce fichier sur un vieux disque dur et je reprends cette diffusion.
A SUIVRE
|
|
Poutine serait un monstre et de Gaulle un héros : ah bon ?
PAR MANUEL GOMEZ
Envoi de M. Georges
|
|
Vladimir Poutine fait assassiner Alexei Navalny qui s’opposait à sa politique : c’est un « monstre ».
Charles De Gaulle fait assassiner 46 innocents qui s’opposaient à sa politique : c’est un « héros ».
Quelle est la frontière entre un « monstre » et un « héros » ? Uniquement l’emplacement de vos pieds d’un côté ou l’autre de cette frontière !
**26 mars 1962 : DE GAULLE ORDONNE D’ASSASSINER DES FRANÇAIS.
De Gaulle voulait absolument rejeter toute la responsabilité du non-respect des «Accords d’Évian» sur l’action de l’OAS et pour cela il a recouru à la force des armes et fait ouvrir le feu sur une population désarmée qui ne souhaitait que rester française.
Le 26 mars 1962, une manifestation pacifique partait de Bab-el-Oued pour se diriger par la rue d’Isly vers le plateau des Glières. Bien entendu personne n’était armé, cela était absolument impossible compte tenu de l’état de siège dans lequel se trouvait Alger. Le rassemblement atteignait la Grande Poste du boulevard Laferrière, lorsqu’une rafale partit d’un fusil mitrailleur mis en batterie au dernier étage du 64 de la rue d’Isly.
Une deuxième rafale meurtrière déchaîna l’enfer.
Les tirailleurs algériens complètement affolés tiraient sur tout ce qui bougeait, vers les toits, sur la foule, c’était une tuerie. Des tirs sans sommation qui durèrent près de douze minutes.
Le bilan officiel sera de 46 morts et 200 blessés du côté des « patriotes », 10 blessés chez les tirailleurs, victimes de balles perdues, et un seul mort (abattu par un officier alors qu’il achevait une femme blessée).
Un second rapport militaire fait état d’une centaine de morts et de plus de 200 blessés.
À la morgue de l’hôpital de Mustapha, les corps étaient jetés par terre, tous nus, en vrac, et ils ne seront pas rendus à leur famille.
La vérité « officielle » sur ce massacre programmé n’est toujours pas reconnue par les différents gouvernements français et il serait étonnant qu’elle le soit un jour.
Une certitude, ce massacre de la rue d’Isly et, par conséquent l’objectif de cette manœuvre, était la fracture totale entre les Français d’Algérie et l’armée métropolitaine, promise dorénavant au service de l’ALN. De Gaulle avait atteint son but.
**La preuve directe de l’organisation par le gouvernement français, donc par De Gaulle en personne, du massacre des innocents le 26 mars 1962, rue d’Isly à Alger nous est apportée par CHRISTIAN FOUCHET qui, rappelons-le, était Haut-commissaire en Algérie ce 26 mars 1962, et ministre de l’Intérieur du 6 avril 1967 jusqu’au 31 mai 1968, date à laquelle il fut limogé par De Gaulle.
Voici le témoignage et l’aveu de CHRISTIAN FOUCHET le 28 octobre 1969 : « J’en ai voulu au général de m’avoir limogé au lendemain de mai 1968. C’était une faute politique. De GAULLE m’a reproché de ne pas avoir maintenu l’ordre en mai 68.
– Vous n’avez pas osé tirer, m’a-t-il dit.
– J’aurais osé s’il l’avait fallu, lui ai-je répondu. Souvenez–vous de l’Algérie et de la rue d’Isly. Là j’ai osé et je ne le regrette pas parce qu’il fallait montrer que l’armée n’était pas complice de la population algéroise. »
(Source : Jean Mauriac « L’Après De Gaulle – notes confidentielles 1969/1989 – page 41)
Ce même mois de mai 68, De Gaulle lançait à Pompidou une phrase qui résumait toute sa carrière : « Mais, Pompidou, figurez-vous que j’ai passé ma vie à tirer contre des Français. » (rapporté par Édouard Balladur à Daniel Rondeau, auteur de « Vingt ans et plus – journal 1991/2012)
Dès le cessez-le-feu proclamé le 19 mars 1962, l’armée française, sur les ordres de De Gaulle et de quelques officiers supérieurs, les généraux Katz, Debrosse et Ailleret, a perdu son honneur car elle n’a pas éprouvé le moindre état d’âme quand il a fallu tirer sur des Français qui défendaient une terre française à Alger et ne s’est pas opposée au massacre, par l’ALN, de près de 3000 français en Algérie et notamment à Oran.
Honneur aux officiers de notre armée qui ne se sont pas parjurés.
Le général de Pouilly, un fidèle parmi les fidèles à De Gaulle, n’hésitera pas à écrire : « J’ai choisi la discipline mais choisissant la discipline, j’ai également choisi avec mes concitoyens et la Nation Française la honte d’un abandon et, pour ceux qui n’ayant pas supporté cette honte et se sont révoltés contre elle, l’Histoire dira peut-être que leur crime est moins grand que le nôtre. »
Conclusion : si Poutine est un monstre, De Gaulle ne l’est pas moins !
|
<
|
La tuerie dite de la rue d’Isly –
Le grand silence
Envoyée Par Mme Simone Gautier-
ALGER Plateau des Glières 26 mars 1962
mardi 12 mars 2024
|
Un assassinat collectif
sur ordre du sommet de d’Etat
C’est, ce jour-là, qu’une foule française a été mitraillée par ses propres soldats. Cela ne s’était plus produit depuis la Commune de Paris en 1870.
Le 23 mars, 4 jours après les soi-disant accords d’Evian, à la suite d’une agression contre les forces de l’ordre, celles-ci encerclent le quartier de Bâb el Oued, soupçonné d’abriter des activistes OAS, l’isolent totalement de l’extérieur, en font un ghetto, mitraillent les façades, les terrasses et les balcons des immeubles, fouillent sans ménagement les habitations, détruisent tout sur leur passage, voitures, vitrines, portes cochères ... violentent les habitants, s’attaquent à des civils sans défense ... raflent les hommes de 18 à 70 ans pour des camps d’internement. Tous les morts, y compris les enfants, sont à eux.
Le 26 mars, tout le petit peuple d’Alger, chef lieu d’un département français, d’une province française, l’Algérie, se rend vers Bâb el Oued en une longue manifestation pacifique. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieux messieurs avec leurs décorations se réunissent pour demander la levée de ce blocus inhumain. Là on est silencieux, là on chante la "Marseillaise" ou les "Africains". Là on séduit les militaires pour passer. Là on est passé. Là c’est le corps à corps avec les militaires.
Mais le piège, un traquenard, est déjà en place : une véritable nasse.
La foule arrive sur le Plateau des Glières et s’engouffre rue d’Isly, seule voie rendue possible pour se rendre à Bâb el Oued. Tout autour, toutes les artères sont verrouillées. La nasse fonctionne. Elle se referme.
14 heures 50, les tirailleurs du 4ème RTA ouvrent le feu sur ordre, mitraillent les civils sans discontinuer, en rechargeant leurs armes. La radio, présente sur les lieux, enregistrera les appels vains et désespérés du lieutenant et de civils hurlant "halte au feu".
Dans les rues alentours, cette fusillade devient un signal. Une véritable chasse aux Français d’Algérie commence. Les CRS et les gardes mobiles s’acharnent, tirent sur leurs compatriotes sans défense ..... Sur ordre … par vengeance.
Nous ne connaissons pas tous les noms et le nombre de tous ceux assassinés au Plateau des Glières devant la Grande Poste et tout autour, rue d’Isly, boulevard Pasteur, rue Chanzy, rue Lelluch, boulevard Baudin et plus loin, Place de l’Opéra et aussi aux Facultés, et plus loin encore au Champs de Manœuvres et dans le haut du boulevard du Télémly, et encore, une heure après la fusillade.
Les militaires, les gendarmes, « les rouges » les CRS occupent les carrefours, les toits, les terrasses, font des barrages. Partout toutes les armes sont approvisionnées et chargées, partout. Les tirailleurs avancent rafales après rafales, arrosent les gisants au P.M. et au F.M., chargeur après chargeur.
Ils mitraillent les façades, les intérieurs des appartements aux volets clos, achèvent les mourants à l’intérieur des magasins, les poursuivent à l’intérieur des couloirs des immeubles. Et puis, ils tirent sur les médecins et les pompiers. Ils tirent sur les ambulances, déjà toutes prêtes, déjà là, à attendre les morts et les blessés. C’est une véritable chasse aux pieds noirs, une tuerie, un carnage, auquel se sont livrés les tirailleurs aux gestes obscènes, les gardes mobiles aux ricanements haineux et les CRS qui insultent et matraquent et balayent rue Charras, rue Richelieu, rue Clauzel : lisez les témoignages.
La foule était dense. C’était un cortège de jeunes gens et de jeunes filles, d’enfants et de vieux messieurs aux médailles d’anciens combattants. Ils avaient des drapeaux, ils chantaient la Marseillaise et les Africains et ils s’effondrent, gisants ensanglantés.
Et puis les ambulances et les Dodges des militaires ramassent les morts et les blessés et vont et viennent et déversent leurs cadavres à l’hôpital Mustapha, à la clinique Lavernhe, à la clinique Solal.
Le bilan est terrible : entre 55 et 80 morts (dont des enfants rendus aux parents sur ordre de se taire) et des centaines de blessés dont certains ne survivront pas et d’autres souffrent encore des séquelles de leurs blessures. Une chape de plomb, 52 années de plomb, couvre toujours cette tragédie. C’est toujours le grand silence, une rupture de la continuité de la vie et de la mort, le deuil impossible.
Les cadavres seront entassés, dénudés, à la morgue de Mustapha puis enterrés à la hâte, sans sacrements, clandestinement, en faisant courir les familles dans les cimetières dispersés de la ville. Il y aura ceux qui n’avaient pas « d’identité » sur eux et qui seront enterrés de nuit, par convoi militaire, pendant le couvre-feu, au cimetière El Halia.
Une enquête judiciaire est tardivement ordonnée. L’enquête sera bâclée en quelques jours. Le compte-rendu de l’enquête réalisée par le Commissaire de police Pierre Pottier ne sera jamais rendu public. L’autorité militaire se refusera à toute audition du service d’ordre ainsi qu’à la communication du dispositif d’implantation des unités engagées. La commission rogatoire sera retournée au magistrat instructeur sans exécution.
En 1966, le juge d’instruction Charbonnier ne peut consulter les pages du journal de marche du 4ème R.T. détachées et transmises au Procureur général Jonquères qui instruisait ce dossier pour l’Armée.
En 1966 un jugement de non-lieu sera prononcé.
En 2008 une nouvelle loi verrouille les archives de la guerre d’Algérie.
Les années de plomb continuent.
C’est aussi pour eux qu’il est indécent de célébrer le 19 mars.
[1] Albert CAMUS
|
|
PHOTOS de CONSTANTINE
ACEP-ENSEMBLE 289
|
|
RECONQUETE
Pieds -Noirs d'Hier et d'Aujourd'hui - N°205 - mai 2012
|
|
Il y n'y avait rien,
il n'y avait plus rien,
C'était le désert et l'abandon,
C'était la marée des conquérants,
La boue des rues,
La boue des urnes,
La boue des peurs
Et des malheurs,
Odeur d'Orient, odeur de rien.
Sur les mosaïques gothiques
De nos cathédrales antiques,
Sur les ruines vivantes,
De la patrie aimante,
Le charivari puant
De polichinelles à turbans,
Haineux, fébriles et méchants,
Donnait un nouveau "la":
Celui du Prophète d'Allah.
Sous le soleil des rois,
Dans la patrie de Jeanne,
De Colbert, de Turenne,
De Larrey, de Paré
A la face de tous paraît,
Dans l'hallali de l'effroi,
Le rictus de la haine.
Entre Saint-Just et Marat,
Rigolard, un Fou d'Allah,
Rotant son dernier repas
De mouton, de zalabias,
Explique sur les télés
Que nos principes et nos lois,
Que la victoire du 19 Mars,
Que les ventres abondants
Du légitime conquérant
Fondent l'ordre nouveau,
Ordonnent la grande farce
D'un nouveau monde où le Gaulois
Entre la tyrannie des sots
Et celle de Gayssot
Doit se taire, muselé,
Adorer le nouveau dieu,
Adopter le calendrier
Et renier le sanglier
Et, pour le reste, se taire et filer droit.
Le nouveau roi de la tribu,
Le perroquet de minaret,
Par les élus souchiens adoubé,
A parlé.
Le Patriote,
L'enfant de France,
Celui de la vieille Europe,
A vu sa citadelle vaciller
Et pleurait le soir en priant son Dieu,
En priant ses dieux,
En invoquant ses aïeux,
Il protestait tout seul
Contre un destin cruel
Et soudain, dans l'ombre du maquis,
Il entendit des frères en marche
Lui redonner, l'espoir.
Il vit leurs ombres se dessiner
Sur fond lumineux de résistance
Et de combat.
Et son cœur reprit confiance.
Face aux traîtres nés,
Face aux vaincus innés
Qui le faisaient dhimmi,
Qui le faisaient esclave,
Qui le faisaient larbin,
Qui le faisaient soumis
De la loi des forbans à Charia,
Arrogants en pays conquis,
Vidant nos caisses et vidant nos lois,
Sifflant nos chants
Violant notre âme et nos drapeaux,
Vidant nos poches et nos mémoires,
Moquant nos femmes et notre Histoire,
Le patriote,
L'enfant de France,
Et de notre vieille Europe
A retrouvé courage,
A retrouvé sa vie.
Dans cette féconde terre
De traîtres héréditaires
Dans la patrie interlope
de Cauchon, de Ganelon, de Judas,
de Bony, de Lafont, de Gayssot
Et de tant de salopes
Sonne l'heure encore
D'une autre résistance,
D'une autre gloire, d'un autre honneur,
Tout autant héréditaire;
L'heure est aux Identitaires
Le Patriote,
L'enfant de France,
Celui de la vieille Europe
Se souvient sans honte
De ses héros et de ses saints,
De ses génies et de ses gloires
Il prie Dieu,
Il prie ses dieux,
Il prie ses aïeux
Que la phalange qui se lève
Comme à Poitiers, comme à Lépante
Que l'armée à fleur de Lys
Ou que l'armée républicaine
De Charleroi et de Verdun,
Comme à Beyrouth, comme en Serbie,
Au Bosphore ou à Alger,
à Madrid, à Vienne ou à Toulouse,
à Budapest ou à Belgrade,
Pour la terre et pour le roi,
Pour la Laïcité ou pour la foi,
Pour l'humanisme, la Liberté
Rende à nos cœurs et à nos lois
Le parfum, le goût et les couleurs
De notre Identité.
Guy Rolland
|
|
L'ASSIETTE
Tirailleur Algérien, N°510, octobre 1900
Source Gallica
|
|
Quand Alphonse Sévéran prit la direction des Fantaisies-Bergerettes, il n'était pas encore trop déjeté, portrait beau, les soirs de « premières », et, avec un peu de brillantine aux moustaches et une pointe de Champagne ailleurs, pouvait passer quand même pour ce que Lucy Lamour nommait un «vieux Confortable ».
Le sobriquet avait fait rapidement le tour de Paris et des foyers des scènes de genre. Bien mieux : pour la centième fois depuis le début de sa longue carrière, Alphonse Sévéran redevint à la mode. Les ingénues le ... désirèrent, les grandes vedettes cessèrent de le dédaigner comme homme, et étalai les demi-mondaines de marque lui risquèrent des avances, pure curiosité de filles d'Eve, histoire de voir si la liqueur demeurait digne du flacon.
— Hé ! Hé ! Mes belles, plastronnait Sévéran, ne me blaguez pas ! Goûtez-y, goûtez-en : dans les vieilles amphores soit les meilleurs vins !
Et, comme Alphonse, en mainte occasion.. montra encore bon visage et gaillarde contenance, Lucy Lamour se trouva n'avoir point menti et, bien inconsciemment, «lança » derechef son directeur.
Celui-ci lui en sut gré, et avec une coquetterie suprême de vieux coq, la manda un soir, en son cabinet, entre le deux et le trois du Beau Paris. Lucy, très en charme, ce soir là, exhibait, pour la volupté des fauteuils d'orchestre, savourant les dessous par en dessous, et la joie des avant-scènes, dégustant les siennes par en dessus, un délicieux décolleté qui la déshabillait à ravir.
On l'eût jurée toute nue, saut la ceinture de rigueur, laquelle montait certes, un peu plus haut que la taille et laissait à découvert des épaules d'une chair... à dévorer des lèvres toute crue.
Le père Sévéran, très ogre, sous ce rapport, se pourlécha les babines plusieurs fois : en parfait, tacticien qui sait conduire un siége par les plus diverses opérations, il amena Lucy Lamour à se seoir à ses côtés sur un divan aux coussins moelleux et élastiques : et, sur ce terrain, par monts et vallées, harcela l'ennemi de façon à lui faire perdre la notion exacte du temps, de l’heure et des mouvements. C'était fatal : Lucy succomba une fois de plus, avec les honneurs de la guerre.
Après l'escarmouche ;
— Sais-tu bien, ma fille, soupira fièrement Alphonse, que je te dois un regain de jeunesse ? J'ai cinquante ans, depuis hier.
Et vous venez de sonner votre cinquantenaire ! entonna Lucy.
— Sur un air de fanfare ''brama Sévéran.
— Les vieux airs sont parfois faits de fameuse musique, accentua Lucy.
Et puis, ces musiques-la sont accompagnées de bonnes paroles, plaisanta Alphonse, et, parfois, de bonnes promesses...
— Pas assez souvent tenues !
— Moi, je tiens et je tiens bon !
— La preuve ?
Sévéran jeta une poignée de louis dans l'entrebâillement du corsage de Lucy Lamour, et cela avec un tel geste de Richelieu ou de Lauzan que, malgré l'évidente brutalité du fait, la belle n'osa protester et se contenta de ramasser les jaunets, dont quelques-uns uns, faute de place, avaient glissé jusqu'à terre.
— Maintenant, causons sentiment reprit Sévéran, Tu me vas.
— Je vous... chausse ?
— C'est à peu près cela. Le vieux pied que je suis s'accommodé de la fine mule que tu es. Et, quand tu voudras mais, une fois par semaine seulement aux mêmes conditions pécuniaires, je t'inviterai à subir ici la même pénitence.
La pénitence est douce ?
Et ron, ron, ron, petit patapon.,,
La pénitence est douce,
Nous recommencerons !
fredonna Lucy Lamour, s'esquivant jusqu'a la scène, tandis que sonnait appel du trois.
Le lendemain, Alphonse Sévéran recevait la visite d'un sien filleul, Ugène Percebois, qui, de sa vie, n'avait mis le pied sur les planches d’un théâtre. Mais il venait de passer avec succès son bachot : et, les parents — ô aveuglement ! — l’avaient en récompense, expédié au parrain pour qu’il le divertit.
— Amuse-toi, mon ami, amuse-toi, dit Sévéran au provincial. Des dessous aux frises, promène-toi ici. Tu y as tes grandes et petites entrées.
Or, c'était fatal, la mine ahurie et... neuve d'Ugène Percebois conquit d'emblée Lucy Lamour. Elle aguicha l'éphèbe, t'interrogea, l'attira dans sa loge, s'en servit en guise d'habilleuse, en usa tant et si bien qu il tut bientôt du dernier mieux avec la pensionnaire de son parrain.
Six jours après l'arrivée d'Ugène, Alphonse, s'impatientait dans le cabinet directorial, sur le divan, ce champ de bataille ou le corps ennemi tardait trop à paraître : Lucy inexacte ? déjà ?... Oh ! A quelle amende il la mettrait. ! L’ingrate !
Les minutes filent, les quarts d'heure, aussi ! Sévéran s'exaspère, bondit jusqu'à la loge de Lucy, en ouvre brusquement la porte, et là — ô rage ! — surprend sa sultane et son filleul dans une attitude qui lui enlève toute illusion :
— Misérable ! S'écrie Alphonse, poignardant Ugène du regard, vil serpent que je reçois à mon foyer et qui a le toupet de manger dans mon assiette !
Dans votre assiette, possible ! riposte dignement le filleul, mais j'ai pris soin de la retourner !
J. N.
| |
| CARTOGRAPHIES
De Jacques Grieu
|
|
C’est du latin « charta » que la carte est venue,
Et depuis, son usage est à tous nos menus.
C’est à toutes les sauces où la carte est citée,
Et « manger à la carte » est fait à satiété.
Tout seul ou à plusieurs, vive le jeu de cartes !
Le bridge ou la belote ont chacune leur charte,
Mais si la réussite a autant d’amateurs,
C’est qu’on ne peut rater un jeu si prometteur…
Aucune carte bleue ne donne carte blanche,
À nos meilleurs banquiers pour ouvrir le dimanche.
Et la carte des vins, emmenée en voiture,
N’a jamais évité, des bouchons, la torture…
Si, aux cartes routières, on peut vraiment se fier,
Pas une ne nous dit comment la replier.
Pour la « Carte du Tendre », il faut faire attention :
Les divers GPS n’y ont aucune action.
Jamais d’insecticide il ne faut qu’on emploie
Pour, d’une carte à puce, arrêter tout emploi.
Certains malades ont dit que les cartes « vitale »,
Quand elles sont perdues, vous font l’issue fatale !
Vouloir battre les cartes en cas de mauvais jeu
Est un acte cruel et même scandaleux.
Il faut les protéger de cette maltraitance,
Et créer une loi pour… condamner la chance !
L’humeur de nos autos serait-elle meilleure,
Si, de leurs cartes grises, on changeait la couleur ?
Si on les faisait vertes, elles pollueraient moins ?
Avec du papier rose, elles iraient plus loin ?
Si la « Carte Vermeil » n’a pas fait des merveilles
Elle a aidé des vieux à aller au soleil.
Pourquoi brouiller les cartes et changer ce doux nom ?
Cette « Carte Sénior » est pour les vieux croûtons ?
Et puis sans carte SIM, fini le téléphone,
C’est alors la panique et qui nous rend aphone !
Nous sommes encartés, de cartes saturés.
Prisonniers de nos cartes, on est « cartographiés » …
Le destin bat les cartes et c’est nous qui jouons ;
Si le jeu est mauvais, pas question d’abandon.
Boiteuse ou pas boiteuse, on joue cartes sur table,
Mais en espérant bien gagner contre le diable.
Quand le dessous des cartes est mal dissimulé.
Notre dernière carte on voudrait essayer.
La vie est jeu de cartes où le cœur est l’atout ;
On coupe ou se défausse, on essaie jusqu’au bout…
Jacques Grieu
|
| |
LE LEVRIER DU SAHARA.
Gallica : Revue orient 1853-1 pages 161 - 166
|
SLOUGUI
S'il était besoin de démontrer combien les habitudes du peuple du Sahara sont aristocratiques, combien ses goûts sont des goûts de grands seigneurs, j'en donnerais une preuve bien simple, certains la trouveront peut-être puérile, c'est l'affection que l'on porte au lévrier.
Dans le Sahara, comme dans tout le pays arabe, le chien n'est pour l'homme qu'un valet disgracié, importun, rebuté, quelle que soit d'ailleurs l'utilité de son emploi, qu'il garde le douar ou veille sur le troupeau.
Le lévrier seul a l'estime, la considération, la tendresse attentive de son maître ; c'est que le riche, ainsi que le pauvre, le regardent comme un compagnon de ces plaisirs chevaleresques auxquels ils se plaisent tant ; pour ce dernier, c'est aussi le pourvoyeur qui le fait vivre. .
Aussi on ne lui ménage pas les soins, empressés ; on surveille le croisement avec les mêmes précautions que celui des chevaux. Un homme du Sahara fait vingt-cinq à trente lieues pour accoupler une belle levrette avec un lévrier renommé. Et un lévrier renommé prend la gazelle à la course. « Lorsqu'il aperçoit une gazelle coupant un brin d'herbe, il l'atteint avant qu'elle ait eu le temps d'avaler ce qu'elle tenait à la bouche. »
C'est de l'hyperbole, mais cette hyperbole a sa raison d'être.
Si par un hasard fatal une levrette (slouyuia) a été couverte par un chien de garde, on la fait avorter en massant les petits dans son ventre, lorsqu'ils sont formés, ou bien on jette ceux-ci aussitôt qu'ils ont vu le jour, mais ce n'est pas seulement son affection maternelle, c'est encore sa vie que menace une mésalliance.
Souvent le maître furieux en apprenant qu'une de ses levrettes s'est souillée au contact d'un chien de berger la fait impitoyablement mettre à mort. « Comment, s'écrie-t-il, toi une chienne de race, tu te prostitues à des roturiers ! c'est infâme, que ton crime meure avec toi ! »
La grandeur a ses tristesses.
La slouguia ayant mis bas, on ne perd pas un seul instant de vue ses petits. Les femmes même leur donnent quelquefois de leur lait. Arrivent les visites d'autant plus nombreuses et plue empressées que la chienne a plus de réputation ; on entoure son maure, on lui offre du lait, du kouskoussou; il n'est sorte de flatteries qu'on ne lui prodigue pour obtenir un petit lévrier : « Je suis « ton ami, je t'en prie, donne-moi ce que je te demande, « je t'accompagnerai dans tes chasses, etc.
A toutes ces sollicitations le maître répond ordinairement qu'il ne figera son choix sur les petits qu'il veut garder qu'au bout de sept jours. Cette réserve est motivée par une observation des plus singulières que font les Arabes. Dans une portée de slouguia, toujours un des nouveau-nés se tient sur le dos des autres.
Est-ce vigueur ? est-ce simple hasard ? Pour s'en assurer, on l'éloigne de sa place habituelle, et si, pendant sept jours de suite, il y revient, le maître fonde sur lui de si grandes espérances, qu'il ne le changerait pas pour une négresse.
Un préjugé établi fait regarder comme les meilleurs produits d'une portée ceux qui viennent le premier, le troisième ou le cinquième, les numéros impairs. Les petits sont sevrés au bout de quarante jours ; on leur donne encore néanmoins du lait de chèvre ou de chamelle, mêlé de dattes ou de kouskoussou. Les troupeaux sont si nombreux dans le Sahara, le lait y est en si grande abondance, qu'il n'est pas étonnant de voir les Arabes riches, après avoir sevré leurs petits lévriers, leur donner des chèvres à téter.
Lorsque les jeunes lévriers ont atteint trois ou quatre mois, on commence à s'occuper de leur éducation. Les enfants chassent de leurs trous des gerboises ou des rats appelés bou-alal , et lancent sur eux les petits lévriers.
Peu après, ceux-ci s'animent à cette espèce de chasse, les poursuivent, aboient aux alentours de leur retraite, jusqu'à ce que les enfants renouvellent cet exercice. A cinq ou six mois, il s'agit d'une proie plus difficile à atteindre, du lièvre ; des gens â pied conduisent le lévrier près du gîte où est blottie la bête qu'il doit atteindre ; par une légère exclamation ils donnent l'alerte au jeune chien qui se lance sur elle et acquiert bien vite l'habitude d'une course intelligente et rapide.
Après le lièvre on passe aux petits de la gazelle, on s'approche des lieux où ils reposent près de leurs mères, on provoque l'attention du lévrier, et lorsqu'il est bien animé, qu'il se cabre d'impatience, on le lâche.
Après quelques exercices le laurier réussit parfaitement, et commence à s'acharner à la poursuite des gazelles mères.
Ces premières leçons terminées, le lévrier a atteint un an, il est alors à peu prés dans toute sa force, son odorat s'est développé, il sent la gazelle à la trace.
Toutefois on le ménage, on ne le fait guère chasser qu'à quinze ou dix-huit mois. Mais, dès cette époque, on le tient en laisse, et on a beaucoup de peine à l'arrêter, car, disent les Arabes, lorsque le laurier sent le gibier, sa puissance musculaire est telle que s'il vient â se raidir sur ses pattes, un homme peut à peine lui faire lever une jambe.
Lorsqu'il aperçoit un troupeau de trente ou quarante gazelles, le lévrier tremble de joie, il regarde son maître, qui lui dit : Ah ! fils de juif, tu ne diras plus cette fois «que tu ne les a pas vues. » Le chasseur détache ensuite sa peau de bouc, et rafraîchit le dos, le ventre et les parties naturelles du slougui. Le lévrier impatient tourne vers son maître un oeil suppliant : il est libre enfin, il bondit, se dissimule toutefois, se baisse est vu, poursuit sa course oblique, et ce n'est qu'une fois à portée qu'il se lance de toutes ses forces et choisit pour victime le plus beau mâle du troupeau.
Quand le chasseur dépèce la gazelle, il donne au slougui la chair qui avoisine les reins ; si on lui donnait les intestins, il les repousserait dédaigneusement.
Le lévrier qui, à deux ans, ne sait pas chasser, ne le saura jamais. On dit à ce sujet
« Slougui men bad aouli
« Ou radjel men bad soumein.
Le lévrier après deux ans et l'homme après deux jeûnes, » s'ils ne valent rien, ne donnent aucun espoir.
Le lévrier est intelligent et plein d'amour-propre lorsqu'en le lançant on lui a désigné une belle gazelle et qu'il n'en a tué qu'une petite de médiocre apparence, il est très-sensible aux reproches, il s'éloigne honteux, sans réclamer sa part.
La vanité ne lui fait pas défaut ;ail fait beaucoup de u fantasia. » Un slougui de race ne mange ni ne boit dans un vase sale, il refuse le lait dans lequel on a plongé lei mains. Ne lui a-t-on pas donné cette délicatesse dédaigneuse ? Tandis que c'est tout au plus si on laisse le chien vulgaire, utile et vigilant gardien, chercher sa nourriture parmi les charognes et les os gisants, tandis qu'on l'expulse honteusement loin de la tente et de la table, le lévrier, lui, couche dans le compartiment réservé aux hommes, sur des tapis, à côté de son maure ou sur son lit même. Il est vêtu, garanti du froid par des couvertures, comme le cheval ; on lui sait bon gré d'être frileux, c'est une preuve de plus qu'il est de race. On prend plaisir à le parer d'ornements, à lui attacher des colliers de coquillages ; on le garantit du mauvais œil en lui mettant dei talismans. On le nourrit avec soin, avec recherche, avec précaution aussi ; le kouskoussou lui est prodigué. En été pour lui donner de la force on lui fait une pétée de lait et de dattes, dont on a Sté les noyaux.
Il en est qui ne donnent jamais à manger à leur lévrier pendant le jour.
Ce n'est pas assez, le lévrier accompagne son maître dans ses visites ; comme lui il reçoit l'hospitalité (difa), et de chaque mets il a sa part. Jamais un slougui de race ne chasse qu'avec son maître.
Il sait par sa propreté, son respect des convenances, et la gracieuseté de ses manières, reconnaître la considération dont il est l'objet. Il ne manque pas de creuser un trou pour faire ses excréments et de les recouvrir. Au retour du maître, après une absence un peu prolongée, le slougui d'un bond se précipite de la tente sur la selle et le caresse. Les Arabes causent avec lui : « 0 mon « ami, écoute-moi ; il faut que tu m'apportes de la viande, je suis las de ne manger que des dattes, » et mille flatteries ; le slougui saute, caracole, a l'air de comprendre et de vouloir répondre.
La mort d'un slougui est un deuil pour toute la tente ; femmes et enfants le pleurent comme une personne de la famille. C'était quelquefois lui qui suffisait à la nourriture de tous.
Le slougui qui nourrit une famille ne se vend jamais, il s'accorde quelquefois aux supplications des femmes, des parents ou des marabouts vénérés.
Le lévrier qui prend facilement le sine (Gazelle de petite taille qui se trouve partout et principalement dans le Sersou) et el ademi (Gazelle de la plue grande espèce qu'on trouve dans le Tell et dans la montagne.) vaut une belle chamelle, celui qui atteint le rinne ! est estimé comme un cheval de prix.
On les nomme ordinairement ghrezal ou ghrezala (Espèce de gazelle intermédiaire pour la taille qui se trouve dans le Sahara).
Souvent des paris s'établissent en faveur de tel ou tel slougui ; les enjeux sont ordinairement des moutons, des régals de Taam, etc.
Le slougui du Sahara est de beaucoup supérieur à celui du Tell, il est de couleur fauve, haut de taille, il a le museau effilé, le front lare lis oreilles courtes, le cou musculeux, lei m'aides de la croupe très-prononcés, pas de ventre, les membres secs, les tendons bien détaché, le jarret près de terre, la face plantaire peu développée, sèche, lest rayons supérieurs très-longs, le palais et la langue noirs, les poils très-doux.
Entre les deux iléons, il doit y avoir plaie pour quatre doigts, il faut que le bout de la queue passée sous la cuisse atteigne l'os de la hanche.
On met ordinairement cinq raies de feu à chaque avant-bras, pour consolider lei articulations.
Les lévriers les plus renommés dans le Sahara sont ceux des Hamyane, des Oulad-Sidi-Chikr, des Harrar, des Arbda, des Oulad-Nayl.
Le général DAUMAS.
| |
ZIAMA - MANSOURIA
ACEP-ENSEMBLE N°290
|
|
L'Antique Aelium Chobae
Par le capitaine Pousset,
colon à Ziama ( Paul Isel).
Le petit village de Ziama, situé sur la côte entre Djidjelli et Bougie et qui, à notre époque, constituait avec le village, voisin, la commune de Ziama-Mansouria était bien connu des estivants mais là s'arrêtait, à ma connaissance son rayonnement. Il n'en a pas toujours été ainsi. J'ai découvert dans les « Notices et Mémoires de la Société Archéologique de la province de Constantine » de très intéressantes descriptions du site romain de Chobae Municipium.
Ziama semble avoir été dans l'Antiquité, un centre au moins aussi développé, si ce n'est plus qu'Igilgilis (Djidjelli) d'où la quasi-totalité des ruines romaines ont disparu. Il est vrai que Choba était le port de Sétif, et la région sétifienne, le grenier à blé de Rome ! Le trafic portuaire devait donc y être intense et la ville prospère.
Voici des extraits de deux communications faites à cette Société Archéologique, en 1908 et 1909, par
Notes sur les ruines du municipium Aelium Chobae.
« J'ai parcouru, depuis 1905, les environs de Ziama jusqu'à une certaine distance et j'al acquis la conviction que non seulement Choba a été une ville importante, mais qu'à un moment donné elle fut riche et prospère. La route qui la reliait à Sitifis était semée de villas fortement édifiées dont j'ai partout retrouvé des traces. Il en existe au co1 d'El-Khenak entre le djebel M'rada et le djebel Messayèa, on en trouve à plusieurs endroits sur les pentes de la rive droite et de la rive gauche de l'Oued-Ziama à Tadernout et à Khankham. Certaines de ces villas étaient somptueuses, avec colonnes et chapiteaux de style très pur.
On retrouve les mêmes ruines au-delà de Bou-M'raou aux pieds du Djebel-Betacha et il en existe aussi à Taghezout. Au col des Beni-Marmi l'importance des ruines semble indiquer que ce point fut solidement fortifié. Vingt kilomètres plus loin chez les Beni-Zoundaï mêmes ruines à peu près régulièrement échelonnées. Un moulin romain presque intact et en tout point semblable à celui que j'ai déterré à Ziama, sert de borne kilométrique près du bordj du cheik.
Jusqu'au plateau des Babors, la voie romaine est parfaitement reconnaissable. Nous arrivons là dans la région de Sétif et je ne l'ai pas suivie plus loin.
Il me faudrait écrire un livre pour vous raconter en détail 1es découvertes de chaque jour et pourtant je ne consacrais à ce travail que mes heures de loisir.
Tantôt c'était un chapiteau corinthien finement sculpté, tantôt plusieurs fûts de colonnes, les uns renversés les autres encore verticaux et scellés sur leurs piédestaux, à l'emplacement qu'ils avalent toujours occupé.
Un jour, en cherchant un endroit pour y construire un mur provisoire, je dégageais l'entrée de la porte des eaux fortement défendue, le lendemain, en abattant les genets épineux, je mettais à jour un amas de colonnes renversées près de leurs chapiteaux, au milieu de débris de voûtes et de tuiles romaines. J'ai dégagé successivement l'enceinte romaine des II et III° siècles, puis une seconde enceinte en pierres de grand appareil, peut-être d'origine punique, car elle semble avoir protégé d'abord la ville primitive essentiellement commerçante installée au bord de la mer, mais plus vraisemblablement relevée à l'époque byzantine en un temps où la garnison romaine, impuissante à défendre I'enceinte des premiers siècles, avait dû se fortifier, sur ce réduit du plateau, en y relevant la muraille primitive au moyen de blocs empruntés aux monuments extérieurs, détruits peut-être par les vandales. Cette seconde enceinte contient, en effet, des pierres de toutes tailles, fort étonnées de se voir ensemble et que le besoin d'organiser une défense hâtive, où peut-être un réduit de défense, a seul put faire réunir en cet endroit. J'ai dégagé complètement une maison romaine et me suis servi des pans de muraille qui restaient debout pour y installer ma cave ; j'ai trouvé dans ces fouilles, au niveau du sol, sous cinq à six mètres de terres éboulées, des débris de poterie romaines de toutes sortes, des lampes plus au moins historiées, quelques pièces de monnaie à l'effigie des Antonins, des fragments de poterie fine peintes, des fragments de vases en bronze, des défenses de sanglier, des ossements humains, un peu de tout.
Un peu plus loin j'ai trouvé une terrasse cimentée, des fragments de mosaïques fines, malheureusement épars dans des décombres, des mosaïques communes un peu partout et un curieux fragment de dallage en petites tuiles de terre cuite parallélépipédiques.
J'ai recueilli un moulin à blé complet avec son cône meule, une énorme amphore, hauteur 1,30m, en terre cuite, pouvant contenir plusieurs hectolitres. J'ai déterminé l'emplacement et l'alignement des principales voies, ceux de nombreux monuments, palais, temples, basiliques, thermes et peut-être théâtre aux gradins en hémicycle, dont il appartient à des fouilles judicieusement conduites de déterminer la destination exacte.
Il y a de tout à Ziama, à une profondeur relativement peu considérable et je crois pouvoir affirmer que jamais aucune recherche sérieuse n'y a été faite.
Les arabes ont longtemps labouré le plateau, tourné, retourné et plus ou moins détérioré les fragments de pierres sculptées provenant des parties supérieures des édifices, mais jamais ils n'ont cherché à creuser le sol. Quelques sarcophages ornés de bas-reliefs et qui se trouvaient au niveau du sol, ont seuls été violés et pillés. Les monuments gisent 1à où les perturbations du sol les ont renversés. Tous les sondages donnent d'abord des tuiles, puis des pierres cubiques, des voûtes, des fragments de charpente carbonisés, des fragments de chapiteaux, des fûts de colonnes, des piédestaux, des dalles, des seuils ou des mosaïques, le tout entremêlé de fragments de poterie et mastiqué de glaise apportée de la montagne par des pluies d'hiver qui inondent la ville à travers les brèches de la muraille sud entièrement rasée.
En résumé, I'antique municipium Aelium Choba, dégagé de son masque de broussaille, se présente aujourd'hui dans les conditions les plus favorables pour être étudié, sondé et fouillé par un amateur disposant de quelques ressources.
J'estime qu'il aurait lieu de sonder surtout l'emplacement de certains édifices nettement déterminés, les thermes par exemple, dans lesquels on a trouvé la seule inscription intéressante découverte jusqu'à ce jour. Doivent être pavés de curieuses mosaïques, les niches destinées à placer des statues et que l'on voit encore en plusieurs endroits. Laisse à supposer qu'en enlevant soigneusement les décombres, on découvrirait certainement des pièces intéressantes.
Nombreux sont les petits monticules, recouvrant les parties essentielles d'édifices importants qui y restent accumulées.
Revenant à Choba, j'estime que le port suffisamment vaste pour y abriter une flotte romaine et bien abrité de tous les côtés se trouvait non pas dans la rade du Bou-Blata, mais bien dans I'estuaire, depuis encombré d'alluvions, qui se trouve à I'embouchure de l'Oued-Ziama. Des quais dallés de marbre et bordés de constructions importantes, dont les décombres se découvrent encore par les temps calmes au nord-est de la ville, servaient aussi à faciliter les mouvements du port de commerce. Les vestiges d'un plan incliné sont encore visibles, attenant à un ensemble de constructions importantes avec caves et citernes voûtées qui surplombent à pic les quais dallés signalés par ailleurs.
 J'ai pu étudier la question d'emplacement du port romain , j'estime que la petite baie qui s'étend au nord-ouest entre I'embouchure de l'Oued Ziama et le promontoire du Djebel-bou-Blata n'a jamais servi que de rade. Le véritable port se trouvait à l'embouchure même de la rivière dans une crique naturelle aujourd'hui comblée par les alluvions de la montagne, mais qui se dessine encore nettement lorsqu'on étudie son emplacement de la tour, point culminant et réduit de la défense du plateau de Ziama. Il existe encore des vestiges des quais du port , au pied de la culée du pont de Ziama, une ligne non interrompue de constructions encore indéterminées et en partie ensevelie sous les décombres et les éboulements longe la rive droite de l'ancien lit de la rivière. J'ai pu étudier la question d'emplacement du port romain , j'estime que la petite baie qui s'étend au nord-ouest entre I'embouchure de l'Oued Ziama et le promontoire du Djebel-bou-Blata n'a jamais servi que de rade. Le véritable port se trouvait à l'embouchure même de la rivière dans une crique naturelle aujourd'hui comblée par les alluvions de la montagne, mais qui se dessine encore nettement lorsqu'on étudie son emplacement de la tour, point culminant et réduit de la défense du plateau de Ziama. Il existe encore des vestiges des quais du port , au pied de la culée du pont de Ziama, une ligne non interrompue de constructions encore indéterminées et en partie ensevelie sous les décombres et les éboulements longe la rive droite de l'ancien lit de la rivière.
A cinquante mètres du pont et recouvert depuis l'année dernière par une épaisseur de près de deux mètres de limon, se trouve un barrage ayant pu servir de fond au radier d'une écluse. Une colonne portant une inscription, de laquelle je n'ai pu relever que les trois lettres supérieures D M S, était appuyée aux fondations d'une solide muraille recouverte aussi actuellement par les alluvions. En face, de l'autre côté de la vallée, j'ai mis à jour des fondations romaines ; enfin au pied du promontoire qui commande I'embouchure de la rivière, rive gauche, sont très déterminées les bases de constructions importantes édifiées sur les pentes de la colline ».
Capitaine E. POUSSET
Transmis par : Paul Isel –
66300 Banyuls des Aspres.
|
|
Bribes élyséennes
par M. Robert Charles PUIG.
|
Macron semble tenir plusieurs rôles dans son spectacle. Après celui de Jupiter, Atlas, il veut jouer celui de Sisyphe qui réussit à maintenir le rocher en haut de la montagne. Un exploit qu'il veut réaliser en individu prétentieux qui croit en son étoile. Pour cette raison il avance sans précaution ce désir de guerre qui a surpris les capitales européennes...
Envoyer des troupes en Ukraine lui parait chose facile et ses propos ne servent qu'à entraîner les membres de l'Otan - 32 avec la Suède - dans un conflit incertain. Son côté "batailleur - lui qui ne sait pas ce que sait une guerre - à trois ans de la fin de son mandat nous montre combien il espère laisser une trace de ces deux mandats.
Pour l'instant qu'à t-il réussi à faire ? Mettre plus bas que terre la Saga de l'Algérie française par ses propos nuisibles en 2017 ; pousser les pays africains par des paroles vexantes à s'éloigner de la construction de De gaulle entre 1956 et 1960
S'incliner devant l'Algérie sans réagir lors du refus de ce pays de recevoir Castex, premier ministre ou interdire le survol du pays par nos avions mais toujours obtenir plus de visas pour les algériens ; faire douter Israël de ses bons offices ; désunir l'Europe sur l'Ukraine et engager le pays dans une sorte de bras de fer avec la Russie dont il n'a jamais digéré l'affront d'une visite avortée.
Il cherche toujours à avoir le beau rôle et il pense l'avoir trouvé avec l'IGV. Un instant de gloire inscrit dans la constitution comme si l'avortement n'était pas admis depuis Simone Viel. Mais il se fait plaisir même si on peut penser que de nombreuses femmes seront d'accord avec lui et nous sur ce sujet sensible.
Un coup d'épée dans l'eau ! pourtant que doit-on penser d'un pays qui n'enfante plus ? Enfin il s'attaque à la fin de vie. Une lubie ou un désir des "mourants"? Une façon d'éliminer les vieux comme le dit Jacques Attali ?
Je pense que le corps médical se sent pris au piège de cette nouvelle idée car en fait, ne serait-il pas préférable de mettre au point un système d'assistance plus performant pour accompagner les malades jusqu'au bout de leur vie, que leur proposer une fin de vie qui est comme une euthanasie dont on tait le nom ? Dans notre XXI nième siècle n'y a-t-il pas des moyens médicaux autres que l'aiguille qui tue pour permettre à un être humain de partir sans se douter qu'il est assassiné ? Peut être est-ce la vraie pensée du président. Ne plus faire d'enfants et se débarrasser des anciens pour mieux offrir le pays à l'Orient.
Je me pose la question, mais l'esprit du président est plein de trouvailles actuellement pour perturber les pensées de la population, des métropolitains qui sentent que la république a besoin d'un sang neuf, d'une pensée nouvelle qui l'extrait d'une "Renaissance" qui elle semble moribonde et qui mérite enfin une fin de vie politicienne car à ce jour, avec le macronisme, rien n'a jamais rendu la FRANCE GRANDE ET FIERE DE SON HISTOIRE.
Robert Charles Puig /12 mars 2024
| |
LIVRE D'OR de 1914-1918
des BÔNOIS et ALENTOURS
Par J.C. Stella et J.P. Bartolini
|
Tous les morts de 1914-1918 enregistrés sur le Département de Bône méritaient un hommage qui nous avait été demandé et avec Jean Claude Stella nous l'avons mis en oeuvre.
Jean Claude a effectué toutes les recherches et il continu. J'ai crée les pages nécessaires pour les villes ci-dessous et je viens de faire des mises à jour et d'ajouter Oued-Zenati, des pages qui seront complétées plus tard par les tous actes d'état civil que nous pourrons obtenir.
Vous, Lecteurs et Amis, vous pouvez nous aider. En effet, vous verrez que quelques fiches sont agrémentées de photos, et si par hasard vous avez des photos de ces morts ou de leurs tombes, nous serions heureux de pouvoir les insérer.
De même si vous habitez près de Nécropoles où sont enterrés nos morts et si vous avez la possibilité de vous y rendre pour photographier des tombes concernées ou des ossuaires, nous vous en serons très reconnaissant.
Ce travail fait pour Bône, Aïn-Mokra, Bugeaud, Clauzel, Duvivier, Duzerville, Guelaat-Bou-Sba, Guelma, Helliopolis, Herbillon, Kellermann, Millesimo, Mondovi, Morris, Nechmeya, Oued-Zenati, Penthièvre, Petit et Randon, va être fait pour d'autres communes de la région de Bône.
POUR VISITER le "LIVRE D'OR des BÔNOIS de 1914-1918" et ceux des villages alentours :
Le site officiel de l'Etat a été d'une très grande utilité et nous en remercions ceux qui l'entretiennent ainsi que le ministère des Anciens Combattants qui m'a octroyé la licence parce que le site est à but non lucratif et n'est lié à aucun organisme lucratif, seule la mémoire compte :
| |
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envois divers
|
Antifraude sur les retraités
Envoyé par Gérard
https://www.tsa-algerie.com/la-france-durcit-les-
controles-antifraude-sur-les-retraites-vivant-en-algerie/
lestrepublicain.com - Par: Merzouk A, 26 Mars 2024
La France durcit les contrôles antifraude sur les retraités vivant en Algérie
Le gouvernement français continue sa lutte contre les fraudes liées notamment aux retraites versées aux assurés dans certains pays étrangers, dont l’Algérie. La France compte désormais renforcer le contrôle sur les personnes âgées de plus de 85 ans.
Le 20 mars, le Premier ministre français a présenté un bilan du plan contre la fraude lancé en mai 2023. Concernant les retraites, Gabriel Attal a fait état de près de 200 millions d’euros de préjudice, détecté par l’Assurance retraite.
France : les retraités algériens visés par un nouveau système de contrôle
Dans ce sens, le gouvernement français compte renforcer les contrôles sur les retraités qui perçoivent leurs pensions dans de nombreux pays à l’étranger, en pointant en particulier les retraités algériens, rapporte le journal Capital.
L’Assurance retraite française dispose de plusieurs outils pour lutter contre les fraudes, dont le certificat d’existence qui prouve qu’un retraité percevant sa pension dans un pays étranger est toujours en vie.
À cela, s’ajoute aussi la vérification des justificatifs pour déterminer le montant de la pension. Dans le cadre de ces dispositifs de contrôle, les retraités sont tenus d’envoyer tous les ans ces documents.
Cependant, la France estime que ce système n’est pas toujours fiable, notamment dans les pays où elle n’a pas d’informations directes pour vérifier si le retraité est toujours en vie. D’où justement la décision de renforcer les contrôles.
La France durcit la lutte contre la fraude aux retraites : l’Algérie visée
C’est le cas justement de l’Algérie où près de 350.000 retraités perçoivent une pension française, souligne le même journal. Ainsi, pour vérifier l’existence de ces retraités, l’Assurance retraite française a mis en place un partenariat avec une banque algérienne.
Dans le cas où un retraité n’a pas répondu à la caisse de retraite pendant six mois et qu’il réapparaît par la suite, il sera obligé de se présenter au guichet de la banque pour permettre une vérification de son identité.
Les personnes qui suscitent un doute d’usurpation d’identité seront dans l’obligation de se rendre au consulat de France en Algérie, une procédure déjà en vigueur au Maroc.
En outre, une expérimentation a été lancée en Algérie concernant les retraités centenaires. Selon les chiffres de l’administration française, 1.000 retraités algériens de plus de 98 ans ont été convoqués et pas moins de 30 % ne se sont pas présentés.
Par conséquent, leurs pensions ont été coupées. Pour renforcer ce dispositif, le gouvernement français veut élargir ce contrôle aux retraités de plus de 85 ans d’ici 2027, via des intermédiaires de confiance, comme les banques, les administrations locales ou les consulats.
Dans ce cadre, le retraité sera convoqué à un guichet physique pour vérification de la véracité de ses documents d’identité. Et s’il ne se présente pas ou si ses documents ne sont pas conformes, sa pension de retraite sera suspendue. Toutefois, certains retraités où leurs ayants droits sont très âgés. Ils sont dans l’incapacité de faire de longs déplacements pour se présenter aux consulats de France.
Merzouk A.
Société
Envoyé par Germain
https://www.tsa-algerie.com/la-pluie-et-la-
neige-sabattent-sur-lalgerie-lespoir-renait/
- tsa-algerie.com - Par: Djamel Belaid — 03 Mars 2024
La pluie et la neige s’abattent sur l’Algérie, l’espoir renaît
De la pluie et de la neige se sont abattues ces derniers jours en abondance sur le nord de l’Algérie qui fait face à la sécheresse depuis plusieurs années. Les régions du centre et de l’est du pays ont été particulièrement arrosées.
En plusieurs endroits, elles ont enfin permis le remplissage des barrages. C’est le cas du barrage Beni Haroun (Mila) où l’Agence nationale des barrages annonce qu’il a atteint son remplissage maximum soit 960 millions de mètres cubes. Est-ce que les risques de tensions concernant l’approvisionnement en eau de ces dernières semaines sont écartés ?
Bien que concentrées sur un laps de temps assez court, ces pluies ont permis le remplissage de nombreux barrages. Ce remplissage est tel qu’au niveau de plusieurs barrages leurs déversoirs ont joué leur rôle en évacuant vers l’aval les excédents d’eau.
Du haut du barrage de Beni Haroun, le spectacle est saisissant. Quelques dizaines de mètres plus bas l’excès d’eau passé par le déversoir s’écrase dans un jaillissement de gouttelettes d’eau.
C’est le cas également du barrage de Tabellout (Jijel) où de Kherrata où son déversoir a pris des allures de chute du Niagara.
L’hydrogéologue Malek Abdesselam de l’université de Tizi-Ouzou égraine sur les réseaux sociaux les cumuls de pluies de différentes régions obtenues par les services de la météorologie.
Ce cumul des pluies entre le 27 et 29 février est élevé. Il est tombé 126 mm de pluie à Jijel alors que la moyenne annuelle est de 925 mm. À Tizi Ouzou les services de la météo ont relevé 113 mm alors que la moyenne est de 720 mm.
Plus à l’Est, il a été relevé 90 mm à Constantine. Cependant, dans l’Ouest de l’Algérie, les cumuls de pluies restent faibles : 27 mm à Sidi Bel Abbès, 10 mm à Tiaret et seulement 7 pour Oran et Mascara.
Concernant le barrage de Taksebt (Tizi-Ouzou), Malek Abdesselam estime une collecte de 30 à 40 millions de mètres cubes à l’occasion des derniers épisodes pluvieux. Photo à l’appui, il signale que le pompage de l’eau à partir du Sebaou vers le barrage est interrompu du fait qu’une partie de la station de pompage est actuellement inondée.
Des pluies bénéfiques
Il s’agit de pluies bénéfiques pour le secteur agricole et en particulier pour les céréales et les pâturages. Dans la wilaya de Tiaret, le prix des bottes de paille est passé de 120 DA à 95 DA du fait que les pâturages aient commencé à reverdir.
Cependant, l’aspect brutal de ces pluies et le fort ruissellement qui s’ensuit limite leur infiltration dans le sol et la recharge des nappes d’eau souterraines.
Un ruissellement d’autant plus limité que dans les wilayas de Béjaïa, Bouira et Jijel de précédents épisodes pluvieux durant le mois de février ont saturé d’eau les sols.
Conséquences, des oueds en crues et des débordements affectant le réseau routier. Un débordement parfois accentué par des branchages et détritus de toute sorte qui se retrouvent charriés par l’eau et qui s’accumulent sous les ponts.
C’est le cas dans la commune de l’Émir Abdelkader (Jijel) où le président adjoint de l’APC confie à Ennahar TV que sur instruction du wali, des travaux de déblaiement ont été immédiatement lancés.
Une telle infiltration n’a lieu qu’au niveau des barrages collinaires et des obstacles pouvant ralentir le flux d’eau tels les gabions édifiés dans des ravins.
Un point positif, en cette saison, le développement de la végétation et la clémence des températures font que la transpiration des plantes et l’évaporation de l’eau du sol sont réduites. Une situation qui pourrait permettre de ré-humecter le sol plus en profondeur en cas de nouvelles pluies après ressuyage des premières couches de sol.
Une eau qui sera utile pour les cultures irriguées telle la tomate industrielle et les arbres fruitiers.
Le remplissage en cours des barrages devrait réduire les craintes observées ces dernières semaines quant à l’adduction en eau potable de certaines villes de l’intérieur du pays.
Au mois de février, le phénomène de « citernage« , cet approvisionnement d’habitations par citerne, s’est accentué dans certaines wilayas comme c’est le cas à Tiaret au grand dam des autorités de wilaya. Des usagers ne recevant de l’eau qu’une fois tous les 5 jours avaient eu recours à l’achat de citernes d’eau.
Dans plusieurs wilayas, en quelques heures les oueds se sont transformés en torrents charriant des eaux de couleur marron car emportant avec elles le limon et les particules d’argiles arrachées au sol. Des particules qui se déposent en fin de course dans les barrages et contribuent à leur envasement.
La pluie et la neige s’abattent sur le nord de l’Algérie : des barrages bien remplis
À la perte de la capacité d’emmagasinement de l’eau de ces barrages s’ajoute chaque année la perte de centaines d’hectares de terres agricoles du fait de cette érosion hydraulique.
Un phénomène que tentent de freiner les services des forêts par la plantation d’arbres à proximité des barrages. Cependant, pour venir à bout de cette insidieuse perte des capacités agricoles, seules des mesures drastiques peuvent enrayer ce phénomène d’autant plus qu’il s’agit de faire face à des pluies au caractère torrentiel.
Il s’agit d’assurer la protection de la couverture végétale des sols mise à mal par le surpâturage, de planter des haies en bordure des champs et d’éviter le labour sur les sols en pente.
Ce type d’action ne peut être mis en œuvre que par la sensibilisation des agriculteurs et l’instauration de subventions et d’aides aux populations rurales vivant de l’élevage pour les services écologiques rendus à la société.
En effet, les coûts de désenvasement d’un barrage sont bien plus élevés que les montants qui pourraient être alloués aux populations rurales vivant sur les bassins versants les plus soumis à l’érosion.
Ces fortes pluies ont parfois provoqué des inondations. C’est le cas dans la wilaya de Sétif et de Jijel où l’intervention des services de la Protection civile a permis de porter assistance aux personnes dont l’habitation était cernée par les eaux.
À Annaba des champs de blé sont sous l’eau de même qu’à Jijel où des vergers et des cultures maraîchères situées à proximité de cours d’eau ont été inondées.
Ces cultures installées sous serres ou sous tunnel plastique ont subi des dégâts considérables qui ont amené les agriculteurs concernés à réclamer une aide dans la mesure où la saison agricole est en partie compromise alors qu’il leur faudra rembourser les dépenses engagées pour l’achat de plastique, semences et engrais.
Le bilan de ces dernières pluies est donc globalement positif. Reste à voir ce que sera ces prochains jours la pluviométrie à l’ouest du pays et surtout durant le printemps.
Djamel Belaid
| |
|
NOUS, LES FRANCAIS d'ALGERIE
Envoyé par Annie
|
|
ODE A DE GAULLE ?
Oui on était simplement des Français d'Algérie,
Balancés n' importe où, dans l'amère patrie
Par un vieux galonné, sénile psychopathe,
On était simplement des Français d'Algérie...
Et durant les 2 guerres, nos morts ont jalonné
Tous les champs de bataille, de France ou d'Italie,
Il a tout oublié, le pédant galonné,
Le trop bouffi d'orgueil et de sombre folie,
On était simplement des Français d'Algérie...
Pour nous, pas de discours et pas d'accueil en France
Nos vieux ont attendu plusieurs jours sur les quais,
Sans aide ni pitié, noyés d'indifférence,
L'ogre de Colombey avait ses préférences
Et il nous méprisait, lui et tous ses laquais
On était simplement des Français d'Algérie...
Mais on s'est relevé à force de courage
Charlot s'en est allé au royaume éternel,
Heureux de son exploit, de son choix criminel,
Il restera pour nous le triste personnage
Qui n'aimait pas du tout les Français d'Algérie !
Les années ont passé sur nos joies et nos peines,
On a refait nos vies sur fond de nostalgie,
Les souvenirs au coeur et sans démagogie,
Insensibles aux appels et au chant des sirènes,
On est sorti vainqueurs du combat des arènes
Pour demeurer toujours... Des français d’Algérie…
|

| |
|
Notre liberté de penser, de diffuser et d’informer est grandement menacée, et c’est pourquoi je suis obligé de suivre l’exemple de nombre de Webmasters Amis et de diffuser ce petit paragraphe sur mes envois.
« La liberté d’information (FOI) ... est inhérente au droit fondamental à la liberté d’expression, tel qu’il est reconnu par la Résolution 59 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1946, ainsi que par les Articles 19 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), qui déclarent que le droit fondamental à la liberté d’expression englobe la liberté de « chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».
| |
|
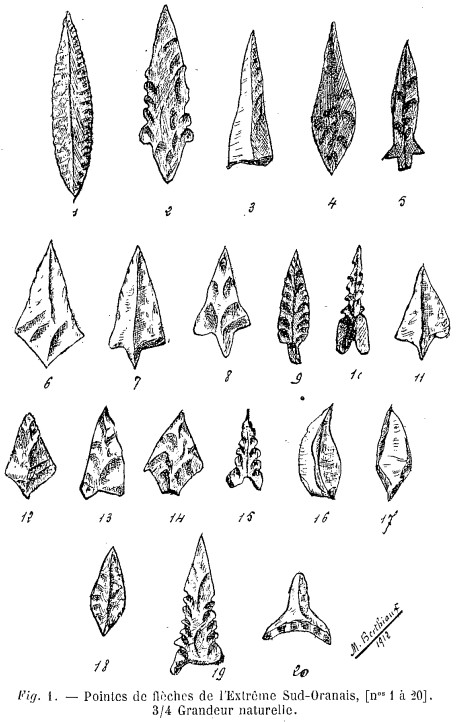
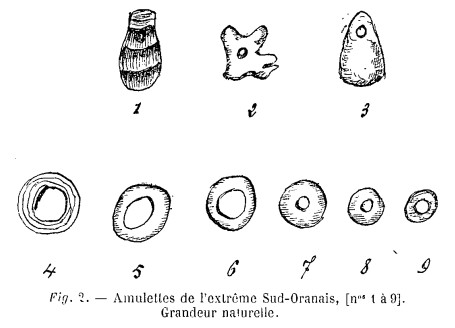





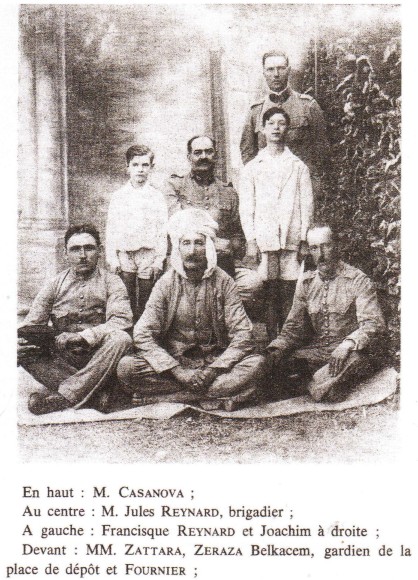
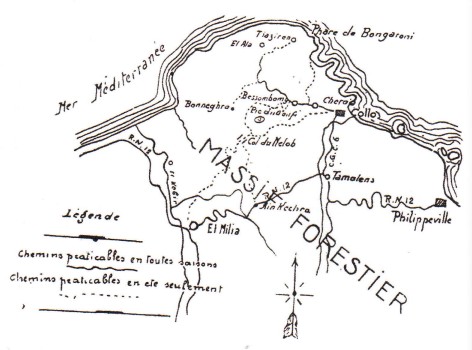





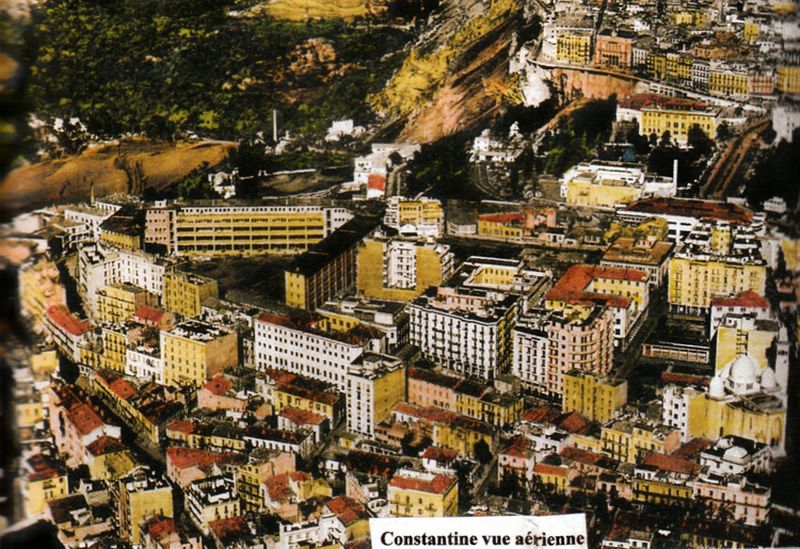

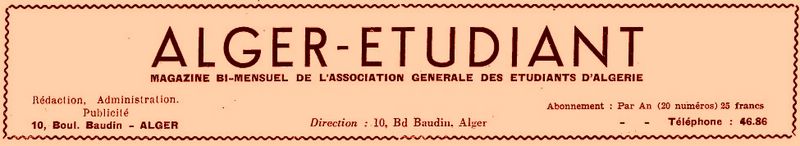 Source Gallica - N° 146
Source Gallica - N° 146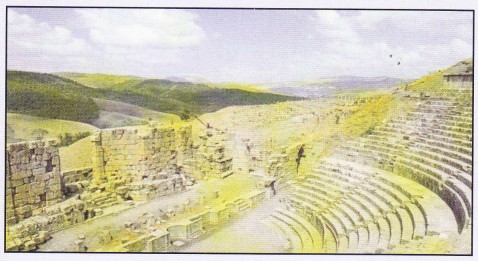 La ville antique de Djemila est située à 48 Kms au Nord-est de Sétif, à 900 m d'altitude, dans le paysage de collines accidentées et pelées des monts Sud de la Petite Kabylie. Le Centre de colonisation ne fut jamais réalisé, quelques fermes furent créées ainsi que des moulins à mouture indigène sur I'Oued Deheb, dont celui ayant appartenu à Henry Dunant. le futur créateur de la Croix Ronge. Sous l'égide de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts - Antiquités et monuments historiques, un immense chantier fut ouvert, des fouilles entreprises dans la cité antique. Le chantier de Djemila a été dirigé, avec énergie et dévouement, jusqu'en 1941 par Mme de Crésolles, qui avait assisté son mari au début des fouilles en 1909.
La ville antique de Djemila est située à 48 Kms au Nord-est de Sétif, à 900 m d'altitude, dans le paysage de collines accidentées et pelées des monts Sud de la Petite Kabylie. Le Centre de colonisation ne fut jamais réalisé, quelques fermes furent créées ainsi que des moulins à mouture indigène sur I'Oued Deheb, dont celui ayant appartenu à Henry Dunant. le futur créateur de la Croix Ronge. Sous l'égide de la Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts - Antiquités et monuments historiques, un immense chantier fut ouvert, des fouilles entreprises dans la cité antique. Le chantier de Djemila a été dirigé, avec énergie et dévouement, jusqu'en 1941 par Mme de Crésolles, qui avait assisté son mari au début des fouilles en 1909.
 Djemila est une ancienne ville romaine, les ruines qui couvrent une très grande surface, démontrent, que c'était un centre très important. Bloqué en 1838 avec le 3° bataillon de zéphir, on fut forcé pour ne pas s'exposer aux balles des assiégeants kabyles d'établir des tranchées servant de chemins couverts; ces travaux firent découvrir une superbe mosaïque, des statuettes et divers objets romains. Les ruines éparses en très grande quantité sur le sol, fourniront les pierres nécessaires à la construction des maisons et des édifices publics. La terre pour la culture est de première qualité, on pourra y cultiver des céréales et y planter des arbres fruitiers, I'eau abonde, le climat est salubre, c'est un pays privilégié pour la culture, comme savaient en choisir les Romains.
Djemila est une ancienne ville romaine, les ruines qui couvrent une très grande surface, démontrent, que c'était un centre très important. Bloqué en 1838 avec le 3° bataillon de zéphir, on fut forcé pour ne pas s'exposer aux balles des assiégeants kabyles d'établir des tranchées servant de chemins couverts; ces travaux firent découvrir une superbe mosaïque, des statuettes et divers objets romains. Les ruines éparses en très grande quantité sur le sol, fourniront les pierres nécessaires à la construction des maisons et des édifices publics. La terre pour la culture est de première qualité, on pourra y cultiver des céréales et y planter des arbres fruitiers, I'eau abonde, le climat est salubre, c'est un pays privilégié pour la culture, comme savaient en choisir les Romains.
 La fertilité du sol, l'abondance des sources contribuèrent à faire de Cuicul une ville riche. Les cultures de céréales et d'oliviers, l'élevage des moutons, de chèvres, d'ânes et de bœufs, ne tardèrent pas à donner naissance à une industrie importante : huileries. poteries et tissages.
La fertilité du sol, l'abondance des sources contribuèrent à faire de Cuicul une ville riche. Les cultures de céréales et d'oliviers, l'élevage des moutons, de chèvres, d'ânes et de bœufs, ne tardèrent pas à donner naissance à une industrie importante : huileries. poteries et tissages.
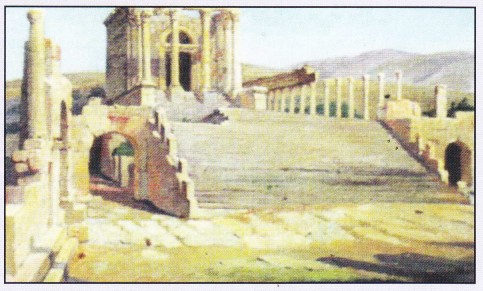 La destruction de Cuicul. - Les traces d'incendie que révèlent les ruines de Djemila, les statues et les divers objets découverts généralement brisés, I'absence presque totale de métaux précieux ou d'objets de valeur dans les ruines, font penser que la ville fut anéantie par I'incendie et pillée par les tribus montagnardes de la petite Kabylie qui s'étaient à plusieurs reprises, déjà soulevées contre l'autorité romaine. Quelques heures suffirent pour rendre à sa désolation sauvage tout ce pays que quatre siècles de civilisation romaine avait conduit à la prospérité.
La destruction de Cuicul. - Les traces d'incendie que révèlent les ruines de Djemila, les statues et les divers objets découverts généralement brisés, I'absence presque totale de métaux précieux ou d'objets de valeur dans les ruines, font penser que la ville fut anéantie par I'incendie et pillée par les tribus montagnardes de la petite Kabylie qui s'étaient à plusieurs reprises, déjà soulevées contre l'autorité romaine. Quelques heures suffirent pour rendre à sa désolation sauvage tout ce pays que quatre siècles de civilisation romaine avait conduit à la prospérité.
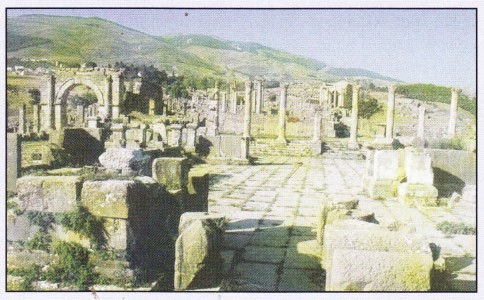 Il est arrivé avec quelques amis à Bône, puis à Philippeville et à Constantine où il reçut I'hospitalité de l'Etat Major de la Division. C'est là qu'il recueillit de la bouche même des valeureux combattants de ce drame, les détails, jusque là inédits, qu'il a rapporté dans son livre« Le Véloce» nom du navire de guerre sur lequel il avait traversé la Méditerranée.. Le récit imagé que nous a transmis le grand romancier n'a pas la valeur d'un compte-rendu officiel. Il peut, cependant, être considéré comme un témoignage de I'importance donnée, à cette bataille, par des chefs dont l'appréciation ne peut être récusée. Nous ne retiendrons de ce récit que les parties essentielles.
Il est arrivé avec quelques amis à Bône, puis à Philippeville et à Constantine où il reçut I'hospitalité de l'Etat Major de la Division. C'est là qu'il recueillit de la bouche même des valeureux combattants de ce drame, les détails, jusque là inédits, qu'il a rapporté dans son livre« Le Véloce» nom du navire de guerre sur lequel il avait traversé la Méditerranée.. Le récit imagé que nous a transmis le grand romancier n'a pas la valeur d'un compte-rendu officiel. Il peut, cependant, être considéré comme un témoignage de I'importance donnée, à cette bataille, par des chefs dont l'appréciation ne peut être récusée. Nous ne retiendrons de ce récit que les parties essentielles.




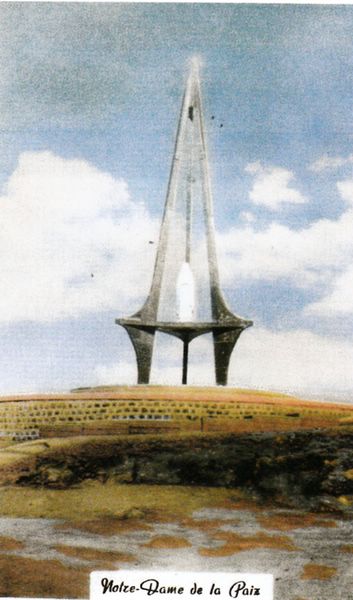
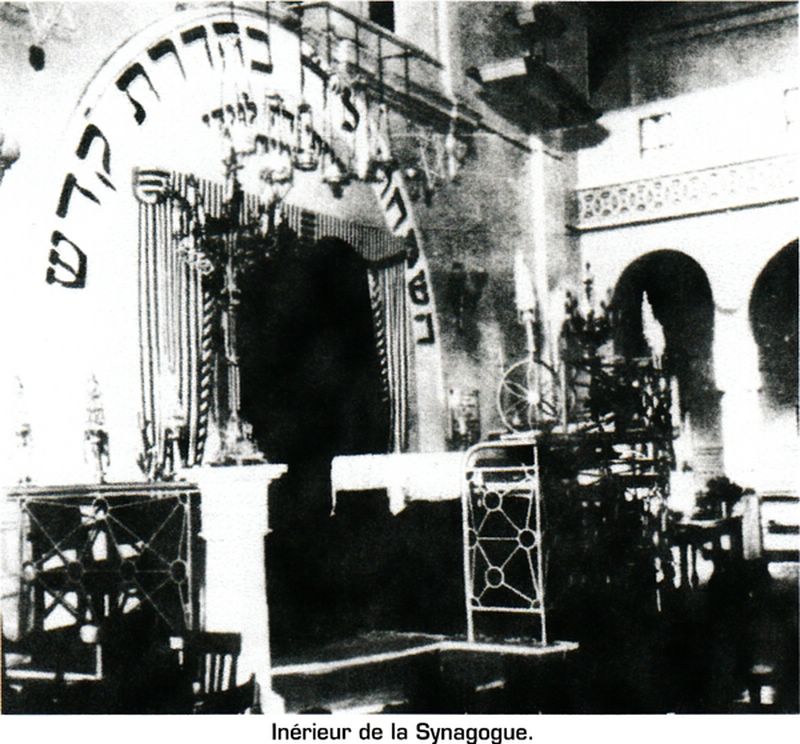
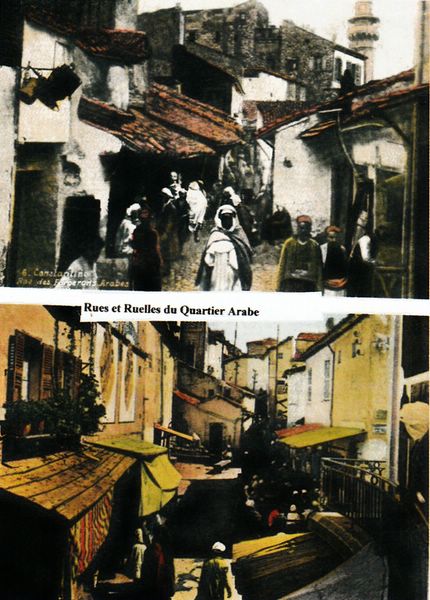
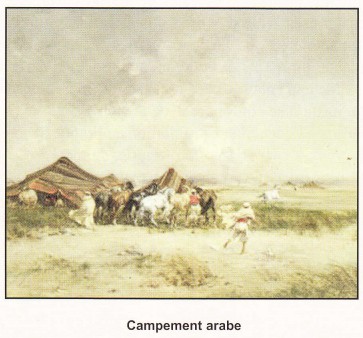
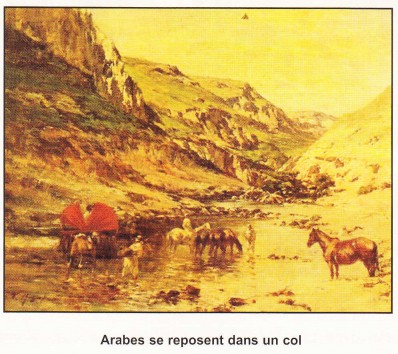


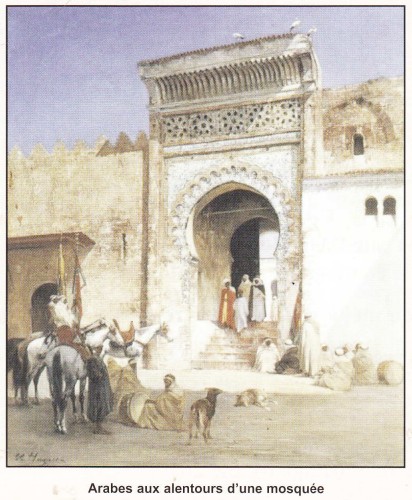 Découvrant l'Algérie quelques années plus tard, il y puisera de nombreuses sources d'inspiration. Débutant aux Salons de Marseille et Paris en 1859, il exposa régulièrement aux Artistes Français avec des oeuvres telles que Halte de bicharis dans le désert de Libye, 1861, Halte sur les murs à Constantine, I865 et Dans les douars du sud de l'Algérie, 1877.Il exposa trois tableaux, dont l'un appartenait au marchand Durand-Ruel, au premier Salon de la Société des Peintres Orientalistes Français, qui fut organisé en même temps qu'une exposition d'art musulman au Palais de l'Industrie à Paris, en 1893. Il continua à envoyer des oeuvres à ce Salon pendant les années 1890.
Découvrant l'Algérie quelques années plus tard, il y puisera de nombreuses sources d'inspiration. Débutant aux Salons de Marseille et Paris en 1859, il exposa régulièrement aux Artistes Français avec des oeuvres telles que Halte de bicharis dans le désert de Libye, 1861, Halte sur les murs à Constantine, I865 et Dans les douars du sud de l'Algérie, 1877.Il exposa trois tableaux, dont l'un appartenait au marchand Durand-Ruel, au premier Salon de la Société des Peintres Orientalistes Français, qui fut organisé en même temps qu'une exposition d'art musulman au Palais de l'Industrie à Paris, en 1893. Il continua à envoyer des oeuvres à ce Salon pendant les années 1890.
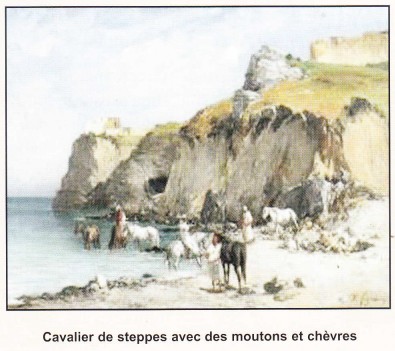

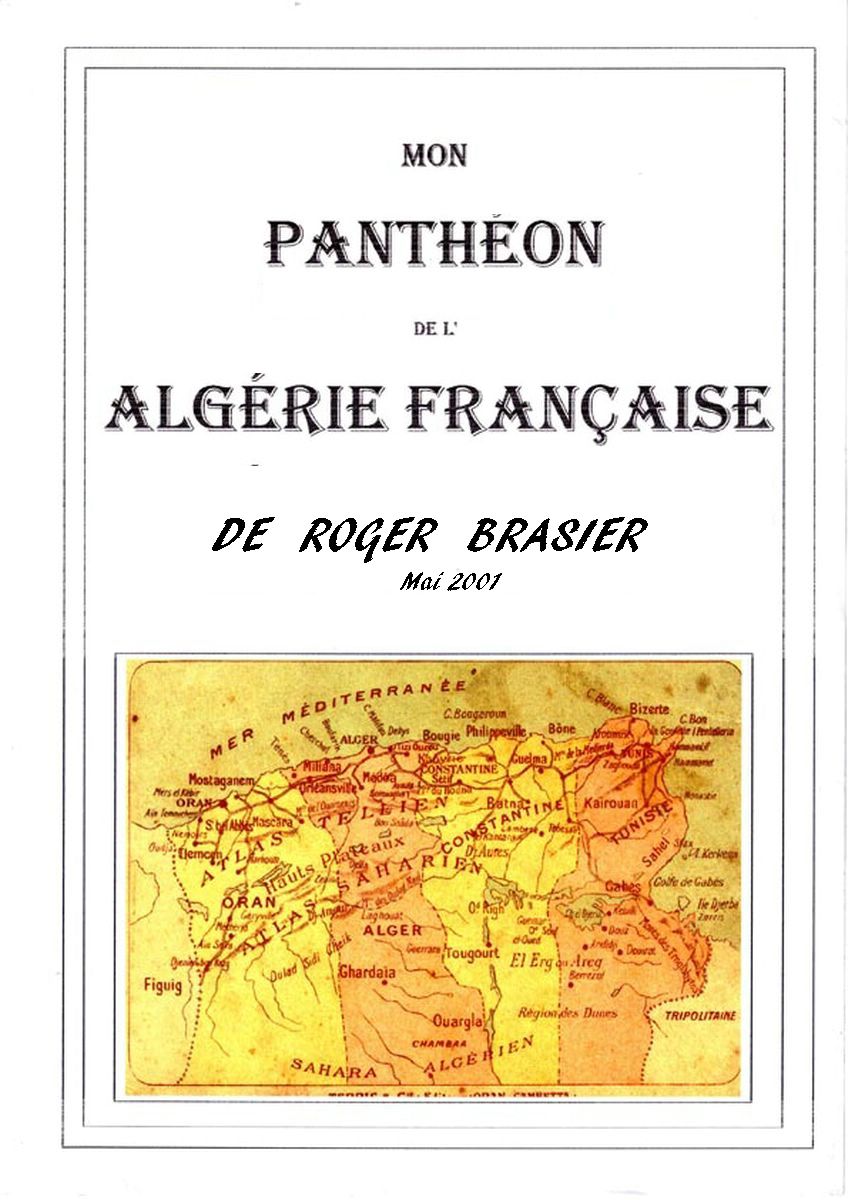
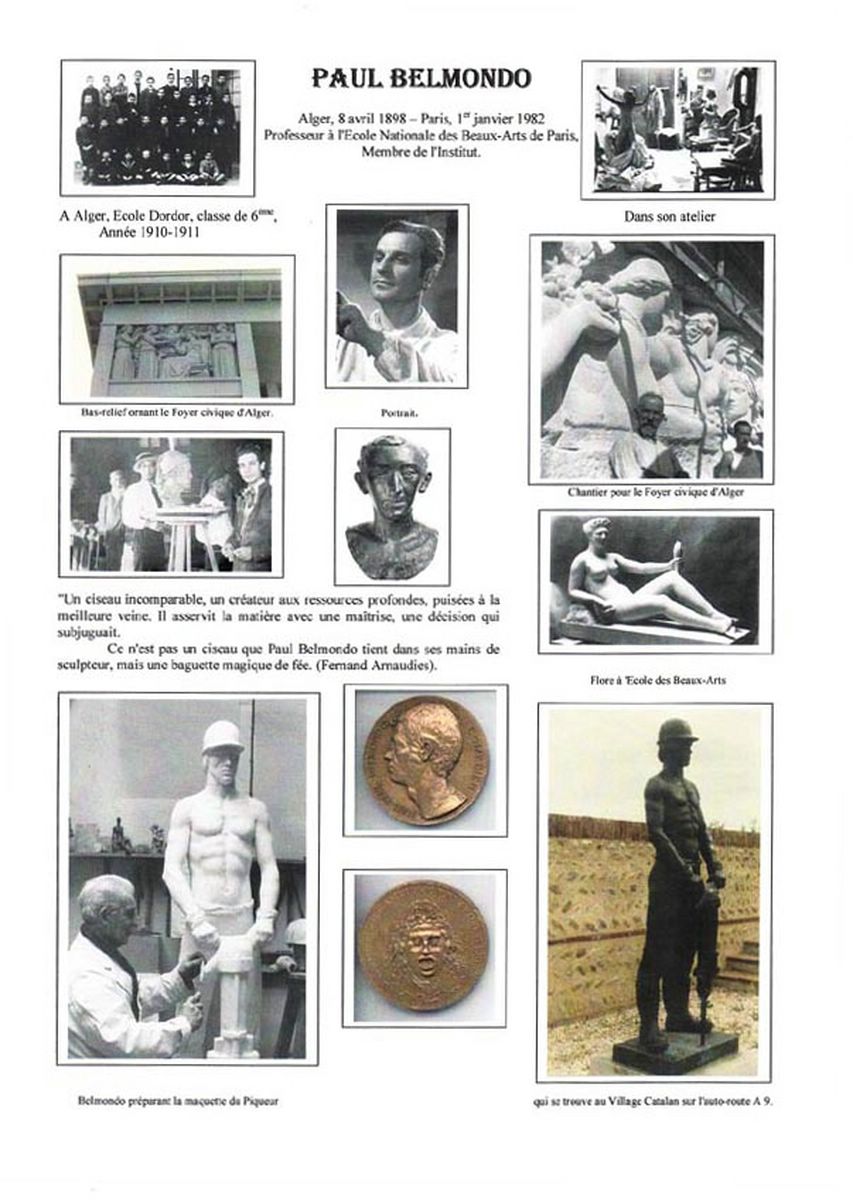
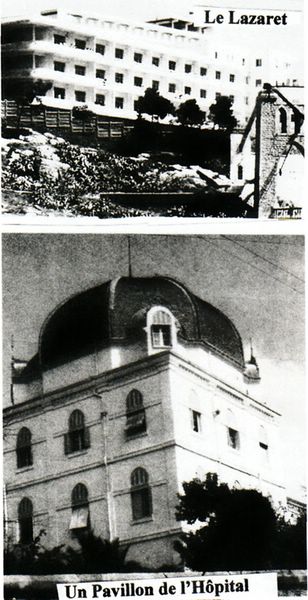

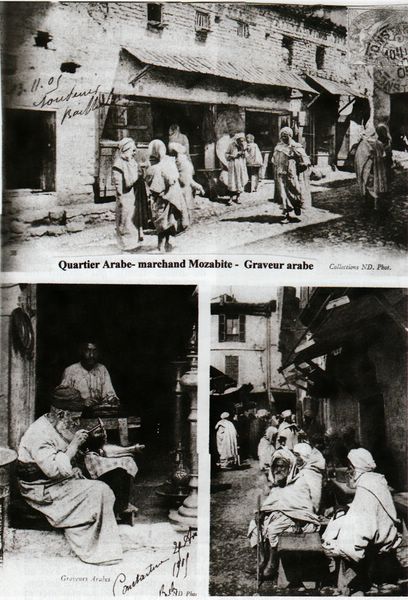



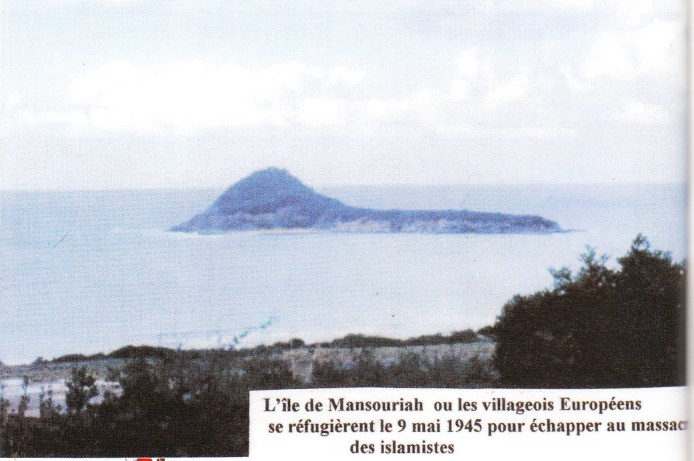
 J'ai pu étudier la question d'emplacement du port romain , j'estime que la petite baie qui s'étend au nord-ouest entre I'embouchure de l'Oued Ziama et le promontoire du Djebel-bou-Blata n'a jamais servi que de rade. Le véritable port se trouvait à l'embouchure même de la rivière dans une crique naturelle aujourd'hui comblée par les alluvions de la montagne, mais qui se dessine encore nettement lorsqu'on étudie son emplacement de la tour, point culminant et réduit de la défense du plateau de Ziama. Il existe encore des vestiges des quais du port , au pied de la culée du pont de Ziama, une ligne non interrompue de constructions encore indéterminées et en partie ensevelie sous les décombres et les éboulements longe la rive droite de l'ancien lit de la rivière.
J'ai pu étudier la question d'emplacement du port romain , j'estime que la petite baie qui s'étend au nord-ouest entre I'embouchure de l'Oued Ziama et le promontoire du Djebel-bou-Blata n'a jamais servi que de rade. Le véritable port se trouvait à l'embouchure même de la rivière dans une crique naturelle aujourd'hui comblée par les alluvions de la montagne, mais qui se dessine encore nettement lorsqu'on étudie son emplacement de la tour, point culminant et réduit de la défense du plateau de Ziama. Il existe encore des vestiges des quais du port , au pied de la culée du pont de Ziama, une ligne non interrompue de constructions encore indéterminées et en partie ensevelie sous les décombres et les éboulements longe la rive droite de l'ancien lit de la rivière.
