|
|
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
Les dix derniers Numéros :
37 , 38 ,
39 , 40 ,
41 , 42 ,
43 , 44 ,
45 , 46 ,
| |
EDITO
La rédaction avec tous ses nombreux collaborateurs de cette Gazette, par leurs écrits et leurs envois vous adresse leurs Meilleurs Vœux pour l'Année 2006.
L'année 2005 est morte et laisse naturellement sa place à 2006. Que cette nouvelle année vous offre, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, santé, bonheur et prospérité.
Cette année 2005 aura apporté son lot de tristesse et de déception aux Français d'Algérie, les exilés que nous sommes restés.
Nous avons été témoins " acteurs " et victimes d'une actualité dont nous nous serions bien passée si les gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 40 ans avaient bien voulu régler favorablement nos problèmes causés par notre déracinement et que nous sommes obligés d'affronter quotidiennement.
Une loi est sortie des cartons. Une loi que nous jugeons très imparfaite car derrière elle, il y a toujours le dessein politique de petite vertu. En effet cette loi, outre quelques améliorations pour quelques uns, est un creuset de discrimination, voulue pour diviser encore plus toute la communauté des Rapatriés d'Algérie, Harkis et Pieds-Noirs.
En 2004, nous espérions que cette loi pourrait nous rapprocher un plus de cette soi disante fraternité française. Nos ennemis et ceux de la France s'en servent pour creuser un peu plus le fossé entre l'œuvre de nos ancêtres et les fossoyeurs de cette Algérie moderne créée de toutes pièces par des pionniers qui ont laissé leur peau sur une terre qui nous est si chère.
2005, devait voir aboutir un traité d'amitié et de paix entre la France et l'Algérie. Nous ne sommes pas contre un véritable traité de paix, à condition qu'il ne soit pas une Traité d'à Moitié ou un Traité à l'eau minérale de repentance unilatérale nous rappelant les odieux accords d'Evian.
Le Traité virtuel de paix existe entre les peuples Expatriés et Algériens. Le retour de millions de compatriotes chez eux en apporte des témoignages poignant de vérités historiques que nous défendons à longueurs d'années. C'est certain que cela contredit toute l'histoire falsifiée de l'intelligentsia aux commandes de l'Etat, des Médias et de l'Enseignement, ainsi que tous ces intellectuels et historiens véreux.
Nous ne voulons pas d'un Traité qui serait basé sur le néo-colonialisme commercial qui à terme sera plus meurtrier que les guerres fomentées et alimentés par la bourgeoisie intellectuelle, totalitaire et autocrate comme le plus illustre criminel que la France ait jamais connu : Charles de Gaulle. Lui qui a financé l'armement du FLN pour qu'il massacre des populations civiles sous la condition expresse qu'il laisse tranquille la mise en œuvre de l'industrialisation et la commercialisation des gaz et pétrole Sahariens. Une mise en œuvre qui ne rapportera rien aux peuples français et algériens, mais seulement à des nantis du FLN et à leurs complices français qui ne vivent encore que pour cela.
Nous demandons un Traité qui reconnaîtra les points essentiels suivants :
- L'incommensurable œuvre des pionniers ;
- Les injustices commises à notre égard comme à celles de toutes les populations ;
- La spoliation honteuse de nos biens ;
- La reconnaissances des crimes et massacres inutiles et ignobles perpétrées au nom de toutes les d'idéologies ;
- La Vérité sur les disparus ;
- La liberté du culte et du droit de l'homme ;
- Etc..
Voilà le Traité que nous voudrions voir aboutir et dont nous aimerions être associés.
Que cette année 2006 soit l'année où l'unité tant désirée dans notre communauté se fera jour. Que cette unité, tant redoutée par nos ennemis, se montre très forte pour peser sur les prochaines échéances électorales. Je n'aime pas jouer au sorcier politique, mais nous constituons une force décisive dont nous pouvons user dans chaque village, ville, canton, circonscription et même au sommet de la pyramide. Utilisons cette force contre tous nos ennemis, qui sont aussi ceux de nos enfants comme également ceux de leur propre pays. Ce mouvement qui se met en marche ne doit pas s'arrêter de sitôt et nous avons espoir et confiance dans les souhaits de chacun.
Que 2006 apporte aussi la paix, la santé la prospérité et le bonheur dans tous nos foyers de nos petits peuples.
Comme on disait à Bône : " Bonne Année, Bonne Santé et la Paille au C.. pour toute l'Année "
Mille bisous à vous tous.
Merci à tous Jean Pierre Bartolini
2006 sera aussi l'année du 2ème voyage de notre site vers Bône. Les places seront limitées car les prix seront très attractifs. Il y a déjà des places de réservées pour ceux qui se sont manifestés précédemment.
Nous mettons la dernière main dans les préparatifs et dans quelques jours, nous aurons les documents définitifs. Si vous désirez faire ce voyage, inscrivez-vous rapidement. Les premiers arrivés seront les premiers servis.
Mon Adresse est : jean-pierre.bartolini@wanadoo.fr
Merci à tous Jean Pierre Bartolini
Diobône,
A tchao.
|
|
|
| Aprés votre visite,
(---n'oubliez pas de Cliquer --- )
|
|
Pétition contre un traité d'amitié Franco-Algérien baclé.
La pétition est ouverte à tout le monde Pieds-Noirs |
|
|
NAISSANCE
"Ils sont partout les Bônois" |
Voilà le beau cadeau de Noël que nous a fait notre fille: une petite fille Alma, Sara, Lucie née le 23 décembre à 9 h 31 à Göteborg (Suède) 2,350 kg et 50 cm
Elle s'appelle Gustafsson mais c'est une petite-fille de BÔNOIS !
Vous imaginez comme les grands-parents sont heureux !!!

Félicitations aux Parents, grands-parents et arriére-grands-parents.
Nous souhaitons tous nos meilleurs voeux à cette petite fille bônoise
et qu'elle ait la tchatche du grand-père.
|
|
| MAISON HANTEE
N° 2 de Février 1950
de M. D. GIOVACCHINI
Envoyé par sa fille
|
|
Il s'agit de notre maison Commune, désormais sans pilote et sans équipage.
De temps à autre un tantinet d'animation agite les fantômes qui y règnent en maîtres.
C'est que le Patron est arrivé. Débarqué du " Chanzy " où l'avait accueilli un pompier de service, il manda le Chef de Cabinet pour s'enquérir des affaires urgentes.
Un rapport sur une affaire importante, que F. avait ciselé d'une plume experte, fut jeté au panier. " C'est du vent " cria le Patron devant l'auteur qui baissa la tête et partit, tel un caniche, la queue basse entre les jambes, pour aller conter sa douleur à H. A.
Puis il aborda avec un intrépide esprit de décision, l'épineuse question du secrétariat général :
" De FORNEL, malgré F., sera le secrétaire général numéro 1, et PANDOLFO, ne sera plus que le secrétaire général - bis, parce qu'il fut un " ami de l'U. R. S. S.
Et Dieu aidant, Bône possède par la grâce de la Municipalité passée ou présente un client de plus pour la Recette Municipale.
Le bon sens exigeait que PANDOLFO retrouve son ancien emploi ou toute autre poste équivalent. Mais ne parlons plus de cette vertu absente.
Tout cela compliquera les rouages de la machine administrative, et ne fera qu'accentuer le désordre qui règne dans le service.
SERVIER et RUBIR marqueront le pas, n'ayant plus qu'à souhaiter... longue vie à leurs deux chefs immédiats.
En attendant, le contribuable fera les frais de cette ineptie sans précédent.
87.000 francs par mois, jetés dans la poche d'un budgétivore inutile, cela fait un beau million dans l'année. De quoi acheter des livres et des cahiers pour tous les élèves nécessiteux de la ville ! Et aussitôt le député "indépendant " regagna Paris, où personne ne l'attend, pour retrouver un vestiaire vide de dossiers.
Il restera F., qui n'oubliera pas de " paraître " quelques heures avant de regagner le Paradis de l'Assemblée Algérienne, où, loin des curieux, on joue avec des tourterelles au plumage nuancé !
Et puis.., plus personne ! BUSSUTIL, qui a son amour propre, a trouvé une saine consolation dans les boules.
NATAF, relit les Fables de la Fontaine et les contes de Daudet.
GUILLEMIN pleure en pensant à Anselme et Alphonse Zerbib.
Mais ne désespérons plus... BENOTMANE l'homme de confiance ! -- dirigera les bureaux et fera les couloirs.
Et puis, il nous restera aussi, Jean - des - Grâces, fidèle délégué à la Rhubarbe, et deux ou trois MINUS HABENS, chargés d'attiser le feu... de la discorde, pour justifier l'utilité des pompiers.
|
|
| Ça qu'on vous a pas dit … ! N° 32
|
Christian AGIUS
le Maltais de la route de Bugeaud,
y ramasse dans les poubelles de luxe…
ma, tombe de ses morts, c'est la franche vérité !!!
|
La loi Perben dessur les remises de peine elle a été rédigée par un calamar qui avait écrit une réduction de sept jours par mois…ma, ce tchoutche il a oublié de préciser que c'était pour les peines inférieures à un an…
Résultat : des chiées de taulards y zont porté plainte pour…..détention arbitraire !
|
La Sécu elle a au moins 400.000 fonctionnaires ! Zeb !
Ma, aucun y s'est aperçu que la carte Vitale elle était pas cryptée !!!
Diocane, c'est un pépé bricoleur en électronique-ta-mère qu'il a découvert le pot ac les roses en-dedans…
|
Yannick-ta-mère Noah c'est un poète, diocane !
Sa chanson " Métisse " elle a un refrain que même Charles Trénet il aurait pas été capabe d'écrire :
" Na na na na na ne na na ne oh oh
Na na na na na na na na na oh oh
Métis
Na na na na na na na na na oh oh
Oh métis, ne na noi na na na na nu oh oh"………….
|
Bernard Tapie il aime le yoyo !
Tout le monde il le disait en dedans les startings-blocs pour le prochain élysée, après son procès qu'il a gagné contre le Crédit Lyonnais (ac vote pognon, bande de gatarelles…).
Zeb ! Y risque de se ramasser deux ans de taule pour fraude fiscale en 92-93……..
|
La polygamie elle est enterdite en France, sauf…………..pour les Musulmans !
Rien à foutre, ma y en a un qu'avec deux femmes, y palpe l'A.P.I., l'A.J.E., l'A.L., le R.M.I., l'A.R.S., les allocations familiales…………..total = 7856 zorros !!!
Sans rien foutre, o tchoutche !
|
Delanoë, le coulot, il arrose bien les associations de copains : 10.000 zorros à " Archives, recherches et culture lesbiennes ", 30.000 zorros à " Ni putes, ni soumises " (alors quoi ? : ndlr) et……toujours rien aux P'tites Sœurs des Pauvres…
|
Colin Powell, cuilà qu'il a fait envahir l'Irak, y vient d'avouer, dessur la chaîne américaine A.B.S., que les " armes de destruction massive " de Saddam Hussein c'était d'la zoubia et qu'il avait été mené en bateau…
Diocane…
|
|
Les é-coco-los ils l'ont dans le therma !
Des scientifiques de l'université de Chicago y viennent de prouver que la couche d'ozone……………….a légèrement augmenté ces dernières années !!!
Diocanamadone, ça gâche le métier…
|
Bush c'est un virtuose du tchalèfe ! y S'est fait photographié ac des pompiers dans la tempête de Louisiane…
Mon zeb ! Il a réquisitionné des pompiers d'Atlanta dessur une base militaire, qui z'étaient prévus pour justement aller dedans les inondations, et y zont tiré les photos…
C'est un pompier, écoeuré, qui l'a lâché le morceau…
|
Après Cécilia, Anne…
Sarcocu il a trouvé une autre : Anne Fulda, journaliste au Figaro.
On s'en fout, ma………………les photos du couple elles sont proposées aux journaux à…………..80.000 zorros !!!!
|
La Turquie elle est pas encore dans l'Union Européenne.
Alors tu vas me dire pourquoi dans les bâtiments du Conseil sont prévus les locaux pour les enterprètes turcs…
|
C'est beau la solidarité ! Après les bafounes Katrina et Rita, le gouvernement américain il avait mis en place des lignes espéciales d'assistance aux familles des victimes.
Ma……………les opérateurs y zétaient en…………Inde, pourquoi ça coûte moins cher, diocane !
|
Tu connais la COFACE : c'est une assurance d'être payé par les pays étrangers qui………….payent pas.
Financée par……………..toi, ô tchoutche !
Le Chirac il a fait des necs en " remettant solennellement " les dettes de quelques pays africains.
Total, ô tchoutche : 230 millions de zorros pris dans tes poches !!!
|
Les flics de La Nouvelle Orléans y zont pas perdu leur temps pendant la bafoune : 200 bagnoles qui zont volées, ac une préférence pour les Cadillac………41 !!!
|
Pas d'Israéliens dedans les morts des attentats d'Amman… Comme dans les deux tours de New-York !
Le Mossad il était au courant………………
|
|
| La suite au prochain numéro :
te fais pas de mauvais sang,
J'en ai encore des tas en dedans les tiroirs….
|
LE PLUSSE DES KAOULADES BÔNOISES (33)
|
|
LES DISSOLUTIONS QUE MOI J'VAS M'LES PRENDE POUR 2006
Avant, là-bas, quan c'est qu'elle venait la bonne année, tous comme on est, on te devenait poètres et quels poètres, diocamadone, rien qu'on te faisait des phrases qu'elles triment entre elles comme par exempe : Bonne année, bonne santé, met ta main dedans le porte-monnaie et des z'aut' soges encore plusse belles mais que ça fait tellement longtemps que je m'les z'ai oubliées à de bon. Aujourd'hui, rien que t'y entends des soges qu'elles sont pas sérieuses, des promesses qu'elles sont faites et qu'elles sont pas tenues ni respectées et qu'elles sont toujours reportées dessur l'année d'après, celle-là là qu'elle vient et ceux-là là, qui te font ça, y sont pas modernes et comme plusse moderne que moi, tu t'affogues alors, comme y dit l'aut', moi aussi je sacrifie à la mode comme tout l'monde et je vas me prende des dissolutions pour 2006 que j'les commence le premier janvier, pas z'avant.
D'abord, y faut pas confonde dissolutions et dissolution. Les premières, c'est celles-là là qu'elles sont toujours prises par les nations z'humides et qu'elles sont jamais respectées et la deuxième, c'est la glu qu'on bouche avec les trous qu'y a en dedans les chambres à air des roules de bisquilettes. Y'alors, comme j'l'ai dit, j'me prends des dissolutions pour 2006 mais j'vas pas faire comme ceux-là là qui sont à Nève-york, j'vas essayer de m'les respecter bien-bien et si que j'le fais pas, personne y saura à part le bon dieu.
Premièrement, d'abord et avant tout, j'vas arrêter de vouloir ête à toute force un suèdois à cause que, comme je suis p'tit et brun et que je parle que le Tchapagate, j'arrive pas à convainque et ça, ça fait pas sérieux.
Deuxièmement et après, arrêter de faire des fôtes d'orthografle quan c'est que j'écris et le mieur, je cois, c'est d'arrêter d'écrire et arrêter à de bon mais oilà, pour ça, y va me falloir beaucoup du courage pasque si que ma main gauche elle s'en fout, la droite, elle, diocane, elle me gratte jusqu'au bout des doigts et la seule façon d'la calmer, c'est d'ui donner un stylo.
Troisièmement, ensuite, arrêter d'ansulter pour un oui, pour un non, la race, les morts et tout ça qu'on s'le jure mais oilà, si que je jure pas, c'est que baccouche, muet j'a venu et ça c'est pas possibe d'arrêter de parler à cause que même ; quan je dors, moi j'me repose mais ma pitain de langue elle continue de travailler ça qui fait que tout ça que j'le cache le jour, j'le raconte quan elle vient la nuit.
Quatrièmement, pour pas que j'oublie, j'vas plus perde mon temps devant la télévision quan c'est qu'elle passe des films que j'les comprends pas. Si que c'est pas un film cove-boy, macache, pas de télé aussinon si qu'y a un film dessur Bône alors là, je vote et j'envite même les amis, seulement ceux-là là qu'y z'apportent avec eux quèque soge à boire ou à s'affoguer comme par exempe d'l'anisette ou une bonne fougasse.
Cinquièmement et c'est la fin, j'irai à Bône, j'irai à Bône, j'irai à Bône, au moins trois fois dedans l'année si que c'est pas plusse et diokixe, quan c'est que " l'Ours polaire " y sert les glaces, ouallah, je jure de me prendre un créponnet double tous les jours que dieu y fait, un créponnet comme je dis moi, à la santé des les bônois, tous comme y sont et aousqu'y sont, même à Tataouïne et en attendant le départ, à tous je dis avec un peu du retard, JOYEUX NOËL et à tous, je souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNEE et pourquoi pas, des retrouvailles dessur le Cours.
Purée j'aime pas m'arrêter dessur un chiff' farde y'alors, je finis dessur un sixièmement mais léger çui-là là comme la fumée que j'vas arrêter d'la faire, ouallah, j'arrête la cigarette qu'elle m'a toujours fait du mal, au vente, à la tête, à la caisse que manque elle s'en va et surtout au portefeuille et je cois que c'est la seule dissolution qu'elle va tenir comme celle-là là des chambres à air que j'en ai déjà parlé à cause que la cigarette, y a main'nan vingt ans que moi et elle on a divorcé et moins j'la ois ou j'la sens et mieur je suis.
Rachid HABBACHI
|
|
|
| ELLES SONT BIEN BÔNE
Par M. Fernand Bussutil dit OTTO BUS
|
|
ELLES SONT BIEN BÔNE
FERNAND BUS
A tous mes Amis bônois, si douloureusement éprouvés par les événements d'Algérie et dispersés dans tous les coins de France et du Monde, avec mes affectueuses pensées.
F.B.
" FUGIT IRREPARIBILE TEMPUS "
(Virgile)
|
LA CHÈVRE A GALLINE
Lettre de Moi à Augu
Alors, te seras toujours le roi des Tchoutches, Atso ! t'y avais une place d'attaque à la Dépêche et te veux t'en sauver.
Reste tranquille, mieux un zoiseau dans la main que deux qui volent. Te dis comme Kesako. J'a choisi la liberté et ben ouvre tes oreilles et écoute l'histoire de la chèvre à Galline, qu'elle voulait vivre en liberté.
Galline, fi avait une madone de poisse ac ses chèvres. Pas qu'elles se mouraient de faim ou d'la maladie. Non, pourquoi elles étaient soignées aux p'tits oignons, ma, elles cassaient la corde et se montaient dans la montagne, et le chacail, toujours le même 0 la charogne ! y se leur faisait un sort.
Galline, il était dégouté : " Plus jamais j'aura une chèvre, même si la mèche en merguez que j'a sous le chapeau elle doit me tomber. "
Y disait çà, ma un jeudi au marché aux bestioles y s'en oit une jolie comme un coeur et vite vite, y se l'achète.
Biquette, c'était son p'tit nom, elle était meumeu..., comme y dit le Parigot, ac sa barbe de tirailloeil, ac ses sabots noirs qui se reluisaient comme les vernis à Paolo quand y s'a marié et ses p'tites cornes bien pointues et ses poils blancs qui se lui faisait une robe de mariée.
Derrière sa maison, Galline il avait un champ et là y s'attachait la chèvre tous les jours, sous un arbre de mandarines.
" Enfin ! je m'la trouvé la perle ! Celle la la y lui viendra pas l'envie d'aller dans la broussaille à faire le vagabond. "
Biquette, 0 la capricieuse ! un jour y lui vient le takouke : " Et pourquoi qu'on m'attache, c'est pas mieux aller en haut l'Hospice Coll ". De ce moment là, l'animal y maigrissait à la vue des yeux, l'herbe çà lui semblait d'la poison, son lait y sentait l'aigre et il avait des yeux de pourpre, que t'y a mis à chécher au soleil.
Galline, fou y devenait, pourquoi y voyait bien que sa chèvre elle décollait.
Un matin ac son langage de chèvre, elle se prend son courage à deux mains et elle se lui dit : " Dans la somme de tes morts, laisse moi aller dans la montagne. "
" Ma, te sais pas çà qui t'attend là-bas en haut, le chacail qui fait la " djei " y t'affoguera. "
" J'a pas peur 0 Galline, pourquoi ac mes cornes, je me lui fais un sort. "
" Non, non et non qui répond Galline, ma, qu'est ce qu'on z'a fait à nies chèvres, al madonna ! a de bon on me les a encerceaulées. Non ! te resteras dans l'écurie et te bougeras plus.
Galline, y prend sa chèvre, ma elle faisait d'là résistance un tas et elle faisait frein tsur les quatre pattes. Enfin, y ferme la bête dedans, ma, y s'avait oublié la funètre qu'elle était ouverte, alors la petite, elle s'en alla en riant dans sa barbe.
Quand Biquette, elle s'arriva dans la montagne, elle en croyait pas ses yeux. Tout du nouveau, c'était pour elle. Les arbres des olives sauvages, les arbourses elles lui caressaient le dos, les genêts jaunes y se lui piquaient son goufnadoure, ma, elle faisait pas entention, telment contente elle était. Elle se mangeait de l'herbe muscate ; tsur le gazon comme çuilà du stade, elle se faisait la p'tite fofolle, des cabrioles, des supérieux. Temps en temps, elle tapait une sprinte et montait d'en bas en haut un rocher et se oyait la maison à Galline, toute petite, petite...
Tout d'un coup, la montagne elle vient noirte. La nuit elle s'arrivait. Une chouette, elle se lui rase la queue, elle était pas rassurée. A un moment, elle entend : Hou... Hou... et dans le fond Galline, qui se l'appelait ac sa corne en escargot de mer. Ma, rien elle voulait saoir pour retourner en errière.
Biquette, elle entend un bruit de branche cassée, elle fait dimi tour et oit dans le noir deux grandes oreilles et des yeux, comme les charbons d'un kanoune.
" Ha ! Ha ! Ha ! c'est la p'tite chèvre à Galline qui dit le chacail en se passant la langue rapée tsur sa bouche, regarde si te veux faire ton testament, pourquoi j'a une faim de chacail et je vas te croquer."
Alors la pôvre Biquette, elle se prend des élans et commence à coups de cornes et dalli dans le bidon, et dalli dans la gargarnelle, des coups de tête à la bônoise. Toute la nuit elle se batailla, ma, comme le jour y se levait, elle se coucha affoguée tsur l'herbe rouge de sang, et le chacail y s'la mangea.
Adieu Augu. L'histoire que je t'a dit, c'est pas des Bônes y ment et pas de mon inventation. Si te vas au Pont-Blanc, tout le monde y te dira : " La chèvre de Galline, elle s'les donna jusqu'au p'tit jour et pis le chacail, y s'la cassecrouta.
" T'y entends 0 Dandalon ! Le chacail y s'la cassecrouta...
* Cette histoire, parue dans la Dépêche de l'Est, ne fit guère plaisir à Galline, " Le Maire du Pont-Blanc ", lequel disait à qui voulait l'entendre : " Ma, où elle est cette Otto Bus, que j'y casse le c..
|
|
| "B Ô N E " REVERIES D'HIVER
|
Notre belle Cathédrale s'est parée de son manteau blanc,
Et nous ne verrons plus un seul amoureux sur un banc.
Sur une branche, un petit oiseau sifflote frileusement,
Puis, un deuxième l'entraîne vers les cieux précipitamment.
Un enfant rose et blond joue dans les jardins de la Mairie,
D'autres bambins se cachent et leur grand-mère en rit…
L'écho monte alors dans nos cœurs,
Et nous voilà plongés dans un grand bonheur,
Celui où l'esprit danse tendrement avec notre cœur.
Au loin, sur la grande robe blanche de Bugeaud, tout est silencieux,
Et toi mon cœur, tu es déjà anxieux,
Tu rejettes la douce voix répétant : " Tout est beau ici, mais il faudra partir ",
Toi mon âme tu sais que : " Partir c'est mourir ".
Mais mon être vibre à travers une lueur d'espoir,
Une petite flamme scintillante rejette tristesse et déboires,
Soudain, les mélodieux carillons de la Cathédrale résonnent au son de mon cœur,
Mon âme murmure : " Je vous quitterai Amis, paysages, mais à jamais je vous garderai dans mon cœur ".
Marseille, le 15 Novembre 2005
Colette LEVY
| |
|
| LA COLONNE RANDON
BÔNE son Histoire, ses Histoires
Par Louis ARNAUD
|
Jusqu'en 1832, la ville que l'on nommait Bled el Aneba, ou Bouna-el-Diedida, était entourée de jardins et de vergers qui en faisaient un site agréable et recherché.
Elle était, du moins, ainsi, lorsqu'elle avait été occupée, sans le moindre combat, au lendemain de la prise d'Alger, le 3 août 1830, par les troupes françaises, commandées par le Général Damrémont.
Malheureusement, cette occupation ne fut que de très courte durée.
La révolution de juillet venait d'éclater à Paris, en effet, et le Général de Bourmont qui commandait le Corps expéditionnaire, craignant des complications dans la Métropole, avait jugé prudent de rassembler, en Alger, toutes les forces dont il avait le commandement, afin de les tenir prêtes à s'embarquer pour la France si les événements l'exigeaient.
Bône fut donc abandonnée purement et simplement, après une occupation de la ville qui n'avait duré qu'une vingtaine de jours.
Mais le Général Damrémont qui savait combien les habitants s'étaient donnés d'enthousiasme à la France partait avec la certitude de revenir bientôt.
Il comptait sans le Bey de Constantine qui envoya aussitôt ses troupes pour reprendre la ville. Les habitants de Bône résistèrent et Ben-Aïssa, commandant de l'armée du Bey, dut mettre le siège devant la ville et en organiser le blocus.
Cette situation dura près de deux ans, jusqu'au 27 mars 1832, jour où d'Armandy et Yusuf s'emparèrent de la Casbah.
Ben-Aïssa, obligé de se retirer alors incendia la ville en partie et détruisit les jolis jardins, avant de reprendre le chemin de Constantine.
Le premier souci des nouvelles autorités françaises, après avoir rétabli la sécurité, fut donc de faire disparaître les marécages nuisibles à l'état sanitaire de la région, et de reconstituer tous les vergers et les jardins potagers si sauvagement détruits.
C'est la petite plaine qui, vers l'Orphelinat, s'étend jusqu'au pied de l'Edough, qui retint, tout d'abord, l'attention du Commandant de la Subdivision.
Les terres y étaient fertiles, mais les montagnards rebelles de l'Edough, par leurs incursions fréquentes et leurs vols incessants, faisaient peser sur ces lieux, une lourde hypothèque d'insécurité qui interdisait qu'on y entreprît sérieusement la moindre culture.
La quiétude des jardiniers était, sans cesse, troublée par ces hordes pillardes venant se ravitailler à bon compte et disparaissant ensuite impunément dans l'ombre inextricable et propice des forêts toutes proches.
Cette situation interdisait aux jardiniers de s'établir trop loin de la ville et surtout d'habiter sur leurs exploitations.
C'est l'ouverture de la route à travers la forêt de l'Edough qui, en permettant une surveillance plus efficace sur les tribus montagnardes, favorisa la création et le développement*, de ce populeux faubourg que l'on a spontanément appelé : " La Colonne Randon ".
Les dix-neuf kilomètres de route qui vont de Bône au Bou-Zizi, le plus haut sommet de la chaîne de l'Edough, avaient été achevés en moins de trois mois, temps record pour l'époque, étant donné l'outillage rudimentaire dont pouvaient alors disposer les soldats du Génie.
La colonne érigée au point de départ de la nouvelle route pour commémorer cet heureux événement indique qu'elle fut officiellement ouverte à la circulation le 2 mai 1842.
Cette colonne commémorative avait été originairement placée beaucoup plus en avant de l'endroit sur lequel elle s'élève aujourd'hui. Elle a été ramenée en arrière pour des raisons d'esthétique et de symétrie dans l'ordonnance des rues du quartier.
La nouvelle route de l'Edough venait se greffer à la hauteur du centre du Palais Loucheur, sur le chemin qui allait vers la campagne, jusqu'à l'oued Forcha.
Ce chemin est aujourd'hui l'Avenue Garibaldi, tandis que la route de l'Edough est devenue la rue Sadi-Carnot.
Dès que la sécurité fut établie, des jardins s'égaillèrent tout autour, vers le pied de l'Edough, et vers le Ruisseau d'Or.
Les gens de la ville vinrent se promener, le dimanche, dans cette banlieue naissante qui s'offrait si bien à des pique-niques et autres ébats sur l'herbe.
Les soirs de ces journées vécues en pleine nature, dans la verdure et les fleurs, sous le beau ciel bleu tout baigné de soleil, le retour à la ville était forcément triste et douloureux.
Combien l'aimable et douce fatigue, causée par une journée de bonheur en plein air, devait devenir pénible et lourde dans ces rues montueuses et inégales qu'il fallait suivre pour regagner un logis étroit, incommode et souvent bien mal aéré.
C'est ainsi qu'a dû naître, dans l'esprit et le coeur des citadins, un désir, et même un besoin d'évasion et c'est ainsi que s'est formé l'embryon du plus grand et plus populeux faubourg de Bône.
C'est naturellement autour de la rue de fa Fontaine que prit corps la petite agglomération originaire qui devait devenir faubourg assez rapidement.
Cette rue de la Fontaine n'était pas très longue. Elle ne se poursuivait que sur cent cinquante ou deux cents mètres. Après, ce n'était qu'un simple sentier étroit et sinueux, sur les côtes duquel des maisons furent, plus tard, construites sans qu'on ait songé à en rectifier les courbes et les accidents, ce qui explique le tracé défectueux, et non rectiligne, de l'actuelle avenue Garibaldi qui, a succédé à la rue de la Fontaine.
La seconde artère du futur faubourg, fut la rue des Prés-Salés. Elle allait rejoindre un sentier qui a donné naissance à la route des Lauriers-Roses et qui se dirigeait vers le pied de la montagne en s'inclinant vers l'Ouest.
Plus tard, la conduite d'eau viendra déboucher entre la rue de la Fontaine et la rue des Prés-Salés.
Mais il n'y aura aucune maison construite sur la conduite d'eau proprement dite. Les constructions s'arrêteront au lavoir situé devant les immeubles du populaire Luc, le peintre-poète, chantre du faubourg.
Ces trois artères, qui sont encore parmi les plus importantes de la Colonne Randon, portent aujourd'hui d'autres noms.
La Conduite d'eau est devenue l'Avenue Célestin Bourgoin.
La rue de la Fontaine qui devait son nom à une grosse bâtisse de pierres maçonnées affectant vaguement la forme d'une fontaine d'où coulait une eau limpide et fraîche a pris celui de Garibaldi, le patriote italien qui vint, en 1870, mettre son épée au service de la France.
La rue des Prés-salés, enfin, fut remplacée au début de ce siècle par la rue Eugène François, pour honorer la mémoire et le sacrifice, en la personne d'Eugène François qui vécut et mourut dans ce quartier, après avoir été l'un des premiers colons de 1848, fameuse et lamentable épopée de la Colonisation de la plaine de Bône.
De ce carrefour, formé par les amorces des rues dont il vient d'être parlé, à la ville, il y avait bien près d'un kilomètre de distance, et il n'existait, tout d'abord, sur ce parcours aucune habitation, ni maison quelconque. Seule, plus tard, était venue se places vers le milieu de cette distance, une villa à un étage, d'assez belle apparence, construite par un fonctionnaire du Génie, M. Levron, qui faillit être la victime de sa propre famille militaire.
Le Génie, en effet, dans le nouveau tracé de l'enceinte de la ville, en 1868, avait compris dans la zone de servitude non edificandi établie autour des fortifications, la villa en question et ses dépendances.
L'immeuble était donc ainsi condamné à périr, lentement peut-être mais sûrement, car il était interdit à son propriétaire de procéder à toute réparation rendue nécessaire par la vétusté et les intempéries.
Mais, nourri dans le sérail, l'ancien garde du Génie en connaissait les détours. Il effectuait toutes les réparations, de l'intérieur, de sorte que l'immeuble put tenir debout pendant de longues années, assez longtemps, pour voir arriver le déclassement pur et simple, en 1905, de l'enceinte fortifiée de la ville.
La villa Lovron fut enfin vendue avec la parcelle de terre qui l'entourait et le nouveau propriétaire, M. Laurent Saunier, put en lotir son vaste terrain, ce qui permit la construction d'immeubles, dont le plus joli et, de beaucoup, le plus important est celui que l'on appelle le Palais Loucheur, et le percement d'une rue à laquelle fut donnée le nom de Laurent Saunier.
Ce carrefour, par où commence le populeux quartier (car il ne sied plus d'employer le mot faubourg) de la Colonne Randon est l'un des plus élégants et des plus mouvementés de la ville d'aujourd'hui.
Peu nombreux doivent être encore ceux qui ont connu, il y a un plus de cinquante ans, ces lieux alors lugubres et sinistres; où la sécurité était extrêmement précaire.
Le square Randon a pris la place d'un infâme marécage au milieu duquel étaient d'épais buissons de ronces, et quelques bosquets d'eucalyptus qu'on avait dû planter là pour tenter d'assainir les terrains.
Il subsiste quelques spécimens de ces arbres qui sont devenus énormes et imposants, contre la grille du square, à proximité du Palais Loucheur.
Un chemin passait sur un vieux pont de pierres noires, sales et lépreuses qui franchissait l'Oued Zaffrania, le même qu'a recouvert le boulevard Alexandre Papier.
Le vieux pont était bas et bien souvent le lit de l'Oued était à sec, ou presque, ce qui permettait aux malandrins et aux escarpes, en mal d'aventures, de l'utiliser pour attendre la venue de quelque passant attardé.
Des troncs d'eucalyptus, épais et sombres, sur le bord du chemin, derrière lesquels pouvaient se dissimuler des hommes aux aguets ; de hauts buissons de ronces, masses noires et inquiétantes entre les troncs d'arbres ; ce vieux pont à l'allure douteuse et traîtresse ; la lune blafarde qui mettait de vagues reflets lumineux et tristes sur la surface glacée des eaux immobiles des marécages et les coassements monotones et lancinants des grenouilles, tel était, le soir, l'aspect sinistre de ces lieux, si élégants et si vivants aujourd'hui.
C'est l'exposition de 1890, installée hors de l'enceinte de la ville, dans ces terrains incultes et affreux, sur l'initiative de la première Municipalité Jérôme Bertagna, qui a permis la transformation radicale et si heureuse de ces lieux nauséabonds et sordides jusqu'alors.
Cette exposition, la troisième manifestation de ce genre organisée à Bône depuis 1832, a certainement été la réussite la plus complète des initiatives économiques locales.
Rien ne manquait : grand festival musical avec concours où parurent une trentaine de sociétés d'Algérie et même de la Métropole, fournées de courses et de fantasias, fêtes indigènes, régates et réjouissances nautiques, et tant d'autres attractions et festivités, telles que le séjour de l'escadre en visite, bals, réceptions de toutes sortes.
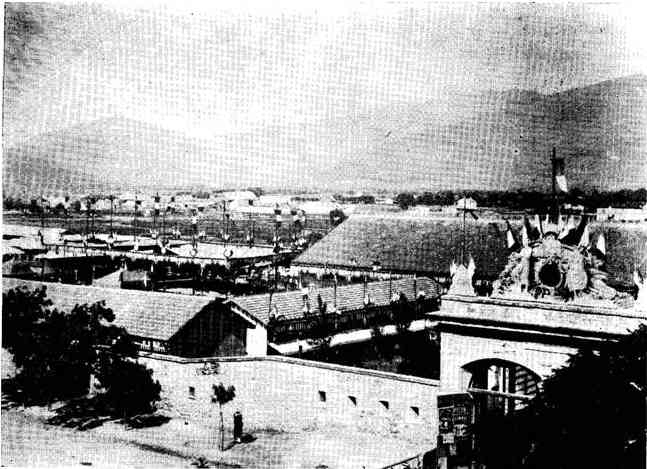 Vue générale de l'exposition prise par dessus les remparts
Vue générale de l'exposition prise par dessus les remparts
Les stands, nombreux, de firmes commerciales, industrielles et agricoles d'Algérie et de la Métropole occupaient une vaste superficie à l'arrière-plan des jardins qui ont formé, après que cette grande manifestation économique régionale eut pris fin, le joli square dont le buste du Président Sadi-Carnot, assassiné à Lyon, quatre années plus tard, est venu orner l'entrée principale.
Le téléphone fit sa première apparition à Bône à l'occasion de cette exposition.
De l'exposition de 1890, il ne reste que ce square magnifique. Il y a cependant encore dans un coin de ce jardin, sur la droite en entrant, un bloc énorme de minerai de fer qui avait été exposé, là, par la société des Mokta-el-Hadid et qu'elle a abandonné à cause des difficultés qu'aurait présenté son enlèvement.
Dans les pelouses, à l'entrée du square, de chaque côté du buste du Président Carnot, on peut voir encore deux gros fûts de bois recouverts de lierre et de glycines.
Ce sont les bases de deux bigues immenses au bout desquelles flottaient les oriflammes qui ornaient l'entrée de l'exposition.
LA VIEILLE EGLISE DE LA COLONNE
Le faubourg, ne s'est étendu, tout d'abord, que fort timidement vers le nouveau chemin de l'Edough qui formait sa limite extrême à l'est.
Aux environs de 1860, sa formation subit une poussée appréciable. De nouvelles maisons vinrent combler des vides, et la petite artère transversale qui allait aboutir à l'Eglise prit alors sa forme définitive, tandis que s'ouvrait, perpendiculairement à cette artère, une ruelle qui devait porter d'abord le nom de " Poujolat " et celui de " Gonssolin " ensuite, après avoir été, à sa création, dénommée par le populaire, la " rue des Ours " sans doute parce que ses habitants semblaient avoir voulu vivre là, à l'écart du mouvement et du bruit.
Dans cette petite rue étroite et sans prestige dont il vient d'être question, qui a porté le nom de " Docteur Mestre ", vieux praticien militaire, émule de Maillot, qui se fixa définitivement dans notre ville, et qui s'appelle aujourd'hui " rue du Sergent Allmann ", les habitants du faubourg avaient placé leur Eglise.
C'est une petite Eglise qui s'accordait avec la petite rue, humble et simple comme elle.
Son règne sur les fidèles du faubourg ne dura qu'un demi-siècle à peine.
Les inondations et les intempéries eurent raison d'elle. D'affreuses lézardes firent ouvrir ses murs, bas et tristes, qui n'avaient certainement nul besoin pour inspirer du dehors la pitié, de ces affreuses morsures du temps.
Comme elle s'effritait tous les jours un peu plus, que les lézardes ouvraient de plus en plus ses murs mal construits, et qu'il était inutile de songer à y effectuer des réparations, une nouvelle Eglise fut édifiée, au début de ce siècle, entre l'avenue Garibaldi et l'avenue Célestin Bourgoin, sur un terrain gracieusement offert par les héritiers de cet ancien Maire de Bône.
 Le hall central de l'exposition
Le hall central de l'exposition
A droite, un des deux écus qui encadraient l'entrée
La vieille et humble Eglise dont il ne reste plus la moindre trace, était au coin que formaient la petite rue que l'on appelait alors rue de l'Eglise, et la route de l'Edough.
Son porche, sans parvis, s'ouvrait directement sur la petite rue, de plain-pied, sans aucune marche à gravir et la chausse était caillouteuse.
A l'intérieur, le sol était en contrebas du seuil, ce qui démontrait que le niveau de la rue avait été surélevé postérieurement à la construction de l'édifice.
Dans la pénombre qu'éclairaient à peine de bien modestes vitraux de couleurs, aucun apparat, aucun faste, n'attiraient le regard des fidèles, ne les divertissaient de leurs prières ou de leur recueillement.
Tout était simplicité, silence et onction. Tout paraissait irréel.
Sous cette nef trop basse, entre ces murs trop étroits, on éprouvait cependant une impression de grandeur, d'infini.
Ce n'était qu'une humble Eglise de faubourg, mais on sentait planer sous sa voûte, dans l'air immobile qui semblait inchangé, les mânes du Passé. Ces tableaux sans art, ni particularité qui rappelaient les stations du Chemin de Croix de Jésus, devaient évoquer dans l'âme des Français qui venaient là, demander à Dieu, d'empêcher que leur courage ne faiblit, un autre Calvaire qu'ils avaient gravi, eux aussi, et gravissaient peut-être encore, pour demeurer dans ce pays qu'ils entendaient conserver à la France.
Car ce vieux faubourg avait été créé et peuplé pendant longtemps presque uniquement par les premiers Français qui s'étaient fixés à Bône.
Ils formaient, alors, comme une grande famille parfaitement unie, vivant dans le calme, loin du bruit et du mouvement de la Ville, où le cosmopolitisme particulier aux ports méditerranéens commençait à troubler la tranquillité des habitants.
Le Curé le plus populaire de cette faubourienne paroisse fut incontestablement l'Abbé Montastruc qui devint ensuite Curé de la Cathédrale, et mourut fort âgé dans ses fonctions. Il avait su conquérir l'estime et même l'affection de tous les habitants de Bône, sans aucune distinction de race ni de religion, qu'il avait séduits par sa belle figure intelligente et loyale, sa bonhomie souriante et sa verve languedocienne et familière.
 Ancienne église et maison natale du Maréchal JUIN
Ancienne église et maison natale du Maréchal JUIN
C'est dans cette modeste paroisse que le 23 janvier 1889, fut baptisé par l'Abbé J. Compayrot, qui avait succédé à l'Abbé Montastruc, Alphonse Pierre Juin, Maréchal de France qui était né le 16 décembre 1888, juste en face de l'Eglise, à l'angle de la route de l'Edough, et de la rue de l'Eglise prolongée.
Quelle gloire aurait été pour la vieille Eglise, si elle n'avait été complètement détruite, ce souvenir du baptême de l'illustre soldat.
Tout a disparu, hélas, de ce vieux sanctuaire si aimé des Colonnois, jadis.
 Les portes de la Colonne au moment de l'exposition
Les portes de la Colonne au moment de l'exposition
Les jeunes gens qui jouent dans le terrain de basket-ball, aménagé sur son ancien emplacement, ne se soucient certainement pas du passé, plein de fervente piété, qu'ils foulent de leur pied agile, et ne perçoivent nullement le parfum d'encens dont, peut-être encore, est imprégné l'atmosphère.
Bien avant qu'elle ne finit, tout à fait son existence matérielle et terrestre, alors que ses murs étaient encore debout, quoique lézardés et branlants, la vieille Eglise avait été remplacée par un nouveau temple, de construction et de style modernes, élevé sur une jolie place et dans un quartier populeux.
Le nouveau clocher, élégant et fier, faisait un contraste singulier avec la vieille tour massive, sans style bien défini, qui écrasait le porche dénué de prestige de la rue de l'Eglise.
Les quatre côtés du vieux clocher étaient percés d'ouvertures garnies de claires-voies, où le vent passait en toute liberté. Sans doute cela était pour permettre aux sons de la petite cloche enfermée là, de mieux se propager et s'éparpiller dans le ciel à travers le faubourg.
Ce vieil édifice délabré, tout noirci par le temps qu'une mousse verte recouvrait par plaques comme une lèpre affreuse, imposait quand même, malgré sa disgrâce, un indéniable respect.
Toute la population du faubourg, pendant un demi-siècle, était passée sous sa voûte trop basse qui maintenant menaçait de s'écrouler.
Ceux qui naissaient, ceux qui mouraient et ceux qui espéraient étaient venus là, dans une égalité qui ne s'écrit pas aux frontispices des monuments publics, et qui n'en est pas moins certaine et juste parce qu'elle est imposée par Dieu.
L'Eglise désaffectée n'était pas encore abattue que déjà la " rue de l'Eglise ", sa rue durant cinquante ans, était débaptisée et devenait la " rue du Docteur Mestre ".
Ainsi, elle avait assisté à sa totale et complète déchéance, à sa chute dans l'oubli définitif. C'était bien cruel et surtout bien injuste.
Son souvenir au moins aurait dû demeurer en ces lieux où elle avait si longtemps trôné, où elle avait été aimée et vénérée.
Il aurait suffit, pour cela, d'ajouter à ce nom si familier aux Colonnois, un simple qualificatif, et la rue se serait appelée " rue de l'Ancienne Eglise ". Peut-être réparera-t-on, un jour, cette erreur ? Ce serait juste, car la vieille Eglise dont la modeste cloche appelait les fidèles par dessus les marécages, et que les inondations envahissaient inexorablement et sans respect, méritait que son souvenir fut maintenu à travers le temps, pour j'aide spirituelle, et l'apaisement intérieur, qu'elle avait apportés aux premiers Bônois, et aussi à cause du grand Soldat qui y reçut le baptême.
Il y a d'autres noms de rues qui sont des hommages à d'anciens citoyens qui, certes, les ont mérités, mais qui n'ont pas fait pour l'union des Français du siècle dernier, et le maintien de leur Foi dans l'avenir de la Cité, ce que représentait à ce point de vue, la vieille petite Eglise de la Colonne.
Lorsqu'il s'était agi de donner un nom à ce faubourg né du groupement spontané de petites " campagnes " qui s'était formé le long du chemin de la Fontaine, après l'ouverture de la route de l'Edough, les habitants n'avaient eu qu'à s'inspirer de la Colonne qui avait été érigée pour commémorer l'heureuse initiative du Général Randon.
Ce n'est donc pas par une décision d'un Conseil municipal ou d'une édilité quelconque, que ce Faubourg fut ainsi dénommé.
Le Conseil municipal de Bône ne songea, que bien plus tard, à rendre l'hommage qui était dû à celui que ses contemporains avaient appelé le " Père de Bône ".
En 1868, l'établissement de la nouvelle enceinte de la Ville avait coupé le chemin que suivaient habituellement les Colonnois, lorsqu'ils venaient aux " Allées " pour assister aux concerts des musiques militaires, ou bien en Ville pour y faire leurs achats.
Ce chemin, ou plutôt ce sentier, partait de l'emplacement actuel du Palais Loucheur (où se dressait alors la colonne commémorative) et aboutissait à la Cathédrale. Il suivait à peu près le tracé actuel des " Allées Guynemer ".
Par suite de la construction du mur d'enceinte et de la création de la nouvelle Ville, seule la partie de ce sentier qui s'était trouvée ainsi " intra muros " avait été conservée et intégrée dans le réseau des rues nouvelles de la Cité agrandie.
La Municipalité en avait fait une artère d'assez belle allure bordée par de grands frênes, à laquelle le Conseil municipal avait donné le nom " d'Allées Randon ".
Cet hommage rendu au " Père de Bône " n'eut malheureusement qu'un temps.
Lorsque pendant la guerre de 1914-1918, on voulut honorer la mémoire du célèbre Capitaine aviateur de 23 ans, Guynemer, véritable héros national, tombé dans un combat aérien, on ne trouva rien de mieux en effet que de changer les " Allées Randon " en " Allées Guynemer ".
La route de l'Edough fut pendant un certain temps la limite à l'Est, de l'agglomération faubourienne.
Elle s'y incorpora, bien après 1850, par la construction d'immeubles sur ses bords.
Il avait été question de faire de cette route, dans sa traversée du Faubourg, une large et belle avenue avec de beaux trottoirs et de grands arbres.
Les constructions devaient être édifiées suivant un alignement beaucoup plus en retrait que celui que l'on voit actuellement.
Hélas, si ces suggestions ont été suivies par quelques propriétaires épris d'esthétique, la majeure partie de ceux-ci refusa de s'y conformer.
Chacun agit selon sa fantaisie, ou son intérêt, et le projet des urbanistes bien pensants n'eut aucun succès et dut être complètement abandonné finalement.
Le joli boulevard ou la belle avenue que des rêveurs avaient projeté d'établir à la place de la route de l'Edough ne fut donc qu'une utopie de plus, et la route de l'Edough ne devint qu'une simple artère, sans beauté, ni cachet particulier.
La seule modification apportée à l'ancien état de chose fut que la " rue de l'Edough " remplaça la " Route " du même nom.
En 1894, en même temps que l'on plaçait le buste de l'infortuné Président de la République, assassiné à Lyon, à l'entrée du square qui venait de succéder à l'Exposition, la rue de l'Edough devint la rue Sadi-Carnot.
Elle prit une telle importance que la rue de la Fontaine qui n'était pas encore l'Avenue Garibaldi, passa au second plan.
Le Faubourg enjamba la rue de l'Edough et s'étendit légèrement vers l'Est, sans dépasser, toujours, le lit du Zaffrania.
La rue Petitjean qui aboutissait à la petite chapelle Sainte-Anne et qui portait le nom du propriétaire des terrains qu'elle desservait, autour de la Chapelle Sainte-Anne, devint la Burdeau du nom d'un président de la Chambre des Députés.
Puis, le Zaffrania fut recouvert, et le boulevard Alexandre Papier fit disparaître la barrière qui s'opposait à la continuité de l'extension du Faubourg vers l'Est.
Le vieux pont de pierres disparut à son tour, comme conséquence de la couverture du Zaffrania, ce qui permit à l'entrée du Faubourg de devenir plus spacieuse et plus belle.
Les Colonnois n'avaient pas attendu ces heureuses transformations pour faire de leur Faubourg un lieu de distractions et de gaieté.
Il y avait des ginguettes accueillantes et nombreuses, et des cafés où l'on dansait souvent les samedis et les dimanches.
Il y eut même un café chantant, un beuglant, comme on disait, sous une tonnelle dans la rue de l'Edough à l'angle de la rue Docteur Teddé.
II y avait aussi des jeux de boules, un peu partout, à l'entrée du Faubourg, aux quatre chemins, et ailleurs.
Il y avait surtout, la grande fête patronale du Faubourg qui attirait à la Colonne toute la population de la Ville. Tous les fêtards et les noceurs venaient danser, gambader, chanter et rire.
Sainte-Anne, la Patronne du Faubourg, à qui une petite chapelle, toute simple, avait été élevée sur le bord du Chemin de Ceinture, était devenue aussi populaire que Saint-Augustin l'avait été chez les tout premiers Bônois.
La fête de Sainte-Anne dépassa bien vite en éclat, et en popularité, celle de Saint-Augustin.
La Colonne avait aussi son poète, ou plutôt son chansonnier, car on sait qu'en France, tout se traduit ou finit par des chansons.
Ce poète s'appelait Luc et il était peintre en bâtiment et propriétaire d'immeubles à l'orée de la conduite d'eau. Il s'appelait Luc, coïncidence bizarre, comme Saint-Luc qui était peintre aussi, paraît-il. Mais l'Evangile du Saint n'était pas le même que celui que prêchait le peintre colonnois.
Celui-ci était plus épicurien, et ne visait qu'aux plaisirs terrestres et matériels. Le Faubourg était son paradis.
Ses refrains étaient populaires, ils chantaient la joie, le plaisir et l'agrément du Faubourg.
Le plus connu, celui que l'on entendait à tout bout de champ, à toute heure, et en n'importe quelle circonstance, était certainement celui-ci
" On s'en donne... "
" A la Colonne
" On s'en donne
" On s'en donne... "
C'était bien naïf, comme on voit ; les vers, certes, n'avaient rien de ceux de José Maria de Hérédia ou de Sully Prud'Homme. Mais le peintre était plus heureux de les avoir écrits, qu'il n'avait dû être fier, dans sa jeunesse, de son premier coup de pinceau.
La Colonne Randon est aujourd'hui une vaste agglomération qui s'est rapprochée du centre de la Ville et s'est même confondue avec celle-ci.
Elle escalade les premières pentes de l'Edough, et va si loin, que les chacals qui venaient, au début de ce siècle, jusqu'au carrefour des quatre-chemins, troubler, par leurs cris hargneux, le sommeil des gens du quartier, n'osent plus quitter leurs broussailles.
Il y a tant de maisons nouvelles qu'il n'est plus possible de trouver un emplacement pour célébrer la fête annuelle de Sainte-Anne comme autrefois.
Finis donc les bals endiablés, et les flonflons des orchestres qui n'arrivaient pas à couvrir les coins-coins des " z'oies canards " et les appels des marchands forains.
Pour retrouver des bals en plein air, les amants de Terpsichore doivent désormais accomplir des dizaines de kilomètres sur les routes alentour de Bône.
Il est vrai qu'ils ont des automobiles...
La Colonne qui est toujours une réalité vivante, n'est plus la Colonne d'autrefois.
Ce sont bien toujours les mêmes quartiers peuplés, remuants et bruyants, mais il y manque les rires, les apostrophes et le lazzi d'autrefois.
II y manque aussi cette estime réciproque qui liait les uns aux autres, sans aucune considération de classe, tous les habitants du Faubourg, et donnait à cette collectivité un peu turbulente peut-être, l'aspect d'une grande famille.
Il y manque, surtout, cette vieille âme Bônoise qui paraissait avoir élu domicile dans ce Faubourg où le simple passant, le nouveau débarqué, l'étranger à la Ville, ne se sentait jamais chez lui et ne cherchait pas à s'y loger, tant il comprenait qu'il ne serait jamais qu'un intrus parmi ces vieux du pays.
| |
BÔNE MILITAIRE
du CAPITAINE MAITROT
Envoyé par M. Rachid Habbachi N° 12
|
Bône Militaire
44 SIÈCLES DE LUTTES
du XXIV ème avant au XX ème Siècle après notre ère
Médaille de Bronze à l'Exposition Coloniale de Marseille 1906
Médaille d'Argent de la société de Géographie d'Alger 1908
Deuxième Partie
BÔNE FRANÇAISE
CHAPITRE XII
LA PRISE DE LA CASBAH
26 Mars au 8 Avril
Le plus beau fait d'armes du siècle
(Maréchal Soult).
J'ai laissé le capitaine D'Armandy au moment où le 26 mars, il abordait, avec la felouque la Casauba, la goélette, la Béarnaise, retour de Tunis.
Après avoir raconté sur le pont de la goélette, ce qui s'était passé depuis le départ de cette dernière, d'Armandy demanda au capitaine Fréart de réunir les officiers dans le carré. Là, il leur exposa la réponse que le capitaine Alliez avait fait à sa demande et leur adressa la même proposition.
Le capitaine Fréart, d'esprit très calme et très rassis, envisagea froidement la situation et dit au consul qu'il lui donnerait une réponse définitive quand il aurait eu une nouvelle entrevue avec Ben Aïssa.
Le consul partit aussitôt.
Ecoutons maintenant le récit du lieutenant du Couëdic de Kergoualer.
" Après le départ de M. D'Armandy, le capitaine Fréart m'appela dans sa chambre, ainsi que l'élève de première classe de Cornulier-Lucinière, et il nous demanda si nous étions décidés à exposer notre vie pour notre pays ; et que dans ce cas, il nous désignerait pour diriger le détachement qui serait placé sous les ordres du baron d'Armandy.
" Nous reçûmes cette nouvelle avec un bonheur inexprimable et nous embrassâmes le capitaine Fréart, avec un sentiment profond de reconnaissance et de joie.
" Vingt-quatre hommes choisis furent désignés, puis armés avec les douze fusils et les douze sabres d'abordage qui composaient l'armement de la goélette. A peine, la nouvelle s'était-elle répandue dans l'équipage que nous avons été entourés ; chacun demandant à marcher, c'était un enthousiasme indicible.
" Nous fûmes même obligés d'employer toute notre autorité pour arrêter ces éclats de joie, ces cris de bonheur car ils auraient pu être entendus du rivage. Ceux qui n'avaient pas été désignés se lamentaient. L'un d'eux s'approcha de moi en versant des larmes.
" Que vous ai-je fait, lieutenant, pour me laisser en arrière, quand il faut se battre ! "
" Mais évidemment il fallait bien laisser à bord de bons matelots pour manoeuvrer la goélette en cas de mauvais temps et même pour la défendre, si besoin en était.
" Le capitaine invita tout l'état-major à dîner et arrosa l'enthousiasme général avec du champagne.
" Yusuf se montrait d'une gaieté folle " Nous allons se battre ensemble ", s'écriait-il et il sautait au cou de tout le monde ".
Le capitaine d'Armandy en arrivant à terre apprit que le muphti venait d'être envoyé à Constantine. On ne s'explique pas cette façon d'agir de Ben Aïssa, étant donné que le muphti avait été l'âme du complot et que c'était lui qui avait ouvert la porte de la mosquée, le 4 mars.
Le consul fut reçu par Ben Aïssa (l'une façon inattendue ; quoique le général se montrât toujours très courtois vis-à-vis du capitaine, il lui dit que si la Casbah ne se rendait pas ou si lui-même ne la lui remettait, grâce à son autorité sur les Turcs, le lendemain à dix heures, il s'en emparerait de vive force ; dans ce cas, tous les occupants seraient massacrés, tandis qu'en cas de reddition, la garnison aurait la vie sauve.
Le consul, malgré l'ennui que lui causait le projet de Ben Aïssa, ne pouvait que se féliciter d'être venu le trouver car, sans cet avertissement, il aurait pu ne se rendre au château que le lendemain matin et trouver les murailles garnies par les Arabes, ce qui eut de beaucoup compliqué la tâche qu'il s'était imposée.
Après cette entrevue qui avait duré fort longtemps, d'Armandy se rendit à bord de la goélette où l'on était très inquiet de son sort.
Toutefois, avant d'aller occuper la Casbah, encore fallait-il s'assurer des dispositions des Turcs et ne pas s'aventurer à l'aveuglette dans une entreprise dont l'issue pouvait être fatale et au détachement et au protégé de la France.
MM. d'Armandy et Yusuf avec une froide intrépidité, quittèrent le bâtiment, à huit heures du soir, et se rendirent au fort où ils furent reçus dans la même salle et avec le même cérémonial que la première fois, moins le salut du canon.
Ibrahim, très sombre, leur demanda le motif de leur visite ; le consul exposa ce qu'il avait fait dans la journée, son entrevue avec Ben Aïssa et les projets de ce dernier, l'arrivée du Pélican et l'autorisation que ce vaisseau avait de le ramener à Alger ; mais il n'avait pas voulu abandonner ses amis, les Turcs, à leur triste sort, aussi avait-il refusé de partir et il venait vaincre ou mourir avec eux.
Il termina en rappelant à Ibrahim la promesse qu'il lui avait faite de livrer le fort quand le général en chef le lui demanderait : le moment était venu et s'il le voulait, il pouvait se retirer lui et sa famille à bord où il serait traité avec tous les égards dus à un hôte de la France.
Ibrahim remercia des bons procédés que l'on employait vis-à-vis de lui, mais il ne voulait pas abandonner ses hommes et à moins que la goélette ne voulût les recevoir tous, il ne quitterait pas son poste.
D'Armandy répondit qu'il était impossible d'emmener tout le monde et que, dans cette circonstance, il n'y avait qu'à remettre la Casbah au général français qu'il représentait et que lui même saurait faire respecter le nouveau pavillon. Alors, dit le lieutenant du Couëdic, qui tint le récit de lui-même :
" Ibrahim lui saisissant (au capitaine d'Armandy) le bras avec force, s'écria d'une voix de tonnerre : " As-tu jamais cru, chrétien, que je serais assez lâche pour livrer nia citadelle à des infidèles et que je me mettrais sous tes ordres ? Je te l'avais promis, c'est vrai, mais aujourd'hui je ne puis me déshonorer et tu me proposes mon déshonneur ?
" Je ne crains point Ben Aïssa et tous ses Arabes. J'ai de la poudre et des boulets ; s'il l'emporte, il ne trouvera qu'une citadelle en cendres et une ville brûlée. "
Les Turcs se précipitèrent alors sur leur chef pour le poignarder ; celui-ci dut son salut à l'intervention des deux Français. Le capitaine d'Armandy fut à son tour menacé, surtout quand, exaspéré du mauvais vouloir des Turcs, il leur cria :
Lâches que vous êtes, vous méritez bien le sort qui vous attend. Je vous abandonne à votre destinée " et ce fut à grande peine que les deux officiers purent regagner la goélette vers minuit.
Le capitaine d'Armandy se rendit ensuite à bord de la Casauba qu'il fit rapprocher du rivage.
À une heure et demie, un Turc arriva à bord, disant qu'Ibrahim avait tiré sur ses hommes et que ceux-ci l'avaient arrêté et mis aux fers sous la garde de quatre Arabes.
Le consul le renvoya à terre avec mission de prévenir la garnison de son arrivée, puis il se rendit à bord de la goélette et, après avoir vu le capitaine Fréart, se fit conduire à terre par sa chaloupe.
Le capitaine Yusuf lui demanda l'autorisation de monter à la Kasbah pour voir ce qu'il en était : il était deux heures du matin.
La Béarnaise, après avoir appareillé, vint s'embosser au pied du rocher du Lion et mit à terre le détachement qui devait occuper le fort. A peine fut-il débarqué que le capitaine d'Armandy le rejoignit en disant que Yusuf était à la Casbah, où il n'y avait plus de vivres. Les canots en retournant à bord portèrent celle nouvelle au capitaine Fréart, en lui demandant d'envoyer des approvisionnements.
Le détachement était composé du :
Capitaine d'Armandy, commandant ;
Lieutenant de frégate Du Couëdic de Kergoualer.
Elève de première classe de Cornulier-Lucinière.
Maréchal des logis Colomt,
Vingt-quatre matelots.
Maréchal des logis Charry.
Un mousse tambour.
Ce qui faisait 31 hommes avec le capitaine Yusuf.
La tenue était la capote, le casque, le pantalon de drap, la couverture roulée sur le sac ; en emportait trois jours de vivres et 60 cartouches par homme ; les armes étaient 12 fusils, 12 sabres plus un fusil de chasse à l'élève de Cornulier-Lucinière.
Il restait à bord 3 pistolets, .5 sabres, 12 piques et l'artillerie.
Le débarquement se fit à la pointe du jour, au moment où Ibrahim après avoir corrompu ses gardiens, réussissait à s'échapper dans la montagne.
Le détachement prit, en se défilant, pour direction le bastion Nord-Est de la Casbah, caché aux vues de la ville.
A peine fut-il en marche, qu'il fut coupé de la mer par une nuée de cavaliers qui n'attaquèrent pas, il est vrai ; on fit halte à mi-chemin pour souffler un peu.
Ces quelques indications permettent de déterminer d'une façon précise le chemin suivi.
Le débarquement se fit au nord du rocher du Lion, car ce rocher se trouve à l'extrémité d'une avancée de terre dans la mer et si le débarquement s'était fait au sud, c'eut été de la folie, car on était en vue de la ville.
On débarqua donc au lieu dit actuellement " Lever de l'Aurore ". On suivit un chemin défilé et I'on s'arrêta à mi-côte, c'est donc par le ravin qui se trouve entre les batteries du Lion, le cimetière indigène et la batterie des Caroubiers. L'arrêt se fit à la fontaine de l'Esclave qui se trouve exactement à l'extrémité de ce ravin et l'élève de Cornulier-Lucinière dit dans sa relation:
" Les pentes étaient raides et la marche se trouvait retardée par les hautes herbes. "
Ces hautes herbes devaient se trouver au fond du ravin, et si les pentes étaient raides, on pourrait ajouter qu'il faisait chaud, car il ne faut pas oublier que l'affaire eut lieu à la fin de mars ; il était donc naturel que l'on s'arrêtât à la fontaine. Puis on monta à la Casbah et l'on se dirigea sur la quatrième embrasure à droite (1) du bastion Nord-Est, c'est-à-dire en pleine face Nord.
A la quatrième embrasure, donc on trouva Yusuf. Celui-ci fit descendre une ficelle à l'aide de laquelle il remonta une corde à noeuds et l'escalade commença pendant que par la cinquième embrasure, on faisait monter les sacs.
Aussitôt sur le terre-plein, les matelots se rangèrent sous les ordres de M. d'Armandy à qui les chefs de la Casbah vinrent faire leur soumission.
C'étaient : Hussein, bachaouch des Turcs, caïd Omar et Ibrahim-Aga, ses lieutenants, et Kalib bachaouch tobji ou, comme son titre l'indique, chef des canonniers et commandant en même temps des 25 Arabes de la Casbah.
On se rendit ensuite au mât de pavillon qui était au bastion à gauche de la porte, où il est d'ailleurs encore actuellement, le pavillon rouge fut amené et remplacé par le pavillon tricolore ; les matelots présentaient les armes, le mousse battait " Aux Champs ".
Yusuf dit alors en turc à la garnison : " Musulmans, dans le grand danger où vous êtes, vous venez d'appeler les Français à votre aide, ils sauront vous tirer d'embarras ; à partir de ce moment, vous êtes à la solde (2) de la France et si quelqu'un n'est pas content, nous lui couperons la tête. "
Ce discours simple et sans artifice eut un plein succès, les Turcs ou du moins la plupart d'entre eux déchargèrent leurs armes en l'air en signe de joie et un boulet en passant par dessus la ville, alla siffler aux oreilles de Ben Aîssa, que le sort en était accompli et qu'il allait avoir affaire à des adversaires autrement redoutables que les bandits d'Ibrahim. Furieux, le général se vengea sur les Bônois dont les cris de détresse montèrent jusqu'à la Casbah.
Malgré ce succès, la situation était très difficile pour les Français. Le capitaine d'Armandy s'en aperçut après avoir visité la Casbah. Il disposait de 13 pièces et de grandes provisions de poudre et de boulets. Mais les canons étaient rouillés, les roues carrées des affûts à moitié brisées, les lumières déchiquetées ; la porte de la forteresse, contre laquelle, de son aveu même, Ben Aïssa devait tirer pour faciliter son attaque, était à peine solide, une méchante traverse servait à la tenir fermée. Voilà pour les dangers du dehors.
Pour les dangers du dedans, les Français étaient entourés de 130 Turcs, mais les uns étaient à peine soumis et les autres franchement hostiles, de plus, les vivres manquaient totalement.
Mais aussi bon organisateur qu'intrépide soldat, le capitaine d'Armandy prévit à tout. Pendant que les officiers de marine faisaient dresser un mât qui, au moyen d'une convention de signaux et du vocabulaire télégraphique du bord, devait servir à communiquer avec la Béarnaise qui d'ailleurs pouvait surveiller toutes les pentes, à cette époque complètement déboisées, et que les maréchaux des logis, reprenant leur rôle d'artilleurs, faisaient disposer des piles de boulets auprès de chaque pièce remise d'aplomb et installaient un atelier de gargousses et de cartouches, le capitaine organisait le service.
Les Turcs étaient mis à la porte des logements et du bastion Nord, réduit dominant toute la citadelle et dont les clefs furent remises au commandant du fort. Ils devaient tous passer toute la journée et la nuit sur les remparts, surveillés par des sentinelles françaises qui avaient l'ordre d'abattre qui ferait mine de flancher ou de communiquer avec l'extérieur.
Un poste de marins était placé à ce bastion Nord, un autre à la vieille mosquée ; la porte était étançonnée et barricadée ; le capitaine Fréart était invité à envoyer des vivres ; le capitaine Yusuf et les deux officiers de marine prenaient des quarts de quatre heures et faisaient des rondes accompagnés d'un maréchal des logis ou du second maître Daunac et d'un officier et d'un sous-officier indigènes; l'état-major composé des officiers français et turcs et des sous-officiers français était logé au réduit.
Peu après l'occupation, un cavalier vint sous les murs, demandant ce que signifiait ce changement de pavillon. Le commandant répondit que n'ayant pu amener Ibrahim à se soumettre, il occupait le fort en attendant les ordres du duc de Rovigo.
Le cavalier partit et revint peu après, porteur d'une lettre de Ben Aïssa qui fut montée dans un panier descendu le long du rempart. Cette lettre disait :
" Consul, tu m'as trompé, lorsque j'avais mis ma confiance en toi. Mais avec l'aide de Dieu, j'espère bientôt t'en faire repentir. "
Le capitaine d'Armandy répondit :
" Je ne peux t'avoir trompé, car je ne t'ai rien promis, si ce n'est de faire mon possible pour ne pas m'éloigner et continuer nos bonnes relations ; c'est ce que je suis toujours prêt à faire. "
Le cavalier ajouta que Ben Aïssa désirait avoir une entrevue avec te consul ; le capitaine Yusuf répondit : " Dis à ton maître de venir lui-même s'il a quelque chose à nous dire. ".
Le cavalier reprit :
" Mon Seigneur n'est pas fait pour venir vous parler lui-même.
" Crois-tu, mal appris, que le commandant de la Casbah soit son inférieur, riposta Yusuf.
" Eh bien, tâchez de vous défendre, puisque vous savez si bien dire des impertinences. "
Le commandant du fort fit immédiatement pointer ses pièces sur la batterie cachée dont il connaissait l'emplacement.
A ce moment, trois cavaliers vinrent examiner le terrain ; le maréchal des logis Colomb pointa lui-même une pièce de 16 dont la lumière n'était plus qu'un trou informe et coupa en deux le cavalier du milieu, en même temps qu'une pluie de fer venant du fort et de la Béarnaise couvrait toutes les pentes desquelles les Arabes disparurent comme par enchantement.
Aussitôt, quarante Turcs, fidèles, descendirent par la corde au-devant des marins du capitaine Fréart et rapportèrent, deux heures après, 20 jours de riz, biscuit, farine et boeuf salé, pendant que les matelots de la goélette enclouaient les pièces de deux fortins de la côte.
Restait à régler le service intérieur. Les Français devaient toujours être armés et ne jamais se déshabiller.
Le mousse devait battre la diane et la retraite, aux champs au moment où l'on hissait les couleurs, la soupe et la générale en cas d'alerte. Les repas étaient pris par groupes. Les officiers français et indigènes avaient une gamelle, les sous-officiers français et indigènes une autre, mais tous dans la même chambre ; les marins mangeaient dans leurs corps de garde, les Turcs sur les remparts où on leur portait leur pitance ; la cuisine était faite par deux négresses, le service par deux jeunes Turcs et le mousse.
Passons un peu en revue les officiers turcs :
Hussein le bachaouch, homme de grande taille, vigoureux, laid et sale, affectait de parler avec poids et mesure. Dès le premier jour, Yusuf lui déclara amicalement qu'en sa qualité de chef, il aurait à répondre sur sa tète de la conduite de ses camarades ; Hussein promit d'être fidèle et il a loyalement tenu sa parole en se montrant toujours vaillant soldat et à l'occasion, homme de bon conseil.
Caïd Omar, excellent petit homme à barbe longue et rousse, hardi et influent, jouissait d'une haute réputation de justice. Il avait été cadi à Bône pendant 15 ans et se montra par la suite tout dévoué aux intérêts français jusqu'au jour où il fut glorieusement tué dans nos rangs.
Ibrahim-Aga était un grand et bel homme, extrêmement velu, à la figure grave et triste ornée d'une superbe barbe rouge, prenant volontiers les grands airs d'un pacha. Il s'est montré froid, réservé et dans la suite fort brave ; son air important lui valut des matelots, dès le premier jour, le sobriquet de " Roi de Carreau " qu'il garda.
Kalib, maure fin et rusé, d'une figure très expressive, grand ami du bey Ibrahim, ennemi juré des chrétiens, était soupçonné par les Turcs d'être un traître ; du reste, bon canonnier, ignorant et hardi soldat, très influent sur les Arabes et fort mal disposé pour les Français. Yusuf ne le perdait pas de vue et sa tête paraissait être peu assurée sur ses épaules.
Leur costume était de mode turque et de couleurs sombres variant du noisette au brun foncé ; leurs turbans étaient rayés ; les jambes étaient nues, les pieds recouverts de chaussettes de laine et chaussés de babouches rondes ; à la ceinture, ils portaient des pistolets à pierre, un yatagan et un couteau à gaine. De plus, ils avaient un fusil arabe et une giberne et ne portaient aucun insigne de grade.
Parmi les Turcs, se trouvait un déserteur des zouaves à cheval d'Alger, qui avait servi sous les ordres de Yusuf et dont il devint par la suite l'âme damnée et l'exécuteur des hautes oeuvres, c'était le nommé Mustapha ; il couchait toujours devant la poudrière et Yusuf lui donnait chaque matin un douro.
Le capitaine faisait sa ronde avec une hache double surmontée d'une pique, décrochée de la panoplie d'Ibrahim et avait promis à toute sentinelle trouvée endormie, de !a précipiter du rempart.
La nuit se passa sans incident ; à chaque heure, se répétait le cri de la sentinelle française " Sentinelles, prenez garde à vous ".
Dans la soirée, la Casauba après avoir versé ses vivres à la Béarnaise partit pour Alger sous les ordres du raïs Mohammed, assisté du pilote provençal de la Béarnaise, elle emportait une lettre du capitaine d'Armandy (3).
La Casauba emmenait aussi la femme et les deux enfants d'Ibrahim Bey.
Le 28, la journée se passa sans incident. Dans la nuit un matelot cria " Aux Armes ". Prétendant avoir entendu marcher. On ne vit ni entendit rien mais on resta groupé sur le rempart.
A quatre heures du matin, le bruit recommença, le commandant fit tirer dans l'obscurité et l'on entendit le bruit d'une fuite. On retrouva des flaques de sang et trois échelles au pied du mur.
Ben Aïssa avait ordonné à tous ses les habitants, sans exception d'age ou de sexe, de se rendre dans son camp, il déclara que quiconque serait pris dans les rues, serait puni de mort. Puis il incendia la ville qui, en un instant, fut toute en flammes.
Les Turcs de la Casbah trépignaient de rage surtout le Caïd Omar qui avait laissé, dans Bône, sa femme et ses filles. Puis, ce crime consommé, Ben Aïssa leva son camp et se relira tranquillement derrière Hippone tandis que la Casbah n'osait tirer de peur d'atteindre les prisonniers. La ville brûla toute la nuit, puis l'incendie s'éteignit de lui-même.
Dans la matinée du lendemain, une sentinelle surprit un Turc essayant de descendre par une corde. Il fut conduit au commandant, auquel il dit vouloir retrouver une arme qu'il avait cachée. Il fut escorté par deux matelots qui avaient l'ordre de lui casser la tète s'il avait retenti. Le fusil fut retrouvé.
Peu après, des cavaliers très bien montés s'arrêtèrent au pied des remparts ; on lui dit qu'il y avait 300 français dans la Casbah ; ils offrirent du lait et des oeufs, puis filèrent à toute vitesse le long des murs. Quelques instants après, un Turc amena au commandant un zouave arabe qui avait causé avec eux.
Il avait dit, d'après le rapport de Caïd Omar : " La citadelle a été livrée aux chrétiens par les Juifs ; mais il y a ici bon nombre de musulmans qui sauront bien s'en défaire ".
Yusuf lui asséna un coup de sabre qui lui traversa la poitrine en lui disant : " Tiens ! Voilà du Juif ". L'Arabe se jeta aux genoux du capitaine en criant " Grâce, Sidi Yusuf ". Un second coup de sabre lui ouvrit le ventre.
Il s'enfuit en tenant ses entrailles, Yusuf le poursuivant sauta derrière lui un mur de six pieds pendant que les sentinelles françaises et turques tiraient sur le fugitif et lui envoyaient sept balles dans le corps ; quand il fut rejoint par le capitaine, il lui lança une pierre ; le projectile évité, Yusuf lui ouvrit le crâne, et un jeune Turc de la gamelle lui déchargea son fusil dans la tète.
En entendant des coups de feu, le capitaine Fréart envoya cinq hommes de renfort. On arrêta les zouaves de la tribu du mort.
Six d'entre eux furent amenés devant le commandant. Le bachaouch Hussein répondit de trois.
Le premier des trois autres se précipita aux genoux de Yusuf en jetant son turban à terre. " Lâche, lui dit Hussein, respecte au moins ce turban que tu n'es pas digne de porter ", et il lui asséna plusieurs coups de son yatayan qui coupait mal.
Le second eut le même sort.
Le troisième, étant donné son maintien froid et calme qui impressionna les officiers, devait être envoyé à la Béarnaise, mais c'était risquer beaucoup pour l'escorte qui devait l'accompagner.
Le commandant, se ravisant, donna ordre de le fusiller.
Le cavalier Mustapha appuya son fusil sur sa poitrine et fit feu, l'arme rata, l'homme ne bougea pas. Mustapha passa le doigt sur la pierre et, ému, dit au zouave " Tourne-toi " ; il appuya l'arme entre les deux épaules et cette fois, l'arabe tomba en récitant la formule du prophète :
" C'est égal, dit Mustapha en rechargeant son fusil, j'aimerais mieux couper la tête à cinquante Juifs que de tuer un homme comme celui-là ".
Le commandant ajouta alors simplement " À présent, que chacun retourne à son poste ".
Mais l'alerte avait été chaude, les français au nombre de six, sentinelles défalquées, se sentaient isolés au milieu de ce groupe de Turcs que la crainte de Ben Aïssa ne retenait plus.
Le soir de ce jour, Kalib ne parut pas à dîner.
Hussein, fier de ses exécutions, dit au commandant :
" Pendant que nous y sommes, finissons-en tout de suite et coupons le cou à Kalib. "
L'officier déclina l'offre, appliquant le fameux principe : diviser pour régner.
Pendant la ronde de cette nuit-là, les Turcs reconnaissant l'autorité de Yusuf, venaient lui baiser l'épaule au fur et à mesure qu'il passait devant eux.
Dans la soirée, un factionnaire français entendit du bruit ; un homme lui parla dans une langue inconnue de lui, Yusuf, prévenu, dit en arabe " Qui va là " ; n'obtenant pas de réponse, il fit tirer dans la direction de la voix. Au matin, l'homme se présenta de nouveau, c'était un Turc, ne sachant pas l'arabe, échappé des mains de Ben Aïssa.
Le 30 au matin, on aperçut la Casauba qui était revenue au port par suite du mauvais temps.
Le capitaine Fréart donna le commandement au pilote Nicaise et lui ordonna de repartir.
Le même jour, le raïs Ali, du port de Bône, vint faire sa soumission, armé d'un yatagan et de pistolets, il se disait échappé de Ben Aïssa. Les Turcs ne voulurent pas le recevoir : il fut envoyé à la Béarnaise et se montra fidèle par la suite.
Puis un zouave d'Ibrahim vint dire que son maître demandait s'il pouvait revenir. Le commandant lui donna trois jours pour ce faire, passé ce délai, il serait considéré comme ennemi. Le bey ne reparut jamais.
Dans la matinée du 31, des Sen-Hadja, vinrent demander la permission de piller la ville, elle leur fut refusée. Puisqu'il en est ainsi, répondit l'un d'eux, nous la pillerons sans votre permission ".
Le commandant ne dit rien, mais, sur la proposition de Caïd Omar, désigna 40 Turcs, pour, par les derrières de la Casbah, gagner la porte de Constantine, pendant que la Béarnaise envoyait sa chaloupe armée d'une caronade de 12 sous les ordres du lieutenant Retailleau à la porte de la Marine.
La Casbah donna le signal en tirant sur la ville. Les Sen-Hadja, affolés, tombèrent qui, sur les Turcs, qui, sur la chaloupe ; quelques-uns essayèrent de passer entre la mer et la Casbah mais ils furent décimés par le feu de la Citadelle et tombèrent sur le second maître Daunac qui revenait de porter un pli au commandant et qui en tua plusieurs à coups de baïonnette pendant que le lieutenant Retailleau parcourait la ville à la tête de quelques hommes.
Les Turcs eurent deux blessés qui furent soignés par le docteur Mauduit ; ils ramenèrent des quantités d'armes et trois chevaux desquels le plus beau fut offert à Sidi Yusuf.
Tout l'argent pris ou résultant des enchères des prises fut distribué à titre d'avance sur la solde.
Le capitaine Fréart envoya encore quelques hommes de renfort, ce qui porta la garnison à 15 français et pour compléter son équipage, il engagea des corailleurs italiens.
Il restait à bord 15 Français et 10 Italiens.
Le premier avril, il nolisa un bateau corailleur pour porter à Alger le duplicata des dépêches, craignant que la Casauba, mauvaise marcheuse, n'ait pu tenir la mer.
Mais la sortie du 31 avait mis les Turcs en appétit ; il leur semblait dur d'être de nouveau claquemurés dans une citadelle où ils étaient déjà restés huit mois.
On les fit sortir sur leur demande, mais quand ils se virent seuls, ils se mirent à insulter Yusuf en l'accusant de les avoir trompés.
N'écoulant que son courage et malgré ses camarades, le capitaine sauta du haut du mur en criant : " Vous nie soupçonnez parce que vous ne me connaissez pas. "
Les Turcs enthousiasmés vinrent lui baiser les mains. Monté sur son cheval, le capitaine tira son sabre et entra triomphalement dans la ville à la tète de ses 130 bandits et suivi du second maître Daunac qui portait un drapeau tricolore.
Arrivé en ville, le capitaine prévint les Turcs que la surveillance devait être très sévère et que, de son côté, il tuerait quiconque manquerait à ses devoirs. Puis il fit hisser le drapeau et commanda une salve d'honneur. Un Turc ne tira pas :
" Pourquoi n'as-tu pas tiré au commandement, demanda le capitaine.
"Mon fusil n'a pas voulu partir, répondit le Turc.
" En vérité, dit Yusuf, montre-moi à quoi cela peut tenir. " Et il le tua de sa propre arme. Toutefois, se méfiant de ses hommes, il se constitua une garde prétorienne composée d'une douzaine de Turcs, dont Hussein, Omar, Ibrahim et Mustapha.
Il ne sortait jamais sans eux. Il se montra très dur envers ses hommes et ne recula jamais devant une exécution :
Ce jour, un Turc avait pillé une maison et s'excusait en disant qu'il était seulement venu puiser de l'eau à une citerne. " Eh bien, puisque tu as soif, tu boiras tant que tu voudras " et le capitaine le fit jeter dans la citerne.
Un autre avait quitté son poste, Yusuf le fit ramener et pendre à l'endroit même.
Dans la journée du 2, le capitaine Fréart monta à la Casbah, apportant à son équipage ses félicitations et des vivres qu'il avait achetés aux corailleurs italiens.
Dans la journée du 3, Yusuf fit ramasser la laine répandue dans les rues et en constitua un approvisionnement.
Dans la nuit du 3 au 1 il fut réveillé en sursaut et vit un Turc de petite taille mais d'une extrême vigueur, la tête couverte d'un turban vert, les veux expressifs, les lèvres cachées par une grande moustache noire qui s'avançait vers lui en rampant :
" Que me veux-tu " lui dit Yusuf en saisissant déjà son sabre.
Le Turc à genoux baisait sa couverture. " Je me nomme Ahmed, fit-il, je passe pour être le meilleur cavalier de Constantine, j'ai assisté à de nombreux combats, j'admire toit courage, Sidi, et en te voyant exposé à tant de dangers, je te demande la permission de me dévouer pour te garder, je ne te quitterai pas plus que ton ombre et quand tu dormiras, je veillerai près de toi " (4).
Yusuf lui donna sa main à baiser et se rendormit.
Le 4, vers midi, on vit un chebec entrer à la rame dans le golfe et se diriger vers le fort Gênois. L'élève de Cornulier-Lucinière fut envoyé avec huit hommes pour le capturer.
Six hommes armés, ayant à leur tète deux personnages de distinction, descendirent à terre.
Le chef était un jeune homme de 25 ans, coiffé d'un beau cachemire, portant sur ses vêtements à la turque, un burnous rouge frangé d'or et à la main, un fusil de 2 m. 50.
L'autre était vêtu à l'arabe, en belle laine blanche.
Les matelots les arrêtèrent et les conduisirent à la Casbah, pendant que le lieutenant Retailleau, avec sa chaloupe, s'emparait du chebec et l'amenait à la Béarnaise.
C'étaient le fils d'Ibrahim, son khodja et quarante soldats turcs qu'il amenait à son père.
Ismaïl ben Ibrahim Bey fut très étonné quand il apprit tout ce qui s'était passé, on le pria d'écrire à son père. Un Turc emporta la lettre, puis les deux chefs furent logés dans une belle chambre et invités à la gamelle des officiers, mais placés sous la surveillance de l'élève de Cornulier-Lucinière. Les 40 Turcs demandèrent à s'engager dans la troupe de Sidi Yusuf. Ismaïl ben Ibrahim devint plus tard officier aux spahis de Constantine.
Le 5, les vivres diminuèrent et l'on fut mis à la ration.
Le 6, les cheiks des environs vinrent faire leur soumission. Un passeport leur fui délivré par Yusuf et ils amenèrent du bétail, du lait et du beurre.
Le 7, deux bricks furent signalés mais ils passèrent au large, sans entendre le canon de la Casbah.
Le 8, la surprise entra dans le golfe, toutes voiles dehors, et fut, saluée de toutes les pièces de la Béarnaise, de la Casbah et de la ville pendant que Yusuf et ses Turcs exécutaient une fantasia sur la plage,
Le commandant de la Surprise se méprit sur tous ces bruits et préparait ses compagnies de débarquement, croyant à une affaire sérieuse, quand il reconnut son erreur.
A sept heures du soir, la Surprise mouillait à coté de la Béarnaise
(1) Je dis quatrième embrasure bien que cela ne soit énoncé nulle part. Mais il faut se souvenir que Horace Vernet a fait un tableau de la prise de la Casbah ; or, ce peintre, le véridique par excellence, et qui connaissait Yusuf, a dit et se rendre sur les lieux et consulter son illustre ami.
(2) La solde était de un boudjou (1 fr. 80) par jour.
(3) Mon Général,
A la tête de 26 marins que m'a confiés le capitaine de la Béarnaise, je suis entré ce matin dans la Casbah de Bône où nous avons 130 Turcs et Arabes pour auxiliaires ; je m'en défie malgré leurs protestations de fidélité ; L'armée du bey de Constantine, maîtresse de la ville, nous tient assiégés ; malgré tout, nous garderons, je l'espère, cette citadelle à la France jusqu'à l'arrivée du renfort que je vous prie de m'envoyer.
(4) Bouyac. -- Histoire de Bône.
|
A SUIVRE
|
|
Encore ! Sur le sable
Je revois tes pas
Aujourd'hui comme hier
Comme une prière
Je dis tout bas
Au creux de mon âme :
Comment que tu reste !
Reste , en moi les gestes
De ce qui fut nous
L'amitié d'un jour
Puis l'amour pour toujours ...
A l'île de Djerba
Je marche pas à pas
Sur notre passé
Aux joies insensées,
Vois-tu , au rythme du sablier,
J'ai très peu changé
Je t'aime comme autrefois
Pour nous deux , avec cette foi,
Là , près de mon cœur
Dans mon porte-feuilles
Cette croix du sud
Pour l'éternité ...
Aux enfants qui s'aiment,
Aux parents de même
Je vous dis ceci
Gardez toujours à l'esprit ;
Qu'une vie s'accomplie
Qu'avec l'amour d'autrui
Semez la cette graine
Qu'on appel " je t'aime "
Qui vient fleurir
Balcons et tonnelles
Et ceci , toute une vie !
( Aux enfants de Tunisie Qui s'aiment aujourd'hui
Comme nous avons aimés Jadis )
Le 06 10 2005 Rio pierre
|
|
|
| COLONISATION de L'ALGERIE
1843 Par ENFANTIN N° 8
| |
1ère PARTIE
CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ.
1er Chapitre : État ancien de la propriété en Algérie.
2ème Chapitre : État actuel de la propriété en France.
3ème Chapitre : État de la propriété pour l'Algérie française.
CHAPITRE II.
ÉTAT ACTUEL DE LA PROPRIÉTÉ EN FRANCE.
CHAPITRE II.
ÉTAT ACTUEL DE LA PROPRIÉTÉ EN FRANCE.
X. - La propriété que je, nomme propriété mixte est donc la régulatrice de la propriété foncière et de la propriété mobilière. Le BANQUIER est le, lien entre le propriétaire et l'industriel; cette corporation de la banque est en effet l'arbitre suprême de la richesse publique et des lois qui la régissent; et c'est encore un des signes de notre, temps, que le rôle politique, rempli par les grands noms de la banque, tels que Périer et Laffitte, et, dans un autre ordre, Rotschild et Aguado.
Je demande encore ici au lecteur de vouloir bien ne pas se hâter de croire que ces considérations - sur les principaux faits relatifs à. la propriété en France, sont inutiles pour ce que je me propose d'écrire sur la constitution de la propriété en Algérie; et, pour le dire même en passant, je ne crains pas de poser, comme une vérité de toute évidence, que la colonisation de l'Algérie sera tout à fait impossible, tant que les banquiers n'auront pas confiance dans l'avenir de cette colonie.
XI. - Certes, ce n'est pas l'appui que donnent les banquiers à tel ou tel Gouvernement, qui suffit pour assurer à ce Gouvernement force et durée, mais ils ne donnent leur appui que parce qu'ils sentent que ce Gouvernement a de l'avenir, et alors cet appui devient un élément de plus pour assurer cet avenir. Quelle est la société politique, quelle est même la société commerciale à laquelle on supposerait la moindre chance, de vie, si les banquiers lui refusaient leur crédit ?
La banque, la bourqeoisie, le commerce, tels sont les trois ordres, sous le rapport de la richesse; et tout règlement de la propriété qui sera imaginé par l'un quelconque de ces trois ordres, portera le cachet de cet ordre (1) : le bourgeois lui donnera le caractère foncier ou féodal, c'est à dire supposera toujours, pour la propriété, un titulaire oisif percevant le fermage, et un prolétaire laborieux, mettant en oeuvre le fond, et surtout payant un fermage; le commerçant sera préoccupé de constituer la propriété de la manière la plus échangeable, vendable, divisible, d'en faire un objet de brocantage facile; tandis que le banquier cherchera, avant tout, les conditions qui doivent assurer au travail le plus grand produit, car ce qu'il lui faut pour accorder sa confiance, c'est le succès et l'enrichissement de celui à qui il raccorde.
Des premiers, ressortira le système de la grande propriété; des seconds, celui de la petite, propriété; des troisièmes, le système d'association de petits propriétaires travailleurs, formant par leur réunion la grande propriété; association qui présenterait ainsi les avantages réels de la grande et de la petite propriété, et qui éviterait leurs inconvénients.
IXI. - Remarquons que les deux premiers systèmes ont déjà été proposés et même employés pour l'Algérie, parce qu'en effet, ce sont des bourgeois et des brocanteurs qui s'en sont occupés, tandis que les banquiers n'ont pas encore daigné dire leur mot sur cette difficile, et immense entreprise de la France.
Effectivement, les colons algériens peuvent se diviser en deux classes. Les uns se sont fait faire de, grandes concessions de terres, ou bien ont acheté de vastes propriétés, sur lesquelles ils ont placé ou voulu placer un nombre assez considérable de petits métayers, espèce de vassaux ou plutôt de serfs de ces barons de l'Algérie; les autres ont acheté, vendu, racheté, revendu, des maisons, des jardins, des terres, sans s'inquiéter de ces maisons, de ces Jardins et de ces terres, dévastant les maisons, dépouillant les jardins et laissant en friche les terres.
Certes, la législation qui permettait l'établissement de ces baronies isolées, incapables de se protéger, de se soutenir les unes les autres, de concevoir et de réaliser des travaux d'utilité commune; la législation qui favorisait le jeu désastreux de ces bandes noires d'agioteurs, n'a pas été une lumineuse importation en Algérie. Tout le monde convient du double vice que je viens de signaler, et pourtant peu de personnes pensent que ces deux vices soient les fruits des deux vieilles branches, non de l'arbre de la science, mais de l'arbre de la richesse, tel que nous le cultivons en France; qu'ils soient les fruits de la propriété foncière féodale et de la propriété commerciale anarchique, tandis qu'il faudrait surtout transplanter en Algérie la branche nouvelle, la propriété des sociétés industrielles, véritable association communale de propriétaires travailleurs.
Continuons, comme nous l'avons fait à l'égard de l'ancienne, propriété d'Algérie, l'examen attentif des causes et des principales conséquences de la constitution actuelle de la propriété en France; nous en déduirons plus tard facilement l'application qu'il est possible d'en faire à la constitution de la propriété dans l'Algérie française.
XIII. - - Et d'abord, rappelons ce que nous avons déjà dit ailleurs (introduction) : notre, mode d'appropriation est très exceptionneI sur le globe, il est exceptionnel même en Europe, et il ne date pour nous que d'un demi-siècle. Je suis loin d'en conclure qu'il ait été ni même qu'il soit mauvais pour la France, mais je ne saurais en conclure qu'il soit bon en tout lieu, en tout temps, pour tout peuple, ni qu'il eût été bon pour la France il y a un siècle, ou qu'il soit encore bon pour elle dans un siècle. Je n'ai d'ailleurs à m'occuper ici que de ses causes et de ses conséquences actuelles.
Or, j'ai déjà dit que notre constitution foncière, dérivant d'une nécessité d'ordre, et même originairement d'un besoin de hiérarchie, avait reçu l'empreinte de la liberté et de l'égalité, par la destruction d'une partie des entraves mises autrefois à sa mobilité, et par la loi des successions; que notre constitution mobilière avait pour cause directe le principe de liberté et même, d'anarchie, qui refuse, toute intervention d'une autorité quelconque, dans la disposition de cette partie de la richesse; et enfin; que la propriété mixte foncière et mobilière à la fois, était une première tentative de notre époque, vers l'union de l'ordre et de la liberté, de, la hiérarchie et de l'égalité, expression très juste du besoin des esprits et des exigences des intérêts, dans la France actuelle.
L'introduction des principes de liberté et d'égalité dans la propriété foncière, la réalisation du principe d'anarchie, c'est à dire du principe du laissez - faire des, économistes, dans la propriété mobilière, ont été fort utiles et même, indispensables pour DÉTRUIRE l'immobilisation du sol et les privilèges personnels de naissance, qui n'étaient plus justifiés, ni par une différence sensible de race entre vainqueurs et vaincus, entre, seigneurs et vilains, ni par le besoin de conservation de castes, nobiliaire ou religieuse, d'origine franque ou d'institution de Rome papale; et ces principes ont été nécessaires pour DÉTRUIRE aussi une, direction et des règlements de travail industriel, commercial et agricole, qui ne ressortissaient pas, en réalité, des industriels, des commerçants et des agriculteurs, mais de seigneurs, étrangers à ces travaux et les méprisant.
Ce fuit, en un mot, l'expression de l'avènement du tiers-état au rôle politique, par la destruction des deux classes qui, jusque-là, en avaient eu le privilège, la noblesse et le clergé.
XIVI - Mais ces principes, excellents pour détruire ce qui est vieux et passé, peuvent-ils fonder et construire pour l'avenir? - Ceci commence à être mis assez souvent en doute ; ce qui ne signifie pas que l'on considère ces principes comme, n'ayant qu'une utilité passagère, car l'humanité a toujours et aura toujours beaucoup de choses passées à détruire, et c'est même, parce que, dans les âges précédents, voulant toujours conserver trop longtemps des choses usées, elle n'a pas, fait la part assez large aux principes et aux instruments de démolition, qu'elle a été toujours brutalement renouvelée, révolutionnée, dans des crises rares, mais terribles.
Le principe, d'ordre et de hiérarchie qui présidait à la conservation de l'ancienne société française ayant été détruit, comme la société, même dans les accès de destruction violente, éprouve toujours le besoin de conserver quelque chose, il a bien fallu faire, un retour vers le principe ancien et vers quelques unes de ses conséquences; c'est ce qu'on a fait : on a gardé, dans la propriété foncière, et, sous quelques rapports, dans la police de la richesse mobilière, quelques unes des conséquences du principe ancien.
Mais ce n'était pas encore là faire du neuf, construire; c'était simplement conserver une aile, une base, quelques pierres d'un édifice détruit.
Et pourtant l'humanité, qui a besoin de détruire et de conserver, a besoin aussi de CREER ; c'est même ce besoin qui prédomine, aux époques qui suivent les grandes destructions. Nous avons donc cherché en France, et nous cherchons avec ardeur, en ce moment, à introduire le principe créateur, dans le néant que, nous avons fait ou dans les ruines qui nous restent.
XV. - Le, principe d'association industrielle est, sous le rapport de la propriété, l'élément créateur qui germe et grandit, et qui tend à se substituer complètement à l'association ancienne, de la féodalité territoriale, si imparfaite et si monstrueuse même, puisqu'elle prétendait unir, mettre en une même société, le propriétaire qui exploitait et méprisait le travailleur, et ce travailleur qui payait et respectait son seigneur et maître.
Ce principe domine déjà dans la richesse mobilière, et il embrasse même une, importante partie de la propriété foncière : les emprunts publics, les banques, les sociétés d'assurances, d'hypothèques, de transports, celles des routes, canaux, mines, forêts, usines, manufactures, emploient la plus puissante et la plus active partie de la richesse mobilière, et la plus riche part de la propriété foncière.
C'est une féodalité nouvelle, ce sont des corporations nouvelles, dira-t-on. - Oui? C'est une féodalité industrielle; mais avec le droit d'ainesse de moins, l'admission de tous à l'autorité, quelle que soit la naissance, la mobilité du titre et pourtant la perpétuité du fond; la différence est grande. Oui, C'est le germe d'une hiérarchie nouvelle, d'une direction et d'une réglementation nouvelles du travail, mais d'une hiérarchie ouverte à tous, et d'une gestion et administration des travaux confiés à la capacité et non à la naissance; n'est-ce pas assez pour ne plus regretter l'édifice détruit, et pour travailler avec ardeur à celui qui s'élève ?
En vue de l'Algérie, en vue de cette création nouvelle que la France a résolu de faire, songeons donc à la puissance créatrice qui se développe en nous, et non pas aux instruments vermoulus du passé ou bien à ceux qui nous ont servi à les réduire en poussière. Songeons à nous servir de la puissance, d'association industrielle, et non à fonder des seigneuries en Algérie, ou de misérables chaumières, entourées d'un petit champ cultivé à la bêche.
XVI. - Tel est, en effet, le spectacle que présente la France, là où n'apparaît pas le mode mixte d'appropriation par association, là où règne seul le principe du passé, celui de l'immutabilité de la propriété foncière, ou le principe révolutionnaire qui a servi à le détruire, c'est-à-dire l'individualisme anarchique, instable et envieux de la propriété mobilière.
En d'autres termes, dans les campagnes dont le sol est possédé par la bourgeoisie des villes, ou bien dans les villes où la concurrence industrielle se livre des combats à mort, que trouvons-nous ? D'une part, les châteaux des propriétaires de la terre et les sales chaumières des cultivateurs de cette terre; et d'autre part, dans les villes manufacturières et commerciales, luxe effréné et pitoyable indigence. Voyez la Bretagne ou le coeur de la France, qui sont les lieux où règne particulièrement le principe de la propriété foncière. Visitez aussi toutes les villes de fabrique et la plupart des villes de commerce, et vous serez frappés de voir deux principes contraires produire des résultats: analogues; tant il est vrai que l'ordre et la liberté, lorsqu'ils dégénèrent en despotisme ou en anarchie, sont également funestes à la société.
Je suis loin de prétendre que la propriété mixte, création de nos jours, ait déjà rétabli, sur tous les points, où on la rencontre, l'harmonie sociale; qu'elle ait partout apporté, dans la répartition de la richesse, la mesure, convenable d'ordre et de liberté; qu'elle ait donné à la propriété foncière sa part légitime de stabilité, et qu'elle n'ait attribué à la propriété mobilière que sa part légitime de mobilité; enfin, qu'elle ait remplacé l'ancienne organisation féodale du sol et les, anciennes corporations industrielles: mais j'affirme qu'en elle est le germe de la future organisation du travail industriel et agricole, de la véritable constitution du PEUPLE des villes et des campagnes, constitution après laquelle nous courons depuis la Révolution, qui a détruit l'ancienne constitution du peuple français.
XVII. -C'est la société anonyme qui est la forme la plus avancée de ce mode d'appropriation; elle repose sur des bases si naturelles, si fermes, que l'avenir pourra bâtir sur elle.
En effet, quels sont ses principes?
L'autorité publique doit approuver son but et ses moyens, ses statuts, et en maintenir l'observation par un commissaire nommé à cet effet.
La gestion et l'administration, sont confiées à des intéressés, non pas en raison de leur qualité d'intéressés, de propriétaires d'une portion de l'avoir social, mais parce qu'ils sont jugés par leurs collègues (intéressés comme eux) les plus capables de gérer et d'administrer l'oeuvre commune.
Les associés, en tant que, propriétaires, ont la libre disposition de leur titre de propriété, leur action; ils peuvent l'aliéner promptement, mais ils n'ont aucun droit sur le fond et ne peuvent l'altérer en aucune manière, ni intervenir dans la gestion ou l'administration, que pour la nomination ou la révocation des gérants et administrateurs, à des époques ou pour des causes prévues.
La situation de ces sociétés est rendue publique annuellement, soit par la remise de l'état de situation au Gouvernement, soit par le compte-rendu annuel aux actionnaires, soit même par les formes d'une plus grande publicité.
Telles sont les garanties données par ce mode d'association :
1° à I'État ;
2° à la capacité personnelle des intéressés;
3° au capitaliste associé,
4° à l'association elle-même;
5° au public, pour ses rapports d'intérêt avec elle.
Il y a là toute la charte d'organisation du travail agricole et industriel, sauf, il est vrai, un point fort important, le seul qui manque pour que l'institution soit parfaite; je veux dire la charte des droits et des devoirs de l'ouvrier employé par l'association
C'est là, en effet, la question qui occupe aujourd'hui les esprits élevés. Tout le monde sent que c'est seulement par l'organisation des ouvriers des villes et de ceux des campagnes, que sera close la crise révolutionnaire qui dure encore; on voit bien que le seul moyen d'enlever aux partis rétrogrades, ou soi-disant progressifs, la clientèle dont ils exploitent l'ignorance ou la misère, est d'organiser cette admirable clientèle, ce peuple de travailleurs, d'une manière profitable à son élévation morale, au progrès de son intelligence et de son aisance, de faire entrer dans une société dont il est encore éxclu, l'ouvrier, le prolétaire qui en assiège violemment les portes; de l'associer, de l'intéresser au bonheur public, au bonheur du riche comme à celui du pauvre, à la fortune de son maître, disons mieux, de son chef, aussi bien qu'à la sienne propre.
XVIII. - Si l'Algérie pouvait être le lieu d'essai de cette organisation, si nous pouvions réaliser cette précieuse nouveauté dans ce pays où tout est à faire, la réaliser loin des obstacles que les droits caducs de notre vieille société où les prétentions exagérées de notre jeunesse rêveuse d'avenir lui opposeraient en France, que d'actions de grâces ne devrions-nous pas rendre à Dieu pour cet heureux résultat de notre imprévoyante conquête !
Mais avant d'examiner si effectivement nous pouvons ORGANISER LE TRAVAIL, dans les campagnes et les villes de l'Algérie française, il me reste à parler d'un droit qui jouait un rôle important dans l'ancienne constitution de la propriété algérienne, et qui n'est pas nul, à beaucoup près, en France; je veux dire le droit du souverain, à l'égard de la propriété.
XIX. - En France, le souverain n'est pas, il est vrai, comme chez les Turcs, un homme; c'est le gouvernement, l'autorité publique, l'État, la loi et les hommes qui sont chargés de la faire exécuter, depuis le garde-champêtre jusqu'au Roi lui-même.
Or, il existe encore en France, fort heureusement, malgré la grande passion d'indépendance qui nous a fait rompre les liens de l'ancienne constitution française, une part très sensible de droit sur la propriété, attribuée au souverain, à l'autorité publique, à la loi.
(1) Je n'ai pas besoin de dire qu'en me servant de ces trois mots : banque, bourgeoisie, commerce, c'est l'esprit qui anime ces trois classes, relativement à la propriété, que je recherche, et que cet esprit se retrouve dans toutes les classes de la société. Bien dés hommes envisagent la propriété en banquiers, d'autres en commerçants, d'autres en bourgeois, qui ne sont cependant pas banquiers ou agents de change en titre, ne payent pas patente ou n'ont pas pignon sur rue, ni château à la campagne.
A SUIVRE
|
| |
| LE CAPITAINE GENOVA
ET LES VOLONTAIRES DE 1870
Envoyé par M. Pierre Latkowski
|
Il y avait à Bône, près du port, la rue du " Capitaine Génova ".
Autrefois " rue de l'Arsenal ", elle avait été contemporaine du début de l'occupation française. On la voit en effet, très nettement tracée, avec son nom très lisiblement écrit, sur un plan de la Ville, dressé le 15 septembre 1833, portant la signature du Maréchal de Camp d'Uzer, premier Commandant de la Subdivision de Bône. Comme la rue Fréart sa voisine, elle s'ouvrait sur la place de la Marine (place Faidherbe) et menait à la porte de la Mer.
Dans cette rue, l'Hôtel " Faidherbe " abrita, pendant trois années consécutives, tout au début du XXème siècle, le compositeur Camille Saint-Saëns. Dans la chambre d'angle du second étage qu'il occupa pendant trois hivers, il composa entièrement sa tragédie lyrique : " Les Barbares " et mon père, qui passait fréquemment sous ses fenêtres, eut le bonheur d'entendre, ainsi que de nombreux Bônois et avant les Parisiens, les accords, les mélodies, les grands airs, qui devaient dans l'hiver 1902, remporter un si grand succès à l'Opéra de Paris.
 La rue de l'Arsenal au début du XXème siècle (photo Louis Latkowski)
La rue de l'Arsenal au début du XXème siècle (photo Louis Latkowski)
Dans les années 1920, la rue de l'Arsenal prit le nom de " rue du Capitaine Génova " pour honorer la mémoire de l'officier qui avait commandé les Volontaires de 1870.
Comme on le sait, la guerre avait été déclarée le 15 juillet. Les nouvelles les plus terribles arrivaient du front. Le 4 septembre on perdait Sedan. La situation était plus que critique. Le général Durrieu, gouverneur général de l'Algérie par intérim après le départ de Mac Mahon, fit alors un énergique appel au patriotisme des colons qui, dés le début de la conquête avaient combattu et travaillé côte à côte avec nos soldats :
Aux habitants de l'Algérie : Algériens, vous connaissez dans toute son étendue le malheur qui vient de frapper la France. J'ai confiance dans votre énergie et votre patriotisme pour vous armer contre toute défaillance et envisager de sang-froid la situation. Je vous recommande l'ordre et le calme. La France n'est pas à bout de ressources. Attendons ses volontés et unis dans une même pensée, tenons nous prêts à les accomplir. (Alger, le 4 Septembre 1870).
Ce fut sur ces bases que, dans les premiers jours de novembre, une compagnie de volontaires fut formée à Bône.
MM. Genova (Xavier) fut élu capitaine commandant ;
Fournier (Albert), lieutenant.
N°Mle 2 : Guy (Charles), sergent-major.
N°Mle 4 : Sion (Jules), sergent.
6 : Bonnefoy (Léon), sergent porte-fanion.
9 : Morlot (Louis), caporal.
10 : Calmon (Ernest), caporal.
11 : Gery (François-Marie), caporal.
12 : Hamon (François-Marie), caporal.
La compagnie eut deux clairons.
N° matricule : 21 Massin (Casimir).
N° 23 Mazias (Alphonse).
Les volontaires au nombre de 42 et divisés en six escouades furent :
N° Mle 20 : Amiel (Lupert).
22 : Bernard (Joachim).
24 : Colombier (Jean).
25 : Chabrol (Prosper).
26 : Blanc (Baptiste).
27 : Liandrat (Pierre).
28 : Garnier (Henri).
29 : Tavera (Joseph).
30 : Denante (François).
31 : Vicari (Jules).
32 : Rossy (Antoine)
33 : Falavel (Emile)
34 : Lartigau (Alphonse)
35 : Laurent (Xavier).
36 : Hutin (Henri).
37 : Bonnefoy (Eugène)
38 : Lopez (Joseph).
39 : Labesse (Auguste).
40 : Legey (François).
41 : Nelet (Gustave).
42 : Basso (Pierre).
43 : Odenino (Michel).
44 : Pouchet (François).
45 : Augier de Maintenon (François),
46 : Platon (Auguste).
47 : Darras (Auguste).
48 : Roche (Léopold).
49 : Laurens (Jérôme).
50 : Estèbe (Damien).
51 : Mikalowski (André)
52 : Fritz (André).
53 : Armand (Léon).
54 : Martin (Joseph).
55 : Remusat (Marius).
56 : Jalabert (Joseph).
57 : Faurte (Emile).
58 : Bertraux (Louis).
59 : Moustier (Charles).
61 : Mégia (André).
63 : Teddé (Antoine).
64 : Ahmed ben Brahim.
Ces hommes reçurent de la ville un franc de solde par jour sans vivres ; les sous-officiers, un franc vingt-cinq centimes ; les officiers, la solde et les indemnités de la première classe de leur grade dans la ligne.
Ils étaient vêtus d'effets de drap, bleu de roi, composés d'un caban avec capuchon, d'une vareuse, d'un pantalon et d'un képi portant sur le bandeau un croissant et une étoile, sauf l'indigène qui conserva sa chéchia.
Une ceinture rouge tranchait sur ces couleurs sombres ; celle des officiers était de mille teintes.
Les officiers et les sous-officiers eurent des insignes de grade en argent ; ceux des caporaux étaient de laine rouge.
L'armement consista en une carabine Minié avec baïonnette et 100 cartouches ; 60 dans la giberne et 40 dans le sac.
Chaque homme reçut en outre de la ville un havre sac et une couverture ; de l'Etat, une tente et des ustensiles de campement.
Le signe de ralliement consista en un fanion de drap noir brodé par les demoiselles Séréno, de Guelma, et portant, en lettres d'or, l'inscription " Volontaires de Bône ".
La plupart de ces jeunes gens étaient des recrues sans aucune instruction militaire ; mais les officiers étaient de vieux soldats rompus au métier des armes.
M. Génova était un ancien fourrier de zouaves, devenu sergent-major à la Légion étrangère, puis sous-lieutenant et lieutenant au Mexique, dans le 6ème bataillon de Casadores (Tirailleurs Mexicains).
M. Fournier, rédacteur en chef du journal bônois " La Seybouse ", avait été sergent-major au 71èmede ligne.
Aussi l'instruction des hommes fut-elle rapidement et savamment menée. Deux tirs furent exécutés avant le départ.
Le 22 novembre, la compagnie fut embarquée sur un vapeur des Messageries Maritimes et débarqua à Marseille, le 25. Elle avait en caisse 2.700 francs donnés par la ville et 50 francs offerts par M. Eromhert.
Elle fut immédiatement immatriculée et les officiers reçurent leurs brevets par les soins de M. Gente, préfet des Bouches du Rhône.
Les hommes touchaient de la guerre un franc par jour sans les vivres. Les officiers eurent la solde de leur grade et reçurent l'indemnité d'entrée en campagne sur laquelle, avec la sollicitude qu'ils montrèrent pour leurs compagnons d'armes au cours de toute la campagne, ils prélevèrent 500 frs pour l'ordinaire.
Le capitaine acheta, au compte de la ville de Bône, à chacun de ses hommes, un revolver et 24 cartouches et pour lui-même une excellente jumelle.
Un conseil d'administration fut formé qui comprit MM. Génova, Fournier, Guy, de Maintenon et Platon.
Le 28, après avoir pris, la veille, un apéritif en l'honneur de la campagne et avoir recruté un volontaire, Durley (Jacques), numéro matricule 62, elle fut dirigée par chemin de fer sur l'armée des Vosges.
Elle arriva, le 29 Novembre, à Autun et fut cantonnée, sans paille, dans une église. Peu habitués aux froides nuits de la région de l'Est, les volontaires eurent beaucoup à souffrir. Le lendemain, il fut décidé que l'on remplacerait le képi par une toque de fourrure dans le genre de celle que portent les rouliers ; le croissant et l'étoile furent cousus sur le bandeau.
Le 1er décembre, après la soupe du matin, les hommes s'initiaient aux mystères de l'école de tirailleurs lorsque, vers une heure, des obus vinrent à tomber sur la ville.
Sans avoir reçu aucun ordre, le capitaine marcha au canon. Il rencontra le général Riccioti Garibaldi, commandant la 2ème brigade, qui le plaça à côté de l'arc romain du faubourg Saint-Symphorien, en réserve générale et en soutien de deux batteries d'artillerie des mobiles de la Charente Inférieure.
Il resta dans cette position toute la nuit du 1 au 2. C'est là qu'il fut abordé par un Bônois, M. Aribaud, incorporé dans un corps garibaldien, qui devait, plus tard, être cité à l'ordre pour avoir à Dijon, fait prisonnier le fils du général de Werder.
Le 3, la compagnie fut incorporée dans la 1ère brigade de l'armée des Vosges (général Menotti Garibaldi) et fit partie d'un bataillon de francs tireurs commandé par le chef de bataillon Lhoste et composé de :
Une compagnie de Lyon.
Deux compagnies d'Alger.
Une compagnie de Constantine.
Une compagnie de Guelma.
Une compagnie d'Aumale.
Deux compagnies d'Avignon.
Deux compagnies du Tarn et Garonne.
La compagnie avait perdu deux hommes, Falavel et Labesse, disparus le 1er décembre.
Le jour même, le bataillon partit pour Arnay-le-Duc. Après un séjour assez long dans cette ville, couvert par la compagnie de Bône en avant-garde, il se dirigea par une marche de nuit sur Pont d'Ouche. Il devait prendre la voie ferrée pour gagner Nuits et prendre part à la bataille qui s'y livrait. Mais la voie était coupée, il dut marcher par étapes et arriva seulement le 24 décembre. Il fut réuni à un groupe de 30 bataillons de francs-tireurs de toutes provenances.
Après un repos de trois ou quatre jours, la compagnie partit en avant-garde vers huit heures du soir. Elle traversa une forêt sous une neige abondante et arriva à Sombernon, à neuf heures du matin.
Des reconnaissances furent lancées de ce point dans toutes les directions, à une distance de 15 à 20 Kilomètres.
Au cours d'une de ces reconnaissances, le fanion noir faillit être cause d'une terrible méprise.
La compagnie avait été réveillée à trois heures du matin, les armes avaient été enveloppées de chiffons et de paille et sans aucun bruit, elle était sortie du cantonnement.
Ce mouvement avait été tellement silencieux que les volontaires Roches et Julian n'avaient rien entendu et étaient restés couchés.
Les hommes furent à un point distant du village de 4 à 5 kilomètres dissimulés dans les fossés de la route, au milieu d'une forêt couverte de neige.
A midi, elle n'était pas rentrée. Le commandant, croyant à un malheur, fit partir quelques hommes en avant du village et fit disposer, sur la route, des grenades commandées par un fil électrique. Tout à coup, on aperçut une ligne sombre, un drapeau très foncé flottait au-dessus des têtes coiffées de bérets.
Les fusils furent abattus, le courant allait être envoyé dans les grenades lorsque les volontaires Julian et Roches qui se trouvaient là, s'écrièrent : " Ne tirez pas, mon commandant, ce sont les enfants de Bône ".
A la suite de cette mésaventure, malgré sa hampe traversée d'une balle et sa flamme déchirée de deux autres, le fanion fut roulé et remplacé par un drapeau tricolore qui fut acheté à la première occasion.
L'ennemi ne se montrant pas, le bataillon fut dirigé sur Dijon puis sur Saint-Seine.
Les Allemands se trouvaient à six kilomètres de là, à Chanceaux.
Le 1er janvier, M. Carcasonne, lieutenant démissionnaire et capitaine de la compagnie de Guelma en l'absence du commandant retenu à Dijon, dirigea une opération sur le village.
Les Allemands, au nombre de 4 à 500 fantassins, soutenus par deux petites pièces de canon, ouvrirent le feu à bonne portée. Le bataillon se déploya immédiatement, la compagnie se trouvait à l'extrême droite, sur deux lignes de tirailleurs respectivement sous les ordres du capitaine et du lieutenant.
Le combat dura une heure, l'ennemi battit en retraite. La compagnie ne subit aucune perte.
A la suite de cette affaire, le colonel chef d'état major des troupes garibaldiennes écrivit dans son rapport officiel que la compagnie vaillamment entraînée par ses chefs avait manoeuvré " avec la même précision et le même calme que si elle avait été sur la place d'exercices ".
Elle avait incorporé, ce même jour, Kilfourmi (Léon), numéro matricule 65.
Le commandant fut nommé lieutenant-colonel à la suite de cette affaire.
Le séjour à Chanceaux fut employé à faire des reconnaissances dans les bois voisins.
Une nuit, deux compagnies, l'une du Tarn et Garonne et l'autre d'Alger, tombèrent sur une reconnaissance allemande dissimulée dans un ravin.
Un combat assez vif s'engagea.
Quatre compagnies envoyées en renfort, trouvèrent au lever du jour, les cadavres du capitaine et du lieutenant du Tarn et Garonne et vingt corps de francs tireurs ; les autres avaient disparu.
Peu de temps après, le bataillon regagna Dijon, le 8 janvier. De là, il retourna à Saint-Seine après avoir échangé ses carabines contre des armes plus modernes. La compagnie reçut des Chassepots.
A six kilomètres de là, à Champigny, se trouvait un troupeau de moutons appartenant à I'administration allemande.
Le 10, à cinq heures du soir, ce troupeau fut surpris. Il fut fait dix prisonniers et l'on s'empara de 600 bêtes qui, vendues à Dijon, par les soins de l'intendance, rapportèrent 13 fr. 05 à chaque homme du bataillon.
Le lendemain 11, à neuf heures du matin, une nouvelle attaque fut dirigée par les francs-tireurs, sur Champigny. La compagnie se trouvait à l'extrême gauche. La présence d'esprit du capitaine évita une surprise qui aurait pu avoir des conséquences fatales.
Le bataillon battait en retraite à trois heures de l'après-midi, faute de cartouches. Le colonel vit, un moment, une ligne déployée s'avancer sur la droite de la compagnie. Il voulait faire cesser le feu, croyant avoir à faire à une de ses unités mal orientées dans son mouvement de retraite par échelons. Ce fut sur l'insistance du capitaine Génova qu'il suspendit son ordre. C'était une compagnie allemande et les Bônois se trouvaient alors seuls en extrême arrière garde. Ils ne quittèrent leur position qu'au dernier moment.
Le volontaire Teddé s'entendit alors appeler, c'était le jeune Hivert (Etienne) de la compagnie de Guelma et bônois d'origine, qui avait été frappé d'une balle au pied droit. La cantinière du bataillon était allée chercher une charrette pour enlever le blessé, mais comme elle n'arrivait pas, le volontaire Teddé, aidé de ses camarades Arnaud, Colombier et de Maintenon, improvisa un brancard avec des fusils. II était temps, les Allemands approchaient et le départ des quatre infirmiers d'occasion fut salué d'une grêle de balles qui heureusement n'atteignirent personne.
La charrette fut rencontrée quelques mètres plus loin. Hivert fut évacué sur Saint-Seine puis sur Dijon où il devait mourir de sa blessure.
La compagnie ne subit aucune perte dans cette affaire, le bataillon eut 30 tués ou blessés.
La retraite se continua sur Dijon où le capitaine reçut, le 12, un mandat de 500 frs envoyé par la ville de Bône.
Après un repos de deux jours, le bataillon vint à Saint-Seine et la compagnie fut détachée à Alise Sainte-Reine.
Au cours de la marche, le caporal Morlot, de 2ème escouade, s'enivra. C'était un peu excusable étant données les privations auxquelles les volontaires étaient souris depuis le commencement de la campagne. Mais le vieux soldat qu'était le capitaine ne pouvait admettre ce manquement à la discipline. Le caporal fut cassé et ses galons lui furent arrachés devant la compagnie sous les armes.
Le 19, les francs-tireurs rétrogradèrent vers Dijon et reprirent leur place dans leur brigade qu'ils avaient quittée depuis Autun.
Le 20, la compagnie reçut un mandat de 123 frs 35 envoyé par les corps de cavalerie de Bône.
Le 21, la ville fut attaquée, le bataillon fut placé à Talan, faubourg de Dijon organisé défensivement par les Garibaldiens. On fit toute la soirée des feux un peu au hasard en avant du faubourg. A deux heures du matin, n'ayant reçu aucun ordre et ses hommes n'ayant pas mangé, le capitaine rentra dans Talan.
A dix heures du matin, le 22, il était en avant du faubourg, appuyé à une vieille masure, formant l'extrême droite d'une ligne composée de bataillons français. La veille, les Garibaldiens avaient repoussé l'ennemi, un mouvement en avant fut ordonné.
A deux heures de l'après-midi, la compagnie commença un vaste mouvement tournant qui décida de la retraite des Allemands. Elle arriva à la fin de ce mouvement en face d'une ferme dans laquelle 700 blessés français et allemands étaient soignés par huit médecins de cette dernière nationalité.
Au moment où le capitaine visitait cette ambulance, une vieille dame de 70 ans, le bras barré de la Croix Rouge, Madame de Saint-Seine, se présenta et se plaignit amèrement au médecin-chef, de ce que les soldats allemands l'avaient, la nuit précédente, malgré la neutralité qui la couvrait, empêchée de prodiguer ses soins aux blessés relevés sur le champ de bataille.
Ceci se passe de commentaires.
Le capitaine envoya un de ses hommes, monté sur le cheval d'un des médecins, prévenir Garibaldi de la découverte de l'ambulance. Le général vint prendre possession du matériel, et en particulier des huit chevaux.
Sans davantage de commentaires.
Les pertes de la compagnie furent assez sérieuses dans cette affaire. Le caporal Géry, de la 5ème escouade, avait été tué ; le volontaire Nelet, de la 4ème, blessé, mourut à l'hôpital de Dijon le lendemain ; le sergent Bonnefoy avait reçu une balle dans la jambe.
Le bataillon avait perdu un lieutenant de la compagnie de Lyon et le capitaine d'une compagnie d'Avignon.
Le caporal Morlot, dégradé précédemment, s'était tellement brillamment conduit, que son capitaine alla lui-même acheter des galons, qu'il lui remit en présence de ses camarades.
Cependant, les Garibaldiens avaient repoussé l'ennemi à Pouilly ; le 61ème régiment poméranien avait même perdu son drapeau.
Le lieutenant-colonel Lhoste, blessé, reçut la croix de chevalier de la Légion d'honneur le soir du combat. Le lendemain matin, il fut fait officier ; le soir, il était mort.
Le capitaine Génova fuit désigné pour lui succéder, mais il refusa cet honneur, en disant qu'en prenant le commandement de sa compagnie, il avait contracté des obligations sacrées envers les parents de ses hommes, qu'il avait commencé la campagne avec eux et qu'il voulait la finir avec et prés d'eux.
Le nouveau chef de bataillon fut un Italien de Gênes, M. Baghetti.
Cet officier exigea des honneurs extraordinaires. Tous les matins avait lieu un rassemblement en armes. Le jour de sa prise de commandement M. Baghetti fit défiler les compagnies au port d'arme. Le lendemain, il voulut qu'il en fût de même. La compagnie de Bône défila, mais l'arme sur l'épaule.
Furieux, le commandant fit appeler le capitaine Genova, qui lui répondit assez vertement, et avec juste raison, qu'il était venu en France pour faire la guerre et non pour jouer au soldat et faire de la parade, que, d'ailleurs, ces honneurs n'étaient pas réglementaires et qu'il n'en avait que faire.
La réplique ne fut pas longue à venir. La compagnie fut envoyée en reconnaissance dans les bois de la Crochère et on la laissa 24 heures sans lui envoyer de vivres. Les hommes avaient, heureusement, emporté du pain dans le capuchon de leur caban.
Il est inutile d'insister sur le procédé.
Le bataillon partit pour Auxonne. Les deux morts de la compagnie avaient été, dès le 26, remplacés numériquement, par Galardi Jean, N.M. 66, et Ghirardi (Pietro), N. M. 67.
Malgré ses préventions contres les Bônois, le commandant était contraint de rendre hommage à leur bravoure. Un jour, il fit appeler le capitaine et lui dit : " J'ai besoin de vos lapins pour occuper un village où les Allemands viennent se ravitailler ". Le capitaine Genova répondit : "Mes hommes n'en peuvent plus, mais je suis à votre disposition. Donnez-moi des hommes frais. "
Puis, sans tenir compte de sa propre fatigue, il partit pour Champevent, à sept ou huit kilomètres de Dôle, avec deux compagnies, que celle de Bône vint renforcer le lendemain.
Une barricade fut construite à l'entrée de la rue principale ; la moitié de l'effectif prit le service de surveillance, le reste se coucha tout habillé.
Mais l'ennemi avait dû être averti, car les hulans qui venaient tous les jours, escortant des charrettes destinées à emporter des provisions de pain, ne parurent pas ; quelques patrouilles se montrèrent sur les crêtes. Après trois jours d'attente, le détachement rentra à Auxonne, le 30 janvier. Le volontaire Vicari fut licencié.
Le premier février, à trois heures du soir, l'armée des Vosges apprit qu'un armistice avait été signé mais qu'elle-même était exceptée de cet armistice. Ce fut une surprise générale et, faut-il l'ajouter, un désarroi assez compréhensible.
Dans le bataillon de francs-tireurs, on discuta longuement. Les officiers se réunirent en Conseil de guerre. Les hommes se tenaient sur les glacis, après avoir laissé leurs sacs dans les casemates et ils attendaient assez inquiets ce qui allait résulter de cette discussion.
Le commandant voulait rester dans la ville, à l'abri des remparts et attendre qu'il ait été statué sur leur sort. Le capitaine Génova fit remarquer que devenus gens d'exception, ils étaient dangereux pour les autres et que, partant de ce principe, les habitants de la ville se montreraient certainement hostiles à leur égard, comme on pouvait déjà s'en apercevoir. Il ajouta que le commandant ferait ce qu'il voudrait mais que lui-même renonçant à ses habitudes d'obéissance et de discipline, quitterait les autres compagnies : il ne voulait pas être fait prisonnier et être dirigé sur l'Allemagne.
C'était d'ailleurs un plan bien arrêté dans son esprit, car il avait déjà envoyé son sergent-major dans la ville pour acheter du pain, du vin et du fromage (29 fr. 05).
Son avis finit par prévaloir et à quatre heures du soir, il prit l'avant-garde et se dirigea, avec un guide, sur Châlon, emmenant, avec ses hommes, les subsistants français de la garnison, soit une quinzaine de zouaves environ.
A la tombée de la nuit, on aperçut un grand feu ; les éclaireurs apprirent que c'était une meule de fourrage qui brûlait. A minuit, on fut en face de Saint-Jean de Lôsne. Le pont était coupé. La compagnie passa la Saône avec des barques, puis ce fut le bataillon, suivi de la 2ème brigade garibaldienne (général Ricciotti Garibaldi).
Le lendemain matin, on était à Châlons-sur-Saône. Le capitaine y acheta 24 musettes (à 2 fr. 30) pour remplacer les sacs laissés à Auxonne.
La compagnie gagna ensuite le Creusot. Le sergent Bonnefoy, blessé le 22 janvier, mourut, à l'hôpital de cette ville, le 6 mars.
Le 21 février, la ville de Bône envoya un mandat de 1000 francs.
Dirigés sur Autun, les volontaires y furent désarmés puis dirigés, par chemin de fer, sur Marseille où ils arrivèrent le 18.
Avant leur départ, ils avaient été l'objet de propositions de la part de meneurs qui voulaient les emmener à Paris et les enrôler dans les troupes de la commune. Je laisse à penser les réponses qui furent faites.
A Marseille, la compagnie se trouva diminuée des volontaires :
Chabrol qui se retira à Nîmes.
Blanc qui se retira dans les Basses-Alpes.
Denante qui se retira à Gordes (Vaucluse).
Basso qui resta à Marseille.
Si l'on tient compte du départ de Kilfoumi parti, le 28 février, de Luzy, elle s'embarqua à l'effectif de deux officiers, trois sous-officiers, (dont le caporal Morlot nommé sergent), et 41 hommes, après avoir eu trois volontaires morts au champ d'honneur.
Elle toucha Philippeville le 20 et arriva à Bône le 21.
Le fanion fut déposé à la mairie.
Lorsque le Capitaine Maitrot écrivit cette page de notre histoire (1912), les survivants de cette héroïque phalange étaient :
Le capitaine Génova ;
Le sergent-major Guy;
Les volontaires Laurens, Lopez, Mégia, Teddé.
Le capitaine Xavier Génova appartenait à une des familles les plus anciennes de Bône.
Son grand-père, originaire d'Ajaccio, était sobrecargue (comptable) de l'association des Corailleurs Corses qui avait son entrepôt à Bône, au milieu de la rue Fréart, rue qui débouchait, à côté de la rue de l'Arsenal, sur la place de la Marine (place Faidherbe).
Le jour de l'Ascension, le 2 juin 1821, les corailleurs italiens et corses avaient tiré leurs barques, au nombre d'une soixantaine et montées chacune par 15 à 20 hommes, sur le sable qui se trouvait entre l'embouchure de la Boudjima et celle de la Seybouse et se livraient aux douceurs de la sieste, lorsque des montagnards de l'Edough les attaquèrent à l'improviste et firent un grand massacre. 200 Corses furent tués. Puis les attaquants se rendirent aux entrepôts, M. Génova s'y trouvait avec deux de ses employés. Ils furent massacrés sans pitié.
Ce fut en Corse un deuil général.
Puis un jour du mois de septembre, M. Génova rentra à Ajaccio. Il avait été recueilli, blessé d'un coup de yatagan à la tête, soigné et guéri, par le consul d'Angleterre qui habitait en face de I'entrepôt.
Son fils continua à venir à Bône. En 1834, il vendait, dans la rue Fréart, du vin, des fruits et des planches, puis retournait, en septembre, dans son pays, en emportant de la laine et du blé.
II vint s'établir définitivement à Bône, avec sa famille, en 1858.
Un siècle plus tard, il y avait encore à Bône un Xavier Génova, docteur en médecine, dont je suis fier d'avoir été l'ami.
Et si, à mon époque, la rue Génova n'était plus une grande artère de la ville, elle évoque encore pour moi quelques souvenirs attachants : ainsi ce Palais Consulaire, construit à son entrée, abrita les services de l'enregistrement où j'ai travaillé quelques années ; c'est dans ce même bâtiment que mon père installa l'agence de la Banque Populaire, après leur déménagement de la rue " des Volontaires " (pure coïncidence..) ; c'est à l'autre bout de cette rue, de l'autre coté de la place Faidherbe, que se trouvait le bureau de mon oncle Pierre Auriol, dans les locaux du Service de l'Hydraulique.
Et c'est en longeant cette rue que mon chien faisait un grand détour pour éviter l'entrée du cabinet d'un autre ami, le vétérinaire Pierre Fourcade…
Pierre LATKOWSKI
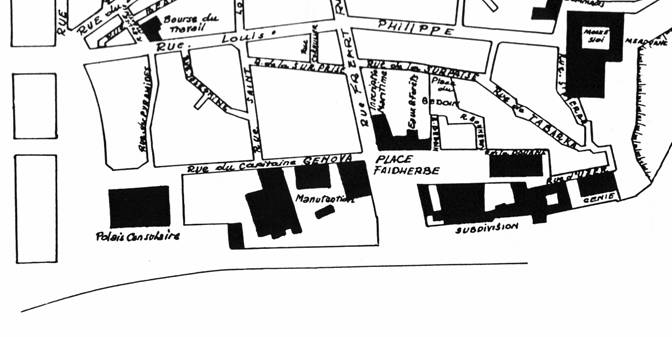 La place Faidherbe et ses environs, vers 1930
La place Faidherbe et ses environs, vers 1930
(Textes extraits du livre du Capitaine Maitrot, " Bône Militaire ", et de " Bône, son histoire, ses histoires ", de Louis Arnaud .)
| |
D'autres te le diront
Avec force et bagage
Sans fard ni ambages
Avec tact et adage
Sans faste ni ombrage !
Bidaoui du pays de la-bas,
Nul ne l'aura touché
Nul ne l'aura senti
Avec amour et passion
Cette terre que tu as quitté
Celle que tes mains ont embelli
Avec le goût de la raison !
Oui ! Elle t'a tout donnée
Le pain du blé
Du cheptel le lait
Du cep le vin tiré
Fruit, légume saisonnier
Amassé au grenier,
Mais il t'as fallu te lever
Aux aurores journaliers
Te coucher à l'étoilée
Le corps fourbu et cassé,
Certes tu n'était pas le premier
Mais cette terre tu l'as tant aimé !
D'autres se souviendront peut-être
Qu'aujourd'hui comme hier
Tu l'as pleuré celle qui t'a mariée,
Que tes aïeux ont défrichés
" Avec la part, vient la peine "
La peine de la retourner
La peine de la quitter
Chaque sillons furent Semés
Avec la vigueur d'un acharné
La rigueur, hivers été
Avec la part de ceux qui t'ont aidés
A l'instar de la fraternité !
Le 23 10 2005 Rio pierre
|
|
|
| ASPECTS ET REALITES
DE L'ALGERIE AGRICOLE
Envoyé par M. Philippe Maréchal N° 14
|
|
Par cette Brochure qui sera diffusée par épisode au cours des Numéros suivants, nous allons faire découvrir des aspects et des réalités qui ont été déformées par les fossoyeurs de l'Algérie Française et dont les conséquences se poursuivent et dureront encore plusieurs décénies.
Les Techniciens
De l'Agriculture Algérienne
Vous présentent
ASPECTS ET REALITES
DE
L'ALGERIE AGRICOLE
" Quand je débarquai à Alger pour la première fois, il y a une vingtaine d'années, j'éprouvai une impression à laquelle, j'imagine, un Français n'échappait guère. J'arrivais dans un des rares coins du monde où nous pouvions nous présenter avec orgueil. "
Jérôme et Jean Tharaud.
|
III - TEMOIGNAGES
B. -ALGÉROIS
Les bienfaits de la culture
du Cotonnier dans la région
d'Orléansville
PAR
Par Paul MOATI
Ingénieur Agricole (Alger 1945)
Ingénieur des Services Agricoles d'Orléansville (Alger)
La plaine d'Orléansville, selon une boutade célèbre et justifiée, peut se définir comme " une portion de Sahara égarée dans le Tell " : l'eau y est, plus qu'ailleurs, un facteur de vie.
Les premiers colons l'avaient si bien compris qu'ils avaient constitué, à la fin du siècle dernier, un syndicat d'irrigation chargé de gérer les premiers barrages installés sur les Oueds Sly et Chéliff. Mais c'est à partir (le 1936, lors de la mise en eau du barrage d'Oued Fodda, que la plaine d'Orléansville a droit à l'appellation de " périmètre irrigable " au sens moderne du mot.
Les deux tableaux ci-dessous donnent, pour 1952, le détail de la répartition (le la propriété entre les deux catégories ethniques de l'Algérie :
REPARTITION DE LA PROPRIÉTÉ IRRIGUÉE ENTRE EUROPÉENS ET MUSULMANS
Européens
Musulmans
|
Nombre de propriétés
|
Surface irriguée
|
RÉPARTITION DU NOMBRE DES PROPRIÉTÉS IRRIGUÉES
SELON LEUR SUPERFICIE
|
Européens |
Musulmans |
Total |
o à 1 ha
1 à 10 ha
10 à 50 ha
plus de 50 ha
|
|
|
|
Les petites et moyennes propriétés (90 %) dominent chez les agriculteurs européens.
La culture familiale est de règle chez les Musulmans puisque 86% de leurs propriétés couvrent de 0 à 10 hectares. Parmi les cultures qui se prêtent le mieux à ce mode de faire-valoir, celle du cotonnier occupe une place particulière. Sujette à des fluctuations importantes par suite de l'irrégularité des cours mondiaux, on l'a qualifiée de " culture à éclipses ". Cela est pleinement valable pour la culture commerciale qui, dans les propriétés moyennes ou grandes, européennes ou musulmanes, est coûteuse et exigeante en main-d'œuvre (120 à 160 journées par hectare), mais chez les petits propriétaires musulmans, on constate, depuis quelques années, que les superficies restent indépendantes des cours et qu'elles vont en s'accroissant régulièrement comme le montre le tableau suivant :
1953
1954
1955
|
Européens
Nombre
12
15
27 |
Surface
164 ha
305 ha
475 ha |
|
Musulmans
Nombre
44
84
119 |
Surface
130 ha
236 ha
360 ha |
|
Le cotonnier, en culture familiale, présente donc un grand intérêt. Certes, la vulgarisation des méthodes modernes est plus lente à cheminer dans les petites propriétés dont l'équipement est souvent insuffisant. Cependant l'action des services techniques et la proximité de propriétés servant de modèles ont heureusement influencé les méthodes de cette culture. Les dernières acquisitions de la technique : semis denses, variétés homogènes, fumure phosphatée, commencent à s'y répandre. C'est ainsi qu'en 1955 les rendements en coton furent les suivants :
Culture européenne ............ 12,5 quintaux/hectare
Culture musulmane ............ 10,0 quintaux/hectare
Ces quelques considérations montrent bien que le "miracle de l'eau " n'a pas été, dans la plaine d'Orléansville, l'apanage d'une seule catégorie d'agriculteurs. Mieux encore : à côté de la grande ou de la moyenne exploitation, la petite propriété musulmane ne fait pas figure de parente pauvre, grâce à la culture du cotonnier qui, par là même, mérite pleinement son autre appellation de " culture sociale ".
L'Introduction de la culture
de la Betterave sucrière
dans les périmètres irrigués
du Chéliff
PAR
Par Jean COLSON
Ingénieur Agronome (1944)
Directeur de la S.A.E.I.A.
de Malakoff (Alger)
Parmi les nombreux sujets de préoccupation que pose l'avenir de l'économie algérienne, deux d'entre eux sont particulièrement à l'ordre du jour : l'industrialisation et la mise en valeur des périmètres irrigués.
1. L'Industrialisation.
Quel que soit l'effort accompli dans le sens de l'industrialisation, l'Algérie sera encore longtemps, sinon toujours, un pays dont l'économie restera axée sur l'agriculture. Vues sous cet angle, les possibilités d'industrialisation offrent un choix intéressant, quoique plus restreint : création de sucreries, brasseries, minoteries, conserveries, etc.
II. La mise en valeur des périmètres irrigués.
Elle pose un problème au moins aussi complexe. Ne s'agit-il pas, en effet, de provoquer une véritable révolution dans la structure de certaines zones agricoles en essayant de modifier radicalement la manière de vivre d'une majorité d'agriculteurs ? Alors que ceux-ci pratiquent jusqu'à présent, en culture sèche, des assolements du type biennal (jachère-blé) ou triennal (jachère-blé-fourrage), on leur propose de planter des vergers et de se lancer dans des cultures industrielles et fourragères.
Cette façon de voir, parfaitement justifiée dans son principe, implique la nécessité d'une importante réforme agraire dont l'application risque d'être fort délicate ; elle ne pourra être réalisée qu'à certaines conditions dont les principales semblent être les suivantes :
- accorder aux agriculteurs les moyens financiers nécessaires ;
- Périmètre d'Orléansville : canal d'irrigation. (Cliché Jean Guglielmi)
- prévoir l'aide technique indispensable pour la mise en place des nouvelles cultures;
- assurer des débouchés à la production.
Du point de vue financier, un certain progrès a déjà été fait depuis près de deux ans, grâce à l'octroi de prêts à moyen terme et à faible intérêt. Mais les agriculteurs semblent hésitants pour deux raisons :
- D'une part, la peur d'un échec en face des investissements énormes que représentent pour eux les frais de nivellement des terres, l'achat de matériel de traction et d'instruments aratoires perfectionnés, qu'implique obligatoirement la culture intensive ;
- d'autre part, ils répugnent à hypothéquer leurs terres pour garantir les prêts.
- Du point de vue technique, les agriculteurs sont très insuffisamment assistés. Les Services Agricoles disposent d'ingénieurs de qualité, mais qui doivent contrôler des superficies beaucoup trop importantes pour agir avec le maximum d'efficacité. Cela est d'autant plus inquiétant que, à part quelques exceptions, l'agriculteur des périmètres irrigables n'est guère au courant des derniers progrès techniques. Ces progrès apparaissent dans les grandes exploitations qui appartiennent, le plus souvent, à des sociétés ayant à leur tête des ingénieurs ou un personnel qualifié. Ce fait important pourrait du reste permettre de conclure que certains projets faisant partie de la réforme agraire risquent ainsi d'aller à l'encontre de la mise en valeur et mériteraient d'être étudiés de plus près.
La question des débouchés est un point délicat. Quelles cultures intensives choisir, en dehors de l'arboriculture, et quelles spéculations suffisamment rentables est-il possible d'implanter en assolement avec les céréales que l'on ne peut effacer d'un trait de plume ? Plusieurs plantes ont retenu l'attention : la betterave à sucre, le cotonnier, le maïs hybride et le ricin. Leur introduction a fait l'objet d'études et d'essais approfondis. Dans le cas particulier du Haut et du Moyen-Chéliff, le développement de la betterave à sucre est souhaitable. A priori, le fait de parler de betterave à sucre risque de faire sourire, sinon s'indigner toute personne au courant des difficultés économiques de la Métropole. Les journaux spécialisés ne font-ils pas mention des excédents d'alcool et de sucre ? Examinons les faits le plus objectivement possible en nous basant sur les chiffres des importations de sucre en ce pays de 1948 à 1953 (d'après les statistiques des Douanes).
1948 : 57.000 tonnes 1951 : 128.000 tonnes
1949: 95.000 tonnes 1952 : 135.000 tonnes
1950 : 112.000 tonnes 1953: 142.000 tonnes
Ainsi, la moyenne de l'augmentation de la consommation est d'environ 14.000 tonnes par an. Par ailleurs, depuis 1953, une sucrerie est entrée eu fonctionnement en Oranie, dans la région de Mercier-Lacombe, et sa production actuelle évolue entre 3.000 et 4.000 tonnes par an. Le projet d'installation d'une nouvelle industrie de ce genre dans les périmètres irrigués du Chéliff concerne la production, dans quelques années, de 8.000 tonnes de sucre. On voit donc que ces deux usines ne produiraient, en définitive, qu'un tonnage légèrement inférieur à l'augmentation annuelle de la consommation algérienne. Il n'apparaît donc pas que le projet de mise en route d'une deuxième sucrerie risque de provoquer un grand bouleversement dans les exportations métropolitaines qui pourront continuer à s'accroître vers l'Algérie.
La culture de la betterave est-elle techniquement possible ? Les essais entrepris à une assez grande échelle permettent de répondre par l'affirmative. Les rendements moyens obtenus depuis plusieurs années dans les plaines d'Affreville et d'Orléansville atteignent aisément ceux de France (30 tonnes à l'hectare), et parfois certains records californiens (60 et même 80 tonnes à l'hectare).
Du point de vue social, cette culture, très exigeante en main-d'oeuvre, procurera une importante source de travail. En effet, la mise en route d'une sucrerie traitant 80.000 tonnes de betteraves permettrait de distribuer à la main-d'oeuvre régionale près de 100 millions de salaires par an.
Il apparaît donc que l'introduction de la betterave industrielle dans la plaine du Chéliff se justifie économiquement, techniquement et socialement.
A SUIVRE
|
|
QUAND L'ORAGE PASSA
DIVAGATIONS
|
AGADES (1967 )
Encore un tir de fusée, encore du désert, comme si ma spécialité était le chameau et les dunes. C'est un peu vrai, encore que les reportages métropolitains ne soient pas à dédaigner, loin s'en faut mais il leur manque la saveur que donne aux autres voyages cette pincée de sel qui en relève le goût.
Notre mission, en allant à AGADES, restait dans de domaine de l'utopie.
Il fallait photographier une fusée, plus exactement un engin balistique, tiré de la base d'Hammaguir sur une borne géographique située à quelques 3000 kilomètres. La ville la plus proche était Agadès. Le tir aurait lieu de nuit, l'engin prendrait ses repères sur "Castor et Pollux" deux étoiles dans la Constellation des Gémeaux.
Nous devrions filmer et photographier une traînée blanche, au moment de la rentrée dans l'atmosphère de notre engin.
Voilà les données de départ, celles que nous ruminons mon ami Duru et moi, dans le vieux DC 3 qui nous pose sur la piste d'Agadès.
J'avoue avoir été surpris tant par la ville que par le côté spartiate de notre installation. Un camp de tentes avec comme couchage des lits "Picot" connus de toute l'Armée française. AGADES, est renommée par sa croix. C' est la représentation d'une constellation très visible dans l' Hémisphère Sud. Comme nous nous trouvons au Nord, mais assez près de l'Equateur, l'étoile qui détermine le sud paraît extrêmement excentrée. Cette figure de constellation est reproduite par les bijoutiers indigènes.
La Croix du Sud n'est façonnée qu'en argent, l'or étant maléfique, dixit la coutume locale. Vous dire que le départ de l'engin eut du retard et que les tirs furent reportés de jour en jour et ce, pendant des semaines, cela présente un intérêt très relatif. Nos occupations restaient essentiellement axées sur le tourisme si l'on peut assimiler ce terme aux découvertes que nous fîmes.
Nous étions en période de Ramadan et toute la population était musulmane. A cette occasion, il y avait des fêtes et les soirées se terminaient tard dans la nuit.
Sur la grande place de la Mosquée, dès que le soir tombait, un marché extraordinaire s'implantait : On y vendait des femmes. ! Celles -ci, veuves , divorcées, répudiées, des cas sociaux, dirions-nous, étaient présentées à la vente. En tout une bonne dizaine de personnes, emmitouflées dans leurs larges vêtements noirs . On ne distinguait pas grand-chose.
Qu'à cela ne tienne, une "vendeuse" vous permettait, à la lueur d'une bougie, de distinguer quelques traits de ces visages tristes.
La palpation était autorisée au-dessus de la ceinture et l'on pouvait demander à voir la dentition...
Qu'on me jette la pierre, qu'on me couvre d'opprobre, je marchandai (comme le veut la coutume) et achetai une jeune personne de 26, 30 ans prénommée Douéla, pour 300 francs français (150 frs C FA)
J'avoue avoir eu quelques remords à participer au plus vil des commerces, celui d'un être humain, mais, avant de me juger, attendez la fin.
Embarrassé par mon acquisition, car je ne savais où loger, elle me fit comprendre qu'elle habitait dans le XVIéme, un quartier d'Agadès ainsi nommé, par dérision, par les Officiers et Sous-officiers de l'Armée Française.
La maison était d'une simplicité biblique, des nattes pour dormir sur la terre battue, pas de meuble, quelques cruches d'eau posées çà et là garnissaient l'espace.
 Douéla était veuve. C'est le mari qui doit subvenir aux besoins de sa femme. Sans son époux toutes les portes s'étaient fermées, et les jeûnes devinrent de plus en plus fréquents. Il lui fallait trouver une solution, se vendre pendant le Ramadan en était une, mais elle n'avait jamais dû penser qu'un tir d'engin lui aurait amené un blanc sur sa natte. Les Indigènes disent que les Blancs sentent le cadavre, nous, nous disons que les Noirs dégagent une odeur proche de celle du lion. Vrai, faux, les senteurs du Sud sont certainement plus poivrées, plus relevées, mais c'est le pays tout entier qui en exhale le parfum.
Ne demeurant plus dans le camp, il fallait que je trouve un moyen pour me rendre rapidement auprès de l'Etat-Major pour prendre les dernières nouvelles de ma mission. Le marché d'Agadès me donna la solution. Je trouvai là un beau cheval arabe, un peu trop fougueux à mon goût, dont je fis l'acquisition pour une somme folle puisque c'était exactement le double du prix payé pour Douéla.
Je suis loin d'être un maquignon, car si j'avais été un peu plus compétent j'aurais dû me rendre compte que le mors avait été remplacé par du fil de fer barbelé. Technique barbare qui blessait la bête, l'irritait, quand on tirait trop sur les rênes. Par chance Douéla me trouva un mors convenable et mon cheval devint plus docile et moins fougueux. Le plaisir de Douéla était simple. Elle s'attifait de sa plus belle robe, aux couleurs des plus criardes, nouait artistiquement un foulard sur sa tête avec quelques pointes, et montait en amazone sur mon cheval. Ainsi, nous formions un équipage des plus remarquables s'il avait défilé dans les rues de Paris mais, à Agadès, peu de gens levaient les yeux sur nous, peut être parce qu'à l'époque je fumais la pipe et que le tabac hollandais faisait retrousser le nez des autochtones peu habitués à ces odeurs pendant cette période de jeûne.
C'est dans cet équipage que nous pûmes saluer le sultan d'Agadès caracolant sur son cheval gris et qui, précédé de ses serviteurs, de ses douze femmes et de sa garde , démontrait à tous sa puissance et sa virilité. C'était là un fait exceptionnel, qui n'avait lieu qu'à la fin du Ramadan.
J'étais plongé dans le Moyen âge, les règles de notre civilisation n'avaient plus cours, on vendait des esclaves, on vendait des femmes, le seigneur avait son palais et, du haut du minaret , le muezzin appelait à la prière.
Les maisons étaient en torchis, pas une trace de goudron sur les routes, des chemins sablonneux qui ne menaient nulle part, de l'eau, rare et précieuse, et de la poussière, encore de la poussière qui s'infiltre partout. Le service de voirie était confié aux vautours, bêtes hideuses mais nécessaires. J'avais reculé de X siècles !
Le XXéme me rattrapa vite et, un soir , on vit une traînée blanche, assez basse sur l'horizon. Notre engin avait décollé mais impossible d'en photographier la trajectoire en plein ciel. II fallait maintenant retrouver les morceaux, en principe près de la balise géographique. Nous partîmes tôt, car les blédards se méfient du soleil. Trois jeeps sur des pistes dignes du Paris-Dakar, encore inconnu, pour le plus grand bien du Sahara. La balise se trouve à une cinquantaine de kilomètres d'Agadès . Nous arrivâmes sur les lieux après 3 heures de secousses souvent incontrôlées et difficiles à anticiper. Ouf ! nous y voilà ! Le temps d'ôter la poussière de nos yeux, nous apercevons un monument, avec un socle en pierre, surmonté de barres en fer forgé lui donnant un côté architectural très fin de XIXéme.
C'est notre balise, avec autour des morceaux de ferraille, les restes de notre engin. Les plus près sont à moins de 5 mètres, j'en suis ébahi.
Un coup au but tiré depuis 3000 kilomètres, voilà qui peut donner à réfléchir. Techniquement c'est formidable, mais d'un point de vue militaire cela reste effrayant.
Pour ceux que les coïncidences amusent, qui aiment le paradoxe des symboles qui se mêlent et s'entrechoquent, je décrirai le voisinage immédiat de notre borne géodésique. Tout près, à moins de 100 mètres une tente de Targui avec sa famille. Ils ont entendu un grand sifflement et des bruits de ferraille.
J'ai sympathisé avec un jeune garçon qui avait un panaris à un doigt. On ne voyait pas le pus, l'enflure était recouverte de crasse. Un peu d'alcool, et j'ouvris l'excroissance avec mon canif. Un pansement et, en prime, j'offris le couteau au garçon. Ils n'avaient rien, mais ils ont tenu à m'offrir un cadeau, un lit touareg pour poupée. Mes filles s'en souviennent peut être encore. Mais le plus incroyable est qu'ils m'amenèrent vers un tumulus qu'ils prétendirent être la tombe d'un dinosaure.
Je fus sceptique, mais les pierres taillées dites " en tranche d'orange", les pointes de flèches, dissipèrent mon doute. J'en ramassai quelques unes que je possède encore.
Ainsi, sur moins de 2000 mètres carrés, se trouvaient réunis par le plus grand des hasards, la réhistoire, la vie actuelle des nomades et des morceaux d'engin de haute technologie. Ma mission se terminait, je vendis le cheval, donnai la moitié du prix à Douéla, ce qui représentait pour elle une belle somme, et je quittai Agadès, avec beaucoup de souvenirs, mais aussi avec un sentiment de révolte pour le marché d'esclaves toujours florissant vers les capitales de l'Arabie.
| A SUIVRE
Histoire écrite en l'an 2001 par Robert ANTOINE
Photographies de l'auteur
A ma femme, à mes filles
A M. et Mme Roger Fauthoux
A ceux qui m'ont aidé à retrouver
une documentation perdue
M. ANTOINE nous fait l'honneur de la diffusion, par épisodes sur notre site, de ce livre de souvenirs. Pour ceux qui voudraient posseder ce livre, il est vendu par l'auteur au prix de 25 Euros (hors frais d'envoi).
Adresse de courriel, cliquez ICI --> : M. Robert Antoine
L'adresse du site de STAOUELI: http://www.piednoir.net/staoueli
|
|
| Bien fait !
Envoyé par M. Marcel Treels
| |
Une femme rentre tôt chez elle et trouve son mari dans leur chambre en train de faire l'amour avec une jeune femme belle et sexy.
- Espèce de porc infidèle et irrespectueux ! Qu'es-tu en train de faire ? Comment peux-tu me faire ça à moi, ton épouse fidèle, la mère de tes enfants ! Je quitte cette maison, je demande le divorce !
Le mari répond :
- Attends, attends une minute ! Avant de partir, laisse-moi au moins te raconter ce qui s'est passé.
- Hummmmm, je ne sais pas ; bon, c'est la dernière chose que j'entendrai de toi. Mais fais vite, porc infidèle.
Le mari commence à raconter son histoire..
- Je rentrais à la maison en voiture et cette jeune femme faisait du stop. Je la vis si désemparée que je m'arrêtais et la fis monter dans la voiture. Je remarquais qu'elle était très mince, pas bien habillée et très sale. Elle m'indiqua qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Compatissant et très ému, je l'amenai à la maison et réchauffais les enchiladas que j'avais préparés pour toi la veille au soir et que tu n'aurais pas voulu manger parce que tu as peur de grossir ; la pauvre petite les a pratiquement dévorés. Comme elle était très sale, je lui ai proposé de prendre une douche. Pendant qu'elle se douchait, j'ai remarqué que ses vêtements étaient sales et plein de trous, alors je les ai jetés. Comme elle avait besoin de vêtements, je lui ai donné un jean que tu avais depuis quelques années et que tu ne peux plus porter parce qu'il est trop juste ; je lui ai également donné la chemise que je t'ai offerte à l'occasion de ton anniversaire et que tu ne portes pas parce que je n'ai pas bon goût. Je lui ai donné le pull que ma soeur t'a offert à Noël et que tu ne porteras pas juste pour embêter ma soeur et je lui ai également donné les bottes que tu as achetées dans une boutique de luxe et que tu n'as plus jamais portées après avoir vu ta collègue porter les mêmes.
Le mari continue son histoire :
- La jeune femme m'était très reconnaissante et je la raccompagnais à la porte. Quand nous fûmes devant la porte, elle se retourna vers moi et, les yeux se remplissant de larmes, me demanda :
- Monsieur, avez-vous autre chose que votre femme n'utilise pas ?
|
|
|
Cette France que j’ai...... j'aime tant !
|
Oui cette France qui fut mienne de 1938 à 1962 (date de ma naissance, et celle de l’abandon du département qui m’a vu naître), puisque né dans un département français d'Algérie, au même titre qu'un savoyard ou un niçois et bien d'autres !
Cette France pour laquelle j'ai versé mon sang le 2 juin 1956. Cette France pour laquelle je me suis engagé dans les formations supplétives de l'Armée Française de 1958 à 1961. Cette France n'existe plus.
Cette France que les politiques : de gauche d'abord, de la majorité actuelle ensuite bradent à qui mieux mieux.
Cette France qui ne cesse sa repentance ! A quand l'inscription de la repentance dans la constitution française ? Au sommet de l'Etat, son chef leur emboîte le pas en créant une commission "Théodule" qui va se pencher sur le sujet.
Notre France, celle que j'aime est en danger, en danger mortel. Je dis halte à ces jérémiades de mauvais aloi. Je demande à mes compatriotes d'Outre mer et principalement aux "Pieds-Noirs" d'Afrique du nord, réveillez-vous, la Patrie est en péril, ne permettez plus que l'on déshonore l'œuvre accomplie par nos valeureux ancêtres depuis 1830. Ces caciques de la repentance oublient un peu vite que leur liberté d'expression ils la doivent à la glorieuse Armée d'Afrique qui est venue les en délivrer du joug Nazi en 1940, bel exemple de gratitude.
Notre tour est venu,nous les Pieds-Noirs, de sauver une nouvelle fois notre Patrie en nous révoltant contre cette falsification de notre histoire nationale.
Je dis NON, trois fois non, écartons ces parlementaires, je devrai plutôt dire ces fonctionnaires de la politique dont le siège et les prébendes sont plus importants que l'intérêt national. Il ne leur manque plus qu'un syndicat, cégétiste de préférence. Ils n'ont d'yeux que pour leur marocain ou le douillet fauteuil des Assemblées.
Je dis NON, à un Président étranger "ex colonisé" qui s'immisce dans la gestion de notre pays. Il n'hésite pas à profiter honteusement de nos hôpitaux, comme les six millions de ses compatriotes.
Le temps de la stupeur doit cesser, il nous faut maintenant passer à l'action et agir. Mes chers compatriotes secouez-vous, inondez vos élus de lettres, de, d'appels téléphoniques, de SMS, de fax pour leur demander d'assumer leurs responsabilités, et ce tous les jours sans arrêt jusqu'à ce que notre voix soit entendue. Point n'est besoin de brûler des véhicules et des biens, encore moins d'assassiner d' innocentes victimes. Notre combat doit être digne et républicain.
Chaque Pieds-Noirs, chaque citoyen a le devoir impératif d'intervenir par le moyen de communication qui lui semble le plus approprié auprès de ses élus, en commençant par le conseiller municipal pour en terminer par le représentant au sommet de l'Etat (c'est d'ailleurs le seul à qui l'on peut écrire gratuitement.)
Stop, arrêtez, Trop c'en est trop, l'histoire est ce qu'elle est bien sûr. Cela suffit de regarder par le petit bout de la lorgnette. Cette vision honteuse et démesurée tire un trait sur l'œuvre et la prospérité de nos anciennes colonies et départements français d'outre mer, ceux-là même qui aujourd'hui, vivent grassement de l'argent du contribuable français.
Chers contestataires, si vous avez honte d'être français, vous devez abandonner la nationalité française que l'on vous a généreusement accordée. Le monde est assez vaste pour vous accueillir, alors je vous le dis tout net : Fichez le camp !
Je suis français et fier de l'être, et vos jérémiades m'agacent.
Christian MIGLIACCIO
|
|
Français, à force de ne point vouloir entendre le tocsin,
c'est le glas qui finira par sonner...
La guerre d'Algérie a été une guerre ethnique et religieuse. Plus simplement, je dirai qu'il s'est agi d'une guerre raciale. Je m'explique. Quand on considère l'humanité, l'emploi du concept de race ne repose pas toujours sur la prise en compte de différences concrètes - anatomiques en particulier - comme celles qui peuvent séparer la race noire de la race jaune. C'est ainsi qu'on a habituellement parlé, par exemple, de race germanique. La spécificité prise en compte n'était point tant anatomique que fondée sur des caractères imposés par l'ethnie, l'histoire, la géographie, la culture, la langue, la religion. Je prétends donc que quand les activistes arabes ou berbères souvent musulmans ont décrété - plusieurs années avant le début de la guerre - " la valise ou le cercueil " pour les Européens et pour les Juifs francisés par le décret Crémieux, il y avait là le préambule d'une guerre raciale. II pourrait être objecté à cette interprétation de guerre raciale que le prétendu F.L.N. a tué beaucoup plus de musulmans que d'Européens, entre 1954 et 1962. Mais ces massacres étaient nécessaires pour arriver à ses fins : le départ ou la mort pour les Européens et les Juifs, objectif qui était impossible tant que la confiance régnait entre toutes les communautés.
La stratégie du prétendu FLN.
Avant les premiers attentats de la Toussaint de 1954, les révolutionnaires les plus déterminés, les plus acharnés, les plus pressés d'atteindre la sécession et l'indépendance se savaient extrêmement minoritaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette poignée d'hommes, dirigés par Boudiaf, s'est séparée au cours de l'été 1954 de Messali Hadj, qui, quant à lui, était persuadé que le moment de l'action n'était pas encore venu. Boudiaf et ses complices comptaient sur une arme absolue pour remédier à leur extrême faiblesse numérique : la terreur, fondement de toutes les guerres révolutionnaires. La terreur n'a pas été un recours auxiliaire à d'autres formes de combats. Elle a été la stratégie même de la guerre révolutionnaire menée par ces activistes. La terreur, qui par son horreur fait sortir la lutte de toute mesure humaine et qui est destinée à neutraliser et à faire basculer une population entière, a reposé sur plusieurs principes. Le premier de ces principes était sans doute de frapper des innocents. Certes quand l'agent local du F.L.N. a coupé le nez et les lèvres de l'habitant qui avait fumé un jour d'interdiction, c'était pour que le spectacle du supplicié invite chacun à l'obéissance la plus totale au représentant du nouveau pouvoir. Mais dans la majorité des cas, les victimes se comptaient aussi bien parmi des hommes innocents que parmi des femmes, des enfants, des bébés. Car, si les exactions ne s'en prennent qu'aux personnes qui se sont " mouillées " avec le système régnant (élus des différentes assemblées et conseils, gardes-champêtres, anciens combattants, caïds) leur assassinat risque de laisser indifférente la masse de la population qui ne se sent pas concernée. C'est le supplice de l'innocent qui engendre réellement la terreur chez tous, laquelle ouvre la voie aux soumissions les plus serviles.
Le deuxième principe se trouvait dans une cruauté sanguinaire et sadique, souvent aggravée par un recours aux monstruosités sexuelles, ajoutant l'humiliation à la souffrance. Ce sont les individus horriblement mutilés et suppliciés, écartelés ou bouillis, écorchés vifs, pendus à des crocs de boucherie. Les enfants, même les bébés ont pu être mutilés à la hache ou ont eu la tête fracassée contre un mur ou contre un arbre. Les femmes, même les plus jeunes gamines ou les personnes les plus âgées sont systématiquement violées avant d'être mises à mort. Des femmes enceintes ont été éviscérées. Dans de nombreux cas, des hommes ont été retrouvés avec les sexes coupés et placés dans la bouche. J'ai connu un caïd de Grande Kabylie, fidèle à la France contre vents et marées, à qui le F.L.N. a tué tous ses fils, au fil des mois et des années, jusqu'à réduire cet homme au plus total désespoir et à la mort lente.
Le troisième principe résidait dans l'ampleur des massacres. Pendant les huit ans de cette guerre, ce sont des centaines de milliers d'êtres humains qui ont été mis à mort, le plus souvent après avoir été suppliciés : terrorisme urbain avec ses attentats individuels, ces bombes dont chacune a tué ou mutilé des dizaines de personnes, hommes, femmes et enfants ; terrorisme rural pouvant aller jusqu'à l'extermination de douars entiers où pas un seul être humain n'a été retrouvé vivant. Il est vrai que les révolutions se complaisent dans le sanguinaire. Les révolutions françaises ou bolcheviques en sont de remarquables illustrations. Mais le sadisme du prétendu F.L.N., les raffinements dans l'horreur, les massacres de masse semblent sortir de l'ordinaire. En outre, n'est il pas remarquable que ces abominations se répètent à l'identique en Algérie depuis 1992, dans un contexte ethnique, politique et social complètement différent ? Il est permis de se demander s'il n'y a pas là un caractère atavique, susceptible d'être rapproché des dispositions impitoyables et même féroces de la charia, en union profonde avec les mentalités des tribus au sein desquelles est née la religion du Prophète...
Etait il possible de ne rien faire face aux crimes perpétrés par cette minorité dont le nombre hélas est allé en s'étoffant au fil du temps ? Car trop souvent pour n'être point supplicié, il n'y avait d'autre échappatoire que de devenir tortionnaire.
Un autre caractère de la guerre que les révolutionnaires nous ont faite en Algérie, mérite d'être rappelé et souligné. Pendant des siècles, pour tenter de diminuer les horreurs des batailles et en particulier pour soustraire les populations civiles au fer et au feu, les militaires - éléments actifs du combat - portaient un uniforme qui les désignait à leurs ennemis comme à leurs compagnons de lutte. Même si elles ont souvent été violées, les lois sacrées de la guerre imposaient de ne pas attaquer des civils ; c'est-à-dire ceux qui ne portaient pas d'uniforme. Le fait avait une contrepartie évidente et légitime : quiconque combattait dissimulé sous des vêtements civils profitait scandaleusement de ces lois sacrées. Dans les grandes guerres mondiales du XXème siècle, il était habituel qu'un tel tricheur fût passé par les armes après un jugement sommaire. Or, pendant la guerre subversive algérienne, les poseurs de bombes, les égorgeurs des passagers d'un autocar ou des habitants d'un douar entier étaient souvent en civil. Leur forfait accompli, ils s'immergeaient instantanément dans la population où ils disparaissaient comme un poisson dans l'eau. Pour les retrouver, il était d'une nécessité absolue de faire parler, et les moyens de faire parler au sein d'une population terrorisée, ne pouvaient relever de la seule dialectique ou de la persuasion douce. Pour combattre ou châtier ces tueurs, les risques étaient grands d'atteindre certains des innocents : elles avaient toute chance de dresser contre nous une population qui jusqu'alors nous était favorable. Nous n'avions pas choisi ces conditions du combat.
La tactique des forces françaises
La police, la gendarmerie et bientôt surtout l'armée française ont eu à faire face à la fois à cette subversion illégitime et en même temps à cette stratégie monstrueuse, toutes fondées sur la terreur érigée en système.
Ces conditions particulières, typiquement révolutionnaires, leur ont imposé un des éléments de la tactique propre à cette guerre d'Algérie. Quand - comme pendant la bataille d'Alger de 1956-57 - quotidiennement des bombes explosaient en ville, dans les endroits les plus fréquentés, fauchant une multitude de vies innocentes, pouvait-on rester sans réagir? Le seul recours n'était il pas de faire parler un suspect ou un poseur de bombes arrêté, pour localiser la cache d'autres engins prêts à l'usage, pour s'en emparer et les détruire ? Quand une équipe de tueurs parcourait une région, assassinant sans relâche, jour et nuit, n'était-il pas un devoir de faire parler tel ou tel de leurs complices ou de leurs sympathisants pour les identifier, les localiser et les mettre hors d'état de nuire ? Les forces de l'ordre ont donc eu à recourir à des interrogatoires douloureux, actuellement qualifiés de " tortures de l'armée française. A l'évidence ces pratiques ne sauraient être comparées à la terreur stratégique mise en oeuvre par le prétendu F.L.N. A la limite, il est inadmissible d'employer les mêmes termes pour les deux phénomènes. Peut-on en effet honnêtement comparer ces interrogatoires, douloureux certes, même extrêmement douloureux mais ne faisant pas le plus souvent couler le sang , aux invraisemblables supplices et massacres de masse pratiqués tous les jours et partout par le prétendu F.L.N.? En outre, ces interrogatoires portaient toujours sur des suspects ou sur des coupables avérés, susceptibles de fournir des renseignements. Ils ne s'attaquaient jamais délibérément à des innocents. La pratique de ces interrogatoires était une nécessité tactique. Elle n'a évidemment jamais été une arme de combat pour faire basculer la population. Enfin, l'obligation de ces interrogatoires n'a jamais été la forme principale prise par l'action des forces de l'ordre. L'essentiel de cette guerre, surtout après 1958, s'est passé dans le bled, parfois en opérations de grande envergure. Celles-ci étaient rendues difficiles
par le relief, les broussailles, la rareté des routes, les conditions climatiques même. Elles ont reposé sur une observation patiente, parfois minutieuse, sur des marches parfois exténuantes de jour et plus encore de nuit et se déroulaient sous la menace constante d'être surpris par un ennemi connaissant parfaitement le terrain et bénéficiant de renseignements complices. Les forces de l'ordre ont toujours recherché le combat ouvert avec les groupes armés du prétendu F.L.N. dès que ceux-ci pouvaient être localisés, alors que ces groupes armés, cherchant le plus souvent à éviter l'affrontement, n'avaient pour objectif que de répandre la mort et la soumission dans les populations désarmées.
Cet obligatoire recours à des interrogatoires impliquant la souffrance - " les tortures de l'armée française - devait être pratiqué par des hommes, des soldats. Non point par des saints. Et malheureusement, il n'est pas impossible que cette pratique ait parfois éveillé, chez eux qui devaient s'y livrer, une sorte de fascination malsaine, d'instinct quelque peu sadique susceptible de sommeiller dans la créature humaine. Ce qui noircissait alors l'âme de l'interrogateur le rendait spirituellement aussi misérable que l'était physiquement l'interrogé. Mais décidément nous n'avions pas choisi cette guerre...
Au cours de cette guerre civile et pendant les opérations de maintien de l'ordre, il est arrivé que des personnes disparaissent. On en a conclu qu'elles avaient été " liquidées " par les " parachutistes ", nom générique destiné à désigner les éléments les plus abominables de l'armée française, elle-même pétrie d'abomination. Il est de bon ton de citer le nom de Maurice Audin, agent du P.C.A. clandestin, lequel apportait sa complicité à la subversion révolutionnaire. II y aurait eu des multitudes de ces disparus. C'est à se demander pourquoi alors on cite toujours Maurice Audin... Un certain général a publié un livre, inspiré par la provocation, par le désir de faire parler de soi - même en remuant l'infâme - et de s'aligner sur les bêlements du troupeau majoritaire. Et dans ce livre, ce général affirme que les forces de l'ordre se sont bien livrées à de telles liquidations. II faut en dire un mot.
Dans les conflits du passé, il n'y a pas eu de haute trahison en temps de guerre - fût-elle civile - qui n'ait pas été normalement sanctionnée par la peine capitale. II n'y pas d'action clandestine contre la France et ses défenseurs qui n'ait été passible du châtiment suprême. Mais dans ces conflits antérieurs, la sentence était régulièrement prononcée par un tribunal militaire avant de devenir rapidement exécutoire, dans une indiscutable légalité. La particularité des opérations en Algérie, c'est que le laxisme des autorités politiques - et à l'aval de celui-ci, le comportement de l'ensemble de l'appareil judiciaire et administratif - laissaient le champ libre à bien des trahisons, à bien des actions criminelles, visant à la généralisation de la terreur. Et dès lors, on a acculé les forces de l'ordre à exécuter dans l'illégalité et sous leur responsabilité morale les opérations que le pouvoir ne voulait plus ni commander, ni faire exécuter dans la légalité. C'est à ce pouvoir et à lui seul que reviennent l'opprobre, la honte et le déshonneur.
En fait, certaines unités des forces de l'ordre, dans les deux dernières années du drame, se sont livrées à de véritables tortures. Mais celles-ci sont les seules qui ne sont jamais dénoncées par notre intelligentsia et par l'histoire falsifiée. Il s'agit tout d'abord d'enlèvements d'Européens par des gendarmes mobiles - dénoncés par tant de témoins - qui remettaient leurs prises au FLN. à qui en général ils laissaient le soin de les torturer et souvent de les saigner à blanc. Mais, dans bien des cas, les unités des forces de l'ordre opéraient elles mêmes les tortures les plus affreuses, les crimes les plus sadiques et les mises à mort les plus injustifiées. Des unités stationnées à la caserne des Tagarins sont justement célèbres, mais ne sont pas hélas les seules à s'être livrées à ces pratiques abjectes. A ce sujet, on dit parfois que les victimes étaient des membres de l'O.A.S. Entendons par là que ces hommes, par leur activisme, avaient bien cherché le sort qui leur était échu. Tout d'abord, l'affirmation est fausse car bien des victimes, hommes et femmes, n'appartenaient nullement à l'O.A.S., et n'avaient pas participé à l'action de l'organisation. Par ailleurs, même en ce qui concerne les membres de l'organisation, rappelons que ceux-ci étaient animés par le souci patriotique de conserver nos départements à la France, et il est inadmissible que leur action leur ait valu un traitement aussi inhumain et qui soulèverait actuellement l'indignation où qu'il ait pu avoir lieu dans le monde.
A l'origine du drame
Les exactions massives et monstrueuses des purificateurs ethniques arabes ou berbères, les interrogatoires douloureux des forces de l'ordre, les tortures des patriotes perpétrés par les unités les plus serves sont les spécificités honteuses de cette guerre d'Algérie. Mais pourquoi cette guerre d'Algérie ? A l'origine se trouvent évidemment les volontés sécessionnistes et indépendantistes à fondement racial d'une minorité indigène, attisées par l'idéologie anti-française des communistes et par la haine religieuse des Oulémas ; l'une et l'autre ont joué sur les tensions dues aux différences ethniques et religieuses existant au sein des communautés d'Algérie. Mais cette inclination à la sécession existait antérieurement et a perduré tout au long de la paix française, s'embrasant - en général localement - pendant des épisodes tels que la révolte de Bou Hammama, celle de Mokrani, ou les événements de mai 1945 à Sétif et à Guelma. Pourquoi et à cause de qui les choses ont-elles tourné aussi tragiquement à partir de 1954 ?
Depuis des temps immémoriaux, le pouvoir et les devoirs de l'Etat reposent sur des valeurs sacrées. Parmi celles-ci, la sauvegarde du bien commun - conditionnant la survie même de la société - justifiait les châtiments les plus sévères à l'encontre des individus qui transgressaient les lois et les tabous, allant jusqu'à l'application de la peine de mort. Plus spécifiquement, la colonisation qui amenait la civilisation, était légitime et sa sauvegarde justifiait également des mesures nécessaires, si impitoyables fussent-elles. Laffitte dans son livre (1994) rappelle comment les velléités révolutionnaires ou subversives locales, suscitées par quelque Ouléma, étaient immédiatement étouffées dans l'oeuf - par exemple - en brûlant les mechtas d'où les agitateurs provenaient - ; le tout au bénéfice des populations qui continuaient ainsi à vivre en paix et dans l'harmonie des communautés. Au XX' siècle ces valeurs sacrées se sont attiédies ; puis, progressivement, elles se sont totalement évanouies. On est alors devenu compréhensif, voire complexé, face au révolté, au saboteur, à l'assassin. On a douté de la légitimité de la colonisation. Davantage encore : les éléments les plus noirs de l'intelligentsia ont suggéré un amalgame entre la résistance des Français à l'armée allemande occupante au cours de la Seconde Guerre Mondiale et les exactions des révolutionnaires algériens. Dès lors, nos capacités de réactions légales et légitimes étaient éteintes.
Dès avant le 1" novembre 1954, les services de police ont alerté le gouvernement français sur l'imminence d'actions subversives et sur l'identité de leurs auteurs ; rien n'eût été plus facile que de mettre hors d'état de nuire ces quelques dizaines d'activistes dont l'initiative allait entraîner des centaines de milliers de morts. Rien n'a été fait. Après le 1" novembre 1954, les actions armées criminelles ont de plus en plus ensanglanté le pays. Trop souvent, la justice n'a opposé à ces actions qu'un légalisme d'un formalisme paralysant quand ce n'était pas un laxisme caractérisé. Cependant, c'était déjà la loi martiale et sa justice expéditive qui s'imposaient. Dans ces conditions, les acteurs de la subversion recrutaient toujours plus d'émules et les partisans de la France ne pouvaient se trouver qu'envahis par le doute sinon le désespoir. La situation d'abandon dans laquelle se trouvaient les populations algériennes, ne tarda pas à devenir intenable. Le gouvernement fit alors appel à l'armée pour tenter de rétablir l'ordre, et celle-ci entra en action. Or l'armée sait surtout faire la guerre, même si, en Algérie, elle a su susciter des milliers de vocations d'administrateurs, d'éducateurs, d'infirmiers, d'assistants sociaux, etc. Malheureusement, en faisant la guerre, la répression ne pouvait plus être ciblée strictement sur les coupables. Les activistes frappés venaient souvent de se rallier à la rébellion, à leur corps défendant. Quant à leur entourage, inévitablement éclaboussé, il était constitué d'innocents, voire d'Arabo-Berbères fidèles à la France.
La mauvaise conscience et l'incurie des gouvernants et de la haute administration, l'inadéquation totale des règles et des principes de l'administration locale, en particulier de la magistrature, menaient ainsi inéluctablement au désastre final. Une telle situation était encore aggravée par la trahison permanente, ostentatoire, arrogante d'une intelligentsia animée par sa haine rageuse de la France ; culpabilisation, calomnie, démoralisation, collecte de fonds en faveur des tueurs, ravitaillement en armes et munitions et implication dans toutes les formes de la lutte armée anti-française. Tout y était ; et le tout généralement dans la plus totale impunité. Ce qui revenait de facto à donner raison à cette intelligentsia aux yeux de la France, de l'Algérie et du monde. Voilà comment nos gouvernants, notre administration, nos médias, ayant systématiquement plongé les départements algériens dans la guerre civile, s'en sont lavé les mains et ont confié plus que jamais la situation à l'armée.
Après 1958, celle-ci qui s'est crue investie enfin d'une mission claire, a à peu près rétabli la situation ; mais à quel prix ! Pendant ce temps, nos gouvernants étaient passés des doutes, des atermoiements et de la mauvaise conscience, à la volonté et à la détermination... de liquider ces douze départements français et de les remettre à nos pires ennemis que nous combattions pied à pied depuis des années !
Je ne cherche pas ici à blanchir les acteurs de la rébellion algérienne, les supplices et les massacres de masse qu'ils ont perpétrés pendant huit ans. Je ne cherche pas à louer les auteurs des interrogatoires douloureux, dont la simple considération de la situation justifie l'indispensable et ignoble travail. Mais je tiens à attirer l'attention sur le vrai coupable que personne, me semble-t-il, n'évoque jamais.
Oui, le vrai coupable, c'est en grande partie le mal français ; l'extinction du sacré qui sous-tendait la défense intransigeante de la France, des terres d'outre-mer, de l'ordre et de la société ; l'action - ou plutôt l'inaction - de gouvernants complexés, déboussolés, indifférents et déjà culpabilisés, abouliques.
C'est la perversité spirituelle d'une intelligentsia, tenant en ses mains - entre autres - l'enseignement et les médias, animée d'une hargne et d'une haine inusables à l'endroit de la France, de l'ordre et du bien commun. Dans ces conditions, la victoire de la minorité révolutionnaire de 1954, forte d'une détermination farouche, n'était-elle pas inévitable ?
Mais ces conditions ne confèrent-elles pas à la guerre d'Algérie une actualité aussi brûlante que cruelle ? N'est-ce pas l'aggravation de ce qui a fait la perte de l'Algérie qui fait actuellement le naufrage de la France ? Extinction des vertus sacrées, mauvaise conscience généralisée, perversion spirituelle et morale responsable d'une rupture sociale sans précédent dans notre histoire. II est inconcevable que les Français du temps présent ne tirent aucune leçon des événements qui ont entraîné l'agonie et la mort de l'Algérie Française. II est inconcevable que la considération véridique de ce drame ne les tire pas de leur apathie et de leur résignation, face à la désagrégation sociale qui affecte la France.
Français, à force de ne point vouloir entendre le tocsin,
c'est le glas qui finira par sonner...
Georges DILLINGER
|
|
|
Bouteflika : la France avant Barcelone
L'analyse de Jean Jolly
Envoyé par M. Georges Bailly
|
En préférant se rendre dimanche dans un hôpital parisien plutôt qu'au Sommet euro-méditerranéen de Barcelone, le président Abdelazziz Bouteflika, très surmené depuis sa dernière campagne électorale, manifeste publiquement sa confiance à la France et à sa médecine. Il a suivi sans hésiter les conseils de ceux qui l'avaient examiné samedi à l'hôpital Aïn Naadja d'Alger "pour des troubles digestifs".
Selon un communiqué officiel algérien, l'état de santé du malade "n'est pas source d'inquiétude". Si tel est le cas, on peut s'étonner que Bouteflika ait pris la responsabilité d'être absent à Barcelone où la lutte contre le terrorisme est à l'ordre du jour. En effet, contrairement à la plupart des dirigeants arabes qui boudent le sommet pour ne pas risquer de cautionner un amalgame entre terroristes et guérilla irakienne et palestinienne, Bouteflika encourage depuis plusieurs mois une collaboration étroite entre les services secrets algériens et occidentaux pour tenter notamment d'éradiquer la résistance islamique conduite par le GSPC.
La présence à Paris du président algérien pourrait contribuer à clarifier les rapports bilatéraux. En effet, Bouteflika a compromis la signature d'un traité d'amitié entre les deux pays en accusant la France de génocide au cours de la période coloniale.
L'affaire est navrante car elle retarde la réconciliation entre deux peuples qui ont des intérêts politiques et économiques communs.
L'agressivité de Bouteflika contre la France s'explique probablement par un manque de sang-froid et le besoin de donner des gages politiques aux vieux apparatchiks du FLN qui ont abusé trop longtemps du pouvoir sans assurer l'essor économique du pays, le plein emploi et la paix civile. Cette agressivité peut également révéler la fragilité politique d'un homme qui a pourtant réussi à amnistier la plupart des dissidents islamistes tout en assurant l'impunité aux militaires accusés de crimes de guerre et qui s'est doté des moyens de contrôler les dépenses budgétaires, de museler la presse, de neutraliser le parlement…
Néanmoins, Bouteflika n'a pas encore reconnu les crimes commis par ses amis du FLN avant et après l'indépendance : attentats aveugles, égorgements de civils, enlèvements, tortures de prisonniers, massacres de milliers de supplétifs de l'armée française et de leurs familles…
Une réconciliation franco-algérienne serait illusoire si les dirigeants d'Alger continuaient de nier les exactions commises contre les Européens et les Musulmans qui ne souhaitaient pas l'indépendance et si les dirigeants français refusaient de reconnaître les trahisons et les crimes dont furent victimes leurs compatriotes d'Algérie. Un traité d'amitié n'aurait aucune signification et serait même contre-productif s'il n'y avait réciprocité dans les repentances. La France a fait largement son auto-critique. À Bouteflika et aux siens d'avoir le courage politique d'accomplir la même démarche. Cela rendrait caduque la loi du 23 février dernier soulignant "le rôle positif de la présence française outre-mer".
Il n'est pas besoin d'une Commission mixte d'historiens pour savoir que, globalement, cette présence a été positive malgré les contradictions et les incohérences de la politique coloniale française durant 132 ans. Une condition s'impose : cette présence ne peut être réduite à huit ans d'une guerre qui, d'ailleurs, ne fut pas que répression, car elle accéléra souvent l'accès aux soins et à l'éducation de populations isolées… Bouteflika le sait. Il détient l'une des clefs d'une vraie réconciliation.
(L'Indépendant du 28 novembre 2005)
Un révélateur des inégalités Nord-Sud
L'analyse de Jean Jolly
Sommet de la pauvreté mais de l'impuissance à la combattre, sommet de la jeunesse africaine condamnée au désœuvrement ou à l'exil quelle que soit son éducation, sommet de la nostalgie du passé mais également des haines refoulées… A Bamako, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pu, comme les fois précédentes, masquer le constat tragique de quarante ans de coopération. Le défi du sous-développement a pris une telle ampleur qu'il ne peut plus être relevé par un seul pays. Aussi le président Jacques Chirac a-t-il confirmé le désir de la France, affaiblie et neutralisée par le coût d'acquis sociaux archaïques et le vieillissement de sa population qui grèvent ses finances, de voir l'Union européenne et les Nations unies s'intéresser davantage à l'Afrique.
La mondialisation a ébranlé les sociétés européennes et asiatiques et porté un coup mortel aux pays africains les plus pauvres. Les discours convenus sur la solidarité Nord-Sud ou démagogiques sur la période coloniale ou l'esclavage ne convainquent plus personne. À l'exception des pays riches en pétrole ou en matières premières rares, le niveau de vie des Africains est inférieur aujourd'hui à celui qu'ils avaient pendant la période coloniale.
D'ailleurs, au début des années soixante, la France s'est retirée d'Afrique, souvent au désespoir des dirigeants africains et de leurs mandants. L'administration coloniale coûtait très cher au budget métropolitain.
Après la proclamation des indépendances et la disparition de cette administration impartiale parce que dégagée des pressions ethniques, les multinationales, grâce à leur pouvoir de corruption, se livrèrent à un pillage éhonté, ne s'intéressant qu'aux investissements et aux profits à court terme et négligeant la formation des hommes et la mise en valeur des régions isolées.
Durant cette période, la DREE, la Direction des relations économiques extérieures, n'a eu de cesse de demander aux chefs d'entreprises françaises de redéployer leurs activités vers des pays solvables, en particulier vers l'Asie.
Quarante ans plus tard, alors que certains pays pauvres d'Afrique francophone (Tchad, Mali, Mauritanie) vont devenir rentables grâce à la découverte de pétrole, la France a perdu une part de son influence dans cette région. Ce sont les entreprises américaines (Exxon et Chevron au Tchad, Mobil en Angola) et chinoises (au Soudan, en Guinée équatoriale) qui sont en train de se tailler la part du lion alors que les compagnies pétrolières françaises furent les premières à investir à l'Afrique. Ce fut le cas de la SN Repal, ancêtre d'Elf, première à exploiter le pétrole d'Algérie et nationalisée au moment où ses investissements devenaient rentables.
Quant à l'esclavage, il n'est pas un crime uniquement européen. On estime, en effet, qu'avant l'arrivée des Européens, un Africain sur deux était l'esclave d'un autre Africain. D'ailleurs les Européens n'ont jamais capturé d'esclaves ; ils les achetaient à des tribus africaines esclavagistes. Quant aux Arabes, ils ont pratiqué l'esclavage sur une grande échelle au détriment des Africains dès le VIIIe siècle et le pratiquent encore aujourd'hui.
Désespérés par leur présent et doutant de leur avenir, certains Africains cherchent des responsabilités dans le passé. Une démarche stérile.
Le Sommet Afrique-France de Bamako est celui des illusions perdues, celui des vrais bilans trop longtemps falsifiés. Il marque le début des règlements de comptes et d'un procès de la décolonisation trop longtemps différé pour le plus grand malheur des peuples africains.
(L'Indépendant du 5 décembre 2005)
|
|
|
Les Harkis se sont battus pendant quarante-trois ans pour qu'enfin la France reconnaisse les sacrifices qu'ils ont consentis pour elle et pour qu'elle esquisse une digne réparation des préjudices qu'ils en ont subis en retour. Ils ont obtenu satisfaction avec le vote de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
Pourimparfaite qu'elle soit, cette loi est dorénavant notre patrimoine et celui de tous les Rapatriés.
A ceux qui voudraient nous en dépouiller sous des prétextes spécieux, nous disons que nous ne nous laisserons pas faire.
Aux élus de tous bords qui ont porté, défendu, voté et préservé cette loi, nous marquons notre reconnaissance et leur disons que nous serons toujours derrière eux.
Texte adressé aux rédactions de Libération, Le Monde, Marianne, l’Evénement, l’Express, le Nouvel Observateur et autres publications...
Prenant prétexte de l'article 3 de la loi du 23 février 2005, les Socialistes, à la suite de Bernard Derosier, député du Nord et président de l’Amicale France-Algérie (qui faisait lui-même écho à des récriminations du FLN contre la loi), font au Gouvernement un procès d'intention : celui de vouloir réhabiliter la colonisation, voire, c’est sous-entendu, le colonialisme.
Or, dans la loi elle-même ou dans les discours des élus de Droite et de Gauche qui l'ont portée et votée, puis, pour certains, reniée, il n'est nullement fait mention de "colonisation". Il y est question du "rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord". Ce faisant, il est question de deux choses :
1°/ rétablir un semblant d’équilibre dans le traitement de la Guerre d’Algérie à l’école, ce que les Pieds-Noirs et Harkis réclament depuis des décennies ;
2°/ rendre hommage ou tout simplement de ne pas oublier les centaines de milliers d'hommes et de femmes de toutes origines qui ont participé à cette oeuvre qu'on voudrait voir reconnue comme partiellement positive.
Comme on le voit, il n'est pas question dans cette loi de demander aux manuels scolaires de faire un "bilan" positif de la présence française outre-mer. Si cela avait été le cas, alors un procès en réécriture de l'Histoire eût pu, en effet, être intenté au Gouvernement. Les promoteurs de cette loi et ceux, de droite et de Gauche, encore une fois, qui l’ont votée, l'ont fait avec précaution et ont pesé tous les mots.
Cela n'a pas empêché les Socialistes et leurs affidés de se jeter à corps perdu dans une querelle absurde.
Sûrs de leur mauvaise foi, ils ont utilisé à mauvais escient des mots qui n'étaient ni dans le texte de la loi ni dans l'esprit des législateurs.
Cette campagne n’aurait eu aucun écho si une certaine presse, n’avait pris le relais des pétitionnaires.
Or, ce qu’on peut, à la limite, admettre d'opposants politiques, mêmes tardifs en l'occurrence, est intolérable de la part d’une institution qui a l’honneur d’exercer la mission d’éclairer le peuple. Le mot de "colonisation", répété à longueur de colonnes dans Libération, le Monde ou d’autres organes de presse ne passe pas. C’est pourtant précisément ce qu’on lit depuis bientôt un mois. En effet, à aucun moment cette presse ne dit précisément ce qu’il y a dans cette loi en utilisant les mots justes, ceux qui figurent dans l’article 4 de la loi du 23 février 2005 dont l'intitulé exact est " portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
En revanche, nombre de commentaires sur la loi elle-même et sur les débats qu'elle entraîne sont libellés avec des mots importés dont le mot " colonisation.
Dans le genre, le pompon revient à Libération.
Parmi les 31 invocations de la loi du 23 février 2005 recensées dans Libé depuis entre le 7 et le 26 décembre dans 32 articles consacrés à divers objets, on trouve 4 fois seulement mention du "rôle positif de la présence française outre-mer", formule qui correspond au contenu de l’article et qui a été reprise par les élus socialistes pour la combattre. A propos du Collectif (antillais) du même nom, Libé parle 3 fois de " loi de la honte " et 1 fois, citant Ségolène Royal, qui s’est crue obligée d’en rajouter, de " loi révisionniste sur la colonisation."
Les 23 autres évocations de la loi utilisent une formule post-fabriquée [" rôle positif " de la colonisation]. La manipulation, grossière, consiste à placer des guillemets avant et après " rôle positif " et de remplacer " présence française outremer ", qui figure dans le texte de la loi, par " colonisation " qui n’y figure pas.
Cette formule est systématiquement employée par "Libération" dans les titres et sous-titres d’articles et éditos signés par d’éminentes personnalités du journal (Pierre Marcelle, Antoine de Baecque, Didier Hassoux, Jacques Amalric, Renaud Dely, Antoine Guiraz, Jean-Pierre Thibaudat, Vanessa Schneider, Jean-Michel Thénard) mais aussi, ce qui est très grave, d’interviews et de papiers de personnalités extérieures invitées qui n’en font pas mention dans leurs interventions. Curiosité : ni Libération, mais aussi ni le Monde, ni le Nouvel Observateur, ni Marianne, ni l’Express, ni l’Evénement, n’a trouvé de signature en faveur de cette loi. Ainsi, il s’est trouvé une majorité de Députés et de Sénateurs pour la voter mais personne hormis son auteur, qu’on tâche de salir par ailleurs, pour la défendre ?
Ce faisant, à la suite des contempteurs de la loi, vous trompez volontairement vos lecteurs. Or, ce qui se comprendrait à peu près de la part de politiciens (qui s’en sont bien gardés, en tout cas dans leurs écrits) ou de polémistes, n’est pas digne de ceux qui sont supposés éclairer le public. Alors, combattez cette loi si vous ne l’approuvez pas mais, de grâce, pour de bonnes raisons, et non sur la base d’un procès d’intention.
Devant tant de mauvaise foi, on est obligé de se poser la question de la vraie raison qui pousse ses opposants et leurs relais médiatiques à combattre la loi du 23 février avec autant d’acharnement.
Petit rappel pour ceux qui l’on oublié : cette campagne a été lancée en France par Bernard Derosier, député du Nord et Président de l’Amicale France-Algérie, après les déclarations incendiaires de Bouteflika, elles-mêmes suivie d’une violente campagne de presse en Algérie. Or, cette loi n’a qu’un objet, tout entier contenu dans son intitulé : porter " reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ", autrement dit, Pieds Noirs et Harkis. On sait que le pouvoir algérien entretient depuis quelques décennies d’excellentes relations avec les organisations de Pieds-Noirs qui ont pignon sur rue et qu’il n’a rien contre une reconnaissance par la France de ses torts envers eux ; on sait aussi qu’il ne veut faire aucune concession quant à la question harkie, laquelle est brandie à chaque tournant de l’Histoire mouvementée de la politique intérieure algérienne.
Dans l’esprit de leurs ennemis, la loi du 23 février 2005 " réhabilite " les Harkis ou plutôt elle leur rend justice officiellement et définitivement. Du coup, elle dérange le lobby algérien pris dans toute son acception (pouvoir et presse algériens, partis de gauche " anti-colonialistes " rétrospectifs, hagiographes des porteurs de valises, droits de l’hommiste à géométrie variable, anti-génocidaires sélectifs et leurs porte-voix que sont l’Humanité, Libération, le Monde , le Nouvel-Obs, Marianne, l’Evénement et l’Express). La preuve de leurs mauvaises intentions est que pas même un membre de notre communauté, même parmi les plus proches de cette mouvance, n’a été cité à témoigner. Aucune personnalité pied-noir ou harkie - il en existe pourtant beaucoup point trop fougueuses ou regardantes – n’a été invitée à donner son point de vue.
Et pour cause ! La plus conciliante, la plus complaisante d’entre elles, aurait refusé d’aller dans ce sens. Or, il s’agissait, en l’espèce et à l’évidence, d’un combat camp contre camp.
La loi du 23 février 2005 dérange par son contenu d'ensemble, dont les implications n’ont été perçues qu’après coup, d’où le retard à l’allumage des Socialistes. Il faut bien peser l'enjeu pour les Algériens : si la France reconnaît le combat historique des Harkis à ses côtés comme légitime ; si elle leur reconnaît le statut de victimes d'un génocide (elle ne va pas jusque là, et, d’ailleurs, nous n’en demandons pas tant) ou, tout du moins, d'un massacre organisé et concerté ; si, de surcroît, elle admet un droit des Harkis à obtenir réparation, alors le mythe de l'unanimité du peuple algérien derrière le FLN s'écroule et emporte avec lui tout l'édifice idéologique sur lequel Bouteflika et sa bande, leurs amis, leurs complices, leurs clients et leurs porte-voix ont fondé a posteriori la légitimité d'un état indépendant et dictatorial. Or, toute la Gauche française s’est construite autour de l’engagement des forces autoproclamées progressistes aux côtés du FLN et de l’Etat algérien.
Saisie sous cet angle, la loi du 23 février 2005 prend tout son sens et la polémique avec elle. Alors, tout s’explique. Et, certes, la première partie de l’article 4 de la loi est importante sur le plan des principes. Il est juste en effet que les " programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord " parce qu’il s’agit là d’une réalité indéniable. Tout aussi important et d’une portée politique cette fois, la suite de l’article " [les programmes scolaires] accordent aux sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit ". Il s’agit là d’une reconnaissance sans réticence de l’engagement des Harkis aux côtés de la France. Et une reconnaissance d’autant moins symbolique qu’elle est confirmée et confortée par l’article 5 qui stipule " Sont interdites : - toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ; - toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian. L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Le lobby pro algérien a déclenché son offensive anti-loi du 23 février en se servant de la première partie de son article 4 comme d’un prétexte. En vérité, c’est la deuxième partie de l’article qui est dangereuse politiquement pour l’Algérie, ses amis, ses complices, ses clients, ses porte-voix et ses thuriféraires puisqu’elle met fin à la pensée unique relativement à la Guerre d’Algérie en disant clairement : " Oui ! Il était possible d’avoir une appréciation positive de la présence française en Algérie et oui ! Il était possible pour un musulman d’Algérie d’aimer assez la France pour prendre les armes afin qu’elle s’y maintienne ! " Mieux, et sans doute les Algériens, leurs amis, leurs complices, leurs clients, leurs porte-voix et leurs thuriféraires l’ont-ils parfaitement compris, c’est l’article 5 de la loi du 23 février 2005 qui donne au précédent toute sa portée et en fait bien autre chose qu’une nième motion de principe sans portée : une profession de foi sincère et un engagement vrai.
C’est cela que nous, Harkis et enfants de Harkis, savions, clamions et revendiquions depuis quarante-trois ans. Et voici que ce droit que l’on nous contestait d’avoir une autre vision de ce qui s’est passé là-bas, et voici que ce droit que l’on nous contestait de prendre une autre option que celle d’autres Musulmans d’Algérie, voici que ces droits ne nous sont plus contestables parce que, pour la première fois, ils sont gravés dans le marbre de la loi et que celle-ci met fin dorénavant à l'absolue impunité des fauteurs de haine que sont les Algériens et leurs affidés quand ils insultent les Harkis. Nous vivions jusqu'à présent sous le règne d’une vérité unique, celle que les Algériens avaient imposée a posteriori grâce à leurs amis, leurs complices, leurs clients, leurs porte-voix et leurs thuriféraires.
Une vérité unique assise sur la certitude d’une impunité totale qui permettait à une brochette de pseudo intellectuels de pérorer sur France-Culture à la suite de Françoise Gaspard (en 1989) sur le thème " Harkis = traîtres ou victimes.
Une vérité unique qui faisait écrire à un Jean Daniel délirant, dans une lettre qu’il m’adressa en 2000 : " Je souhaite que le gouvernement algérien pardonne aux Harkis " ( !) Une vérité unique qui autorise Benjamin Stora, autoproclamé (et proclamé par ses amis) historien de la Guerre d’Algérie, à dire qu’ " il serait temps que l’on se pose la question sur ce qu’on fait les Harkis, les Harkis ont choisi la France et ils ont perdu ", sous-entendu qu’ils ont mérité ce qui leur est arrivé.
Une impunité qui autorisa le dessinateur Siné à écrire à propos des enfants de Harkis solidaires du choix historique de leurs pères " Qu’ils crèvent ! " et qui permet aujourd’hui à des auteurs algériens de venir en France mettre en scène et jouer des pièces de théâtre subventionnées par le contribuable français sur le thème " Harkis = traîtres.
Tout cela est fini et c’est une grande nouvelle !
Abdelkader Hamiche
Fils de Harki et fier de l'être.
|
|
COMITES DE DEFENSE DES FRANÇAIS D'ALGERIE
C.D.E.A. et U.C.D.A.R.
|
Béziers le 21 décembre 05
Le Président
Chers Compatriotes et Amis,
Que l'année 2006 puisse vous apporter santé, joies et prospérité au milieu de l'affection de tous ceux qui vous sont chers, ce sont les vœux que nous formulons pour vous et tous les vôtres.
Cette année se termine, pour certains d'entre-vous, avec l'obtention de la restitution des sommes qui avaient été indûment perçues sur vos indemnisation.
Nous nous sommes battus depuis 1970, date de cette loi et de son article 46, nous sommes arrivés à ce résultat qui ne nous satisfait que partiellement et qui nous laisse le goût d'une injustice supplémentaire à notre égard.
En effet, comment concevoir que ces prélèvements effectués par l'état, qui a ainsi pris place face à nos créanciers avec nos prêts d'installation migrants super bonifiés de l'époque, que celui-ci nous restitue aujourd'hui ces sommes sans les intérêts légaux.
Imaginez une seconde ce que vous auriez eu à payer à cet état si il avait été votre créancier pendant plus de 30 ans !
Voilà encore un exemple de cette iniquité chronique !
Le combat de votre association basé sur la reconnaissance de nos droits les plus élémentaires, nous n'allons pas encore les rappeler aujourd'hui, doit avoir une priorité sociale en faveur de ceux des nôtres, les plus nombreux, ce petit peuple, qui représentait les forces vives de notre Algérie Française, et qui reste le laissé pour compte de notre histoire.
Comment peut-il être concevable que, par la force des armes, par la terreur, par une trahison d'état éhontée, l'on oblige des citoyens modestes à se séparer de leur pays de leur famille, de leurs amis, de leurs morts, sans compensation.
Non seulement sans compensation matérielle mais après avoir été aussi accueillis avec des cris de haine, cette haine qui encore, à ce jour, les assimile au mensonge, complaisamment colporté, du gros colon avec cigare et cravache et faisant payer le verre d'eau au petit militaire.
La France doit reconnaître son implication dans notre tragédie, c'est une question d'honneur et de justice !
L'honneur ! Cette France insultée sans aucune réaction par un " bouteflikassassin ", en a-t-elle encore ?
Vous voudrez bien excuser ma diatribe mais les attaques récentes dont nous sommes les victimes ne me permettent pas de baisser la garde et vous pouvez compter sur votre association pour répondre, coup pour coup, à toutes les attaques, d'où qu'elles viennent.
Evidemment, sans votre aide, aussi modeste soit-elle, nous n'arriverons à rien.
Cette aide, merci à ceux qui nous l'apportent, elle nous encourage et vous pouvez compter sur nous !
Alain ALGUDO
|
|
 ICI===>
ICI===> 
 Pour Mieux Connaître Jean Paul
Pour Mieux Connaître Jean Paul
|
|
| "LA CROISIERE EN PELERINAGE"
|
Chers amis!
Je vous annonce une bonne nouvelle.
Je participe avec des amis à une belle croisière "Pélérinage à Alger" par bateau spécialement affrêté pour nous et qui se déroulera du 17 au 24 novembre 2006.
Cette croisière sera une occasion unique de revoir vos lieux d'enfance, vos lieux familiers et être de nouveau en contact avec votre terre et confronter vos souvenirs.
Vous trouverez en pièces jointes le détail du programme et des animations à bord ainsi qu'un bulletin d'inscription.
J'espère que vous serez très nombreux à m'accompagner et vous permettre de renouer avec vos racines.
Pour tout renseignement complémentaire :
clubdescroisieres@wanadoo.fr
tél: 04.42.721.666 ; mobile: 06.12.909.658.
Avec toutes mes amitiés sincères et pieds noires.
Jean Paul Gavino.
| |
|
LETTRES A UN METROPOLITAIN
|
L'homme le plus parfait est celui qui est le plus utile à ses frères.
| |
LETTRE N° 7
Nous pouvons maintenant définir le " problème algérien " et en rechercher la solution. Parmi ses données essentielles, il semble que la première à retenir soit les extrêmes inégalités qui, sur le plan culturel ou économique, séparent les différents éléments de la population : d'une part, en effet, la population européenne et une fraction de la population musulmane constituent une société qui est exactement comparable à celle de n'importe quel pays d'Europe, avec, bien entendu, ses caractères propres. C'est cette partie de la population qui pratique l'agriculture moderne (dans la proportion de 60 % de musulmans pour 40 % de non musulmans), qui dirige les entreprises industrielles et commerciales et qui groupe également les fonctionnaires, les professions libérales, les artisans, les petits commerçants urbains, les ouvriers et employés.
D'autre part, la masse de la population rurale musulmane : petits fellahs se livrant à l'agriculture traditionnelle caractérisée par l'archaïsme des moyens et des méthodes (araire primitif, cultures et élevage extensifs), la faible étendue des propriétés (70 % de moins de 10 hectares), le recours au système de la jachère nue (les engrais et l'assolement étant inconnus).
Notons à ce sujet que, contrairement à une opinion très répandue, l'Algérie est un pays de culture difficile, exception faite de certaines plaines sublittorales malheureusement trop peu étendues. Sur une superficie de 21 millions d'hectares, la proportion des terres productives n'est que de 33 % dans l'Algérie du Nord. Cette faible proportion s'explique par un relief tourmenté, la fragilité des terres pauvres en humus et l'irrégularité des ressources en eau. En cultures céréalières un rendement de 12 est considéré comme très satisfaisant. Il tombe à 4 ou 6 avec les moyens de culture des petits fellahs.
En vertu d'une loi qui semble correspondre à un processus naturel de conservation, le taux de natalité de cette population est inversement proportionnel aux moyens de subsistance dont elle dispose, et comme l'effort sanitaire de la France a considérablement freiné la mortalité, que cette natalité élevée avait pour but de compenser, on se trouve en présence d'un surpeuplement, c'est-à-dire d'une rupture d'équilibre entre le nombre de bouches à nourrir et les ressources du pays.
Comme nous l'avons déjà indiqué, cette partie de la population possède encore une mentalité politique rudimentaire. Elle est absolument incapable de résoudre, par elle-même, ses propres difficultés, dont la solution n'est d'ailleurs pas à son échelle. En l'abandonnant à elle-même, on la voue inéluctablement à devenir la proie des propagandes extrémistes, ce qui n'a, d'ailleurs, pas manqué de se produire. Incontestablement, cette tâche incombe à la France parce qu'elle l'a déjà commencée, qu'elle l'a jusqu'à présent accompli d'une manière satisfaisante, et parce qu'enfin, il y va de son intérêt et de son avenir même qu'elle la termine.
Le premier problème qui se pose est donc essentiellement d'ordre économique et social. Il s'agit d'augmenter le potentiel économique de l'Algérie de manière à relever le niveau de vie de la population musulmane rurale et d'une façon générale, celui de l'ensemble de la population. II convient, d'autre part, d'éduquer cette masse afin de l'amener progressivement à un mode de vie qui soit en harmonie avec le siècle où nous vivons. On peut penser que cette ascension vers une existence plus aisée entraînera par un phénomène inverse de celui qui nous signalions tout à l'heure, une réduction de la natalité, mais il n'est pas interdit, bien au contraire, d'entreprendre dès à présent, dans le respect absolu des règles morales et religieuses, une action de persuasion, notamment auprès de l'élément féminin.
La double tâche qui s'impose dans ce domaine consiste donc, d'une part, à éduquer cette fraction de la population et, d'autre part, à accroître le " revenu " de l'Algérie, c'est-à-dire à la fois sa production agricole, base de son économie, et son potentiel industriel, de manière à créer des emplois pour les travailleurs non agricoles.
Les moyens de résoudre ces problèmes ont été depuis longtemps définis et, pour la plupart, déjà mis en oeuvre, ce sont :
- le plan de scolarisation (formation générale et formation technique) ;
- la formation professionnelle des adultes ;
- la formation agricole, par l'intermédiaire des Secteurs d'amélioration rurale ;
- l'intervention des organismes destinés à accroître les rendements agricoles par la modernisation des méthodes (Sociétés Agricoles de Prévoyance - Coopératives) ;
- la réforme agraire, ayant pour objet de rendre les exploitants propriétaires des terres qu'ils cultivent sous le régime du fermage (khamessat) ;
- la mise en valeur de nouvelles superficies, grâce à l'action du Service de la Défense et de la Restauration des Sols et à celle du Service des Irrigations ;
- la construction d'habitations destinées à remplacer le gourbi ou le bidonville ;
- l'action des différents mouvements féminins ou familiaux.
Cette liste n'a, bien entendu, pas la prétention d'être complète.
Sur le plan du développement industriel, l'Algérie a été longtemps paralysée par le manque total de sources d'énergie. Mais la découverte des gisements de pétrole et de gaz au Sahara, que l'on serait tenté de qualifier de providentielle si on ne savait quels trésors de foi et d'énergie elle a coûtés, est venue changer la face des choses.
II faut comprendre, en outre, que ces différents moyens interfèrent constamment et non seulement s'ajoutent, mais en quelque sorte, se multiplient. La création d'une usine employant cent ouvriers permet de relever le niveau de vie de cent familles, ce qui signifie aussi l'ouverture de nouveaux commerces, de chantiers de construction pour les logements, l'extension des réseaux de transport en commun, de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, l'augmentation des transports de marchandises, c'est-à-dire encore la création de nouveaux emplois.
Dans le même ordre d'idées, l'industrie pétrolière proprement dite (extraction et transport) n'emploiera pas un nombre considérable d'ouvriers. Mais elle permettra à la France de réaliser une économie de devises qui, consacrées à d'autres achats, pourront être investies, dans de nouvelles exploitations (1).
Dès à présent, donc, les différents moyens sont appliqués qui doivent permettre de remédier au déséquilibre que nous signalions en commençant. La future Société algérienne continuera à avoir des riches et des pauvres, mais du moins, entre ces deux extrêmes, la plus grande partie de la population trouvera-t-elle une place moyenne que nous souhaitons aussi élevée que possible.
Accroître l'efficacité de ces moyens et les mettre à l'échelle des problèmes à résoudre, tel est, en définitive, l'objectif de ce programme que l'on appelle le: " Plan de Constantine ".
(1) Lorsqu'il atteindra son débit normal (14 millions de tonnes), le seul oléoduc d'Hassi Messaoud permettra à la France d'économiser 200 à 250 millions de dollars de devises étrangères.
En 1958, les importations de pétrole figuraient à la balance des paiements pour la contre-valeur de 350 millions de dollars.
|
|
Par Émile Zona
Monsieur le Président de la République,
Permettez-moi de vous exposer, par ces quelques mots jetés sur le papier, mon sentiment de profonde injustice ressentie à la suite des évènements qui ont embrasé, en ce mois de novembre 2005, les banlieues de cette République que vous présidez.
J’ai vu, de visu ou à travers l’écran de ma télévision, des cohortes à l’allure étrangère, incendier des voitures et des lieux de savoir ou de culte. J’ai entendu les réponses de vos ministres, au-delà du couvre-feu instauré dans certains quartiers, autant que les promesses de discrimination positive, d’ailleurs mises en oeuvre depuis longtemps.
Le fils d’ouvrier que je suis, issu d’un milieu modeste, ne peut dès lors réprimer une sourde colère !
Ainsi donc, un jeune de banlieue pourra intégrer un Institut de Sciences Politiques ou bénéficier d’un parrain issu d’une grande école pour lui permettre d’avoir le baccalauréat et réussir son cursus. Que n’ai-je pu bénéficier d’une telle aide, moi dont les parents se saignaient aux quatre veines pour que je puisse décrocher mon baccalauréat, et qui ai raté de quelques points le concours d’entrée de cet institut de sciences-po en province. Ma vie en aurait été changée.
Ainsi donc un jeune de banlieue peut, dans la région parisienne, par le biais de l’armée ou du service civil volontaire, passer le permis de conduire gratuitement. Que n’ai-je pu bénéficier d’une telle aide, moi qui ai dû économiser sou après sou et beaucoup me priver pour pouvoir me payer les cours d’auto-école.
Ainsi donc, un jeune de banlieue pourra bénéficier d’un réseau d’associations subventionnées, et d’équipements et stades rénovés. Que n’ai-je pu, avec les jeunes de mon quartier bénéficier de tels équipements ? Cela nous aurait évité de jouer derrière ce garage au milieu des gravats ou le long de cette autoroute où subsistait le seul espace vert.
Ainsi donc 20 000 emplois liés à la fonction publique seront créés pour les jeunes de banlieues. Que n’ai-je pu bénéficier d’une telle mesure ? Cela m’aurait évité de connaître les aléas de l’ANPE et du chômage.
Ainsi donc, un jeune de banlieue pourra bénéficier des avantages des zones franches lorsqu’il créera son entreprise et des exonérations qui vont avec. Que n’ai-je pu bénéficier de telles aides, moi qui suis aujourd’hui en train de faire les chèques pour l’Urssaf et autres organismes sociaux.
Monsieur le Président de la République, dois-je en vouloir à mes parents de s’être impliqués dans mon éducation et d’avoir joué leur rôle en m’apprenant ce qu’était la Loi et l’Ordre ? Dois-je leur en vouloir de n’avoir jamais mendié quoique ce soit pour nous venir en aide et de m’avoir inculqué le sens de l’effort et de la discipline ?
Monsieur le Président de la République, lorsque j’entends les mesures prises par votre gouvernement, lorsque j’entends certains ministres évoquer la nécessaire discrimination positive, je pense aux trois mots « liberté, égalité, fraternité » que l’on croise de moins en moins sur les frontons des mairies.
La liberté n’est désormais plus la même pour tous puisque certains peuvent mettre les quartiers à feu et à sang (je pense aux deux morts victimes d’agressions), tandis que d’autres sont des délinquants simplement parce qu’ils téléphonent dans leur voiture où qu’ils ont le malheur de revendiquer leur identité de Français.
L’égalité n’est plus puisque désormais, à la lueur de mon existence, je sais qu’il y a des jeunes plus « égaux » que moi dans la République.
Quant à la fraternité, la société marchande l’a mise en pièce pour instaurer l’individualisme consumériste et la seule subsistance de cette valeur est celles des « bandes » dans les quartiers.
Monsieur le Président,
Je m’accuse, en me regardant dans la glace, de supporter tout cela et je m’accuse presque de respecter la Loi lorsque je vois que dans certains quartiers, le crime a payé.
Mais j’accuse surtout une classe politicienne de gauche comme de droite, de me faire me sentir de plus en plus exclu, étranger, discriminé et même victime d’un certain racisme au cœur de mon propre pays.
Et vous, Monsieur le Président, de quoi vous accusez-vous ?
|
|
Le visage caché derrière son foulard,
Le valeureux casseur se lance dans la rue
Il défie, avec ses amis, les Lois, les règles
L'autorité ne lui fait pas peur, il est mineur.
La tête protégée d'un casque de motard
Le bras armé, sur les forces de l'ordre il se rue.
Il fonce sur ses proies tel un aigle,
Créant le désarroi et le malheur ?
Il brandit bien haut le drapeau de l'islam
Au nom duquel il met la ville en flamme.
Voitures, magasins, écoles incendiés,
Plus rien n'arrête cet émeutier de quartier.
Il se targue d'avoir beaucoup de courage
Pourtant il prend soin de cacher son visage.
La France lui a donné une nationalité ?
Elle l'a accueilli avec générosité,
Lui donnant un drapeau et tous les droits
Dont il abuse, mais dénie les devoirs.
Il se sent exclu de cette société
Ne se reconnaît pas sous cette identité.
L'Imam du quartier lui a bien dit
Que le Français, de chez lui le banni.
Le casseur est maître dans son quartier
Qu'il maintient sous son autorité,
Il plastronne avec arrogance
Et se pare de sa suffisance.
Plus rien n'arrête cet émeutier
Qui fait trembler tout un quartier.
Un jour peut-être une balle perdue
Aura raison de cet individu
Un autre alors prendra ce prétexte
Pour revenir dans ce contexte
|
|
|
LES ECHOS DIVERS
Par les VIGIES DU NET
|
1) LA GESTION DU CHEF-LIEU
L'anarchie
Par Leïla Azzouz
La 24 (Edition du 29 novembre 2005) liberté-Algérie
Au moment où les populations des bidonvilles et habitats précaires s'impatientent et récriminent contre les autorités locales n'épargnant ni élus ni les membres de l'exécutif, la wilaya croule sous le nombre de problèmes sociaux économiques.
Le programme de réalisation de 14 000 logements, dont les travaux auraient dû être lancés en mars 2005, semble avoir été gelé. Du côté de la direction du logement et des équipements de la wilaya, l'on est toujours dans l'attente du feu vert du directeur de l'exécutif. La programmation quotidienne 6 jours sur 7 des visites d'inspection des différents chantiers, institutions et autres structures de l'Etat a énormément perturbé les activités des responsables des administrations locales. Pris dans l'engrenage de ces visites, les directeurs des administrations locales sont dans l'incapacité d'assurer un suivi efficace de leurs missions respectives. N'étaient les interventions avec succès des services de police de lutte contre la délinquance et le banditisme, Annaba serait devenue une ville invivable pour ses 600 000 habitants. La commune chef-lieu est le parfait exemple du laisser-aller et du dilettantisme caractérisant la gestion de la 4e wilaya d'Algérie. A la tendance à la multiplication des bidonvilles, s'ajoute la dégradation de l'environnement. La saleté a envahi les cités, quartiers, boulevards. Les odeurs nauséabondes, les eaux usées et stagnantes, les égouts crevés, les ordures ménagères non enlevées, les espaces verts et places publiques livrés à l'abandon, les perturbations dans la distribution de l'eau potable... sont le quotidien des citoyens. " Le chef de daïra est occupé. Il ne peut pas vous recevoir. Revenez une autre fois peut-être ", a répondu à notre tentative de prise de contact la secrétaire de ce commis de l'Etat à Annaba. Cette réponse donne toute l'étendue de l'anarchie dans la gestion de la ville, dont les principales artères sont envahies par les marchands ambulants. Malgré l'existence de marchés de fruits et légumes de proximité, la colonne, El Hatab, Plaine Ouest, Oued Eddeheb, la Ménadia, rue Ibn Khaldoun sont squattés par ces marchands ambulants à l'agressivité sans limite. A Annaba, l'anarchie règne en maître des lieux. N'importe qui fait n'importe quoi et les
infractions sont banalisées. Cette anarchie est également visible dans la circulation automobile et piétonnière. Et si la voie publique et les trottoirs sont squattés à longueur de journée, les automobilistes éprouvent des difficultés à circuler ou à stationner face à des énergumènes qui s'arrogent la qualité de gardiens.
(envoyé par Pierre Barisain)
|
|
|
|
Décès du Colonel
Pierre CHATEAU-JOBERT
Dit " CONAN" |
Le colonel CHATEAU-JOBERT, compagnon de la Liberation, est décédé, la nuit dernière (28/12 ndlr) dans sa maison de retraite à Caumont l'Eventé.
Une messe sera dite mardi 3 janvier 2006, à 10 heures) en l'église de
Sartilly (50530) dans la Manche (entre Grandville et Avranches.
Le colonel sera inhumé ensuite à Morlaix (29)
Info de J.P Rondeau
Sa biographie d'après http://www.salan.asso.fr
 Pierre, Yvon, Alexandre, Jean Château-Jobert né à Morlaix, le 3 février 1912.
Son père tué au front en 1915, Pupille de la nation, il fait ses études à Morlaix, au collège Stanislas à Paris et au collège Saint Charles de Saint-Brieuc où deux pleurésies successives l'empêchent de préparer l'Ecole Navale.
Après son service militaire qu'il effectue en 1934-35, il reste dans l'armée et suit, comme sous-lieutenant, les cours de l'Ecole d'Application de l'Artillerie à Fontainebleau.
Affecté au 154ème régiment d'artillerie, il suit les cours de l'école d'observateurs en avion de Dinan.
Blessé durant la campagne de France, il rejoint l'Angleterre et s'engage dans les Forces Françaises Libres, à Londres, le 1er juillet 1940, sous le nom de Conan.
Lieutenant à la 13ème Demi-Brigade de Légion Etrangère (DBLE), il se bat en Erythrée, en Syrie et en Libye où il est blessé en février 1942.
Le 7 novembre 1942, capitaine, il prend le commandement du 3ème Bataillon d'Infanterie de l'Air (SAS) qui devient, en juillet 1944, le 3ème Régiment de Chasseurs Parachutistes (RCP).
Le 3ème RCP opère sur les arrières de l'ennemi, par petites unités, dans des régions non encore libérées du territoire métropolitain, du Poitou à la Bourgogne.
Chef de bataillon en décembre 1944, il transmet le commandement du régiment au lieutenant-colonel de Bollardière
Il crée, par la suite, le Centre Ecole de Parachutisme Militaire, basé à Lannion, puis à Pau-Idron.
Adjoint du colonel de Bollardière, puis commandant de la Demi-Brigade Coloniale de Commandos Parachutistes SAS, il est engagé à la fin de 1947 et en 1948, au Cambodge, en Cochinchine et en Annam.
Après un séjour à Vannes-Meucon où il commande en second la 1ère DBCCP auprès du colonel Gilles, il retourne en Indochine en 1950, comme lieutenant-colonel, à la tête de la 2ème DBCCP, pour se battre au Tonkin et en Cochinchine jusqu'en avril 1952.
Après un passage en métropole, il est affecté à l'état-major des Forces terrestres, maritimes et aériennes à Alger de 1953 à 1955, puis, en novembre 1955, au commandement du 2ème Régiment de Parachutistes Coloniaux (RPC), devenu peu après le 2ème RPIMA, à Constantine.
Colonel, lors de l'affaire de Suez, le 5 novembre 1956, il est parachuté au sud de Port-Saïd à la tête d'une partie de son régiment renforcée de commandos du 11ème Choc et y atteint tous ses objectifs jusqu'à l'ordre du cessez-le-feu.
Le 7 avril 1952, alors que Château-Jobert va quitter l'Indochine, à la fin de son deuxième séjour, le général Salan, commandant en chef des forces en Extrême-Orient préside la cérémonie d'adieux, ce qui le touche beaucoup.
Dans les premiers jours de 1957, le colonel Château-Jobert, de retour en Algérie après l'affaire de Suez, vient se présenter au général Salan, commandant supérieur interarmes. Il lui fait part de sa déception de ne pas avoir reçu l'ordre de pousser ses parachutistes, au-delà de Port-Saïd et de Port-Fouad, jusqu'au Caire et à Suez.
En 1957, il commande à Bayonne la Brigade de Parachutistes Coloniaux où il succède au général Gracieux.
Dans les semaines qui suivent le 13 mai 1958, il y est en liaison avec des délégués d'Alger, tel le commandant Vitasse.
En 1959-60, il est auditeur à l'IHEDN et suit les cours du CHEM (Centre des Hautes Etudes Militaires).
Affecté au Niger en février 1961, il se solidarise avec les officiers qui, le 22 avril 1961, autour du général Challe, ont saisi le commandement à Alger, ce qui lui vaut plusieurs mois d'arrêts de forteresse.
Le 13 janvier 1962, alors qu'il est affecté à l'état-major de l'amiral préfet maritime de Cherbourg, il rejoint clandestinement l'Algérie et se met aux ordres du général Salan, chef de l'OAS.
A la fin de janvier 1962, à son arrivée à Alger, Pierre Château-Jobert est reçu par le général Salan qui lui confie le commandement de l'OAS du Constantinois qui manque chroniquement de cadres supérieurs.
Cette nomination est officialisée par une note de service du général Salan diffusée largement en Algérie.
En charge du Constantinois, il y retrouve le lieutenant Michel Alibert et y noue, en vue de leur ralliement, de nombreux contacts avec des officiers supérieurs et subalternes des régiments qui y sont stationnés, 13ème Dragons, 6ème Cuirassiers et 2ème REC (Le général Multrier, commandant de la zone Est Constantinois dira : " l'OAS progresse vite dans le Constantinois quand Château-Jobert en prend la tête").
Désapprouvant les " Accords Susini -Mostefaï ", il quitte l'Algérie le 30 juin 1962 à bord d'un cargo qui le ramène en métropole.
Clandestin, en France et en Espagne, il continue son combat ;
En 1965, il est condamné à mort par contumace. Il réapparaît à Morlaix le 3 novembre 1968, après la première amnistie de juin 1968. Il poursuit son action aux plans politique, social et spirituel en publiant plusieurs ouvrages d'analyse et de réflexion.
Le 16 mai 2001, le PC du 2ème Régiment Parachutiste d'Infanterie de Marine à l'île de la Réunion, héritier direct du 2ème RPC est baptisé " PC Lieutenant-colonel Château-Jobert ".
Pierre Château-Jobert est commandeur de la Légion d'Honneur et Compagnon de la Libération. Il est titulaire de la croix de guerre 1939-45 avec 11 citations et de la croix du Distinguished Service Order (D.S.O.).
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages :
-Manifeste Politique et social, Editions du Fuseau (1964)
-La confrontation Révolution-Contrerévolution, Diffusion de la Pensée Française (1975)
-Feux et lumières sur ma trace - Faits de Guerre et de Paix, Presses de la Cité (1978)
-La voix du pays réel, Nouvelles Editions Latines (1981)
-Doctrine d'action contrerévolutionnaire, Editions de Chiré (1986)
-SCOR, SOS contre la révolution (1987) 
Le Colonel lors de son dernier anniversaire. Photo prise par M. Antoine SARBONI |
|
MESSAGES
S.V.P., lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une nouvelle rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Après avoir pris connaissance des messages ci-dessous,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
Avec mes Amis Gilles Martinez et Jean Roda nous sommes heureux d'accueillir dans notre groupe des Sites Pieds-Noirs des Pyrénées Orientales un nouveau venu.
M. Robert Antoine et son site de STAOUELI qui ne demande qu'à grandir grâce à vous tous.
son adresse: http://www.piednoir.net/staoueli
Nous vous invitons à le visiter.
Jean Pierre Bartolini
| |
| BISOU FRAPPE
Envoyé par !
| |
Un jour, dans un train, Sarko, Chirac et une jolie Norvégienne voyagent dans le même compartiment.
Ils roulent sans se parler depuis un moment, quand un tunnel vient plonger le train dans l'obscurité la plus totale.
On entend alors un bruit de bisou, immédiatement suivi d'un monumental bruit de baffe.
Quand le train sort du tunnel et que la lumière revient, Chirac et la Norvégienne sont assis comme si de rien n'était.
Sarko, lui, se tient la tête à deux mains, visiblement sonné.
Il se dit : "Chirac a embrassé la Norvégienne , elle a cru que c'était moi et elle m'a collé un pain".
La Norvégienne pense : " Sarko a voulu m'embrasser, mais il a loupé son coup et a embrassé Chirac qui n'a pas apprécié. "
Chirac se dit : " Au prochain tunnel, je refais le bruit du bisou et je lui en recolle une autre, à ce connard..."
|
|