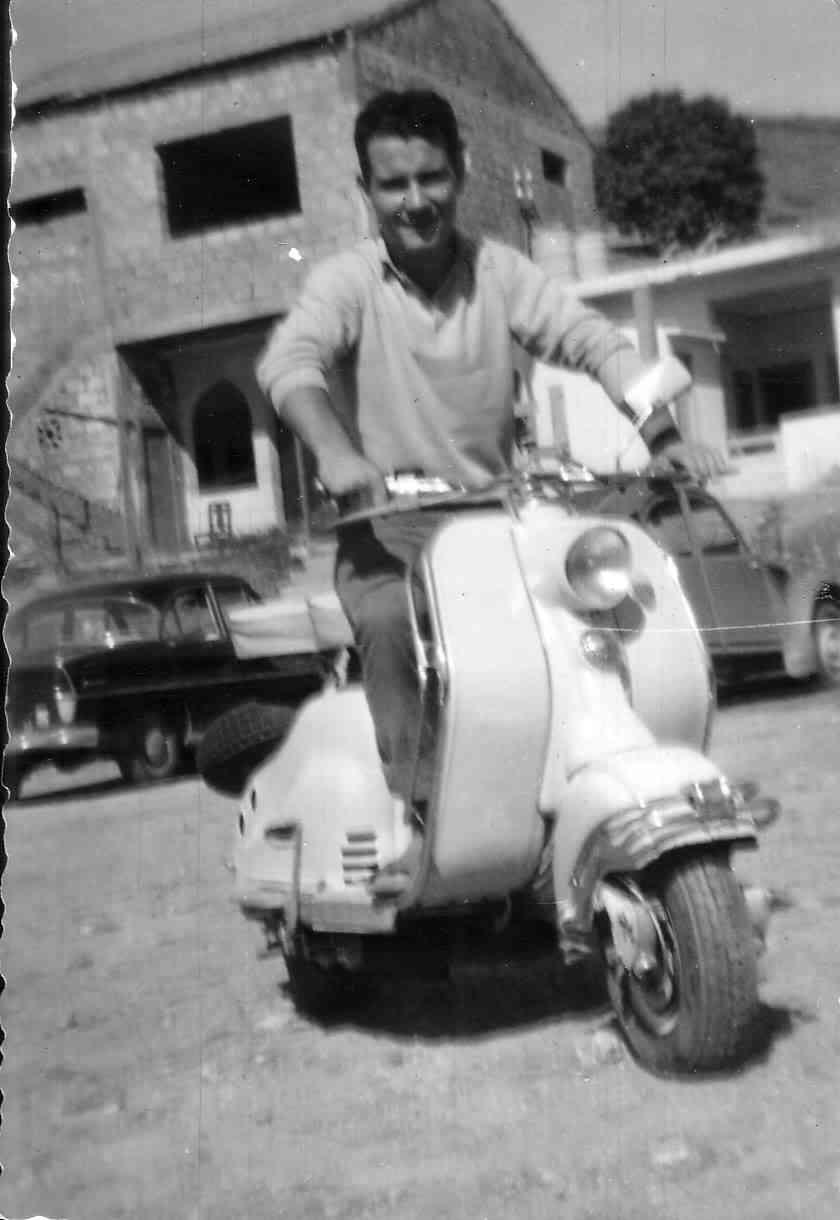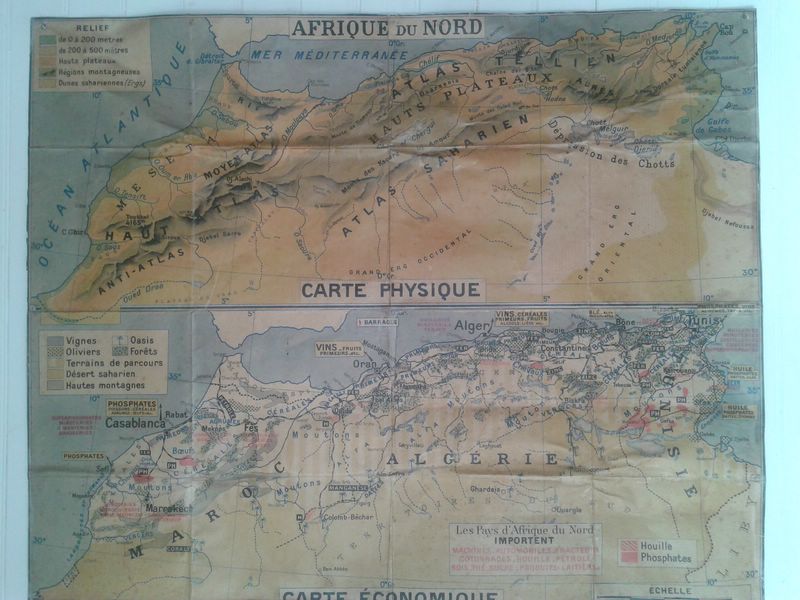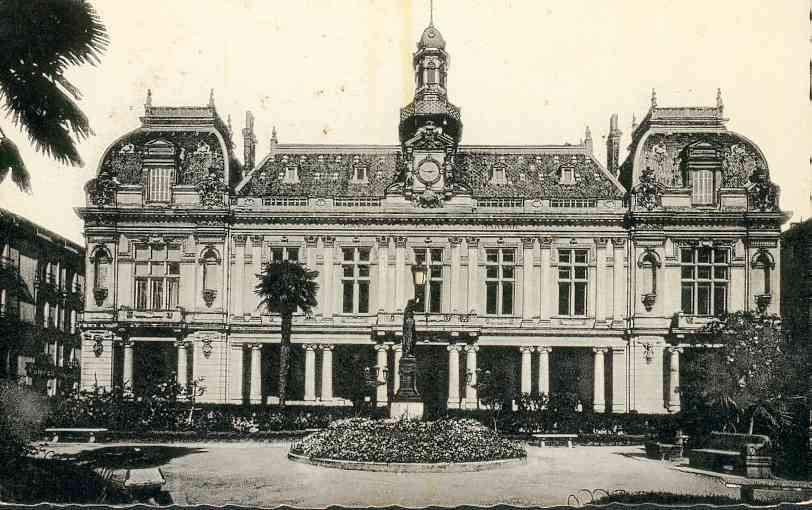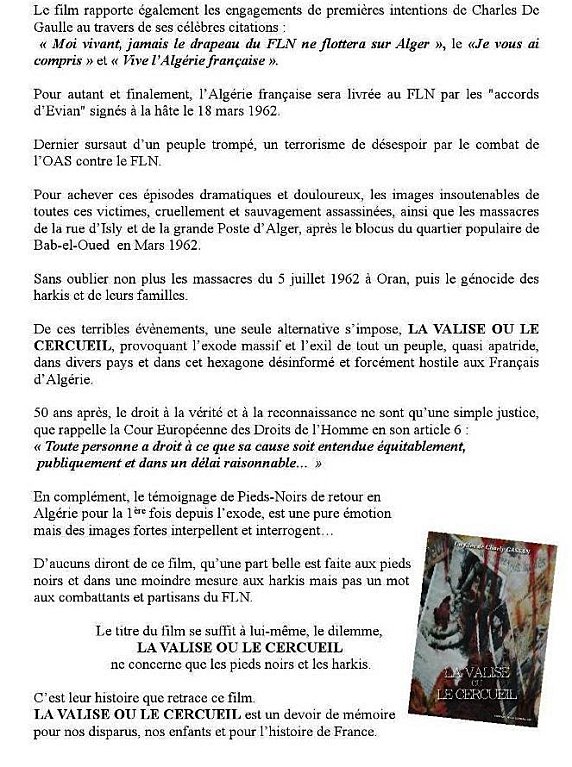|
|
 |
LA SEYBOUSE
La petite Gazette de BÔNE la COQUETTE
Le site des Bônois en particulier et des Pieds-Noirs en Général
l'histoire de ce journal racontée par Louis ARNAUD
se trouve dans la page: La Seybouse,
|
Ecusson de Bône généreusement offert au site de Bône par M. Bonemaint
Les Textes, photos ou images sont protégés par un copyrigth et ne doivent pas être utilisés
à des fins commerciales ou sur d'autres sites et publications sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Webmaster de ce site. |
|
Algérie la Belle
| |
|
EDITO
ON Y EST,
LA SEYBOUSE FÊTE SES DIX ANS.
Inauguré le 1er décembre 2001, La Gazette " La Seybouse " fête ses dix ans. Retour sur un projet qui a fait le pari de la culture de la mémoire pour tous et qui a relevé un défi ambitieux et culotté.
" À l'époque, c'était un pari fou de permettre aux Pieds-Noirs d'avoir accès à cette culture gratuitement sur Internet. Et c'est un pari plus que tenu " depuis le début. On a donc pu constater l'évolution car lorsque " La Seybouse " est sortie en 2001, elle pensait apporter pour la première fois au public P.N. une petite feuille de chou sans grande ambition que quelques pages mensuelles. Dès les premiers numéros, l'ambition a évoluée grâce au nombre grandissant de lecteurs. Puis quelques Amis comprenant l'intérêt d'une telle Gazette m'ont aidé à en créer le noyau. Bâti sur des convictions infiniment plus solides que tout ce que l'on voyait sur les forums, elle se voulait défenseur de notre Mémoire.
Dix ans que les différents " rédacteurs " qui ont alimenté La Seybouse, ont essayé de fournir le plus de contenu possible sur tout l'univers de la communauté. Difficile en effet de reconnaître les débuts de la Gazette à l'actuelle, tant le contenu de celle-ci a changé
Le parcours de La Seybouse fut notablement marqué par sa constance, son ouverture, sa volonté de faire connaître notre histoire, sa recherche de la vérité historique, son désir d'alimenter le savoir de la communauté mais aussi de ceux qui ne connaissaient rien de nous les Exilés d'Algérie. C'est vrai qu'en premier lieu, cette Gazette était consacrée à la ville de Bône, mais la diversité des lecteurs l'a poussé à élargir les lignes à toute l'Algérie tout en gardant le principal.
La Seybouse tout en respectant des principes ne veut pas s'enfermer dans un genre, dans un style. L'éclectisme en est le maître mot. L'objectif étant que tous les publics se sentent bien ou apprennent en la parcourant
Le bon signe de croissance, c'est le nombre de lecteurs mensuels, des lecteurs de tous les continents en constante augmentation. La réussite de La Seybouse c'est leur réussite.
En 10 ans, son rédacteur a une grande fierté : " La proximité et la convivialité par la messagerie dont malheureusement il n'arrive pas à apurer, la confiance des lecteurs et de ceux qui lui envoient de la documentation, lui donnent envie de toujours faire mieux ". Il aimerait parfois pouvoir étirer les pages pour que tout le monde puisse avoir la satisfaction de voir rapidement leurs souhaits exaucés. " Sa frustration, c'est la frustration des lecteurs ! "
La Seybouse a également vécu plusieurs procès d'intention ou judiciaire intentés à son auteur pour des motifs mineurs ou minables que certains apparentent à de la jalousie ou de la méchanceté gratuite.
Cela a abouti à l'amputation d'une partie de notre histoire comme par exemple la guerre civile d'Algérie de 1945 à 1962 afin de laisser ceux qui se croient toujours en guerre, faire ce qu'ils appellent " leur travail ". D'autres diront leur dada pur beurre. (sic)
Pour sa part, la Seybouse sait tourner une page sans oublier le passé et les leçons du passé. C'est pour cette raison que cette amputation de la guerre civile retrouvera un jour sa place lorsque les esprits se seront naturellement calmés et que la réflexion aura fait son oeuvre.
Je suis pour ma part convaincu que pour respecter et entretenir notre mémoire nous devons continuer à tisser la toile de la connaissance de la présence française et Pieds-Noirs en Algérie en parfaite articulation avec les outils numérique dont nous disposons. Nous devons, nous, sites P.N., sans attache commerciale, être les pivots de la sauvegarde et de la pérennité de notre histoire. La plupart des Webmasters sont résolument ancrées dans cette démarche et la grande majorité des lecteurs y sont également très fortement sensibles. Nous aurons donc à y œuvrer ensemble.
Tout au long de ces dix années, La Seybouse a su faire la preuve de sa qualité et se constituer en une structure saine, solide, de mutualisation à la fois des connaissances et des compétences en matière de sauvegarde et de diffusion de notre mémoire. Il n'est pas besoin ici d'insister sur l'importance des échanges avec les lecteurs et des documents reçus dans la construction de cette expression toute particulière qui se pose en véritable moteur de la communauté.
Internet est une chance mise à notre disposition pour contrecarrer les ambitions de nos ennemis qui ne pensent qu'à une seule chose, la disparition des P.N. et leur mémoire.
La Seybouse est une réussite. A l'issue de ces 10 ans, elle a fait la preuve qu'elle ne saurait se réduire à un simple journal. Elle est au contraire un lieu privilégié de prise de conscience des spécificités de chacune des communautés d'Algérie où le respect de l'identité de chacun en fait une force que nous disposons et d'un avantage comparatif dans la mondialisation des savoirs et un atout considérable pour la direction de la paix à laquelle nous aspirons tous.
Cet anniversaire de la Seybouse marqué au sein de tous ses numéros et ses articles divers avec des auteurs divers doit continuer à nous inspirer. Quelles que soient nos appartenances politiques ou religieuses, nous devrions faire en sorte que la gestion de notre mémoire, la maîtrise de nos différents, l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité, la pureté et l'abnégation de nos actions deviennent la priorité communautaire. Il n'y a pas de liberté sans souveraineté morale.
Et cette priorité elle n'est ni politique, ni religieuse, ni de classe de société, c'est la priorité de la communauté, qui doit toujours être en mesure de maîtriser son destin comme son passé.
10 ans ce n'est pas non plus uniquement le moment de dresser un bilan. Un tel anniversaire doit être aussi l'occasion de préparer l'avenir et d'entrevoir nos nouveaux défis. Défis auxquels nous aurons à faire face dans les prochaines années et c'est pour cela que j'aimerai connaître vos envies, vos idées, ce que vous aimeriez voir apparaître sur La Seybouse.
Voilà déjà dix ans que La Seybouse encourage les lecteurs à l'alimenter de tous documents, photos, récits et à se lancer dans la rédactions de leurs souvenirs au nom de la mémoire collective afin de la perpétuer gracieusement et avec le cœur pour nos ancêtres, les pionniers.
Aussi, je souhaite à La Seybouse, aux rédacteurs anciens, nouveaux et futurs, aux lecteurs connus ou inconnus, un joyeux anniversaire... et longue vie.
Jean Pierre Bartolini
Diobône
A tchao.
|
|
ANECDOTE
Copie de la dépêche du 25-26 avril 1954
Envoyé par M. Sauveur Teuma
|
|
LE SIMOUN
Publicité parue dans un guide touristique de 1936 qui représente le bar "Le Simoun", situé rue Neuve St Augustin, celle en face du théâtre qui monte vers la place d'Armes et la vieille ville.
| |
| MENDIANTS
De Germain NOUVEAU
Envoyé par Gérard
| |
Pendant qu'hésite encor ton pas sur la prairie,
Le pays s'est de ciel houleux enveloppé.
Tu cèdes, l'œil levé vers la nuagerie,
A ce doux midi blême et plein d'osier coupé.
Nous avons tant suivi le mur de mousse grise
Qu'à la fin, à nos flancs qu'une douleur emplit,
Non moins bon que ton sein, tiède comme l'église,
Ce fossé s'est ouvert aussi sûr que le lit.
Dédoublement sans fin d'un typique fantôme,
Que l'or de ta prunelle était peuplé de rois !
Est-ce moi qui riais à travers ce royaume ?
Je tenais la martyre, ayant ses bras en croix.
Le fleuve au loin, le ciel en deuil, l'eau de tes lèvres,
Immense trilogie amère aux cœurs noyés,
Un goût m'est revenu de nos plus forts genièvres,
Lorsque ta joue a lui, près des yeux dévoyés !
Et pourtant, oh ! pourtant, des seins de l'innocente
Et de nos doigts, sonnant, vers notre rêve éclos
Sur le ventre gentil comme un tambour qui chante,
Dianes aux désirs, et charger aux sanglots,
De ton attifement de boucles et de ganses,
Vieux Bébé, de tes cils essuyés simplement,
Et de vos piétés, et de vos manigances
Qui m'auraient bien pu rendre aussi chien que l'amant,
Il ne devait rester qu'une ironie immonde,
Une langueur des yeux détournés sans effort.
Quel bras, impitoyable aux Échappés du monde,
Te pousse à l'Est, pendant que je me sauve au Nord !
|
|
|
LES COPAINS
Souvenirs
Les articles sur la Caroube parus le journal " La Seybouse " ont, semble-t-il réveillé des souvenirs chez les anciens de la plage Fabre.
" Nous étions plus que des amis, presque des frères ".
" Je suis né à la caroube en janvier 1942, mes premiers pas ont été fait sur le sable de la caroube.
Dans ma jeunesse nous allions avec mon père dans un cabanon. Nous sortions une barque pour aller pêcher à quelques mètres du rivage, puis plus tard à l'âge de 13 ans, mon grand-père qui était marin pêcheur et propriétaire d'un OUTS (grand bateau à deux pointes de 5 à 12 mètres) m'emmenait avec son équipage poser les filets en face de la caroube. Je me rappelle le repérage pour, retrouver la zone. C'était les deux clochers de l'église Ste Thérèse avec la pointe de la Caroube. Après la pose des filets, nous descendions sur la plage et attendions toute la journée avant de retirer les filets et de rentrer au port.

Jean Claude Stella, Gérard Stella, Guy Colandréa, Jacques Stella, Jean Pierre Pétroni et Jacky Russo.


G. Stella, A.M Stella, M. Russo, Yvon Marfaing, ?, ?, J P Pétroni,
D. Vermeuil, A. Vermeuil H. Dibatista M. Zammit, , G Colandréa, ?, ?, Y Lucas
La pointe de la Caroube était un poste pour les pêcheurs. C'était un lieu de passage de banc de bonites. Chaque patron pêcheur venait à tour de rôle poser leurs filets.
" Lors des gros temps venant du sud, il fallait vite remonter sur le sable les bateaux qui étaient amarrés dans la crique. On mettait alors des rouleaux de bois sous la quille pour faciliter la remontée sur le sable. Une équipe tirait sur une corde attachée à l'avant de la barque, d'autres poussaient, un autre était chargé de récupérer le rouleau, à l'arrière de la quille, pour le présenter à nouveau devant, sous la proue. Tout cela se terminait par un bain collectif. "


de G à D :Gérard Stella et Hubert Dibatista Emmanuel Zammit, J.José Jardino,
Guy Martin, Sauveur Cane

Charles Ciantar, ? , Philippe Tarento

De G à D :Christiane Zammit, ?, Claude Constanzo, Claudine Maldonado, Yvette Portelli,
Assises : Aline Portelli et Madeleine Guillemin

de G à D : Marcel Tarento, André Draguasti, Jules Fournier, Lucien Balestrière, Charles Ciantar, Philippe Tarento
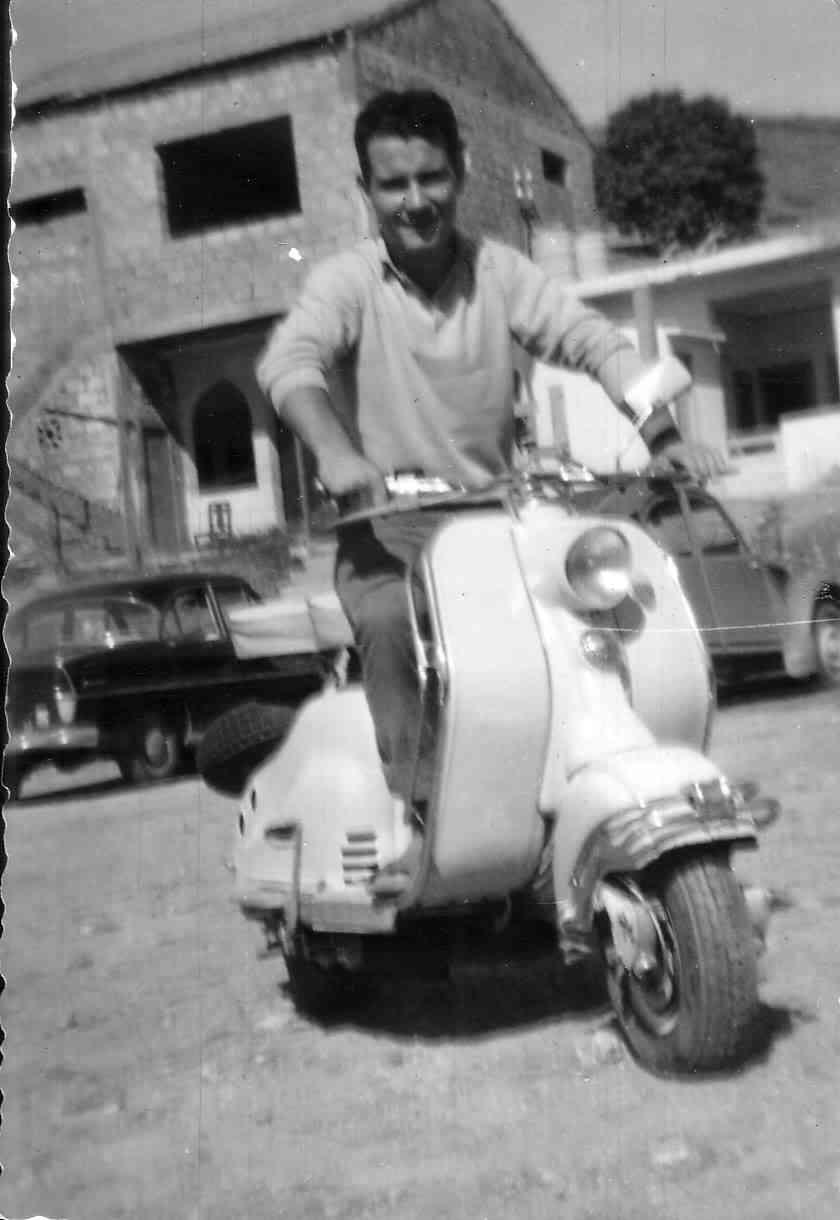


Jean Claude Stella Jean Claude et Gérard Stella J.Pierre Pétroni
et Jacques Stella


Guy Colandréa, Gérard Stella, ? Frick Abdelkader
Joueur de l'OCB

Un groupe à la grotte

Devant de G à D : J. José Jardino, Gérard Stella, Guy Colandréa, Guy Martin, ? ,
2ème rangée : Hubert Dibatista, ? , jacques Stella, ?,
rangée du fond : ?, ?, Brahim Boutamine, Mimi Khodja, ?, ?, ?, Emmanuel Zammit, ?, ?,
Jacky Russo, Adeline Paloqui, Elisabeth Jardino, Yves Lucas et J.PerrePétroni

Photo JC Stella
De gauche à droite : JC Stella, JC Acquaviva, Hubert Dibatista, Jacky Russo, Elisabeth Jardino, Guy Colandréa, Aline Vermeuil, Michèle Russo, Brahim Boutamine, Jacques Stella, Sauveur Cane, Yves Lucas.
Accroupis : Gérard Stella,, Emmanuel Zammit, Jacky Russo.

Photo Alain Zammit
Debout : Claude Constanzo, Christiane Zammit, ?,
Aline Portelli, Claudine Maldonado, Madeleine Guillemin,
Accroupie : Yvette Portelli


Photo G. Fois Photo Alain Zammit


Photo JC Stella
Gérard Stella, Hubert Di Batista Charles Ciantar, Jean Claude Zammit
et Yvan Marfaing et Jean Pierre Mattera (assis)


Bernard Ciantar, Solomiac, Roland Ciantar, Bernard Ciantar, Charles Ciantar
Pierre Magnani Paul Ciantar sous la tonnelle de Saint Michel


Charles Ciantar Paul Ciantar, Annie Méloni, Jules Fournier,
Jean Pierre Mattéra, Monique Di Méglio,
Gilbert Fois, Marc Davergne et Josiane Di Méglio
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué, par l'envoi de photos ou de souvenirs, à ce devoir de mémoire.
Ciantar.charles@wanadoo.fr
| |
| En souvenir de notre pays
ECHO D'ORANIE Septembre/Octobre 2000 - N°270
| |
Je suis né en Algérie pays plein d'espérance
J'ai vécu les beaux jours de ma plus tendre enfance
J'ai grandi tout heureux en pensant à la France
Je ne savais pas qu'un jour des gens plein d'ignorance
Nous mettraient en prison si on criait vive la France
Les Français sont venus pour notre grand malheur
Pour régler un problème qui n'était pas le leur
Depuis ce jour la tristesse nous poursuit
Avec cette tristesse qui nous envahis
On ne cesse de rêver à notre beau pays
Le soleil d'Algérie était tout notre bonheur
Depuis qu'on nous la pris on a brisé nos cœurs
Le sort en fût jeté nous sommes tous partis
Mais on ne peut oublier notre cher pays
Dans cet ouragan qui nous a ballottés
comme des fleurs fanées au souffle de l'orage
Pour ses jeunes tombés à la fleur de l'âge
Pour ceux qui encore ne nous on pas compris
Algérie- Liverpool - débarquement en Normandie
Si nous sommes Pieds-Noirs nous sommes Français aussi
Décembre 1962
|
|
|
|
CORSAIRES, ESCLAVES ET MARTYRS
DE BARBARIE (1857)
PAR M. L'ABBE LÉON GODARD
ANCIEN CURE D'EL-AGHOUAT,
PROFESSEUR D'HISTOIRE
AU GRAND SÉMINAIRE DE LANGRES
Dominare in medio inimicorum tuorum.
Régnez, Seigneur, au milieu de vos ennemis.
SOIREES ALGERIENNES
ONZIÈME SOIRÉE
Aventures de quelques esclaves.
Abolition de l'esclavage.
" Voyez donc, révérend père, disait Alfred, Fatma ne se prive de rien : une médaille de la Vierge en vermeil !
- Là, là, non, non ; pas en cuivre : c'est de l'or.
- Comment, de l'or ?
- Oui, dit Carlotta, s'approchant avec M. et M. Morelli; c'est de l'or; c'est moi qui lui ai donné cette médaille ; je voyais du reste que Fatima la désirait ardemment. "
La négresse baissa la tête et resta silencieuse.
" Je le crois bien, répliqua Alfred. Est-ce qu'une négresse ne désire pas tout ce qui brille ?
- Ce n'est pas, je vous assure, l'éclat du métal qui lui cause maintenant le plus de plaisir.
- Je soupçonne, dit M. Morelli, que nous ne sommes pas éloignés d'un heureux dénouement. Hier, Fatma me semblait fort émue tandis que nous parlions de saint Vincent de Paul et de l'impression qu'il avait fait éprouver à la femme de son maître.
- O sidi, vous sondez jusqu'au fond du cœur.
- C'est une bien intéressante aventure, si ce mot convient à la vie d'un saint, dit Mme Morelli, que cette captivité de saint Vincent de Paul à Tunis. Le hasard, ou, pour parler plus exactement, les accidents permis par la Providence ont dû conduire quelquefois en Barbarie des voyageurs dont la vie devenait un roman.
- Nous nous sommes entretenus des martyrs, ajouta Alfred; mais parmi les esclaves rachetés, on rencontre sans doute des personnages qui ont un nom dans l'histoire, ou que leurs aventures mêmes ont fait connaître.
- Cette conjecture bien naturelle est parfaitement fondée, répondit don Gervasio.
- Il y a des hasards vraiment curieux, ajouta M. Morelli. Ainsi, révérend père, la captivité de votre Cervantès à Alger n'est-elle pas une histoire étrange ?
- Étrange et glorieuse pour le poète, dit le trinitaire.
Le monde ne sait point assez qu'il nous doit Cervantès, et par conséquent Don Quichotte.
- Veuillez donc nous raconter ce fait, dit Mme Morelli.
- Michel Cervantès, reprit le trinitaire, est né à Alcala de Hénarès, d'une famille noble, mais sans fortune. Dans son enfance, il était dévoré de la curiosité de lire. Ses premières études se firent à Alcala et à Salamanque. Il vint ensuite à l'école de Madrid, où il obtint l'estime et l'affection de son maître Jean Lopen. Le cardinal Giulio Acquaviva, envoyé par Pie V à Philippe I, s'attacha Cervantès à titre de page ou de camerero ; il l'avait remarqué parmi les jeunes littérateurs qu'il admettait à sa table. Cervantès le suit en Italie, où ils se rendent en traversant, croit-on, le midi de la France. L'Italie, cette terre sacrée des arts, échauffe son génie précoce ; mais après quinze mois il quitte le cardinal pour s'engager les troupes espagnoles. Le 7 octobre 1571, à la bataille de Lépante, il est blessé de trois coups de feu, dont l'un lui brise la main gauche. Honorable souvenir qu'il rappelle plus d'une fois dans ses œuvres.
Bien sé que en la naval dura palestra Perdiste et movimiento de la mano Izquierda.
" Ma blessure, dit-il ailleurs, je l'ai reçue dans la plus éclatante action qu'aient vue les siècles passés et que puissent espérer de voir les siècles à venir. J'aime mieux la garder avec le souvenir d'avoir été à cette journée prodigieuse, que de me trouver sain et sauf à la condition de n'y avoir point assisté. "
Il avait fait l'expédition de Tunis en 1573, et il s'était couvert de gloire, quand il obtint un congé pour revoir sa patrie. Muni de lettres de recommandation adressées à Philippe II par don Juan d'Autriche et don Carlos d'Aragon, vice-roi de Sicile, il s'embarque à Naples sur la galère El Sol, avec don Rodrigue son frère, soldat comme lui. Le 26 septembre 1575, l'escadre d'Arnaut-Mami rencontre la galère espagnole, qui, enveloppée à l'improviste, soutient un combat acharné avant d'amener pavillon. Cervantès échut en partage au capitaine Dali-Mami, renégat grec, homme avare et cruel. Les lettres dont son esclave était porteur allumèrent la convoitise du renégat. Il se crut en possession d'un personnage des plus éminents, et se promit bien d'en tirer une rançon considérable. Dans cette vue, il lui rendit la captivité très dure, à force de vexations brutales et de privations excessives. Mais il avait affaire à une âme intrépide et fortement trempée dans la foi. Cervantès, sans attendre les secours qu'il pouvait espérer d'Espagne, médita les moyens de recouvrer la liberté par force ou par ruse. En 1576, il tente de s'enfuir à Oran avec d'autres compagnons d'esclavage. Il gagne un Maure, qui s'engage à leur servir de guide dans cette route longue et périlleuse.
Ce Maure, dès la première journée de marche, sent le cœur lui manquer ; il craint les châtiments qui le menacent s'il est arrêté comme traître ; il abandonne tout à coup les fugitifs, et ils sont obligés de revenir d'eux-mêmes à Alger, pour éviter un sort plus malheureux. Cervantès subit la colère de son maître, sans désespérer du succès pour une tentative nouvelle.
Cependant son vieux père, apprenant la captivité de ses fils, avait vendu tout ce qu'il possédait pour les racheter. Il leur envoya la somme qu'il avait pu réunir, et y ajouta môme la dot de leurs sœurs, qui n'étaient pas mariées. Dali?Mami, couvant de l'œil ce trésor, n'y vit pas toutefois de quoi satisfaire sa soif, et il déclara que cela suffisait à peine pour la rançon de l'un des deux frères.
Michel exige que Rodriguez accepte sa liberté, et dans l'effusion de fraternels adieux, il le charge d'expédier un navire à un point convenu de la côte, afin de pouvoir lui?même s'évader. Dès lors il s'occupe de préparer sa fuite et celle des esclaves qui mettraient à profit cette belle occasion. Il s'assure le concours de l'esclave navarrais Juan, qui cultivait, à trois milles d'Alger, le jardin du caïd Hassan, renégat grec. El-Dorador, esclave renégat, natif de Melilla, s'engage à leur donner la main.
Or, il y avait dans le jardin du caïd une caverne où se rendirent, au nombre d'une quinzaine, les chrétiens qui devaient s'embarquer sur le navire attendu. " Ils y restèrent enfermés, dit Haedo, sans voir la lumière, les uns sept mois, les autres cinq, les autres moins. Michel les nourrissait au grand péril de sa vie. " Enfin le jour de la délivrance approche. Cervantès, le 20 septembre 1577, va rejoindre ses compagnons dans le souterrain, regrettant de ne pouvoir emporter son ami malade, le docteur Antonio de Sosa.
La frégate si ardemment désirée fut en vue d'Alger le 28, sous les ordres du marin Viana. Elle allait aborder vers minuit, lorsque des Maures passant par hasard l'aperçurent et se mirent à crier : " Chrétiens ! Chrétiens ! Barque ! Barque ! "
Suivant une version, le navire ayant manqué son coup se retira, en renonçant à l'entreprise. Suivant d'autres, il revint le surlendemain; mais l'équipage et Viana, descendus à terre, furent faits prisonniers.
Quoi qu'il en soit. Cervantès et ses compagnons étaient trahis.
Le renégat El-Dorador, effrayé de l'issue de cette tentative, se présente au dey Hassan-Agha et lui révèle le complot, en dénonçant comme plus coupable le R. P. Georges Olibar, de l'ordre de la Merci, commandeur de Valence, et qui était alors à Alger en qualité de rédempteur de la couronne d'Aragon, Mais lorsque tous les fugitifs furent arrêtés, Cervantès se déclara seul auteur du complot, et il appela sur lui toutes les rigueurs dont on menaçait ses complices.
- Quel noble caractère ! dit Alfred.
- Le caïd pendit pour l'exemple Juan le Navarrais.
Cervantès fut rendu à Bali-Mami ; mais le dey Hassan l'acheta cinq cents écus d'or, autant pour s'assurer de sa personne que par spéculation. On peut voir la peinture du bagne de Hassan, où fut jeté Cervantès, dans le chapitre XI de Don Quichotte, épisode du Capitaine captif. Rien n'abattait la hardiesse de l'esclave. En 1578, il essaie de préparer une nouvelle évasion, et, pour nouer des relations avec Oran, il charge un Maure d'y porter une lettre. Mais on arrêta ce messager aux abords de la ville, et ce fut encore une déception accompagnée d'un redoublement de souffrances.
Ce qui est une cause de découragement pour les âmes vulgaires n'est souvent qu'un aiguillon pour les grands cœurs. Aussi, en 1579, ayant appris que le licencié Giron, renégat nommé Abd-er-Rhaman, et natif de Grenade, souhaitait d'abjurer son erreur et de retourner dans sa patrie, Cervantès le détermine à acheter de marchands de Valence une frégate, sur laquelle ils pourront s'enfuir avec d'autres esclaves. Ce projet échoua par le crime d'un traître, Juan Blanco de Pazo. Cervantès, la veille de l'embarquement projeté, s'était enfui du bagne à la maison de l'enseigne Diego Castellano, son ami, mais à la nouvelle de la révélation du complot, il se livra lui-même pour ne pas compromettre Diego; et quand le dey voulut l'obliger à nommer ses complices, il indiqua des esclaves rachetés de la veille, déjà en mer depuis quelque temps.
Hassan Agha fit renforcer les chaînes de cet homme indomptable. Cervantès médita cinq mois, sous le poids des fers, une conjuration formidable. Il ne s'agissait de rien moins que de soulever les vingt-cinq mille esclaves chrétiens dans Alger, et de s'emparer de la ville pour la remettre à Philippe II. Le plan fut habilement combiné. Cervantès, évadé de prison, était sur le point de le réaliser, quand il fut vendu par la trahison de plusieurs renégats. Traîné au palais du dey la chaîne au cou, et suivi de l'appareil du supplice, il étonne Hassan par la fierté de ses réponses, et le barbare lui laisse la vie sauve.
" Si le bonheur de Cervantès, dit Haedo, eût correspondu à son courage et à son adresse, aujourd'hui Alger serait aux chrétiens. Tous ses desseins tendaient à cela. "
Le dey, de son côté, disait : " Quand je suis sûr du manchot, la ville et mes navires n'ont rien à craindre, je suis tranquille. "
Cependant le père de Cervantès, son frère Rodriguez et Andrea, sa sœur, n'épargnaient aucun effort pour obtenir sa liberté. Ils remirent trois cents ducats, dans cette intention, aux pères trinitaires Juan Gil et Antonio de la Bella.
Le 29 mai 1580, ces rédempteurs arrivent à Alger. Hassan, disgracié, partait pour Constantinople, emmenant avec lui le plus précieux de ses captifs. Il n'y avait pas de temps à perdre. Les pères offrirent jusqu'à cinq cents écus d'or en échange de Cervantès. Hassan repoussa la proposition, et il exigea mille écus. Dans cette extrémité, les religieux durent recours à un emprunt, et Cervantès descendit du vaisseau qui allait l'emporter chargé de chaînes en Orient. Il garda aux trinitaires une reconnaissance éternelle.
- C'est un sentiment que le monde, et particulièrement les amis des lettres, doivent partager, dit M. Morelli ; car il est probable que, sans la charité de ces moines, Cervantès était perdu pour jamais, lui et les œuvres qu'il a composées depuis son retour en pagne.
- On ne croirait pas, ajouta Alfred, que le créateur de Don Quichotte et de Sancho Pança, que l'écrivain le plus habile à manier la fine plaisanterie et à exciter le franc rire, ait éprouvé de si longues souffrances dans l'enfer des bagnes. Cela suppose en lui une riche et puissante nature.
- Les aventures de Cervantès, dit M. Morelli, sont une des pages les plus curieuses de l'histoire des esclaves en Afrique. La captivité de Mlle de Bourk ne serait pas moins intéressante pour les jeunes filles.
- Oh ! veuillez nous la raconter, mon père, dit avec empressement Carlotta.
- En 1719, le 22 octobre, la comtesse de Bourk, dans le dessein d'aller rejoindre, à Madrid, son mari, M. de Bourk, ambassadeur du roi en Espagne, s'embarqua sur une tartane génoise qui faisait voile de Cette pour Barcelone. Elle emmenait avec elle son fils, âgé de huit ans, sa fille, âgée de neuf ans et dix mois, l'abbé de Bourk, une gouvernante pour ses enfants, une jeune fille, qu'elle avait prise par charité chez des religieuses de Villefranche, et plusieurs domestiques : en tout onze personnes. Dix-sept caisses plombées renfermaient ses meubles et de précieux objets d'orfèvrerie.
Le 25, un corsaire d'Alger de quatorze canons aperçut en mer la tartane, et détacha vers elle une chaloupe avec vingt Turcs armés, qui s'en rendirent maîtres. Ils se gorgèrent des provisions du bord, en pâtés, en vins et en eau-de-vie, et firent passer l'équipage génois sur le vaisseau corsaire où on le mit à la chaîne. Le capitaine des pirates, hollandais renégat, déclara à Mme de Bourk qu'il ne pouvait se dispenser de la conduire à Alger, où le dey la remettrait au consul de France, avec les personnes de sa compagnie qui étaient sous la protection du même passeport ; et il la laissa libre de rester sur la tartane, où elle avait moins à craindre de l'équipage musulman. Par reconnaissance, Mme de Bourk donna sa montre au capitaine, et elle en offrit une autre au commandant turc chargé des manœuvres de la tartane à la remorque.
Les 28, 29 et 30, une violente tempête se déchaîna, brisa le câble qui liait les deux navires, et la tartane, sans boussole, dirigée par des Turcs sans expérience de la navigation, fut poussée par le caprice des vents et de la mer au port de Collo.
Le commandant envoya deux Maures à la nage, pour reconnaître à terre quel point l'on avait abordé. Les Kabyles, habitants de cette côte, craignaient que ce ne fût un vaisseau chrétien venu avec des intentions hostiles.
Ils furent rassurés bientôt, et l'un des Maures rapporta au commandant là renseignements nécessaires pour prendre la route d'Alger. Celui-ci commit l'imprudence de ne pas lever l'ancre, et de couper le câble afin de partir plus vite. Un vent contraire jeta peu après le navire sur un rocher et le brisa. Mme de Bourk, qui était en prière dans sa cabine, fut noyée avec son fils et ses femmes de chambre. L'abbé et d'autres personnes qui s'étaient retirées vers la proue, s'accrochèrent à la carcasse du navire jeté sur le rocher. Un Irlandais nommé Arthur vit quelque chose qui se débattait dans les flots : il descendit, et trouva que c'était Mme de Bourk. Il la retira, et la mit entre les mains du maître d'hôtel, il s'élança ensuite à la mer, trop confiant dans son habileté comme nageur, et il disparut pour jamais sous les flots.
L'abbé réussit à se cramponner au rocher en enfonçant son couteau dans une fente de la pierre, puis il gagna le rivage avec l'aide d'une rame flottante.
Les Kabyles attendaient sur la plage ; ils s'emparèrent du naufragé, le dépouillèrent jusqu'à la chemise et le maltraitèrent inhumainement. Ils nagèrent bientôt à l'envi vers l'écueil où était Mlle de Bourk. Le maître d'hôtel la leur jeta ; ils la reçurent par une main et par un pied, et la conduisirent sur la grève. En les voyant s'approcher, cette courageuse enfant avait dit : " Je ne crains pas que ces gens-là me tuent; mais j'appréhende qu'ils me fassent changer de religion ; cependant je souffrirai plutôt la mort que de manquer à ce que j'ai promis à Dieu. " Le maître d'hôtel, une femme de chambre et un domestique ne tardèrent pas à rejoindre à terre l'abbé et Mlle de Bourk. Les Kabyles les dirigèrent vers un village de la montagne, en pressant leur marche à force de coups. Les malheureux naufragés teignaient de leur sang les sentiers raboteux. Ils portaient tour à tour la jeune demoiselle. Les habitants du premier dechera ou village qu'on atteignit dans la montagne, les accueillirent par des huées, et les chiens, innombrables comme vous le savez dans les tribus d'Algérie, hurlèrent contre les étrangers, mordirent le laquais et firent une profonde blessure à la femme de chambre.
- Est-il possible, ô Dieu ! s'écria Mme Moretti, quel y ait des hommes aussi féroces que les tigres et les panthères !
- Il est constant, dit Alfred, que tous les peuples barbares ont exercé sur les côtes de la mer ce qu'on a nommé le droit de naufrage. Ils pillaient les vaisseaux qui avaient le malheur d'échouer à leur portée; ils réduisaient en esclavage l'équipage et les passagers, comme s'ils ne devaient ni justice ni pitié à quiconque ne leur est point uni par les liens du droit civil. Le christianisme a réformé ces mœurs chez les barbares du Nord; il n'a pu le faire encore pour tous ceux de l'Afrique.
- Et d'ailleurs, poursuivit M. Morelli, on ne devait à ces Roumis que la mort ou l'esclavage. Les Kabyles se les partagèrent : l'abbé, Mlle de Bourk et l'hôtelier échurent au même maître. La pauvre enfant passa la nuit comme les autres, sur la terre nue, avec des habits encore mouillés de l'eau de la mer et l'esprit troublé de mille frayeurs.
Le dechera se composait d'une cinquantaine d'habitants, logés dans cinq ou six cabanes faites de boue, de roseaux, de branches d'arbre et de bouse de vache ; car, vous ne l'ignorez pas, les Kabyles de la montagne vivent dans de misérables maisons, mais non pas sous la tente, comme les Arabes des tribus. Plusieurs voulaient mettre à mort les chrétiens ; ils leur montraient le feu par menace, brandissaient les yatagans sur leur tête ou les couchaient en joue. L'un d'eux prit par les cheveux Mlle de Bourk, et lui posa sur le cou le fil de son sabre. Les enfants et les femmes ajoutaient des outrages à ces sauvages traitements.
Habiles plongeurs autant que légers et infatigables coureurs, les Kabyles retirèrent de la mer des ballots submergés et les cadavres qu'ils voulaient dépouiller. O horreur ! ils traînèrent sur la plage, à la vue du maître d'hôtel, le corps de Mme de Bourk, lui enlevèrent ses habits, et, pour avoir ses bagues, lui coupèrent les doigts avec des cailloux, de peur de souiller leurs couteaux au contact d'une chrétienne. Ils se firent ensuite un jeu de lancer des pierres sur ces cadavres enflés par l'eau et qui résonnaient sous leurs coups. Au partage du butin, ils vendirent pour cinq livres trois calices ternis par l'eau de la mer, et dont un seul valait au moins quatre cents livres. Ils laissèrent aux naufragés, sans en connaître le prix, quelques livres et une écritoire.
Durant trois semaines de séjour en ce lieu, Melle de Bourk écrivit trois lettres au consul de France à Alger ; mais elles ne furent pas remises. Le bey de Constantine fit sommer les Kabyles de lui envoyer les chrétiens dont il avait appris la capture; mais on lui répondit par un refus et en bravant sa puissance, fût-elle accrue de toutes les forces du dey d'Alger. Tel est le caractère de ces hommes indomptables et qui jusque aujourd'hui n'ont pas courbé la tête sous le joug étranger. Ils envoyèrent les chrétiens à leur cheikh, en résidence à Koukou. Celui-ci, après une délibération de la djema, ou assemblée des principaux du village, les rendit à leurs premiers maîtres. Durant ces voyages, les infortunés se crurent plusieurs fois à deux doigts de la mort ; ils éprouvèrent des angoisses et des privations inouïes. Cependant les enfants se familiarisèrent peu à peu avec Mlle de Bourk, et lui procurèrent la douceur d'un peu de lait qu'on lui servait avec le pain.
Elle écrivit au consul une quatrième lettre, qui parvint au dey le 24 novembre. Celui-ci la fit remettre à M. Dusault.
La jeune fille racontait avec simplicité, mais de manière à exciter les larmes, tout ce qui était arrivé : elle conjurait que l'on eût compassion de leur triste sort et qu'on vint les secourir. Les pères Comelin, de la Motte et Bernard, de l'ordre de la Trinité, qui se trouvaient alors à Alger, offrirent leurs services. Mais ils n'avaient pas besoin d'animer le zèle de M. Dusault, qui connaissait d'ailleurs la famille de Bourk.
Il expédia une tartane française avec des provisions et une lettre du dey au grand marabout de Bougie, dont le caractère était respecté des Kabyles de cette contrée. Le marabout, ayant reçu les lettres et les explications nécessaires, monta à cheval, accompagné du drogman de la tartane, d'un marabout de Djigelly et de quelques Kabyles. Ils arrivèrent, à cinq ou six jours de Bougie, dans la montagne où étaient les chrétiens. Les Kabyles s'apprêtaient à se défendre de l'intérieur de la cabane où ils tenaient leurs prisonniers ; mais ils s'enfuirent lorsque le marabouts frappèrent à la porte : la malédiction des marabouts est plus redoutée en Kabylie que les forces d'une armée.
Les chrétiens, à ce tumulte, crurent leur dernière heure arrivée ; mais le marabout El -Kébir, s'approchant de Melle de Bourk, lui donna la lettre du consul et dissipa leurs terreurs. Le lendemain il manda les Kabyles qui s'étaient enfuis, et ils vinrent lui baiser les mains.
Toutefois il eut beaucoup de peine à leur faire comprendre qu'ils devaient rendre les chrétiens, parce qu'ils étaient Français, et que la paix régnait entre la France et le dey d'Alger. Il convint que les Kabyles n'étaient point sujets du dey ; mais il fit observer que les côtes de Kabylie étaient néanmoins respectées par les navires de guerre français, à raison des traités avec les Algériens.
Nos esclaves, témoins de ces contestations, ne savaient pas s'il fallait espérer encore. Enfin les Kabyles consentirent à les relâcher, en exceptant Mlle de Bourk. Le cheikh voulait absolument la garder et la donner en mariage à son fils, âgé de quatorze ans ; " Fût-elle fille du roi de France, disait-il, mon fils ne serait pas indigne de l'avoir pour épouse. "
Le marabout dut prendre le cheikh à part afin de combattre ses prétentions inflexibles. Il ajouta aux raisonnements des sultanis d'or qui leur donnèrent beaucoup de poids. Mlle de Bourk fut livrée avec les autres captifs, pour neuf cents piastres payables très prochainement. Le marabout laissa un Turc en Étage et des joyaux de ses femmes en garantie. Grande fut la joie des chrétiens quand ils prirent le chemin de Bougie, où la tartane les attendait. Ils logèrent, durant le trajet, dans les cabanes ou tezaka des Kabyles. Un soir, tout en préparant un sale plat de couscous aux marabouts, une de ces vieilles femmes, d'une laideur monstrueuse qu'on ne trouverait guère en pays chrétien, se déchaîna contre les montagnards qui n'avaient pas tué les captifs . " Elle l'aurait fait, s'écriait-elle, si ces Roumis étaient tombés entre les mains de son mari. "
A la vue de telles dispositions, les naufragés hâtaient de leurs vœux le moment où ils quitteraient cette terre inhospitalière. Ils s'embarquèrent le 10 décembre à Bougie, et le 13, à la pointe du jour, ils entraient au port d'Alger.
Un coup de canon d'un vaisseau français signala leur arrivée impatiemment attendue. Ils furent reçus avec bonheur à l'hôtel du consul. M. Dusault, prenant par la main Melle de Bourk, la conduisit à la chapelle, où elle entendit la messe, ainsi que ses compagnons d'infortune. On chanta ensuite un Te Deum d'action de grâces, et tous les chrétiens qui assistaient à la cérémonie avaient peine à retenir leurs larmes. Des Turcs et des Juifs qui s'étaient introduits dans l'hôtel parurent eux-mêmes touchés du spectacle dont ils furent témoins. " Nous tirâmes avec plaisir de nos caisses, dit le père Comelin, les neuf cents piastres (un peu plus de cinq mille francs), qu'on envoya à l'instant même, chez les Juifs, afin de les blanchir, suivant le goût des Maures des montagnes. " M. Dusault y joignit des présents pour le grand marabout et les autres officiers qui lui avaient rendu un si bon office. Il en chargea le Maure qui était venu de la part du marabout et n'attendait que l'occasion de retourner à Bougie.
Ainsi furent délivrés de la captivité Melle de Bourk et ses serviteurs. Ils louaient extrêmement la force d'âme de cette enfant, au milieu de l'infortune et des misères qui ne lui avaient point enlevé un certain air de noblesse et d'heureuse éducation. Dans sa foi vive et sa raison précoce, elle encourageait elle-même les autres à souffrir la mort plutôt que déroger à la religion de Jésus-Christ.
- On pourrait, dit le père Gervais, comparer cette Héroïne au jeune Tobie, qui, emmené captif à Ninive, soutint ses compatriotes par ses exemples, et ne laissa rien paraître en ses actions qui tint de l'enfance: Quumque esset junior omnibus, nihil tamen puerile gessit in opere.
Durant les premiers temps de ma résidence à Alger, continua le moine, on parla beaucoup de votre savant compatriote M. Arago, dont les aventures en Afrique sont également fort étranges, Il était occupé, en 1808, à mesurer, pour servir à la détermination de l'arc du méridien, la hauteur du clop de Galazo, la plus haute montagne de Majorque, lorsqu'une insurrection éclata dans Palma contre les Français. La foule s'imagina que les signaux de feux allumés sur la montagne par le savant avaient pour but de diriger l'escadre française. On se précipita au clop de Galazo afin de s'emparer du jeune homme, mais, prévenu à temps, il revêtit le costume du pays, et, comme il en parlait très-bien la langue, il trompa les exaltés qui le cherchaient. A Palma, ses amis ne trouvèrent pas de meilleur moyen pour sauver sa vie que de l'emprisonner au château de Belver. En s'y rendant, il faillit être exterminé par l'émeute. On ménagea ensuite son évasion, et il s'embarqua sur une chaloupe munie d'une provision de pain et d'oranges. Il fuyait avec M. Bertmy, officier d'ordonnance de Napoléon. La chaloupe échappa, grâce à son exiguïté, aux navires anglais qu'elle aperçut en mer, et, le 1er août, elle entra dans le port d'Alger.
Le 8, les fugitifs partaient pour Marseille sur un navire algérien, avec des passeports du consul d'Autriche. Le navire fut pris par un corsaire espagnol de Palamos et conduit à Rosas. Là M. Arago se trouva de nouveau dans un péril imminent, parce que la perfection avec laquelle il parlait l'espagnol le faisait regarder comme originaire d'Espagne et traître à son pays. Il ne pouvait d'ailleurs se déclarer Français. On le jeta dans un fort de Rosas, puis dans un souterrain où s'entassaient les prisonniers musulmans et chrétiens rongés de vermine.
Il réussit à faire connaître leur sort commun au dey d'Alger par une lettre. Celui-ci menaça la junte espagnole, qui gouvernait en Catalogne au nom de la nation, de déclarer la guerre à l'Espagne si l'on ne rendait le bâtiment capturé. Cette menace obtint un succès immédiat, et M. Arago fit voile sur le même navire de Rosas à Marseille.
Mais le mistral pousse avec furie le vaisseau sur les côtes, de la Sardaigne, qui était alors en guerre avec Alger.
On manœuvra pour s'écarter. Après plusieurs jours d'une navigation malhabile, on découvrit qu'on était à Bougie au lieu d'entrer à Majorque. La saison ne permettait pas de naviguer sur la côte d'Afrique pour regagner Alger. M. Arago résolut de se déguiser en Arabe et de se rendre par terre en cette ville, sous la protection d'un marabout.
Il effectua heureusement ce voyage, que nous tiendrions presque aujourd'hui pour impossible. Mais, à son arrivée, une révolution éclate ; un nouveau dey réclame de la France une dette prétendue, et, sur un refus, inscrit le consul français et tous vos nationaux sur le registre des esclaves, avec menace de les envoyer au bagne. M. Arago fut mis à l'abri de cet orage par le consul de Suède ; et, lorsqu'on eut payé la rançon des Français, il s'embarqua de nouveau pour Marseille sur un corsaire algérien. Ce navire fut arrêté par deux frégates anglaises ; mais de fausses manœuvres lui permirent de s'échapper et d'entrer au port de Pomègue, où le futur secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences vit enfin le terme de ses fabuleuses aventures.
- Hé quoi ! dit Alfred, sous l'Empire les Algériens osaient encore inscrire un consul de France au nombre des esclaves ?
- Oui, répondit le moine, et la course continuait au XIXe siècle, malgré les répressions et les expéditions nombreuses dont nous avons précédemment parlé. Ainsi Tunis, au commencement de ce siècle, retenait encore en esclavage toute la population de l'île sarde de San-Pietro, enlevée d'un seul coup, en 1798, au nombre de plus de neuf cents personnes !. Les corsaires firent cette capture durant la nuit, et ils entassèrent à fond de cale les hommes enchaînés, les vieillards, les femmes, les enfants, hurlant de terreur et de désespoir. Il fallut de, longues négociations, l'intervention du consul de France pour les racheter, quatre ans et demi plus tard, et au prix de deux cent cinquante mille francs, non compris soixante-dix mille francs exigés comme rançon d'esclaves sardes enlevés en d'autres circonstances.
- Comment donc, demanda Mme Morelli, l'Europe a-t-elle mis fin à ces lamentables excès ?
- Au congrès de Vienne, répondit le religieux, l'Angleterre promit, en échange des îles Ioniennes, de protéger le commerce européen contre les Barbaresques. Elle obtint en effet quelques réparations à Alger, à Tunis, à Tripoli.
Alger refusa, toutefois, de consentir à l'abolition de l'esclavage des Européens et à traiter les prisonniers comme ils le sont en Europe. Cette concession avait été faite dans les autres régences, malgré la rage des janissaires. Bientôt les Algériens mirent en prison le consul d'Angleterre ; à Bône, on massacra les corailleurs ; à Oran, des chrétiens subirent le même sort, et des corsaires pillèrent un village de Sardaigne, dont ils enlevèrent deux cents habitants. Ces atrocités ramenèrent devant Alger, le 27 août 1816, la flotte anglaise sous les ordres de lord Exmouth. Il envoya un parlementaire, qui revint sans réponse, et le feu commença.
Le bombardement causa de grands désastres dans la ville ; mais la flotte souffrit beaucoup du canon des Turcs, et lord Exmouth fut heureux que le dey Omar consentit à signer la paix aux conditions proposées avant le combat : délivrance sans rançon des esclaves chrétiens, abolition de l'esclavage des Européens, et réparations diverses en excuses ou en argent. Les janissaires accusèrent Omar de lâcheté, bien qu'il se fût montré d'une grande bravoure pendant l'action, et il fut peu après obligé de tendre le cou au lacet que des conjurés lui présentèrent. C'était le 8 septembre 1817.
Ali-Khodja, monstre de luxure et de cruauté, lui succéda. Il se renferma dans la Casbah, où il mourut de la peste, en 1818, après avoir fait tomber plus de quinze cents têtes pour assurer sa puissance. Hussein, le dernier dey d'Alger, voulut, au mépris du traité de 1816 et des conventions antérieures qui l'engageaient vis-à-vis de la France, donner quelque satisfaction aux Algériens, qui souffraient et se plaignaient de la cessation de la piraterie. Bien que M. Deval, consul de France, eût consenti à porter de soixante mille à deux cent mille francs la redevance annuelle de la compagnie française pour la pêche du corail, les faits de piraterie recommencèrent par le pillage de bâtiments qui naviguaient sous pavillon français, et les infractions aux règlements maritimes se multiplièrent de façon à porter une grave atteinte à l'honneur de l'Europe comme à ses droits.
En 1818, un brick français fut pillé par les habitants de Bône, et l'on ne put obtenir de réparation. En 1823, on viola, sous prétexte de contrebande, la maison du consul de France à Alger. On captura des bâtiments romains protégés par le pavillon français, et l'on s'empara de marchandises françaises sur des navires espagnols, où, suivant les traités, elles devaient être respectées.
La France, particulièrement insultée, le fut une dernière fois, mais d'une manière sanglante, le 27 avril 1827, dans la personne de son représentant. Le dey frappa M. le consul Deval d'un chasse-mouches en plumes de paon qu'il avait à la main. Ce fut l'occasion de l'expédition d'Alger, qui écrasa pour jamais ce nid de pirates. Charles X ne comprit peut-être pas toute l'étendue de la mission providentielle qu'il remplissait ; mais la conquête d'Alger n'en est pas moins un magnifique adieu de la dynastie des Bourbons à la France : cette famille avait fait de trop grandes choses pour tomber autrement.
Que la France marche maintenant dans les voies où Dieu la pousse ! Qu'elle réalise, par des moyens en rapport avec notre temps, les desseins de saint Louis, d'Henri IV et de Napoléon ! L'abolition de la piraterie et de l'esclavage des chrétiens n'est qu'un premier résultat, le commencement d'une grande œuvre.
Déjà l'influence de la France et le respect mêlé de crainte qu'elle inspire sur ces rivages barbares, ont porté quelques fruits. Non-seulement les corsaires ont disparu, non-seulement l'esclavage des Européens a cessé, en vertu de lois portées par les princes musulmans eux-mêmes ; mais ces princes commencent à rayer du code infâme de Mahomet la consécration de l'esclavage en général. Si la mesure est encore incomplète, c'est que le temps et la prudence ont leur part dans ces réformes.
Le 8 août 1830, M. Matthieu de Lesseps, consul général, obtenait aisément, sous l'impression de la conquête d'Alger, une convention par laquelle Hussein, bey de Tunis, abolissait pour toujours dans ses États la course des pirates et l'esclavage des chrétiens; et le neveu de Hussein, Sidi-Ahmed-Pacha-Bey, arrivant au pouvoir, en 1837, interdisait absolument la vente à l'enchère des esclaves de toute race, et fermait le marché où cet odieux trafic se faisait publiquement.
C'est le même pacha qui autorisa Louis-Philippe à ériger la chapelle Saint-Louis, sur l'emplacement de la citadelle de Carthage. On lui doit encore la destruction du Bordj-er-Riouss, dans l'île de Djerba, aux frontières des régences de Tunis et de Tripoli.
- Qu'était-ce donc ? dit Alfred.
- C'était une pyramide de trente pieds de haut sur cent trente de circonférence, et bâtie avec des crânes de chrétiens ; de là son nom de Bordj-er-Riouss (la Tour desTêtes). Selon le voyageur Paul Lucas, ce monument lugubre avait été construit par le cheik Arcan, conquérant de l'île sur la chrétienté. Je ne sais de quelle conquête Paul Lucas veut parler; mais il est certain que les Espagnols auraient démoli cette pyramide, si elle eût existé au XVIe siècle, quand ils se rendirent maîtres de Djerba. Il est raisonnable de croire qu'elle date plutôt de leur expulsion, en 1660, lorsque Alvar de Sande, après un combat des plus héroïques dont l'histoire fasse mention, remit son épée à l'amiral turc Piali-Pacha.
Les hommes que Sande commandait se firent tuer jusqu'au dernier. Seul il resta debout et blessé, et il ne voulut se rendre qu'au pacha lui-même.
Les crânes et les débris des squelettes de ses généreux compagnons d'armes formèrent ce Bordj-er-Riouss, dont la base était en pierres de taille. En 1846, Mgr Fidèle Sutter, après une visite pastorale à Djerba, parla au consul français à Tunis de ce monument du triomphe des musulmans sur les chrétiens, et de l'impression pénible qu'il en avait ressentie. On fit des instances auprès du bey pour sa destruction.
Elle fut décrétée en 1847. Le révérend père Gaetano de Ferrare, ministre capucin en résidence à cette île, recueillit les crânes et les ossements. On les transporta au cimetière chrétien, où ils furent déposés dans une grande fosse. Tous les chrétiens de Djerba assistèrent à cette cérémonie.
Parmi les os, on avait découvert une petite croix. Le père Gaetano, dans un voyage à Rome, en septembre 1849, la présenta au saint-père Pie IX, qui l'accepta volontiers comme un pieux et touchant souvenir.
Ce soir, du moins, dit Mme Morelli, nous respirons librement.
- Il nous semble, révérend père, que vous nous enlevez un poids de dessus le cœur, ajouta Alfred; nous avons vu, grâce surtout à la France après Dieu, la fin d'une grande calamité, la réparation d'un grand déshonneur, la punition d'une grande iniquité : l'esclavage des chrétiens en Afrique n'est plus qu'un souvenir.
- Et nous avons fait plus, dit M. Morelli, puisque nous avons donné l'exemple et le signal déjà suivi de l'affranchissement universel des esclaves dans les pays musulmans.
- El-hamdou lillahi, Rabbi, el-salemyna, er-rahman, er-rahym ! - Louange à Dieu, maître de l'univers, le clément, le miséricordieux ! "
Fatma jetait cette exclamation au moment où la conversation finissait, et où l'on se retirait pour aller prendre le repos de la nuit.
" Tu n'oublies point, dit Alfred, les formules de prières musulmanes.
- Oh ! répondit Carlotta, cette formule est musulmane ; mais le cœur dont elle s'échappe ne l'est déjà plus. "
A SUIVRE
|
CONTE EN SABIR
Par Kaddour
|
|
LI CHACAL QUI YANA PAS SA QUEUE
FABLE IMITEE DE LA FONTAINE!
Un vio chacail, ma tot a fi digordi
Qui coni quisqui ci por trapi les poli
Por mangi li lapin y li pitit moton,
On chacail qui ji soui canaille por di bon :
On jor por sa queue, on zarabe (sans sabatte)
Il attrape cit chacail ;
Comi la por ji m'en aille,
Y tire mon zami :
Tout d'un coup y si sauve, y cor afic son patte
Ma sa queue son fini.
Y vian à son mison, tot à fi coilloné
Sa femme quand il y voir, y sa fouti di Ioui.
Li chacail son pensi : " Pas bisoan di bloré,
Ji va sarché quiqu' soge y poui
Ji ti fir voir quisqui fir on chacail
Qui yana one blissour qui viann dans one bataille. "
Li jor qui li chacails y viannent bor la Djemmâa,
Y dimande la barole à mosiou présidann,
Y voilà quisqui dire :
- " Ji si pas bourquoi fir, li mon Dio y nos a
Douni cit micanique, por ji traîne por tirre.
Borquoi fir qui j'en a cit queue
Qui son lourd, qui s'accroche, quand ji marche la brosaille
Qui tojor ji son cause, ji peu pas ji m'en aille.
Si ti yana bon lite
Vos fir quisqui ji di, tos vo copi la queue. "
- " Por sûr ti n'y pas bite,
Ji crois ti a rison,
(Qui son barli por loui, Mosiou li présidann)
Ma fit voir vot darrière, ji dira s'il y a bon
Si la queue pas bisoann. "
Quand misio li chacails, y son voir cit kouffa
La queue j'yana pas
Y son crivi por rire, di loui y son fouti.
Pas moyann bor barli, tot suite y son bard
Afic la queue droite, y fir gran fantasia.
Li vio chacail y rage, porquoi y n'en a pas.
MORALE
Ji voir qui li zami, cit. tos di saloperi
Si on jor one poli d'on zarabe ti a pri.
Tot souite la Djemmâa, y vos donne one mardaille
Y moi qui ja perdu, mon queue dans one bataille
Y sa fouti di moi
Y parc' qui son bocoup, par force y fir la loi.
|
|
CARTES D'ALGERIE
De M. Gérard Mayer
Envoi de M. Duchenne
|
Des cartes que l'on trouvait sur les murs de nos Ecoles en Algérie

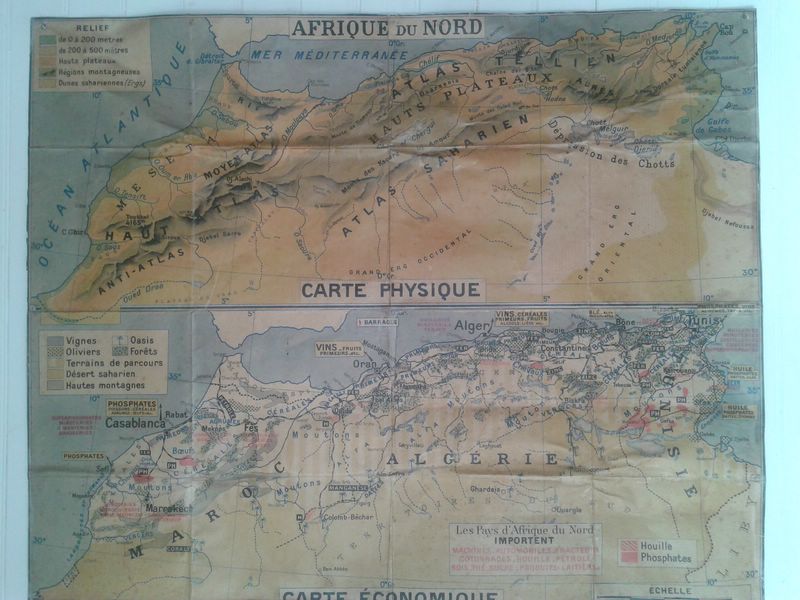
|
|
MES SOUVENIRS
Par Mme ETIENNE Paulette (93 ans)
|
|
LES PETITS METIERS DE CHEZ NOUS
- LES BOUSSADIAS -
Qui de nous, ne se souvient des Boussadïas ? je ne sais pas si l'orthographe est correcte sais ce dont je suis sûre c'est de la terreur qu'ils inspiraient aux enfants. Un beau jour, sans qu'on sache pourquoi ni comment, ils apparaissaient dans nos rues, s'annonçant par de petits tapotements sur leurs tam-tam: Ils allaient toujours par deux, tout noir, le "musicien" et le "danseur", plus très jeunes tous les deux.
Le danseur, plutôt grand, frappait d'abord par son accoutrement, dessus ses vêtements, il portait une ceinture de laquelle pendaient, attachée par la queue, des peaux de chacal; sur sa tête une espèce de mitre décorée de perles multicolores et de nombreux débris de miroirs et de verre dans lesquels le soleil se reflétait en mille éclats; ses pieds étaient chaussés de sandales et il tenait un tam-tam à la main.
Le musicien, lui, n'avait rien de spécial, il portait une espèce de sac accroché à l'épaule et son tam-tam sur lequel il tapait en cadence en chantant une mélopée. Les enfants attirés par le bruit leur faisaient escorte mais à distance respectueuse.
Aux fenêtres des têtes apparaissaient, les enfants faisaient cercle. Alors le rythme des tam-tam s'accélérait; le danseur, d'abord lentement, se mettait à faire une espèce de gigue se dandinant et sautant d'un pied sur l'autre, puis suivant la cadence du tam-tam il saccadait sa danse se mettant à tourner comme un derviche. Les dépouilles de chacals s'élargissaient autour de lui, sa mitre brillait de tous ses éclats de verre. Dans sa face noire ses yeux roulaient comme des billes, il tirait la langue qui nous paraissait énorme, toute rouge comme celle du diable. De temps à autre il faisait semblant de se précipiter vers la ronde des enfants qui s'éparpillaient en poussant des cris aigus et qui revenaient aussitôt excités et apeurés.
Bientôt le rythme se ralentissait et des fenêtres les piécettes tombaient, tintant sur les pavés. parfois un enfant plus courageux qu'un autre se précipitait pour la ramasser et rouge d'excitation et de crainte, un pied en arrière pour se sauver plus vite, la lui jetait vivement dans la main.
Sur un dernier roulement de tambour, ils reprenaient leur chemin; toujours suivis de quelques gosses, ils reprenaient leur danse plus loin, puis, on ne les revoyait plus, ils avaient dû regagner leur mechta ou leur douar, attendant la belle saison pour réapparaître. Mais que sont-ils devenus?
Paulette ETIENNE
|
|
| HISTOIRE DES VILLES DE LA
PROVINCE DE CONSTANTINE N°9
PAR CHARLES FÉRAUD
Interprète principal de l'Armée auprès du Gouverneur général de l'Algérie.
|
|
LA CALLE
ET DOCUMENTS POUR SERVIR A L'HISTOIRE
DES ANCIENNES CONCESSIONS
FRANÇAISES D'AFRIQUE.
Au GÉNÉRAL FORGEMOL
Ancien Capitaine Commandant supérieur,
du Cercle de La Calle
Le Chevalier d'Arvieux, Consul à Alger en 1674.
Cependant le Gouvernement français qui voulait terminer cette ridicule affaire, fit partir pour Alger, en janvier 1674, l'auteur des mémoires dans lesquels nous trouvons le récit des événements dont il est question ici.
A ce moment, le Consulat d'Alger se trouvait vacant parce que le Dey avait renvoyé en France le Consul du Bourdieu sous le prétexte qu'il avait favorisé l'évasion de plusieurs Esclaves qui s'étaient sauvés à bord des vaisseaux de guerre Français qui passaient quelquefois à Alger. Cela avait causé une Sédition dans la Milice barbaresque qui était prête rompre la paix. On en était venu jusqu'à refuser le salut à des vaisseaux du Roi de, France et à ne pas leur donner les provisions de bouche dont ils avaient besoin La mission du Chevalier d'Arvieux était donc extrêmement délicate: il s'agissait, pour lui, de régler non-seulement les affaires du Bastion, mais encore celles du Roi. Il fallait entretenir avec les Algériens une paix qui était indispensable au commerce, que la quantité de Corsaires, sortant de leurs Ports, aurait pu troubler.
Avant de quitter Marseille, le Chevalier d'Arvieux proposa un accommodement aux divers intéressés dé la Compagnie du Bastion. Grâce à sa médiation, on finit par tomber d'accord et la transaction était signée chez un Notaire. Arnaud s'obligeait â remettre le Bastion à de La Font, et Estelle à quitter Alger et repasser en France. La Compagnie s'obligeait à donner douze mille écus à Arnaud comme dédommagement, à obtenir son amnistie en bonne forme et à payer toutes les dettes de l'Établissement. - Tout semblait terminé, mais de La Font allait secrètement chez un Notaire faire une protestation contre la transaction qu'il avait signée, sous prétexte qu'il avait été violenté et forcé à faire cet accommodement. Il obtint ensuite des Lettres de Rescision quelque temps après le départ de d'Arvieux, qui ne parurent que quand celui-ci fut arrivé à Alger et qu'il y fut arrivé lui-même, pour se mettre en possession du Bastion et de La Calle. Cela mit les affaires dans le même état qu'elles étaient auparavant.
Le Chevalier d'Arvieux raconte maintenant dans ses Mémoires les intrigues ourdies contre lui, dès son embarquement à Alger, par des compatriotes indignes qui, pour sauvegarder leurs intérêts, eurent l'infamie faire subir au Consul, représentant de leur Nation, l'affront d'être renvoyé par le Gouvernement barbaresque. Cet incident est un curieux tableau de mœurs l'époque, que je n'hésite pas à relater ici en donnant le récit textuel de d'Arvieux : " Parti de Marseille, le 1er septembre 1674, la barque sur laquelle était d'Arvieux touchait à Bougie, 6, où elle s'arrêta deux jours.
Le 10, ajoute-t-il, nous arrivâmes à Alger, vers les trois heures de l'après-midi. Nous mouillâmes et saluâmes la Ville, et un peu après le Dey passa auprès de nous dans un petit bateau, accompagné seulement de deux personnes. Nous le saluâmes de cinq coups de canon. M. Le Vacher, Vicaire Apostolique, vint me saluer avec Sid Ali, Renégat, Janissaire et Trucheman de notre Nation. Il me dit de la part du Dey que j'étais le bienvenu et que je pouvais débarquer avec mon Équipage.
" Je fis mettre quelques hardes nécessaires dans la chaloupe ou je m'embarquai avec mes gens, M. Le cher, le Trucheman et quelques Marchands. La barque me salua de toute son artillerie, et je fus salué tous les Bâtiments Français, Anglais et Livournais qui tirèrent chacun cinq coups de canon. J'avais mon épée au côté, ma canne à la main et un habit assez propre pour être distingué de tous ceux qui m'accompagnaient.
" Nous mîmes pied à terre à la Porte de la Pêcherie, et ayant traversé la grande rue du Marché, nous entrâmes dans le lieu où se tient le Divan de la Milice. Ils l'appellent la Maison du Roy (l'ancienne Janina sur la Place du Gouvernement), non pas qu'il y ait un Roy à Alger, mais parce que la Milice du Grand Seigneur y reçoit sa paye, qu'on y traite les affaires de l'État et que le Pacha, qui représente sa personne, y fait sa résidence.
" Nous traversâmes une grande cour où nous ne trouvâmes personne, la garde étant déjà retirée et le Dey étant encore à la Marine. Son gendre, appelé Baba Hassan, y était assis dans un coin. Je trouvai un homme de fort mauvaise mine et habillé d'une manière peu convenable à une personne qui était la seconde de l'État et réellement la première en puissance et eu autorité à cause du grand âge et de la faiblesse du Dey. Je ne l'aurais jamais connu pour ce qu'il était si le Trucheman ne me l'avait dit et si je n'eusse pas remarqué les révérences que lui faisaient ceux qui l'approchaient. Après que je l'eus salué, il ne se donna pas le temps d'écouter mon compliment. Il m'en fit un de fort mauvaise grâce et fort impoli, mais qui convenait à un homme de son caractère, brutal, emporté, et n'ayant que les manières d'un vrai paysan, tel qu'il était. Il se leva sans regarder personne et se mit dans une colère furieuse contre Sid Ali, le Trucheman, de, ce qu'il m'avait fait débarquer sans attendre qu'on eût délibéré avec le Dey si on devait me recevoir, parce qu'il savait que, sous prétexte d'exercer le Consulat, on ne m'envoyait que pour favoriser les pernicieux desseins de la Compagnie du Bastion contre leur bon ami Arnaud et pour établir le nommé de La Font qui avait conspiré contre la vie du Dey et la sienne. Le Trucheman demeura si interdit qu'il ne put répondre un mot. Je pris la parole et je lui dis qu'on ne recevait point ainsi les gens qui venaient, à Alger, de la part du Roy, sous la bonne foi de la paix, et je lui tournai brusquement le dos appelant mes gens pour m'en retourner à la barque. Baba Hassan se repentit sur-le-champ de sa brutalité. Il envoya le Trucheman après moi et pria M. Le Vacher de me radoucir et de me mener à la maison Consulaire, et que le lendemain j'aurais audience du Dey.
Nous arrivâmes à la maison Consulaire. J'y fus complimenté de tous les Français, du Consul d'Angleterre, des Pères Mathurins Portugais qui étaient à Alger pour le rachat des Esclaves de toutes sortes de nations ; car les Esclaves ont toujours recours au Consul de France, selon les capitulations, parce qu'il est censé Consul de toutes les nations qui n'en ont point auprès de cette République de Larrons.
J'appris qu'avant mon arrivée le sieur Estelle, instruit par les lettres de la dame Arnaud de mon voyage, avait fait entendre au Dey et à son gendre que, pendant mon séjour à Marseille, j'avais brouillé les affaires du sieur Arnaud ; que j'étais entretenu par la Compagnie du Bastion ; que le Consulat qu'on m'avait donné n'était qu'un prétexte que le Roy prenait pour se servir de moi contre les intérêts de la République d'Alger et qu'on ferait fort bien de me renvoyer au lieu de me recevoir.
Ces raisonnements tout défectueux qu'ils étaient, avaient engagé le Dey d'écrire au Roy et de le prier de ne point me donner cette Commission si je devais ouvrir la bouche pour lui parler du Bastion et de sa Compagnie, et que si le sieur de La Font y venait, il en ferait un exemple et qu'il l'enverrait pieds et poings liés comme un criminel qui avait attenté à sa vie la dernière fois qu'il était venu dans le pays. Le sieur Estelle vint, le même jour, me faire ses froids compliments sur mon arrivée. Je les lui rendis de la même manière et sans entrer dans aucun détail avec lui, mais je ne pus m'empêcher de lui dire que si je m'apercevais qu'il me traversât, j'en donnerais avis à la Cour et qu'il pourrait s'en repentir.
Le jour suivant, 11 septembre, M. le Vacher et le Trucheman s'en allèrent voir le Dey, de grand matin, et lui parlèrent assez vigoureusement sur la manière dont son gendre m'avait reçu en arrivant. Ils lui firent connaître que j'étais dans le dessein de me rembarquer, et qu'il en pourrait arriver du désordre, et l'assurèrent que je ne me souciais plus d'avoir audience, après ce qui m'était arrivé le jour précédent.
Le bonhomme appelé Hadji Mohamed, âgé de plus de quatre-vingts ans, lui répondit que son gendre n'avait été en colère que parce que le Trucheman m'avait fait débarquer sans attendre qu'il fut de retour de la marine, dans l'intention où il savait qu'il était d'envoyer au devant de moi les Officiers du Divan pour me recevoir en cérémonie et honorer ma personne et mon caractère tout autant qu'il dépendait de lui et qu'il me priait de le venir voir aussitôt que je pourrais.
En effet, le Chevalier d'Arvieux fut reçu en audience par le Dey et le Pacha.
" Le sieur Estelle, ajoute-t-il, vint ensuite me proposer des moyens pour mettre de La Font en possession du Bastion et l'y établir à la place d'Arnaud ; mais je connaissais trop cet homme pour m'ouvrir avec lui je lui dis pour toute réponse que je ne me mêlais point de ces affaires-là.
Le 15, j'envoyai mes présents au Pacha, au Dey et à Baba Hassan. Ils consistaient en draps de Hollande couleur de feu, en brocards de soie et en boîtes de confitures, qui valaient chacun environ 200 piastres. Outre cela, j'envoyai une veste couleur de feu au Kihaïa du Pacha. Tous ces présents furent bien reçus, mais comme le Dey et Baba Hassan voulaient être distingués du Pacha et avoir leur présent en argent, ce qui est contraire à la coutume, ils me renvoyèrent le même jour les draps et les brocards, disant que cette couleur n'était pas à leur usage, qu'ils ne me demandaient rien et que les confitures suffisaient pour régaler leurs petits enfants. Je leur fis offrir d'autres étoffes, ils me remercièrent en disant qu'ils me parleraient de cela dans une autre occasion. Un des domestiques du Dey, à qui j'avais fait une gratification, vint m'avertir que le sieur Estelle voulant me rendre désagréable au Dey, l'avait dégoûté de mes présents, en lui disant que, selon les apparences, je ne venais pas de la part du Roy, puisque je lui faisais un présent si médiocre ; que je n'étais qu'un homme que la Compagnie du Bastion avait supposé pour en chasser Arnaud. Le Dey et son gendre le crurent et m'envoyèrent le Trucheman me faire défendre de me mêler de ces affaires, parce qu'ils ne voulaient rien avoir à démêler avec leur ennemi irréconciliable, de La Font. Je leur envoyai dire que je ne m'en mêlerais jamais de mon chef, mais que si le Roy me l'ordonnait, je serais obligé de lui obéir.
Le 16, dans une audience, je représentai au Dey que j'étais surpris qu'il m'eut renvoyé mes présents après les avoir reçus, que je voyais bien par-là qu'on me rendait de mauvais offices auprès de lui, et qu'on lui voulait persuader que j'étais d'intelligence avec des gens qu'il croyait être ses ennemis, ce qui n'était point.
Le Dey me répondit qu'il était maître du Bastion : qu'il le donnerait à qui bon lui semblerait ; qu'il était content du sieur Arnaud, parce qu'il avait de l'amitié pour lui et qu'il lui tenait parole sur tout ce qu'il lui avait promis ; qu'il n'y souffrirait jamais le sieur de La Font, à cause de sa conspiration, et que je ne devais me mêler que des choses qui regardaient ma charge, si je voulais bien vivre avec eux.
Le 21 on reçut nouvelle du Bastion que le sieur Arnaud y était mort le 10 du mois précédent : une fièvre violente avait emporté l'opiniâtre Marseillais. Le sieur Estelle vint me le dire et me demanda mon sentiment sur ce qu'il y avait à faire pour la conservation de ce commerce. Je lui répondis que le Dey m'avait défendu de m'en mêler, mais que s'il m'en parlait le premier, je verrais ce que j'aurais à lui répondre. Je fus bien aise de trouver cette occasion de mortifier le sieur Estelle pour les embarras qu'il m'avait causés depuis mon arrivée. La mort d'Arnaud faisait croire que la querelle entre les associés était finie ; mais on se trompait.
Le sieur Estelle était allé porter cette nouvelle à Baba Hassan, parce que le Bey était absent : celui-ci lui dit qu'il fallait faire venir à Alger, l'aîné des enfants du défunt et qu'on l'investirait à la place de son père ou qu'on l'y mettrait lui-même. Estelle répondit qu'ils n'avaient pas assez de bien l'un et l'autre, ni assez d'expérience pour se charger de ce fardeau.
Le Trucheman qui avait accompagné le sieur Estelle, vint me rendre compte de ce qui s'était passé à cette audience. Je le renvoyai représenter au Dey que de la Font était connu pour un honnête homme dans toute la France, que j'étais bien fâché de voir cet Établissement à la veille d'être perdu par les impressions malignes que ses ennemis avaient données de lui ; que s'il était une fois abandonné, il n'y aurait plus personne, en France, qui osât entreprendre ce commerce et qu'il y avait lieu de le donner au sieur de La Font, après les dépenses que lui et sa Compagnie y avaient faites. Le Dey m'envoya prier de venir au Divan et me demanda ce que je croyais qu'il fallait faire du Bastion, puisque Arnaud était mort. Je lui répondis qu'il était le maître du Bastion, comme il me l'avait dit plusieurs fois et qu'il en pouvait faire tout ce qu'il voudrait. Il me demanda si je ne connaissais pas quelqu'un à Marseille qui put entreprendre ce commerce. Je lui dis qu'il n'y avait point de particulier assez riche pour cela et que personne n'y songerait dès que la Compagnie l'aurait abandonné,
" Le Dey répliqua qu'à défaut des Français, il y avait assez de gens Gênes qui s'empresseraient de faire ce commerce et qu'il était résolu de le leur donner, Je répondis à cela que ce commerce était depuis très longtemps entre les mains des Français, que c'étaient eux qui l'avaient établi, qu'ils avaient fait des dépenses immenses pour mettre les forts du Bastion et de La Calle en l'état où ils étaient ; qu'il n'avait été rétabli qu'en considération d'une paix dont il semble être le lien et que j'aurais peine à croire qu'il pensât à établir dans ces Postes des gens qui n'ont jamais été amis de la République.
Le bonhomme, après avoir rêvé quelque temps, me dit qu'il était de justice de le laisser à la Compagnie française, mais qu'il ne pouvait se résoudre à y placer un homme qui avait attenté à sa vie, en promettant vingt mille piastres au Bey de Constantine pour le faire mourir avec son gendre, et qu'il me le prouverait en me montrant les originaux des lettres que de La Font avait écrites à ce Bey.
Je lui répartis que dans le poste où Dieu l'avait élevé, il devait rendre la même justice aux Étrangers qu'il voulait que l'on fit à ses Sujets. Qu'il fallait entendre les parties avant de les condamner. Que le Roy n'aurait pas accordé sa protection au sieur de La Font, s'il l'avait cru capable d'une semblable lâcheté et de la perfidie dont il était accusé et qu'après que la Compagnie du sieur de La Font avait dépensé près de cent mille écus pour l'établissement de ce commerce, il y aurait de l'injustice à l'empêcher de revenir à son fonds et d'en retirer quelque profit.
J'ajoutai que selon la transaction qui avait été passée à Marseille, le sieur de La Font et ses associés s'étaient chargés de toutes les dettes et de toutes les dépenses, outre les douze mille écus dont ils étaient convenus pour le dédommagement de feu Arnaud, et qu'il exposerait sa famille à les perdre s'il faisait passer le Bastion et son commerce en d'autres mains qu'en celles de la Compagnie et qu'enfin les redevances qu'Alger en retirait étaient assez considérables pour le faire penser sérieusement à la conservation de ce commerce.
Le Dey m'interrompit et me dit que quand le Bastion avait été abandonné, la Milice n'avait pas laissé d'être payée et qu'il lui paraissait que j'étais un bon ami du sieur de La Font. Je lui dis que les membres de cette compagnie étant Français et moi le Consul de la Nation, le devoir de ma charge m'obligeait de prendre soin de leurs intérêts que le Roy m'avait recommandés très expressément.
Le Dey me pressa encore de lui dire mon sentiment sur ce qu'il devait faire pour la satisfaction des deux parties et pour la sienne, Je le priai de considérer que le Bastion ne pouvait subsister qu'entre les mains de la Compagnie du sieur de La Font. Que, si on l'abandonnait, les enfants de feu Arnaud perdraient les douze mille écus de la transaction et seraient punis comme étant la cause de la perte de ce commerce et qu'on se pourvoirait contre eux pour les dommages et intérêts. Je lui dis ensuite que si le sieur de La Font avait pu lui parler la dernière fois qu'il était venu à Alger, il n'aurait pas eu de peine à se laver de cette fausse accusation, mais qu'il n'avait pas osé débarquer pour ne pas s'exposer aux premiers mouvements de Baba Hassan qui ne le menaçait de rien moins que de la mort.
Après que le Dey m'eût écouté avec beaucoup d'attention, il me dit ces paroles : " Eh bien, puisqu'il faut pardonner et rétablir les affaires, écrivez-lui de ma part qu'il vienne, que l'accusation soit vraie ou fausse, le passé est passé ; j'oublie tout cela et je vous en donne ma parole qu'il ne lui arrivera rien, ni en sa personne, ni en ses biens. Dépêchez incessamment la barque du patron Légier pour le faire venir et pour porter en France la lettre que j'écrirai au Roy sur les affaires présentes. "
Cela ayant été ainsi terminé, le Dey me retint encore pour me parler d'autres affaires qui n'étaient pas moins importantes. Après les avoir expédiées, il me chargea d'écrire à la Cour que quand les vaisseaux du Roy voudraient toucher à Alger, ils y seraient les bienvenus et qu'on ne leur refuserait rien de tout ce qu'ils pourraient avoir besoin ; mais que s'ils recevaient les esclaves qui se sauveraient chez eux à la nage ou autrement, on les ferait payer au Consul dès le lendemain de leur départ.
Le 23 septembre, Baba Hassan m'envoya chercher et me remit trois lettres pour le Roy. Elles étaient écrites en Turc, de la part du Pacha, du Dey et de la Milice, toutes trois de la même teneur. Il me dit avec sa grossièreté ordinaire que j'écrivisse selon leurs intentions et que j'en fisse venir la réponse au plus tôt. Il me déclara en même temps que si la réponse ne venait pas dans un temps raisonnable qui devait être court, vu le peu de distance qu'il y a de Marseille à Alger, je n'aurais qu'à rentrer en France.
J'eus une autre prise avec ce brutal sur ce qu'il ne voulait pas que son Secrétaire donnait la qualité de Padis?chali, qui veut dire Empereur au Roi. Il prétendait que leur conscience et leur loi ne leur permettaient pas de donner cette qualité aux Princes Chrétiens ; et je lui fis voir que le Grand Seigneur la donnait au Roi de France. A la fin, je l'emportai après une longue contestation et je ne voulais point recevoir les Lettres à moins qu'elles ne fussent dans des bourses de satin. Il fallut y venir et les trois Lettres furent mises dans les bourses de satin blanc avec les qualités convenables. En voici la teneur :
" Au plus glorieux et plus majestueux Prince de la croyance de Jésus, choisi entre les grands, magnifiques, honorés dans la Religion Chrétienne, arbitre et pacificateur des affaires qui naissent dans la communauté des peuples Nazaréens ; dépositaire de la grandeur, de l'éminence et de la douceur ; possesseur de la voie qui conduit à l'honneur et à la gloire, l'Empereur de, France, Louis. Dieu veuille le combler de prospérité et de bonheur et affermir ses pas dans les sentiers de la droiture, Après avoir donné le salut à celui qui a suivi le Conducteur. (Le Conducteur n'est autre que Mahomet, de sorte que le salut ne s'adresse qu'aux Musulmans.)
" Votre Majesté saura que votre serviteur, le Consul d'Arvieux, est heureusement arrivé en cette ville d'Alger, dans les premiers jours du mois de septembre de notre année 1085. Il est le bienvenu. Nous le recevons avec plaisir et à notre contentement. Nous le reconnaissons pour Consul. Tout ce qu'il fait nous est agréable, parce que tous ceux qui viennent de la part des Grands doivent être considérés comme la personne de ceux qui les envoient. Mais nous n'avons la paix qu'avec vous et non pas avec les autres Nations. Nous n'avons rien à voir sur vos navires, et nous ne consentons pas aussi qu'aucun de nous les trouble et les inquiète. Cependant vos vaisseaux reçoivent des Chrétiens étrangers dans leurs bords, qu'ils transportent de côté et d'autre ; il n'y a personne de nous qui soit content de cela. Si on trouve deux ou trois étrangers dans un vaisseau Français, on ne leur dira rien ; mais s'il y en a davantage nous prendrons nos ennemis sans toucher au chargement où nous ne prétendons rien.
" Nous vous avertissons aussi que vos Sujets naviguent avec les vaisseaux de Livourne, de Gênes, de Portugal, d'Espagne, de Hollande et de Malte ; si nous les trouvons dans les navires de nos ennemis, nous les prendrons, parce qu'ils se battent contre nos gens et en blessent et en tuent. Lorsque nous en trouverons en cet état, nous ne leur donnerons point de quartier et les ferons esclaves. Nous ne les considèrerons plus comme vos Sujets, d'autant que depuis vingt ou trente ans qu'ils ont passé dans ce pays-là, ils s'y sont mariés et habitués ; ils servent nos ennemis et font la course avec eux. Nous vous déclarons donc que nous-en prendrons tout autant que nous en trouverons de cette manière. Nous vous avons écrit deux ou trois Lettres sans recevoir de réponse.
" Ainsi, dès que cette Lettre sera arrivée eu votre présence, faites-nous savoir en diligence, par une autre Lettre de votre part, quelle est votre intention là-dessus, afin que nous prenions nos mesures et que nous sachions si vous désirez que nous soyons en paix. Le moyen de l'affermir est que vous fassiez défendre à vos Sujets de recevoir dans leurs bords plus de trois Chrétiens qui ne soient pas de nos amis, et que vos Sujets ne naviguent point dans les vaisseaux de nos ennemis, parce que ce procédé pourrait être cause, de quelque rupture qui serait, en ce cas, contre notre volonté.
" De votre part, quand vous prendrez quelques vaisseaux sur vos ennemis, comme ceux de Salé et de Tripoli, s'il se trouve quelqu'un qui se réclame d'Alger, nous le désavouerons et nous ne le reconnaîtrons point.
" Au surplus, si vos navires venant dans le port d'Alger pour avoir de l'eau, du biscuit et autres provisions dont ils auront besoin, les ayant reçues et étant sur le point de partir, reçoivent dans leurs bords les Esclaves des particuliers qui s'y réfugient avec des chaloupes ou à la nage et les emmènent avec eux, leurs patrons viennent ensuite nous faire enrager, c'est ce que nous ne pouvons souffrir en aucune manière, et pour ce sujet aussi défendez-leur qu'ils n'enlèvent aucun des Esclaves de cette ville quand ils y viendront. "Il y a aussi des Turcs qui se sauvent de Gênes, de Livourne, d'Espagne et d'autres Pays où ils étaient captifs et s'en vont clans votre Royaume, à cause de la paix qui est entre nous. Nous ne consentons point aussi que vous les fassiez Esclaves et qu'on les mette aux galères. Nous finissons en vous souhaitant une longue vie, pleine de félicités. " Écrit dans les derniers jours de la lune de Djoumari, le second de l'année 1085 (23 septembre 1674). "
Lorsque Baba Hassan nie remit ces Lettres, il me recommanda d'écrire au sieur de La Font que s'il allait au Bastion avant de passer à Alger, il prit bien garde de ne commettre aucune violence contre qui que ce fut, s'il voulait s'établir dans un pays où il n'était point aimé.
J'obligeai le sieur Estelle d'écrire à de La Font, en conformité de ce que le Dey m'avait dit, et ayant fait un état de tout ce que le Bastion devait à Alger, qui se montait à douze mille piastres, j'envoyai le tout par la barque de Légier.
Le 27 septembre, Baba Hassan m'envoya dire qu'il prétendait que Légier allât en droiture à Marseille, sans toucher au Bastion ni en aucun lieu de la côte, afin que la réponse des Lettres arrivai plus tôt ; qu'il voulait l'avoir dans un mois, qu'autrement il nous déclarerait la guerre, étant, extrêmement fatigué de nos longueurs, et qu'il lui convenait de rompre une bonne fois avec nous et me renvoyer en France.
Estelle demeurait à Alger en qualité d'Agent du Bastion, avec deux mille piastres d'appointements ; mais il était caution de toutes les redevances et de toutes les dettes de la Compagnie. On l'accusa d'avoir dit au Dey que la barque de Légier avait un fond considérable qui appartenait aux associés d'Arnaud, et qu'il était à propos de le prendre à compte de ce que le Bastion devait à la République d'Alger. Quoique cela fût faux, cela flattait trop l'avidité du Dey et de son gendre pour le négliger. Il m'envoya chercher avec le patron Légier, à qui il ordonna de mettre à terre les fonds qu'il avait appartenant à la Compagnie du Bastion, et, sans lui donner le temps de répondre, il dit, et à moi aussi, qu'il ne voulait point de remontrances et qu'il fallait obéir sur-le-champ.
Je ne laissai pas de lui dire que la Compagnie du Bastion n'avait rien sur la barque de Légier, que si le Bastion devait quelque chose à Alger, c'était à Estelle à qui il fallait s'adresser, puisqu'il en était l'agent et la caution ; qu'on ne pouvait rien prétendre du sieur de La pont qu'après qu'il aurait été mis en possession da Bastion ; qu'il était inouï qu'on enlevât par force les biens d'un marchand pour payer les dettes d'un autre ; que cette violence se répandrait de tous côtés et empêcherait qu'on osât venir trafiquer à Alger ; que le patron Légier serait entièrement ruiné s'il ne rapportait les fonds qu'il avait empruntés pour employer en marchandises à Alger et à la côte, et, enfin, que le Roy ne manquerait pas de s'en formaliser.
Toutes mes raisons, qui auraient été bonnes pour tout autre que pour un barbare brutal, ne firent aucune impression sur Baba Hassan. Il envoya le Trucheman avec le Gardien du Port, visiter la barque et apporter au Divan tout l'argent qu'ils y trouveraient et se contenta de répondre à mes oppositions que, puisque la barque de Légier ne s'en allait que pour revenir, il voulait que l'argent demeurât à terre entre les mains de M. Le Vacher.
J'envoyai chercher le sieur Estelle, et, après lui avoir reproché qu'il était l'auteur de cette avanie, dont il ne put disconvenir, je lui fis mes protestations en forme, qu'il serait responsable en son propre et privé nom de tous les événements. Nous étions encore ensemble quand ou vint l'appeler de la part du Pacha. Il y alla et ne revint plus me retrouver.
Je sus quelques heures après, que le patron Légier était de retour de sa barque et qu'on avait apporté au Divan tout l'argent qui s'y était trouvé, consistant en neuf cents piastres, y compris les fonds particuliers des matelots. J'allai promptement au Divan y renouveler mes oppositions.
Baba Hassan voulut alors tourner les choses en raillerie, parce que Estelle lui avait dit que je l'avais menacé. Il me dit qu'on n'avait pas trouvé grand argent dans la barque de Légier et qu'il fallait nécessairement qu'il m'eût remis les trois mille piastres de la Compagnie du Bastion.
Le second jour d'octobre 1674, je menai le patron Légier au Divan pour prendre congé du Dey, selon la coutume d'Alger. Je trouvai qu'Estelle nous avait suscité de nouvelles brouilleries, En effet, Baba-Hassan dit au patron Légier qu'il l'envoyait en France pour porter ses Lettres et lui en rapporter la réponse dans un mois au plus tard, et que pour assurance de sa parole, il fallait qu'il laissât ses fonds entre les mains du trésorier du Divan.
J'eus là-dessus un démêlé terrible avec ce brutal, nous nous poussâmes à bout réciproquement et comme il voulait l'emporter absolument, je le quittai brusquement, en lui protestant que s'il s'obstinait à retenir les fonds de cette barque, le patron et la barque ne partiraient point du port d'Alger, que ce procédé mettrait la confusion dans la place de Marseille et qu'il n'en viendrait plus personne et que les fonds de cette barque étant arrêtés par les intrigues d'Estelle, on les lui ferait payer à Marseille avec les dédommagements, ou sur ses biens, ou sur les douze mille écus promis à feu Arnaud par la transaction, Cette dernière raison frappa vivement Baba-Hassan. Il donna congé au patron Légier, lui souhaita un bon voyage et le congédia. Il fut à son bord et en moins d'une heure il mit à la voile.
Baba-Hassan s'étant trouvé avec le Dey, ils voulurent entrer dans une autre matière. Ils me demandèrent si je n'avais jamais exercé des Consulats ou d'autres charges publiques. Je leur répondis que je n'avais jamais fait autre chose et que j'avais vu toutes les Échelles du Levant. Ils dirent alors que tous les pays que j'avais vus étaient bien différents d'Alger et qu'il y fallait vivre d'une manière toute autre. Ils ajoutèrent que c'était grand dommage que je fusse Chrétien, et qu'on ferait de moi un bon Gouverneur si j'étais assez heureux pour embrasser leur religion. Je reçus cela comme une raillerie et je leur répondis que la justice devant être égale partout, je ne m'apercevrais point de cette différence quand ils voudraient nous la rendre et qu'alors je trouverais les mêmes agréments à Alger que j'avais trouvé partout ailleurs. Qu'à l'égard du changeaient de religion, qu'outre le Baptême, qui est commun à tous les Chrétiens, j'avais encore une Croix et un caractère qui m'obligeaient à une plus étroite observance, et que je souhaitais de tout mon cœur d'avoir l'occasion de les leur faire connaître.
Le 5 octobre, Estelle employa l'autorité du Dey pour faire enlever trois cent cinquante piastres appartenant à un Espagnol, qui étaient en dépôt à la Chancellerie, a cause qu'un Majorquin devait pareille somme à feu Arnaud.
Je dis à Estelle que la Chancellerie était un lieu sacré où tout ce qu'on y déposait devait être en sûreté. Que s'il continuait à faire agir la violence des Turcs, je serais obligé de faire un procès-verbal contre lui.
Le 12 octobre, le Dey m'envoya chercher pour me dire que le terme des paiements du Bastions étant expiré, il voulait que je lui trouvasse de l'argent. Je lui répondis que j'étais Consul et que je n'étais ni agent, ni intéressé dans la Compagnie du Bastion. Je vis bien que c'était un tour du sieur Estelle qui cherchait entes sortes de moyens pour me brouiller avec les puissances d'Alger.
Je dis au Dey que je m'étonnais qu'il eût oublié qu'Estelle était l'agent et la caution de la Compagnie du Bastion, et que, par conséquent, c'était à lui qu'il devait adresser.
Le Dey me répliqua qu'il était informé, avant mon arrivée, que je soutiendrais les intérêts de la Compagnie qui me donnait trois mille piastres par an, que l'exercice du Consulat n'était qu'un prétexte, et qu'ayant la connaissance des langues orientales, je n'étais pas obligé de m'en rapporter aux Truchemans. Qu'il savait que j'avais apporté dix mille écus du Bastion, et qu'il voulait que je lui trouvasse de l'argent, sauf à moi à m'en faire rembourser par de La Font ou par les héritiers d'Arnaud.
Je lui dis qu'Estelle l'avait instruit très mal contre la vérité et seulement pour me brouiller avec lui. Qu'il était vrai que je m'étais mêlé des différends qui étaient, entre Arnaud et ses associés, terminés par la transaction sans laquelle le Bastion aurait été abandonné. Que ceux qui avaient visité mes hardes par on ordre et contre les droits et les privilèges de tout temps des Consuls, n'avaient trouvé qu'un sac de cinq cents piastres pour ma dépense personnelle.
Le Dey me congédia après ces paroles, en disant qu'il aviserait à ce qu'il aurait à faire. Que les soldats ne connaissant que Dieu et leurs intérêts, n'entendaient pas raillerie sur l'argent qui est destiné à leur paye et qu'ils auraient bien le moyen de m'en faire trouver ou de me renvoyer en France, Ce dernier compliment, qui était la conclusion Ordinaire de toutes mes audiences, ne m'effraya pas beaucoup.
Le 14 octobre, le sieur Arnaud, fils aîné du défunt, arriva à Alger. Il fut voir le Dey qui lui promit de lui tenir lieu de père. Il me vint voir ensuite, accompagné du sieur Estelle, et après son compliment, il m'assura que son père avait des sentiments de moi bien opposés à ceux que son parti avait, tant à Alger qu'à Marseille, et qu'i1 était mort avec le regret de n'avoir pu me remercier des soins que j'avais pris pour leur accommodement.
Le 28, le Consul Anglais, qui l'est aussi des Génois, eût une audience secrète du Dey, dans laquelle il lui proposa, de la part du sieur. Lomellini, Génois, Gouverneur de Tabarque, de ruiner le Bastion de France et de le lui abandonner, aux offres de lui payer toutes les sommes qu'il recevait des Français.
On avait fait précédemment la même proposition à Arnaud, avec des dédommagements avantageux.
Cela donna occasion au Dey de m'envoyer dire par le Trucheman que ses soldats voulaient être payés ; qu'il ne se souciait plus que de La Font vint ou non, puisqu'il tardait tant à venir, et qu'il était dans la résolution de donner le Bastion a des gens qui lui offraient de plus grands avantages.
Il y avait longtemps déjà que je voyais le Dey et la Milice dans la résolution d'accepter ce parti. Je chargeai le Trucheman de dire à son Maître de ma part qu'il n'avait pas encore lieu de s'impatienter depuis que nous avions écrit à de La Font ; que les Lettres de Tabarque marquaient qu'on le croyait déjà arrivé au Bastion avec un secours considérable ; que je savais les offres que les Génois lui faisaient, mais que j'étais bien assuré qu'il n'oserait les exécuter, parce que le Roy, qui protégeait la Compagnie, ne manquerait pas de lui faire sentir les effets de son ressentiment. Le Dey ne, répliqua rien et ne m'en parla plus.
On fit venir Estelle au Divan. Le Dey lui dit qu'il y aurait trois termes échus à la fin de la lune courante et qu'il lui fallait trouver de l'argent pour la paye des soldats. Il lui répondit qu'il n'avait plus de crédit depuis la mort d'Arnaud, et, que tout ce qu'on pouvait faire était d'envoyer le jeune Arnaud au Bastion pour rapporter tout le corail et tout l'argent qu'il y trouverait. Cet expédiant ne plut point au Dey qui lui donna jusqu'à la fin de la lune pour le payer. D'ailleurs; le jeune Arnaud ne voulut point aller au Bastion, craignant d'y être malade, et que, pendant son absence, de La Font arrivât, et que son oncle Estelle ne gâtât toutes choses par ses vivacités.
Le 22, de La Font aborda à Bougie sur le vaisseau du capitaine Colin. Il m'écrivit par un exprès et me pria de voir le Dey et d'obtenir la confirmation de ce qu'il m'avait promis pour lui. Le messager alla d'abord chez Estelle qui prit la lettre qui m'était adressée, l'ouvrit, la lut et lui ordonna de me l'apporter sans enveloppe, et de me dire pour excuse que les Maures de la campagne la lui avaient prise et l'avaient ouverte, croyant qu'il y avait de l'argent dedans.
J'allai d'abord au Divan porter cette nouvelle au Dey et à son gendre qui la savaient déjà, parce qu'Estelle les en avait instruits et leur avait montré la lettre avant de me l'envoyer. Ils me dirent que la nouvelle que je leur donnais leur faisait bien plaisir, que de La Font pouvait débarquer sur l'assurance qu'ils m'avaient donnée et qu'ils me confirmaient encore, et que quand il ne voudrait pas demeurer à Alger, il lui serait permis de se retirer, sous la bonne foi avec laquelle il était venu.
A l'arrivée de de La Font à Alger, j'allai prier le Dey de lui permettre de débarquer. Je pris ce temps pour lui dire les raisons qu'il avait eues de ne pas exécuter la transaction avant de partir de Marseille, la première desquelles était que les facultés du Bastion avaient été enlevées ; la seconde, que les créanciers d'Arnaud avaient fait saisir les douze mille écus, et la troisième, l'incertitude où était la Compagnie si elle soutiendrait ou abandonnerait le commerce du Bastion.
Le Dey et son gendre reçurent de La Font comme ils me l'avaient promis, et peu après ils m'envoyèrent dire de ne plus me mêler des affaires du Bastion, puisque de La Font était à Alger. On convint dans ces audiences que de La Font payerait toutes les redevances échues, trois mille piastres de présents pour la paye des soldats, deux mille piastres de gratification au Dey et à son gendre, mille piastres au Dey dues par Arnaud, etc. ; toutes ces sommes montaient à huit mille cinq cents piastres, et de La Font ayant donné sa parole pour ces paiements fut proclamé Capitaine du Bastion.
A ce moment, il était dû trois mille piastres à Estelle pour ses appointements, environ huit mille pour les redevances échues, vingt mille aux Maures du Bastion et de Bône et aux garnisons, sans les munitions et autres choses nécessaires à l'Établissement, ce qui montait à environ quarante mille piastres. De La Font n'en avait apporté que six mille qui furent bientôt employées, car le Dey lui fit payer trois mille piastres pour les redevances échues et deux mille pour le présent qu'il lui avait promis.
I
l ne restait, à de La Font que mille piastres et on le pressait de payer le restant. Ce fut le commencement de l'embarras où il se trouva. Pour y remédier, il envoya chercher un Juif nommé David Seyari, Censal de la Nation, pour lui en faire trouver. Toute la journée se passa à cela inutilement et de La Font commença à se désabuser de son prétendu crédit.
Estelle, qu'on allait consulter sur les emprunts, dépeignait la situation des affaires de de La Font, sa conduite et son honneur, d'une manière qui fit fermer tontes les bourses et cela obligea ses créanciers de le pousser encore plus vivement. Ce fut alors que de La Font commença d'éclater contre moi. Il vint me trouver en disant que, faute d'être sa caution dans ses emprunts, je serais cause que le commerce du Bastion périrait. Que comme Consul, j'étais obligé de lui faire trouver de l'argent, selon la promesse que j'avais faite à M. de Colbert de protéger et de soutenir les intérêts de cette Compagnie.
Après que j'eus réussi à réconcilier Estelle et de La Font, ils trouvèrent quelques sommes d'argent et, par ce moyen, ce dernier continua à payer ce qu'il avait promis.
Le 12, il alla prendre congé de Baba Hassan, accompagné d'Estelle et d'Arnaud fils, qui avait un emploi au Bastion. Baba Hassan recommanda à de La Font les intérêts d'Arnaud et la transaction, et à Arnaud fils de revenir sur ses pas, si on ne lui tenait pas exactement la parole qui lui était donnée tant pour l'emploi qu'il aurait au Bastion que pour la transaction…
A SUIVRE
ALGER, TYP. DE L'ASSOCIATION OUVRIÈRE V. AILLAUD ET Cie
Rue des Trois-Couleurs, 1877
Livre numérisé en mode texte par M. Alain Spenatto.
| |
LA DETTE
Par M. Nafaa Boumaiza
Envoyé par Mme Boumaiza (sa fille)
|
Je me souviens qu'enfant, Annaba était BONE
Un vieil homme m'attendait, debout et gentiment
Au coin de notre rue, le jour des classements
Une pièce à la main : c'était HENRI TABONE.
Il scrutait un à un les devoirs et les notes
Me remettait la pièce avec mon gros cahier
En disant, souriant à sa " NOUCHE Rocher "
Il est toujours premier cette " tête de linottes.
Ma vergogne d'enfant, d'émoi l'avait poussé
A me faire don d'un livre dont j'ai tourné les pages
J'ai gardé dans ma tête comme tableau de voyage
La cigogne portant en l'air TOM le POUCET.
Quarante ans ont passé mais les joies de l'enfance
Continuent de couler dans mes esprit et âme
Et d'un doux souvenir j'ai rallumé la flamme
Le souvenir d'un homme qui me faisait confiance.
A la place de CLAUDINE, à la place de PAULETTE
En voyant hommes et femmes, nombreux tel un essaim
Revenir voir leurs mânes le jour de la TOUSSAINT
Je suis venu te voir pour m'acquitter d'une dette.
Et les fleurs que j'apporte disent ma reconnaissance
A celui qui comptait des amis et des frères
Et la Mort le scella à l'Algérie entière
Même si l'origine le liait à la France.
C'est le plus beau bouquet qu'ANNABA dans ses murs
S'est vu offrir un jour au coeur du cimetière
Je voudrais que les gens qui m'ont en vu si fier
Disent que j'ai de ces fleurs garni ta sépulture.
Je voudrais que les âmes disent devant l'ETERNEL
Que l'on ne t'oublie point dans nos mémoires humaines
Qu'en parlant de ta REINE elles te jurent, sereines
Qu'elle est partie vers DIEU pour te rejoindre au CIEL.
Je viens pour te transmettre les pensées de Paulette
Celle qui fut de tes yeux la plus belle prunelle
Elle était tout pour toi celle aussi pour laquelle
Le Larousse aurait du créer le mot mérette.
Il m'a semblé entendre chanter un TE DEUM
Peut-être était-ce un ange à l'invisible bouche
Qui aurait pu chanter pour toi et pour ta " NOUCHE
Après l'AVE MARIA, DOMINUS VOBISCUM.
BOUMAIZA NAFAA.
- ANNABA -
|
|
|
OMELETTE A LA SOUBRESSADE
De M. Llorens Jeanjean 1934 (Alger Belcourt Les Halles)
Envoyé par Hugues
Et si vous preniez deux oeufs, que vous les cassiez, après vous les battez bien pendant cinq minutes,
Puis vous prenez une petite "poëlle", avec un petit fond d'huile d'olive, vous versez les oeufs, et les éparpillez bien,
Après vous allez à la fenêtre de la cuisine dans le petit garde'manger, vous prenez une belle soubressade piquante de chez Zeralta, vous savez le charcutier du marché de Belcourt, donc vous prenez la soubressade, vous enlevez la peau et la ficelle rouge, et vous l'éparpillez dans les oeufs,
Juste un petit instant, après, vous la versez dans une assiette, vous prenez un bon morceau de pain mahonnais, avec la mie bien dure, un bon verre de vin rosé bien frais, pour ceux et celles qui aiment le vin, ou la gargoulette avec de l'eau bien fraîche,
Vous vous mettez au balcon assis par terre, les jambes en tailleur, et en regardant en bas la mer bien bleue, avec les bateaux qui rentrent et qui sortent du port, vous vous tapez un repas royal, que même azrine il ne peut pas nous enlever,
Et quand il n'y a plus rien dans l'assiette, vous descendez en bas chez le Tunisien, et vous prenez un bon makrout plein de miel qui vous coule entre les doigts, et doucement, mais surtout bien doucement, les yeux fermés, vous le dégustez, et même qu'à la fin vous vous léchez les doigts tellement que c'est bon...
Et puis catastrophe, votre femme vient vous réveiller, et tout ce beau rêve y fait tchouffa et ça vous fout les boules pour toute la journée.
Quand est-ce qu'on arrêtera de penser à ce foutu pays ?????
Jamais oh non jamais, plutôt crever. Comme me dit souvent la Viviane, "si tu pouvais m'aimer le centième de ce que tu aimes ton Belcourt, je serais la plus heureuse des femmes",
Mais ça c'est pas possible ma fille...
Jeanjean... de Belcourt.
 |
|
DOCUMENT
Exceptionnel
envoyé par M. Georges Bailly
|
|
BUGEAUD
Que de souvenirs de ce si beau village français!
Que j'ai connu dés l'âge de 4 ans!
Quand on voit ce que c'est devenu!!!!
M. Georges Bailly
|
|
| Ah, ces Auvergnats
Envoyé Par Sauveur
| |
À la campagne on a une perception différente des choses
Un fermier Auvergnat, dans son C 15, s'en va chez un de ses voisins et frappe à la porte. Un garçon d'environ 9 ans ouvre la porte.
- « Est-ce que ton père est là ?»
- «Non Monsieur il est parti à saint Flour
- «Est-ce que ta mère est là ?»
- « Non Monsieur elle est avec mon père à la ville»
- « Et ton frère lui, est-il ici?»
- « Non Monsieur, il est allé au bois du Fayard avec le tracteur »
Le fermier reste planté là pendant quelques minutes maugréant entre ses dents.
- « Si c'est pour emprunter quelque chose Monsieur je sais où sont les outils ou je peux transmettre un message si ça peut vous aider»
- « Bon , dit le fermier, j'aurais vraiment voulu parler à ton père à propos du fait que ton grand frère a mis ma fille Suzie enceinte.»
Le garçon réfléchit un moment et dit « Il va falloir parler de ça avec mon père. Je sais qu'il prend 500€ pour le taureau et 50€ pour le bouc mais pour mon frère je ne sais pas le prix.»
|
|
|
|
LA RÉVOLTE DU 1er REGIMENT
ETRANGER DE PARACHUTISTES
« Mère, voici vos fils qui se sont tant battus
…
Mère, voici vos fils et leur immense armée,
Qu’ils ne soient pas jugés sur leur seule misère,
Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre
Qui les a tant perdus et qu’ils ont tant aimée. »
(Charles Péguy)
Extrait de la conférence de José CASTANO :
« Les Seigneurs de la Guerre »
… 12 Novembre 1960
Une nouvelle consternante parvient dans les unités parachutistes. Dans les Aurès, les fells ont surpris un groupe de combat du 1er REP à sa descente d’hélicoptères, faisant 11 morts et 6 blessés graves.
15 Novembre 1960
Dans la chapelle de l’hôpital Maillot à Alger, eut lieu la cérémonie militaire et religieuse en l’honneur des légionnaires tombés le 12. Ils allaient maintenant reposer comme tant d’autres dans cette terre d’Algérie qu’ils avaient défendue jusqu’à l’ultime sacrifice et qui était la leur désormais.
Au cimetière de Zéralda –qui gardera à jamais, dans son « carré légionnaire » les dépouilles mortelles de ces soldats morts pour la France - l’aumônier de la 10ème Division Parachutiste, le Père Delarue, bien qu’habitué à conduire des légionnaires à leur dernière demeure, se sentait, devant tous ces cercueils, bouleversé. Ce qui le mettait en rage, lui, prêtre, c’était l’absurdité de cette mort si elle ne correspondait plus à un sacrifice exigé par la Nation. Onze cadavres inutiles et scandaleux… Onze cadavres de plus dans cette longue liste… Et sa détresse, sa lassitude étaient immenses, de cette guerre où des hommes valeureux payaient de ce qu’ils avaient de plus cher pour racheter l’incompétence, la veulerie, les fautes et les palinodies de leurs gouvernants.
Tous écoutaient, muets et bouleversés, les dernières prières douloureuses de l’aumônier. Des paroles simples lui venaient aux lèvres. Il disait :
«Vous étiez venus de tous les pays d’Europe où l’on aime encore la liberté pour donner la liberté à ce pays… La mort vous a frappés en pleine poitrine, en pleine face, comme des hommes, au moment où vous vous réjouissiez d’avoir enfin découvert un ennemi insaisissable jusque-là… »
Et, d’une voix forte, il ponctua en criant presque :
«Vous êtes tombés au moment où, s’il faut en croire les discours, nous ne savons plus, ici, pourquoi nous mourons ! »
Puis le clairon, gonflant ses joues et les veines de son cou, lança vers les airs cette courte sonnerie saccadée : la sonnerie aux morts.
« Notre Père, qui êtes aux Cieux… » commença le prêtre, de sa voix qui tremblait et qui n’avait pas son impassibilité habituelle. Et tandis que se continuait le Pater, chez ces grands enfants qui écoutaient, recueillis, se reflétait un immense chagrin au souvenir de leurs camarades de combat. Chez certains, les yeux devenaient troubles comme sous un voile et, à la gorge, quelque chose s’étranglait. Sur toutes ces têtes alignées, flottait pour la dernière fois, l’ombre de ceux qui étaient morts, parce que la France, une dernière fois, le leur avait demandé. Et quand le prêtre, après un arrêt, et la voix plus grave encore, prononça les derniers mots de l’Ave Maria, d’une simplicité sublime : « Sainte Marie mère de Dieu… priez pour nous, pauvres pécheurs… maintenant… et à l’heure de notre mort », tout à coup, sur les joues de ces hommes rudes que l’on qualifiait « d’inhumains », de brusques larmes coulèrent, qui jaillissaient rapides et pressées comme une pluie…
L’émotion avait atteint un degré douloureux. La foule pleurait en silence communiant dans la douleur avec « ses soldats », «ses légionnaires ». Puis le nouveau chef du 1er REP, le Colonel Dufour, s’avança à son tour pour dire adieu à ses hommes. Il énuméra les noms de ceux qui ne feraient plus le chemin, tant rêvé, du retour dans leur foyer. Ces noms qui, bientôt ne vivraient plus que dans le cœur des mères, émurent le silence, cognèrent aux poitrines, bâillonnèrent les gorges et mouillèrent de nouveau les yeux. Puis il termina par ces mots :
«Il n’est pas possible que votre sacrifice demeure vain. Il n’est pas possible que nos compatriotes de la Métropole n’entendent pas nos cris d’angoisse
Il salua ; les clairons sonnèrent : « Au drapeau ». Les détachements présentèrent les armes et défilèrent, les yeux tournés vers les tombes. Les visages graves, bronzés et maigres, recelaient toutes les tristesses cachées, toutes les tares et tous les deuils qui les avaient amenés là.
« Nous ne savons plus ici pourquoi nous mourrons… » Ces paroles du père Delarue allaient avoir un écho immédiat : il allait, sur le champ, être banni d’Algérie et exclu des unités parachutistes.
« Si quelqu’un veut savoir pourquoi nous sommes morts, dites-leur : « Parce que nos pères ont menti ! » s’était écrié Rudyard KIPLING, après que son fils fut tué à la bataille de LOOS en 1915.
Trois semaines plus tard, le Colonel Dufour fut relevé de son commandement pour avoir exprimé en public ses sentiments « Algérie française » et fut prié de quitter le sol algérien avant le 9 décembre 1960, date d’arrivée de De Gaulle à Oran. Ecarté de la Légion, affecté en Métropole, le Colonel Dufour choisit la clandestinité et rejoindra cinq mois plus tard, en Algérie, les rangs de l’OAS.
8 Janvier 1961
Un événement tout à fait extraordinaire venait de se dérouler au 1er REP. Pour la première fois depuis le début des guerres d’Indochine et d’Algérie, des officiers de cette prestigieuse unité refusaient de partir en opération. Ils se mettaient en grève !
Unanimement hostiles à la politique algérienne du général de Gaulle, ils n’acceptaient plus de voir mourir leurs légionnaires alors que l’indépendance de l’Algérie semblait inéluctable. A quoi pouvaient désormais rimer ces opérations incessantes et meurtrières à l’heure où le chef de l’état clamait qu’il voulait en finir à n’importe quel prix avec le « boulet algérien ». L’absurdité dépassait les bornes. Ils avaient donc décidé de faire la « grève de la mort ».
Un vent de panique souffla à tous les échelons de la hiérarchie. Quoi ! La « grève de la mort » ? Impensable pour des hommes qui étaient « soldats pour mourir »! (1)
Une pluie de sanctions s’abattit sur les révoltés qui furent mis aux arrêts et mutés immédiatement en Métropole. L’un d’eux, le Lieutenant Roger Degueldre fut affecté au 4ème Régiment Etranger d’Infanterie mais il refusa de rejoindre son nouveau corps. Le 25 janvier 1961, il entra dans la clandestinité. Les dés de son destin étaient jetés. Une légende naissait…
A Zéralda, fief du 1er REP, le cœur n’y était plus et les questions que posaient les cadres rescapés de la purge n’obtenaient aucune réponse de la hiérarchie : le drapeau du FLN va-t-il flotter sur Alger ? Après avoir été vaincu sur le terrain, le FLN y sortira-t-il vainqueur ? Que vont devenir les Européens ? Et les Musulmans ralliés au drapeau français, eux qui ont cru aux promesses de l’armée ? Après l’Indochine, l’Algérie… L’armée sera-t-elle donc éternellement vaincue, éternellement parjure ?
Et de mains en mains l’on se passait une lettre. C’était une missive vieille de 2000 ans. Le texte, rapporté par Suétone, était de Marcus Flavinius, centurion à la 2ème cohorte de la légion Augusta. Destiné à son cousin Tertullus, il avait été écrit en Numidie, ainsi que s’appelait l’Algérie à l’époque romaine : « Si nous devions laisser nos os blanchis en vain sur les pistes du désert, alors que l’on prenne garde à la colère des légions !»
La colère des légions ! Elle se concrétisera le 22 avril 1961 avec le soulèvement des plus belles unités de légion et de parachutistes… et se termina par la dissolution du 1er REP. (2) + (3)
José CASTANO 8 Janvier 1961
e-mail : joseph.castano0508@orange.fr
(1) - En janvier 1885, lors des préparatifs de l’attaque de Bac Ninh, au Tonkin, le général de Négrier s’était adressé aux légionnaires des 1er et 2ème Bataillon en ces termes : « Vous, légionnaires, vous êtes soldats pour mourir et je vous envoie où l’on meurt ! »
(2) - Avril 1961 - Il y a 50 ans, disparaissait, en Algérie, la plus prestigieuse unité de Légion étrangère… : LA FIN DU 1er REGIMENT ETRANGER DE PARACHUTISTES - Cliquez sur : Lire la suite
(3) - Cliquez sur : Les Régiments dissous
-o-o-o-o-o-o-o-
Concernant l’histoire du 22 avril 1961, il appartiendra aux historiens de l’écrire, un jour, avec honnêteté et clairvoyance. Avant toute chose, ils devront établir une liste des colonels et des généraux permissionnaires. Ils découvriront alors que ce « putsch » ne fut rien d’autre, en réalité, que l’épreuve de force entre une élite qui s’engagea, qui jeta tout dans l’aventure jusqu’aux soldes, jusqu’au prestige hérité du passé, jusqu’à la vie… et un troupeau qui éluda l’engagement et l’abandonna aux sergents, parce qu’il avait depuis longtemps choisi entre l’auge et le sacrifice à une idée.
La politique et l’histoire offrent à chaque instant le spectacle de retournements qui, quelques mois, quelques jours, quelques heures auparavant avaient encore paru incroyables. Il semble que le cœur des hommes et leurs intérêts rivalisent d’inconséquence et nourrissent le même goût pour l’imprévu et pour l’imprévisible.
La logique et la raison ne s’emparent de leur imagination que pour mettre un semblant d’apparence d’ordre et de nécessité dans le foisonnement de leurs scrupules, de leur indécision, de leurs regrets et de leur versatilité.
J.C
|
ARCHIVE
Copie d'un journal l'Aurore du 08/07/1962
Envoyé par M. Derrien
|
L'Assassinat de Roger Degueldre
Original de l'article de l'Aurore en date du 08/07/1962, retrouvé dans des papiers familiaux.
Eric DERRIEN ( ancêtres en Algérie de 1844 à 1962 )

| |
| Après la bataille
de KADDOUR ben NITRAM
racontée par un BONOIS inconnu
Envoyé Par Jacques
| |
Mon père, ce fant de loup, qu'on l'y dit : Daïdone,
Que mieur que lui, t'sais, y a pas, dans toute la Colonne,
Pour trapper dédans la mer - basta, quand elle est belle -
La gross' crâpe poileuse acq' les oursins fumelles,
Un soir qui s'avaient fait, comm' ça, après le turbin,
Un' bring' d'attaque, lui, Beurre, Fauvétt' et pis Tintin,
I' s' prom'naient, ensemble, en côté la Grenouillère,
En s' fumant un' sèch' mortell', - va saoir pourquoi faire,
Tôt d'un coup, zac ! y voient un' foule de mecs gamasses,
Ho ? Tous on s'approche pour voir ça qu' c'est ces rascasses.
Forcé, tout d'suit' on s'a vu, acqu' les camarades,
Que ceuss'là, y z'étaient en train de fair' barouffade,
Ma une barouffade en première, d'attaque,
Acque les poings, acque les pieds, acque les matraques.
Chacun y s'attrape un et laisse-le qu'il y met
Une chataîgn' sur la carabasse ou sur le nez.
Mon père, ce fant de loup, que mieur que personn' y sait
Comme y se donne le coup d' tête empoisonné,
I' s'approch' acq' Beurre et pis Fauvétt' et pis Tintin,
Pour saoir, si des fois, y faudrait pas un coup de main,
Ma ouala qu' les autes, à peine y voient c'renfort,
Y serchent disput' à euss' comm' si c'est euss' qui z'ont tort.
Oï, ma mer' ! L'oss' de tes biss encarnés où qui restent ?
Mon père, acq' les autes, tous, on tombe la veste,
Après, tchac ! d'ici ! tchac ! de là ! y marqu'nt à coups d'tampons,
Tchaff ! un coup de têt' à çuilà acq' sa face de mélon,
Allez ! Poum ! dans l'œil. Pim ! dans le naz. Toc ! dans la pantche.
Beurre, à chaque coup, zec, y s'en prend une tranche.
Fauvette, à chaque mec, il y range son potrait.
Tintin, Madon', qu'il est costaud, deux y s'en a choppé
Et frott' que te frott' comme si ça s'rait une meule.
Pendant qui s'ies tient, oualà à mon pér' quoi y gueule :
" Ho ! Un je m'le casse ! Ma d'I'aute quoi y faut faire ? "
" 0 Tintin ! Sors-z'y les oss de ses morts ! " y dit mon père !!
|
|
|
LES ANNALES ALGERIENNES
De E. Pellissier de Reynaud (octobre 1854)
Envoyé par Robert
|
|
LIVRE IX
Séparation de l'autorité civile de l'autorité militaire à Alger. - Rappel du général Berthezène. - M. le duc de Rovigo est nommé commandant du corps d'occupation d'Afrique. - M. Pichon est nommé intendant civil. - Renouvellement des régiments de l'armée. - Formation des chasseurs d'Afrique et des bataillons d'infanterie légère. - Travaux des routes et établissement des camps. - Contribution des laines. - Actes de l'administration de M. Pichon. - Abandon du nouveau système, et rappel de M. Pichon. - M. Genty de Bussy, intendant civil. - Etablissement des villages de Kouba et de Dely Ibrahim. - Actes de l'administration de M. Genty sous le duc de Rovigo.
Séparation de l'autorité civile de l'autorité militaire à Alger.
Rappel du général Berthezène.
Dès le mois de mai 1831, M. Casimir Périer, président du conseil des ministres, voulant se réserver une large part dans la direction des affaires d'Alger, avait fait prendre au Gouvernement la résolution d'y séparer l'autorité civile de l'autorité militaire, par la création d'un intendant civil, indépendant du général en chef. M. le général Berthezène fut instruit de ce projet par une lettre du ministre de la guerre, dans les premiers jours du mois de juin, époque où il n'était pas encore question de son rappel; niais l'ordonnance qui le mit à exécution ne fut signée que le 1er décembre; elle donnait à l'intendant civil la direction de tous les services civils, financiers et judiciaires. Cet intendant était placé sous les ordres immédiats du président du conseil des ministres, et respectivement sous ceux des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, des finances, de la justice, du commerce et des cultes. Cette combinaison était vicieuse, car elle détruisait l'unité d'impulsion dans un pays qui, plus que tout autre, doit être considéré dans son ensemble, et où les détails de l'administration ont besoin d'être coordonnés vers un but commun. En France, où cette coordination est établie de longue main, et où des règles fixes l'indiquent aux intelligences les plus vulgaires, on conçoit que les préfets puissent, sans inconvénient, correspondre avec tous les ministres : mais il ne pouvait en être de même à Alger, qui, sous le rapport administratif, était un pays de nouvelle création. Il paraît que M. Casimir Périer avait d'abord senti la nécessité de l'unité d'impulsion, et que son premier projet avait été de centraliser lui-même tout le travail relatif à Alger, mais qu'il y renonça pour ne point choquer le ministre de la guerre.
M. le duc de Rovigo est nommé commandant du corps d'occupation d'Afrique.
L'ordonnance du 1er décembre constitua un conseil d'administration, composé du général commandant en chef, président, de l'intendant civil, du commandant de la station navale, de l'intendant militaire, du directeur des domaines, et de l'inspecteur des finances, secrétaire du conseil. Une ordonnance du 5 décembre régla les fonctions du général commandant en chef. Il fut chargé, outre ses attributions militaires inhérentes à sa position, des mesures politiques et de la haute police.
M. Pichon est nommé intendant civil.
Le Gouvernement fit choix, pour l'application de ce nouveau système administratif, de M. le lieutenant général Savary, duc de Rovigo, dont les antécédents sont assez connus, et du conseiller d'Etat baron Pichon, qui avait exercé quelques emplois administratifs assez importants, et rempli des missions diplomatiques aux États-Unis d'Amérique, à Saint-Domingue et dans quelques États de l'Europe.
Renouvellement des régiments de l'armée
L'armée que le duc de Rovigo venait commander fut renouvelée en grande partie, et se trouva composée du 10ème léger, du 4ème de ligne, du 67ème de ligne, formé des volontaires parisiens, de la légion étrangère, des zouaves et des chasseurs d'Afrique. Les zouaves, qui étaient divisés en deux bataillons, furent réunis en un seul; les chasseurs d'Afrique formaient deux régiments de cavalerie à six escadrons. Les noyaux de ces escadrons étaient français, mais on mit à la suite de chacun d'eux un certain nombre d'indigènes, qui, pour le service actif, se réunissaient en escadron séparé. Les chasseurs algériens furent supprimés par suite de cette nouvelle organisation. Le 1er régiment de chasseurs d'Afrique se forma à Alger, et le 2éme à Oran, où se trouvaient le 66ème de ligne et une partie de la légion étrangère. Dans le cours de l'année 1852, une ordonnance du roi prescrivit la formation de deux bataillons d'infanterie légère d'Afrique, composés de tous les militaires qui, après avoir été condamnés à des peines non infamantes, rentraient dans les rangs de l'armée, par expiration ou par remise de la peine.
Le duc de Rovigo eut successivement pour commander ses brigades les maréchaux de camp Fodoas, Buchet, Brossart, Brô et Avisard; ce dernier prit le commandement de la place d'Alger au départ du général Danlion. Le lieutenant général d'Alton fut nommé inspecteur général permanent des troupes du corps d'occupation d'Afrique. Le général Trézel fut nommé chef d'état-major général ; il eut pour sous-chef le colonel Leroy-Duverger.
Formation des chasseurs d'Afrique et des bataillons d'infanterie légère.
Le nouveau général était arrivé à Alger avec la résolution bien arrêtée de ne laisser qu'une partie des troupes en ville, et de disséminer le reste sur les points principaux du Sahel et du Fhas. En conséquence, il fit choix de divers emplacements qu'il jugea propres à l'établissement de petits camps permanents, d'un bataillon chacun. Les troupes devaient s'y construire elles-mêmes des logements, au moyen de quelques faibles ressources qui leur seraient fournies par l'administration. On commença à travailler à ces camps dès le printemps; mais bientôt les maladies qui s'y déclarèrent firent connaître que les emplacements avaient été en général mal choisis, sous le rapport, de la salubrité. Après plusieurs tâtonnements, on s'arrêta aux camps de Kouba, Birkadem, Tixerain et Dely-Ibrahim. Les deux derniers furent construits à peu près en entier dans l'année 1832, parce que l'on y arriva du premier coup sur des emplacements salubres; les autres, où l'on ne parvint qu'après plusieurs essais, ne furent édifiés que dans l'année 1833, et en grande partie sous l'administration du général Voirol. Les zouaves, à qui le camp de Dely-Ibrahim avait été destiné, furent les seuls qui remplirent exactement leur tâche; partout ailleurs il fallut que le génie vînt au secours des troupes au moyen d'un crédit de 25,000 francs par camp. Cette somme, ajoutée aux fournitures faites par l'administration, et aux gratifications accordées aux travailleurs, éleva les dépenses de chaque camp à 50,000 francs environ.
Travaux des routes et établissement des camps.
M. le duc de Rovigo avait conçu le projet de construire un camp plus considérable que les autres, sur un point d'où il pût menacer en même temps Blida et Coléa; mais ce projet ne fut mis à exécution que sous le général Voirol, par la construction du camp de Douéra.
Les environs d'Alger étaient sillonnés de nombreux chemins pour les gens à pied et les bêtes de somme; mais il n'y avait pas à vrai dire de routes carrossables. Le général en chef s'occupa d'en créer. Les camps furent unis entre eux par une route, dite de ceinture, faite à la hâte et par simple écrêtement, pour assurer le plus tôt possible les communications les plus nécessaires. On établit ensuite des plans pour des routes plus régulières, qui devaient être construites d'après tous les préceptes de l'art. Celle d'Alger à Dely-Ibrahim fut commencée sous le duc de Rovigo, et poussée depuis le faubourg Babazoun jusqu'au-dessus du château de l'Empereur. C'est un travail aussi admirable par la beauté de la construction que par la promptitude de l'Exécution. Les troupes seules y furent employées. Nous reviendrons sur la construction des routes, lorsque nous parlerons de l'administration du général Voirol, qui s'en occupa avec un soin tout particulier.
Les travaux de la route du fort de l'Empereur, et ceux d'une esplanade construite en dehors de la porte Bab-el-Oued, amenèrent la destruction de deux cimetières musulmans. Il était impossible de les épargner, et l'on ne devait pas, par respect pour les morts, gêner la libre circulation des vivants; mais on aurait dû agir avec moins de brutalité qu'on ne le fit, et ne pas donner le scandale d'un peuple civilisé violant la religion des tombeaux. Il fallait procéder avec ordre et décence, et transporter les ossements dans un lieu convenable. Au lieu de cela, ces tristes débris furent dispersés au hasard. Dans les travaux de déblai, lorsque la ligne tracée impassiblement par l'ingénieur partageait une tombe, la pioche coupait en deux et la tombe et le squelette; la partie qui tombait allait servir de remblai à quelque autre point de la route, et celle qui restait demeurait exposée à tous les regards sur le revers du chemin. Ces sépulcres béants étaient comme autant de bouches accusatrices d'où les plaintes des morts semblaient sortir pour venir se joindre à celles des vivants, dont nous démolissions en même temps les demeures; ce qui a fait dire à un Algérien, avec autant d'éloquence que d'énergie, que les Français ne laissaient à ses compatriotes ni un lieu pour vivre, ni un lieu pour mourir.
Contribution des laines.
Le duc de Rovigo, qui avait beaucoup de sollicitude pour les soldats, s'était aperçu, à son arrivée, qu'ils n'avaient pas même de lits pour reposer leurs membres, souvent affaiblis par la fatigue et la maladie, et il chercha un moyen de procurer un matelas à chaque homme. Comme il n'y avait pas de crédit ouvert pour cette dépense, et qu'on lui persuada que les habitants d'Alger étaient possesseurs de quantités considérables de laine, il frappa cette ville d'une contribution de 5,400 quintaux de laine payable en nature, ou en argent sur le pied de 80 francs le quintal. C'était donc 452,000 francs à prélever sur une population de 20,000 indigènes, ce qui ne faisait qu'une moyenne de 21 fr. par tète : mais, comme de raison, cette contribution ne devait pas être payée par tête, mais bien au prorata des fortunes; il fut même décidé que les riches paieraient seuls. La municipalité, qui fut chargée de la répartition, la fit d'une manière très injuste et très partiale, de sorte que les rentrées furent lentes et difficiles, et qu'il fallut plusieurs fois employer la rigueur. Les versements en nature se réduisirent presque à rien, ce qui donna la preuve qu'il n'y avait pas à Alger autant de laine qu'on l'avait cru d'abord. Il fallut, pour s'en procurer au moyen du produit en argent de la contribution, passer un marché avec le sieur Lacroutz, négociant d'Alger, qui en fit venir de Tunis.
Cependant les Maures avaient fait entendre leurs plaintes à Paris, où elles furent d'autant mieux accueillies, que la mesure prise par le duc de Rovigo accusait l'imprévoyance du ministre de la guerre, qui aurait dû avoir pourvu depuis longtemps au couchage des troupes de l'armée d'Afrique, par les ressources de son budget. Le ministre, qui s'en aperçut seulement alors, passa un marché pour cet objet avec la compagnie Vallée, et prit une décision par laquelle la mesure du duc de Rovigo fut annulée comme inutile. Le duc refusa d'obéir à cet ordre, s'étayant d'une délibération du conseil d'administration, qui fut d'avis que revenir sur la contribution serait une marque de faiblesse susceptible de produire un très mauvais effet. Mais le ministre ayant réitéré ses ordres, il fallut bien s'y soumettre la contribution, qui avait été versée dans la caisse du domaine, fut remboursée aux contribuables. Le sieur Lacroulz s'arrangea avec la compagnie Vallée, et lui remit les objets de couchage qu'il avait déjà fait confectionner. Voilà comment se termina cette affaire, qui donna beaucoup d'embarras au duc de Rovigo, mais dans laquelle il n'eut en vue que d'améliorer la position du soldat.
Actes de l'administration de M. Pichon.
M. Pichon, qui n'arriva à Alger qu'un mois après le général en chef, trouva l'arrêté sur la contribution des laines tout formulé et signé par le duc de Rovigo. On lui proposa de le signer aussi. Il refusa, en disant que, puisqu'il avait été rendu avant son arrivée, le général en chef devait en prendre seul la responsabilité, mais que, du reste, il concourrait à son exécution : c'est en effet qu'il fit. Cependant, comme il était opposé à la mesure, sa coopération ne pouvait être franche. Les Maures s'en aperçurent, et ce fut pour eux un motif de plus de résister à l'arrêté. Lorsque l'ordre qui l'abrogeait arriva à Alger, M. Pichon fut le seul membre du conseil d'administration qui vota pour que cet ordre fût exécuté sans objection ; il exigea même que son avis motivé fût inséré dans le procès-verbal de la séance où cette affaire fut traitée. Tout cela indisposa le général en chef contre l'intendant civil, et fut la cause première de la mésintelligence qui exista continuellement entre ces deux fonctionnaires. Il ne pouvait pas, du reste, en être autrement : un système vicieux devait nécessairement porter ces fruits.
Quelques changements eurent lieu dans le personnel administratif sous le duc de Rovigo : M. Fougeroux revint à Alger avec lui comme inspecteur général des finances; M. Willaume, qui n'était qu'inspecteur, fut placé sous ses ordres. Au bout de quelque temps, ils furent remplacés l'un et l'autre par MM. De Maisonneuve et Blondel. M. Fougeroux avait pris une part très active à l'affaire des laines, et il parait que ce fut ce qui motiva son rappel. M. d'Escalonne, directeur des douanes, et M. Girardin, directeur des domaines, n'appartenaient pas, par leur position administrative, à ces deux administrations; on leur proposa d'y entrer, mais avec des grades inférieurs. Ils refusèrent, et furent remplacés, le premier dès la fin de 1851, par M. Verlingue, et le second en 1852, par M. d'Haumont. M. d'Escalonne fut envoyé par M. Pichon à Oran, pour remplacer provisoirement M. Barachin, sous-intendant civil de cette résidence.
M. Cadet de Vaux, commissaire du roi près de la municipalité d'Alger, étant mort dans le courant de l'année 1852, fut remplacé par M. Cotin, ancien notaire à Paris.
La courte administration de M. Pichon à Alger doit donner à tout homme impartial une idée assez favorable de ce fonctionnaire. Il s'y montra homme de bien et ennemi déclaré de l'injustice. Peut-être eut-il le tort de mettre un peu trop d'acrimonie dans la défense de ses opinions administratives; mais il faut avouer qu'il eut à lutter contre un système qu'un cœur bien placé ne pouvait combattre de sang froid : c'était celui de l'abus de la force pris pour base gouvernementale, et soutenu avec autant de déraison que d'entêtement par des hommes qui auraient été même incapables de l'appliquer.
M. Pichon nomma, le 5 février, un procureur du roi près la Cour de justice. Le 8 du même mois, il créa le Moniteur algérien, journal officiel, destiné en outre aux publications légales et judiciaires. Le 16 février, un arrêté, pris en commun par lui et le général en chef, régla que les recours à l'autorité supérieure, contre les décisions judiciaires, seraient portés au conseil d'administration. Le 29 février, l'intendant civil détermina la forme et l'instruction de ces recours. Le 28 mai, un arrêté régla la législation sur les hypothèques, dont il donna la conservation aux greffiers des tribunaux.
Le 16 février, tous les actes judiciaires furent soumis à la formalité de l'enregistrement. L'administration des domaines prit le titre d'administration des domaines et des droits réunis, le 17 mars ; il fut réglé que sa caisse recevrait les dépôts et consignations. Le travail de cette administration, ainsi que celui de l'administration des douanes, dut être centralisé à Alger pour tous les points de la Régence. Lorsque ces dispositions furent prises, Bône était depuis quelques jours rentrée sous notre domination.
Un arrêté du 20 avril organisa les services civils à Bône, en y instituant un sous-intendant civil, un commissaire de police et un juge royal, chargé de connaître de toutes contestations civiles entre chrétiens, et entre chrétiens, musulmans et israélites, sans appel jusqu'à concurrence de deux mille francs; au-delà de cette somme, l'appel dut être porté à la Cour de justice d'Alger. En affaires correctionnelles, le juge royal dut connaître de celles qui ne pouvaient amener qu'une condamnation à dix jours d'emprisonnement au plus, outre les amendes. Celles qui pouvaient donner lieu à de plus fortes peines durent être renvoyées devant le Tribunal correctionnel d'Alger. Dans les affaires criminelles, il fut réglé que le juge royal dresserait l'instruction et renverrait les prévenus devant la Cour de justice, pour être statué par elle ce qu'il appartiendrait. M. Pichon n'établit point de juge royal à Oran, quoique cette ville fût sous notre domination depuis plus longtemps que celle de Bône.
Les dispositions fiscales et de police relatives à la pèche du corail furent établies par un arrêté du 31 mars. La pêche fut divisée en deux saisons, comme dans les règlements de l'ancienne compagnie d'Afrique, et les anciennes prestations furent conservées, mais seulement pour les corailleurs étrangers.
Le service de la police sanitaire n'avait encore à Alger qu'une organisation provisoire. II était d'autant plus nécessaire de lui en donner une régulière et définitive, que ce n'était qu'en imprimant une bonne direction à ce service qu'on pouvait offrir aux ports de l'Europe assez de garanties, pour obtenir en échange quelque diminution de quarantaine sur les provenances de la Régence. L'arrêté du 25 avril fut rédigé dans ce sens, institua trois commissions sanitaires pour Alger, Bône et Oran, et mit en vigueur les principales dispositions de la loi du 3 mars 1822 et de l'ordonnance du 14 août de la même année.
Tels sont les principaux arrêtés de l'administration de M. Pichon ; les autres sont ou transitoires ou d'un intérêt secondaire.
Abandon du nouveau système, et rappel de M. Pichon.
Cependant la mésintelligence qui s'était manifestée, dès le principe, entre le général en chef et l'intendant, prenait chaque jour un caractère d'aigreur de plus en plus marqué. Les choses en vinrent enfin au point où le Gouvernement se vit dans la nécessité de rappeler l'un ou l'autre. Ce fut l'intendant civil qui succomba, et avec lui l'indépendance légale de l'intendance civile. Une ordonnance du 12 mai abrogea celle du 1er décembre 1831, et M. Pichon quitta Alger à la grande satisfaction du duc de Rovigo. Il fut remplacé par M. Genty de Bussy, que l'ordonnance de nomination mit sous les ordres du général en chef. Ainsi fut rétablie dans la colonie l'unité gouvernementale.
M. Genty de Bussy, intendant civil.
M. Genty de Bussy était sous-intendant militaire et maître des requêtes au conseil d'Etat. Il était encore à Alger lorsque la commission d'Afrique y fut envoyée, et nous ne pouvons rien faire de mieux, pour le peindre en peu de mots, que d'emprunter au rapport de cette commission les termes dont elle se servit pour caractériser son administration :
L'autorité civile est placée dans une mauvaise position : absence de haute direction, défaut d'intelligence de sa mission, activité peu féconde en résultats utiles, souvent imprudente et dommageable.
La commission ne méconnaît pas que les circonstances ont été souvent difficiles; l'autorité supérieure a " fait tout ce qui devait les aggraver. " (Séance du 51 octobre 1833.)
M. Genty était du reste un homme d'esprit et de savoir-faire, qui sut bientôt se rendre de fait à peu près indépendant du général en chef. M. le duc de Rovigo, qui n'avait pu supporter les prétentions légitimes de M. Pichon, se soumit sans peine à l'ascendant de son successeur, et toléra ses nombreuses usurpations. L'on vit bientôt le nom de M. Genty figurer dans les arrêtés à côté de celui du général en chef, et sur le pied de l'égalité; ce qui prouve que, si les positions font les hommes, il y a aussi des hommes qui savent eux-mêmes faire leur position; mais il serait à désirer qu'ils n'usassent jamais de cette faculté que pour le bien général, ce qui a rarement lieu.
C'est à l'administration de M. Genty que se rattache la construction des deux villages européens de Kouba et de Dely-Ibrahim. Il convient d'entrer dans quelques détails à cet égard.
Dans le courant de l'année 1851, il était arrivé à Alger environ 500 émigrés allemands et suisses, qui étaient partis de chez eux avec l'intention de se rendre en Amérique, mais qui, parvenus au Havre, changèrent brusquement de résolution et se dirigèrent sur Alger. Ils y arrivèrent dans un état complet de dénuement pour la plupart ; comme ils ne trouvèrent pas à s'employer, puisqu'on ne faisait absolument rien dans le pays, ils tombèrent à la charge de l'administration, qui fut obligée de leur faire des distributions de vivres et de les loger ; ou des tentes et dans les masures des environs d'Alger.
Malgré ces secours, une centaine d'entre eux moururent de misère on de nostalgie. Le duc de Rovigo, qui était autorisé par le ministre de la guerre à faire quelques essais de colonisation, voulut distribuer quelques terres à ceux qui restaient; il s'adressa à cet effet à M. Pichon, qui répondit que, le domaine ne possédant rien dans les environs d'Alger, il était impossible d'y placer les nouveaux colons, ainsi que le désirait le général en chef. Celui-ci, qui tenait beaucoup à l'exécution de son projet, insista, et dit que l'on pouvait toujours placer les colons sur les terres abandonnées, sauf aux propriétaires, s'ils se présentaient, à faire valoir leurs droits, que l'on pourrait réduire à une redevance annuelle, ou quelque chose de semblable. Cette manière de procéder, par expropriation préalable, ne devait pas être approuvée par un administrateur qui avait des idées méthodiques et régulières, et qui certainement ne pouvait comprendre qu'il y eût le moindre avantage à déposséder des Maures au profit de quelques Européens; il est vrai que ces Maures avaient abandonné la culture de leurs terres, et que l'intérêt général exigeait que le sol ne restât pas improductif; mais nous connaissons déjà les causes qui avaient fait suspendre les travaux agricoles dans la banlieue d'Alger; nous savons que ce fâcheux état de choses était le résultat inévitable des dégâts commis par les troupes, et des mesures spoliatrices et violentes qui avaient remis en question les droits les mieux établis, toutes circonstances qu'il ne tenait qu'à l'autorité supérieure de faire cesser par un retour franc et loyal aux principes de la justice universelle et aux bases de la capitulation. Cette manière de rétablir la culture dans la banlieue d'Alger aurait certainement été beaucoup plus efficace que l'exécution du projet de colonisation du duc de Rovigo. Quant aux colons allemands, c'était un fardeau qu'il fallait supporter encore quelque temps; et dans peu de mois d'un régime qui aurait ramené dans le Fhas la culture et la sécurité, ils auraient trouvé eux-mêmes à s'employer utilement, sans déposséder personne; mais on voulait faire de l'effet, et annoncer pompeusement dans les journaux qu'on était parvenu à établir quelques centaines d'étrangers sur un sol d'où notre détestable administration avait éloigné les cultivateurs indigènes. Tout fut sacrifié à cette malencontreuse préoccupation, à laquelle M. Pichon, après une assez longue résistance, fut obligé de céder. C'est sous lui que furent choisies les deux localités de Kouba et de Dely-Ibrahim pour l'établissement de deux villages européens, qui furent construits sous son successeur. Les dépenses de ces constructions furent prises sur un crédit de 200,000 francs, ouvert à l'intendant civil par le ministère de l'intérieur, pour des essais de colonisation. M. Prus, nommé récemment ingénieur des ponts et chaussées à Alger, fut chargé de l'exécution des travaux. On débattit dans le conseil la question de savoir si les villages seraient fortifiés; elle fut résolue affirmativement. Dès lors, ce fut au génie militaire à déterminer les emplacements dans les localités désignées par l'administration, ce qui explique le mauvais choix qui fut fait sous le rapport agricole, surtout pour celui de Dely-Ibrahim, tout ayant été sacrifié à des considérations militaires d'un ordre assez peu relevé et sentant tout à fait l'école. Le projet de fortifier les villages fut depuis abandonné, et le vice de l'emplacement resta seul.
Le noyau des terres distribuées aux colons fut, à Dely-Ibrahim, la ferme de ce nom appartenant à la corporation des janissaires, et à Kouba un haouch appartenant à une mosquée. Ces deux immeubles étaient sous le séquestre ; on empiéta aussi sur des propriétés privées. De nombreuses réclamations s'élevèrent contre cette mesure, et des droits abandonnés par les indigènes, qui désespéraient de les faire valoir utilement, furent achetés à vil prix par des Européens qui s'en servirent pour tracasser l'administration. Des employés publics même se livrèrent à ce genre d'industrie, assez peu honorable.
Les colons établis à Kouba et à Dely-Ibrahim furent divisés en trois classes :
La première comprit ceux qui avaient assez de ressources pour construire eux-mêmes leurs maisons. On leur donna 10 hectares par tête.
La deuxième comprit les anciens militaires, à qui on donna 6 hectares par tête. Ces anciens militaires sortaient de l'armée française.
La troisième classe comprit tous ceux dont il fallut construire les maisons. On leur donna quatre hectares par tête.
Ce qu'il y eut de particulier dans toute cette affaire, c'est que l'on créa, pour la diriger, une agence de colonisation, dont les frais de personnel s'élevèrent à près de 20,000 fr. par an. C'était encore une idée du duc de Rovigo, qui avait quelques amis à placer. M. Pichon la combattit, mais ce fut en vain.
M. le duc de Rovigo aurait désiré dans le principe que toutes les contrées de l'Europe nous envoyassent l'excédant de leur population ; mais, quand il vit combien il avait eu de peine à colloquer 4 à 500 colons, ses idées se modifièrent, et un avis officiel prévint le public qu'aucun individu ne serait reçu à Alger comme colon, s'il n'y arrivait avec les moyens de pourvoir à sa subsistance pendant un an; mais Ies portes restèrent ouvertes aux brocanteurs, aux usuriers décorés du titre de capitalistes, aux avocats et aux filles de joie.
Ils seraient fatigant pour l'auteur, autant que pour le lecteur, de rapporter ici, même succinctement, tous les arrêtés rendus sous M. Genty de Bussy : la quantité en est effrayante. Cet administrateur, doué d'une grande facilité d'écrire et d'une prédilection toute particulière pour le travail du bureau, ne voyait l'Afrique que dans ses cartons. Quant à l'action réelle, il ne fallait pas en parler. Plusieurs de ses arrêtés moururent en naissant, et ne reçurent pas même un commencement d'exécution. Parmi ceux qu'il fit signer au duc de Rovigo, et qui ont fait législation, nous citerons les suivants :
Un arrêté du 4 novembre 1850 avait défendu l'exportation des grains et farines pour toute autre destination que la France ; il fut rapporté plus tard pour la province d'Oran. Le 10 juillet 1851, le duc de Rovigo signa un arrêté qui prohibait l'exportation pour quelque destination que ce fût.
Le 16 août, un arrêté organisa l'administration de la justice criminelle sur les bases ci-après : une Cour criminelle fut instituée pour juger les crimes commis par des Français et des étrangers. Cette Cour se composa des membres de la Cour de justice et du tribunal de police correctionnelle, réunis au nombre de sept membres. Il fut réglé que la procédure et l'instruction auraient lieu conformément aux règles établies par les lois françaises pour les tribunaux de police correctionnelle; que les condamnations ne pourraient être prononcées qu'à la majorité de cinq voix, et que les appels seraient portés devant le conseil d'administration jugeant au nombre d'au moins cinq membres.
Les indigènes continuèrent à être justiciables des conseils de guerre pour les crimes commis contre la personne et les propriétés des Européens. Le cadi maure continua à connaître des affaires criminelles et correctionnelles entre Musulmans, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1850, et les rabbins des mêmes affaires entre les Israélites; mais il fut réglé qu'il y aurait appel des jugements des uns et des autres, au criminel, devant le conseil d'administration, et au correctionnel, devant la Cour de justice. Les affaires criminelles entre Musulmans et Israélites durent être jugées par la Cour criminelle, et les affaires correctionnelles par le tribunal de police correctionnelle..
On voit que l'arrêté du 16 août apporta de grands changements au régime judiciaire établi par le général Clauzel. D'après l'arrêté du 22 octobre, les Français non militaires, accusés de crimes, devaient être envoyés en France pour le jugement. M. Clauzel n'avait pas cru pouvoir aller plus loin. Il est certain qu'une affaire de cette importance ne pouvait être réglée définitivement que par une loi, ou du moins par une ordonnance royale. M. Genty en jugea autrement, et pensa que le général en chef, réuni à lui, pouvait donner des juges spéciaux à des Français. Cette usurpation de pouvoir fut sanctionnée par le ministre de la guerre.
Le 17 août, une garde nationale fut instituée à Alger. Un arrêté du 21 septembre en fixa l'organisation. Les Français y furent seuls admis.
Etablissement des villages de Kouba et de Dely Ibrahim.
Le 21 septembre, M. Genty signa seul, mais avec l'approbation exprimée du duc de Rovigo, un arrêté qui prescrivait à tous les propriétaires des environs de Kouba et de Dely-Ibrahim de présenter leurs titres à jour et à heures fixes, savoir, le 24 septembre, à sept heures et demie du matin pour ceux de Dely-Ibrahim, et le lendemain, à la même heure, pour ceux de Kouba ; faute par eux de se présenter, il devait leur être fait application de l'article 713 du Code civil, ainsi conçu :
" Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat. "
Ce monstrueux arrêté prouve avec quelle légèreté M. Genty traitait les droits des indigènes. N'était-ce pas une amère dérision, une profanation condamnable, que de se servir d'un article isolé de nos lois, sans tenir compte de ceux qui conservent les droits des absents, de faire dépendre le droit de propriété de la présentation d'un titre à heure fixe, et enfin de mettre l'Etat en possession sans jugement, et par un simple acte administratif ?
Le 20 septembre, un arrêté institua un juge royal à Oran, comme il y en avait déjà un à Bône, et régla que les affaires criminelles qui, de ces deux villes, devaient être renvoyées devant la Cour de justice, en exécution de relui du 20 avril, le seraient devant la Cour criminelle.
Le 8 octobre, la garde nationale fut instituée à Bône et à Oran. Le même jour les appels au conseil d'administration des arrêts rendus par la Cour criminelle furent restreints aux cas de condamnation à la peine capitale. Les appels en affaires criminelles des jugements rendus par les juges indigènes durent être portés, non devant le conseil d'administration, comme I'avait réglé l'arrêté du 16 août , mais devant la Cour criminelle.
Le 21 janvier 1833, un arrêté mit en vigueur de nouvelles dispositions sur les appels devant le conseil d'administration des décisions judiciaires de la Cour de justice d'Alger, et abrogea tous ceux qui avaient été précédemment rendus sur cette matière.
M. Genty de Bussy fit en outre, avec des lambeaux de la législation administrative française, une foule d'arrêtés sur la profession de pharmacien, sur la police de la navigation, sur la propreté de la ville et l'entretien des maisons, sur la voirie, etc., etc. Tous ces actes écrits figuraient très honorablement dans le Moniteur algérien, mais nul ne s'embarrassait beaucoup de leur exécution. La ville était sale et mal tenue, les maisons tombaient en ruines, et les fontaines tarissaient par la négligence de l'administration, car écrire n'est pas administrer. M. Genty se fit principalement remarquer par la fiscalité de ses principes, je devrais plutôt dire de ses actes, car dans un ouvrage qu'il a publié sur Alger, il se montre partisan éclairé de l'affranchissement de l'industrie. Il établit, sous le duc de Rovigo, un nouveau tarif des droits d'exportation, taxa les constructions sur la voie publique; enfin un misérable carrossin ayant paru aux portes d'Alger, il fit sur-le-champ paraître un tarif des droits à percevoir sur les voitures publiques, ce qui suspendit tout aussitôt cette industrie, qui ne se releva que deux ans après.
Dans un pays nouveau, on devrait donner la plus grande liberté au commerce et à l'industrie, ne rien en exiger dans les commencements, afin de leur donner le temps de croître et de prospérer; c'est ce qu'on ne fit pas à Alger : le désir de présenter des recettes un peu plus enflées égara presque tous nos administrateurs, qui sacrifièrent sans nécessité l'avenir au présent. Il est étrange que des hommes qui, pour la plupart, n'étaient pas sans lumières, aient refusé d'appliquer un principe d'une vérité aussi vulgaire, et qu'ils ne pouvaient faire autrement que d'admettre, au moins en théorie, car il est au nombre des plus simples éléments de l'économie politique.
Le 1er mars, M. Genty institua, avec l'autorisation du duc de Rovigo, une commission chargée de la vérification de tous les titres de propriété. Trois jours après l'avertissement donné par la commission, les propriétaires, détenteurs ou tenanciers, devaient présenter leurs titres, et, faute par eux de les produire, il devait leur être fait application de cet article 713, pour lequel M. Genty parait avoir eu une grande prédilection. La commission chargée de ce travail colossal était composée de quatre membres dont un seul savait lire l'arabe, et dont deux seulement le parlaient. Il était matériellement impossible qu'elle remplit cette lourde tâche, les indigènes s'y seraient-ils prêtés, ce qui n'eut pas lieu : car je ne crois pas qu'il y ait eu plus d'une centaine de titres remis à la commission. Cette mesure, qui aurait été odieuse, si elle n'avait pas été ridicule, n'eut pas de suite. M. Genty de Bussy avait un grand désir de découvrir les biens domaniaux dont les titres avaient pour la plupart disparu par l'imprévoyance de l'administration de M. de Bourmont, et pour cela son idée favorite, dont l'arrêté du 1er mars ne fut qu'un pâle reflet, était de s'emparer de tous les immeubles de la Régence, sans distinction, sauf à ceux qui croiraient y avoir des droits à les faire valoir. M. Genty n'ayant pu faire adopter par le Gouvernement cette manière gigantesque d'opérer, il fallut avoir recours au moyen plus lent, mais plus juste, des recherches partielles qui, sous le général Voirol, conduisirent, comme nous le verrons, à de bons résultats.
Actes de l'administration de M. Genty sous le duc de Rovigo.
Deux actes de l'administration du duc de Rovigo qui doivent être cités avec éloge sont l'établissement de l'hôpital du Dey et celui de l'église catholique. L'hôpital fut placé dans une ancienne maison de campagne du pacha, fort vaste et fort belle, située dans un endroit très sain, à peu de distance de la ville, en dehors de la porte Bab-El-Oued. Elle avait été destinée aux généraux en chef, mais le duc de Rovigo en fit généreusement l'abandon. Quoique le local fût considérable, il fallut cependant y ajouter de nouvelles constructions.
L'église catholique fut établie dans une mosquée : cette mesure choqua beaucoup moins les Musulmans qu'on n'aurait pu le croire, car notre indifférence religieuse était ce qui les blessait le plus. Ils furent bien aises de voir que nous consentions enfin à prier Dieu. On s'empara aussi, sous le duc de Rovigo, de plusieurs autres mosquées pour divers services administratifs.
A SUIVRE
|
|
PERPETUITETERNITE
Envoyé par M. Vitus
|
Si la perpétuité dans la langue française
Prend à revers Littré et transforme en foutaise
Non seulement les mots mais les chiffres aussi
C’est que dette et peine se comptent à Bercy
Et qu’un politicien ne croyant pas un mot
De tout ce qu’il raconte et c’est là son crédo
Peut jurer le matin la bouche en cul de poule
Le contraire de ce qu’au soir venu la foule
Entendra l’âme en fête car le rôle de l’urne
Est bien de couper tout ce qui restait de burne
Au peuple souverain si fier de son égo
Du haut de son fumier debout sur ses ergots.
Une condamnation à la perpétuité
Signifie qu’au pays des dirigeants futés
On prend les Français pour des gens complaisants
Qui confondent perpète avec vingt deux ans.
La Ville éternelle dans la langue romaine
Se garde prudemment de susciter la haine
Car ce qui n’est pas né et ce qui ne meurt pas
Ne sait rien des limites que le Temps happa
La légende promet un berceau éternel
Sans fixer pour autant qu’elle sera fidèle
Mais si ce berceau n’est au total qu’un linceul
Chaque homme ne sera pas autrement que seul.
C’est pourquoi “éternel" dans la langue romaine
Ne saurait s’écrire autrement que “Amen”
Et que Blaise Pascal qui n’était pas un con
Par son pari se fit à juste titre un nom.
|
PHOTOS
Diverses de BÔNE
Envois de diverses personnes
|
PORT

PLACE D'ARMES

RUE NEGRIER

RUE BUGEAUD

MAIRIE
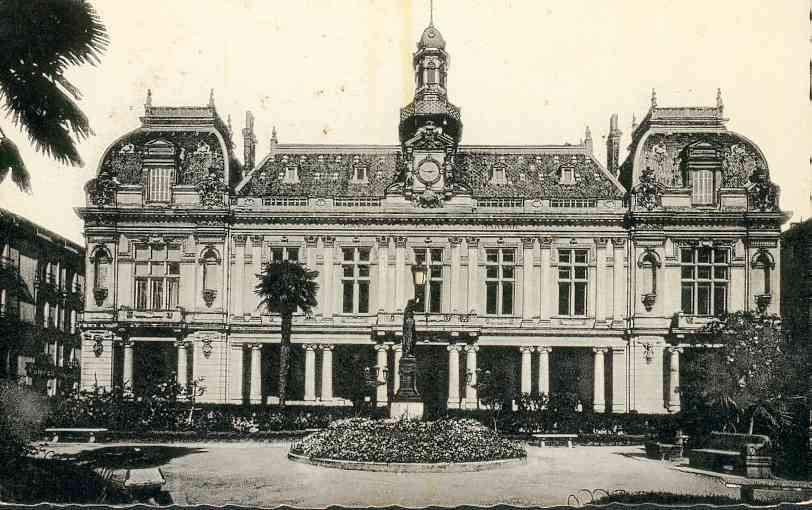
LYCEE MERCIER

POSTE DES SANTONS

CENTRE DE SANTE DES SANTONS

FORTIN

LES CIGONIAUX A CHAPUIS

CHATEAU ANGLAIS ST-CLOUD

CHAI A VIN SUR LE PORT

|
|
| HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DU COMMERCE FRANÇAIS
DANS L'AFRIQUE BARBARESQUE
(1560-1793) (N°13)
|
|
(Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Maroc)
PAR Paul MASSON (1903)
Professeur d'Histoire et de Géographie économique
à l'université D'Aix-Marseille.
TROISIÈME PARTIE
LA PAIX AVEC LES BARBARESQUES
ET SES PREMIERS RÉSULTATS (1690-1740)
CHAPITRE X (suite)
LES PREMIÈRES COMPAGNIES D'AFRIQUE (1706-41)
(1690-1706)
La Compagnie des Indes de Law était en train d'absorber, à ce moment, toutes les autres grandes entreprises du royaume ; elle offrit de succéder à la Compagnie d'Afrique ; un arrêt du 4 juin 1719 lui accorda les Concessions pour vingt-quatre ans(1). Elle s'engageait à employer 2.000.000 de livres à leur exploitation, c'est-à-dire plus que toutes les compagnies précédentes. Le produit annuel des Concessions était alors estimé en moyenne à 351.000 livres, les dépenses à 200.000, les bénéfices ressortaient donc à 151.000 livres par an.
Mais les actionnaires de l'ancienne compagnie d'Afrique faisaient peu de cas de ces bénéfices, car leur joie fut grande à la réception de l'arrêt du 4 juin. Ils se déclarèrent " pénétrés de reconnaissance pour le Conseil de marine qui les délivrait ainsi d'un écrasant fardeau. "
C'est alors qu'on vit, pour la dernière fois, soutenir les prétentions de la maison de Guise à la propriété des Concessions d'Afrique, de la façon la plus inattendue. Joseph-Louis de Lorraine, duc de Guise et de Joyeuse, avec lequel la Compagnie Arnaud avait conclu des baux de 29 ans, en 1666 et en 1668, était mort en 1671, laissant un fils unique, le duc d'Alençon, qui mourut lui-même en 1675. La grand-tante de celui-ci, mademoiselle de Guise, restée seule héritière des droits de la maison, mourut elle-même le 3 mars 1888, sans avoir jamais rien touché d'Arnaud, ni des compagnies qui lui succédèrent. Les droits des Guise semblaient tombés dans l'oubli quand, en 1701, les héritiers de mademoiselle de Guise s'avisèrent d'en poursuivre la revendication et entamèrent une procédure interminable, comme la liquidation des affaires de l'ancienne compagnie de Dusault, à laquelle elle était liée. Mais le régent lui-même, l'un des héritiers des Guise, était le principal des poursuivants ; en 1719, ce n'était plus aux anciens associés de Dusault que ceux-ci réclamaient les arrérages de la grosse dette contractée envers eux, mais à la nouvelle Compagnie des Indes de Law. Ils soutenaient cette thèse singulière que la Compagnie du cap Nègre, en se confondant avec la Compagnie du Bastion de Dusault, en 1693, avait contracté les s obligations que celle-ci ; or, d'après eux, cette compagnie du cap Nègre n'était autre que l'ancienne Compagnie des Indes, absorbée par la Compagnie de Law.
Le curieux mémoire, qui nous renseigne sur cette poursuite, résume ainsi la procédure engagée depuis 1701 jusqu'en 1718 :
Les héritiers de Mlle de Guise n'ont pu être informés de leurs droits qu'en 1701, à cause des grandes discussions qu'ils ont eu entre eux pour le partage de sa succession, auquel temps feu Mr le prince, Mme la princesse de Condé et Mme la duchesse de Brunswick, ayant appris le procès que les associés au commerce du Bastion avaient entre eux au conseil, demandèrent à S. M., par requête du 26 février 1701,d'être reçus parties intervenantes en l'instance et ayant égard à leur intervention les maintenir comme héritiers de la maison de Guise en la pleine propriété et... que les associés fussent condamnés à payer le prix des anciens baux... Ils ont été reçus parties intervenantes et ont produit leurs titres...
Les associés qui n'avaient point de moyens valables pour se dispenser de payer le prix tics baux, déclinèrent, sous le nom de Denis Dusault, la juridiction de MM. les Commissaires, en disant que l'arrêt de 1687 ne les avait commis que pour juger leurs différends entre eux. En vertu d'arrêt du 20 septembre 1701, Mgr le Régent, comme héritier du duc d'Orléans son père, conjointement avec feu Mr le Prince, ont fait assigner Dusault et autres associés... Par ordonnance de M. de Fourcy, du 30 janvier 1702, l'instance a été reprise... M. de Fourcy et tous les autres commissaires étant décédés, cette instance n'a pas été suivie. Les titres et pièces pour la propriété du Bastion ayant été de nouveau vus et examinés au conseil de Mgr le Régent, pour la succession de Guise, ont été trouvés incontestables. S. A. R. ordonna qu'il fût dressé des lettres patentes en son nom et de celui de S. A. R. Mme la princesse de Condé, qui ont été scellées au mois d'avril 1716 et registrées au Parlement par arrêt du 1er juin 1717...
Elles ordonnent que les arrêts des 21 et 28 juillet 1659 seront exécutés... en conséquence S. M. rétablit son A. R. et son A. SS. dans la possession et jouissance actuelle du Bastion...
Le 23 décembre 1717, requête donnée au Parlement pour faire assigner le sieur Dusault et autres associés représentant Arnault et les intéressés en la Compagnie du cap Nègre, pour payer le prix du bail jusqu'en 1693, et les intéressés en La Compagnie du cap Nègre pour rapporter leur jouissance depuis 1693 jusqu'à présent, sur le pied des anciens baux. Le 6 septembre 1718, arrêt par défaut qui condamne Dusault à payer le prix du bail.... Le 1er décembre 1718, opposition audit arrêt par Dusault. Voilà toute la procédure qui a été faite.
L'auteur du mémoire ajoutait : " Il n'y a pas prescription parce que, depuis 1675, où Mlle de Guise fut héritière, jusqu'au 27 février 1701 que les héritiers se sont pourvus, il n'y a que 26 ans(2). " il est probable que la fièvre de l'agiotage en 1719, puis la débâcle du système de Law, retardèrent la solution de l'affaire ; la Compagnie des Indes n'était plus capable de supporter de nouvelles charges. Dusault mourut peu après et ne pouvait plus être rendu responsable des anciennes dettes ; enfin, le régent allait bientôt disparaître. Les lointains héritiers des Guise semblent avoir abandonné leurs revendications dont il ne fut plus question.
La situation en Barbarie était bonne pour les débuts de la Compagnie des Indes. Dusault, chargé de sa dernière mission, avait repris les négociations de Duquesne Monnier et était prévenu à renouveler les anciens traités de paix, à Alger et à Tunis, en décembre 1719 et en février 1720. En 1724, le vicomte d'Andrezel, qui partait pour Constantinople comme ambassadeur, passa par Alger et par Tunis, y fut reçu avec les plus grands honneurs, et obtint satisfaction de quelques contraventions aux récents traités.
Il semblait donc que la Compagnie des Indes allait pouvoir exploiter paisiblement les Concessions. En réalité, il n'en fut rien ; elle éprouva les s difficultés pour la sortie des blés, son monopole ne fut pas respecté. Les Trapanais intriguaient, avec l'appui du consul anglais, pour obtenir la permission de pêcher le corail. " Il n'est sorte de vexations que cette compagnie n'ait eu à souffrir depuis qu'elle a été substituée à la Compagnie d'Afrique ", écrivait en 1725 le ministre Maurepas. Deux vaisseaux du roi, commandés par le chevalier de Vatan, furent envoyés à Tunis pour appuyer les réclamations de la Compagnie et demander, entre autres, la liberté du commerce des blés. " Le bey répondit qu'aucun traité ne l'obligeait à donner du blé à la place du cap Nègre, que les 8.000 piastres de redevances étaient payées par la Compagnie pour l'établissement et pour la traite de ses autres denrées et qu'enfin, si elle ne voulait pas continuer à payer ces 8.000 piastres, elle n'avait qu'à abandonner cet établissement. "
De Vatan conseillait de retirer l'agent de la Compagnie à Tunis et de suspendre le paiement des lismes, car le bey avait besoin d'argent et ni lui, ni la population, ne voulait la guerre avec la France. On n'en fit rien et les vexations continuèrent ; les beys tendaient en effet, de plus en plus, à se réserver les bénéfices du commerce. " Le bey, écrivait le consul à Maurepas, en 1730, s'occupe à ramasser le plus d'argent possible. Il accapare tous les grains à bas prix pour les revendre lui-même à un taux beaucoup plus élevé, au grand détriment de la Compagnie d'Afrique. "
En outre, la Tunisie fut troublée pendant cette période par la guerre civile, jusqu'en 1729. Aussi, n'y eut-il pas une année où l'on put faire au cap Nègre " une traite un peu passable " et le commerce " y languit d'une façon pitoyable. " Enfin, la Compagnie souffrit d'autres causes d'insuccès qu'elle énumérait dans un mémoire, rédigé en 1730 : gros frais de régie de la direction établie à Marseille ; éloignement de la direction centrale fixée à Paris ; infidélité ou négligence divers comptoirs qui favorisaient le commerce des interlopes(3). C'est ainsi que le sieur La Pérouze, directeur du cap Nègre, l'un de ses principaux agents, fut convaincu d'avoir trafiqué pour son propre compte et de s'être livré à de nombreuses malversations ; on le rappela, en l728, pour venir rendre compte de sa conduite(4).
Au lieu des bénéfices annoncés, la Compagnie des Indes perdait 100.000 livres par an dans ses comptoirs de Barbarie(5). Un édit de juin 1725 avait transformé en concession perpétuelle son bail temporaire ; elle ne garda cette concession que cinq ans. En 1730, elle supplia le roi de consentir à ce qu'il se défit de son privilège en faveur de quelque compagnie qui eût son siège à Marseille ; la preuve était faite que ce commerce ne pouvait être dirigé qu'à Marseille, et par des négociants au courant des affaires de Barbarie ; d'un autre côté, la jalousie des négociants de Marseille était une source grave de difficultés pour une compagnie formée en dehors d'eux. La Compagnie des Indes fut heureuse de s'entendre, en 1731, avec une compagnie marseillaise qui se forma pour la remplacer dans l'exploitation des Concessions.
On trouve des détails intéressants sur la situation des comptoirs de Barbarie, vers 1730, dans la correspondance de Taxil, agent de la Compagnie des Indes à Marseille ; dans celle de Soret, le nouveau directeur du cap Nègre, publiée par M. Albert Maire, et dans la relation du médecin Peyssonnel, qui visita les Concessions en 1724. Ils sont particulièrement importants pour le cap Nègre qui devait disparaître peu après, en 1741(6).
" L'anse ou port du cap Nègre, écrivait Taxil à l'abbé Raguet, finit à une plage ou rivage de sable ; il s'y présente d'abord une grande muraille où il y a des coulisses par où l'on fait passer le blé des magasins, pour l'embarquer avec plus de diligence, car, comme le port est dangereux, il n'y a point de pays où l'on charge plus promptement et où les bâtiments restent moins de temps mouillés. L'on y charge de 2 à 3.000 charges par jour. Les vaisseaux sont toujours expédiés en deux ou trois jours. Il y a de grands magasins capables de contenir 60.000 charges de blé. Ils soutiennent un grand terre-plein qui est la place du marché qu'on appelle bazar. Le marché est entouré de halles, où l'on reçoit les marchandises et les blés qu'on jette dans les magasins ; l'entrée de la place se trouve à côté du marché ; de là, l'on monte sur une jolie terrasse où il y a sept pièces de canon, vis-à-vis est la maison du directeur de la Compagnie et, derrière elle, diverses loges pour les employés ; plus haut est l'église et, sur le haut du cap, il y a une forteresse mal bâtie et mal fortifiée avec des pièces de canon(7). La Compagnie y entretient un directeur qui est gouverneur de la place, 4 ou 5 commis, un aumônier, un chirurgien et environ 80 personnes pour la garde et pour le service du comptoir...(8). "
Les fortifications du cap Nègre n'étaient pas bien sérieuses puisque le directeur, Soret, écrivait à Maurepas en 1735 : " Je n'ai rien omis pour pourvoir à notre sûreté, autant qu'il est possible dans une place revêtue de simples et basses murailles, sans fossés et dominée de toute part. "
Deux mémoires de 1730, de Taxil ou de Peyssonnel, donnent d'autres détails à retenir sur les colonies du cap Nègre et du Bastion de France.
" L'établissement du cap Nègre est très considérable par rapport aux bâtiments, aux fortifications et au grand nombre de magasins à mettre les blés. Les vaisseaux qu'on y envoie sont chargés en moins de 24 heures et les barques en huit ou dix heures. Les voyages de Marseille au cap Nègre et de retour audit Marseille, ou autres ports de Provence, se font ordinairement en 15, 20 ou 25 jours. Le principal commerce de cette colonie se fait en blé(9). On en peut tirer, année commune, 60,000 mesures de Maure qui rendent à Marseille 54,000 charges, du poids de 300 livres, sur le pied de une piastre et demie ou deux piastres au plus la mesure, faisant 120,000 piastres que nous évaluerons ici à 75 sols pièce, soit une somme de 326.000 livres de bénéfice annuel, déduction faite des frais, nolis et redevances... Il se fait au cap Nègre un commerce en orges, fèves, cuirs, cires, laines et quelquefois en huiles; le profit qu'on peut faire sur toutes ces marchandises est plus que suffisant pour payer les salaires et la nourriture des garnisaires et employés à la place. La Compagnie peut faire encore un commerce de marchandises, de France à Tunis, où l'on pourrait gagner de quoi payer les lismes qu'on est obligé de faire aux puissances du pays. "
Un des mémoires donne d'intéressants détails sur la pêche du corail au Bastion. Il y avait eu autrefois 40 bateaux qui péchaient jusqu'à 180 caisses pesant 150 livres, poids de table. Ce corail était surtout vendu aux Indes Orientales, mais beaucoup était acheté par les Génois et les Italiens, qui le faisaient passer au Levant et en Égypte sur nos bâtiments, après l'avoir travaillé.
" La caisse de coraux doit produire 1.500 livres, dont les 180 donneraient 270.000, dont il convient de déduire le tiers pour tous les frais; il resterait encore 180.000 livres de bénéfice, si ce commerce était fait dans toute son étendue. Les profits que l'on peut faire sur les blés sont encore plus considérables. Les autres commerces qu'on y fait en orges, fèves, cuirs, laines, cires et en denrées de France, rendent suffisamment pour payer les appointements des employés et les lismes et tributs qu'on est obligé de faire.
" Si la Compagnie des Indes ne retire pas tous ces avantages, il faut l'attribuer aux temps peu favorables pour le commerce et au peu d'attention qu'ont leurs commis de le faire valoir ; cela est si vrai qu'il n'y a pas, à présent, plus de 26 à 27 bateaux corailleurs à la Calle, parce que les directeurs donnent dans ce que les patrons leur disent que la pêche n'est pas assez abondante pour en entretenir davantage, cependant les anciennes compagnies ont eu jusqu'à 40 bateaux... Il est plutôt à présumer que les patrons recherchent en cela leur intérêt, pour avoir plus de profit et moins de peine.
" Les compagnies précédentes de ces colonies avaient grand soin d'entretenir les manufactures qui étaient établies à Marseille pour travailler aux coraux. Ces manufactures ont été portées jusqu'au nombre de 40 ; il n'en reste que deux aujourd'hui ; encore elles ne peuvent pas avoir de corail pour travailler, depuis que la Compagnie des Indes ne fait plus magasin de leurs pêches dans leur bureau de Marseille, mais bien à Gènes, ce qui ne peut lui tourner à compte, puisque, de tous les temps, cette ville a été l'entrepôt de cette marchandise, qui était demandée par les compagnies de Hollande, d'Angleterre et par celle des Indes, lorsqu'elle était régie par les négociants de Saint-Malo. Les Italiens y venaient également, au lieu qu'il faut envoyer à Gènes les chercher avec de grosses dépenses, ce qui achèvera de perdre ces deux seules manufactures qui restent.
" Les ouvriers qui travaillent au corail sont assez rares et surtout les bons, tant parce qu'ils sont obligés de faire six années d'apprentissage, que parce qu'il y a peu d'ouvrage. Il s'en fait de différents, les gros morceaux, qu'on appelle branches, sont au-dessus du poids de 6 onces, on les conserve dans leur entier ; on les polit et on les vend ainsi dans les pays étrangers. On laisse aussi dans leur entier tous les morceaux qui sont du poids de demi jusqu'à deux onces et qui sont à peu près de la longueur et grosseur du doigt ; on les lustre et les appelle dents de corail qui servent pour les petits enfants. On coupe les autres petits morceaux de corail en grains, comme des perles, depuis la grosseur d'un grain de poivre jusqu'à ceux qui pèsent une once pièce, les grains qui sont au-dessus sont très rares ; il s'en est cependant trouvé de deux onces et un de trois onces, ce dernier fut vendu, en 1709, 300 écus. Il se fabrique d'autres grains de corail, en forme d'olives, qu'on appelle olivettes. Comme il y en a de toute grosseur, on les assortit et on les enfile en collier; c'est la parure des femmes dans toute l'Afrique. Il y a sept façons à donner dans le travail de ces coraux avant qu'ils soient rendus dans leur perfection, mais le détail de ces ouvrages serait trop long pour être décrit dans ces mémoires. "
Le second mémoire évaluait les bénéfices réalisables au Bastion à 218.000 livres sur le corail, 120.000 sur le blé, 63.000 sur les cuirs, 12.000 sur la cire, 49.000 sur la laine, 90.000 sur le commerce d'Alger. 4.000 sur les rentes de la boutique à la Calle. En déduisant les lismes, tributs et frais, il devait rester à la Compagnie 382.365 livres pour les bénéfices du Bastion ; ajoutés à ceux du cap Nègre, évalués à326.000, ils donnaient un total de 708.365 livres. Ces bénéfices pouvaient être augmentés " par l'échange des piastres de haut poids pour des légères ou en rognant les piastres de haut poids pour les réduire à celui de Livourne. " Sur un fonds de 800.000 livres, ce bénéfice, de 10 % au moins, s élèverait à 80.000 livres. Ainsi le produit total annuel des colonies pouvait être de 788.365 livres.
Il est vrai que, pour arriver à ce résultat, Taxil indiquait des réformes à faire : " Pour retirer tout l'avantage de ce commerce, il est absolument nécessaire d'établir un bon ordre de régie qui prescrive à chaque employé, en France et en Barbarie, les fonctions qu'il doit faire, et le faire observer avec beaucoup de rigidité car, ça été par la mauvaise régie que sont provenues les pertes que les précédentes compagnies ont faites et leur désunion entre elles, causée parleur intérêt particulier au préjudice de celui de leur compagnie, et la brigue pour les emplois qui ont jamais été remplis que par des gens ignorants, sans expérience, ou gens qui n'ont regardé que leur intérêt propre. "
Il y avait longtemps que, dans tous les mémoires concernant les Concessions, on supputait de gros bénéfices à réaliser, mais jusqu'ici leur exploitation s'était toujours finalement soldée par des pertes. Aussi, les marchands de Marseille, qui consentirent à former la troisième compagnie d'Afrique, exigèrent des avantages qui n'avaient jamais été sollicités auparavant. Après s'être entendus avec la Compagnie des rudes, qui consentait en leur faveur à un prêt de 26.000 livres, pour être débarrassée des comptoirs de Barbarie, ils offrirent au roi, le 24 octobre 1730, de se charger pour 10 ans de l'exploitation de ceux-ci, moyennant un prêt de l'État de 300.000 livres, non productif d'intérêts, tandis qu'eux constitueraient un apport social de 300.000 livres. Il est vrai qu'ils s'engageaient à n'abandonner les Concessions que sils étaient en perte totale de leur apport. Deux arrêts, du 19 et du 21 novembre 1730, substituèrent la nouvelle société à la Compagnie des Indes pour jouir pendant 10 ans, à partir du 1er janvier 1731, des places élu cap Nègre, de la Calle et de ses dépendances(10).
La constitution des compagnies d'Afrique devenait donc de plus en plus difficile ; le pouvoir central était obligé d'intervenir. Mais, à mesure que les Marseillais se dégoûtaient des Concessions, celles-ci paraissaient plus utiles et même nécessaires au royaume, leur exploitation devenait une affaire d'État et le gouvernement ne pouvait admettre qu'il pût être question de les abandonner(11). En 1731, malgré l'appui financier du trésor royal, le capital de la troisième compagnie d'Afrique était inférieur à celui des précédentes. Elle avait à sa tête le Marseillais Jacques Auriol, et on trouvait parmi ses principaux associés les noms des Bourguet et des Baguet, ces protestants originaires du Languedoc, qui, vers 1700, avaient troublé l'échelle de Tunis par leurs intrigues et cherché à enlever le cap Nègre à la Compagnie Hély(12).
L'expérience des difficultés, rencontrées auprès des Algériens et des Tunisiens, faisait rechercher aux nouvelles compagnies des sûretés plus grandes. Par suite des privilèges nouveaux qu'elles obtenaient successivement, l'exploitation des Concessions, qui tentait de moins en moins les Marseillais, était faite pourtant dans des conditions de plus en plus avantageuses. C'est ainsi que, le 6 juillet 1731, le sieur Fénix, gouverneur de la Calle, signa avec le dey d'Alger une convention très importante. Celui-ci confirmait, suivant l'usage, le traité de 1694 mais, en outre, pour la première fois, le dey, divan et milice d'Alger reconnaissaient et ratifiaient le traité, signé en 1714 avec Assen, bey de Constantine, qui permettait à la Compagnie d'Afrique de faire la traite des blés et lui en concédait le monopole.
" Nous avons accepté, disaient-ils, un traité que le sieur Fénis nous a présenté, fait entre notre très cher fils le bey du côté du Levant, cacheté de sa tappe.... Après avoir vu, par le détail, les articles dudit traité… et, entre autres, celui par lequel la Compagnie s'est engagée de prendre de lui 200 caffis de blé, mesure de Bonne, à 10 piastres le caffis, ce qui a été accepté depuis longtemps par icelle et ses agents, à condition qu'on a permis et permet à ladite Compagnie et à ses agents d'en acheter au prix du marché public, comme le font les habitants de ladite ville et au même prix, sur lequel prix les marchands dudit Bastion les prendront et accepteront, sans qu'on puisse prendre, de part et d'autre, ni plus ni moins que comme il se vend au marché public, et qu'on ne pourra le vendre à autre nation qu'aux Français du Bastion, quelle qu'elle soit, que ce soit Anglais, Génois, Hollandais, ni Grecs, pas seulement un grain, soit de blé, orge ou fèves, ainsi qu'il est expliqué dans ledit traité…
Et, à cet effet aussi, ledit commandant du Bastion ou ses commis sont les seuls qui peuvent négocier à la ville et port de Bonne, au port de Stora et de Tarcul; lesquelles échelles seront prohibées par nous à toutes les autres nations que nous regardons à ce sujet comme rapineurs, les autres Français même qui ne sont pas intéressés au Bastion ; que si quelques autres que ceux du Bastion viennent négocier dans lesdits ports, ce sera contre notre volonté, à cause de rapinerie et, pour cela, il est permis, aux dits Français dudit Bastion, de les chasser desdits endroits et de les empêcher d'y négocier, sans que personne puisse les empêcher ni dire ; pourquoi cela(13) ? "
Par cette convention, non seulement les Puissances d'Alger autorisaient officiellement pour la première fois la traite des blés, mais elles affirmaient, avec une énergie toute particulière, la concession du monopole général du commerce accordé aux Français.
C'était grâce à l'appui du gouvernement que la Compagnie avait obtenu ces avantages. Duguay-Trouin, lieutenant-général des armées navales, était venu à Alger avec quatre navires, avait réglé les difficultés pendantes avec la régence, puis était passé à Tunis et à Tripoli. L'envoi d'escadres à Alger était un usage qui tendait à devenir régulier, particulièrement quand une nouvelle compagnie allait prendre possession des Concessions. " L'objet de S. M., disaient les instructions, est de donner aux Barbaresques l'opinion qu'ils doivent avoir de ses forces maritimes, de les obliger à respecter son pavillon et d'assurer le commerce et la navigation des bâtiments français dans la Méditerranée(14). "
Le chevalier de Caylus, commandant la frégate le Zéphyr, reçut une mission plus précise : il devait " aller chasser les bâtiments interlopes qui faisaient le commerce dans les concessions de la Compagnie d'Afrique ". Il avait ordre d'arrêter tous les bâtiments, français et étrangers, qu'il trouverait dans les mers des Concessions et d'envoyer dans les ports du royaume les prises qu'il ferait. " Quant à la prise des bâtiments nolisés par des Turcs, Maures ou Grecs, pour aller soi-disant chercher des blés pour leur propre compte et qui, au lieu de les porter à Tunis, leur destination apparente, les transportaient dans les pays étrangers, le chevalier de Caylus devait se concerter avec le sieur de Saint-Gervais, consul de Tunis. "
Caylus se rendit, en effet, aux Concessions et parut devant Tabarque. De son bord, il écrivit au gouverneur une lettre comminatoire : " Le roi, mon maître, qui accorde une protection particulière à la nouvelle Compagnie d'Afrique, m'a ordonné de vous avertir qu'il ne veut pas que vos coralines se mêlent, comme elles le font souvent, avec celles de la Compagnie, ni qu'elles pêchent dans les mers de ses Concessions. Je ne doute pas que vous ne vous rendiez à cet avertissement que vous devez regarder comme un ordre. "
En même temps, le dey d'Alger, qui montrait les meilleures dispositions, adressait des ordres analogues aux gens de Tabarque(15) ; il défendait aux aghas de Bougie et de Gigery de faire transporter leurs marchandises à Tabarque au lieu de les vendre à la Compagnie d'Afrique. " Le dey a tout promis touchant les traités avec la Compagnie d'Afrique, écrivait à Maurepas le consul d'Alger, Dieu veuille que.... les privilèges tant de fois jurés ne s'évanouissent pas à la première donative des Anglais. "
En effet, les intrigues des Anglais ne cessèrent d'inquiéter la Compagnie, dont le monopole ne fut jamais respecté, car les meilleures dispositions des Puissances et les promesses les plus solennelles ne tenaient pas devant les présents habilement distribués. Dès 1732, la Compagnie se plaignait que le dey eût accordé, à un Grec établi à Bône, la permission de charger de blé deux vaisseaux anglais(16).
Maurepas donnait l'ordre au consul de lui faire entendre que, s'il continuait à donner de pareilles permissions, la Compagnie ne lui paierait plus les lismes. Le dey protesta, il est vrai, de ses bonnes intentions ; il promit d'avoir égard aux plaintes de l'agent de la Compagnie.
Il écrivait à Maurepas, en janvier 1733, qu'il avait expédié des ordres aux caïds, pour interdire le commerce du blé à toute autre nation qu'à la Compagnie française ; il avait envoyé spécialement une galiote à Bône. Mais, trois mois après, les plaintes renouvelées par le consul étaient mal accueillies ; une escadre de quatre vaisseaux, commandée par le chevalier de Luynes, alla en vain appuyer ses réclamations, elle n'obtint aucun résultat.
A ce moment, la flotte espagnole du comte de Montemart était venue reprendre Oran en 1732 et, dans son armée, il y avait de nombreux officiers français. Les Anglais firent au dey des propositions séduisantes pour l'aider à chasser d'Oran les Espagnols, à condition que, pour prix de leurs services, ils recevraient les Concessions françaises ; le consul Lemaire eut fort à faire pour déjouer leurs intrigues appuyées par les autres consuls, jaloux de nos privilèges.
De leur côté, les Tunisiens n'avaient pas toujours respecté les traités ; le commerce du cap Nègre n'avait jamais pu être fait avec régularité. Le bey montrait les meilleures dispositions et promettait tout ce qu'on voulait, quand les vaisseaux du roi venaient à Tunis, mais les traités et les promesses continuaient de rester souvent lettre morte. Dès le mois de juillet 1731, le consul de Tunis se plaignait à Maurepas que le commerce ne fût pas libre ; Soret, le directeur du comptoir, écrivait au mois d'août que le bey, étant venu à Béja, " avait commandé un chaoux avec des spahis pour barrer les chemins du cap Nègre et empêcher les caravanes de grains de se rendre. " Soret était d'autant plus surpris du procédé qu'un mois auparavant, avant envoyé au bey son truchement, il avait obtenu un ordre écrit pour la liberté entière du négoce. Il se rendit lui-même au camp, près de Béja, pour remettre les présents usuels en pareille occasion, mais ne put rien obtenir. En 1732, deux vaisseaux du roi vinrent mouiller à la Goulette. Le bey reçut les officiers avec dignité et politesse ; ils lui demandèrent sa protection pour le commerce et pour la Compagnie d'Afrique et ses réponses furent conformes à tout ce qu'on pouvait désirer. Cependant, au mois d'octobre, Soret vit encore paraître autour de la place du cap Nègre une troupe de spahis, se disant envoyée par le bey pour arrêter les caravanes de blé. Il fallut leur donner une gratification pour les éloigner. En 1733, le bey commettait une nouvelle infraction aux traités, en faisant armer une coralline à Bizerte pour la pêche du corail ; le chevalier de Luynes parut à Tunis avec quatre vaisseaux du roi, pour se plaindre et " faire au bey toutes les instances convenables pour que la Compagnie fût maintenue dans la jouissance de ses privilèges. "
Deux raisons dictaient la conduite du bey : il aurait voulu lui-même faire le commerce et accaparer les blés, pour les revendre à gros bénéfices aux Français. Après avoir fermé la route aux caravanes, en 1731, il offrit à Soret de lui prendre 1.000 à 1.500 caffis de son blé, à 10 piastres le caffi, tandis que le prix courant à Tunis n'était que de six piastres. D'un autre côté, il jugeait plus politique de ne pas permettre ouvertement la traite, " afin que le peuple ne dit pas qu'il fournissait des vivres aux chrétiens ", et pour " satisfaire aussi par-là les gens de loi pour lesquels il affectait de grandes déférences. " Cette attitude ambiguë rendait les opérations toujours précaires. Soret avait raison d'écrire : " Notre médiocre commerce ressemble plutôt à une contrebande qu'à un négoce, qui est cependant autorisé par des traités authentiques et soutenu par des redevances considérables. "
De plus, les tracasseries du bey encourageaient les cheiks turbulents des tribus voisines du cap Nègre à imiter son exemple. Soret avait trouvé les Mogods en guerre ouverte avec son prédécesseur, La Pérouze, et le sang avait coulé des deux côtés. Il avait obtenu des ordres du bey pour châtier les principaux coupables et le caïd de Mateur, souvent délégué pour les affaires du cap Nègre, avait fait signer, en 1730, une paix en règle entre les chefs Mogods et les Français.
Cependant, en 1733, Sorel dut encore demander au bey la punition de quelques indigènes qui avaient entravé le transport des grains, puis il sollicita habilement leur grâce. Cet acte de bonne politique avait eu les meilleures conséquences. Ceux-là même auxquels le bey avait pardonné, sur les instances de Soret, furent les premiers à conduire et à escorter les étrangers qui allaient négocier au cap Nègre. Mais les faits du même genre ne pouvaient faire autrement que de se renouveler souvent. Soret caractérisait nettement la situation, en écrivant à Maurepas :
" Le moindre misérable Maure mécontent ou mal faisant, chose très ordinaire, peut impunément troubler notre négoce en se mettant sur les chemins avec quelques autres malheureux comme lui. Ils arrêteront les caravanes sans que nous puissions nous en plaindre, qu'ils aient rien à craindre, car ils savent que le bey ne nous accorde pas la liberté du commerce, malgré ses traités ; ainsi chacun se croit en droit de nous inquiéter. De là s'ensuivent, de toutes parts, des spahis en campagne qu'il faut gratifier pour les faire retirer, des nations en divorce qu'il faut nécessairement concilier, car rien ne viendrait. On n'y parvient qu'en payant les prétentions souvent respectives et tous les frais, enfin mille autres engagements où l'on est obligé de se jeter, dans la vue de négocier, ce qui n'arriverait pas, si l'on était autorisé par les Puissances. "
Soret faisait allusion dans cette lettre au " divorce des nations " ; les querelles et les jalousies des tribus voisines étaient, en effet, une autre cause de tracas. A la fin de 1732, Sorel était très occupé à faire cesser les différends entre les Amédous et les Nevezins (Nefzas) qui voulaient être les seuls à commercer avec le cap Nègre.
Outre cette insécurité du commerce, des prétentions particulières du bey inquiétaient de temps en temps la Compagnie. Est 1734, il imagina de lui réclamer 2000 piastres par an au lieu de 1000 caffis de blé qu'elle était obligée de lui acheter, depuis la convention du 3 juin 1711, mais il renonça à cette prétention. Soret fut moins heureux, en 1736, quand il lui fallut payer 5.909 piastres pour des redevances que le bey réclamait aux Nefzas.
Enfin, quand la traite des blés n'était pas entravée, les fraudes des indigènes qui mêlaient de l'orge au froment étaient une autre source d'ennuis ; il fallait négocier, ou baisser les prix, pour décider les tribus à fournir des grains moins mélangés, car il était impossible de faire disparaître complètement l'abus. " C'est un vice du pays, écrivait Sorel, et, depuis que le cap Nègre existe, cela a été ainsi. "
D'ailleurs, les blés étaient à si bon prix au cap Nègre que la Compagnie y trouvait soit compte. En les vendant à Marseille 20 sols par charge de moins que ceux de Bône, la Compagnie gagnait encore, d'après Soret, 3 liv. 10 sols par mesure.
Tels étaient les tracas continuels au milieu desquels se débattaient les directeurs des comptoirs des Concessions, et cependant il est certain que la Compagnie Auriol, au moins jusqu'en 1735, put exploiter plus paisiblement les Concessions que celles qui l'avaient précédée. Les incidents de toutes sortes étaient chose habituelle en Barbarie. On sen tirait avec de l'habileté, de la patience et des cadeaux.
Sort écrivait à Maurepas, dans l'une de ces occasions :
" Le résultat de tout ceci est qu'un désordre amènera un ordre, qu'il ne faut pas regarder ces troubles comme une interruption générale du commerce, mais seulement comme une cessation de commerce qui ne durera pas...
L'expérience nous apprend que les affaires en ce pays sont bientôt dérangées et bientôt rétablies, et qu'on y éprouve mille révolutions différentes. "
Il n'était pas moins inévitable que le monopole de la Compagnie d'Afrique fût souvent violé par les Tabarquins, pour la pêche du corail, par les Anglais ou autres étrangers et même par les Français(17), pour la traite des blés.
Les débuts de la Compagnie Auriol avaient été difficiles ; les intéressés écrivaient à Fleury, en décembre 1731, qu'ils avaient trouvé le commerce des Concessions totalement ruiné; de plus, ils avaient été obligés de tout réparer et de tout rétablir. Aussi le bilan de la première année accusait une perte de 74.128 livres. Pour remettre ses affaires en état, la Compagnie d'Afrique aurait voulu que la Compagnie des Indes s'engagent à lui prendre, chaque année, une quantité déterminée de corail.
" La pêche du corail, écrivait-elle au cardinal Fleury, le 3 juillet 1733, a toujours été regardée comme la base et le fondement du commerce des compagnies d'Afrique. Un seul calcul en fera sentir l'importance. Il se pêche tous les ans, dans les Concessions de la Compagnie, au moins 10.000 livres de corail, ce qui compose 70 caisses vendues 102,000 livres. La Compagnie paie le corail gros et menu, aux pécheurs, à raison de 3 livres 10 sols, de sorte que ces 10.000 livres ne lui coûtent que 35.000 livres et que, par conséquent, elle trouve tous les ans sur cet article environ 67.000 livres de bon. "
En conséquence, elle demandait au cardinal d'agir auprès de la Compagnie des Indes, pour la décider à lui acheter tous les ans 40 caisses de corail, ou bien de lui permettre de porter chaque année 80 caisses de corail aux Indes(18).
La situation de la Compagnie devint meilleure les années suivantes. D'après ses bilans, conservés aux archives des colonies, elle possédait un excédent d'actif de 238.167 livres au 31 décembre 1733, de 266.723 livres à la fin de 1734. Ses bénéfices étaient dus, en grande partie, au comptoir du cap Nègre qui avait causé des déboires à la Compagnie précédente et dont la compagnie Auriol aurait voulu d'abord être débarrassée. " Le commerce du cap Nègre va actuellement bien, écrivait le consul de Tunis à Maurepas, en octobre 1731, et deviendra, s'il continue, plus avantageux pour la Compagnie que celui de ses autres postes " ; il donnait déjà plus de 50.000 livres de bénéfices nets et les transactions eussent été plus actives, encore, si les fonds n'avaient pas manqué(19). Cette prospérité du cap Nègre était due en grande partie à l'habileté et à la vigilance de son directeur Soret, ancien officier de marine, protégé de Maurepas, qui reçut à diverses reprises les félicitations du ministre pour sa bonne conduite et pour ses succès(20).
Malheureusement cette heureuse situation ne dura pas. En 1733, la Tunisie fut une fois de plus désolée par la guerre civile, et le commerce devint moins facile avec le nouveau bey, amené à Tunis par les Algériens. " Si ce bey règne, écrivait le consul, ce pays est perdu ; c'est un véritable Néron qui abhorre les chrétiens. " En 1737, la Compagnie demandait à résilier son bail " en raison du préjudice porté à son commerce par la révolution survenue à Tunis ". En 1738, elle renouvelait plusieurs fois la même demande.
" La cause de nos malheurs, écrivait-elle le 9 juin 1738 à Maurepas, vient donc des troubles qui durent dans le royaume de Tunis, de ce qu'on ne sème presque plus les terres... de sorte que, quand la guerre pourrait finir avec la vie d'un des deux beys, le commerce et l'abondance ne sauraient s'établir de longtemps… Nous ne devons pas en attendre davantage dans le royaume d'Alger ; l'insatiable avidité du nouveau bey de Constantine et de ses officiers qui enlèvent aux habitants leurs denrées, leurs troupeaux et leurs autres effets, les a réduits à la dernière misère et a forcé la plupart à se retirer dans d'autres endroits(21). "
La Compagnie n'avait cessé de faire des pertes depuis 1735. Elles finirent par surpasser les bénéfices réalisés précédemment, puisque le bilan de 1738 montre que son capital de 300.000 livres était entamé de 17.963 livres(22). Le déficit était, il est vrai, peu important et il aurait pu être changé en gain sans la mauvaise administration de la Compagnie(23), si l'on en croit un mémoire dressé par ceux qui la remplacèrent.
" La Compagnie d'Auriol avait deux moyens de faire des profits considérables dans l'exploitation du privilège des Concessions ; l'un était d'en augmenter le commerce, l'autre de réduire le nombre de ses employés. Pour cet effet, il fut conseillé au sieur Auriol de faire passer dans les Concessions un des intéressés en sa compagnie..... pour former un plan de régie autre que celui qu'il y avait; les intéressés avaient des croupiers et aucun d'eux ne voulut se donner la peine d'aller aux Concessions par le peu d'intérêt qu'il avait dans ce commerce. Le sieur Sorel, directeur à cap Nègre, convient qu'il suffit de 70 hommes pour le commerce et pour la garde de cette place… La Compagnie a cependant toujours employé dans le cap Nègre 132 personnes; elle en a eu 138 à la Calle qui est mieux gardée que le cap Nègre, attendu la résidence qu'y font les pécheurs de corail. La compagnie donnait 2000 livres à son agent d'Alger et 500 à celui de Tunis ; elle les logeait et elle entretenait un drogman à celui d'Alger ; elle aurait pu charger de ses affaires dans ces deux villes le chancelier du consulat; il ne lui en aurait coûté que 1000 livres tous les ans au lieu qu'elle en dépensait M. Le commis qui elle entretenait à Bizerte, à qui elle payait 330 livres tous les ans, et le chancelier de la Calle qui en avait 800, étaient très inutiles à son service, elle aurait pu retrancher aussi beaucoup de bas employés…(24). "
En somme, l'exploitation de la Compagnie Auriol avait été beaucoup moins désavantageuse que celles des compagnies précédentes ; son échec relatif s'expliquait par des circonstances fortuites et des causes réparables. Néanmoins, elle n'avait pas réussi, elle ne songeait pas à renouveler son bail, en 1741, et les Marseillais n'étaient pas encouragés à risquer encore une fois leurs capitaux dans l'exploitation des Concessions de Barbarie.
Pourtant, s'ils avaient pu jeter un coup d'œil d'ensemble sur leur histoire, ils auraient pu concevoir de légitimés espérances. Sans doute, les échecs successifs de multiples compagnies, pendant plus d'un siècle et demi, semblaient prouver que le commerce n'y jouirait jamais de la sécurité nécessaire. Aux longues guerres contre les Barbaresques avaient succédé, en 1690, les guerres contre les Anglais, ou bien la Barbarie était désolée elle-même et le commerce interrompu par les guerres entre les Algériens et les Tunisiens. Quand on avait cru pouvoir profiter de la paix, les deys et les beys avaient troublé l'exploitation des comptoirs par leurs tracasseries : ou bien ils s'étaient faits marchands et avaient voulu forcer les compagnies à leur acheter leurs grains à des prix trop élevés, ou bien, tout en exigeant leurs redevances, ils avaient vendu à d'autres leurs céréales et leurs légumes.
Cependant la situation des compagnies en Barbarie était devenue progressivement meilleure ; depuis 1690 il n'y avait plus eu d'expulsion des Français, ni d'abandon des comptoirs. Des traités très favorables avaient été signés en 1690, en 1714, et 1731 ; ils n'étaient guère respectés, mais les rapports des compagnies avec les Barbaresques étaient néanmoins de mieux en mieux réglés ; en devenant plus anciennes ces conventions devaient acquérir peu à peu plus d'autorité auprès des Barbaresques, respectueux des vieux usages. Malgré ces progrès, les dernières compagnies avaient fait des pertes, mais elles avaient duré plus longtemps ; elles étaient parvenues au terme de leur concession et elles s'étaient retirées sans dettes. On commençait à se rendre bien compte des causes multiples qui avaient amené leur ruine ; un mémoire de 1730 résumait ainsi les principales de celles qu'on aurait pu éviter :
" La régie de ce commerce a été faite alternativement par diverses compagnies qui ont, pour la plupart, perdu leur fonds capital, les unes par les désordres arrivés en Barbarie, les autres par des dépenses excessives, d'autres pour n'avoir mis aucun fonds et n'avoir fait le commerce que des emprunts qu'ils faisaient sur la place avec des changes excessifs ; les dernières compagnies, pour n'avoir pas suivi ce même commerce avec toute l'attention nécessaire, et les unes et les autres pour avoir multiplié les redevances inconsidérément. " " Il est bien constaté, lit-on dans un autre mémoire de 1750, que le mauvais succès des compagnies précédentes a moins été l'effet des circonstances malheureuses des temps que de l'insuffisance de leur administration, quelque zèle qu'ils eussent d'ailleurs pour leur prospérité. L'inspecteur du commerce, Pignon, écrivait encore plus catégoriquement au ministre le 10 octobre 1757 : Toutes les compagnies qui précédemment ont exploité le commerce des Concessions, et le nombre en est grand, ont échoué par une mauvaise régie, la chose est bien constatée. "
L'expérience chèrement acquise par près d'un siècle et demi d'erreurs allait enfin profiter. On touchait, en 1741, au montent où les causes de prospérité allaient l'emporter sur les agents de ruine ; les établissements français allaient entrer dans une dernière période de leur histoire et la dernière des compagnies d'Afrique allait s'y maintenir plus de 50 ans, en donnant à leur commerce l'essor et La prospérité qu'on avait si longtemps attendus vainement.
(1) Propositions présentées au roi par les directeurs de la Compagnie des Indes, pour entrer en possession du commerce fait ci-devant par la Compagnie d'Afrique. 1 juin 1719. Arch. nat. marine B7. 276. En vertu d'un compte dressé le 6 mars 1720, elle remboursa 68.679 livres à l'ancienne compagnie d'Afrique pour ses effets mobiliers. Elle fut en outre condamnée, par arrêt du conseil du 31 janvier 1723, à lui payer 250.000 lires, pour les forts, armes et munitions, maisons et magasins. - Arrêt du 4 juin 1719. Arch. nat. marine. B7, 534 et 276.
(2) Arch. colon. Carton Compagnies de commerce n° 16 : " Mémoire pour son A. R. Mgr le duc d'Orléans, petit-fils de France, régent du royaume, leurs altesses SS. madame la princesse et madame la duchesse de Brunswik, héritiers de mademoiselle Marie de Lorraine, duchesse de Guise, et pour les légataires de lad, princesse, propriétaires du Bastion de France, cap Nègre... du droit exclusif d'y faire le commerce, seuls ou par telle compagnie qu'ils voudront choisir sous l'autorité du roi, et du droit de nommer un gouverneur et consul dudit Bastion à S. M. "
(3) Arch. colon. carton Compagnie du Bastion 1639-1731. - Dans une série de mémoires écrits en 1730 (V. ci-dessous), la gestion de la Compagnie des Indes fut très discutée : " De mauvais qu'il était sous les autres compagnies, lit-on dans l'un d'eux, le commerce devint pire sous la Compagnie des Indes parce que celle-ci était chargée d'une infinité de grandes opérations… elle regardait celui de Barbarie comme un fort petit objet… A peine en fut-elle chargée, qu'elle débuta par envoyer en Barbarie le sieur Dalmas, homme d'esprit à la vérité, mais point du tout homme de commerce. Il Avait été très longtemps écuyer d'une dame de distinction en Italie, où il avait connu M. Law qui se souvint de lui, en 1719, et le fit passer aux places d'Afrique en qualité d'inspecteur. " - Le capital engagé paraissait antre de 1.800.000 livres, mais il n'était en réalité que de 600.000 qui ne faisaient pas 300.000 de bonne monnaie… avec ce petit fonds, le commerce de Barbarie a pourtant gagné 400.000 livres pendant la régie, la preuve en est sans réplique… Si 100.000 piastres de fonds lui ont gagné 420.000 livres, 200.000 piastres lui auraient doublé ce bénéfice, de sorte quelle serait en profit au lieu de la perte où elle se trouve de 124.000 livres. La preuve de cette démonstration résulte de toutes les lettres de Barbarie qui marquent que les marchandises passent à l'étranger, faute de piastres pour les acheter des Maures. " Arch. colon. carton Compagnies de commerce. N° 12.
(4) Plantet, n° 490-92. - Il refusa d'obéir aux ordres du roi, se réfugia chez le consul de Hollande qui refusa de le livrer (n° 498), puis se retira à Gènes. V. diverses lettres. Arch. nat. marine. B7, 289 : Lettre du contrôleur général. Le Peletier des Forts, à l'abbé Raguet, du 6 juillet 1726, au sujet de l'irréligion et des violences de La Pérouze ; aucun aumônier ne peut rester au cap Nègre. M. de Garcin, prêtre de la Mission, qui, depuis 25 ans, envoie des prêtres de Marseille, ne trouve plus de prêtres qui y veuillent aller. - Aff. étrang. Tunis deux mémoires de 1729 sur La Pérouze. - V. une importante correspondance de La Pérouze avec les directeurs généraux de la Compagnie des Indes à Paris (1726-29). Dans un mémoire du 27 février 1728. Il se défend contre les accusations dont il est l'objet, dont l'auteur est Pignon, consul de Tunis, protégé du cardinal Fleury ; il accuse à son tour Pignon ; il annonce son passage en France pour se disculper. - Une curieuse lettre, du 14 janvier 1724, au directeur de la Calle, raconte longuement ses démêlés avec l'aumônier du cap Nègre. Arch. col. carton Compagnies de commerce, n° 12. La Pérouze fut remplacé par Soret dont la correspondance, pour 1729-1730, se trouve dans le même dossier. - CL la correspondance de Soret publiée par M. Albert Maire (lettres du 29 juin et du 18 août 1729. p. 209-212).
(5) Voir pour les opérations de la Compagnie les correspondances de Taxil, La Pérouze, Fort, directeur à la Calle (1728-31), Paget, agent à Cagliari. David, agent à Gènes pour l'entrepôt et la vente du corail, et plusieurs mémoires. Arch. col. Compagnies de commerce, n° 12. Arch. nat. marine, B7, 2726 et 289. (Plantet Tunis, II, p. 161, note 1, renvoie par erreur à B7, 303 et 291 où il n'y a que des documents relatifs à l'Espagne). - Tableau des dépenses du cap Nègre de 1707 à 1724 : pour 1707-12, 108.599 livres au total ; pour 1713-18, 101.734 ; pour 1719-24, 110.729. (B7, 289). - Mémoire de Taxil, 19 août 1726 La pêche du corail est allée dans le commencement autour de 300 qx, poids de Marseille ; mais depuis plus de 30 ans, n'y ayant qu'environ 30 bateaux armés, faute d'avoir de bons patrons, cette pêche n'est allée qu'à 150 quintaux au plus, dont il s'est composé environ 120 caisses de différentes qualités. " (B7, 289). - Mémoire sur le commerce de la Compagnie des Indes en Barbarie, par Laugier de Tassy, 1730. Arch. col. Compagnie d'Afrique, 1681-1731.
(6) On trouvera plus loin, au chapitre 14, la description de la Calle et des autres établissements d'Algérie.
(7) Cf. Description des bâtiments et forts du cap Nègre avec l'état et inventaire des canons, armes et munitions de guerre, qui sont dans ladite place, suivant la visite qui en a été faite, le 21 septembre 1731 et jours suivants, par le sieur Boyer de Saint-Gervais, consul de France à Tunis, et par le sieur Soret, directeur pour la Compagnie d'Afrique audit lieu. Aff étrang. Tunis. - Cet inventaire est très curieux ; on y passe successivement en revue les fortifications, le puits, la buanderie, la cave, les magasins, l'intérieur de la place, le bazar, le corps de garde, la salle d'armes, les casernes, la maison du directeur, le logement du chirurgien, la maistrance, l'église et son clocher, le logement de l'aumônier, l'hôpital. la boulangerie, le moulin, la boucherie, l'écurie, le jardin, la forteresse, le four à chaux, etc. - Plantet, Tunis, II, n° 551.
(8) 19 avril 1726. Plantet. Tunis, II, n° 392. - La même description se trouve textuellement dans Peyssonnel qui l'écrivit le 28 novembre 1724 (Dureau de la Malle. p. 255-56). Taxil et Peyssonnel ont dû copier le même mémoire, rédigé à Tunis, et qui se trouvait sans doute la chancellerie du consulat, à moins que Taxil n'ait copié simplement Peyssonnel.
(9) Cf. Mémoire touchant le commerce du cap Nègre, par Soret, directeur du comptoir, 26 janvier 1731 : " On a des exemples qu'on a fait en une année jusqu'à 100.000 mesures de blé, la mesure pesant environ 280 livres ; il y a actuellement dix ans qu'on n'y fait qu'un très médiocre commerce par les troubles et guerres qu'il y a eu dans le pays. " Arch. colon. Compagnie du Bastion, 1639-1731.
(10) Ces deux arrêts se trouvent aux archives de la Chambre de Commerce de Marseille, II, 48. - On peut remarquer que le nom du Bastion de France n'est plus mentionné dans l'arrêt du 21 novembre. Jusque-là, bien que la Calle fût le principal comptoir depuis 1679, l'ancien usage s'était maintenu et en avait continué à désigner les Concessions sous l'ancien nom du Bastion de France. - Pour la constitution de la Compagnie, voir : Propositions du sieur Jacques Auriol et associés pour se charger de la Compagnie d'Afrique pendant 10 années. Arch. colon. Compagnie d'Afrique 16811731. V. aux arch. des Aff. étrang. Mém. et doc. Afrique, t. V, fol. 137-41.
(11) Dans des mémoires rédigés en 1730 pour discuter l'utilité d'une nouvelle compagnie, on affirme la nécessité pour l'État de conserver les Concessions. Aff. étrang. Mémoire et doc. Alger, t. XIII, fol. 82-97. - L'idée tendait de prévaloir que l'exploitation des Concessions ne pouvait pas être lucrative. L'auteur d'un de ces mémoires, qui reconnaît les fautes commises, soutient que la Compagnie des Indes a fait tout ce qui était possible : " Il ne fallait pas moins que les fonds d'une compagnie aussi puissante pour être en état de soutenir le commerce de ces colonies, avec une perte au-dessus d'un million depuis onze années… une nouvelle compagnie ne durerait pas trois récoltes. "
(12) V. ci-dessus, p. 2.38. - Procuration notariée à Jacques Auriol par les intéressés, Naville. Bourguet, Claude Baguet, Amyot, François Marguerit et Maystre, 27 octobre 1730. Aff. étrang. Concessions d'Afrique. - Le député de Marseille au Conseil du Commerce avait écrit à Maurepas, en octobre 1730, pour essayer de suspendre l'expédition des arrêts du Conseil en faveur de la nouvelle compagnie : " Ceux qui la composent, disait-il, sont la plupart étrangers, tous calvinistes et pas un seul originaire de Provence. Arch. des colonies, Compagnie d'Afrique, 1681-1731. - Jacques Auriol mourut le 6 décembre 1732, mais ses deux frères lui succédèrent parmi les intéressés dans la Compagnie. V. Leur lettre à Maurepas, du 8 octobre 1732. Arch. des colonies, Compagnie d'Afrique, 1732. - Dans une lettre du 2 avril 1731, le dey demanda à Maurepas de remettre dans son poste de commandant du Bastion le nommé Linabéri " homme de probité dont tout le monde ici dit du bien ", qui a été révoqué et remplacé par un certain Masder " homme duquel personne ne dit du bien en ce pays. " Plantet, Alger. Aucun autre document ne nous renseigne sur ces deux personnages, mais cette intervention du dey est intéressante à signaler.
(13) Encyclopédie méthodique. Commerce. V Compagnie d'Afrique, p. 614.Ottoman passé entre le dey d'Alger et le sieur Fénis, 6 juillet 1731. Arch. col. Compagnie d'Attique 1681-1731. Ce document est aussi aux AR étrang. Mém. et Doc. Alger, t. XIII, fol. 123-126.
(14) Plantet, Tunis, t. II, n° 536. - V. la relation de voyage de Tollot, qui accompagnait la Condamine, de l'Académie des Sciences, et passa en Barbarie sur les navires de Duguay-Trouin. - Biblioth. nat. Mss. fr.113333 : Journal de mon voyage au Levant (copie collationnée d'un manuscrit autographe inédit de M. de la Condamine). - Cf. Arch. nat. marine, B7, 311 : Journal de la campagne de 1731. - Ce traité de 1731 était un grand succès, étant donné les Prétentions antérieures des Algériens. Le consul Delane écrivait, en effet, le 22 mai 1731: Les conventions ont été mal observées : sachant positivement que les beys de Bône, peut-être de concert avec le dey d'Alger, ont toujours prétendu que, pourvu que la Compagnie tirât de la ville de Bône deux chargements de grains seulement scion l'usage, ils pouvaient laisser charger à qui bon leur semblait du blé, et, comme on ne l'est pas raidi là-dessus depuis fort longtemps, ils voudront maintenir cet abus. " (Aff étrang. Alger. 1731-35.)
(15) Fénix, au sujet de cet ordre qu'il avait obtenu le 5 juillet 1731, laissa à l'agent de la Compagnie à Alger de curieuses observations : A plusieurs reprises déjà, on avait obtenu du dey contre les Tabarquins des ordres inutiles. Par surprise, le gouverneur de Tabarque avait obtenu du dey la reconnaissance du droit de pêche jusqu'au cap de Rose, moyennant le paiement d'un peu de corail. Fénix avait pu montrer au dey qui il avait été abusé : les Tabarquins avaient le droit de pêcher au cap Roux, dans les mers de Tunis, où ils avaient des magasins, tandis que le cap de Rose était dans les mers d'Alger. Les Tabarquins avaient profité de ce que les deux noms de ces caps ont en Arabe les s lettres pour produire une confusion. Il faudrait s'en défier à l'avenir. Arch. de la Compagnie royale d'Afrique. Recueil de traités. - L'ordre obtenu par Fénix était très impératif; le dey disait, en s'adressant à l'agha et au caïd de Bône : " Nous avons donné au capitaine Fénix les mains et permissions de chasser les bateaux de Tabarque jusqu'à leurs bornes, et, s'il n'a pas de quoi les chasser, vous nous le faites savoir et nous enverrons de nos galiotes pour les prendre et les faire esclaves et ce sera tant pis pour eux qui n'auront pas lieu à se plaindre parce que chacun d'eux a et doit savoir ses limites. Arch. de la Compagnie royale. -Cf. Arch. colon. Compagnie d'Afrique, 1681-1731.
(16) V. Journal de Benoît Lemaire, envoyé du roi à Alger, 2 mars 1732. Aff. étrang. Mém. et doc. Alger, t. XIII, fol. 158-163. Lemaire devait représenter au dey les griefs de la Compagnie et demander l'expulsion du grec de Bône. Il fut accueilli favorablement. Cependant les plaintes de la Compagnie continuèrent. V. ses lettres à Maurepas du 21 novembre, 17 décembre 1732. Arch. colon. Compagnie d'Afrique, 1732-33.
(17) Ibid. n° 553. - V. aux arch. des colonies une série de mémoires et lettres au sujet des démêlés de la Compagnie avec la maison Solicoffre. Mayer et Cie. de Marseille, qui avait cherché à trafiquer dans l'étendue des concessions de la Compagnie. Celle-ci fit condamner la maison Solicoffre à la confiscation de ses bâtiments et à une amende par l'intendant Lebret; l'affaire fut portée au Conseil. Solicoffre et Mayer, sujets suisses, furent appuyés par les sieurs Mottet et Wordaagh, négociants à Amsterdam, à qui appartenait le chargement confisqué et par le consul hollandais à Tunis. Les Hollandais invoquaient le traité d'Utrecht violé, disaient-ils, par le monopole de la Compagnie. Une note de mai 1732 montre que les sollicitations pressantes de l'ambassadeur de Hollande firent rendre le bâtiment confisqué, et décharger la maison Solicoffre de l'amende prononcée contre elle par l'intendant Lebret. Cartons Compagnie d'Afrique. 1681-1731 et 1732-33. Le même dossier renferme une série de lettrés, de la Compagnie à Maurepas, de 1731.
(18) Mémoire pour le corail, joint à la lettre du 3 juillet 1733. Arch. colon. carton Compagnie d'Afrique; 1732-33. Il est étonnant que la Compagnie ait été obligée de solliciter de pouvoir vendre ses coraux à la Compagnie des Indes car, dans un mémoire de 1730, on lit : " Outre les raisons de politique qui demandent que les places soient conservées à la France, la Compagnie des Indes y perdrait beaucoup, si elle n'en était pas la maîtresse, car, s'il fallait qu'elle achetât des Anglais ou des Juifs les coraux dont elle a besoin pour les Indes, elle serait obligée de les payer quatre fois au-dessus de leur valeur. " Arch. colon. carton Compagnies de commerce. n° 12. - Cf. Arch. nat. marine B7, 293 : Mémoire concernant les colonies du cap Nègre et du Bastion de France. 1730.
(19) Soret dans sa lettre à Maurepas, du 14 décembre 1731, se vantait seulement d'avoir fait 30.000livresde bénéfice (Alb. Maire. p. 224). Cependant, d'après un autre document. la perte pour le cap Nègre, en 1731, aurait été de 41.759 livres. Arch. colon. carton Compagnies de commerce, n° 12.
(20) Outre les lettres de Soret publiées par M. Maire, voir aux Archives des colon. cartons Compagnie d'Afrique, 1681-1731, 1732-33. 1734, l'intéressante correspondance de Soret avec Maurepas. - Le consul, de Saint-Gervais, dans ses Mémoires historiques (p. 329) vante la sagesse de la Compagnie dans son commerce des blés : " Satisfaits des profits raisonnables... Ils rejettent avec mépris les gains illégitimes et honteux, que la fureur d'accumuler attend de l'occasion, que fait naître quelquefois la misère publique. "
(21) Arch. des Colonies. Compagnie d'Afrique. 1734-39. - Cf. Plantet. Tunis, nos 634, 654. Vayssettes qualifie cependant ce bey, Hassen ben Hosseïn (1736-54), d'administrateur remarquable (p. 302, année 1868).
(22) Voir les bilans de la compagnie aux arch. des col. Compagnie d'Afrique, 1732-33 et 1734-39. - Mémoire instructif concernant les établissements et le commerce des colonies du Bastion de France et du cap Nègre. Janvier 1732. Aff. étrang. Compagnie d'Afrique.
(23) En outre, la discorde régnait parmi les intéressés comme dans la plupart des compagnies précédentes. V. lettre du 18 mai 1732. Arch. des colon. carton Compagnie d'Afrique, 1732-33. La Compagnie se plaignait aussi de l'hostilité des négociants marseillais qui cherchaient à la faire échouer. Lettre du 6 juin 1732. lbid.
(24) Arch. de la Compagnie royale d'Afrique. Mémoire de 1741. - Dans le même mémoire, on trouve un état des dépenses de la Compagnie Auriol Total = 266.783 livres. Cf. Plantet. Tunis, II, n° 676 et 687. Ces deux documents se complètent l'un par l'autre ; les dépenses totales de la Compagnie en Tunisie ne dépassaient pas 35.000 livres. - V. (arch. de la Compagnie royale d'Afrique) un état des employés, ouvriers... qui sont indispensablement nécessaires au cap Nègre... du 3 mars 1731 : 7 employés, 16 hommes de maistrance, 22 soldats, 21 frégataires, 6 domestiques, soit au total 72 hommes et 6 ou 7 Maures.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A SUIVRE
|
|
| La crevaison
Envoyé Par Chantal
| |
Un automobiliste crève juste devant le mur d'enceinte d'un hôpital psychiatrique.
Il déboulonne la roue, monte la voiture sur le cric, enlève la roue et la remplace par la roue de secours.
Mais au moment de revisser celle-ci, Il s'aperçoit que les quatre écrous ont roulés dans une bouche d'égout qui se trouve à côté.
Il est désemparé et se demande comment il va pouvoir faire pour remonter sa roue ?
Au bout d'un quart d'heure qu'il tourne autour de sa voiture, il entend un rire au-dessus de lui et aperçoit un fou en haut du mur qui se marre comme une baleine.
Il lui dit :
- Ce n'est pas très malin de rire, je ne sais pas comment faire pour repartir !
- Et si vous preniez un écrou de chaque roue, cela ferait trois écrous que vous pourriez mettre sur la roue de secours !
Comme cela toutes les roues auront trois écrous et vous pourrez repartir !
- Hé bien ça alors il fallait le trouver ! Je suis étonné que vous soyez enfermé dans cet asile !
Le fou répond alors :
- On peut être fou sans être C.. !!!
|
|
|
DISTINCTION
Envoyé par M. Jean-Louis Ventura
Bône - Valle di mezzana (Corse)
|
|
"Un Bônois à l’honneur !
Par décret du Président de la République en date du 4 novembre 2011, pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense et des anciens combattants et visé pour son exécution par le chancelier de l'ordre national du Mérite, vu la déclaration du conseil de l'ordre en date du 21 septembre 2011 portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur, sont promus ou nommés, pour prendre rang à compter de la date de leur réception, les militaires appartenant à l'armée active désignés ci-après :
Au grade d'officier
Ventura (Jean, Louis, Nicolas), 30 mai 1951, enseigne de vaisseau de 1re classe. Chevalier du 11 novembre 2003.
La Seybouse et ses lecteurs félicitent notre Ami Jean Louis.
|
|
LA VALISE OU LE CERCUEIL
Un film Documentaire de Charly CASSAN
Envoyé par plusieurs internautes
Ce film documentaire, où des vérités sont dites sans polémique ou esprit de revanche, est un film à voir et à montrer dans toutes les écoles et aussi dans les familles Françaises et pas seulement Pieds-Noirs qui pour la plupart n'ignorent pas ces vérités.
Un très beau cadeau à Offrir ou à montrer à ceux qui ne savent pas !!!
- Pour tout savoir sur cette œuvre exceptionnelle et commander le DVD, cliquez sur : Film la valise ou le cercueil
|
|
|
Rodolphe ORANE
Auteur, Compositeur, Interprête
|
|
NOUVELLES de LÁ-BAS
Envoyées d'Algérie
|
Affaire des «non-jeûneurs»
Hocine, un des deux prévenus, témoigne :
«Je ne jeûne pas, j'assume! »
Hocine Hocini et Sallem Fellak ont été arrêtés le 12 août dernier à Ain El Hammam, une localité de Kabylie, au motif qu’ils n’observaient pas le rituel du ramadan, le mois sacré chez les musulmans. Inculpés pour offense à l’Islam, les deux hommes devront comparaitre le 21 septembre prochain. DNA a enquêté sur cette affaire. Pour la première fois, Hocine ainsi que l’avocat des deux prévenus livrent leurs témoignages. Lire également : Me Mohamed Aït Mimoun, avocat des deux prévenus : « Rompre le jeûne ne constitue pas un délit »
Jeudi 12 août, Hocine Hocini, 44 ans et Sallem Fellak , 34 ans viennent d’achever leur demi-journée de travail sur un chantier appartenant à un privé dans la ville de Ain Al Hammam (ex-Michelet), à 50 kms au sud-est de Tizi-Ouzou. Les deux hommes font une pause pour se désaltérer et déjeuner. Nous sommes au deuxième jour du mois de ramadan, rituel sacré chez les musulmans. Mais Hocine et Salem ne s’en sentent pas concernés. Convertis depuis quelques années au christianisme évangélique, ces deux travailleurs saisonniers n’observent donc pas le carême.
Un policier : « Pourquoi vous ne faites pas le ramadan ? »
Alors que Hocine et Salem déjeunent tranquillement, deux policiers, roulant dans un véhicule à proximité de la maison en construction, arrivent sur les lieux et entrent dans le chantier pourtant clôturé. «Vous ne faites pas carême?», demande un policier aux deux hommes. «Pourquoi vous ne faites pas le ramadan?», insiste-t-il. Hocine finissait de manger son couscous et Salem grillait une cigarette. Décontenancés par le fait que les deux «malotrus» n’observent pas le rituel musulman, les policiers procèdent à leur interpellation. Direction le commissariat de police de la ville située à un jet de pierre du chantier. Joint par téléphone, Hocine, technicien en informatique de gestion, père d’une fille née récemment, accepte de témoigner pour DNA. «Nous avons été surpris au moment du déjeuner dans un chantier qui est, au vu de la loi, un domicile privé, de plus entouré par une clôture», confie-t-il.
L'avocat : «Dès que mes clients divulguent leur confession, les policiers commencent à leur donner des leçons sur le sujet.»
A l’intérieur de la brigade, leur arrestation ne fait pas l’unanimité parmi les agents présents. «Laissez-les tranquilles, maugrée un policier. Ils ne font pas carême ? Et alors !? C’est leur affaire après tout…» Mais des collègues ne l’entendent de cette oreille. Après une heure d’attente, les deux hommes subissent un interrogatoire. Séparément. Au cours de leurs interrogatoires respectifs, Hocine et Salem révèlent devant les éléments de la sureté de daïra de Ain El Hammam qu’ils ne sont pas de confession musulmane mais qu’ils sont plutôt chrétiens. Les policiers tombent des nues. Non musulman, chrétien et bouffeur de carême…Ah la belle affaire ! Devant une telle révélation, les agents de la sureté décident de pousser l’interrogatoire. Doublé d’une leçon de morale. «Dès que mes clients divulguent leur confession, les policiers commencent à leur donner des leçons sur le sujet», explique l’avocat des deux prévenus. En revanche, celui-ci atteste que ses deux clients n’ont pas été maltraités.
Hocine J'ai mangé du couscous...»
Hocine raconte encore : «Lorsque le policier m’a demandé si j’avais rompu le jeûne je lui ai bien précisé que j’ai mangé du couscous que j’avais ramené de ma maison. Une fois l’interrogatoire terminé, le policier m’a mis sous les yeux le procès –verbal d’audience pour la signature. En parcourant le texte, j’ai noté qu’ils ont mentionné « endroit public » pour situer le lieu de notre interpellation. J’ai refusé de signer le document en expliquant aux policiers que nous avons été arrêtés sur un chantier appartenant à un privé et que le chantier était cerné par une clôture. Il ne s’agissait pas donc d’un endroit public, mais privé. Sur ce, ils ont refait le PV. C’est alors que j’ai décidé de le signer. »
Le procureur adjoint : « Ici, nous sommes dans un pays musulman, si vous êtes chrétiens, vous devez changer de pays !»
Au bout de deux heures d’audition, Hocine et Salem sont alors déférés devant le tribunal d’Ain El Hammam. Dans le bureau de la procureur adjoint, ils auront, une fois de plus, droit à une nouvelle leçon de morale. Doublé d’une mise en examen, cette fois-ci. Hocine raconte : « La procureur adjoint nous dit : «Ici, nous sommes dans un pays musulman, si vous êtes chrétiens, vous devez changer de pays!» Devant la procureur-adjoint qui multiplie les admonestations, les deux «casseurs» de jeûne ne se démontent pas. Hocine et Salem assument leur foi chrétienne et revendiquent crânement leur droit de ne pas observer le ramadan. Au bout de quelques minutes d’audition, ils quittent l’enceinte du tribunal avec une inculpation : dénigrement et offense à l’un des préceptes et dogmes de l’Islam. Les deux prévenus sont convoqués devant le juge pour répondre de leur méfait. Le procès est programmé pour mercredi 18 août.
Le procès est reporté au 21 septembre
Mais voila. L’arrestation et l’inculpation de Hocine et Salem ne passent pas inaperçue dans la ville. Aussitôt leur affaire connue, de nombreux citoyens se mobilisent pour apporter leur soutien et leur solidarité aux deux prévenus. Mercredi, jour du procès, des dizaines de personnes se sont présentées devant le tribunal pour observer un sit-in de protestation. Certains amis de Hocine et Salem ont même prévu de s’y rendre dans l’enceinte du tribunal munis de «sandwichs» afin de manifester leur désapprobation. Devant cette mobilisation citoyenne, les magistrats préfèrent ajourner le procès au 21 septembre prochain.
L’avocat : « Rompre le jeûne ne peut pas constituer un fait incriminé, aux yeux de la loi »
Depuis son éclatement, l’affaire des «non-jeûneurs» a pris une dimension internationale. Des pétitions circulent sur le net pour dénoncer une atteinte à la liberté de culte. Associations, intellectuels, ONG ou simples citoyens multiplient les actions pour interpeller les autorités algériennes pour qu’elles veillent au respect des droits de l’homme et des libertés individuelles garanties par la Constitution. Ne pas observer le ramadan dans un pays où l’Islam est religion d’Etat peut-il constituer une infraction, un délit ? Dans un pays ou la Constitution garantit la liberté d’opinion et de conscience des citoyens peuvent-ils jouir de cette liberté sans être interpellés par des agents de la police et traduits devant les tribunaux de la République ? Dans cette affaire, l’avocat de Salem et Hocine est clair : Non seulement l’arrestation et l’inculpation relève d’un vice de procédure mais elles constituent une violation flagrante de la loi fondamentale. «Rompre le jeûne ne peut pas constituer un fait incriminé, aux yeux de la loi, notamment l’article 144 bis 2, explique l’avocat. Car, pour dénigrer l’un des préceptes de l’Islam, c’est plutôt l’offenser ou l’insulter. Rompre le jeûne est un phénomène tout à fait naturel chez une personne qui n’est pas musulmane.»
Hocine et Salem restent sereins. Bien qu’ils ne souhaitent pas donner davantage de publicité à leur affaire, ils affirment assumer jusqu’au bout leur acte. «Nous n’avons commis aucun délit, soutient Hocine. Nous sommes Algériens et Chrétiens et nous avons le droit de pratiquer notre religion comme des citoyens libres.»
Mardi, 05 Octobre 2010, 10:52
Enquête : Slimane Khalfa, Farid Alilat
Lire l'article original : Affaire des «non-jeûneurs» : Hocine, un des deux prévenus, témoigne : «Je ne jeûne pas, j'assume! » | DNA - Dernières nouvelles d'Algérie
Autoroute, hôtels, barrages,
hôpitaux, écoles, logements :
L’empire des Chinois d’Algérie
Elles sont partout et raflent tout. Autoroutes, hôtels, barrages hydrauliques, hôpitaux, transports ferroviaires, écoles, logements et maintenant la Grande Mosquée de Bouteflika. Les entreprises chinoises font main-basse sur les grands projets infrastructurels. Discrets mais très efficaces, les Chinois supplantent désormais Français, Allemands et Américains autant par leur nombre que par leurs parts de marché dans l’économie algérienne.
Dans le courant du mois d’octobre 2011, les Chinois ont réussi deux grands coups. Le premier en décrochant le marché de la Grande mosquée d’Alger, troisième plus grand édifice religieux au monde, confié à la China State construction ENRG (CSCEC), pour un montant d’un milliard d’euros.
Le second est un méga projet de production de matières premières destinées à des médicaments. Si ce projet est encore à l’étude et si son coût n’a pas encore été chiffré, le ministre algérien de la Santé affirme que celui-ci permettra à l’Algérie de devenir à terme « une plaque tournante pour le Moyen-Orient et l'Afrique du nord », en matière de médicaments.
Ces deux projets attestent de la puissance qu’exercent désormais les Chinois sur l’économie algérienne.
Les Chinois sont présents partout
Depuis leur arrivée timide sur le marché algérien au début des années 1980, les entreprises chinoises ont pris du galon tant et si bien qu’aujourd’hui elles sont présentes dans presque tous les grands projets d’infrastructures lancés au début des années 2000.
Le premier grand coup réalisé est le nouvel aéroport international d’Alger. Initié en 1986 mais à l’arrêt pendant plusieurs années faute de ressources financières, le projet de parachèvement du terminal international Houari Boumediene a été confié en 2003 au groupe chinois CSCEC pour un montant de 2,6 milliards de dollars.
Trois années plus tard, le terminal devient opérationnel durant l’été 2006.
CSCEC, un vrai empire
L’appétit venant en mangeant, ce groupe obtiendra la réalisation du nouveau siège du ministère des Affaires étrangères, celui du Conseil constitutionnel, la construction de l’hôtel Sheraton à Alger ainsi que des dizaines de projets de logements sociaux à Alger, Sétif, Annaba, Constantine, Oran.
CSCEC possède aujourd’hui des chantiers dans au moins 35 wilayas en Algérie et collabore avec 300 entreprises locales. Un vrai empire.
Le deuxième grand coup réalisé par les Chinois est le chantier de l’autoroute Est-Ouest longue de 1216 km, présenté comme le projet du siècle en Algérie.
Evalué à 11,4 milliards de dollars, le projet a été confié en 2006 aux groupe japonais COJAAL pour le tronçon Est et au Chinois CITIC/CRCC pour les tronçons Ouest (359 km) et Centre (169 km). Là encore, les chinois ont damé le pion aux grandes entreprises occidentales.
Le montant des projets décrochés par les entreprises chinoises en Algérie au cours de la dernière décennie se chiffre à plusieurs dizaines de milliards de dollars alors que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 4,55 milliards de dollars durant les onze premiers mois de l’année 2010.
A titre indicatif, le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la France, partenaire traditionnel d’Alger, a atteint quelque 10 milliards d’euros en moyenne entre 2009 et 2010.
La présence chinoise en Algérie
On compte aujourd’hui quelque 30 000 ressortissants chinois en Algérie, ce qui constitue la plus forte communauté étrangère dans le pays, loin, très loin des Turcs, des Syriens et autres Français.
D’abord cantonnés dans les bases de vie installées autour des chantiers, les Chinois se sont progressivement affranchis pour investir les villes et ouvrir des commerces. Ce qui n’est pas sans provoquer parfois des conflits avec les Algériens.
Cohabitation difficile
En août 2009, des rixes ont opposées des Chinois à des habitants du quartier de Bab Ezzouar, banlieue est d’Alger. Plusieurs personnes avaient blessées au cours de ces affrontements. C’est peu dire que la cohabitation entre Chinois et Algériens est parfois difficile.
C’est que les Chinois d’Algérie sont souvent victimes de préjugés, voire de racisme. On les accuse de ne pas respecter les coutumes locales, de manger « des chiens et des chats », de boire de l’alcool, de piquer le travail des Algériens.
Les entrepreneurs algériens n'en pensent pas moins quand ils reprochent aux autorités d’ouvrir les portes aux produits «made in china », contrefaits, bon marché ; des produits qui asphyxient, pour ne pas dire tuent, la production locale.
Les Chinois une main d’œuvre corvéable
Pourquoi les Chinois arrivent-ils à damer le pion aux grands groupes occidentaux, pourtant réputés plus solides, plus expérimentés et dont la présence en Algérie est plus ancienne que celle des Chinois ?
Confrontées à un manque criard en matière de grandes infrastructures (routes, hôpitaux, logements…), les autorités algériennes ont lancé depuis le premier quinquennat du président Bouteflika de vaste programmes de constructions publiques dotés d’une enveloppe évaluée à plusieurs centaines de milliards de dollars.
Entre 1999 et 2014, l’Algérie aura ainsi prévu de dépenser plus de 500 milliards de dollars en projets d’investissement.
Pour faire vite, les différents gouvernements algériens ont donc opté pour les entreprises chinoises. Ces dernières ont la réputation d’être efficaces et peu regardantes sur les conditions de travail de leurs employés.
Les groupes chinois ne sont-ils pas les seuls à pratiquer le système 3/8, à savoir trois équipes qui se relayent sans arrêt, de jour comme de nuit?
Les mauvaises langues affirment que certains de ces travailleurs sont des prisonniers de droit commun, condamnés en Chine pour divers délits, mais engagés de force en Algérie pour y effectuer leurs peine dans les chantiers. Toutefois, aucune preuve ne permet d’attester ces allégations.
N’empêche. Les résultats sont là. Les chantiers fleurissent un peu partout sur le territoire national et les projets sont presque livrés à temps. Quand on reproche aux responsables algériens de privilégier les Chinois, ils rétorquent : Mais les Chinois sont bien efficaces, fiables, opérants.
Corruption, l’arme fatale
Certes le sont-ils, mais le recours aux entreprises venues de Chine se justifie également par la corruption.
Certains n’hésitent pas à expliquer la mainmise de ces entreprises par leur disponibilité à graisser la patte, à corrompre, à payer, à soudoyer.
Le meilleur exemple reste celui concernant le scandale de l’autoroute Est-ouest.
Plusieurs responsables civils et militaires – y compris dans l’entourage immédiat du ministre des Travaux Publics, Amar Ghoul – sont actuellement poursuivis par la justice algérienne pour délit de corruption présumée.
Dégoupillée par le DRS, les services secrets algériens, l’affaire touche au cœur même du ministère chargé de la conduite de ce chantier, sans pour autant que le ministre ne soit inquiété par les magistrats instructeurs.
On estime à plus de 200 millions d’euros le montant de pots-de vin versés par les Chinois à des intermédiaires algériens et étrangers pour obtenir le dit marché et pour débloquer le recouvrement des créances détenues auprès des autorités algériennes.
Qui pourrait demain faire barrage aux entreprises chinoises dans leur conquête exponentielle du marché algérien ?
Soumissionnaires à tous les marchés, forts d’une présence humaine évaluée à plus de 30 000 personnes, ayant déjà engrangé un grand capital de confiance auprès des responsables algériens, les groupes chinois sont bien partis pour bâtir un vrai empire en Algérie.
Samedi, 29 Octobre 2011, 20:50
Slimane Khalfa
Lire l'article original : Autoroute, hôtels, barrages, hôpitaux, écoles, logements : L’empire des Chinois d’Algérie | DNA - Dernières nouvelles d'Algérie
|
|
MESSAGES
S.V.P., Lorsqu'une réponse aux messages ci dessous peut, être susceptible de profiter à la Communauté,
n'hésitez pas à informer le site. Merci d'avance, J.P. Bartolini
Notre Ami Jean Louis Ventura créateur d'un autre site de Bône a créé une rubrique d'ANNONCES et d'AVIS de RECHERCHE qui est liée avec les numéros de la seybouse.
Pour prendre connaissance de cette rubrique,
cliquez ICI pour d'autres messages.
sur le site de notre Ami Jean Louis Ventura
--------------------
|
M. Buonomano
Bonjour
Je recherche la date de la grande tempête qu'il y a eu lieu à Bône. Les bateaux avaient été jetés sur les quais.
Je recherche aussi une phto du b^teau du Bachaga Boualem qui avait accosté à Bône.
Merci pour toute votre aide
Cordialement
M. Buonomano
Mon adresse : claire.buonomano@sfr.fr
|
|
DIVERS LIENS VERS LES SITES
M. Gilles Martinez et son site de GUELMA vous annoncent la mise à jour du site au 1er Novembre 2011.
Son adresse: http://www.piednoir.net/guelma
Nous vous invitons à visiter la mise à jour.
Le Guelmois
| |
| L'Inspecteur et le Rabbin
Envoyé par Sauveur
| |
|
Un jeune inspecteur tatillon des Impôts est envoyé pour un contrôle fiscal à la Grande Synagogue de Paris.
Impitoyable, il pose de nombreuses questions au Rabbin :
- Et que faites vous des restes de cire et de bougies ?
- Nous les renvoyons à notre fournisseur qui, une fois l' an, nous offre un paquet de bougies.
- Et les restes de baguettes, toutes ces miettes, qu'en faites-vous ?
- Mais, la même chose, nous les expédions à notre boulanger et une fois l' an, il nous donne gratuitement un pain supplémentaire.
Moqueur, l inspecteur ajoute :
- Et ce qui reste des circoncisions... toutes ces petites peaux... qu'en faites-vous ?
- Mais, comme pour le reste, nous les envoyons aux Impôts et une fois l' an, ils nous envoient un gland ou une tête de no...
|
|